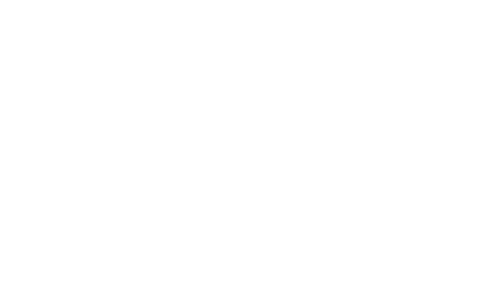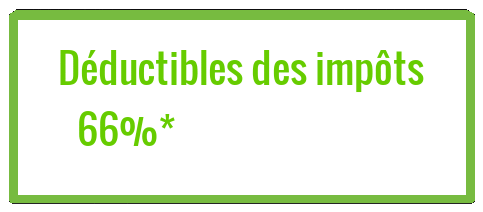Histoire contemporaine
an 2000 : Burundi - Le 28 août 2000 est signé à Arusha, en Tanzanie, sous l'égide de Nelson Mandela un accord de paix.
an 2000 : Congo Kinshasa - En mai-juin 2000 de nouveaux combats rwando-ougandais ont lieu à Kisangani.
an 2000 : Côte d'Ivoire - Laurent Gbagbo, vainqueur des élections de 2000, et porté au pouvoir par les manifestants devant le refus de Guéï de reconnaître le résultat des élections.
Robert Guéï se proclame vainqueur des élections d'octobre 2000, dont la candidature d'Alasaane Ouattara du RDR avait été exclue pour doutes sur la nationalité, ainsi que celle de Bédié pour ne pas avoir consulté le collège médical désigné par le Conseil constitutionnel. Des manifestations mêlant le peuple et l'armée imposent Laurent Gbagbo, dont la victoire électorale est finalement reconnue. Son parti, le FPI, remporte les législatives de décembre avec 96 sièges (98 au PDCI-RDA), le RDR ayant décidé de les boycotter. Le RDR participe aux élections municipales et sort vainqueur dans la majorité des villes, dont Gagnoa, la principale ville du Centre Ouest du pays, région d'origine de Laurent Gbagbo.
an 2000 : Eswatini (Swaziland) - Depuis 2000, le Swaziland réclame plusieurs kilomètres carrés de territoires à l'Afrique du Sud au prétexte qu'ils leur auraient été volés par les colons blancs au XIXe siècle et annexés illégalement à l'Afrique du Sud. Le royaume swazi base sa réclamation sur un engagement du gouvernement sud-africain signé en 1982 par lequel il s'engageait à rétrocéder au Swaziland plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoires sud-africains en échange de la collaboration dans la lutte anti-terroriste du royaume swazi. Ces territoires situés principalement au Mpumalanga et dans le KwaZulu-Natal et concernent les villes de Nelspruit, Malelane, Barberton, Ermelo, Piet Retief, Badplaas et Pongola. En novembre 2006, Mswati III prit la décision de porter l'affaire devant la cour internationale de La Haye
an 2000-2005 : Ghana - Lors de l'élection présidentielle de décembre 2000, Jerry Rawlings approuve le choix de son vice-président, John Atta-Mills, comme le candidat de la décision du NDC, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d’État en 1981, puis élu en 1992 et en 1996, n'a pas de briguer un troisième mandat, selon la constitution. Il quitte le pouvoir à cinquante-trois ans, après une vingtaine d'années durant lesquelles il a joué les premiers rôles. Mais John Kufuor, candidat du Nouveau Parti patriotique (NPP), parti d'opposition, remporte l'élection, et devient le président le 7 janvier 2001, ce résultat marquant une alternance politique. Le vice-président est Aliu Mahama. Kufuor remporte une autre échéance présidentielle en 2004. Pendant quatre ans, il a su préserver une stabilité économique et politique, et réduire l'inflation.
Durant les deux mandats présidentiels de Kufuor, plusieurs réformes sociales sont menées, telles que la réforme du système d'Assurance Nationale de Santé du Ghana. En 2005, est mis en place un programme d'alimentation en milieu scolaire, avec la fourniture d'un repas chaud gratuit par jour dans les écoles publiques et les écoles maternelles dans les quartiers les plus pauvres. Bien que certains projets sont critiqués comme étant inachevés ou non-financés, les progrès du Ghana sont remarqués à l'échelle international.
an 2000-2003 : Guinée-Bissau - Kumba Ialá est élu président en 2000 mais renversé par un coup d'État sans effusion de sang en septembre 2003. D'ethnie ballante, celui-ci était accusé de favoriser sa communauté et s'était discrédité en dissolvant en 2002 l'Assemblée nationale tout en repoussant sans cesse de nouvelles élections législatives. Le coup d'État ne suscita que peu de protestations tant de la part de la population que de la communauté internationale.
an 2000 - 2003 : Libye - En dépit des sanctions occidentales la Libye maintient une politique internationale de tradition panafricaniste. Elle prend en charge l'essentiel des couts de construction d'un satellite de communication africain, s'engage auprès de l'UNESCO à financer le projet de réécriture de l'Histoire générale de l'Afrique, à payer les cotisations des États défaillants auprès des organisations africaines et à briser le monopole des compagnies aériennes occidentales en Afrique à travers la création de la compagnie Ifriqyiah en 2001.
Dans les années 2000, grâce notamment au contexte de la guerre contre le terrorisme suivant les attentats du 11 septembre 2001, suivi en 2003 par l'arrêt du programme nucléaire de la Libye visant à acquérir la bombe atomique, la Libye de Kadhafi connaît un net retour en grâce diplomatique. Elle renoue de bonnes relations avec le monde occidental, qui voit en elle un allié contre le terrorisme islamiste; la lutte contre l'immigration illégale fournit en outre un argument à la Libye pour entretenir des liens d'alliance avec les pays de l'Union européenne, notamment l'Italie, son principal partenaire commercial. Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de Mouammar Kadhafi, fait figure de réformateur au sein du régime, pour le compte duquel il multiplie les contacts dans le monde occidental, ce qui le fait apparaître comme un « ministre des affaires étrangères bis », souvent décrit comme un potentiel successeur de son père.
an 2000-2019 : Iles Maurice - Anerood Jugnauth redevient Premier ministre après les élections de septembre 2000, puis après trois ans, comme convenu, cède son poste à son allié du Mouvement militant mauricien, Paul Bérenger, dirigeant de la principale formation d'opposition de gauche depuis l'indépendance. Paul Bérenger reste Premier ministre pendant moins de deux ans, puis, dans une nouvelle alternance, Navin Ramgoolam revient au pouvoir pendant neuf ans et demi, jusqu'à décembre 2014, passant alors le relais à nouveau à Anerood Jugnauth, jusqu'à janvier 2017. Le 21 janvier 2017, il annonce sa démission lors d'une allocution télévisée. Il est remplacé par son fils, ministre des Finances Pravind Jugnauth. À la lignée des Ramgoolam succède ainsi celle des Jugnauth. Pravind Jugnauth remporte les législatives de 2019.
Le 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution41 demandant au Royaume-Uni de rétrocéder sous six mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos. Ce délai a pris fin le 22 novembre 2019, sans que le Royaume-Uni se conforme à cette résolution, ni à l'avis consultatif formulé en février par la Cour internationale de justice (CIJ) demandant à Londres de mettre fin « dans les plus brefs délais » à son administration des Chagos.
an 2000 : Mayotte - Le 27 janvier 2000, les principaux partis politiques de Mayotte signent « l’accord sur l’avenir de Mayotte » et sur son édification en collectivité départementale.
an 2000-2005 : Ouganda - En mars 2001, Museveni fut réélu dès le premier tour avec 69,3 % des voix alors que son rival Kizza Besigye en obtint 27,8 %.
Malgré un referendum similaire ayant eu lieu en 2000, lors duquel un retour au multipartisme avait été rejeté par 90,7 % des votants, un nouveau referendum, organisé en juillet 2005, vit la population approuver à 92,5 % un abandon du système sans partis pour un retour au multipartisme.
an 2000 : Réunion (Ile de la) - un projet de bidépartementalisation de La Réunion est abandonné.
an 2000 : Rwanda - Après la prolongation de la période de transition, plusieurs changements de premiers ministres, la démission du président de l'assemblée nationale, Pasteur Bizimungu démissionne en 2000. Paul Kagame est élu président de la République par l'assemblée nationale de transition.
an 2000 : Sénégal - Mars 2000 : Le président sortant, Abdou Diouf, est battu au deuxième tour des élections présidentielles par Abdoulaye Wade. L’arrivée au pouvoir de Me. Wade met un terme à 40 ans de pouvoir du Parti Socialiste. Porté par son slogan “SOPI” (“changement” en wolof), l’opposant de longue date Abdoulaye Wade, chef de file du Parti démocratique sénégalais, remporte l’élection présidentielle du 19 mars 2000, avec 58,5% des suffrages au second tour, devant le président sortant Abdou Diouf.
Le 9 décembre 2000 le Sénat et le Conseil économique et social sont supprimés.
an 2000 - 2006 : Swaziland (Estwatini) - Depuis 2000, le Swaziland réclame plusieurs kilomètres carrés de territoires à l'Afrique du Sud au prétexte qu'ils leur auraient été volés par les colons blancs au XIXe siècle et annexés illégalement à l'Afrique du Sud. Le royaume swazi base sa réclamation sur un engagement du gouvernement sud-africain signé en 1982 par lequel il s'engageait à rétrocéder au Swaziland plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoires sud-africains en échange de la collaboration dans la lutte anti-terroriste du royaume swazi. Ces territoires situés principalement au Mpumalanga et dans le KwaZulu-Natal et concernent les villes de Mbombela (ex-Nelspruit), Malelane, Barberton, Ermelo, Piet Retief, Badplaas et Pongola. En novembre 2006, Mswati III prit la décision de porter l'affaire devant la cour internationale de La Haye.
an 2000-2003 : Somalie - Le 26 août 2000, le Parlement de transition en exil élit un nouveau président en la personne de Abdiqasim Salad Hassan, dans un contexte particulièrement difficile. Le pays reste aux prises avec des rivalités claniques. Après diverses tentatives infructueuses de conciliation, une conférence de réconciliation aboutit en juillet 2003 à un projet de charte nationale prévoyant le fédéralisme et mettant sur pied des institutions fédérales de transition.
an 2000-2003 : Togo - Le président s'était engagé à dissoudre l'Assemblée nationale et à organiser des élections législatives en mars 2000 pour que d'autres formations politiques puissent entrer au Parlement. Il s'était aussi engagé à respecter la Constitution et à ne pas se présenter pour un troisième mandat. Mais ces promesses ne sont pas tenues. Le général Gnassingbé Eyadema et son parti modifient par la suite le code électoral et la constitution que le peuple togolais avait massivement adoptés en 1992, pour lui permettre de faire un troisième mandat, lors des élections de 2003. Le président Gnassingbé Eyadema est donc réélu en juin 2003 pour un nouveau mandat de cinq ans. La Commission électorale annonce que Eyadéma, détenteur du record de longévité politique à la tête d'un État africain, a réuni 57,2 % des suffrages lors du scrutin.
an 2000 : Zambie - Le gouvernement suit les recommandations du Fonds monétaire international (FMI) et privatise de nombreuses entreprises, dont celles du cuivre, principale ressource du pays, et les compagnies aériennes. Au début des années 2000, la poursuite du programme de privatisation provoque des licenciements massifs et une hausse de la pauvreté.
an 2000 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En février 2000, les occupations de terres par des paysans noirs et d'anciens combattants de la guerre d’indépendance se multiplient. Quelque 4 000 propriétaires possèdent alors plus d'un tiers des terres cultivables dans les zones les plus fertiles, sous forme de grandes exploitations commerciales, tandis que plus de 700 000 familles paysannes noires se partagent le reste sur des « terres communales » beaucoup moins propices à la culture. Les propriétaires blancs avaient continué de s'enrichir pendant les vingt années ayant suivi la chute du régime ségrégationniste, attisant le ressentiment d'une partie de la population noire dans un contexte de crise économique et de montée du chômage. Le président zimbabwéen, qui les avait jusqu'alors défendu, vit mal leur soutien à la nouvelle formation de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique. Dépassé par le mouvement d'occupation de terres, Mugabe tente de sauver la face en officialisant les expropriations et en installant sur les terres réquisitionnées des proches du régime, officiellement anciens combattants de la guerre d’indépendance. Ceux-ci n’ont cependant pas les connaissances ni le matériel nécessaires pour cultiver leurs lopins et beaucoup de terres restent en friches. Des dizaines de milliers d'ouvriers agricoles perdent leur emploi et la production chute.
an 2001 : Bénin (anc. Dahomey) - Depuis 2001, le Bénin est plongé dans de graves difficultés économiques, en raison de la situation difficile du port autonome de Cotonou, du choc pétrolier, de la crise du secteur du coton, de la contrebande très étendue, des effectifs pléthoriques de l'administration ou encore des sérieux problèmes d'approvisionnement en électricité créés par les sécheresses. Le Bénin est dans une période économique difficile que seule l'agriculture, relativement diversifiée parvient à maintenir compétitif face à ses voisins.
an 2001 : Burundi - L'Afrique du Sud envoie 700 militaires pour veiller à la mise en place de l'accord et assurer la sécurité des membres de l'opposition de retour d'exil. Le 10 janvier 2001, une assemblée nationale de transition est nommée et son président est Jean Minani, président du Frodebu. L'accord d'Arusha entre en vigueur le 1er novembre 2001 et prévoit, en attendant des élections législatives et municipales pour 2003 et présidentielles pour 2004, une période de transition de 3 ans avec pour les 18 premiers mois, le major Buyoya à la présidence et Domitien Ndayizeye du Frodebu au poste de vice-président avant que les rôles ne soient échangés. L'alternance prévue est respectée par Pierre Buyoya qui cède le pouvoir au bout de dix-huit mois. Les différents portefeuilles du gouvernement sont partagés entre Uprona et Frodebu. Le 4 février 2002, le Sénat de transition élit l'uproniste Libère Bararunyeretse à sa présidence.
Malgré les critiques du comité de suivi des accords d'Arusha à l'encontre du gouvernement, en particulier en ce qui concerne la modification de la composition ethnique de l'armée et de l'administration, c'est-à-dire un rééquilibrage ethnique de ces deux institutions, l'exécutif Hutu-Tutsi fonctionne.
an 2001 : Cap Vert - En 2001, Pedro Pires, du PAICV est élu président contre Carlos Veiga, du MPD avec une majorité de 12 voix seulement. Tous deux avaient exercé précédemment la charge de premier ministre.
an 2001 : République de Centrafrique - Si les accords de Bangui de janvier 1997 semblent mettre un terme aux conflits et le scrutin présidentiel de 1999 ouvre la voie d'un deuxième mandat à Ange-Félix Patassé, en 2001, l’ancien président André Kolingba tente un coup d’État contre le président Patassé le 28 mai 2001 que seule l’intervention de la Libye et des combattants du Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba permet de contrer.
La tentative de coup d'État provoque de violents affrontements dans la capitale, Bangui.
De nouvelles périodes de troubles suivront et le général François Bozizé, ancien chef d’état-major des forces armées centrafricaines, est impliqué dans un putsch avorté en mai 2001 contre le président Patassé et doit fuir au Tchad le 9 novembre 2001.
an 2001 : Congo Kinshasa - Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné par un de ses gardes du corps. Son fils Joseph Kabila est désigné par le gouvernement pour assurer l'intérim (en attendant « le rétablissement du blessé », que tous savent pourtant déjà décédé). Kinshasa reconnaît enfin le décès de Laurent-Désiré Kabila le 18 janvier.
Joseph Kabila, proclamé chef de l'État, prête serment le 26 janvier et appelle à des négociations pour la paix. À Gaborone, s'ouvre une réunion préparatoire au Dialogue intercongolais : celui-ci ne s'ouvrira officiellement à Addis-Abeba que le 15 octobre, et les négociations continuent sans mettre réellement fin au désordre.
En février 2001, un accord de paix est signé entre Kabila, le Rwanda et l'Ouganda, suivi de l'apparent retrait des troupes étrangères. Les troupes de maintien de la paix de l'ONU, la MONUC, arrivent en avril, afin de soutenir les difficiles efforts de paix ou au moins soutenir le cessez-le-feu, protéger les populations et les organisations humanitaires prêtant assistance aux nombreux réfugiés et déplacés.
an 2001-2004 : Erythrée - En l'état actuel, le président de l’Érythrée est en fonction ad intérim et n’a pas été élu. L’Assemblée nationale compte 104 membres sont 60 sont nommés et 44 représentent les membres du Comité central du Front populaire pour la démocratie et la justice.
Des élections étaient prévues en 1997, puis reportées en 2001 avant d’être ajournées sans date précise avec pour raison avancée l’occupation de 20 % du territoire érythréen par l’Éthiopie. Des élections régionales ont lieu périodiquement, les dernières en mai 2003.
Le directeur du bureau du Président, Yemane Ghebremeskel, a annoncé en 2004 l’ouverture au pluripartisme et des élections nationales, sans précision quant à la date.
an 2001-2002 : Gambie - Vers la fin de l'an 2001 et au début 2002, la Gambie termine un cycle complet d'élections présidentielles, législatives et locales, que les observateurs étrangers jugent libres, justes et transparentes, malgré quelques lacunes. Réélu, le président Yahya Jammeh, installé le 21 décembre 2001, conserve un pouvoir obtenu à l'origine par un coup d'État. Son parti, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), conserve une large majorité à l'Assemblée nationale, en particulier après que la principale force d'opposition Parti démocratique unifié (UDP) a boycotté les élections législatives.
an 2001 - 2002 : Madagascar - Le résultat de l'élection de décembre 2001 est contesté entre Didier Ratsikara et Marc Ravalomanana, maire de Tananarive. Marc Ravalomanana devient président à l'issue d'une crise politique qui dure tout le premier semestre 2002. Sous prétexte de controverse sur les résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 16 décembre 2001, Marc Ravalomanana se fait proclamer vainqueur au premier tour, puis est installé Président de la République le 22 février 2002. Un recomptage des voix prévu par les Accords de Dakar permet d’attribuer officiellement à Marc Ravalomanana la victoire au premier tour qu’il revendiquait. Didier Ratsiraka quitte Madagascar en juillet 2002 pour la France et l'élection de Marc Ravalomanana est reconnue par la France et les États-Unis.
an 2001-2002 : Mali - Le 1er septembre 2001, Amadou Toumani Touré, dit ATT, demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l’armée pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle. Il est élu président du Mali en mai 2002 avec 64,35 % des voix au second tour. Son adversaire Soumaïla Cissé, ancien ministre, obtient 35,65 % des voix. Il nomme Ahmed Mohamed ag Hamani comme premier ministre en le chargeant de réunir un gouvernement de grande coalition.
an 2001 : Mayotte - Le 11 juillet 2001, une nouvelle consultation électorale approuve à 73 % la modification du statut de l'île qui change pour un statut assez proche de celui des départements d'outre-mer : une collectivité départementale d'outre-mer. Le 28 mars 2003, la constitution française est modifiée et le nom de Mayotte est énuméré dans l'article 72 concernant l'outre-mer.
an 2001-2004 : Mozambique - En 2001, Joaquim Chissano indique qu'il ne se présente pas une troisième fois,. Armando Guebuza lui succède à la tête du FRELIMO, et remporte encore les élections de décembre 2004.
an 2001 : Namibie - En 2001, la crise de la réforme agraire se poursuit, en dépit d'un nouvel impôt foncier. Le président Samuel Nujoma s'en prend aussi aux homosexuels, accusés d'être les responsables de la propagation du sida qui ravage le pays.
En politique étrangère, les forces de sécurité namibiennes participent en Angola à la lutte contre l'UNITA. Au côté de l'armée du Zimbabwe, l'armée namibienne est impliquée militairement au Congo-Kinshasa en faveur du régime de Laurent-Désiré Kabila puis de son fils Joseph.
an 2001 : Sénégal - En 2001 une nouvelle constitution réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans.
L’Assemblée nationale – au sein de laquelle le Parti socialiste est majoritaire – est dissoute le 5 février 2001.
25 formations politiques sont autorisées à participer aux élections législatives anticipées.
Pour la première fois au Sénégal, un parti écologiste, Les Verts, entre en lice dans une consultation électorale, mais n’obtient aucun siège.
Suite à la démission de Moustapha Niasse, la juriste Mame Madior Boye est la première femme à occuper les fonctions de Premier ministre dans le pays, du 3 mars 2001 au 4 novembre 2002.
Les élections législatives du 12 mai 2001 voient la victoire de la coalition Sopi proche du président Wade, ce qui permet à 9 nouveaux ministres d’entrer au gouvernement, renforçant ainsi le poids du PDS.
Quelques jours plus tard, 10 partis d’opposition s’unissent pour créer un « Cadre permanent de concertation » (CPC).
Le 25 août 2001 : 25 partis créent cette fois une structure de soutien à l’action du président Wade : « Convergence des actions autour du Président en perspective du 21e siècle » (CPC).
an 2001 : Somaliland (ou Somalie Britannique) - En mai 2001, l'indépendance est entérinée par un référendum qui remporte 97,1% de oui
an 2002-2020 : Canaries (Îles) -
Catastrophes naturelles : inondations de Ténérife de 2002 (es), tempête tropicale Delta (2005), incendies de forêt de 2007 (es), inondations à Ténérife en 2010 (es), éruption volcanique d'El Hierro en 2011 (éruption sous-marine du 10 octobre 2011 au 5 mars 2012).
Le 29 septembre 2019, l'île de Tenerife (environ 900 000 habitants) subit une panne générale d'électricité de presque une journée, due à une panne encore inexpliquée de générateur de centrale thermique. Le 15 juillet 2020, une panne plusieurs heures se produit de nouveau à Tenerife.
En 2002, les commandements militaires (Mando de Canarias (MCANA), Mando Naval de Canarias (ALCANAR) et Mando Aéreo de Canarias (MACAN)) sont réunis en un unique Commandement conjoint des îles Canaries (es) (MACOCAN).
Vers 2010, les îles Canaries ont une population d'environ 2 000 000 habitants.
Depuis 2010, l'archipel est un des lieux de la crise migratoire en Europe, se trouvant au croisement de la route méditerranéenne occidentale et de la route de l'Afrique de l'Ouest.
Après des débats intenses et des blocus partisans, un nouveau statut d'autonomie est établi en 2018 pour les îles Canaries.
an 2002-2009 : Congo Brazzaville - En 2002 est adopté une nouvelle constitution supprimant le poste de Premier ministre, renforçant les pouvoirs du président de la République. Le président est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. La même année a lieu l'élection du président de la République : Denis Sassou-Nguesso est reconduit à ce poste. Le septennat de Denis Sassou-Nguesso de 2002 à 2009 est marqué par le retour à la paix civile, même si des troubles subsistent dans l'Ouest du Pool. La flambée des cours du pétrole enrichit considérablement l'État, dont le budget annuel dépasse pour la première fois les 100000 milliards de francs CFA. De nombreux projets de construction d'infrastructures sont entrepris (port de Pointe-Noire, autoroute Pointe-Noire - Brazzaville...) en coopération avec des États et entreprises étrangers (France, Chine...).
an 2002 : Congo Kinshasa - Le conflit éclate à nouveau en janvier 2002 à la suite d'affrontements entre des groupes ethniques dans le Nord-est ; l'Ouganda et le Rwanda mettent alors fin au retrait de leurs troupes et en envoient de nouvelles. Des négociations entre Kabila et les chefs rebelles aboutissent à la signature d'un accord de paix par lequel Kabila devra désormais partager le pouvoir avec les anciens rebelles.
Le 15 février 2002 s'ouvre réellement en Afrique du Sud le Dialogue intercongolais : l'accord de paix est signé à Prétoria en décembre; le Dialogue sera clôturé en avril 2003.
an 2002 : Côte d'Ivoire - Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles tentent de prendre le contrôle des villes d’Abidjan, Bouaké et Korhogo. Ils échouent dans leur tentative en ce qui concerne Abidjan mais sont victorieux dans les deux autres villes, situées respectivement dans le centre et le nord du pays. Robert Guéï est assassiné dans des circonstances non encore élucidées. La rébellion qui se présente sous le nom MPCI crée plus tard le MJP et le MPIGO et forme avec ces dernières composantes le mouvement des Forces nouvelles (FN). Il occupe progressivement plus de la moitié nord du pays (estimée à 60 % du territoire), scindant ainsi le territoire en deux zones : le sud tenu par les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et le nord tenu par les Forces armées des forces nouvelles (FAFN).
Les pourparlers entamés à Lomé permettent d’obtenir le 17 octobre 2002, un accord de cessez-le-feu qui ouvre la voie à des négociations sur un accord politique entre le gouvernement et le MPCI sous l’égide du président du Togo, Gnassingbé Eyadema. Ces négociations échouent cependant sur les mesures politiques à prendre, en dépit de réunions entre les dirigeants de la CEDEAO à Kara (Togo), puis à Abidjan et à Dakar. 10 000 casques bleus de l’ONUCI98 dont 4 600 soldats français de la Licorne sont placés en interposition entre les belligérants.
an 2002-2005 : Kenya - En août 2002, le Président Moi — qui constitutionnellement ne peut plus être élu ni président, ni député — surprend tout le monde en annonçant qu'il soutient personnellement la candidature du jeune et inexpérimenté Uhuru Kenyatta — un des fils de Jomo Kenyatta — dans la course à la présidence lors des élections de décembre. En opposition totale avec les vues de Moi, des membres importants du cartel KANU-NDP tels Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, George Saitoti et Joseph Kamotho rejoignent le Liberal Democratic Party (LDP). Pour contrer le dessein de Moi, le LDP, dont Raila a pris la tête, fait alliance avec le National Alliance Party of Kenya (NAK), le Democratic Party (en) (DP), le Forum for the Restoration of Democracy-Kenya (FORD-K) et le National Party of Kenya (NPK). Cette alliance appelée National Rainbow Coalition (NARC) pousse la candidature de Mwai Kibaki le prétendant du DP au poste de président de la République.
Mwai Kibaki gagne largement l'élection présidentielle du 27 décembre avec 62,2 % des suffrages devant Uhuru Kenyatta (31,3 %) et trois autres candidats. Le LDP de Raila Odinga devient le premier parti politique du pays avec 59 sièges de députés à l'Assemblée nationale.
Présidence de Mwai Kibaki - Entre 2002 et 2005, une équipe de constitutionnalistes rédigent au Bomas of Kenya, un texte portant révision de la Constitution. Ce texte, connu sous le nom de Bomas Draft, limite, entre autres, les pouvoirs du président de la République et crée un poste de Premier ministre. En 2005, Mwai Kibaki rejette ce texte et présente un texte de réforme donnant plus de pouvoirs politiques au chef de l'État. Ce texte connu sous le nom de Wako Draft est soumis le 21 novembre 2005, à un référendum national et rejeté par 58,12 % des votants. En réaction, le président Kibaki congédie l'intégralité du gouvernement deux jours après le résultat du référendum et, deux semaines plus tard, forme un nouveau gouvernement qui ne comporte plus aucun membre du LDP.
C'est à ce moment que Raila Odinga décide d'être candidat à l'élection présidentielle de décembre 2007 et crée son propre parti politique : l′Orange Democratic Movement (ODM). Son symbole est une orange en référence au symbole visuel qui représentait le « non » lors du référendum (le « oui » était imagé par une banane)
an 2002 : Nigéria - Depuis 2002 et plus particulièrement depuis 2009, le gouvernement nigérian est confronté, au nord-est du pays, au mouvement terroriste Boko Haram. Ce mouvement salafiste, prônant un islam radical et rigoriste, est à l'origine de nombreux attentats et massacres à l'encontre des populations civiles.
an 2002-2004 : Rwanda - En 2002, l'armée rwandaise quitte officiellement la République démocratique du Congo (Zaïre de 1971 à 1997). Toutefois, dès le début de 2003, le troupes rwandaises envahissent de nouveau l'est de la RDC, et ne commencent à être évacuées que six mois plus tard, après l'envoi de casques bleus. Le 1er juin 2004, les troupes rwandaises et leurs alliés rwandophones occupent la ville de Bukavu, dans le sud du Kivu, mais, dès le
8 juin, les pressions de l'ONU contraignent les troupes à se retirer. Le mouvement RDC-Goma reste armé et soutenu par Kigali.
Malgré les immenses difficultés pour reconstruire le pays qui ont marqué la période de transition, la pression de la communauté internationale aidant, le pouvoir rwandais prépare une constitution et des élections au suffrage universel pour 2003. À tort ou à raison, la crainte manifestée par certains rescapés tutsi de voir le pouvoir à nouveau entre les mains de supposés proches des génocidaires est réveillée. Des intimidations de candidats et d'électeurs, afin qu'ils votent pour le pouvoir en place, sont remarquées.
En 2002, accusé de corruption, l'ancien président de la république, Pasteur Bizimungu, est arrêté et mis en prison. Il est accusé d'avoir constitué un parti politique d'opposition non autorisé par les accords d'Arusha (qui limitaient les partis à ceux qui les avaient signés), de malversations financières et d'avoir publié un article où il manipule les concepts « hutu/tutsi ». Il est condamné à quinze ans de prison. Des associations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, voient en M. Bizimungu un « prisonnier d'opinion », incarcéré pour son opposition au président Kagame plutôt que pour les motifs officiellement invoqués53. Le MDR, signataire des accords d'Arusha, accusé d'abriter en son sein un courant idéologique génocidaire, est dissous par les députés. Une association des droits de l'homme est aussi menacée pour les mêmes raisons. La rigueur qui paraissait excessive chez Paul Kagame est guidée par le fait que la paix intérieure du Rwanda demeurait très fragile à l'époque.
C'est dans ce climat de suspicion de « division » que se déroulent les élections en 2003.
an 2002 : Sénégal - Le 15 février 2002 : la création d’une Commission électorale nationale autonome (CENA) est décidée, en remplacement de l’Observatoire national des élections (ONEL). Elle prendra ses fonctions en 2005.
Le 26 septembre 2002 : le Sénégal vit une tragédie nationale avec le naufrage du Joola, le ferry qui reliait Dakar à Ziguinchor en Casamance. Plus de 1 800 passagers y perdent la vie. Les négligences constatées suscitent un forte rancœur à l’égard des pouvoirs publics. La région, déjà affectée par son enclavement, perd sa liaison maritime pendant trois ans et l’île de Karabane, ancienne escale, ne peut plus compter que sur les pirogues. Ce drame n’est pas sans conséquences sur la carrière de Mame Madior Boye qui est remplacée par Idrissa Seck, maire de Thiès et numéro deux du Parti démocratique sénégalais (PDS).
Seck sera Premier ministre du 4 novembre 2002 au 21 avril 2004. Son ministre de l’Intérieur Macky Sall lui succède lorsqu’il tombe en disgrâce en raison de ses responsabilités dans la gestion des chantiers de Thiès et peut-être de ses ambitions nationales.
an 2002-2004 : Sierra Leone - Le 14 mai 2002, le président sortant, Ahmad Tejan Kabbah, est réélu avec 70,6 % des voix.
Le pays est désormais en paix, après 10 ans d'une guerre civile atroce. Les différentes mesures prises par l'ONU sont progressivement réduites, voire supprimées, comme l'atteste la levée de l'embargo sur les exportations de diamants du sang. De même, les effectifs de la MINUSIL (casques bleus) sont diminués. Après un pic de 17 500 hommes en mars 2001, les effectifs sont ramenés à 13 000 en juin 2003 et à 5 000 en octobre 2004.
Cependant, pour des raisons économiques, de nombreux enfants travaillent toujours dans les mines de diamants, qui sont très dangereuses. La propagation du SIDA chez eux est également très importante : 16 000 enfants de moins de 15 ans sont séropositifs.
an 2002 : Somaliland (ou Somalie Britanique) - 3 mai 2022 : Mort de Mohamed Ibrahim Egal élu président en 1993 et réélu en 1998. Son 2e mandat n'est pas terminé, Dahir Riyale Kahin, le vice-président, prend donc les fonctions de président jusqu'aux prochaines élections.
an 2002 : Zambie - En 2002, en raison de la sécheresse, la famine menace trois millions de personnes.
Après avoir tenté de faire amender la Constitution qu'il a lui-même promulguée afin de briguer un troisième mandat, Chiluba, face aux protestations populaires, doit céder la place en janvier 2002 à son vice-président et successeur désigné, Levy Mwanawasa, qui est élu président, au cours d’un scrutin contesté. Le Parlement vote à l'unanimité la levée de l'immunité de l'ancien président Chiluba qui est mis en examen au titre d'une soixantaine d'inculpation concernant principalement des détournements de fonds. Les charges seront levées en 2009.
an 2002 - 2003 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
Mugabe est désavoué lors d’un référendum sur une réforme constitutionnelle. En 2002, il gagne l’élection présidentielle lors d’un scrutin dont l’honnêteté est contestée. En 2003, une grave crise agraire et politique éclate à la suite de l’expropriation par Mugabe des fermiers blancs. Une crise politique survient quand les mouvements d’opposition comme la MDC sont réprimés et les élections truquées. À la suite d'une campagne intensive des mouvements des droits de l’Homme, des Britanniques et de l’opposition, le Commonwealth impose des mesures de rétorsion contre les principaux dirigeants du Zimbabwe. Au sein du Commonwealth, Mugabe reçoit cependant le soutien de plusieurs pays africains et dénonce des mesures prises à l’instigation des pays « blancs » (Canada, Grande-Bretagne, Australie). L’opposition locale du MDC est réprimée.
an 2003 : Burundi - le 7 juillet 2003, les forces hutu des CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie), en coalition avec le PALIPEHUTU-FNL (Parti pour la libération du peuple hutu-Forces de libération nationale) attaquent Bujumbura.
40 000 habitants fuient la capitale. Un accord de paix (protocole de Pretoria) est néanmoins signé le 15 novembre 2003 entre le président Ndayizeye et le chef des CNDD-FDD. La principale branche de la rébellion (CNDD-FDD) entre au gouvernement, au sein duquel elle détient quatre ministères et dispose également de postes de haut rang dans les autres institutions, conformément à l'accord d'Arusha.
an 2003 : République de Centrafrique - Après une nouvelle série de troubles et malgré l'intervention de la communauté internationale (MINURCA). Malgré l'intervention de la communauté internationale, Ange-Félix Patassé est finalement renversé le 15 mars 2003 par François Bozizé grâce à une rébellion dont l'élément central est constituée par plusieurs centaines de « libérateurs », qui sont souvent d’anciens soldats tchadiens ayant repris du service avec l’assentiment d’Idriss Déby. Une bonne partie des « libérateurs » retournera au Tchad en 2003 ou 2004, d'autres intégreront les forces de sécurité ou se reconvertiront dans le commerce sur le grand marché PK5
Le 15 mars 2003, le général François Bozizé réussit, avec l'aide de militaires français (deux avions de chasse de l'armée française survolaient Bangui pour filmer les positions des loyalistes pour le compte de Bozizé) et de miliciens tchadiens (dont une bonne partie va rester avec lui après son installation au pouvoir), un nouveau coup d'État et renverse le président Patassé. Le général Bozizé chasse alors les rebelles congolais, auteurs de méfaits et crimes innombrables, notamment dans et autour de Bangui.
Toutefois, le coup d’État de François Bozizé, en 2003, a déchaîné un cycle de rébellion dans lequel le pays est toujours plongé en 2019.
an 2003 : Congo Kinshasa - Le 4 avril 2003, la Cour d'ordre militaire (COM), condamne, sans convaincre, 30 personnes à mort pour l'assassinat de Laurent Kabila.
La même année se met en place le gouvernement de transition « 4+1 » (quatre vice-présidents et un président) : Abdoulaye Yerodia Ndombasi (PPRD), Jean-Pierre Bemba (MLC), Azarias Ruberwa (RCD), Arthur Z'ahidi Ngoma (société civile), ainsi que Joseph Kabila (PPRD).
En juin 2003, l'armée rwandaise est la seule de toutes les armées étrangères à ne pas s'être retirée du Congo. L'essentiel du conflit était centré sur la prise de contrôle des importantes ressources naturelles du pays, qui incluent les diamants, le cuivre, le zinc, et le coltan.
an 2003 : Afrique Côte d'Ivoire - Dans une nouvelle initiative, la France abrite à Linas-Marcoussis du 15 au 23 janvier 2003, sous la présidence de Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel français, secondé par le juge sénégalais Kéba Mbaye, une table ronde avec les forces politiques ivoiriennes et obtient la signature des accords de Linas-Marcoussis. Cet accord prévoit la création d’un gouvernement de réconciliation nationale dirigé par un premier ministre nommé par le Président de la République après consultation des autres partis politiques, l’établissement d’un calendrier pour des élections nationales crédibles et transparentes, la restructuration des forces de défense et de sécurité, l’organisation du regroupement et du désarmement de tous les groupes armés, le règlement des questions relatives à l’éligibilité à la présidence du pays et à la condition des étrangers vivant en Côte d’Ivoire. Un comité de suivi de l’application de l’accord, présidé par l’ONU, est institué.
an 2003 : Guinée - Après avoir révisé la Constitution pour pouvoir se présenter une troisième fois en décembre 2003, le chef de l'État, pourtant gravement malade, est réélu avec 95,63 % des suffrages face à un candidat issu d'un parti allié, les autres opposants ayant préféré ne pas participer à un scrutin joué d'avance.
an 2003 : Libéria - Les combats s'intensifient, les rebelles encerclent progressivement dans la capitale les forces de Charles Taylor, le risque d'une tragédie humanitaire se profile à nouveau. Le 8 juillet 2003, le Secrétaire général décide de nommer Jacques Paul Klein (États-Unis) comme son Représentant spécial pour le Liberia. Il lui confie la tâche de coordonner les activités des organismes des Nations unies au Liberia et d'appuyer les nouveaux accords. Le 29 juillet 2003, le Secrétaire général décrit le déploiement en trois phases des troupes internationales au Liberia, aboutissant à la création d'une opération de maintien de la paix pluridimensionnelle des Nations unies (S/2003/769). La nomination de Jacques Paul Klein et la création d'une opération des Nations unies au Liberia mettent fin au mandat du BANUL. La situation au Liberia évolue ensuite rapidement. Le 1er août 2003, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1497 (2003): autorisation de la mise en place d'une force multinationale au Liberia et d'une force de stabilisation de l'ONU déployée au plus tard le 1er octobre 2003. Parallèlement, le 18 août 2003, les parties libériennes signent à Accra un accord de paix global, dans lequel les parties demandent à l'Organisation des Nations unies de déployer une force au Liberia, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Celle-ci est chargée d'appuyer le Gouvernement transitoire national du Liberia et de faciliter l'application de cet accord. Grâce au déploiement ultérieur de la Mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Liberia, la situation en matière de sécurité dans le pays s'améliore.
Les événements aboutissent à la création de la Mission des Nations unies au Liberia (MINUL), à la démission de Charles Taylor, le 11 août et à une passation pacifique des pouvoirs.
Le Secrétaire général recommande que le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, autorise le déploiement d'une opération de maintien de la paix des Nations unies dotée d'effectifs d'un maximum de 15 000 hommes, dont 250 observateurs militaires, 160 officiers d'état-major et un maximum de 875 membres de la police civile, 5 unités armées constituées supplémentaires fortes chacune de 120 personnes, ainsi que d'une composante civile de taille appréciable et du personnel d'appui requis. La Mission des Nations unies au Liberia comporte des volets politiques, militaires, concernant la police civile, la justice pénale, les affaires civiles, les droits de l'homme, la parité hommes-femmes, la protection de l'enfance, un programme « Désarmement, Démobilisation, Réinsertion », ainsi que, le moment venu, un volet électoral. Elle comporte un mécanisme de coordination de ses activités avec celles des organismes humanitaires et de la communauté du développement. Elle agit en étroite coordination avec la CEDEAO et l'Union africaine. Afin d'assurer une action coordonnée des Nations unies face aux nombreux problèmes de la sous-région, la Mission doit travailler également en étroite collaboration avec la Mission des Nations unies en Sierra Leone (MINUSIL), la Mission des Nations unies en Côte d'Ivoire (MINUCI) et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest.
Dans son rapport, le Secrétaire général fait observer que la passation des pouvoirs du Président Charles Taylor au Vice-Président Moses Blah et la signature, par les parties libériennes, de l'accord de paix global offrent une occasion unique de mettre un terme aux souffrances du peuple libérien et de trouver une solution pacifique à un conflit qui avait été l'épicentre de l'instabilité dans la sous-région. Il souligne que si l'Organisation des Nations unies et la communauté internationale dans son ensemble sont prêtes à soutenir le processus de paix libérien, c'est aux parties libériennes elles-mêmes qu'incombe la responsabilité première de la réussite de l'accord de paix.
Le 19 septembre 2003, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 1509 (2003), en remerciant le Secrétaire général de son rapport du 11 septembre 2003 et de ses recommandations. Il a décidé que la MINUL comprendrait 15 000 membres du personnel militaire des Nations unies, dont un maximum de 250 observateurs militaires et 160 officiers d'état-major, et jusqu'à 1 115 fonctionnaires de la police civile, dont des unités constituées pour prêter leur concours au maintien de l'ordre sur tout le territoire du Liberia, ainsi que la composante civile appropriée. La Mission a été créée pour une période de 12 mois. Il a prié le Secrétaire général d'assurer le 1er octobre 2003 la passation des pouvoirs des forces de l'ECOMOG dirigées par la CEDEAO à la MINUL.
Comme prévu, la Mission des Nations unies au Liberia (MINUL) a assuré les fonctions de maintien de la paix des forces de la Mission de la CEDEAO au Liberia (ECOMIL) le 1er octobre. Les quelque 3 500 soldats ouest-africains qui avaient fait partie des troupes avancées de l'ECOMIL ont provisoirement coiffé un béret de soldat de la paix des Nations unies. Dans un communiqué paru le même jour, le Secrétaire général a accueilli avec satisfaction cette très importante évolution et a salué le rôle joué par la CEDEAO dans l'instauration du climat de sécurité qui a ouvert la voie au déploiement de la MINUL. Il a rendu hommage aux gouvernements du Bénin, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Nigeria, du Sénégal et du Togo pour leur contribution à la MINUL, ainsi qu'aux États-Unis pour leur appui à la force régionale. Le Secrétaire général s'est dit confiant dans le fait que la MINUL pourrait être en mesure de contribuer de manière importante au règlement du conflit au Liberia pour autant que toutes les parties concernées coopèrent pleinement avec elle et que la communauté internationale fournisse les ressources nécessaires.
an 2003 : Mauritanie - En novembre 2003, Ould Taya est réélu président de la République avec 67 % des voix.
an 2003 : Tchad - En 2003, les recherches de gisements pétroliers permettent au Tchad de lancer les premières phases d'exploitation de son sous-sol, entraînant avec elles l'espoir que le Tchad puisse enfin connaître une phase d'essor économique et de développement humain
an 2003-2005 : Togo - Gnassingbé Eyadema est réélu en 2003 à la suite d'un changement dans la constitution pour l’autoriser à se présenter à nouveau. Il décède le 5 février 2005.
an 2003-2007 : Rwanda - La constitution adoptée par référendum – 26 mai 2003 - Inspirée des principales constitutions occidentales, la constitution rwandaise laisse néanmoins une large place aux problèmes spécifiques du Rwanda post-génocide, inscrivant notamment dans la constitution le refus de l'ethnisme hérité du colonialisme et ayant conduit au génocide. Des opposants au FPR, des courants liés à l'ancien régime génocidaire, et des observateurs occidentaux y voient une hypocrisie visant à renforcer un pouvoir politique disposant d'une faible base ethnique et voulant de ce fait forcer la marche vers l'apparence d'une nation composée de citoyens débarrassés du concept ethnique. Elle crée aussi des outils juridiques pour favoriser la place des femmes dans la vie politique (art. 185 et 187). Selon Human Rights Watch, certaines dispositions de la Constitution de 2003 violent « le droit d'association, de libre expression et de représentation politique assurée par des élections libres.
L'élection présidentielle au suffrage universel – 25 août 2003 - Paul Kagame est élu président de la République avec 95 % des voix contre son principal opposant, Faustin Twagiramungu, du MDR dissous. Des membres du comité de soutien à Faustin Twagiramungu ont été arrêtés la veille du scrutin. Certains ont subi des violences avant d'être relâchés. Les observateurs de la communauté européenne ont émis des critiques, regrettant des pressions exercées sur le corps électoral, et ont constaté des fraudes, mais estiment qu'un pas important vers la démocratie a été franchi. Amnesty International et Human Rights Watch ont en revanche manifesté un grand scepticisme sur la démocratisation du Rwanda.
Les élections législatives au suffrage universel – 2 octobre 2003 - Les députés favorables à Paul Kagame obtiennent la majorité des sièges. 49 % des députés sont des femmes, ainsi qu'une très forte proportion de sénateurs et de ministres.
Pour résoudre la difficulté de juger les nombreux prisonniers, qui attendent dans les prisons rwandaises l'idée germe d'adapter les gacaca, structures de justice traditionnelle (de agacaca, « petite herbe » ou « gazon » en kinyarwanda). On forme rapidement des personnes intègres pour présider ces tribunaux populaires. Pour désengorger les prisons, des prisonniers de certaines catégories sont relâchés, sans être amnistiés, avant de passer devant les gacaca. Ces décisions ravivent, dans la société rwandaise et la diaspora, les inquiétudes des rescapés qui craignent pour leur vie et le débat controversé sur la réconciliation, politiquement souhaitée, entre tueurs et rescapés.
Après plusieurs années de réflexions et de mises au point, le 15 janvier 2005, huit mille nouvelles juridictions « gacaca », (tribunaux populaires chargés de juger les auteurs présumés du génocide de 1994), entament la phase administrative de leur travail. Elles se rajoutent aux 750 « gacaca » pilotes mises en place depuis 2001. L'expérience des « gacaca » pilotes laisse penser qu'il y aurait au moins sept cent cinquante mille personnes, soit un quart de la population adulte, dénoncées et jugées par ces assemblées populaires.
Amnesty International estime que « cette volonté de traiter les affaires aussi rapidement que possible a accru la suspicion régnant sur l’équité du système. Certaines décisions rendues par les tribunaux gacaca faisaient douter de leur impartialité. » L'association souligne également que « Le 7 septembre 2005, Jean Léonard Ruganbage, du journal indépendant Umuco, a été arrêté à la suite de l’enquête qu’il avait menée sur l’appareil judiciaire et le gacaca ». Les autorités rwandaises estiment que ces critiques sont déplacées en rappelant que l'aide qu'elles avaient demandée à la communauté internationale pour juger les génocidaires a été gaspillée dans la mise en place d'un Tribunal pénal international, qui fut sa réponse à la demande rwandaise et qui n'a achevé en 2007 qu'une trentaine de jugements.
an 2003 : Soudan - En 2003, la guerre civile éclate au Darfour, où le Mouvement de libération du Soudan (MLS ou SLM) et le Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE ou JEM) se posent en protecteurs des populations civiles face aux exactions des « janjawids » (expression arabe qui signifie les diables à cheval, milices soutenues par le gouvernement de Khartoum). L'année suivante, l’Union africaine (UA) envoie des troupes au Darfour pour veiller au respect d'un cessez-le-feu et assurer la protection des populations civiles.
an 2004 : Afrique du Sud - second mandat pour Thabo Mbeki. Victoire pour la première fois de l'ANC dans les neuf provinces. Le NNP entre au gouvernement.
an 2004 : Algérie - De nouvelles élections sont organisées au mois d'avril, le principal concurrent du président sortant étant son ancien Premier ministre Ali Benflis. Abdelaziz Bouteflika est réélu avec un taux de 85 %. Son programme pour le deuxième mandat prévoit un plan quinquennal pour la relance de l'économie, au profit duquel il consacre une enveloppe financière de 150 milliards de dollars.
an 2004-2008 : République de Botswana - En 2004, le Président Festus Mogae, réélu pour cinq ans, s'engage à améliorer l'économie du pays et à tenter d'enrayer l'épidémie de sida laquelle toucherait près de 25 % de la population du pays d'après l'Organisation mondiale de la santé. Il se voit décerner en 2008 le prix Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique pour avoir su faire bon usage des richesses du sous-sol du pays, notamment en diamants. Il laisse le pouvoir au vice-président, Ian Khama, fils de Seretse Khama, père de l'indépendance du Botswana et de son épouse britannique Ruth Williams. Celui-ci est confirmé comme président par des élections l'année suivante. Il reste au pouvoir, réélu démocratiquement, pendant dix ans et fait ses adieux 18 mois avant la fin de son deuxième mandat, en respectant ainsi la Constitution.
an 2004 : Congo Kinshasa - En mars 2004 échoue une tentative de coup d'état attribuée à d'anciens mobutistes.
En mai 2004, des militaires banyamulenge déclenchent une mutinerie à Bukavu, sous les ordres du général tutsi congolais Laurent Nkunda, et prennent Bukavu le 2 juin. Ces mutins abandonnent la ville le 9 juin sous la pression internationale. Les 3 et 4 juin, dans les grandes villes congolaises, sont organisées des manifestations anti-rwandaises par des étudiants, qui tournent à l'émeute anti-ONU au Kivu. Le 11 juin, des membres de la garde présidentielle tentent un coup d'état. Le RCD-Goma suspend sa participation au gouvernement; il reviendra sur sa décision le 1er septembre.
an 2004-2006 : Guinée - Fin avril 2004, le premier ministre François Louceny Fall profite d'un voyage à l'étranger pour démissionner, arguant que « le président bloque tout ». Le poste reste vacant plusieurs mois avant d'être confié à Cellou Dalein Diallo, qui sera démis de ses fonctions en avril 2006.
an 2004-2005 : Guinée-Bissau - Le pays entreprend alors à nouveau avec difficulté une phase de normalisation démocratique, culminant avec l'organisation d'élections législatives en 2004 et d'une élection présidentielle le 24 juillet 2005 qui voit le retour à la tête du pays de João Bernardo Vieira dit « Nino Vieira », l'ancien président déposé en 1999 par un coup d’État militaire qui s'était présenté en indépendant. Pour gouverner, Nino Vieira, fortement contesté au sein du PAIGC, conclut une alliance tactique avec son ennemi historique, le général Batista Tagme Na Waie, en nommant chef d'état-major10 ce personnage rustre et illettré qui voue une haine farouche à l'ancien président Vieira, qui l'aurait torturé et jeté sur une île prison à la suite de la tentative de coup d'État de novembre 1985.
an 2004-2005 : Malawi - Le mois de mai 2004 voit l’élection de Bingu wa Mutharika, du FDU, contre le candidat du PCM, John Tembo. Durant la campagne électorale, les médias contrôlés par l'Etat (radio et télévision) privilégient la communication de la coalition au pouvoir. Des observateurs de l'Union Européenne mettent également en exergue des « distributions manifestes et répandues d'argent aux électeurs » et « l'utilisation de fonds publics par le parti au pouvoir ». Quand il prend ses fonctions, le Malawi est en pleine crise alimentaire. Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime que le nombre de personnes vulnérables au Malawi s’élève à plus de 5 millions, et en octobre 2005, le président déclare le Malawi en état de crise. Tout en demandant de l’aide alimentaire, le président engage le pays, après cette année désastreuse,dans une « révolution verte ». En faisant de l’agriculture une priorité, en mettant l'accent sur l'irrigation, en subventionnant 1 700 000 fermiers pauvres, il permet au pays de sortir de la disette et de devenir exportateur de maïs.
Bingu wa Mutharika se représente pour un deuxième mandat à l'élection du 19 mai 2009, cette fois à la tête du Parti démocrate progressiste qu'il a fondé en 2005 après avoir quitté le Front uni démocratique, et est réélu. L’image du Malawi à l'étranger s’améliore grâce à cette politiques de développement et aux avancées en sécurité alimentaire, ainsi qu'aux actions pour combattre la mortalité infantile et maternelle et les maladies telles que le malaria, la tuberculose et le SIDA. Le Malawi ouvre de nouvelles ambassades en Chine, Inde et Brésil.
an 2004 : Namibie - En 2004, Sam Nujoma renonce à modifier la constitution une nouvelle fois pour obtenir un nouveau mandat.
Les élections générales de novembre 2004 sont remportées par la SWAPO, qui renforce son emprise à chaque échéance électorale.
Les élections des 15 et 16 novembre sont sans surprise avec la victoire écrasante de la SWAPO qui remporte 55 des 72 sièges du parlement.
an 2004 : Somalie - Le 10 octobre 2004, le Parlement fédéral de transition de la République de Somalie, exilé au Kenya en raison des affrontements entre seigneurs de la guerre à Mogadiscio, et formé en nombres égaux de représentants de chacun des quatre grands clans somalis, a élu en tant que président intérimaire Abdullahi Yusuf Ahmed, président du Pays de Pount. À la tête du Gouvernement fédéral de transition, celui-ci a nommé Ali Mohamed Gedi, un vétérinaire de profession, en tant que Premier ministre, avec pour mission de former un gouvernement de coalition avec les différents chefs de guerre du pays. Les institutions somaliennes siègent au Kenya par mesure de sécurité à l'égard de la situation intérieure de la Somalie. Les institutions en exil n'ont aucun contrôle sur le pays en dehors de certains quartiers de la capitale Mogadiscio, leur autorité n'est pas reconnue à l'intérieur du pays, mais uniquement par les gouvernements étrangers.
an 2004 - 2005 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 2004, le pays ne peut plus subvenir à ses besoins et 70 % de la population se retrouve sans emploi. Le Zimbabwe se retire du Commonwealth. Le pays est alors au bord de la famine, ce que chercherait à dissimuler le régime. Le pays apparait dans la liste du nouvel « axe du mal » rebaptisé « avant poste de la tyrannie » par Condoleezza Rice en 2005.
En 2005, le parti de Robert Mugabe, la ZANU, remporte les élections législatives sur fond de violence et de fraudes électorales face à un MDC divisé et affaibli. Entre 120 000 et 1 500 000 habitants des bidonvilles d'Harare, bastions de l'opposition, sont expulsés à la fin du printemps lors de la destruction de leurs habitations sur ordre du gouvernement ; c'est l'opération Murambatsvina. Adoption d'une réforme constitutionnelle restreignant les droits de propriété et permettant au gouvernement de priver n'importe qui de passeport pour des raisons « d'intérêt national ». Afin de gagner l'appui de la population, Mugabe persécute la minorité ndébélé[réf. nécessaire]. Nombre d'entre eux fuient en Afrique du Sud. On empêche les propriétaires de terres d'aller en appel au sujet de leur expropriation. Un Sénat de 66 membres est créé mais celui-ci est soupçonné d'être une simple chambre d'enregistrement au service du président Mugabe. L'inflation dépasse les 1 000 % en 2006, et les 100 000 % en 2007, alors qu'a lieu une purge au sein de l'armée. L'exode de la population vers les pays voisins s’accélère.
an 2005 : Afrique du Sud - Dissolution du NNP dont les membres ont été invités à rejoindre l'ANC. Le vice-président Jacob Zuma est limogé par le président Mbeki à cause de son implication dans une affaire de corruption. L'insatisfaction augmente dans les bidonvilles et des manifestants s'en prennent aux autorités locales, accusées d'incompétence et de corruption. La cour constitutionnelle sud-africaine invalide la loi de 1961, qui stipulait que le mariage n’était légal que s’il unissait un homme et une femme.
an 2005 : Burkina Faso -Blaise Compaoré est élu président de la République (taux d'abstention : 74 %). Il est réélu en 2005 et en 2010.
an 2005 - 2020 : Burundi - Le CNDD-FDD, dirigé par Pierre Nkurunziza, s'impose dès lors comme l'un des principaux acteurs politiques, en obtenant la majorité absolue aux élections communales du 5 juin 2005 (1 781 sièges sur les 3 225 à pourvoir) avec 62,9 % des voix, contre 20,5 % pour le FRODEBU et seulement 5,3 % pour l'Uprona. Le CNDD-FDD, majoritairement hutu, dispose désormais de la majorité absolue dans 11 des 17 provinces du pays. Une victoire sans appel qui annonce la recomposition du paysage politique après douze années de guerre civile et met un terme au long tête-à-tête entre l'UPRONA et le FRODEBU. Mais le vote rappelle aussi que certains rebelles (PALIPEHUTU-FNL) n'ont pas encore déposé les armes (le jour du scrutin, 6 communes ont été la cible de violences). Ces opérations d'intimidation révèlent que la trêve conclue le 15 mai 2005 à Dar es Salaam avec les forces du PALIPEHUTU-FNL reste fragile.
Le CNDD-FDD remporte également les élections législatives du 4 juillet 2005 et les sénatoriales du 29 juillet. Nkurunziza est donc élu président le 19 août et investi le 26 août 2005.
2005-2020 : présidences Pierre Nkurunziza (1964-2020)
an 2005 : République de Centrafrique - Une élection présidentielle a lieu, après plusieurs reports, le 13 mars 2005, sous la direction d'une Commission Électorale Mixte Indépendante (CIME), présidée par Jean Willybiro-Sako. On peut relever comme candidatures, celles de François Bozizé (déjà chef de l'État), l'ancien président André Kolingba, et l'ancien vice-président Abel Goumba. Les candidatures de plusieurs autres candidats, dont celles de Charles Massi du FODEM, de l'ancien premier ministre Martin Ziguélé, de l'ancien ministre et ancien maire de Bangui Olivier Gabirault et de Jean-Jacques Démafouth, sont refusées par la commission électorale avant la médiation gabonaise et les accords de Libreville. À la suite de ces accords, seule la candidature de l'ancien président Ange-Félix Patassé est définitivement rejetée par la commission élue.
L'accession à la présidence de Bozizé est violemment contestée et une première guerre civile centrafricaine ravage le pays entre 2004 et 2007, jusqu'à la signature d'un accord de paix.
an 2005 : Congo Kinshasa - En janvier 2005 des émeutes se déclenchent à Kinshasa lorsque la Commission électorale envisage publiquement un report de la date des élections, comme le lui permettent les textes. La MONUC déclenche une offensive militaire, médiatique et diplomatique contre les milices lendues et hemas, après la mort de neuf casques bleus banglashis, tués en Ituri par ces dernières. La Cour pénale internationale annonce ses premiers mandats d'arrêts pour 2005 dont un accusé en Ituri.
En mai, l'avant-projet de constitution est approuvé par le parlement. Fin juin, celui-ci décide de prolonger la transition de six mois. Un gouvernement de transition est établi jusqu'aux résultats de l'élection.
an 2005 : Afrique République de Djibouti - Ismaïl Omar Guelleh est réélu en 2005, puis, après une modification de la Constitution, en 2011, 2016 et 2021.
an 2005-2006 : Eswatini (Swaziland) - Le 26 juillet 2005, après 30 ans de suspension de la loi fondamentale, le roi ratifie une nouvelle constitution entrée en vigueur le 8 février 2006. Le pays demeure une monarchie absolue. Les partis politiques sont toujours interdits et ne sont en pratique perçus que comme des associations. La Cour suprême ne peut juger d'affaires pouvant impliquer le régime royal. Le pays est par ailleurs toujours totalement dépendant économiquement de l'Afrique du Sud.
an 2005 : Kenya - Un premier projet de nouvelle constitution est rejeté en 2005 par un référendum.
an 2005-2006 : Libéria - Après le départ de Charles Taylor, une transition politique débute par la tenue d'élections législatives et présidentielles. La campagne électorale se déroule sans incidents notoires, notamment grâce à la présence de 15 000 Casques bleus de l'UNMIL, présents dans le pays depuis d'octobre 2003. Deux courtes courtes présidences se succèdent, avec tout d'abord Moses Blah, ancien vice-président de Charles Taylor à qui celui-ci a transmis le flambeau lorsqu'il a démissionné : Moses Blah assure un intérim pendant quelques mois, le temps que des négociations, organisées à Accra entre les différentes parties, aboutissent. Gyude Bryant lui succède12. C'est un homme d’affaires. Mais il est aussi l’un des fondateurs, en 1984, du Liberia Action Party (LAP), dont il est devenu le président en 1992, deux ans après le début de la première guerre civile. Bryant n’a pas quitté son pays pendant les guerres civiles. Il a ensuite été un président de transition, pendant deux ans et quelques mois, avant les élections présidentielles prévues par la paix d'Accra, et organisées fin 2005.
Le 11 octobre 2005, les Libériens sont effectivement appelés aux urnes pour élire leur président, comme prévu dans l'Accord de paix d'Accra. Parmi les vingt-deux candidats, George Weah (un ancien footballeur reconverti dans la politique) et Ellen Johnson-Sirleaf (une économiste et ancienne responsable au sein de la Banque mondiale), sont les favoris dans les sondages.
Le 21 octobre, la Commission nationale électorale (NEC) annonce que George Weah a obtenu 28,3 % des voix, devançant Ellen Johnson-Sirleaf qui a obtenu 19,8 %. Ces derniers participent donc au second tour qui a eu lieu le 8 novembre. Les résultats définitifs de ce premier tour sont rendus public le 26 octobre, après l'examen des vingt réclamations concernant des fraudes éventuelles. Concernant les élections législatives, le Congrès pour le changement démocratique (CDC) de George Weah a obtenu 3 sièges sur 26 au Sénat et 15 sur 64 à la Chambre des représentants. Le Parti de l'unité d'Ellen Johnson-Sirleaf a obtenu 3 sièges au Sénat et 9 à la Chambre des représentants. Le taux de participation a été de 74,9 %.
Le 8 novembre a lieu le second tour de l'élection présidentielle. George Weah a réuni autour de lui plusieurs hommes politiques de poids, comme Winston Tubman (quatrième au premier tour), Varney Sherman (cinquième au premier tour) et Sekou Conneh (ancien chef de la rébellion du LURD (Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie)). Ellen Johnson-Sirleaf a comme soutien uniquement des hommes politiques de second plan, mais elle espère profiter d'un vote massif des femmes en sa faveur au moment de l'élection qui fasse d'elle la première femme démocratiquement élue président en Afrique. Le 23 novembre, la Commission électorale nationale (NEC) annonce les résultats définitifs qui déclarent vainqueur Ellen Johnson Sirleaf avec 59,4 % des votes, contre 40,6 % pour George Weah. Le nouveau président doit prêter serment le 16 janvier 2006.
an 2005 : Mauritanie - Le 3 août 2005, l'armée, au travers du Conseil militaire pour la justice et la démocratie (CMJD) présidé par le colonel Ely Ould Mohamed Vall, prend le pouvoir pour officiellement « mettre fin aux pratiques totalitaires du régime » du président Ould Taya. Le putsch se déroule alors que le président revient de Riyad où il a assisté la veille aux funérailles du roi Fahd d'Arabie Saoudite.
an 2005 : Mayotte - Du côté des Comores, la question de Mayotte perd peu à peu son importance. Ainsi, depuis 1995, la question de Mayotte n'a plus été inscrite à l'ordre du jour de l’Assemblée générale de l'ONU. En 2005, le colonel Azali Assoumani, président des Comores depuis 1999, a déclaré qu'« il ne sert plus à rien de rester figé dans nos positions antagonistes d’antan, consistant à clamer que Mayotte est comorienne, pendant que les Mahorais eux se disent Français ». Il autorisera donc Mayotte à se présenter aux jeux des îles de l'océan Indien sous sa propre bannière.
Depuis le rattachement à la France, l'immigration clandestine venant essentiellement d'Anjouan (l'île la plus proche) n'a fait que s'accentuer. En 2005, près de la moitié des reconduites à la frontière effectuées en France l'ont été à Mayotte.
an 2005-2009 : Namibie - Le ministre des terres, Hifikepunye Pohamba, est imposé par Nujoma pour lui succéder à la présidence de la république en mars 2005. Nujoma reste toutefois à la présidence de la SWAPO jusqu'en 2007, date à laquelle Hifikepunye Pohamba lui succéda à la présidence du parti. Hifikepunye Pohamba a été réélu avec plus de 75 % des suffrages lors des élections de novembre 2009.
an 2005 : Ouganda - En août 2005, le Parlement (dominé par le NRM) vota une modification de la constitution qui, en enlevant la limite de deux mandats présidentiels, permit à Museveni de se représenter pour un troisième mandat. Kizza Besigye, revint d'exil en octobre 2005, et fut le principal opposant lors de l'élection de février 2006, remportée par Museveni avec 59,3 % des voix (au premier tour). Les résultats furent contestés par l'opposition du FDC (Forum for Democratic Changes, dirigé par Besigye).
an 2005 : Réunion (Ile de la) - Le cyclone Dina passe à 45 km des côtes nord l'île (22-23 janvier 2005).
an 2005 : Réunion (Ile de la) - La Réunion est un département et une région d’Outre-mer constitué d’un Conseil départemental de 50 élus et d’un Conseil régional de 45 élus. Comme les collectivités de l’Hexagone, La Réunion a bénéficié du transfert de nouvelles compétences et de moyens de l’État depuis janvier 2005. Les collectivités interviennent depuis lors dans les domaines suivants : développement économique, voirie, solidarité, santé, logement social, éducation et culture.
La Réunion fait partie des régions ultrapériphérique de l’Union européenne, ce qui lui permet de bénéficier de fonds structurels de l’Union Européenne. En outre, la position géographique de l’île autorise la France à faire partie de la Commission de l’océan Indien, qui rassemble également l’Union des Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles.
La Réunion compte :
-
7 députés à l’Assemblée nationale
-
4 sénateurs au Sénat
-
1 représentants au CESE
-
2 eurodéputés pour l’ensemble des outre-mer au Parlement européen
an 2005 : Swaziland (Estwatini) - Le 26 juillet 2005, après 30 ans de suspension de la loi fondamentale, le roi ratifie une nouvelle constitution entrée en vigueur le 8 février 2006. Le pays demeure une monarchie absolue. Les partis politiques sont toujours interdits et ne sont en pratique perçus que comme des associations. La Cour suprême ne peut juger d'affaires pouvant impliquer le régime royal. Le pays est par ailleurs toujours totalement dépendant économiquement de l'Afrique du Sud.
an 2005 - 2015 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Après les élections de décembre 2005, Jakaya Kikwete devient le nouveau président de la République, le quatrième depuis la création de la Tanzanie. Il effectue les deux mandats que lui permettent la constitution. Le parti au pouvoir, le Chama cha Mapinduzi, choisit ensuite John Magufuli comme candidat à la succession pour les présidentielles de 2015. John Magufuli l'emporte et devient ainsi le cinquième président de la République de Tanzanie. Celui-ci acquiert une popularité, notamment grâce à sa lutte contre le gaspillage de l'argent public et contre la corruption, mais faitpreuve également de dérives autoritaires, contre ses opposants, contre les libertés individuelles, contre la presse, etc.
an 2005 : Togo - Le 5 février 2005, le président Étienne Eyadéma Gnassingbé, décède d'une crise cardiaque à 69 ans, après avoir présidé durant 38 ans le pays. Sa mort surprend autant la population du pays que le gouvernemen.
À la suite du décès de Gnassingbé Eyadema et profitant de l’absence au pays du président de l’Assemblée nationale qui, selon l’article 65 de la Constitution, doit assurer l’intérim de la présidence, l’armée togolaise prend la décision de confier le pouvoir au fils de Gnassingbé Eyadema, Faure Gnassingbé. L'Union africaine par la voix du président de la Commission Alpha Oumar Konaré dénonce un coup d’État militaire.
Le 25 février 2005, à la suite des pressions de la CEDEAO et de l’Union européenne, Faure Gnassingbé se retire et laisse la place au vice-président de l’Assemblée nationale togolaise, Abbas Bonfoh. Ce dernier assure l’intérim de la fonction présidentielle jusqu’à la tenue d'élections le 24 avril 2005. Quatre candidats se présentent : Faure Gnassingbé, soutenu par le Rassemblement du peuple togolais (RPT), Emmanuel Bob Akitani, candidat de la coalition de l’opposition radicale, Harry Olympio (en), candidat du Rassemblement pour le soutien à la démocratie et au développement (RSDD, opposition modérée) et Nicolas Lawson, homme d’affaires qui annonce le retrait de sa candidature le 22 avril 2005.
Le scrutin se déroule dans des conditions très controversées, l’opposition dénonçant des fraudes. Emmanuel Bob Akitani, chef de l’opposition, se déclare vainqueur avec 70 % des voix alors que le gouvernement déclare Faure Gnassingbé élu. Dès l’annonce des résultats, des manifestations émaillées de violences éclatent dans les principales villes. Elles seront violemment réprimées par les forces de l'ordre. Le gouvernement décide de mettre en place une commission nationale d'enquête qui estime le nombre de morts à des centaines, plus de 800 selon la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH). De nombreux Togolais, environ 40 000, se réfugient dans les pays voisins, le Bénin et le Ghana. Le 3 mai 2005, Faure Gnassingbé prête serment et déclare qu’il se concentrera sur « la promotion du développement, le bien commun, la paix et l’unité nationale ».
Le 8 juin 2005, Edem Kodjo, président de la Convergence patriotique panafricaine (CPP, opposition modérée), est nommé Premier ministre. Il est chargé de constituer un gouvernement d’union nationale.
Amnesty International publie en juillet 2005 un rapport dénonçant selon ses propres termes « un scrutin entaché d’irrégularités et de graves violences » tout en montrant que « les forces de sécurité togolaises aidées par des milices proches du parti au pouvoir (le Rassemblement du peuple togolais) s’en sont violemment prises à des opposants présumés ou à de simples citoyens en ayant recours à un usage systématique de la violence ». Le rapport reproche aussi à la France son rôle ambigu dans la situation actuelle15. Les violences consécutives aux événements politiques de 2005 auraient entraîné entre 400 et 500 morts.
an 2005 : Soudan - En 2005, un accord de paix est signé à Nairobi entre le gouvernement de Khartoum et l’APLS. Cet accord prévoit pour une période de six ans une large autonomie pour le Sud, qui disposera de son propre gouvernement et d'une armée autonome. À l’issue de cette période, un référendum d’autodétermination sera organisé. Les revenus issus du pétrole seront partagés en part égale entre le Sud et le Nord . D’autre part, le gouvernement aura 70 % des postes dans l’administration centrale contre 30 % pour la rébellion du Sud. Enfin, la charia ne sera appliquée que dans le Nord, à majorité musulmane. John Garang, le dirigeant de la rébellion contre le régime islamiste du général Omar el-Béchir, trouve la mort dans un accident d’hélicoptère, quelques semaines après sa nomination comme vice-président du Soudan pour pacifier la situation.
an 2006 : Afrique du Sud - Élections municipales du 1er mars remportées largement par l'ANC avec 65 % des suffrages contre 16 % à l'Alliance démocratique et 4,7 % à l'Inkatha Freedom Party. Néanmoins, on assiste à ces élections à une baisse significative de la participation (49 %). La municipalité du Cap est la seule des six grandes métropoles d'Afrique du Sud à être dirigé par l'opposition officielle (l'Alliance démocratique).
an 2006 : Afrique du Sud - Le 14 novembre 2006, l'Afrique du Sud est le premier pays du continent africain à légaliser le mariage homosexuel, avec égalité des droits au mariage entre hétérosexuels. La nouvelle loi entre en vigueur le 30 novembre 2006.
an 2006-2007 : Algérie - Les actions terroristes se poursuivent néanmoins dans plusieurs régions du pays : le quotidien L'Expression estime en 2006 qu'il y aurait de 600 à 900 membres de groupes terroristes encore en activité dans le maquis algérien, la majorité appartenant au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC). Ils se manifestent notamment par les attentats du 11 décembre 2007 à Alger (entre 30 et 72 victimes suivant les sources)
an 2006 : Bénin (anc. Dahomey) - Lors des élections de mars 2006, les Béninois ont décidé d'exprimer leur « ras-le bol » et que le novice en politique, l'ancien président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), le docteur Thomas Boni Yayi succède à la surprise générale à Mathieu Kérékou. Il est élu président de la République à l'issue du deuxième tour de scrutin le 5 mars 2006, rassemblant 74.51 % des suffrages, contre 25.49 % pour Me Adrien Houngbédji, qui a présenté ses félicitations au nouvel élu. On note un fort taux de participation, de 76 %
Mathieu Kérékou, qui avait refusé de changer la constitution, n'a pas pu se représenter. Il n'en était pas moins opposé à Boni Yayi, trop novice à son goût. En effet, à quelques jours des résultats l'ancien président, surnommé « le caméléon », a plongé le pays dans le doute, en affirmant publiquement que lors du déroulement de l'élection il y avait eu des dysfonctionnements dans l'organisation, avec des problèmes de listes électorales et de cartes d'électeur. Malgré cela, la coordination des observateurs internationaux indépendants s'est félicitée au cours d'une conférence de presse à Cotonou, du déroulement du second tour de l'élection présidentielle au Bénin, jugeant qu'il avait été de « très bonne tenue ».
Le 6 avril 2006, Boni Yayi, 54 ans, est officiellement installé dans ses villas à Cotonou, en tant que nouveau président de la république du Bénin. Le nouveau président qui prône une « république coopérative et solidaire », a énuméré les quatre priorités de son mandat que sont les ressources humaines, une gouvernance concertée, le développement de l'esprit d'entreprise, la construction de nouvelles infrastructures.
Candidat indépendant, Boni Yayi a su rallier les ténors de la politique béninoise que sont Albert Tévoédjrè, Émile Derlin Zinsou et une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale, avant de bénéficier des consignes de vote de presque tous ses concurrents du premier tour, à l'issue duquel il totalisait un peu plus de 35 %, contre 24 % pour son poursuivant Me Adrien Houngbédji. Apparemment, les consignes de vote ont été suivies. Toutefois, certains observateurs estiment qu'avec ou sans consignes, le « candidat du changement » serait passé. Aux yeux des électeurs et plus particulièrement des jeunes et des milieux d'affaires, Boni Yayi (économiste) incarne l'espoir d'une reprise économique, l'amoindrissement du chômage, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance.
Le successeur de Mathieu Kérékou a promis un taux de croissance à deux chiffres (environ 5 % actuellement) et le positionnement du Bénin en tête des producteurs du coton ouest-africains à partir de la campagne agricole 2006-2007. Quoique entouré de toute la classe politique, Boni Yayi se refuse à faire de la politique politicienne. « Nous sommes venus pour produire de la richesse », dit-il, refusant de constituer un « gouvernement de remerciement ». Cependant, des sources bien informées indiquent qu'il a demandé aux partis politiques de lui proposer des cadres pour la formation du gouvernement.
an 2006 : Burkina Faso - Avec l'arrestation de certains étudiants à la suite d'une conférence de presse à l'université de Ouagadougou, en 2007-2008 contre le coût élevé de la vie.
an 2006-2008 : Congo Kinshasa - Une constitution est approuvée par les électeurs, et le 30 juillet 2006, les premières élections multipartites du Congo depuis son indépendance (en 1960) se tiennent :
-
Joseph Kabila obtient 45 % des voix,
-
Son opposant, Jean-Pierre Bemba, 20 %.
Les résultats de l'élection sont contestés et cela se transforme en une lutte frontale, entre les partisans des deux partis, dans les rues de la capitale, Kinshasa, du 20 au 22 août 2006. Seize personnes sont tuées avant que la police et les troupes MONUC de l'ONU ne reprennent le contrôle de la ville.
Une nouvelle élection a lieu le 29 octobre 2006, et Kabila remporte 58 % des voix. Bien que tous les observateurs neutres se félicitent de ces élections, Bemba fait plusieurs déclarations publiques dénonçant des irrégularités dans les élections.
Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila prête serment comme président de la République et le gouvernement de transition prend fin. La fragilité du nouveau gouvernement a permis l'installation d'affrontements répétés et de violations des droits de l'homme.
Dans l'affrontement se déroulant dans la région du Kivu, les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) continuent de menacer la frontière rwandaise et les Banyarwandas ; le Rwanda soutient les rebelles du RCD-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie) contre Kinshasa; et une offensive rebelle ayant eu lieu fin octobre 2008 a causé une crise de réfugiés à Ituri, où les forces de MONUC se sont révélées incapables de maîtriser les nombreuses milices et groupes à l'origine du conflit d'Ituri.
Dans le Nord-Est, la LRA de Joseph Kony (LRA pour Lord's Resistance Army, l'Armée de résistance du Seigneur), s'est déplacée depuis sa base originelle en Ouganda (où elle a mené une rébellion pendant vingt ans) ou au Sud-Soudan, jusqu'en république démocratique du Congo, en 2005, et a établi des campements dans le parc national de Garamba.
Dans le Nord du Katanga, les Maï-Maï (anciennes milices créées par Laurent-Désiré Kabila pour lutter contre les milices rwandaises et ougandaises dans le Kivu, mais oubliées dans l'accord de Lusaka en 1999) ont échappé au contrôle de Kinshasa.
an 2006 : Gambie - En 2006 Jammeh est réélu pour un troisième mandat à 66 %. Une tentative de coup d’État a eu lieu en 2006 : l’ancien chef de l’armée est accusé.
an 2006 : Libéria - Au sujet de la formation de son gouvernement, Ellen Johnson Sirleaf a affirmé son intention de « former un gouvernement d'unité qui dépassera les lignes de fracture entre les partis, les ethnies, et les religions ». Avançant comme unique condition le fait de ne pas être corrompu, elle n'exclut pas la participation de George Weah au gouvernement, en déclarant : « Mais le pays ne va pas cesser de fonctionner s'il n'est pas dans le gouvernement. Nous allons avancer, avec ou sans lui ».
Ellen Johnson Sirleaf prête serment le 16 janvier en présence de nombreux personnages politiques, dont le perdant du second tour, George Weah. Au niveau international on peut noter la présence marquée pour l'aboutissement du processus de transition de la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, accompagnée de la première dame Laura Bush et de sa fille. Les officiels présents pour l'Afrique étaient le président Thabo Mbeki (Afrique du Sud), Abdoulaye Wade (Sénégal), Mamadou Tandja (Niger), John Kufuor (Ghana) et Ahmad Tejan Kabbah (Sierra Leone). La France était représentée par Brigitte Girardin, ministre délégué à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, la Chine par le ministre des Affaires étrangères Li Zhaoxing, la Guinée par le Premier ministre Cellou Dalein Diallo et la Côte d'Ivoire par Simone Gbagbo, épouse du président Laurent Gbagbo. Lors de son discours, elle a une fois de plus mis l'accent sur le fait que son gouvernement sera d'union nationale : « Mon gouvernement tendra la main de l'amitié et de la solidarité pour rallier tous les partis politiques [...] en tournant le dos à nos différences » et que la lutte contre la corruption sera l'une de ses priorités. Elle remplace donc officiellement Gyude Bryant. Concernant le Parlement, les deux nouveaux présidents de chacune des chambres ont également prêté serment ce même jour. Il s'agit d'Isaac Nyenabo pour le Sénat et d'Edwin Snowe pour l'Assemblée nationale.
an 2006 - 2007 : Madagascar - Après avoir lancé la reconstruction de routes et d'une partie des infrastructures du pays, Marc Ravalomanana est réélu lors de l'élection du 3 décembre 2006 en gagnant au premier tour avec la majorité absolue devant 13 autres prétendants, et est investi de nouveau président de la République de Madagascar pour un nouveau mandat de 5 ans.
Il appelle de nouveau les Malgaches aux urnes pour le 4 avril 2007 pour un référendum qui a pour objet principal la suppression des six « provinces autonomes » et l'instauration des « régions » au nombre de 22.
an 2006-2009 : Mali - Troisième rébellion touarègue.
an 2006 : Mozambique - En 2006, le pays compte 19 millions de Mozambicains dont un tiers vivant dans les villes, conséquence d'une urbanisation rapide intervenue au cours de l’interminable guerre civile.
S’il demeure l’un des pays les plus pauvres du monde, où l’espérance de vie est d’à peine 41 ans, le Mozambique connaît depuis 1995 une croissance annuelle exceptionnelle qui atteint 9 % en 2005. La Banque mondiale cite ainsi le Mozambique comme « un modèle de réussite. Une réussite en termes de croissance, et un modèle qui montre aux autres pays comment tirer le meilleur parti de l’aide internationale », même si la pauvreté reste omniprésente, plus de la moitié des habitants vivant encore en dessous du seuil de pauvreté.
an 2006 : Réunion (Ile de la) - épidémie de Chikungunya.
an 2006 : Somalie - Depuis le 26 février 2006, le gouvernement de transition siège à Baidoa, en Somalie.
Au début du mois de juin 2006, les affrontements entre les membres de l'Alliance pour la restauration de la paix et contre le terrorisme (ARPCT), une alliance entre des chefs de guerre et le gouvernement fédéral de transition, soutenu par Washington, et l'Union des tribunaux islamiques, soutenus par de nombreux entrepreneurs de la capitale, ont vu la victoire de ces derniers pour le contrôle de Mogadiscio. Le nouveau régime serait soutenu par l'Érythrée, l'Iran et divers pays arabes, tandis que le gouvernement fédéral de transition, replié sur Baidoa, bénéficierait de l'appui militaire de l'Éthiopie. Le rétablissement de l'ordre se fait au nom de la seule structure législative stable et consensuelle du pays, la jurisprudence chaféite.
Le 13 juin 2006 à Nairobi, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui regroupe le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée et le gouvernement de transition de Somalie, décide d'interdire l'accès au territoire de ses pays membres aux miliciens de l'ARPCT fuyant devant l'avancée des tribunaux islamiques dont le plus important, celui de Mogadiscio, est nommé Hifka-Halane. Il sert de pouvoir judiciaire (civil et pénal), en jugeant les affaires en appliquant la charia.
Début décembre 2006, les Nations unies autorisent le déploiement d'une force de maintien de la paix, composée de 8 000 hommes, sous l'égide de l'Union africaine24 (résolution 1725). Fin décembre 2006, l'armée éthiopienne intervient et les tribunaux islamiques fuient Mogadiscio. Elle prend ainsi le contrôle de la majeure partie du pays et le gouvernement de transition se déclare le gouvernement de facto du pays.
Du 20 au 31 décembre 2006, l'Éthiopie est entrée en guerre contre l'Union des tribunaux islamiques. La loi martiale a été décrétée le 30 décembre 2006 par le premier ministre somalien du gouvernement fédéral de transition, Ali Mohamed Gedi, et un délai de trois jours a été donné aux Somaliens pour remettre leurs armes à feu aux troupes éthiopiennes ou fédérales, avec un suivi très faible.
an 2006 : Soudan - En 2006, le gouvernement de Khartoum rejette le déploiement de « Casques bleus » au Darfour. Mais il accepte finalement l'année suivante le déploiement au Darfour d’une « force hybride » associant l’ONU et l’Union africaine (la MINUAD).
an 2006-2010 : Tchad - Alors que le président Déby fait modifier la constitution pour supprimer la limite de deux mandats présidentiels, une guerre civile éclate, contestant cette mainmise sur le pouvoir. Le président réussit à se maintenir au pouvoir et à être réélu, lors d'élections contestées boycottées par l'opposition. Entre 2006 et 2008, les forces d'opposition rebelles tentent plusieurs fois de prendre la capitale par la force, mais échouent systématiquement.
Le 13 avril 2006, des combats éclatent entre les troupes du président de la République et une faction de la rébellion, le Front uni pour le Changement (FUC), dans la périphérie de N'Djaména. Idriss Déby Itno accuse le Soudan, en pleine guerre du Darfour, de soutenir ses adversaires, à l’aube des élections présidentielles.
Malgré l’opposition et les appels au boycott, le 3 mai 2006, Idriss Déby Itno est réélu au suffrage universel avec 64,67 % des votes exprimés.
Le 2 février 2008, les rebelles, en provenance du Soudan frontalier, s’emparent de la capitale du Tchad, N'Djaména, à l'exception du palais présidentiel où le président Idriss Déby Itno semble s'être cloîtré. La France décide d’évacuer une partie de ses ressortissants. Le 4 février 2008, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques contre le gouvernement tchadien, dont l’armée rencontre des difficultés à repousser les rebelles. La France, via l’opération Épervier, apporte alors une aide logistique qui permet d’assurer la stabilité régionale au Tchad.
Mais les rebelles mènent une guerre de mouvement dans l’Est du Tchad, afin de faire tomber le gouvernement au pouvoir. Les attaques répétées ont pour conséquence de provoquer en juin 2008 un combat opposant pour la première fois la mission militaire européenne EUFOR et les rebelles au sud d’Abéché, autour de la ville de Goz Beïda. En novembre 2008, dans l’Est du pays, deux véhicules militaires belges sont brûlés, à la suite de tirs provenant d’hélicoptères soudanais.
En mai 2009 a lieu une autre offensive de la rébellion partant du Soudan, toujours dans l'objectif de renverser Idriss Déby. Le contingent militaire français de l'opération Épervier est suppléé, entre 2007 et 2009, par la force d'interposition EUFOR, forte de 3 000 soldats, mandatée par l'Union européenne à la demande de la France, en principe neutre mais qui assure un soutien de fait au régime du président Déby.
Finalement, en 2010, le président soudanais Omar el-Bechir se rend au Tchad pour normaliser les relations entre les deux pays. Le gouvernement du Tchad refuse d’arrêter ce dernier, pourtant visé par des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale émis à son encontre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour.
an 2007 : Afrique du Sud - Jacob Zuma prend la présidence de l'ANC et évince les partisans de Thabo Mbeki
an 2011 - 2016 : Bénin - Les élections législatives du 31 mars 2007 donnent la majorité à la Force Cauris pour un Bénin émergent (FCBE).
an 2007-2008 : Burkina Faso - contre le coût élevé de la vie. En juin 2008, l'université de Ouagadougou connaît une grève massive, qui se solde par une reprise en main brutale de l'université par le pouvoir : suppression de toutes les prestations sociales étudiantes (bourses, restauration, résidences universitaires vidées en deux jours) après tirs à balles réelles sur les étudiants.
an 2007 : Afrique Côte d'Ivoire - Appliqué avec beaucoup de difficultés, l’accord de Linas-Marcoussis est suivi par plusieurs autres, conclus en Afrique et mis en œuvre par les gouvernements successifs de Seydou Diarra, Charles Konan Banny.
L’accord politique de Ouagadougou conclu en 2007 avec Laurent Gbagbo, sous l’égide du président burkinabé Blaise Compaoré, qui fait office de facilitateur, offre aux Forces nouvelles le poste de Premier ministre. Les Forces nouvelles désignent leur secrétaire général, Guillaume Soro, le 26 mars 2007 pour exercer cette fonction.
Guillaume Soro entre en fonction le 4 avril et son gouvernement est installé trois jours plus tard. Le gouvernement doit mettre en place notamment deux points clefs de l'accord politique de Ouagadougou : la préparation d'élections devant se tenir dans les dix mois à compter de mars 2007, puis l'unification des Forces armées des Forces nouvelles (FAFN) et des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire (FANCI).
Dans le gouvernement Soro I composé de 33 membres, la formation militaro-politique de celui-ci (les Forces nouvelles de Côte d'Ivoire) et le Front populaire ivoirien (FPI), formation politique dont est issu le président Laurent Gbagbo, disposent chacun de huit portefeuilles (le Premier ministre y compris). Les autres portefeuilles sont répartis entre divers autres partis politiques. Ainsi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) en détient 5, le Rassemblement des républicains (RDR) 5, le Mouvement des forces d'Avenir (MFA) un, le Parti ivoirien des travailleurs (PIT) un, l’Union démocratique de Côte d'Ivoire (UDCI) un et l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) un ; deux autres ministres sont réputés proches du Président de la République et un ministre est issu de la société civile.
Concrètement, outre la gestion des affaires relevant de ses compétences traditionnelles, le gouvernement coordonne la mise en œuvre du processus de sortie de crise au moyen de programmes spécifiques. Il s’agit d’un dispositif technique comprenant notamment le Centre de commandement intégré (désarmement des combattants), le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire, le Comité national de pilotage du redéploiement de l'Administration (restauration de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire et reprise du fonctionnement des services publics), l’Office national d'identification (identification des populations et des électeurs) et la Commission électorale indépendante (organisation des élections).
an 2007 : Guinée - Le pouvoir du président, sous influence d'hommes d'affaires comme Mamadou Sylla, est de plus en plus contesté. Début 2007 éclate une grève générale réprimée dans le sang.
an 2007 : Kenya - Lors de l'élection présidentielle du 27 décembre 2007, Raila Odinga reçoit un soutien massif dans les provinces de Nyanza, occidentale, de la vallée du Rift et de la côte mais aussi de personnalités emblématiques telle Wangari Maathai. Dans la soirée du 30 décembre 2007, Samuel Kivuitu (en), qui vient juste d'être reconduit, pour cinq ans, par Kibaki à son poste de président de la commission électorale (Electoral Commission of Kenya), déclare Raila Odinga battu par 232 000 voix de différence en faveur du président sortant contrairement aux tendances des derniers résultats enregistrés. Controversée par les observateurs de l'Union européenne qui demande un recomptage des bulletins de vote, cette annonce est immédiatement contestée par le camp de Raila et entraine la plus grande crise de violence survenue au Kenya.
an 2007 : Mali - Le 29 avril 2007, Amadou Toumani Touré est réélu au premier tour avec 71,20 % des voix, mais cette élection est contestée par les principaux candidats de l’opposition. Les relations commerciales, politiques et culturelles avec la France se ralentissent tandis que celles avec la Chine, la péninsule arabique et les États-Unis se renforcent.
an 2007-2008 : Mauritanie - Le 25 mars 2007, Sidi Ould Cheikh Abdallahi est le premier civil à être élu président de le République démocratiquement, le colonel Ely Ould Mohamed Vall, conformément à ses engagements, ne s’étant pas présenté. En avril 2007 la Mauritanie réintègre l’Union Africaine, dont elle avait été exclue après le coup d’État de 2005. Pour la première fois, des membres du parti islamique modéré rejoignent le gouvernement en mai 2008.
Esclavage :
La société mauritanienne reste dominée par la caste des Beydanes, qui a historiquement fondé son pouvoir sur l'esclavage des castes inférieures.
L’esclavage reste courant en Mauritanie, le président de l’IRA (Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste) Biram Dah Abeid considère la Mauritanie comme un régime « d’apartheid non écrit ». Certains parmi la minorité Maures (arabo-berbère) y exploitent des Haratines dans les quartiers riches des grandes villes. Selon le rapport de l’ONG Walk Free publié en 2014 environ 4% de la population mauritanienne, soit 150 000 personnes vit en situation d’esclavage. La Mauritanie est le pays le plus touché au monde par ce phénomène. Selon Biram Abeid, la réalité se rapproche plus des 20% de la population.
L'esclavage a été officiellement aboli à quatre reprises (la dernière fois en 1980, avec un succès mitigé) mais les ségrégations raciales, tribales ou de castes y subsistent. En 2007 a été votée une loi criminalisant l'esclavage, et des actions sont prévues par le gouvernement pour lutter contre ses séquelles, car l'ethnie haratine des anciens esclaves reste parmi la plus défavorisée. Selon le Global Slavery Index, l'esclavage concerne 4 % de la population mauritanienne.
an 2007-2010 : Nigéria - En 2007 des élections une nouvelle fois agitées amènent au pouvoir le successeur désigné d'Olusegun Obasanjo : Umaru Yar'Adua, qui décède le 5 mai 2010. Son vice-président Goodluck Jonathan lui succède alors.
an 2007-2009 : Rwanda - La veille de la commémoration du 7 avril 2007, l'ancien Président de la République, Pasteur Bizimungu, est gracié par le Président Paul Kagame. Cette incarcération était vivement contestée par des ONG qui y voyaient un prétexte pour écarter un éventuel rival politique. Pasteur Bizimungu avait en effet symbolisé une réconciliation possible entre Tutsi et Hutu après le génocide.
La peine de mort est abolie au Rwanda en milieu d'année 2007. Cette abolition était demandée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda afin que, dans le cadre de la cessation de ses activités, prévue dans ses statuts en 2008 et 2010 pour la cour d'appel, il puisse transférer des détenus et des dossiers de présumés génocidaires au Rwanda.
Le président du Parti Vert rwandais, Frank Habineza, fait également état de menaces. En octobre 2009, une réunion du Parti des Verts rwandais est violemment interrompue par la police Quelques semaines seulement avant les élections, le 14 juillet 2009, André Kagwa Rwisereka, le vice-président du Parti vert démocratique, est retrouvé mort, à Butare, au sud du Rwanda. Le climat interne est marqué par des meurtres ou des arrestations de journalistes toujours selon Amnesty International.
L'analyse publique des politiques et pratiques du gouvernement est limitée au sein du pays par les limites de la liberté de la presse. En juin 2009, le journaliste du journal Umuvugizi Jean-Leonard Rugambage est abattu devant son domicile à Kigali. En juillet 2009, Agnes Nkusi Uwimana, rédactrice en chef du journal Umurabyo, est accusée d'« idéologie du génocide" ».
an 2007 : Sénégal - Abdoulaye Wade est facilement réélu lors de l’élection présidentielle de 2007, et malgré le mot d’ordre de boycott de l’opposition lors des élections législatives consécutives, il dispose d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale et au Sénat, rétabli en début d’année. Le Président mène une politique libérale ouvertement revendiquée qui donne certains résultats. En effet le Sénégal devient une terre d’élection pour les investisseurs d’Europe, mais aussi des émirats du Golfe – c’est le cas de Dubaï Ports World qui enlève l’exploitation du port de Dakar –, du Brésil, de Chine, d’Iran ou d’Inde – par exemple avec le géant mondial de la sidérurgie, Arcelor Mittal. Abdoulaye Wade appelle également à la création d’États-Unis d’Afrique et de grands travaux d’infrastructures ont été lancés en vue du 11e sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) qui s’est tenu à Dakar en mars 2008.
Mais la politique gouvernementale essuie aussi des revers, comme l’inexorable recul du secteur agricole (arachide, coton…), l’effondrement de l’industrie chimique en 2006, le développement insuffisant du secteur tertiaire ou l’engorgement persistant de la capitale.
Le pays reste très dépendant de l’aide extérieure, notamment des subsides envoyés par l’importante diaspora sénégalaise. Le ralentissement de la crois sance et un taux de chômage élevé poussent bien des jeunes Sénégalais à l’émigration, parfois au péril de leur vie. L’augmentation du coût de la vie, notamment liée à la hausse des cours du pétrole, suscite des manifestations de rue en novembre 2007.
Beaucoup dénoncent aussi une dérive autoritaire du pouvoir, – guère tempérée par un Premier ministre généralement présenté avant tout comme un technocrate, Cheikh Hadjibou Soumaré , et qui laisse une marge de manœuvre réduite à l’opposition, ainsi qu’aux médias, pour la plupart solidaires de l’action présidentielle.
La question de la future succession d’Abdoulaye Wade, réélu à 80 ans, apparaît en filigrane dans le débat politique actuel, alimenté notamment par les spéculations sur les intentions de son fils Karim Wade.
an 2007 : Somalie - En janvier 2007, les États-Unis interviennent dans le sud de la Somalie pour pourchasser des membres présumés d'Al-Qaïda.
Le 23 janvier 2007, les troupes éthiopiennes commencent officiellement à se retirer de Somalie. Peu fréquent auparavant, les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du 29 octobre 2008 sont attribués au groupe al-Shabaab)
an 2008 : Afrique du Sud - En 2008, une grave pénurie d'électricité achève le bilan économique du président, à qui la presse reproche l'imprévoyance de son gouvernement, ainsi qu'à celui de Nelson Mandela, pour avoir refusé, en 1996, d'investir dans la construction de nouvelles centrales électriques alors que le pays connait une croissance de la demande en électricité de 10 % chaque année. Les grandes villes sont, pendant plusieurs semaines, périodiquement plongées pendant quelques heures dans l'obscurité alors que le gouvernement est contraint de promouvoir le rationnement, de renoncer à certains grands projets créateurs d'emplois et de suspendre ses exportations d'électricité vers les pays voisins. En mai, le gouvernement est confronté à une vague de violences contre les immigrés, caractérisée notamment par des meurtres, des pillages et des lynchages.
Mis en cause indirectement pour des « interférences » politiques dans des affaires judiciaires impliquant son ancien vice-président, Thabo Mbeki est contraint de démissionner de la présidence sud-africaine le 21 septembre 2008 après avoir été désavoué par son parti.
L'ANC nomme alors le vice-président du parti, Kgalema Motlanthe, pour lui succéder. Cela s'accompagne d'un schisme au sein de l'ANC et la création du Congrès du Peuple (COPE) par les partisans de l'ancien président.
an 2008 : République de Botswana - Le nouveau président est le lieutenant-général Ian Khama qui entre en fonction 2008, en prévision des élections de 2009. Il est le fils du premier président du Botswana, et un ancien chef de l'armée du Botswana (BDF). Élu formellement en 2009 et réélu en 2014, il demeure en fonction jusqu'en 2018, date à laquelle il démissionne pour laisser la place au vice-président Mokgweetsi Masisi qui lui succède.
an 2008 : Cameroun - En février 2008, des émeutes éclatent, réclamant la baisse des prix et le départ de Paul Biya. Les manifestants sont sévèrement réprimés : une centaine de morts, des milliers d’arrestations.
Le projet de Paul Biya de modifier la Constitution en février 2008 donne lieu à des manifestations brutalement réprimées ; une centaine de personnes sont tuées.
an 2008 : Cap Vert - Le 23 juillet 2008, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) accueille le Cap-Vert qui devient le 153e pays membre. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux principaux partis, le Mouvement pour la démocratie (MPD), et le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV, l'ancien parti unique), qui se succèdent au pouvoir, et quelquefois y cohabitent (avec un président de l'un et un premier ministre de l'autre). L'archipel souffre par contre du réchauffement climatique et de sécheresses, d'autant plus que l'eau douce y est rare. Les gouvernements ont opté pour une politique de développement des énergies renouvelables, ainsi que de l'écotourisme.
an 2008 : Afrique République de Djibouti - La frontière reste donc inchangée, l'île est indivise entre les deux pays. Douméra est le prétexte de l'affrontement entre les forces érythréennes et djiboutiennes de juin 2008.
an 2008-2009 : Afrique République de Djibouti - Le 10 juin 2008 éclate la guerre djibouto-érythréenne qui a opposé l'Érythrée à Djibouti autour du cap (ras) Douméra. Djibouti accuse Asmara d'avoir financé le mouvement armé anti-gouvernemental du Front pour la restauration de l’unité et la démocratie entre 1991 à 1994. L'Érythrée revendique la zone du cap Douméra, point littoral de la frontière entre les deux pays. En janvier 2009, par la résolution 1862 du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil de sécurité des Nations unies impose des sanctions contre l'Érythrée.
an 2008 : Algérie - Le 8 juin, l’explosion de deux bombes visant le convoi d’une entreprise française, près d’Alger, tue douze personnes, dont un ingénieur français. Recrudescence des attentats en août.
Le 12 novembre, M. Bouteflika fait réviser la Constitution afin de briguer un troisième mandat. Il est réélu six mois plus tard avec plus de 90 % des suffrages, les principaux partis d’opposition ayant appelé à boycotter le scrutin présidentiel.
an 2008-2018 : Érythrée - Enfin, un différend territorial oppose par ailleurs l'Érythrée à Djibouti sur sa frontière sud depuis 2008 qui vaut à l'Érythrée des sanctions des Nations unies, sanctions levées le 14 novembre 2018. Le Conseil a ainsi adopté à l'unanimité cette résolution élaborée par la Grande-Bretagne et levé l'embargo sur les armes, toutes les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et autres sanctions.
an 2008-2012 : Ghana - Le président Kufuor quitte le pouvoir en 2008, respectant comme son prédécesseur, la limite du nombre de mandat possible. La décision du Nouveau Parti Patriotique est de choisir Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le fils de Edward Akufo-Addo comme leur candidat, tandis que le Congrès National Démocratique choisit John Atta Mills pour la troisième fois.
Le 28 décembre 2008, au terme d'une élection présidentielle très disputée et unanimement saluée pour son caractère démocratique, le candidat du Congrès démocratique national (Ghana), John Atta Mills, devient le nouveau président du pays. La passation de pouvoir s'est déroulée le 7 janvier 2009. John Atta Mills bénéficie ensuite de l'exploitation de forages pétroliers qui créent une dynamique nouvelle. La gestion de cette manne, qui soulève de grands espoirs dans la population, se veut basée sur un modèle norvégien avec « une industrie pétrolière où le sens de l’équité et de la justice doivent être reproduits localement pour le bénéfice de tous les Ghanéens »
Le 24 juillet 2012, le président meurt. Le pouvoir est transmis au vice-président, John Dramani Mahama, et des élections sont convoquées18. Il choisit le Gouverneur de la Banque du Ghana, Amissah Arthur, comme nouveau vice-président. Il est confirmé à son poste par le scrutin de décembre 201220. Son mandat est perturbé par une croissance en berne et des scandales de corruption et il perd l'élection présidentielle de 2016 face au chef de l'opposition Nana Akufo-Addo.
Industrialisation, opération séduction des investisseurs étrangers, lutte contre le paludisme, les initiatives s'enchaînent. Réputé pour sa stabilité politique, son fonctionnement démocratique et son dynamisme, le pays accueille Melania Trump après Barack Obama, mais aussi Angela Merkel ou encore Emmanuel Macron.
an 2008-2009 : Guinée - Le 22 décembre 2008, Lansana Conté décède des suites d'une longue maladie (leucémie et diabète aigu) à l'âge de 74 ans. Au cours de la nuit suivante, les proches du régime s'affairent pour organiser l'intérim suivant les procédures prévues par la Constitution mais le 23 décembre 2008 au matin, à la suite de l'annonce du décès de Lansana Conté, des dignitaires de l'armée annoncent unilatéralement la dissolution du gouvernement ainsi que la suspension de la Constitution, dans un discours à teneur résolument sociale. Ces événements laissent planer le doute sur l'effectivité d'un nouveau coup d'État. Le même jour, le capitaine Moussa Dadis Camara est porté à la tête du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et devient le lendemain, le troisième président de la République de Guinée.
an 2008 : Kenya - Fin février 2008, grâce à la médiation de Kofi Annan, l'ancien Secrétaire général des Nations unies, un accord de partage du pouvoir entre le président Kibaki et Raila est signé et entériné à l'unanimité par le Parlement le 18 mars pour résoudre la crise. Il se matérialise par la nomination de Raila Odinga au poste de Premier ministre le 13 avril suivant. Quatre jours plus tard, il prête serment et un gouvernement de coalition est constitué.
an 2008 : Libéria - L'ancien président Charles Taylor est jugé pour l'armement et le soutien aux rebelles de Sierra Leone depuis le 7 janvier 2008 à La Haye. Il plaide non coupable.
an 2008 : Mauritanie - Le 6 août 2008, à la suite du limogeage d'officiers supérieurs, les militaires conduits par le chef du bataillon chargé de la sécurité présidentielle, le général Mohamed Ould Abdelaziz, déposent le président Abdallahi. Il est assigné à résidence durant 4 mois et demi. Les principaux partis d’opposition, à l'exception du RFD d’Ahmed Ould Daddah se réunissent en un Front national pour la défense de la démocratie (FNDD) et s'opposent au coup d’État.
an 2008 : Sainte-Hélène (Île) - Il n'existe pas de population indigène sur l'île. Les habitants de l'île sont des Européens descendants de Britanniques, des Africains descendants d'esclaves et des Chinois. Tous les habitants parlent anglais ; il n'y a jamais eu de créoles et les populations d'origine non britannique ont perdu la langue de leurs ancêtres.
La population s'élève à environ 4 200 habitants en 2008 en incluant les visiteurs (3 900 en ne comptant que les autochtones), se répartissant pour la plupart dans l'intérieur de l'île, plus verdoyant. Cependant, celle-ci est en forte baisse, puisqu'elle a perdu 1 000 habitants depuis 1998.
La capitale de l'île est Jamestown, qui en est également la ville principale avec 864 habitants. Située sur la côte, s'étirant sur 1,5 km, mais dépourvue de port, elle est si encaissée entre deux montagnes que les habitants ne reçoivent aucune chaîne de télévision.
Le tourisme est rare, et les visiteurs sont surtout d'anciens habitants de Sainte-Hélène qui viennent rendre visite à leurs familles. S'il y a tout de même quelques centaines de vrais touristes (chiffre qui varie d'une année à l'autre), la vie reste chère sur place, l'île étant relativement isolée. Le prix d'un produit non fait sur place peut facilement être deux à trois fois plus élevé que son prix dans un magasin standard à Londres.
an 2008 : Somalie - les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du 29 octobre 2008 sont attribués au groupe al-Shabaab)
Le 29 décembre 2008, le président Abdullahi Yusuf Ahmed annonce sa démission, déclarant qu'il regrette n'avoir pas pu mettre fin au conflit somalien. Le Parlement, réuni à Djibouti en raison du désordre en Somalie, élit alors le cheikh Sharif Ahmed, ancien dirigeant de l'Union des tribunaux islamiques, à la présidence de la République. Il l'emporta face à Maslah Mohamed Siad Barre, fils de l'ancien président Mohamed Siad Barre, et au Premier ministre sortant Nur Hassan Hussei.
an 2008 - 2010 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 2008, les élections présidentielle et législatives du 29 mars constituent un revers pour la ZANU. Le MDC remporte la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale (109 élus contre 97 élus à la ZANU). Publiés le 2 mai, le résultat de l’élection présidentielle est contesté. En obtenant officiellement près de 48 % des suffrages en dépit des fraudes, Morgan Tsvangirai devance néanmoins Robert Mugabe (43 %). Lors de la campagne du second tour, le pays est le théâtre de violences politiques continues marquées par des exactions commises par la police contre des membres de l'opposition et leur famille mais aussi par l’arrestation de ses principaux chefs31. Dans ce climat de terreur, Morgan Tsvangirai décide à cinq jours du second tour de l’élection présidentielle de boycotter celle-ci, permettant ainsi à Robert Mugabe d’être réélu. L’inflation dépassant les 10 millions de % en rythme annuel, l'édition de billets de 100 milliards de dollars zimbabwéens (environ 3 EUR fin juillet 2008) devient nécessaire. La population est contrainte de revenir à une économie de troc et à la marche à pied : il n'y a plus de gazole pour faire rouler les bus.
De plus, à partir du mois d'août, une épidémie de choléra sévit dans le pays ; elle fait, selon l'OMS, 2 971 morts, pour 56 123 personnes contaminées (chiffres officiels au 27 janvier 2009). Toujours d'après l'OMS, jusqu'à la moitié des 12 millions de Zimbabwéens sont susceptibles de contracter la maladie en raison de l'insalubrité des conditions de vie dans le pays. En 2009, sous la pression de l'ONU quant aux fraudes concernant l'élection présidentielle, Robert Mugabe décide de partager le pouvoir avec son opposant et rival personnel Morgan Tsvangirai, chef du Mouvement pour le changement démocratique (MDC). En avril 2010, Mugabe reçoit le président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, avec lequel il conclut huit accords commerciaux entre les deux pays. Cette visite n'est pas bien perçue par l'opposition et par le reste du monde.
an 2009-2010 : Afrique du Sud - En mai 2009, Jacob Zuma est élu président de la république après la victoire de l'ANC (65,90 %), lors des élections générales, face notamment à l'alliance démocratique (16,66 %) d'Helen Zille, qui remporte la province du Cap occidental, et face au Congrès du Peuple (7,42 %) de Mosiuoa Lekota. Il hérite d'un pays toujours considéré comme le poumon économique de l'Afrique subsaharienne (40 % du PIB de l'Afrique subsaharienne) mais où le crime, sans distinction raciale, est omniprésent, faisant de ce pays l'un des plus dangereux du monde au côté de l'Irak et de la Colombie, où l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'est accentué, où la politique de discrimination positive est contestée pour son inefficacité et où les tentatives de réforme agraire n'ont débouché que sur des échecs. Le nouveau gouvernement qu'il forme est alors plus ouvert aux autres partis et autres races que ne l'était celui de Mbeki. Il fait notamment entrer au gouvernement Jeremy Cronin, un Blanc par ailleurs secrétaire général adjoint du parti communiste sud-africain et Pieter Mulder, chef du front de la liberté, le parti de la droite afrikaner qui a succédé à l'ancien parti conservateur.
En 2010, quinze ans après avoir organisé avec succès la coupe du monde de rugby, marquée par la victoire de l'équipe nationale, les Springboks, l'Afrique du Sud est le pays hôte de la coupe du monde de football. Deux mois avant l'évènement sportif, le 3 avril 2010, l'assassinat, dans sa ferme, d'Eugène Terre'Blanche par deux de ses ouvriers agricoles fait craindre un moment un réveil des tensions raciales dans une Afrique du Sud toujours minée par ces conflits latents. Le très influent leader de la Jeunesse de l'ANC, Julius Malema, connu pour ses outrances verbales à l'encontre de Thabo Mbeki et des opposants à Zuma, pour qui il se déclarait prêt à tuer, est mis en cause pour avoir repris dans ses discours une chanson prônant de « tuer les Boers » parce que « ce sont des violeurs ». Dans les campagnes sud-africaines, le modèle zimbabwéen reposant sur la carte raciale et la carte de la terre a beaucoup de partisans. L'épisode du meurtre de Terre'Blanche souligne ce malaise en zone rurale où plus de 2 500 fermiers blancs ont été tués en une dizaine d'années, souvent dans d'atroces conditions et le fait que des ouvriers agricoles noirs sont souvent mal payés et maltraités par leurs employeurs.
an 2009 : Algérie - Pendant les mois de mars et d'avril de l'année 2009, la campagne électorale pour la présidentielle se déclenche à la suite d'un nouvel amendement constitutionnel. Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014.
an 2009-2011 : Afrique - les Comores - Il est organisé le 29 mars 2009 et 95,2 % des votants acceptent le changement de statut, faisant de Mayotte le 5e département d'outre-mer (DOM) et le 101e département français en 2011.
Mayotte fait partie des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Elle devrait devenir une région ultrapériphérique de l'Union européenne au moment de sa départementalisation. Le pays souverain formé par les trois îles s'appelle aujourd'hui Union des Comores.
an 2009 : Congo Brazzaville - Denis Sassou-Nguesso est de nouveau réélu président du Congo, avec 78,61 % des voix à l'issue du vote du 12 juillet.
an 2009-2016 : Gabon - Le 3 septembre 2009, Ali Bongo, ministre de la Défense et fils d'Omar Bongo Ondimba, devient le troisième président du Gabon, élu à l'occasion d'un scrutin majoritaire à un tour, avec 41,79 % des suffrages exprimés, soit environ 141 000 voix sur un total de 800 000 électeurs inscrits. Il devance Pierre Mamboundou, crédité de 25,64 % des voix, et André Mba Obame, le nouveau chef de l'opposition gabonaise et ancien ministre de l'Intérieur. Les résultats sont fortement contestés et à la suite des forts soupçons de fraude, des émeutes éclatent et sont violemment réprimées par les forces de l'ordre, fidèles au pouvoir.
Par la suite, plusieurs enquêtes attestèrent que les scores avaient été truqués. Dans un documentaire diffusé sur France 2 en décembre 2010, le diplomate Michel de Bonnecorse, ex-conseiller Afrique du président Jacques Chirac, confirmera cette version des faits. L’ambassadeur américain Charles Rivkin, dans un télégramme transmis en novembre 2009 à la secrétaire d’État, le confirme également : « octobre 2009, Ali Bongo inverse le décompte des voix et se déclare président » (le télégramme sera divulgué par WikiLeaks en février 2011).
Depuis, le président Bongo prône le concept de « Gabon émergent », politique visant notamment à la diversification de l'économie afin de diminuer sa dépendance aux cours mondiaux du pétrole.
an 2009 : Guinée - Le 28 septembre 2009, des mouvements civils organisent une manifestation pacifique pour demander à Dadis Camara de respecter sa parole et de ne pas se présenter aux présidentielles. Une foule de plusieurs milliers de personnes s'était rendu au stade à la demande de l'opposition pour protester contre le désir du président Dadis de se porter candidat à l'élection présidentielle. Le 28 septembre 2009, au stade de Conakry, à la surprise générale les militaires ouvrent le feu sur les manifestants ainsi bloqués dans le stade sans possibilité de fuite. Ce massacre délibéré et manifestement planifié fait plusieurs centaines de morts. De plus, les militaires violent et enlèvent plusieurs dizaines de jeunes femmes, dont certaines seront libérées quelques jours plus tard après avoir subi des viols à répétition, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de trace.
À la suite du tollé international soulevé par cet évènement, des dissensions apparaissent au sein du CNDD34 et le 3 décembre 2009, alors que Sékouba Konaté est en voyage au Liban, le président est grièvement blessé par son aide de camp Aboubacar Sidiki Diakité - ce dernier avait été mis en cause explicitement par des diplomates étrangers pour son rôle dans le massacre du 28 septembre, et craignait d'être « lâché » par son président et livré à la justice. Dadis Camara est hospitalisé au Maroc le 4, et Sékouba Konaté rentre au pays pour assurer l'intérim.
an 2009 : Guinée-Bissau - le 1er mars 2009, le chef d'état-major des forces armées, le général Batista Tagme Na Waie, est tué dans un attentat à la bombe. Le président João Bernardo Vieira, que certains militaires tiennent pour responsable de cet attentat dans la mesure où il entretenait des relations historiquement exécrables avec ce dernier, est assassiné à son tour, le 2 mars 2009, par des hommes en armes. Pour lui succéder, Malam Bacai Sanhá, candidat du PAIGC, est élu président le 26 juillet 2009.
Parallèlement, la Guinée-Bissau est gangrenée par le trafic de drogue et qualifiée à ce titre de « narco-État » par l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime. Ainsi, les attentats contre le chef d'état-major Tagmé Na Waié et le président Vieira ont probablement été fomentés par les trafiquants colombiens, peut-être en représailles de la destitution en août 2008 du contre-amiral José Américo Bubo Na Tchuto, chef de la marine nationale, qui couvrait le trafic avec Antonio Indjai. Ce dernier, après bien des péripéties, tombera d'ailleurs en mars 2013 dans un piège tendu par la DEA et envoyé aux États-Unis pour y être jugé pour trafic de drogue tandis qu'Antonio Indjai est depuis lors inculpé par la justice américaine et sous mandat d'arrêt international.
Le mandat de Malam Bacaï Sanha est émaillé de graves incidents en lien avec le narcotrafic. Le 1er avril 2010, une tentative de coup d'État menée par Antonio Indjai et l'ancien contre-amiral José Américo Bubo Na Tchuto aboutit à l'arrestation du Premier ministre Carlos Gomes Júnior et d'une quarantaine d'officiers dont le chef d'état-major de l'armée, José Zamora Induta, dans un coup de force présenté comme « un problème purement militaire ». À la suite de manifestations de soutien au Premier ministre, Antonio Indjai menace de tuer ce dernier avant d'expliquer dans une allocution que l'armée « réitérait son attachement et sa soumission au pouvoir politique ». Le Premier ministre est relâché le lendemain tandis qu'Indjai se présente comme le nouvel homme fort de l'armée. Ce dernier est relâché le lendemain, mais demeure en résidence surveillée, tandis qu'Antonio Indjai devient le nouvel homme fort de l'armée.
an 2009 : Libéria - Constatant une certaine stabilité politique, la Banque européenne d'investissement accorde le 15 mai 2009 un prêt de 3,5 millions d'euros au Liberia pour le soutien de la micro finance dans ce pays ainsi que la suspension des remboursements de l'encours du solde de la dette jusqu'en 2012. Mais la corruption continue de gangrener le système politique, malgré les intentions initialement affichées.
an 2009 : Madagascar - À partir de janvier 2009, une crise politique entre le maire de la capitale Andry Rajoelina et le président Marc Ravalomanana fait une centaine de victimes. Le 16 mars 2009, le président Marc Ravalomanana démissionne. Il transfère les pleins pouvoirs à un Directoire militaire composé des plus hauts gradés de l'Armée malgache, en lieu et place du président du Sénat comme le prévoyait la constitution, lequel directoire (re)transfère le jour même le pouvoir à Andry Rajoelina. Cette prise de pouvoir, validée par la Haute Cour Constitutionnelle malgache (HCC), est toutefois considérée par une grande partie de la Communauté internationale comme un coup d'État. Du 17 mars 2009 au 25 janvier 2014, Andry Rajoelina dirige l’État malgache sous le régime de la Transition.
an 2009 : Mauritanie - En avril 2009, Mohamed Ould Abdel Aziz abandonne le pouvoir afin de se présenter à l'élection présidentielle promise par la junte. Un accord pour préparer les futures élections est signé à Dakar entre les représentants de l’opposition et de la junte.
Le 18 juillet, Mohamed Ould Abdelaziz, qui durant sa campagne se présente comme le « président des pauvres », est élu au premier tour face à 8 autres candidats, avec 52,58% des voix. Ses opposants dénoncent un « coup d’État électoral » et fondent une Coordination de l’opposition démocratique, qui inclut le RFD.
L'arrivée du président actuel Mohamed Ould Abdel Aziz, le 18 juin 2009, fut marquée notamment par la coupure de ces relations diplomatiques avec Israël.
an 2009 : Réunion (Ile de la) - le 23 juin, la route des Tamarins est ouverte à la circulation.
an 2009 : Mozambique - Le 28 octobre 2009, Armando Guebuza est réélu président pour un deuxième mandat, dès le premier tour de scrutin avec 75 % des voix
an 2009 : Ouganda - Des tensions apparaissent également avec le Kabaka (roi) du Buganda et dégénèrent en affrontements en 2009.
Dans un mouvement de populisme, une loi anti-homosexualité fut proposée en 2009 prévoyant jusqu'à la peine de mort pour les homosexuels et pénalisant les individus, entreprises, médias et ONG soutenant les droits des LGBT.
an 2009 : Sénégal - Lors des élections locales du 22 mars 2009, le PDS, parti au pouvoir, essuie un sérieux revers dans la plupart des grandes villes dont Dakar convoité par Karim Wade, au profit de la coalition d’opposition Bennoo Siggil Senegaal.
Après la démission de Cheikh Hadjibou Soumaré le 30 avril 2009, Souleymane Ndéné Ndiaye est nommé Premier ministre.
Septembre 2009 : des pluies torrentielles provoquent de violentes inondations dans le pays.
an 2009 : Somalie - Dès février 2009, divers groupes islamistes fusionnèrent au sein du Hizbul Islam et déclarèrent la guerre au gouvernement modéré de Sharif Ahmed. Cette coalition inclut l'Alliance pour la nouvelle libération de la Somalie, dirigée par Hassan Dahir Aweys, l'un des chefs radicaux de l'Union des tribunaux islamiques, Hassan Abdullah Hersi al-Turki, un autre commandant de l'Union des tribunaux islamiques et leader des brigades de Ras Kamboni et le groupe Muaskar Anole. Cette nouvelle coalition islamiste est, avec le groupe al-Shabaab, la plus active dans le conflit. De plus, en mars 2009, ben Laden appelait dans un enregistrement au renversement de Sharif Ahmed.
an 2009 : Soudan - En 2009, la Cour pénale internationale (CPI) lance un mandat d’arrêt contre le président soudanais Omar el-Béchir 4 mars 2009 pour crimes contre l’humanité (l’année suivante, l’accusation de génocide sera rajoutée).
an 2010 : Afrique du Sud - Coupe du Monde de football
an 2010 : Burkina Faso -Blaise Compaoré est réélu en 2010.
an 2010 : Burundi - Après cinq années, l'érosion du pouvoir conduit à un certain agacement au sein des autres groupes Hutus. Lorsque le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) de Pierre Nkurunziza obtient une majorité des 2/3 aux élections communales du 26 mai 2010, les partis Hutus signataires des accords d'Arusha dénoncent immédiatement des fraudes massives. L'ONU et l'Union européenne, qui supervisent le scrutin, assurent ne pas avoir observé de graves irrégularités.
Peu après, une émeute éclate dans un faubourg de Bujumbura : les manifestants ont découvert une urne remplie de bulletins non-décachetés dans un quartier acquis aux Hutus anti-Nkurunziza ; il y a plusieurs blessés. Le 2 juin, des dirigeants de l'opposition Hutu sont arrêtés, tandis que Ban Ki-moon arrive au Burundi pour appeler à la poursuite du processus électoral. Il ne rencontre que le président, ce qui est vécu par les opposants comme une trahison de la communauté internationale.
Le lendemain, les partis Hutu d'opposition (FNL, etc.) décident le boycott total de l'élection présidentielle du 28 juin. Le 5 juin, l'ancien président Domitien Ndayizeye décide de rejoindre la contestation. Le 7 juin, le gouvernement interdit toute campagne pour l'abstention, ce qui radicalise la divergence.
L'opposition burundaise refuse de participer à l'élection présidentielle du 28 juin 2010 et dénonce des fraudes lors des élections municipales de mai (le CNDD-FDD a remporté les municipales avec 64 % des voix et le déroulement de l'élection est jugé correct en regard des standards internationaux par les observateurs de l'Union européenne). La campagne est émaillée d'incidents, plusieurs membres de l'opposition sont arrêtés. Pierre Nkurunziza a été réélu président en 2010 avec plus de 91 % des voix, étant le seul candidat de l'élection. Les candidats de l’opposition s’étaient retirés pour protester contre les irrégularités du scrutin.
an 2010 : Congo Kinshasa - Depuis novembre 2010, l'ancienne mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUC qui n'était pas parvenue à désarmer les milices rwandaises, est renforcée militairement pour intervenir dans l'est du pays et devient la MONUSCO, mais plusieurs dissidences et révoltes persistent et de nombreuses violences continuent.
an 2010 : Afrique Côte d'Ivoire - À l'issue d'une élection présidentielle sous tension, les deux candidats arrivés au second tour, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, se déclarent vainqueurs et prêtent serment comme président du pays. Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur par Youssouf Bakayoko, le président de la Commission électorale indépendante, au siège du camp de Ouattara contrairement aux dispositions de ladite CEI, et a reçu le soutien du Premier ministre Guillaume Soro et d'une partie de la Communauté internationale. Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel et a reçu le soutien du général Philippe Mangou, commandant de l'armée. La Côte d'Ivoire se retrouve alors avec deux présidents tentant de s'imposer sur l'ensemble du pays.
Mais Alassane Ouattara bénéficie du soutien de la plus grande partie de la communauté internationale, ainsi que celui d'instances économiques et financières tant régionales qu'internationales. L'économie ivoirienne est paralysée par les sanctions et les finances de l'État ivoirien asséchées, notamment les zones encore contrôlées par Laurent Gbagbo.
an 2010 : Guinée - Arrivé au pouvoir, le capitaine précise que le nouveau régime est provisoire et qu'aucun membre de la junte ne se présentera aux élections présidentielles prévues en 2010.
Au fil de ses interventions médiatiques, Moussa Dadis Camara envisage de plus en plus explicitement de se présenter, décevant les espoirs de véritable transition démocratique et déclenchant des mouvements de protestation.
Le 12 janvier 2010, Moussa Dadis Camara est renvoyé vers le Burkina Faso par le Maroc pour y continuer sa convalescence. C'est ainsi que le 15 janvier, un accord sera trouvé entre Dadis et Sékouba pour que ce dernier soit reconnu Président de la transition. Cet accord stipule qu'un premier ministre issu des Forces Vives (Partis d'opposition, syndicats, société civile) soit nommé dans le but de former un gouvernement d'Union nationale et de conduire le pays vers des élections libres et transparentes dans les six mois. Aussi, aucun membre du gouvernement d'union nationale, de la junte, du Conseil national de la transition et des Forces de Défense et de Sécurité n'aura le droit de se porter candidat aux prochaines échéances électorales.
Le 16 janvier, Dadis, dans une allocution à partir du palais présidentiel burkinabé, dit que la question de sa candidature est définitivement réglée, ainsi que celle des autres membres de la junte. Jean-Marie Doré, doyen de l'opposition, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement d'union nationale chargé d'organiser les futures élections présidentielles.
Le 8 février 2010, la justice guinéenne ouvre un instruction judiciaire pour les crimes commis le 28 septembre 2009 à Conakry, trois magistrats instructeurs sont nommés et le 3 juin 2010, la FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen (OGDH), trois autres organisations guinéennes de victimes (AVIPA, AFADIS, AGORA) et 67 victimes se constituent parties civiles.
Le 7 mars 2010, Sékouba Konaté fixe par décret la date du premier tour de l'élection présidentielle au 27 juin 2010. Il tient parole et pour la première fois une élection présidentielle en Guinée se déroule sans qu'aucun militaire ne soit candidat. Le second tour des élections présidentielles devait se tenir le 19 septembre 2010 mais a été reporté à une date ultérieure.
Le 28 septembre 2010, un an après le massacre, les victimes et les ONG de défense des droits de l'homme demandent le jugement des auteurs présumés des faits.
Le 7 novembre 2010, Alpha Condé (candidat du RPG et de l'Alliance Arc-En-Ciel) obtient 52,5 % des suffrages face à son adversaire Cellou Dalein Diallo (candidat de l'UFDG et de l'Alliance des bâtisseurs), qui a fini par accepter les résultats de la cour suprême qu'il avait initialement contestés en raison de soupçons d'irrégularités. Le président Alpha Condé est élu pour un mandat de 5 ans.
an 2010 : Kenya - Le 4 août 2010, le texte de réforme de la Constitution, incluant la Charte des droits et libertés16, chère à Raila — et maintenant soutenu par Kibaki — est accepté, contre la position d'un autre membre influent de l'ODM, le ministre des Hautes études William Ruto — soutenu, lui, par l'ex-président Moi —, par la majorité des 72,1 % de Kényans ayant participé au référendum populaire (70 % de votes favorables contre 30 % de défavorables).
La cérémonie publique de promulgation par le président Mwai Kibaki de cette Constitution moderne16 le 27 août 2010 est entachée par la présence du président soudanais Omar el-Béchir alors qu'il est notifié d'un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Cette invitation, directement adressée par le président Kibaki suscite l'émotion et la réprobation des Kényans, de leur Premier ministre et des parlementaires. Les protestations de la Communauté internationale et en particulier celles du président américain Barack Obama — bien que les États-Unis n'aie pas ratifié le statut de Rome — et de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan sont rapides.
an 2010 : Leshoto - En 2010, peu avant la Coupe du monde de football, des milliers d’habitants ont demandé au gouvernement sud-africain l'annexion du pays pour en faire la dixième province d'Afrique du Sud. Fin mai, plusieurs centaines de personnes ont défilé dans la capitale, Maseru, et remis au Parlement et à l'ambassade d'Afrique du Sud une pétition demandant le rattachement. Plus de 30 000 signatures ont été recueillis et les raisons sont multiples : une situation économique extrêmement précaire, un taux de sida très élevé (400 000 personnes en sont atteints), une espérance de vie très basse (34 ans) et l'effondrement de l'industrie textile, ce qui rend la survie du pays extrêmement difficile, d'autant plus qu'il est totalement encerclé par l'Afrique du Sud et qu'il y a plus de Sothos vivant en Afrique du Sud qu'au Lesotho lui-même.
an 2010-2012 : Malawi - Mutharika remplace Muammar al-Gaddafi à la tête de l’Union africaine, devenant le premier chef d’état malawite à exercer la charge de secrétaire général de cette organisation. En 2011, le Malawi établit des relations diplomatiques avec 10 pays. Mais le second mandat de Mutharika est vite marqué par une dégradation brusque de l'économie, une dégradation des conditions de vie et des pénuries d'essence dues à un manque de confiance des bailleurs de fonds. Des émeutes éclatent, et le régime se durcit, s'appuyant sur l'armée. Finalement, le président Bingu wa Mutharika est victime d'un arrêt cardiaque le 5 avril 2012.
an 2010-2013 : Mali - En septembre 2010, sept étrangers, dont cinq Français, sont enlevés par Al-Qaida au Maghreb islamique. Treize mois plus tard, des Touareg maliens, ex-mercenaires en Libye, reviennent dans la partie nord du Mali : le contrôle de cette partie du pays semble échapper de plus en plus au pouvoir en place à Bamako entre les interventions de Al-Qaida au Maghreb islamique et ces forces Touaregs. Le 22 mars 2012, le capitaine Amadou Haya Sanogo dirige un coup d’État militaire. Quelques mois plus tard, soumis également à une pression internationale, il rend le pouvoir à des autorités civiles, pour une période de transition, avec comme président par intérim Dioncounda Traoré. Celui-ci organise une élection présidentielle qui se tient les 28 juillet et 11 août 2013 et s'achève par la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta auquel Dioncounda Traoré transmet le pouvoir le 4 septembre suivant.
Pendant ce temps, durant cette même année 2012, profitant des bouleversements politiques successifs à Bamako, les événements s'accélèrent dans le nord du pays et dans le Sahel, au centre du pays. De mars à septembre 2012, les villes de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti tombent aux mains des islamistes qui se rapprochent des régions du sud. Le 23 septembre 2012, Le Mali et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) s'accordent sur le déploiement d'une force africaine. Le 21 décembre 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies autorise par une résolution le déploiement d'une force africaine au Mali. Le 11 janvier 2013, les troupes françaises interviennent en appui de cette force africaine, c'est le début de l'opération Serval.
an 2010 : Mauritanie - La Mauritanie a suspendu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009 avant de "rompre complètement et définitivement les relations avec Israël" le 21 mars 2010. Ces relations avaient été établies en 1999 par le président de la République à l'époque, Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya.
Sous le président Abdel Aziz, la Mauritanie s’est érigée en garante de la lutte contre la menace terroriste, tout en adoptant des lois qui définissent les infractions terroristes en termes vagues. La loi antiterroriste adoptée en 2010 a ainsi permis aux autorités de museler plusieurs opposants politiques, comme Abdallahi Salem Ould Yali, activiste issu de la communauté «haratine», descendants d’esclaves, qui a été poursuivi pour incitation au fanatisme ethnique ou racial pour avoir diffusé des messages dénonçant la discrimination dont est victime son groupe ethnique dans un groupe de discussion WhatsApp, ou encore, en 2015, le colonel de la Garde nationale à la retraite Oumar Ould Beibacar, qui dénonçait les exécutions sommaires de ses co-officiers en 1992 dans une purge d’officiers noirs de l’armée mauritanienne.
an 2010 : Niger - Le 31 octobre 2010, par l'adoption d'une nouvelle constitution, la VIIe République est proclamée. L'armée promet de rendre le pouvoir aux civils en 2011. Une élection présidentielle a lieu effectivement en janvier 2011 et voit s'affronter 10 candidats. Mahamadou Issoufou (1952-), investi par le PNDS, arrive en première position lors du premier tour. Avec 36,06 % des suffrages exprimés, il est opposé au second tour, le 12 mars 2011, à Seyni Oumarou du MNSD. Avec le soutien du MODEN-FA (Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine) de Hama Amadou (qui deviendra président de l'Assemblée nationale), il s'impose au second tour avec 57,95 % des voix. Il est investi le 7 avril 2011 et nomme Brigi Rafini Premier ministre.
an 2010 : Rwanda - En 2010, les opposants ont une marge de manœuvre très réduite. Ainsi, par exemple, l'opposante Victoire Ingabire, présidente des FDU-Inkingi (Forces démocratiques unies) est arrêtée pour négation du génocide, lorsqu'elle exprime la nécessité de réconciliation. Une loi de 2008 punit de dix à vingt-cinq ans de prison « l'idéologie du génocide », avec une formulation « rédigée en termes vagues et ambigus », selon Amnesty International, qui y voit un moyen de « museler de manière abusive la liberté d'expression ».
À l'approche de l'élection présidentielle rwandaise de 2010, deux autres rédacteurs en chef de journaux sont contraints de quitter le Rwanda. Les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis, la France et l'Espagne expriment publiquement leurs préoccupations. Paul Kagame est réélu à cette élection présidentielle, avec plus de 93 % des suffrages exprimés.
an 2010 : Sénégal - Février 2010 : un projet de loi déclarant l’esclavage “crime contre l’humanité” est exposé par le chef de l’Etat.
Abdoulaye Wade annonce également la fermeture de la base militaire française à Dakar.
an 2010 : Somaliland (ou Somalie Britanique) - Le 26 juin 2010, Ahmed Silanyo est élu président de la République, et succède à Riyale Kahin un mois plus tard.
Un conflit frontalier s'installe entre l'État du Somaliland et la région autonome du Pount.
an 2010 : Togo - En 2010 est organisée une élection présidentielle, où le président Faure Gnassingbé est réélu avec 61 % des voix. Gilchrist Olympio, candidat naturel de l'UFC, a été remplacé au dernier moment par Jean-Pierre Fabre.
Des heurts ont lieu en protestation à cette élection entre militants de la coalition et forces de l'ordre. Les élections ont été dénoncées par l'Union européenne, finançant les élections, qui au travers de ses observateurs a constaté des irrégularités dans la campagne électorale.
an 2010 - 2011 : Tunisie - En décembre 2010, la situation économique et sociale est très difficile. Le chômage, en particulier celui des jeunes diplômés, est très important. Le suicide d'un jeune commerçant empêché par la police de pratiquer son commerce déclenche un vaste mouvement de protestations. Des manifestations répétées, qui s'appuient sur les réseaux sociaux permis par l'internet, parviennent le 14 janvier 2011 à chasser du pouvoir le président Ben Ali. C'est la révolution tunisienne de 2010-2011, qui a lieu en même temps que d'autres mouvements dans des pays arabes : le Printemps arabe.
an 2011 : Afrique du Sud - Les élections municipales sont marquées par une baisse relative de l'ANC (62 %), qui l'emporte cependant assez largement, et par la montée de l'Alliance démocratique (24 % des voix) qui s'impose dans la majorité des municipalités du Cap-Occidental
an 2011 : Algérie - Du 3 au 10 janvier, des émeutes contre le pouvoir et contre la vie chère font cinq morts et plus de huit cents blessés. Le gouvernement décide de baisser les prix de plusieurs denrées de base, comme le sucre ou l’huile.
Le 12 février, une marche dans la capitale, réunissant deux mille manifestants à l’initiative de la Coordination nationale pour le changement et la démocratie (CNCD), est bloquée par trente mille policiers.
Le 15 avril, il promet une série de réformes politiques. La nouvelle loi sur l’information, adoptée le 12 septembre, met fin au monopole de l’Etat sur l’audiovisuel et consacre l’ouverture du secteur au privé. Le délit de presse est dépénalisé. Le gouvernement s’engage également à « conforter le pluralisme démocratique ».
Le 3 novembre, les députés rejettent le projet de loi sur la représentativité des femmes au Parlement et dans les assemblées locales, présenté en août par M. Bouteflika. Le texte initial portait le quota de femmes de 7 % à 30 %. La nouvelle mouture, qui prévoit une représentation variable selon la taille des circonscriptions, réduit de fait la possibilité pour les femmes d’être élues.
an 2011 - 2016 : Bénin - Le président Boni Yayi a été réélu pour un second mandat lors des élections présidentielles de mars 2011. Obtenant plus de 55 % des voix, contre 35 % pour son principal concurrent Adrien Houngbédji, Boni Yayi a été élu dès le premier tour. Il s'est engagé, dès sa prise de fonction, à ne pas modifier la constitution dans le but de briguer un troisième mandat et quitte donc ses fonctions en mars 2016, à l'issue des prochaines élections présidentielles. Lui succède Patrice Talon, candidat indépendant et ancien homme d'affaires.
an 2011 : Burkina Faso - La révolte de 2011 secoue le pays en même temps que le Printemps arabe.
an 2011 : Cap Vert - Depuis 2011, le président est le dirigeant du MPD Jorge Carlos Fonseca.
En raison de sa stabilité politique et de la régularité des élections, le Cap-Vert est considéré comme l'un des pays africains les plus démocratiques.
an 2011 : Afrique Côte d'Ivoire - Les combats éclatent à Abidjan à la fin du mois de février 2011 entre le « Commando invisible » hostile à Gbagbo et l'armée régulière. Puis, début mars, la tension gagne l'ouest du pays, où les Forces nouvelles prennent le contrôle de nouveaux territoires. L'ensemble du front finit par s'embraser à la fin mars, et les forces pro-Ouattara, rebaptisées Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), prennent Yamoussoukro, la capitale politique du pays, le 30 mars. À partir de ce moment-là, les événements s'accélèrent : le sud du pays est conquis en quelques heures et les troupes pro-Ouattara entrent dans Abidjan sans rencontrer de réelle résistance (mais non sans commettre de nombreuses exactions sur les populations civiles).
Laurent Gbagbo et son épouse se retranchent à la Résidence présidentielle, protégés par un dernier carré de fidèles dont la Garde Républicaine dirigé par le colonel Dogbo Blé Bruno. La Résidence est assiégée par les forces pro-Ouattara qui ont du mal à accéder à la Résidence malgré plusieurs tentatives. Un assaut final est lancé contre le domicile le 11 avril avec l'appui des forces onusiennes et surtout de l'armée française (en application de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU). Laurent Gbagbo (accompagné de sa famille) est fait prisonnier, puis placé en état d'arrestation à l'hôtel du Golf. Il est ensuite transféré à Korhogo dans le nord du pays, où il est placé en résidence surveillée. Quelques jours plus tard, son épouse, qui n'a pas été autorisée à le suivre, sera placée quant à elle en résidence surveillée à Odienné, une autre localité du nord ivoirien. Depuis le 30 novembre 2011, Laurent Gbagbo est incarcéré à la Cour pénale internationale où il est inculpé pour quatre chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Les forces pro-Ouattara sont soupçonnées de s'être livrées à des exactions sur des populations supportant Laurent Gbagbo (massacre du camp de Nahibly et Duekoué). Dans le cas de Duekoué, l'ONU explique que les forces pro-Gbagbo seraient aussi impliquées.
an 2011 : Afrique République de Djibouti - Au début de 2011, des manifestations inspirées par le Printemps arabe sont réprimées.
an 2011 : Gambie - En 2011, Jammeh est réélu à 72 % des suffrages. Il déclare être « prêt à diriger le pays un milliard d’années ». Son opposant Darboe qualifie le scrutin de « frauduleux et grotesque ». La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest estime elle aussi que les élec Le gouvernement de Jammeh devient de plus en plus policier, il ignore les ONG et la Commission Africaine des droits de l’homme. Sont dénoncés par ces derniers le traitement discriminatoire des homosexuels, l’usage de la torture et la violence des services de renseignement, surnommés les « Jungelers ».
an 2011 : Kenya - Faisant suite à l'enlèvement d'une touriste britannique et à l'assassinat de son mari le 11 septembre 2011, à l'enlèvement d'une résidente franco-kényane le 1er octobre et enfin, le 13 octobre, à l’enlèvement de deux volontaires humanitaires espagnoles ainsi qu'à l'assassinat de leur chauffeur kényan, des unités militaires des forces armées kényanes entrent en Somalie le 16 octobre à la poursuite des miliciens d'Al-Shabaab. Cependant, Alfred Mutua, le porte-parole du gouvernement déclare, le 26 octobre, que l'opération militaire était planifiée depuis longtemps et que les enlèvements n'ont été qu'une aire de lancement (« the kidnappings were more of a good launchpad. »). Cette « invasion » donne lieu à des représailles de la part d'Al-Shabaab (cf. section détaillée : « Attentats »).
2011-2013 : Égypte - Hosni Moubarak est Président de la République jusqu'en février 2011, date de sa démission contrainte à la suite de la Révolution égyptienne de 2011. Hosni Moubarak poursuit la politique de libéralisation de l’économie, notamment par la réduction des subventions à l'agriculture et à la consommation, et par la libéralisation des prix. En 1992, il fait annuler les dispositions régissant la location des terres. Généralement appelée « loi pour chasser les paysans de leurs terres », cette loi, combinée aux autres mesures de désengagement de l’État dans l’économie, accroît le mécontentement des populations rurales pauvres en particulier en Haute-Égypte. Hosni Moubarak devient un pilier de la stratégie régionale des États-Unis et la Constitution qu'il met en place reconnait les « principes de la charia » comme source principale de la législation.
En janvier et février 2011, une série de manifestations d'ampleur inégalée se déroulent à travers le pays et mènent à la démission d'Hosni Moubarak le 11 février. Les nouvelles élections législatives et présidentielle sont remportées par le Parti de la liberté et de la justice, le bras politique des Frères musulmans.
Le pouvoir n'est cependant resté que peu de temps entre leurs mains car d'importantes manifestations contre le président élu, Mohamed Morsi, critiquant des dérives dictatoriales, et le retournement de l'armée contre celui-ci le destitue en faveur d'un gouvernement transitoire un an seulement après son élection. L'Égypte connait depuis une période de troubles causée par l'instabilité et les tensions politiques, notamment entre les opposants à l'ex-président et ceux qui continuent à le soutenir et n'acceptent pas ce qu'ils voient comme un coup d'État illégal.
an 2011-2018 : Éthiopie - En 2011, une crise alimentaire touche une grande partie de la Corne de l'Afrique. Dans la nuit du 20 au 21 août 2012, Meles Zenawi décède en pleine fonction après 21 ans au pouvoir. Conformément à la Constitution (article 73), Haile Mariam Dessalegn est désigné comme Premier ministre par la Chambre des représentants des peuples. Les Oromos, ethnie majoritaire avec plus du tiers de la population, entrent en rébellion en novembre 2015. Les Amharas, un quart de la population, font de même en août 2016. L'état d'urgence est décrété le
9 octobre 2016. Haile Mariam Dessalegn démissionne en février 2018 à la surprise générale. Le 2 avril 2018, Abiy Ahmed lui succède. Cet homme politique de longue date est populaire parmi les Oromos dont il est issu. Dès son discours d’investiture, il tend la main à l’Érythrée, en appelant à mettre fin à un conflit qui dure depuis l’indépendance du pays, en 1993. Il qualifie également les partis d’opposition de frères et non d’ennemis. La situation intérieure et les relations avec les pays voisins s’apaisent.
an 2011 : Libéria - Ellen Johnson Sirleaf remporte à nouveau l’élection présidentielle de 2011. Le taux de participation aux votes est faible, 37,4 %
an 2011 : Libye - La guerre civile de 2011
En 2011, dans le contexte du « Printemps arabe », le mécontentement populaire contre le régime de Kadhafi s'affirme désormais ouvertement. La violente répression des manifestations dans le pays, durant laquelle la troupe tire à l'arme lourde sur la population, débouche en février sur une véritable guerre civile. L'Est du pays échappe bientôt au contrôle de Kadhafi, et un gouvernement provisoire, le Conseil national de transition (CNT), est formé à Benghazi. Mais les troupes de Kadhafi contre-attaquent rapidement, et reprennent progressivement le contrôle du pays. Alors que Benghazi est directement menacée, le Conseil de sécurité des Nations unies vote la résolution 1973, autorisant en mars une intervention militaire internationale qui fournit aux rebelles un appui aérien et leur évite d'être écrasés. Au bout de six mois de conflit, les forces du CNT prennent Tripoli le 23 août. Kadhafi, ayant quitté la capitale, est mis à prix et visé par un mandat d'arrêt international. Le 16 septembre, le CNT est reconnu comme gouvernement de la Libye par l'Assemblée générale des Nations unies. À l'automne 2011, les partisans de Kadhafi tiennent encore plusieurs bastions, principalement Syrte et Bani Walid.
Le 20 octobre 2011, Syrte est la dernière ville kadhafiste à tomber aux mains des forces du Conseil national de transition. Mouhammar Kadhafi est capturé et tué le jour même.
La « libération » du pays est officiellement proclamée le 23 octobre; le même jour, le président du CNT, Moustafa Abdel Jalil, annonce que la future législation de la Libye serait fondée sur la charia. Cette déclaration ayant suscité l'inquiétude des gouvernements occidentaux, il déclare vouloir « assurer à la communauté internationale que nous, les Libyens, sommes des musulmans modérés ». Un référendum est annoncé pour approuver la future constitution. Le 22 novembre, un nouveau gouvernement, dirigé par Abdel Rahim al-Kib, est mis en place41. Kadhafi ayant laissé derrière lui un vide politique, et un pays dépourvu d'institutions réelles, d'armée structurée, et de traditions démocratiques, la Libye apparaît bientôt comme un pays très instable, en proie au désordre et à la violence.
an 2011 : Mauritanie - Durant deux mois, entre le 24 septembre et le 28 novembre 2011, le collectif "Touche pas à ma nationalité" organise plusieurs manifestations pour protester contre le recensement national.
an 2011-2021 : Ouganda - Museveni se fit réélire à nouveau en 2011 et 2016, nouveaux scrutins présidentiels après ceux de 1996, 2001, et 2006, chaque fois au premier tour, et avec des soupçons de fraude. Il fit procéder aussi à un nouveau changement de constitution fin 2017,pour supprimer la limite d'âge de 75 ans s'appliquant aux candidats à cette élection présidentielle et à lui en tout premier lieu. Il instaura également une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux et fin août 2018, fit arrêter et battre un député d'opposition, Robert Kyagulanyi Ssentamu (en), connu également comme ex-chanteur sous le nom de Bobi Wine. Libéré, celui-ci se fit soigner aux États-Unis avant de revenir en Ouganda en septembre 2018 et d'être à nouveau inculpé. Constituant l'un des leaders de l'opposition ougandaise, Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine, affrontera le président sortant Yoweri Museveni, qui est au pouvoir depuis 1986, lors des élections présidentielles qui se tient le 14 janvier 2021, Yoweri Museveni est réélu.
an 2011 : Sénégal - Février 2011 : Dakar rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran, accusé d’avoir livré des armes aux rebelles indépendantistes de Casamance, où la recrudescence de la violence depuis fin décembre 2010 a causé la mort d’au moins seize soldats sénégalais.
Juin 2011 : face à la fronde de la rue, Abdoulaye Wade renonce à une réforme constitutionnelle qui prévoyait de faire élire un ticket présidentiel, au premier tour, avec 25% seulement des suffrages exprimés. On le soupçonnait de vouloir assurer sa réélection et de préparer la succession pour son fils Karim.
an 2011 : Seychelles - L'élection présidentielle de mai 2011 voit la réélection du président Michel qui remporte 55,4 % des suffrages exprimés, contre 41,4 % à Wavel Ramkalawan. Il se présente une troisième et dernière fois à l'élection présidentielle de 2015, remportant le scrutin avec 50,15 % des suffrages exprimés contre 49,85 % à son adversaire, Wavel Ramkalawan. Mais il est contraint d'attendre le second tour de l'élection, alors qu'il avait été élu dès le premier tour aux élections précédentes.
an 2011-2017 : Somalie - En octobre 2011, l'armée kényane, appuyée par les troupes somaliennes, intervient dans le conflit, lançant l'opération Linda Nchi (« protéger le pays » en swahili) contre les positions d'Al-Shabaab.
Les relations entre la Somalie et la Turquie (en) contribuent à la relative stabilisation du pays. La Turquie, qui fournit une aide humanitaire et économique importante depuis 2011, ouvre une base militaire à Mogadiscio en septembre 2017
an 2011 : Soudan du Sud - En 2011, le Sud du Soudan accède à son indépendance sous le nom de Soudan du Sud. Mais en 2012, Le conflit au Kordofan du Sud s'envenime. Président de la république – 9 juillet 2011 : Salva Kiir Mayardit, également appelé Salva Kiir, né le 13 septembre 1951 dans le Bahr el-Gahzal.
an 2011 : Tchad - Jusqu'en 2011, le Tchad alimentait un flux migratoire important vers la Libye : on estime qu'au moins 500 000 Tchadiens vivaient dans ce pays en 2006. Les échanges transsahariens assuraient une relative prospérité à des villes frontalières comme Abéché. Cependant, depuis la première guerre civile libyenne en 2011, l'instabilité de ce pays rend ces échanges aléatoires ; la frontière entre la Libye et le Tchad est devenue une zone de non-droit dominée par les contrebandiers et les groupes armés.
an 2011 : Tunisie - Après la révolution et l'élection de l'Assemblée constituante, celle-ci vote une loi constituante le 10 décembre 2011 ; le nouveau texte indique dans son article 9 que le candidat à la présidence doit être musulman, de nationalité tunisienne uniquement, issu de parents tunisiens et âgé d'au moins 35 ans ; il doit démissionner, une fois élu, de toute responsabilité à l'Assemblée constituante et au sein de son parti.
an 2011 - 2014 : Zambie - À la suite de la dégradation de l'état de santé de Mwanawasa, le vice-président Rupiah Banda assure l'intérim. Après la mort du président en août 2008, Banda est élu quatrième président du pays et le reste jusqu'en septembre 2011. Le chef de l'opposition Michael Sata lui succède, et devient le cinquième président de la Zambie. Il décède à son tour, à la suite d'une maladie à Londres le 28 octobre 2014.
an 2012 : Afrique du Sud - Centenaire de l'ANC. Festivités à Bloemfontein, son lieu de naissance.
Le massacre de Marikana en 2012, où la police tire sur des salariés grévistes faisant des dizaines de morts, entache la gouvernance de l'ANC au sein de son électorat mais lors des élections générales sud-africaines de 2014.
an 2012-2013 : République de Centrafrique - En décembre 2012, le pays est à nouveau dans une situation insurrectionnelle. Une coalition rebelle prenant le nom de Séléka (Alliance en langue sango) s'est constituée contre le régime de Bozizé. Réunissant au moins trois mouvements préexistants, cette coalition, qui dispose de troupes bien armées et disciplinées, a pris le contrôle de la ville diamantifère de Bria le 18 décembre, avant de progresser rapidement vers la capitale. Le président Bozizé espéra un temps obtenir un soutien militaire de la France ou des États-Unis, mais ces deux pays choisissent de ne pas intervenir.
Les rebelles dénoncent la non-tenue des accords par le président Bozizé, et reprennent les armes fin 2012, lançant une série d'attaques démarrant la deuxième guerre civile centrafricaine. Le 24 mars 2013, les rebelles de la coalition Seleka s'emparent de Bangui et Bozizé s'enfuit. Michel Djotodia s’auto-proclame président de la République centrafricaine. Mais les nombreuses exactions commises par les miliciens de la Seleka, majoritairement musulmans, amènent l'insécurité dans le pays, et des milices d'auto-défense, les anti-balaka se forment. Le conflit débouche sur une situation « pré-génocidaire » selon la France et les États-Unis. Le 5 décembre 2013, une résolution de l'ONU permet à la France d'envoyer des troupes armées en République centrafricaine (opération Sangaris) aux fins annoncées de désamorcer le conflit et de protéger les civils.
an 2012-2013 : Égypte - En juin 2012, Mohamed Morsi remporte l'élection présidentielle et devient ainsi le premier président du pays élu au suffrage universel dans une élection libre. Un an après son arrivée au pouvoir, le président Morsi est massivement contesté par l'opposition qui regroupe diverses factions entre laïcs de gauche, anciens partisans du régime de Moubarak et différents groupes révolutionnaires, dont Tamarod (Rebellion). Une grande partie de la population reproche au nouveau président une dérive dictatoriale et une politique menée dans le seul intérêt de son organisation, les Frères musulmans. Après des rassemblements massifs dans tout le pays, l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Sissi, lance un dernier ultimatum le 1er juillet 2013. Celui-ci est rejeté le lendemain par Mohamed Morsi qui défend sa légitimité en soulignant qu'il a été élu démocratiquement, avec 52 % des voix. Cependant, selon des observateurs, l'ultimatum a été lancé dès le mois d'avril 2013, par la coalition des opposants, alors que la situation économique était au plus mal.
an 2012 : Ghana - À la suite du décès du président en exercice le 24 juillet 2012, le vice-président John Dramani Mahama lui succède à la tête de l’État
an 2012 : Guinée-Bissau - Le 12 avril 2012, un coup d'État mené par l'armée dépose le premier ministre Carlos Gomes Júnior dans le contexte d'une élection présidentielle contestée. La CEDEAO et la CPLP prennent des positions fortes contre ce coup d'état et examinent les possibilités d'intervention politique et militaire. L'Union africaine suspend la Guinée-Bissau le 17 avril 2012. Mamadu Ture Kuruma devient de facto le dirigeant du pays. Manuel Serifo Nhamadjo, président de l'Assemblée nationale populaire, devient président de la République par intérim.
an 2012 : Libye - Le 7 juillet 2012, la Libye organise l'élection du Congrès général national, premier scrutin démocratique de son histoire. Elle se déroule dans un climat de tensions, les milices fédéralistes de Cyrénaïque se montrant hostiles au pouvoir central de Tripoli. Parmi les nombreux partis politiques formés après la chute de Kadhafi, les islamistes apparaissent comme les grands perdants du premier scrutin : l'avantage revient aux libéraux, et notamment à l'Alliance des forces nationales dirigé par Mahmoud Jibril, qui n'a cependant pas la majorité absolue. Le Congrès général national (CGN), une assemblée de 200 membres, succède au Conseil national de transition48. Mohamed Youssef el-Megaryef, islamiste modéré et opposant de longue date à Kadhafi, est élu en août président du CGN, soit chef de l'État par intérim ; en octobre, le diplomate Ali Zeidan, ancien porte-parole du CNT, devient chef du gouvernement. Le climat de violence ne cesse pas pour autant en Libye :
le 11 septembre 2012 — anniversaire des attentats de 2001, mais également dans le contexte de l'affaire du film L'Innocence des musulmans — le consulat des États-Unis à Benghazi est attaqué par un groupe armé. Quatre Américains sont tués, dont l'ambassadeur J. Christopher Stevens.
an 2012-2014 : Malawi - Conformément à la Constitution, la vice-présidente Joyce Banda est officiellement investie présidente du Malawi le 7 avril 2012 à la suite du décès de Bingu wa Mutharika. Ses premières décisions politiques la démarquent de son prédécesseur. Elle s'efforce notamment de restaurer les bonnes relations du Malawi avec les pays développés afin que l'aide internationale reprenne pleinement, notamment en revenant sur des décisions monétaires et, dans le domaine social, en dépénalisant les actes homosexuels.
an 2012 : Mauritanie - En mars 2012, Abdallah al-Senoussi, le beau-frère de Mouammar Kadhafi et ancien chef des renseignements militaires libyens recherché par la Cour pénale internationale est arrêté à Nouakchott. Il est finalement remis aux autorités libyennes, six mois plus tard, après de longues tractations. Le premier ministre libyen Ali Zeidan accuse la Mauritanie d'avoir exigé un paiement de 200 millions de dollars en échange de l'extradition Abdallah al-Senoussi.
Le 12 octobre 2012, le président Mohamed Ould Abdelaziz est blessé par balle par une patrouille militaire. Il est évacué vers la France pour y être soigné à l'hôpital Percy-Clamart près de Paris.
Situation sanitaire et humanitaire
Depuis 2012, près de 60.000 réfugiés peuls, touaregs et arabes venus du Mali, fuyant les violences des groupes jihadistes ou de l’armée malienne, ont élu domicile dans le camp de Mbera, en Mauritanie. Leur accès à l'eau potable est précaire.
an 2012 : Sénégal - Janvier 2012 : le Conseil constitutionnel se prononce pour une nouvelle candidature, jugée anticonstitutionnelle par ses opposants, du chef de l’Etat à la présidentielle de février. Il rejette la candidature du chanteur Youssou N’Dour. Cette décision provoque la colère de l’opposition.
25 mars 2012 : L’ex-premier ministre Macky Sall devient le nouveau chef de l’État sénégalais en battant au second tour de la présidentielle son rival Abdoulaye Wade qui a reconnu sa défaite avant même les résultats officiels d’un scrutin qui s’est déroulé pacifiquement.
“Mes chers compatriotes, à l’issue du second tour de scrutin de dimanche, les résultats en cours indiquent que M. Macky Sall a remporté la victoire“, a déclaré le président Wade, selon un communiqué diffusé dans la soirée par la présidence.
“Comme je l’avais toujours promis, je l’ai donc appelé dès la soirée du 25 mars au téléphone pour le féliciter“, a expliqué le chef de l’État sortant.
“Ce soir, un résultat est sorti des urnes, le grand vainqueur reste le peuple sénégalais“, a déclaré de son côté Macky Sall lors d’une conférence de presse dans la nuit dans un grand hôtel de la capitale. “Je serai le président de tous les Sénégalais“, a-t-il promis, remerciant notamment le président Wade pour son appel téléphonique.
27 mars 2012 : Macky Sall est le vainqueur de l’élection présidentielle avec 65,80% des suffrages, selon les résultats officiels provisoires annoncés par la Commission nationale de recensement des votes. Le président sortant Abdoulaye Wade obtient, lui, 34,20% des voix. Le taux de participation est à 55% des inscrits, toujours selon les mêmes résultats officiels provisoires.
Résultats officiels mardi 27 ou mercredi 28. “Ce soir une ère nouvelle commence pour le Sénégal”, s’est félicité le vainqueur du scrutin, qui lui aussi a salué la maturité des électeurs et de la démocratie sénégalaise. “L’ampleur de cette victoire aux allures de plébiscite exprime l’immensité des attentes de la population, j’en prends toute la mesure. Ensemble, nous allons nous atteler au travail“, a-t-il conclu. “C’est encore une preuve de la maturité du peuple sénégalais et de la classe politique“, a commenté le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), chargée de superviser le scrutin.
Macky Sall prendra ses fonctions le 1er avril 2012.
3 avril 2012 : Le président Macky Sall nomme Abdoul Mbaye Premier ministre. Chef d’entreprise et banquier de formation, 59 ans, Abdoul Mbaye doit former le nouveau gouvernement du Sénégal sans dépasser les 25 personnes. La nomination de M. Mbaye a été précédée du premier discours à la nation de Macky Sall qui a dit vouloir un règlement pacifique du conflit casamançais qui dure depuis près de trente ans.
an 2012 : Sierra Leone - Ernest Bai Koroma, principal opposant, candidat du Congrès de tout le peuple (APC), ex-parti unique écarté du pouvoir depuis quinze ans, succède à Ahmad Tejan Kabbah, battant au second tour son adversaire, Solomon Berewa, vice-président et candidat du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) avec 54,6 % des suffrages. Il est réélu pour un deuxième et dernier mandat le 17 novembre 2012 en remportant 58,7 % des suffrages contre 37,4 % pour son adversaire, le général Julius Maada Bio, brièvement chef de l'État en 1996. Il a maintenu la paix, amélioré le réseau routier et la fourniture en électricité, même si celle-ci reste déficiente. Pour autant, le pays reste un des plus pauvres d'Afrique, malgré ses mines de diamant.
an 2012 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
En décembre 2012, est créé le Mouvement Madère-Autonomie (MMA), visant à redéfinir le statut actuel d'autonomie, pour le développement des activités civiques, des valeurs démocratiques, de l'autonomie régionale réelle.
an 2013 : Afrique du Sud - le 5 décembre, mort de Nelson Mandela à Johannesburg.
an 2013 : Algérie - 27 avril 2013 le président Abdelaziz Bouteflika a eu un accident vasculaire cérébral (AVC) qui a affecté sa mobilité et son élocution
an 2013 : République de Centrafrique - Face au risque de génocide, la France annonce, le 26 novembre 2013, l'envoi d'un millier de soldats pour rétablir la sécurité dans le pays. Le 5 décembre 2013, par la résolution 2127, le conseil de sécurité des Nations unies autorise le « déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) pour une période de 12 mois » officiellement pour mettre fin à la « faillite totale de l'ordre public, l'absence de l'état de droit et les tensions interconfessionnelles ». La MISCA est appuyée par des forces françaises (opération Sangaris), autorisées à prendre « toutes les mesures nécessaires ».
an 2013 : Congo Kinshasa - Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise appuyée par une brigade d'intervention de l'ONU chasse les rebelles du M23 des dernières positions qu'ils occupaient dans les montagnes du Nord-Kivu, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda, les rebelles déposent les armes et dissolvent leur mouvement en décembre 2013 dans un traité de paix signé à Nairobi.
an 2013-2014 : Afrique République de Djibouti - En 2013, les élections législatives aboutissent à une grave crise électorale et une répression du régime contre l'Union pour le salut national (USN), coalition des sept partis djiboutiens d'opposition. Elle aboutit à la signature entre cette dernière et le gouvernement d'un accord-cadre politique le 30 décembre 2014. Les dix députés de l'opposition qui commencent à siéger peu de temps après sont les premiers depuis l’indépendance.
an 2013-2013 : Égypte - Mohamed Morsi est remplacé par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Adli Mansour, qui prête serment comme président par intérim. Le 4 juillet 2013, on apprend que Mohamed Morsi est détenu par l'armée et que des mandats d'arrêt sont émis à l'encontre des dirigeants des Frères musulmans. Le 5 juillet 2013, le Parlement est dissous. Le 26 juillet 2013, l'armée déclare que Mohamed Morsi est en prison dans l'attente de son procès pour collusion avec le mouvement palestinien du Hamas.
Fin 2013, le nouveau pouvoir militaire est à son tour la cible de contestations, notamment à cause de la répression de manifestations et de l'arrestation d'activistes démocrates.
an 2013 : Gambie - Alors qu'elle en est membre depuis 1965, la Gambie, par la voix de son ministre de l'Intérieur, annonce le 2 octobre 2013 son retrait du Commonwealth. Le pays refuse les injonctions du Royaume-Uni au sujet des droits de l'homme alors que le régime du président Yahya Jammeh se fait plus autoritaire et accuse l'organisation d'être néo-coloniale.
an 2013-2022 : Kenya - Pour la première fois des débats présidentiels télévisés sont organisés les 11 et 25 février 2013. Également, pour la première fois, certains bureaux de vote sont équipés pour transmettre électroniquement les résultats vers la commission indépendante IEBC chargée de comptabiliser les résultats des élections générales.
Huit candidats ont posé leur candidature lors de l'élection présidentielle du 4 mars 2013. Pour l'emporter au premier tour, un candidat doit réunir au moins 25 % des votes dans au moins 24 comtés différents et 50 % de l'ensemble des votes plus un (majorité absolue).
Depuis la première élection présidentielle multipartisme de 1992, l'appartenance d'un candidat à tel ou tel groupe tribal a toujours été un élément important dans le choix des électeurs. Uhuru Kenyatta avec son colistier William Ruto sont respectivement kikuyu et kalenjin (premier et quatrième groupe tribal du pays) alors que son adversaire Raila Odinga et son colistier Kalonzo Musyoka sont luo et kamba (troisième et cinquième groupe). Uhuru Kenyatta est déclaré vainqueur dès le premier tour de l'élection du 4 mars 2013 avec 50,07 % des suffrages devant Raila Odinga avec 43,31 %. Ce dernier conteste les élections et, conformément à la possibilité donnée par l'article 140.1 de la Constitution, dépose, en date du 16 mars 2013 une pétition à la Cour suprême pour contester la validité du scrutin présidentiel arguant des bourrages d'urnes, les dysfonctionnements du système électronique de transmission vers l'IEBC et l'inorganisation de cette dernière. La Cour rend son jugement le 30 mars suivant en déclarant que « l'élection générale fut libre et impartiale » et que « Uhuru et son colistier Ruto ont été valablement élus » et en publie la version intégrale le 16 avril.
Présidence de Uhuru Kenyatta
Uhuru Kenyatta est investi en tant que 4e président du Kenya le 9 avril 2013 au centre sportif international Moi de Kasarani (Nairobi).
D'emblée, il s'oppose à la demande des députés d'obtenir une augmentation de 60 % de leur salaire29 et réduit le nombre de ministères et secrétariats d’État, de quarante-deux sous la présidence de son prédécesseur, à dix-huit30. Cinq femmes deviennent ministres31 dont deux à des postes très importants comme Amina Mohamed aux Affaires étrangères et Raychelle Omano à la Défense.
Lors de son discours prononcé lors du Madaraka Day (célébration de l'autonomie du pays au 1er juin 1963) du 1er juin 2013, il réaffirme la teneur de la Constitution à propos de la gouvernance des comtés, rappelle les huit anciens commissaires provinciaux vers d'autres fonctions et met, ainsi, fin aux dissensions entre les gouverneurs et les commissaires.
L'organisation État islamique et les chebabs multiplient les attaques au Kenya dans les années 2010, mettant en échec la politique sécuritaire du gouvernement. À ces attaques, s'ajoute une instabilité politique interne dans les mois qui précèdent les élections générales d'août 2017. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, est finalement réélu et affiche un score électoral de 54,28 % des suffrages exprimés. Son rival Raila Odinga parle de fraudes. Des émeutes éclatent avant un appel au calme par l'opposant Raila Odinga, qui s'en remet à la Cour suprême. Celle-ci, à la surprise générale, lui donne cette fois raison et invalide les élections, qui sont réorganisés en octobre 2017. Cette décision montre une consolidation des contre-pouvoirs au Kenya à la suite de la constitution de 2010. Uhuru Kenyatta fait procéder à des modifications de la loi électorale avant ce nouveau scrutin, ce qui provoque le retrait de Raila Odinga, qui appelle au boycott de l'élection. Finalement, le président sortant Uhuru Kenyatta remporte le nouveau scrutin avec 98,26 % des voix, mais la participation le 26 octobre 2017 n'est que de 38,8 % des électeurs inscrits, à comparer à 79 % le 8 août 2017, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême. Le 13 mai 2021, le projet de réforme constitutionnelle de Uhuru Kenyatta est jugé illégal. Le 20 août 2021, La Cour d'appel du Kenya a confirmé l'illégalité du processus de révision constitutionnelle lancé par le président Uhuru Kenyatta mettant fin définitivement à ce projet de révision constitutionnelle.
an 2013 : Libye - En mai 2013, sous la pression des milices révolutionnaires, le parlement libyen adopte une loi dite de « bannissement politique », excluant de toute fonction officielle les personnes ayant occupé des responsabilités, à un moment ou à un autre, sous le régime de Kadhafi. Le radicalisme de cette loi, qui frappe de fait une grande partie des dirigeants libyens, provoque une crise politique et plusieurs démissions, privant la Libye d'un personnel politique expérimenté. Le président du Congrès général national Mohamed Youssef el-Megaryef, qui avait été ambassadeur sous Kadhafi avant de rejoindre la dissidence, est contraint de quitter ses fonctions. Fin juin, Nouri Bousahmein est élu président du GNC. Le premier ministre Ali Zeidan a quant à lui le plus grand mal à imposer son autorité face aux différents chefs de milices, qui tiennent notamment les champs pétroliers de Cyrénaïque, avec le soutien des tribus : en octobre 2013, il est séquestré quelques heures par un groupe armé, avant d'être relâché. En novembre 2013, des rebelles autonomistes proclament en Cyrénaïque un gouvernement, défiant celui de Tripoli qu'ils disent aux mains des islamistes.
an 2013 - 2018 : Madagascar - L’élection présidentielle malgache de 2013 fait de Hery Rajaonarimampianina le président de la IVe république et son Premier ministre est Roger Kolo. Mais Hery Rajaonarimampianina, qui remporte cette élection considérée par les observateurs comme démocratique, dispose alors du soutien politique d'Andry Rajoelina, avec qui il est conduit à prendre progressivement ses distances. Le nouveau président manque dès lors de soutien politique tout en étant confronté à une ploutocratie aux commandes du pays. La crise politique est doublée d'une crise économique persistante. Le 14 janvier 2015, le général de brigade aérienne Jean Ravelonarivo est nommé Premier ministre en remplacement de Roger Kolo. En mai 2015, le président est destitué par l’Assemblée nationale, mais la décision est ensuite annulée par la justice malgache. Olivier Mahafaly Solonandrasana remplace Jean Ravelonarivo le 10 avril 2016, mais pour calmer le pays en proie aux émeutes, il est contraint à la démission et remplacé par Christian Ntsay le 4 juin 2018. Les élections de décembre 2018 portent au pouvoir pour 5 ans Andry Rajoelina. Celui-ci remporte également les élections législatives de mai 2019 et obtient la majoprité absolue à l'Assemblée nationale.
an 2013 : Mali - Présidences Ibrahim Boubacar Keïta (2013-2020)
an 2013 : Mauritanie - Le 18 février 2013, les forces armées mauritaniennes annoncent le début d'exercices militaires dans le sud-est du pays avec la participation de dix-neuf pays européens, africains et arabes.
En 2013, les élections législatives de novembre et décembre confortent la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale.
an 2013-2015 : Nigéria - En 2013, le Nigeria devient aussi la première économie d'Afrique, avec un Produit intérieur brut de 510 milliards de dollars, dépassant l'Afrique du Sud, même si ce dernier pays reste en tête en termes de PIB par habitant.
À la suite de l'élection présidentielle de 2015, Muhammadu Buhari est élu. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine du Nigéria qu'une transition à la tête de l'État se fait de façon démocratique.
an 2013-2019 : Somalie - Le 11 janvier 2013, l'armée française lance une opération militaire afin de libérer l'otage Denis Allex de la DGSE détenu par les Al-Shabbaab à Buulo Mareer depuis 2009 mais celle-ci s'avérera être un échec.
Le groupe terroriste Harakat al-Chabab al-Moudjahidin multiplie les attaques depuis 2008, et notamment en 2019 : en juillet, contre un hôtel de Kismaayo, puis sur la route d’accès à l’aéroport de Mogadiscio et quelques jours plus tard contre la mairie de Mogadiscio, contre un hôtel de hôtel à Mogadiscio le 10 décembre 2019 puis le 28 décembre sur un poste de contrôle à l'entrée de Mogadiscio (cette dernière attaque faisant 81 morts).
Outre le terrorisme, les Somaliens sont victimes de la violence d’État de certains pays de la région. Ainsi, 42 réfugiés sont tués en mars 2017 dans une attaque aérienne saoudienne sur la mer Rouge.
Les Nations unies estiment que 1,7 million de personnes manquent de nourriture à cause de la sécheresse en mai 2019, et que leur nombre va augmenter d'un demi-million d'ici à juillet. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont contraintes d'abandonner leur foyer pour tenter de trouver de la nourriture, venant ainsi s'ajouter aux 2,6 millions de personnes déjà déplacées dans le pays du fait de la sécheresse et de la guerre.
an 2013-2015 : Togo - En 2013, de nouvelles élections législatives sont organisées. Le parti Unir obtient 62 sièges sur 91 soit la majorité absolue. L'ANC devient le premier parti de l'opposition avec 19 sièges. Un regroupement des principaux partis d'opposition (le Combat pour l'alternance politique) dénonce par avance des fraudes massives pour l'élection présidentielle de 2015.
an 2014 : Afrique du Sud - Jacob Zuma est réélu pour un second mandat, l'ANC restant nettement en tête dans l'électorat bien qu'en recul face à l'Alliance démocratique et aux Combattants pour la liberté économique de Julius Malema.
an 2014 : Algérie - Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014
an 2014 : Burkina Faso - Le 30 octobre 2014, Blaise Compaoré fait face à un soulèvement populaire contre son projet de modification de l'article 37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels, afin de se représenter en 2015. À la suite des émeutes, Blaise Compaoré quitte le pouvoir.
Le chef d'état-major des armées Honoré Traoré annonce le 31 octobre la création d'un « organe de transition », chargé des pouvoirs exécutif et législatif, dont l'objectif est un retour à l'ordre constitutionnel « dans un délai de douze mois ». Le 1er novembre 2014, l'armée publie un communiqué qui affirme son soutien à Isaac Zida comme président de transition. Honoré Traoré en est un des signataires, ce qui implique son renoncement au pouvoir. Le 17 novembre 2014, le diplomate Michel Kafando est nommé président de transition. Il nomme Isaac Zida Premier ministre.
an 2014-2018 : Afrique du Sud - Jacob Zuma est, en 2014, réélu pour un second mandat avec Cyril Ramaphosa comme vice-président. Il ne peut achever son second mandat et est poussé par son parti à la démission en février 2018.
La presse dresse alors un bilan négatif de ses deux mandats marqués par de multiples scandales de corruption, des accusations de prévarication, un échec aux élections municipales sud-africaines de 2016, marquées par un recul de l'ANC dans les métropoles et une popularité en berne affectant son parti.
an 2014-2015 : Algérie - L'attentat du 19 avril 2014 contre l'Armée nationale populaire (ANP) entraîne la mort de 11 militaires, celle du 17 juillet 2015 la mort de 11 à 13 soldats
an 2014 : Burkina-Faso - Le 30 octobre 2014, Blaise Compaoré fait face à un soulèvement populaire contre son projet de modification de l'article 37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels, afin de se représenter en 2015. À la suite des émeutes, Blaise Compaoré convoque l'article 43 et décrète la vacance du pouvoir le 31 octobre 2014. Une période d'incertitude de plusieurs mois s'ensuit. Le chef d’état-major des armées, Honoré Traoré, annonce alors la création d’un «organe de transition», chargé des pouvoirs exécutif et législatif, dont l’objectif est un retour à l’ordre constitutionnel «dans un délai de douze mois». Le 1er novembre 2014, l'armée publie un communiqué qui affirme son soutien à Isaac Zida (1965-) comme président de transition. Honoré Traoré en est un des signataires, ce qui implique son renoncement au pouvoir. Le 17 novembre, le diplomate Michel Kafando est nommé président de transition. Il nomme Isaac Zida, premier ministre.
an 2014 : République de Centrafrique - Le 10 janvier 2014, le président de la transition centrafricaine Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaye annoncent leur démission lors d'un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).
Le 20 janvier 2014, le Conseil national de transition de la République centrafricaine élit Catherine Samba-Panza comme chef de l'État de transition de la République centrafricaine. Au printemps 2014, trois journalistes sont tués, dont la française Camille Lepage, sur fond de sanctions de l'ONU.
Le 23 juillet 2014, les belligérants signent un accord de cessation des hostilités à Brazzaville. En dépit de cet accord, le pays est divisé en régions contrôlées par des milices, « sur lesquelles ni l’État ni la mission de l’ONU n’ont prise ».
an 2014 : République de Djibouti - En mai 2014, le pays est victime d'un attentat suicide dans le restaurant La Chaumière. Selon les informations, deux ou trois kamikazes (dont une femme) se seraient fait exploser en entrant dans le restaurant. Un mort, un ressortissant turc, a été recensé, et plusieurs blessés, dont des coopérants français présents dans le restaurant, ainsi qu'une jeune femme originaire des Pays-Bas. L'un des kamikazes n'a pas pu entrer dans le restaurant. Il s'est jeté sur la terrasse en déclenchant sa ceinture explosive.
2014 - 2030 : Égypte - En mai 2014, Abdel Fattah al-Sissi, déjà considéré comme le dirigeant de fait de l'Égypte, remporte l'élection présidentielle. Il est réélu pour un deuxième mandat en 2018. Par une révision constitutionnelle validée par un référendum en avril 2019, il se donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Il impose une logique autoritaire, réprime toute opposition et toute voix critique , et met sous contrôle les médias et la justice. La répression touche notamment des médias, des blogueurs, des journalistes, dont des personnalités féminines comme Israa Abdel Fattah ou Solafa Magdy.
La population égyptienne dépasse les cent millions d’habitants en février 2020. Elle progresse d’un million supplémentaire tous les six mois. Le taux de fécondité est passé de 5,3 enfants par femme en 1980 à 3 en 2008, puis est remonté à 3,5 en 2014. A titre de comparaison, l’Iran connaît un taux de fécondité de 1,8 enfants par femme et la Tunisie de 2,2. Cette croissance de la population égyptienne intervient de plus sur une bande de terre limitée essentiellement à la vallée du Nil et à son delta, représentant moins de 5% de la superficie d’un pays relativement désertique. La proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté semble un élément déterminant. Les Égyptiens les plus pauvres, ne disposant pas d'aide publique adaptée, veulent s'appuyer sur leur progéniture pour assurer leur besoins quotidiens.
Par ailleurs, l'armée égyptienne semble perdre progressivement le contrôle de la péninsule du Sinaï face à la guérilla jihadiste, une branche locale de l'État islamique.
an 2014 : Gambie - Le 30 décembre 2014, une autre tentative de coup d’État a lieu en Gambie pendant que Jammeh est à Dubaï. Il accuse fortement les puissances occidentales d’avoir aidé des terroristes pour le renverser. La répression et les accusations arbitraires s'accentuent.
an 2014-2015 : Guinée - En 2014 et 2015, le pays est touché par l'épidémie Ebola mais se mobilise pour en contenir les impacts.
an 2014 : Guinée-Bissau - En 2014, José Mário Vaz remporte l'élection présidentielle du 13 avril 2014, marquant le retour progressif à la légalité constitutionnelle. Pour autant, l'instabilité persiste, et les premiers ministres se succèdent.
an 2014 : Leshoto - Le Lesotho demeure l'un des pays les plus pauvres du monde : en 2014, l'indice de développement humain (IDH) le classe au 162e rang sur 187 pays.
Le 30 août 2014, le pays subit un coup d'État militaire dirigé par le chef d’état-major de l’époque, le général Tlali Kamoli, qui avait été limogé. Le Premier ministre Tom Thabane quitte le Lesotho et rejoint l'Afrique du Sud où il demande l'aide internationale, avant de revenir au Lesotho le mardi 2 septembre.
an 2014 : Libéria - En 2014, le Liberia, avec ses voisins la Guinée et la Sierra Leone, est touché par une épidémie de maladie à virus Ebola, qui désorganise sérieusement la vie du pays. Cette épidémie fait des milliers de morts.
an 2014 : Libye - Le 20 février 2014, sans passion et au milieu d'épisodes de violences, les Libyens élisent leur assemblée constituante. Le scrutin se déroule dans un contexte d'instabilité politique persistante, alors que le gouvernement d'Ali Zeidan, qui tente de poser les bases d'un État, est de plus en plus discrédité. Le Congrès général national provoque également le mécontentement de la population et de la classe politique en prolongeant son mandat d'un an, jusqu'en décembre 2014, et en laissant à un futur parlement, dont la date n'est toujours pas décidée, la tâche de décider de la nature d'une élection présidentielle. Minoritaires au Congrès, les islamistes gagnent cependant en influence dans l'assemblée et accaparent de plus en plus de pouvoir, laissant peu de marge de manœuvre au gouvernement. Un bras de fer oppose le premier ministre au Congrès général national jusqu'en mars 2014, date à laquelle le Congrès démet par un vote le chef du gouvernement : les islamistes se débarrassent ainsi d'un de leurs principaux adversaires. Abdallah al-Thani assure l'intérim après le départ de Zeidan. La Libye n'a alors toujours pas réussi à former d'armée ou de police réellement professionnels, laissant en grande partie le terrain à diverses factions armées et des ex-chefs rebelles.
Le 30 mars, le Congrès général national décide de laisser la place à une Chambre des représentants, qui devra être élue en juin. Le 4 mai, le Congrès général national élit Ahmed Miitig au poste de premier ministre : la validité de cette élection est aussitôt contestée, les rebelles autonomistes de l'Est annonçant quant à eux qu'ils refusent de reconnaître ce gouvernement. Le général Khalifa Haftar, chef d'état-major de l'Armée nationale libyenne, défie ouvertement le Congrès général national dominé par les islamistes, exigeant sa dissolution et la mise en place d'un « Conseil présidentiel » pour mieux assurer l'autorité de l'État. Les 16 et 18 mai, des forces loyales à Haftar attaquent des milices à Benghazi, puis le siège du CGN à Tripoli, faisant plusieurs dizaines de morts60. En juin, la justice invalide l'élection de Miitig ; Abdallah al-Thani revient alors à la tête du gouvernement. Les élections législatives se déroulent le 25 juin : 12 des 200 sièges du nouveau parlement ne sont pas pourvus, les votes ayant été annulés dans diverses localités en raison des violences. Le Parti de la justice et de la construction, proche des islamistes, est nettement minoritaire.
L'instabilité persiste ensuite en Libye, qui s'avère incapable de construire un véritable pouvoir central et de mettre un terme au désordre et à la violence dans le pays, où les milices continuent de s'arroger un pouvoir de fait. En juillet 2014, la mission de l'ONU évacue son personnel après des affrontements à Tripoli et Benghazi, qui font plusieurs victimes. Toujours en juillet, la milice de Misrata alliée à des groupes islamistes affronte la milice de Zenten alliée à d'anciens soutiens de Khadafi pour le contrôle de l'aéroport de Tripoli, tandis que d'autres groupes combattent en Cyrénaïque pour le contrôle des ressources pétrolières.
Après les élections, la passation de pouvoir entre le Congrès général national et la nouvelle Chambre des représentants est annulée : le nouveau parlement, boycotté par les élus islamistes et présidé par Aguila Salah Issa, tient sa session inaugurale à Tobrouk. Fin août, la coalition « Aube de la Libye » (Fajr Libya) formée par les groupes islamistes, prend le contrôle de Tripoli et reforme le Congrès général national : Nouri Bousahmein est réélu au poste qu'il occupait avant les élections, tandis qu'Omar al-Hassi devient le nouveau premier ministre. L'Égypte et les Émirats arabes unis mènent des bombardements répétés sur la capitale libyenne.
an 2014 - 2019 : Malawi - En mai 2014, Joyce Banda perd l'élection présidentielle, au profit du frère de Bingu wa Mutharika, Peter Mutharika. Le pays, comme d'autres en Afrique australe, est confronté à des phénomènes climatiques difficiles, alternant sécheresse et inondations, dont les effets sont aggravés par la déforestation, mais connait une croissance de son PIB. Peter Mutharika est réélu pour un deuxième mandat lors de l’élection présidentielle de 2019, dans un scrutin serré. L'opposition dénonce des résultats frauduleux. Le 3 février 2020, la cour constitutionnelle, constatant des irrégularités, annule l'élection.
an 2014 : Mali - Interventions de troupes françaises (opération Serval puis Barkhane)
Cette opération Serval semble être un succès dans un premiers temps : les villes ont été reprises ainsi que le territoire du nord du pays, un dialogue est rétabli avec les différentes composantes Touareg et l’État malien est stabilisé. Mais Al-Qaida au Maghreb islamique change d'approche,et se reconstitue. L'organisation procède désormais par des incursions ponctuelles et par des attentats, et le maintien sur place des troupes françaises et africaines, dans l'organisation initiale de ces forces, se révèle coûteux. Il est décidé de substituer l’opération Barkhane à l'opération Serval, pour sécuriser la bande sahélo-saharienne, avec la mission de lutter contre les groupes djihadistes et d’empêcher la constitution de sanctuaires terroristes dont le quartier-général semble établi à N’Djamena. Le nouveau dispositif est officiellement lancée le 1er août 2014.
an 2014 : Mauritanie - Le 2 février 2014, le Premier ministre Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf, en poste depuis le début du mandat du président Aziz, présente la démission de son gouvernement. Il est reconduit dans ses fonctions dès le lendemain et chargé de former un nouveau gouvernement qui compte onze nouvelles personnalités dont cinq femmes.
Le 21 mai 2014, les ministres de l'Intérieur du groupe des Cinq du Sahel, dont fait partie la Mauritanie, créent une « plateforme de coopération sécuritaire » destinée notamment à « lutter contre le terrorisme » à Nouakchott.
Le 4 juin 2014, des milliers de sympathisants manifestent à Nouakchott contre le mode d'organisation des élections présidentielles à l'appel du Forum national pour la démocratie et l'unité (FNDU, opposition radicale).
Mohamed Ould Abdel Aziz remporte une victoire écrasante et attendue à la présidentielle le 21 juin 2014, et recueille 81,94% des suffrages, avec un taux de participation de 56,55%. Investi le 2 août pour son second mandat, il nomme comme Premier ministre Yahya Ould Hademine, ancien ministre de l'Equipement et des Transports du précédent gouvernement.
Le 3 novembre 2014, le responsable du parti islamiste modéré Tewassoul Elhacen Ould Mohamed est nommé à la tête de l'opposition démocratique.
Le 25 décembre 2014, pour la première fois depuis son indépendance, une condamnation à mort pour apostasie est prononcée en Mauritanie à Nouadhibou (au nord-ouest du pays) à l'encontre d'un citoyen mauritanien musulman, inculpé après avoir publié sur internet un texte considéré comme blasphématoire. Le 21 avril 2015, la peine de mort est confirmée pour le blogueur Mohamed Cheikh ould Mkheitir, qui est détenu depuis janvier 2014 pour un article jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. Le 31 janvier 2017 la Cour suprême renvoie devant une autre cour d'appel le dossier de Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir, le blogueur condamné à mort pour apostasie et emprisonné depuis 3 ans. Il est libéré le 29 juillet 2019 et ne cesse de dénoncer les discriminations ethniques et sociales en Mauritanie.
Esclavage
Le 6 mars 2014, avec l'appui de l'ONU, la Mauritanie adopte un plan pour l'éradication de l'esclavage.
En novembre 2014, les autorités mauritaniennes ferme le siège de l'IRA, une ONG anti-esclavagiste qu'elles accusent de propager la haine entre les populations.
Situation sanitaire et humanitaire
Le 24 octobre 2014, le gouvernement annonce le renforcement des contrôles de sa frontière avec le Mali à la suite de l'annonce du premier cas d'Ebola dans ce pays.
an 2014 : Mozambique - Le 15 octobre 2014, le FRELIMO propose un nouveau candidat à l'élection présidentielle, Filipe Nyusi qui est élu au premier tour, au cours d’un scrutin parsemé de fraudes et contesté par l’opposition, comme chaque fois. Afonso Dhlakama, chef du RENAMO, principale force d'opposition, double cependant son score de 2009, et réunit 37 % des suffrages exprimés. La situation post-électorale est tendue et le RENAMO semble pendant quelques mois reprendre une insurrection militaire, comme pendant les heures noires de la guerre civile qui a duré de 1976 à 1992.
an 2014 : Namibie - En 2014 a lieu l'Élection présidentielle namibienne de 2014, Elle est remportée par le candidat de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO), Hage Geingob, avec 86,73 % des suffrages.
an 2014 : Nigéria - L'année 2014 est marquée par la montée en puissance du groupe, qui kidnappe notamment plus de 200 lycéennes, provoquant des réactions d'indignations mondiales.
an 2014-2015 : Sierra Leone - Le pays est touché par l'épidémie d’Ebola en 2014 et 2015, qui fait 4 000 morts, et, en 2017, par des inondations meurtrières.
an 2014 : Tunisie - L'article 37 de la loi électorale, votée en application de l'article 74 de la Constitution de 2014, permet à tout électeur de confession musulmane, âgé d'au moins 35 ans et jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance de se présenter à l'élection présidentielle ; il doit présenter, s'il est titulaire d'une autre nationalité, un engagement stipulant l'abandon de son autre nationalité en cas d'élection. L'article 38 de la même loi exige que le candidat soit parrainé par dix élus de l'Assemblée des représentants du peuple ou par 10 000 électeurs, tout en stipulant qu'il est interdit au même parrain de parrainer plus d'un candidat. L'article 39 exige enfin le dépôt d'une caution de 10 000 dinars auprès du trésor public, qui est restituée au candidat s'il obtient plus de 3 % des suffrages exprimés.
L'Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de statuer et de fixer la liste des candidatures approuvées dans un délai de quatre jours à compter de la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures ; toute décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.
an 2015 - 2022 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - la présidence Kaboré (2015-2022). - Des élections sont prévues initialement en octobre 2015, pour passer de cette période de transition à un fonctionnement démocratique stabilisé. Mais une tentative de coup d'état, (qualifié par des burkinabés de « coup d'état le plus bête du monde ») retarde l'échéance prévue pour cette consultation électorale.
Le 16 septembre 2015, en effet, le président de transition, le premier ministre et quelques membres du gouvernement sont pris en otages par des troupes armées, le Régiment de sécurité présidentielle, sous les ordres du général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Comparé. Des manifestations sont réprimées. Finalement, les autorités de transition sont rétablies, et le fameux régiment de sécurité présidentielle est désarmé fin septembre 2015. Les élections ont lieu en novembre 2015.
Le 30 novembre 2015, à la suite des élections présidentielles et législatives, Roch Marc Christian Kaboré (1957-) (MPP) est élu au premier tour président du Burkina Faso avec 53,49 % des voix devant Zéphirin Diabré (UPC), qui récolte 29,65 % des voix, les douze autres candidats se partageant le reste. Il est le deuxième président civil depuis l'accès à l'indépendance du Burkina Faso après Maurice Yaméogo.
Depuis 2016, le Burkina Faso est touché par un certain nombre d'attaques menées par des groupes armés djihadistes : le 15 janvier 2016 ont lieu les attentats de Ouagadougou, des hommes armés attaquent le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ces lieux sont fréquentés principalement par des occidentaux. L'attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fait 30 morts. En août 2017, une autre attaque djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou. Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste visant l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou fait 8 morts, tous des militaires et plus de 80 blessés (civils et militaires). Cette attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
En 2019, Les actions menées par des groupes armés djihadistes contre les lieux de culte se multiplient en particulier dans le nord et l'est du pays. Dans la nuit du 3 au 4 février 2019, une attaque terroriste frappe le département de Kain au nord du pays. Quatorze civils sont tués. Les forces armées nationales ripostent en lançant des opérations dans les départements de Kain, de Banh et de Bomboro. L'armée annonce alors que ces opérations ont permis de « neutraliser » 146 terroristes. Le 26 mai, quatre fidèles sont tués lors d'une attaque contre une église catholique à Toulfé, localité du nord du pays. Le 13 mai, quatre catholiques sont tués lors d'une procession religieuse à Zimtenga, également dans le nord. Le 12 mai, six personnes dont un prêtre, sont tués lors d'une attaque pendant la messe dans une église catholique à Dablo, une commune de la province du Sanmatenga. Le 29 avril, six personnes sont tuées lors de l'attaque de l'église protestante de Silgadji, dans le nord. Le 1er décembre 2019, quatorze fidèles dont des enfants sont tués lors de l'attaque d'une église protestante à Hantoukoura dans l'est du pays.
En décembre 2019, l’annonce, par le président ivoirien Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron, de la fin du franc CFA pour les huit pays de la CEDEAO, au profit de l'Eco est diversement qualifiée. Décision historique pour certains, d'autres la qualifient d’« arnaque » et de « poudre aux yeux ». Une parité fixe est maintenue pour la future monnaie avec l’euro. « La France reste le maître d’œuvre de cette monnaie. Elle donne d’une main et retient de l’autre. Dans ces conditions, l’éco reste un sous-CFA ou un néo-CFA », commente l’économiste burkinabé Taladidia Thiombiano.
an 2015 : Burundi - Pierre Nkurunziza décide de briguer un troisième mandat à la présidence de la République et s'impose en avril comme le candidat du pouvoir pour l'élection présidentielle du 26 juin 2015. Cette décision est contraire à la constitution du Burundi, promulguée en mars 2005. Sa candidature est néanmoins validée par une décision controversée de la Cour constitutionnelle.
Le 13 mai 2015, Pierre Nkurunziza, en déplacement, est victime d'une tentative de coup d'État de la part du général Godefroid Niyombare.
Le 15 mai, après de violents combats dans le centre-ville de Bujumbura, les putschistes annoncent leur reddition et le pouvoir indique le retour imminent du président Nkurunziza. Les jours qui suivent voient une répression sanglante de l'opposition de la part du président. Cette répression fait des centaines morts et provoque des départs massifs : des centaines de milliers de burandais se réfugient à l'extérieur du pays . Après plusieurs reports, l'élection présidentielle, jugée illégale et truquée par tous les observateurs de la politique burundaise, se tient finalement le
21 juillet. Le 24 juillet, la commission électorale nationale indépendante proclame Nkurunziza vainqueur avec 69,41 % des suffrages.
.
an 2015-2016 : République de Centrafrique - Une élection présidentielle est organisée en décembre 2015 et janvier 2016. Faustin-Archange Touadéra arrive deuxième du premier tour avec 19 % des voix, derrière son opposant, Anicet-Georges Dologuélé qui arrive en tête avec 23,7 %. Il est finalement élu président de la République à l'issue du deuxième tour, avec 62,7 % des suffrages contre 37,3 % à Anicet-Georges Dologuélé. Ce nouveau président de la République lance un processus de réconciliation nationale afin de rendre justice aux victimes des guerres civiles, la plupart déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pour ce faire, il charge par décret son ministre conseiller, Regina Konzi Mongot, d'élaborer le Programme national de réconciliation nationale et de paix, proposé en décembre 2016, adopté en séance tenante à l'unanimité par les organismes internationaux.
an 2015 : Congo Brazzaville - En 2015, Denis Sassou-Nguesso organise une série de consultations avec des personnalités politiques du pays afin d’examiner une possible modification de la constitution en vigueur dans le pays depuis 2002. La démarche est vivement critiquée par une partie de l’opposition qui y voit une manœuvre afin de pouvoir se présenter une troisième fois à la présidence de la République (la Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels à deux et l’âge pour se présenter à la présidence de la République à 70 ans). La majorité assure de son côté souhaiter renforcer les institutions du pays en passant d’un régime présidentiel à un régime semi-parlementaire.
Le 25 octobre 2015, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Elle entre en vigueur le 6 novembre 2015, après sa promulgation par Denis Sassou-Nguesso.
an 2015-2017 : Congo Kinshasa - En 2015, des tensions apparaissent dans la perspective de l'élection présidentielle de 2016 et d'un éventuel prolongement de mandat de Joseph Kabila. L'article 70 de la Constitution du pays, datée de 2006, dispose que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Prétextant un délai supplémentaire de seize mois et un jour pour finaliser l’enregistrement des 30 millions d’électeurs, la commission électorale a annoncé le 20 août 2016, que l'élection présidentielle ne pouvait pas se dérouler avant juillet 2017. Le 19 septembre 2016, lors d’un rassemblement à Kinshasa contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, au moins dix-sept personnes sont mortes (3 policiers et 14 civils) durant la manifestation. Après la crise de confiance dans les institutions résultant de cette décision, des mouvements insurrectionnels sont signalés dans différentes provinces : milice Kamwina Napsu dans le Kasaï central, Bundu dia Kongo dans le Kongo central, Pygmées contre Bantous dans le Tanganyika, réactivation du M23. L'économie pâtit de la situation, et le phénomène des enfants soldats est en recrudescence.
Le 11 octobre 2017, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Corneille Nangaa, annonce que le scrutin pour remplacer Joseph Kabila ne pourra pas avoir lieu avant 504 jours, en raison du recensement encore en cours dans les régions du Kasaï, jusqu'en décembre 2017, puis de l’audit du fichier électoral par les experts, de l’élaboration de la loi portant répartition des sièges au parlement et de plusieurs autres opérations techniques et logistiques nécessaires avant la tenue des élections, prévue au premier semestre 2019. Ce nouveau report des élections suscite l'indignation de l'opposition, ainsi que nombre d'ONG.
an 2015-2016 : Afrique Côte d'Ivoire - À la suite de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015, le président Ouattara est réélu pour cinq ans. Il souhaite consolider les efforts de réconciliation nationale et rédiger une nouvelle Constitution. Cette nouvelle Constitution, qui entraine la création d'un sénat et d'un poste de vice-président, est approuvée par référendum le 30 octobre 2016. La troisième République Ivoirienne est proclamée le 8 novembre 2016.
an 2015 : Guinée - Le 11 octobre 2015, le président Alpha Condé obtient 58 % des suffrages et est réélu au premier tour de l'élection présidentielle pour un nouveau mandat de 5 ans.
an 2015 - 2017 : Leshoto - Pakalitha Mosisili, déjà Premier ministre entre 1998 et 2012, occupe à nouveau cette fonction à partir du 17 mars 2015
Le Lesotho est une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement bicaméral. L'Assemblée nationale compte 120 membres élus pour cinq ans, et le Sénat : 33 membres nommés.
La constitution du Lesotho a été adoptée en 1993, puis plusieurs fois remaniée. Elle a restauré le multipartisme. Le pouvoir exécutif appartient au gouvernement. Le pouvoir législatif est partagé entre le gouvernement et les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Le rôle du roi est essentiellement protocolaire. N'ayant plus d'autorité exécutive, il ne peut pas intervenir activement sur la scène politique.
an 2015 : Libye - Le gouvernement de Tobrouk — seul à être reconnu par la communauté internationale — et celui de Tripoli se disputent dès lors le pouvoir, en même temps que le contrôle des puits de pétrole, tandis que le pays entier est en proie à la violence et aux affrontements de groupes armés, tribaux ou djihadistes. La déliquescence de la Libye contribue à faire du pays l'une des principales zones de transit de l'immigration clandestine à destination de l'Europe. Par ailleurs, à la faveur du chaos politique, l'État islamique s'implante en Libye et lance des attaques, notamment à Misrata et à Syrte. L'ONU s'efforce d'amener les belligérants libyens à s'unir pour contrer l'État islamique. Le 10 juillet 2015, le gouvernement de Tobrouk signe finalement avec une partie des groupes armés un accord de paix proposé par l’ONU : celui de Tripoli rejette au contraire le texte et n'envoie pas de délégation à la signature.
an 2015 - 2020 : Maroc - Le PJD confirme sa forte présence au niveau local et régional à la suite des élections communales de 2015. Saad Dine El Otmani remplace Benkiran à la tête du gouvernement en 2017.
Sur le plan extérieur, toujours en 2015, le Maroc participe officiellement à l'Opération Tempête décisive déclenchée par l'Arabie saoudite contre l'insurrection houthiste au Yémen. Mais avec la crise diplomatique du Qatar, les relations du Maroc avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se dégradent, Ryad et Abou Dabi reprochant à Rabat une neutralité bienveillante en faveur du Qatar. Les rapports maroco-saoudiens se détériorent gravement, ce qui amène le Maroc à se retirer de la guerre saoudienne au Yémen au début de 2019 et à rappeler son ambassadeur aux Émirats en 2020. En 2016, Rabat opère un virage stratégique en direction de la Russie et de la Chine, après des visites royales dans ces pays. Le Maroc réintègre l'Union africaine en 2017 afin de retrouver sa dimension géopolitique continentale, et entreprend d'adhérer à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'intervention de la Turquie dans la guerre en Libye qui se complexifie et dans laquelle s'affrontent plusieurs belligérants extérieurs plonge l'environnement maghrébin dans l'incertitude, ce qui pousse le Maroc à adopter une ligne prudente et à réitérer son attachement aux accords de Skhirat qu'il a abrité. Pour prévenir une aggravation du conflit, les autorités marocaines organisent à Bouznika des négociations entre les différentes parties libyennes en vue de privilégier une solution politique. L'ouverture d'un consulat des Émirats arabes unis à Laâyoune en novembre 2020 signe une réconciliation spectaculaire avec Abou Dabi après une longue période de brouille et conforte la souveraineté marocaine sur le Sahara à l'échelle internationale. Néanmoins le Maroc subit durement la pandémie de Covid-19 de 2020, et ses retombées sur le plan sanitaire, économique et social.
an 2015 : Mauritanie - Le 28 janvier 2015 débute une grève de 9 semaines affectant les sites de production et d'exportation de la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM). Les revendications portent sur des augmentations de salaire. Après 9 semaines de grève la reprise du travail se déroule le 3 avril à la suite de l'ouverture de négociations et de la réintégration de grévistes licenciés.
Le 6 aout 2015, un islamiste malien, ancien porte-parole d'Ansar Dine, un groupe lié à Al Qaïda, et visé par un mandat d'arrêt international l'accusant de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, meurtre et actes terroristes est libéré par la Mauritanie, où il était détenu depuis plusieurs mois.
Le 2 septembre 2015, un remaniement ministériel remercie huit ministres, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Equipement.
Le 17 novembre 2015, la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM) ouvre un nouveau complexe minier sur le site de Zouerate, dans le nord du pays. Dénommé Guelb II, c'est le plus important projet industriel de l’histoire de la Mauritanie, dans lequel près d’un milliard de dollars ont été investis.
Le 10 février la présidence annonce un nouveau remaniement et le départ de cinq ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de l'Économie.
Le 7 mai 2015 l'opposition appelle a manifester contre le projet de révision constitutionnelle annoncé par le président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui prévoit entre autres choses la suppression du Sénat. Des heurts avec les forces de l'ordre feront plusieurs blessés. Le 29 septembre 2015, après de longues négociations entre pouvoir et opposition, s'ouvre un nouveau dialogue national. L'initiative est le point de départ qui doit amener à une réforme constitutionnelle, portant notamment sur la suppression du Sénat et la création du poste de vice-président. Une partie importante de l'opposition accuse le président Mohamed Ould Abdel Aziz de vouloir modifier le texte fondamental dans le but se présenter pour un troisième mandat. Le 20 octobre 2015 un accord politique marquant la fin du dialogue national est signé entre la majorité et quelques partis d'opposition. Plusieurs révisions constitutionnelles sont retenues, mais pas la suppression de la limitation des mandats présidentiels est rejetée.
Esclavage
Le 1er juillet 2015, six militants anti-esclavage de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) sont arrêtés, marquant le début d'une série d'arrestations dans les rangs de l'IRA. Leur procès débute le 3 août 2015 et dure quinze jours à l'issue desquels la Cour criminelle condamne la plupart des accusés à des peines de prison allant de trois à huit ans. Treize d'entre eux disent avoir été torturés durant leur détention.
Le 13 août 2015, le Parlement adopte une loi durcissant la répression de l'esclavage, considéré désormais comme un « crime contre
l'humanité ».
Situation sanitaire et humanitaire
Le 9 octobre 2015, la Mauritanie alerte l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'épidémie de fièvre qui sévit dans la vallée du rift
an 2015 : Nigéria - Début 2015, Boko Haram rase plusieurs villes et villages du nord-est du pays. Cette série d'attaques pousse les voisins du Nigéria, le Tchad, le Niger et le Cameroun à intervenir contre la secte islamiste. En 2015, Boko Haram fait allégeance à l'État islamique.
an 2015 : Niger - Le 6 juin 2015, plus de 20 000 personnes manifestent à Niamey à l'appel d'une quarantaine d'associations de la société civile. Elles revendiquent que davantage de moyens soient alloués à l'armée pour combattre Boko Haram et s'alarment d'une possible dérive autoritaire du régime de Mahamadou Issoufou. En août 2015, de grandes manifestations ont également lieu à Niamey contre la politique Mahamadou Issoufou, à l'appel de l'Alliance pour la République, la Démocratie et la Réconciliation (ARDR), une coalition de 15 partis d'opposition. Mahamadou Issoufou est réélu le 20 mars 2016 pour un second mandat à la présidence de la république. Il est investi à ce poste le 2 avril 2016. Il est réélu à 92,51 % des voix, l'opposition ayant boycotté l'élection.
Mais la situation sécuritaire continue à se dégrader dans les territoires limites avec le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria. C'est une zone d'instabilité pour l'Afrique de l'Ouest, d'autant que la croissance démographique y est forte.
an 2015 : Tchad - Depuis 2015, l'armée tchadienne est engagée dans le conflit contre le groupe djihadiste Boko Haram, répandu dans le Nord du Nigeria et du Cameroun. En représailles, ce groupe a commis plusieurs attaques en territoire tchadien.
an 2015-2020 : Togo - Faure Gnassingbé est à nouveau réélu lors de l'élection présidentielle d'avril 2015, avec 58,75 % des suffrages exprimés, contre 34,95 % pour son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Une élection jugée libre et transparente par l'UE et les principaux observateurs internationaux. L'abstention s'élève à 40,01 %, contre 35,32 % à la précédente présidentielle de 2010. Du côté de l'opposition, Tchabouré Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI), a obtenu 3,08 % des suffrages, Komandega Taama, président du Nouvel engagement togolais (NET), 1,06 %, et Mouhamed Tchassona-Traoré, président du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (MCD, opposition), 0,99 %. Il nomme Premier ministre Komi Sélom Klassou le 5 juin 2015 jusque-là premier président de l'Assemblée nationale. Faure Gnassingbé se présente pour un quatrième mandat lors des élections présidentielles de 202022. Il est reconduit et l'élection est contestée une nouvelle fois par l'opposition.
an 2015 : Zambie - Edgar Lungu est élu en 2015 pour le remplacer et terminer son mandat présidentiel. Edgar Lungu est à la tête du Front patriotique (PF) qu'il a créé en 2001 après avoir quitté le Mouvement pour la démocratie multipartite (MMD). Il est vainqueur du scrutin présidentiel, d'une courte tête.
an 2016 : Algérie - Le pays enregistre sa première grande attaque terroriste dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016. Bilan : une trentaine de morts et une centaine de blessés.
an 2016 : Bénin - Patrice Talon remporte l’élection du 20 mars 2016 avec 65,39 % des voix face à Lionel Zinsou (34,61 %) des suffrages et nommé Président de la République au 6 avril 2016.
an 2016-2018 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Depuis 2016, le Burkina Faso est touché par un certain nombre d'attaques menées par des groupes armés djihadistes : le 15 janvier 2016 ont lieu les attentats de Ouagadougou, des hommes armés attaquent le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ces lieux sont fréquentés principalement par des occidentaux. L'attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fait 30 morts. En août 2017, une autre attaque djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou. Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste visant l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou fait 8 morts, tous des militaires et plus de 80 blessés (civils et militaires). Cette attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
an 2016 : Cameroun - Depuis novembre 2016, des manifestants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, majoritairement anglophones, font pression pour le maintien de l'usage de la langue anglaise dans les écoles et les tribunaux. Des personnes ont été tuées et des centaines emprisonnées à la suite de ces protestations.
an 2016 : Cap Vert - Jorge Carlos Fonseca, du MPD, est réélu Président en 2016. José Maria Neves, du PAICV, est, dans le même temps, désigné premier ministre, de 2001 à 2016. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux partis au pouvoir, et même d'une cohabitation de ces deux partis pendant certaines périodes. Il est considéré comme ayant une bonne gouvernance, avec l'une et l'autre de ces formations, même si l'économie, peu diversifiée, est dépendante à 20 % du tourisme. Cet état ne dispense pas de grandes ressources naturelles. En 2016, le MPD revient au pouvoir à la suite des législatives, et la dirigeante relativement récente du PAICV, Janira Hopffer Almada, reconnaît sa défaite sans drame. L'archipel, qui souffre du réchauffement climatique, d'autant plus que l'eau douce y est rare, a une politique de développement des énergies renouvelables9, ainsi que de l'écotourisme.
an 2016 : Congo Brazzaville - Le 20 mars 2016, après avoir fait modifier la constitution (cf. infra), Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 60,07 % des voix, score validé par la Cour constitutionnelle le 4 avril suivant.
an 2016-2019 : Gabon - Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin à cinq mille voix près. L'opposition dénonce immédiatement ces résultats. Des émeutes encore plus violemment réprimées que celles de 2009 éclatent, avec comme point d'orgue l'attaque du quartier général de l'opposition par la garde présidentielle qui fait de nombreux morts. Le 24 septembre 2016, Ali Bongo est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec 50,66 % des voix, suivi de Jean Ping avec 47,24 % des suffrages.
Le président Bongo prône le concept de « Gabon émergent », politique visant notamment à la diversification de l'économie afin de diminuer sa dépendance aux cours mondiaux du pétrole. En 2018, cela ne s'est pourtant pas concrétisé, notamment du fait de la baisse des cours du pétrole et d'investissements peu judicieux, tandis que le chômage des jeunes reste élevé.
Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin à cinq mille voix près. L'opposition dénonce immédiatement ces résultats. Des émeutes encore plus violemment réprimées que celles de 2009 éclatent, avec comme point d'orgue l'attaque du quartier général de l'opposition par la garde présidentielle qui fait de nombreux morts. Le 24 septembre 2016, Ali Bongo est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec 50,66 % des voix, suivi de Jean Ping avec 47,24 % des suffrages.
Le 2 février 2017, le Parlement européen adopte une résolution déclarant que les résultats de la présidentielle « manquent de transparence » et sont « extrêmement douteux ».
Le 7 janvier 2019, une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence après un accident vasculaire cérébral, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour ; sur cinq mutins, deux sont tués et les autres arrêtés. Le 12 janvier, un nouveau Premier ministre est nommé, Julien Nkoghe Bekalé. Le pouvoir gabonais connaît une guerre des clans au sommet. Les remaniements ministériels se succèdent entre janvier et décembre 2019, alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé d'Ali Bongo. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée première ministre en juillet 2020.
an 2016-2017 : Gambie - En décembre 2016, sept partis d'opposition choisissent un candidat unique, Adama Barrow, pour l'élection présidentielle. Adama Barrow remporte l'élection à l'unique tour de scrutin en recueillant 43,3 % des suffrages, contre le président sortant qui arrive second avec 39,6 % des suffrages. Le 17 janvier 2017, Yahya Jammeh instaure l'état d'urgence et le lendemain, le Parlement prolonge son mandat de trois mois, jusqu'au 19 avril 2017. Le 19 janvier, Adama Barrow prête serment à l'ambassade de Gambie à Dakar. Devant le refus de Yahya Jammeh de lui céder le pouvoir, malgré les injonctions de la CÉDÉAO, l'armée sénégalaise pénètre en territoire gambien dans le courant de l'après-midi. Le soir même, le chef de l'armée gambienne, le général Ousman Badjie, déclare à des ressortissants occidentaux qu'il n'ordonnera pas à ses hommes de résister en cas d’intervention des troupes africaines.
L'élection présidentielle de décembre 2016 voit Adama Barrow, candidat de l'opposition, remporter la victoire sur le président sortant13 dont le mandat court jusqu'au 18 janvier 2017. Le 19 janvier 2017, Adama Barrow prête serment dans l'ambassade gambienne à Dakar au Sénégal, après le refus du président sortant de céder le pouvoir. Le même jour, l'armée sénégalaise entre en Gambie, forte d'une résolution de l'ONU. Le 20 janvier 2017, Jammeh accepte de quitter le pouvoir, et part en exil le lendemain soir pour Conakry, avant de rejoindre la Guinée équatoriale.
an 2016 : Guinée - En juillet 2016, la Guinée est le premier pays à majorité musulmane d'Afrique à renouer ses liens diplomatiques avec Israël.
an 2016-2018 : Guinée-Bissau - Au mois de septembre 2016, le président guinéen Alpha Condé, médiateur de la crise bissau-guinéenne, et son homologue de la Sierra Leone Ernest Baï Koroma obtiennent un compromis politique signé le 10 septembre par toutes les parties : ce sont les accords de Conakry. Successivement, Umaro Sissoco Embaló en novembre 2016, puis Artur Silvafin janvier 2018, puis Aristides Gomes mi-avril 2018 sont nommés premier ministres.
an 2016 : Guinée Equatoriale -
Arrivé au pouvoir le 3 août 1979 à la suite d’un coup d'État, Teodoro Obiang Nguema se reconduit régulièrement à la tête du pouvoir :
-
1982 : nommé chef d'État pour sept ans par le conseil militaire ;
-
1989 : élu avec 99,99 % des voix comme candidat unique ;
-
1996 : élu avec 97 % des voix comme candidat unique, dans un scrutin officiellement multipartite ;
-
2003 : élu avec 97,1 % des voix dans un scrutin multipartite (5 candidats autorisés) ;
-
2009 : élu avec 95,19 % des voix dans un scrutin multipartite (5 candidats autorisés) ;
-
2016 : élu avec 93,53 % des voix dans un scrutin multipartite (7 candidats autorisés). le
an 2016 : Libye - Devant la gravité de la situation et la progression de l'EI, la communauté internationale pousse à la création d'un gouvernement unitaire. Le 12 mars 2016 Fayez el-Sarraj prend la tête d'un gouvernement « d'union nationale », formé à Tunis, initialement rejeté par les parlements de Tripoli et de Tobrouk. Grâce au soutien occidental, le gouvernement peut s'installer à Tripoli à la fin du mois. Il obtient le 23 avril le soutien de la majorité des parlementaires de Tobrouk, et s'installe progressivement dans ses fonctions.
L’Organisation internationale pour les migrations note le développement de la traite d’êtres humains dans la Libye post-kadhafiste. Selon l'organisation, de nombreux migrants sont vendus sur des « marchés aux esclaves » pour 190 à 280 euros. Ils sont égalent sujets à la malnutrition, aux violences sexuelles, voire aux meurtres.
La ville de Syrte, place forte de l’organisation État islamique (EI) en Afrique du Nord, est reconquise début décembre 2016 par les forces du gouvernement libyen d’union nationale de Faïez Sarraj, soutenu par les capitales occidentales et les Nations unies, stoppant les vélléités de l'EI dans ce pays.
an 2016 : Mali - Djenné : La Grande Mosquée est inscrit sur la liste du patrimoine en péril par l'Unesco
an 2016 : Mauritanie - Torture
Le 4 février 2016, après une inspection de dix jours, Juan Ernest Mendez, le rapporteur spécial de l'ONU fait part de ses regrets quant à la non application de la loi sur la prévention et la répression de la torture, promulguée en septembre 2015. La Mauritanie est dénoncée par plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, qui rapportent de nombreux actes de tortures et de mauvais traitement infligés aux détenus lors des interrogatoires.
Le 14 novembre 2016, une plainte visant de hauts responsables mauritaniens est déposée à au tribunal de grande instance de Paris. Ils sont accusés de « tortures et de traitements cruels » à l'encontre de militants anti-esclavage.
Situation sanitaire et humanitaire
En novembre 2016, le Programme alimentaire mondial (PAM) appelle à la mobilisation de 17 millions de dollars pour faire face à la situation des réfugiés maliens qui ont fui les exactions des groupes terroristes, confrontés à une crise alimentaire.
an 2016 : Réunion (Ile de la) - la quasi-totalité des 5 300 ha de terres agricoles irriguées par l'Irrigation du Littoral Ouest est en service.
an 2016-2018 : Sao Tomé et Principe - Chef de l’Etat : M. Evaristo Carvalho, Président de la République (élu le 7 août 2016)
Chef du Gouvernement : M. Jorge Bom Jesus
L’élection présidentielle du 7 août 2016 voit Evaristo Carvalho, candidat de l’ADI (action démocratique indépendante), élu président de la République contre le président sortant Manuel Pinto da Costa. Le Président a un rôle non exécutif, d’arbitre et de représentation.
Malgré deux tentatives de coup d’État en 2003 et 2009, la démocratie parlementaire s’affirme et permet à plusieurs reprises une alternance entre les deux grandes forces qui animent la vie politique : l’ADI de Patrice Trovoada (fils de Miguel Trovoada, il est premier ministre de 2010 à 2012 et de 2014 à 2018) et le MLSTP de Jorge Bom Jesus.
Aux élections législatives d’octobre 2018, une coalition menée par le MLSTP l’emporte d’une très courte avance (28 sièges contre 27) et, après une courte période d’incertitude rapidement tranchée par la Cour constitutionnelle et acceptée par toutes les parties, Jorge Bom Jesus est chargé de former un gouvernement, début décembre 2018. Le gouvernement, toujours dirigé par Jorge Bom Jesus, a été remanié en septembre 2020.
an 2016 : Seychelles - Les élections législatives sont remportées par l'Union démocratique seychelloise (Linyon Demokratik Seselwa), une coalition politique seychelloise, constituée à la suite de l'élection présidentielle de l'année précédente et regroupant le Parti national des Seychelles (SNP), le Lalyans Seselwa (LS), le Parti des Seychelles pour la justice sociale et la démocratie, le Seychelles United Party et le candidat indépendant Philippe Boullé
À la suite de la défaite de son parti Lepep aux élections législatives de septembre 2016, James Michel annonce sa démission de son poste de président de la République en septembre 2016. La victoire de l'opposition marque une évolution significative et un désaveu pour l'ancien parti unique. C'est la première fois depuis l'instauration du multipartisme que cette opposition l'emporte, l'année du 40e anniversaire de l'indépendance. Le 16 octobre suivant, il est remplacé par son vice-président, Danny Faure (1962-), ouvrant une période de cohabitation entre ce nouveau président et un Parlement contrôlé par l'opposition. Dans ce pays dépendant de la pêche et du tourisme, la situation économique est tendue, les inégalités se creusent. Un autre sujet inquiète cette population : plusieurs îles sont également sensibles à la montée des eaux, dû au changement climatique.
an 2016 : Tchad - Depuis 2016, le Tchad est confronté à un mouvement insurrectionnel dans le Nord du pays : plusieurs groupes armés d'exilés tchadiens ayant combattu dans la guerre civile libyenne reviennent en force dans leur pays d'origine.
an 2016 : Zambie - Edgar Lungu est réélu en 2016, dans un scrutin là encore serré, contre Hakainde Hichilema.
an 2017-2019 : Algérie - Bouteflika est critiqué pour ses manières autocratiques, et le chômage affecte encore plus d'un tiers de la population. En 2009, Bouteflika est réélu pour un troisième mandat après avoir fait amender la Constitution algérienne à cet effet. Victime en 2013 d'un accident vasculaire cérébral affectant son élocution et l'obligeant à se déplacer en chaise roulante, il fait en mars 2017 une apparition publique qui alimente les inquiétudes sur son état de santé. Il est alors âgé de 80 ans et des voix commencent à mettre en doute sa capacité à gouverner le pays.
Sous la pression de manifestations populaires de masse, et alors qu'il se présente pour un cinquième mandat, Abdelaziz Bouteflika démissionne le 2 avril 2019.
an 2017 : Angola - L'Angola présente un paysage de cités martyres, de provinces jadis agricoles stérilisées par la présence de millions de mines. Une bonne partie des infrastructures coloniales a été laissée à l'état de ruines (routes, ponts, aéroports, voies de chemin de fer, écoles), pendant que d'autres ont été reconstruites et même augmentées. L’agriculture et les transports ont été fortement endommagés et se trouvent en récupération lente. Malgré l’aide alimentaire, la famine sévit et le pays ne vit que de l’exportation du pétrole. Comme d’autres pays, l’Angola réclame des indemnisations et des aides financières, que le Portugal et l’Union européenne lui accordent sous forme d’aide au développement (écoles, eau potable, routes, hôpitaux) ou de visas de travail. En dépit de la guerre civile, la scolarité, certes médiocre, s'est améliorée (15 % d’enfants scolarisés en 1975, 88 % en 2005). De nombreuses missions catholiques et protestantes encadrent également les populations depuis l’indépendance. D'un point de vue politique, José Eduardo dos Santos confirme sa retraite, resté trente-sept ans de pouvoir. Il annonce début février 2017, se mettre en retrait de la politique fin 2017, après avoir, pendant 38 ans, muselé l’opposition par une répression policière, limité la liberté d'expression et imposé son autorité17. Il choisit pour lui succéder João Lourenço.
Le parti au pouvoir depuis plus de quatre décennies en Angola, le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), remporte les élections générales, en août 2017, avec plus de 64 % des suffrages. Le candidat du MPLA, Joao Lourenço, succède donc comme prévu à la tête du pays au président José Eduardo dos Santos. Les deux principaux partis dans l'opposition, l’Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (Unita) et la CASA-CE, obtiennent respectivement 24,04 % et 8,56 % des voix exprimées. Au terme de ce scrutin, le MPLA, au pouvoir depuis l’indépendance en 1975, conserve la majorité absolue des 220 sièges du Parlement18. En septembre 2018, Joao Lourenço succède également à José Eduardo dos Santos à la tête du MPLA.
an 2017 : Bénin - En avril 2017 et en juillet 2018, le parlement béninois rejette une réforme constitutionnelle. Le gouvernement annonce dans la foulée la tenue d’un référendum sur cette réforme avant de se rétracter en août de la même année. Le ministre de la Défense, Candide Azannai, a présenté sa démission dès le mois de mars 2017 pour marquer son opposition à ce projet de réforme. Présenté par la presse comme l’un de ses plus proches soutien politique, c’est un coup dur pour Patrice Talon.
an 2017-2018 : Cameroun - En 2017, le gouvernement de Biya a bloqué l'accès de ces régions à Internet pendant trois mois. En septembre, des séparatistes ont lancé une guérilla pour l'indépendance des régions anglophones en tant que République fédérale d'Ambazonie. Le gouvernement a répondu par une offensive militaire, et l'insurrection s'est étendue aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le 1er octobre 2017, Sisiku Julius Ayuk Tabe déclare symboliquement l'indépendance de la république fédérale d'Ambazonie, déclenchant une répression par les forces de l'ordre se soldant par des morts, des blessés, des émeutes, barricades, manifestations, couvre-feu, etc. En janvier 2018, le Nigéria compte entre 7 000 et 30 000 réfugiés liés au conflit et à la répression à la suite de cette déclaration d'indépendance. Le 5 janvier 2018, des membres du gouvernement intérimaire d'Ambazonie, dont le président Sisiku Julius Ayuk Tabe, sont arrêtés au Nigéria et déportés au Cameroun. Ils y sont arrêtés et passent 10 mois dans un quartier général de gendarmerie avant d’être transférés dans une prison à sécurité maximale de Yaoundé. Un procès débute en décembre 2018. Le 4 février 2018, il a été annoncé que Samuel Ikome Sako deviendrait le président par intérim de la République fédérale d'Ambazonie, succédant temporairement à Tabe. Sa présidence a vu l'escalade du conflit armé et son extension à tout le Cameroun anglophone. Le 31 décembre 2018, Ikome Sako déclare que 2019 verrait le passage d'une guerre défensive à une guerre offensive et que les séparatistes s'efforceraient d'obtenir une indépendance de facto sur le terrain. Le 20 août 2019 au matin le tribunal militaire de Yaoundé condamne Julius Ayuk Tabe et neuf autres de ses partisans à la réclusion criminelle à vie.
an 2017 : Centrafrique (République de) - En juin 2017, les affrontements à Bria, dans le centre-est du pays, font une centaine de morts. Par ailleurs, un comité est également mis en place afin de juger les principaux acteurs et dédommager les victimes.
an 2017 : Afrique République de Djibouti - En 2017, après les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon, la Chine obtient de pouvoir y implanter une base militaire. L'Espagne et l’Allemagne y ont aussi disposé de petits contingents.
an 2017 : Gabon - Le 2 février 2017, le Parlement européen adopte une résolution déclarant que les résultats de la présidentielle « manquent de transparence » et sont « extrêmement douteux ».
an 2017 : Ghana - Depuis 2017, Nana Akufo-Addo est président de la République.
an 2017 : Guinée-équatoriale - Le père et le fils Obiang sont poursuivis par la justice française sur des biens mal acquis, provenant notamment de détournements de fonds publics. Le fils Teodorin est finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Ce procès dit « des biens mal acquis », révélateur du pillage des richesses nationales, aboutit à une condamnation en octobre 2017, en première instance.
an 2017 : Kenya - L'organisation État islamique et les chebabs multiplient les attaques au Kenya depuis les années 2010, mettant en échec la politique sécuritaire du gouvernement. À ces attaques s'ajoute une instabilité politique interne dans les mois qui précèdent les élections générales d'août 2017. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, est finalement réélu et affiche un score électoral de 54,28 % des suffrages exprimés. Son rival Raila Odinga parle à nouveau de fraudes. Des émeutes éclatent avant un appel au calme par Raila Odinga, qui s'en remet une fois encore à la Cour suprême. Celle-ci, à la surprise générale, lui donne cette fois raison et invalide les élections, qui sont réorganisés en octobre 2017. Cette décision montre une consolidation progressive des contre-pouvoirs au Kenya à la suite de la constitution de 2010. À la suite des modifications de la loi électorale avant ce nouveau scrutin, Raila Odinga se retire et appelle au boycott de l'élection. Finalement, le président sortant Uhuru Kenyatta remporte le nouveau scrutin avec 98,26 % des voix, mais la participation le 26 octobre 2017 n'est que de 38,8 % des électeurs inscrits, à comparer à 79 % le 8 août 2017, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême.
an 2017-2022 : Lesotho - Les élections législatives de juin 2017, organisées de manière anticipées à la suite du vote d'une motion de censure à l'encontre du Premier ministre Pakalitha Mosisili après la dislocation de la coalition le soutenant, aboutissent à une alternance.
Le parti d'opposition Convention de tous les Basotho (ABC) remporte arrive en effet en tête des suffrages et remporte la majorité relative des sièges, tandis que le Congrès démocratique (DC) de Mosisili perd plus du tiers des siens. Mené par Tom Thabane, l'ABC forme un gouvernement de coalition avec trois autres partis, l'Alliance des démocrates (AD), le Parti national basotho (BNP) et le Congrès réformé du Lesotho (RCL), permettant à Thabane de devenir premier ministre.
Accusé d'avoir commandité le meurtre de son ex épouse Lipolelo Thabane deux jours avant sa prise de fonction en 2017, le Premier ministre est cependant conduit à la démission le 19 mai 2020. Remplacé le lendemain par lendemain par le ministre des Finances Moeketsi Majoro, qui prend également la tête de l'ABC, Thabane est par la suite officiellement inculpé pour meurtre fin novembre 2021.
L'organisation des législatives de 2022 est compliquée par la pandémie de Covid-19 et le manque de budget, qui pousse le gouvernement à repousser le scrutin de juin à septembre.
an 2017-2018 : Libéria - Le 26 décembre 2017, lors d'une nouvelle présidentielle; George Weah est élu avec 61,5 % des voix au suffrage universel face au vice-président sortant, Joseph Boakai, qui en obtient 38,5 %. Il met l'accent sur la lutte anticorruption et sur l'éducation. La situation économique dont hérite le nouveau président reste délicate, avec le poids de la dette sur le budget de l'État, et une inflation importante. À partir de juin 2019, l'état de grâce de George Weah est terminé : des manifestations sont organisées contre sa politique économique.
George Weah s’est fixé comme principal objectif d’améliorer la vie des Libériens grâce à la mise en œuvre d’un programme « pro-poor » qui vise les plus défavorisés. Il entend également parachever la réconciliation nationale, lutter contre la corruption, et développer les infrastructures, en particulier routières, dont le pays est largement dépourvu.
L’élection de George Weah marque par ailleurs un pas supplémentaire dans la stabilisation du pays, confirmée par le départ de la mission des Nations unies pour le Libéria (MINUL), le 30 mars 2018.
an 2017 : Mauritanie - Le 17 mars 2017, le projet de révision constitutionnelle soumis par le gouvernement est rejeté par le Sénat. Le président Aziz annonce l'organisation d'un référendum pour le 5 août 2017.
Le 6 juin 2017, la Mauritanie annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec le Qatar, et accuse le pays de propager l'extrémisme et l'anarchie dans de nombreux pays arabes.
Le référendum du 5 août 2017 donnent un «oui» qui l'emporte à plus de 85 %. Il comporte deux volets, la modification du drapeau national (85,6 % de «oui» et 9,9 % pour le «non») ainsi que la suppression du Sénat (85,6 % pour le « oui » et 10,02 % pour le « non »). Malgré le boycott de l'opposition et de la société civile, le taux de participation est de 53,75 % selon la commission électorale. Leader des opposants à la suppression du Sénat, le sénateur d'opposition Mohamed ould Ghadde est arrêté le 10 août. Plusieurs personnalités de l'opposition sont interrogées. Plusieurs sénateurs, journalistes et représentants syndicaux, accusés de faits de corruption et tous opposants à la réforme constitutionnelle, comparaitront devant un juge d'instruction.
À la fin du mois d'octobre 2017, la première opération conduite par la Force antiterroriste G5 Sahel est lancée. Dénommée Hawbi, elle est constituée du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad et compte jusqu'à 5.000 hommes répartis dans sept bataillons.
Le 13 novembre 2017, le Sénat est dissout, les grilles de l’institution sont fermées et l'accès au bâtiment fermé, mais des sénateurs frondeurs forcent l'entrée et ouvrent une session parlementaire symbolique, qui ne dure en réalité que le temps que la police intervienne et déloge les élus.
Le 28 novembre 2017, le 57e anniversaire de l’indépendance est l'occasion de présenter le nouveau drapeau mauritanien ainsi que le nouvel hymne national, nouveaux emblèmes adoptés à l'issue du référendum constitutionnel du 5 août.
Esclavage
Le 28 avril 2017, la journaliste Tiphaine Gosse et la juriste Marie Foray qui enquêtent sur l'esclavage en Mauritanie sont expulsées du pays. Elles dénoncent aux côtés d'organisations engagées dans la lutte ntre l’esclavage en Mauritanie telles que SOS-Esclaves, l’AMDH et l’Association des femmes chefs de famille (AFCF) « l’hypocrisie des autorités mauritaniennes », qui cherchent selon elles par la ratification des traités internationaux et l’adoption de lois qu'elle jugent incomplètes, à plaire à la communauté internationale sans lutter pour autant contre l’esclavage dans le pays.
Le 22 juin 2017, une plainte contre l’esclavagisme et la torture en Mauritanie est déposée devant l'ONU et l'UA. L'eurodéputé Louis Michel souligne que l'esclavage continue en Mauritanie. Biram Dah Abeid, le président de l'association IRA déplore l'acharnement des autorités mauritaniennes à l'encontre des militants anti-esclavagisme.
an 2017 : Mayotte - La question de l'immigration crée aujourd'hui des tensions locales. Jusqu'à présent, les immigrés clandestins comoriens, venus chercher l'Eldorado, servaient souvent de main-d'œuvre bon marché, dans des conditions de travail proches de la condition d'esclave, pratique courante depuis des années et exercée en toute impunité par certains entrepreneurs mahorais. Aujourd'hui, alors que la politique intérieure de la France s'est resserrée et que la démographie locale ne fait qu'augmenter : la maternité de Mamoudzou enregistre le plus grand nombre annuel de naissances en France avec 7 300 bébés nés en 2014 dont 20 % des mères étaient des comoriennes non régularisées (40 % des mères de la maternité sont comoriennes) en 2017. Le désir de refouler ces clandestins vers les Comores se fait de plus en plus sentir. Aucune structure n'existe pour aider ces clandestins, aucun service social hormis la DDASS, et la coopération entre la France et les Comores reste embryonnaire sur la question de la santé, malgré la présence de coopérants français médicaux à Anjouan.
an 2017 : Mozambique - le spectre d'une nouvelle guerre civile s'éloigne début 2017. Par contre, un scandale de dettes cachées, à la fin du deuxième mandat d'Armando Guebuza, touche le FRELIMO même si le président a changé, et fragilise le pays. Des médias anglo-saxons démontrent l'existence d'emprunts contractés de façon opaque mais garantis par le gouvernement de l'époque, pour 1,8 milliard d’euros, par trois entreprises publiques. L'affectation précise des sommes reste floue, même s'il est indiqué que ces emprunts auraient financé un programme d'armement. Depuis, le Mozambique, incapable d’honorer les remboursements de ces dettes, est plongé dans une crise financière.
an 2017 : Rwanda - Une opposante, Diane Rwigara annonce son intention de se présenter à l'Élection présidentielle rwandaise de 2017. 72 heures plus tard, des photos d'elle dénudée sont divulguées, dans un but d'intimidation. Elle persiste dans sa candidature, mais cette candidature est invalidée le 7 juillet 2017, par la Commission électorale nationale. Cette candidate semble disparaître fin août 2017, puis la police rwandaise annonce son arrestation, pour atteinte à la sureté de l’État. Début octobre, elle est inculpée, ainsi que sa mère et sa sœur, d’« incitation à l’insurrection ». Elle est libérée sous caution quelques mois plus tard en signe d'apaisement, et finalement acquittée par un tribunal de Kigali le 6 décembre 2018, ainsi que les co-accusés. Selon le jugement, « les charges retenues par l’accusation sont sans fondement »
an 2017 : Somaliland (ou Somalie Britanique) - En février 2017, le Somaliland et les Émirats arabes unis signent un accord, prévoyant la construction dans le port de Berbera d'une base navale et aérienne, concédée aux Émirats pour 25 ans. Ces derniers s'engagent aussi à agrandir le port civil et à le gérer pendant 30 ans.
Lors de l'élection présidentielle de 2017, Muse Bihi Abdi est élu avec 55,10% des voix le 13 novembre 2017. Il entre en fonction le 13 décembre 2017, à Hargeisa, la capitale du pays, en présence de dignitaires d'Éthiopie, de Djibouti, du Royaume-Uni et de l'Union européenne.
an 2018 : Afrique du Sud - Visé par des affaires de corruption, Jacob Zuma démissionne sous la pression de son parti début 2018, après avoir été menacé de destitution, et Cyril Ramaphosa lui succède comme président de la République par intérim. Le 15 février 2018, le Parlement élit formellement Cyril Ramaphosa président de la République.
Après avoir été élu président de l'ANC le 18 décembre 2017 contre Nkosazana Dlamini-Zuma (ex-femme de Jacob Zuma et ex-présidente de la commission de l'Union africaine), Cyril Ramaphosa obtient de haute lutte le 14 février 2018 la démission de Jacob Zuma de la présidence de la République. Ramaphosa lui succède comme président de la République par intérim avant d'être élu formellement par le parlement. Acculé par la gauche de l'ANC et par la surenchère des Economic Freedom Fighters (EFF), il se prononce en faveur d'une redistribution des terres aux Sud-Africains noirs afin de « panser les plaies du passé » alors que 72 % des terres agricoles restent détenues par des Blancs (personnes physiques ou sociétés commerciales) contre 85 % à la fin de l’apartheid. Le Parlement adopte alors une motion présentée par Julius Malema, le chef des EFF, visant à faire modifier la constitution sud-africaine et permettre, sans compensation financière, l'expropriation de terres agricoles. Une partie de l'opposition invoque une violation du droit de propriété, tandis que des investisseurs et le South African Institute of Race Relations déclarent craindre que cette réforme ne porte atteinte à l'agriculture commerciale et ne provoque une crise durable. En juillet 2018, le président sud-africain annonce que l'ANC compte amender la Constitution pour y faire entrer le principe d'expropriation des fermiers sans compensation, provoquant la chute de la devise nationale. Au delà des fermes, des experts sud-africains de l'Institute for Poverty, Land and Agragian Studies (Université du Cap-Occidental) et du Mapungubwe Institute for Strategic Reflection soulignent que d'autres types de propriétés pourraient être soumises au nouveau Code foncier, notamment en centre-ville (friches et terrains non exploités, bâtiments non entretenus...) ou en zone périphérique rurale (terrains miniers notamment). Mais cette réforme avance avec lenteur. Il est réélu chef de l’État le 22 mai 2019, à l’issue d’élections générales lors desquelles l’ANC obtient le plus faible score de son histoire (57,5 %), passant sous la barre des 60 % pour la première fois depuis un quart de siècle et payant ainsi les errements et les scandales de l'ère Zuma, son prédécesseur.
Il doit également faire face à une opposition interne au sein de l'ANC, avec un clan resté fidèle à Jacob Zuma, ayant à sa tête le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, et son adjointe, Jessie Duarte. Mais le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, connaît également des divisions internes : son leader, Mmusi Maimane, démissionne le 24 octobre 2019, dénonçant une « campagne de dénigrement », de « diffamation » et des « comportements de lâches », quittant à la fois la direction du parti, le parti lui-même et ses fonctions de parlementaire. Ce départ, ou cette éviction, risque de réduire à nouveau ce parti à un «parti de Blancs».
Une vague de xénophobie vis-à-vis des migrants, les «étrangers», secoue également le pays. Par ailleurs, plusieurs sociétés importantes pour l'économie africaine sont en difficulté, notamment la compagnie nationale d'électricité Eskom. Le 19 novembre 2019,au PDG est nommé pour cette entreprise, qui lance dans la foulée un nouveau plan de restructuration.
Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi.
En mars-avril 2020 il doit faire face à la pandémie mondiale de Covid-19 et obtient un certain succès.
an 2018-2019 : Bénin (anc. Dahomey) - En 2018 et 2019, des mouvements sociaux sont constatés mais ne remettent pas en cause la stabilité de la République béninoise. Par contre, une « contagion » djihadiste est constatée avec l'enlèvement de deux Français dans le parc national de la Pendjari, un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Afrique. Cet événement, même si les otages sont libérés par une intervention de forces françaises, confirme la possibilité de voir les groupes djihadistes descendre vers le golfe de Guinée au fur et à mesure de la déstabilisation du Burkina Faso, et du centre du Mali. Cela contrarie également les objectifs du président béninois, Patrice Talon, de développer le tourisme dans son pays.
En 2018, une nouvelle cour de justice est créée. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) apparaît pour l’opposition politique au président Talon comme une institution inféodée au pouvoir de ce dernier. Selon le journaliste Ariel Gbaguidi, la CRIET est « érigée comme une justice superpuissance prête à neutraliser toute voix opposée à celle du chef de l'État et à empêcher toute compétition politique ». Depuis la création de la CRIET, le Réseau Ouest Africain pour l’Édification de la Paix (WANEP-Bénin) affirme qu’il existe des « risques de vassalisation du pouvoir judiciaire »
En février 2018, dans la perspective des élections législatives d’avril 2019, des formations politiques soutenant l’action de Patrice Talon se rassemblent au sein de l’Union progressiste
an 2018-2019 : République de Botswana - Le 1er avril 2018, son vice-président, Mokgweetsi Masisi est désigné pour le remplacer comme président du Botswana. L'année suivante, en 2019, il remporte les élections générales.
an 2018-2019 : Cameroun - Paul Biya est réélu pour un septième mandat en 2018, dans un scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition. Il lance un «grand dialogue national» en 2019. Aucune avancée décisive n'en ressort sur le conflit dans les régions anglophones. Paul Biya fait libérer des détenus, mais les leaders du mouvement restent en prison.
an 2018 : République de Centrafrique - Depuis 2018, des mercenaires russes du Groupe Wagner et de la société privée Sewa Security Services (SSS) sont présents en Centrafrique, où ils participent à la formation de militaires des Forces Armées Centrafricaines (FACA) et à la protection rapprochée du Président centrafricain.
an 2018 : Congo Kinshasa - Le 30 décembre 2018, les élections ont lieu et le 10 janvier 2019, le président de la CENI, Corneille Nangaa proclame Félix Tshisekedi comme président de la république démocratique du Congo. Le président Tshisekedi prête serment le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation, résidence officielle des présidents congolais.
Félix Tshisekedi a noué une alliance de circonstance pendant la campagne électorale avec le parti de Joseph Kabila, devenu sénateur à vie et qui conserve ainsi une influence sur le pouvoir. Leur principal opposant, Martin Fayulu, donné un moment vainqueur de l'élection présidentielle, sur la base d'une fuite de données de la CENI et par la mission d’observation de l’Église catholique congolaise, est contraint de s'incliner devant le résultat annoncé, probablement truqué. La Cour constitutionnelle a rejeté son recours. Par cette alliance, Félix Tshisekedi joue aussi la stabilité et prépare la suite de son mandat en composant avec l'assemblée législative où le parti de Kabila possède 337 sièges sur 50064,65. Le 6 décembre 2020, le président met fin à la coalition avec Kabila. Les proches de ce dernier sont alors écartés et les autres politiciens rejoignent Félix Tshisekedi. Le nouvel exécutif compte 56 membres dont 14 femmes. Leur objectif sera de « lutter contre la corruption et la misère qui touche les deux tiers de la population et ramener la paix dans l’est du pays, ensanglanté par les violences des groupes armés".
2018-2019 : Égypte - En mai 2014, Abdel Fattah al-Sissi, est réélu pour un deuxième mandat.
Par une révision constitutionnelle validée par un référendum en avril 2019, il se donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Il impose un régime autoritaire, réprime toute opposition et toute voix critique, et met sous contrôle les médias et la justice.
an 2018-2019 : Eswatini (Swaziland) - En avril 2018, à l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance, le roi annonce que le pays reprend son nom d'origine d'avant la colonisation : Eswatini. En octobre 2019, la livraison de voitures de luxe flambant neuves, des Rolls Royce, à la famille royale d’Eswatini provoque des réactions négatives dans ce royaume très pauvre d’Afrique australe, alors que des fonctionnaires manifestent pour demander une revalorisation de leurs salaires.
an 2018 : Gambie - Le 8 février 2018, la Gambie adhère à nouveau au Commonwealth.
an 2018-2021 : Ghana - En 2018, cette nation est également endeuillée par la mort d'un de ses plus célèbres compatriotes, Kofi Annan. Sur le plan économique, le Ghana s'associe avec la Côte d'Ivoire, en 2019, pour obtenir des marchés un prix juste pour le cacao, en suspendant pendant quelques semaines la vente des récoltes 2020-2021. Il cherche à développer le tourisme vers ses terres au sein de la communauté afro-américaine, en mettant l'accent sur la mémoire de la traite négrière. Nana Akufo-Ado, d’inspiration libérale, mise aussi sur le développement de l’esprit d’entreprise. Il incite également la diaspora formée dans les pays occidentaux à revenir au pays, ou à y investir.
an 2018 : Guinée - D'après la Banque mondiale, en 2018, le chômage frappe 80 % des jeunes et près de 80 % de la population active travaille dans le secteur informel. Surtout, 55 % des Guinéens vivent sous le seuil de pauvreté.
an 2018 : Guinée-Bissau - Lors d'une réunion du 30 août 2018 du Conseil de sécurité de l'ONU, les signes d'une amélioration de la situation politique sont soulignés, mais il est rappelé que des points des accords de Conakry restent à réaliser : réforme constitutionnelle et réforme électorale.
an 2018-2020 : Libye - Par contre, la situation reste bloquée entre le Premier ministre Fayez el-Sarraj issu du gouvernement d'accord national (GAN) et le chef de l'Armée nationale libyenne (ANL) du Khalifa Haftar. Des médiations diplomatiques entre ces deux partis sont menées en France, en juillet 2017 à La-Celle-Saint-Cloud, en France toujours en mai 2018 au palais de l'Élysée, puis à Palerme en Italie en novembre 2018, laissant espérer la reprise d'un dialogue. Mais l'assaut militaire déclenché en avril 2019 par les troupes de l'Armée nationale libyenne (ANL) du Khalifa Haftar sur Tripoli, un assaut qui s'enlise ensuite, pulvérise à court terme les espoirs d'un règlement politique. Chacune des forces en présences, le GAN et l'ALN, multiplie les contacts et les alliances avec des puissances extérieures : notamment la Turquie pour le GAN, les Émirats arabes unis,l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Russie pour l'ALN. Une nouvelle initiative de médiation, turco-russe cette fois, pour obtenir la signature à Moscou d’un cessez-le-feu en Libye tourne court, en janvier 2020.
an 2018 - 2023 : Madagascar - Les élections de décembre 2018 portent au pouvoir pour 5 ans Andry Rajoelina. Celui-ci remporte également les élections législatives de mai 2019 et obtient la majoprité absolue à l'Assemblée nationale.
an 2018-2019 : Mali - La situation sécuritaire reste très précaire, avec de nombreuses attaques djihadistes. Les conflits communautaires persistent, occasionnant des centaines de morts, particulièrement dans la région de Mopti. En 2018, l'armée française poursuit ses opérations et particulièrement dans le Liptako Gourma, une zone entre le centre du Mali, le sud-ouest du Niger et le Burkina Faso.
Les djihadistes opèrent une guerre asymétrique : ils procèdent surtout par attaques surprises, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires. Le 23 mars 2019, des miliciens dogons font 157 morts lors du massacre d'Ogossagou, village peul situé près de Bankass, toujours dans le centre du pays. Beaucoup des victimes avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d’autres affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts en 2018 dans le centre du Mali, selon l’ONU. Les troupes françaises sont de plus en plus critiquées localement : poursuivre le combat accroît le risque d’enlisement et de compromission.
an 2018 : Mauritanie - Le premier janvier 2018, la Mauritanie change l'unité de sa monnaie. L'ouguiya passe d'une échelle de 10 à 1, dix ouguiyas deviennent un ouguiya. De nouveaux billets sont émis mais la monnaie conserve le même nom. Avant même l’annonce de la mise en circulation des nouveaux billets, la monnaie mauritanienne se déprécie au marché noir face à l’euro et au dollar, une tendance qui s'aggrave dès l'annonce officielle.
Le 20 mai 2018, le régime durcit la loi sur les partis politiques et un décret ouvre la voie à la dissolution des partis sous-représentés à l'échelle nationale et régionale.
Les élections locales et législatives du 15 septembre 2018 voient la victoire du parti au pouvoir, l'UPR, qui remporte les 13 Conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat, ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale et plus des deux tiers des communes. Le 8 octobre Cheikh ould Baya, député de l'UPR et proche du président, est élu président de l'Assemblée. Le 29 octobre 2018 Mohamed Salem Ould Bechir est nommé Premier ministre et nomme le lendemain un nouveau gouvernement.
Esclavage
Le 12 février 2018, l'ONG Human Right Watch présente à Nouakchott son rapport sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Intitulé « Ethnicité, discrimination et autres lignes rouges : répression à l’encontre de défenseurs des droits humains en Mauritanie » le rapport pointe les difficultés rencontrées par les militants traitant des questions sociales sensibles comme l'esclavage, la discrimination entre communautés ou le passif humanitaire du pays.
Le 25 mars 2018, un rapport sur la répression contre les militants des droits de l'Homme en Mauritanie est publié par Amnesty International. Le rapport avance que 43.000 personnes vivent en situation d'esclavage dans le pays. Amnesty International détaille également la façon dont les militants abolitionnistes et les associations qui dénoncent ces discriminations sont la cible des autorités108. Trois jours plus tard, la cour criminelle de Nouadhibou condamne un homme et une femme à respectivement 20 et 10 ans de prison ferme pour esclavagisme. Une première en Mauritanie.
Le 4 novembre 2018, les États-Unis, constatant le manque de progrès du pays en matière de lutte contre l'esclavage, suspendent la Mauritanie de l'AGOA.
Situation sanitaire et humanitaire
Le 26 juin 2018, la Mauritanie alerte sur des cas de malnutrution sévères touchant plusieurs dizaines d’enfants dans l’est du pays. La région du Hod Ech Chargui, non loin de la frontière avec le Mali, est particulièrement touchée.
En juin 2018, un rapport de l’ONU établi que les trois quarts des mauritaniens vivent dans une extrême pauvreté. Présenté durant la 35e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU par le rapporteur spécial Philip Alston, le rapport pointe les difficultés dans l'accès à l'eau, à l'alimentation, à l'éducation et à la santé de la population.
En décembre 2018, grâce à un don chinois, la capitale Nouakchott se dote d'un véritable réseau d'assainissement, absent jusqu'ici
an 2018-2020 : Nigéria - Entre 2011 et 2018, le bilan humain de ce violent conflit a été estimé à 37 530 morts.
Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest prend également part à l'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria. En août 2018, Mamman Nour, le numéro 2 de l'organisation, accusé d'être trop modéré, est assassiné par d'autres membres de l'EIAO et les partisans d'une ligne plus dure reprennent le dessus. Le groupe s'en prend alors de plus en plus aux civils. Le 26 décembre 2019, le groupe diffuse notamment une vidéo montrant l'exécution par balles de 11 chrétiens.
En novembre 2020, au moins 110 civils sont tués par des jihadistes présumés dans l'État de Borno sans que le massacre ne soit revendiqué par l'un des deux groupes.
an 2018 : Sierra Leone - En 2018, le pays connaît une nouvelle alternance politique entre les deux principaux partis. Le candidat de l’opposition, Julius Maada Bio, ancien militaire de 53 ans, remporte les présidentielles avec 51,81 % des voix, contre 48,19 % pour Samura Kamara, le candidat du parti précédemment au pouvoir, le Congrès de tout le peuple (APC)
an 2018 : Somaliland (ou Somalie Britanique) - Le 7 octobre 2018, le porte-parole du gouvernement du Somaliland déclare officiellement que son gouvernement est prêt à ouvrir un dialogue diplomatique avec le gouvernement somalien, afin qu'il puisse enfin mettre fin à l'hostilité politique, sociale et économique chronique des deux pays
an 2018 : Soudan - En 2018, le régime applique en 2018 un plan d'austérité du Fonds monétaire international, transférant certains secteurs des importations au secteur privé. En conséquence, le prix du pain est doublé et celui de l’essence augmente de 30 %. L’inflation atteint les 40 %. Des mouvements étudiants et le Parti communiste soudanais organisent des manifestations pour contester cette politique. Omar el-Bechir réagit en faisant arrêter le secrétaire général du Parti communiste et deux autres dirigeants du parti, et par la fermeture de six journaux.
an 2018 : Swaziland (Estwatini) - En avril 2018, à l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance, le roi annonce que le pays reprend son nom d'origine d'avant la colonisation : Eswatini. En octobre 2019, la livraison de voitures de luxe flambant neuves, des Rolls Royce, à la famille royale d’Eswatini provoque des réactions négatives dans ce royaume très pauvre d’Afrique australe, alors que des fonctionnaires manifestent pour demander une revalorisation de leurs salaires.
an 2019 : Afrique du Sud - Cyril Ramaphosa est réélu chef de l’État le 22 mai 2019, à l’issue d’élections générales lors desquelles l’ANC obtient le plus faible score de son histoire (57,5 %), passant sous la barre des 60 % pour la première fois depuis un quart de siècle et payant ainsi les errements et les scandales de l'ère Zuma, son prédécesseur.
Il doit également faire face à une opposition interne au sein de l'ANC, avec un clan resté fidèle à Jacob Zuma, ayant à sa tête le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, et son adjointe, Jessie Duarte. Une vague de xénophobie vis-à-vis les migrants, les « étrangers », secoue également le pays.
an 2019-2022 : Algérie - Depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika et l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, le pays est dirigé par le président Abdelmadjid Tebboune.
an 2019 : Bénin (anc. Dahomey) - En décembre 2019, l’annonce, par le président ivoirien Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron, de la fin du franc CFA pour les huit pays de la CEDEAO, au profit de l'Eco est diversement qualifiée. Décision historique pour certains, d'autres la qualifient d’« arnaque » et de « poudre aux yeux ». Une parité fixe est maintenue pour la future monnaie avec l’euro.
En mars 2019, la Commission électorale nationale autonome ne valide que deux listes sur 7 présentées, toutes deux favorables au président Patrice Talon, pour les élections du 28 avril 2019. L’opposition se retrouve exclue de facto des élections.
Le 29 mars la Cour africaine des droits de l’homme réunie à Arusha dénonce des dérives éloignant le pays de l’État de droit. Jean-Baptiste Elias, dirigeant du Front des Organisations Nationales contre la corruption, affirme en avril 2019 que « la démocratie risque de tourner en dictature » au Bénin. Dans le contexte d’élections législatives controversées et sans opposition, l’ONG Social Watch Bénin décide de ne pas participer au processus contrairement à la séquence électorale de 2015.
Quelques mois après les élections, en mai 2019, une intrusion djihadiste est constatée avec l'enlèvement de deux Français dans le parc national de la Pendjari. Cet événement, même si les otages sont libérés par une intervention de forces françaises, confirme la possibilité de voir les groupes djihadistes descendre vers le golfe de Guinée au fur et à mesure de la déstabilisation du Burkina Faso, et du centre du Mali. Cela contrarie également un des objectifs économiques du président béninois, Patrice Talon, de développer le tourisme dans son pays.
an 2019 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - - Dans la nuit du 3 au 4 février 2019, un groupe terroriste attaque la ville de Kaïn dans le département du même nom, au nord de la province du Yatenga. Le bilan est de 14 morts civils. L'armée réagit rapidement, avec des actions contre les groupes terroristes dans le nord-ouest du pays, déclarant avoir alors « neutralisé » 146 terroristes. À la veille du début de l'année de la présidence par le pays du G5 Sahel, l'attaque terroriste porte à près de 300 le nombre d'habitants assassinés par ces groupes depuis 201541. Le jour inaugural du G5 Sahel, mardi 5 février, un détachement de la gendarmerie est attaqué à Oursi, cinq militaires meurent, contre selon l'armée, 21 assaillants tués lors de l'attaque. L'insécurité croissante a entrainé la multiplication des milices. En 2020, le pays compterait près de 4 500 groupes de koglweogo, mobilisant entre 20 000 et 45 000 membres.
Pour faire face au crime organisé (attaques à main armée dans les lieux de travail et habitations, vols d'animaux et autres formes de violences ciblant notamment les populations rurales et périurbaines), des groupes d'autodéfense se sont constitués au sein de certaines communautés. Dénommés « koglwéogo », ils sont indépendants vis-à-vis de l'État, ne rendent comptes à personne. Ils agissent hors de tout cadre légal. Ils ont localement fait reculer la délinquance, mais des exactions commises par certains de leurs membres créent une nouvelle source d'insécurité et de péril pour les droits humains, et affaiblissent encore le système judiciaire légal (déjà critiqué pour son inefficacité par la population et les médias). Au sein de koglwéogo qui, sous prétexte d'une réponse citoyenne à la crise sécuritaire, « s'arrogent le droit d'arrêter, de juger et de sanctionner, par des amendes, sévices corporels et humiliations, au terme de tribunaux populaires expéditifs », de graves violences (torture notamment) sont observées. « De présumés voleurs sont ligotés au pied d'un arbre, fouettés avec des branches enflammées de tamarinier, le tout en public, et ce jusqu'à ce qu'ils avouent leur crime », bafouant les droits humains via une justice expéditive. Selon Amnesty international, « les Koglwéogo ont commis des exactions, telles que des passages à tabac et des enlèvements, poussant ainsi des organisations de la société civile à reprocher à l’État de ne pas agir suffisamment pour empêcher ces violences et y remédier ; une levée de boucliers qui avait amené l'Etat à condamner en septembre 2016 Koglwéogo à 6 mois d'emprisonnement, et 26 autres à des peines allant de 10 à 12 mois de prison avec sursis. Les 29 et 30 mai 2020, plusieurs attaques djihadistes ont fait une cinquantaine de morts à Kompienga48. Dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, une nouvelle attaque djihadiste tue plus de 160 personnes dont « une vingtaine d'enfants » à Solhan, un village situé au nord-est du pays. C'est l'attaque la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso depuis le début des assauts djihadistes, en 2015. En six ans, les violences ont déjà fait plusieurs milliers de morts, plus particulièrement dans les zones proches des frontières avec le Mali et le Niger
an 2019 : Afrique du Sud - Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa, Président d'Afrique du Sud, prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi
an 2019 : Algérie -
22 février 2019, Hirak contre le 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Les manifestations durent plusieurs semaines et se déroulent tous les vendredis
11 mars 2019, retrait de la candidature de Abdelaziz Bouteflika aux élections du 18 avril 2019 et annulation des élections
2 avril 2019, le président Abdelaziz Bouteflika démissionne
9 avril 2019, le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah est investi des fonctions de chef de l'État par intérim
19 décembre 2019, élection de Abdelmadjid Tebboune, Président de la république algérienne démocratique et populaire.
an 2019 : Cameroun - En 2019, les combats entre les guérillas séparatistes et les forces gouvernementales se poursuivent.
an 2019 : Centrafrique (République de) - Le 6 février 2019, l'État centrafricain signe avec les 14 principaux groupes armés du pays un nouvel accord de paix négocié en janvier à Khartoum (Soudan). Malgré cet accord, 80 % du territoire restent contrôlés par des groupes armés et les massacres de populations civiles continuent.
an 2019 : Congo (République Démocratique du) - Présidence Félix Tshisekedi
an 2019-2020 : Gabon - Le 7 janvier 2019, une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence après un accident vasculaire cérébral, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour ; sur cinq mutins, deux sont tués et les autres arrêtés. Le 12 janvier, un nouveau Premier ministre est nommé, Julien Nkoghe Bekalé. Le pouvoir gabonais connaît une guerre des clans au sommet. Les remaniements ministériels se succèdent entre janvier et décembre 2019, alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé d'Ali Bongo. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée première ministre en juillet 2020.
an 2019 : Gambie - Le 27 août 2019, Dawda Jawara décède, il avait était premier Premier ministre de Gambie entre 1962 et 1970, puis le premier président de la République de Gambie de 1970 à 1994.
an 2019 : Guinée-Bissau - élection présidentielle de fin 2019 voit la défaite du candidat de l'ex-parti unique, au pouvoir depuis 1974, le PAIGC, et la victoire d'Umaro Sissoco Embaló, ancien général et ancien Premier ministre devenu opposant. La confirmation de ce résultat est compliquée, donnant lieu à des allers et retours entre la Commission électorale et la Cour suprême (saisie par le PAIGC), mais c'est la première transition politique qui s'effectue pacifiquement.
an 2019 : Guinée équatoriale - La population de Guinée équatoriale vit dans des conditions précaires. Bata, seconde ville du pays et capitale économique, a été ainsi privée d'eau courante pendant trois semaines en 2019, sans que les autorités s'expliquent sur les difficultés rencontrées.
an 2019 : Libye - L'assaut militaire déclenché en avril 2019 par les troupes de l'Armée nationale libyenne (ANL) du Khalifa Haftar sur Tripoli, un assaut qui s'enlise ensuite, pulvérise à court terme les espoirs d'un règlement politique. Chacune des forces en présences, le GAN et l'ALN, multiplie les contacts et les alliances avec des puissances extérieures : notamment la Turquie pour le GAN, les Émirats arabes unis,l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Russie pour l'ALN.
an 2019 : Mali - Les djihadistes opèrent une guerre asymétrique : ils procèdent surtout par attaques surprises, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires. Le 23 mars 2019, des miliciens dogons font 157 morts lors du massacre d'Ogossagou, village peul situé près de Bankass, toujours dans le centre du pays. Beaucoup des victimes avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d’autres affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts en 2018 dans le centre du Mali, selon l’ONU. Les troupes françaises sont de plus en plus critiquées localement : poursuivre le combat accroît le risque d’enlisement et de compromission.
an 2019 : Iles Maurice - À la lignée des Ramgoolam succède celle des Jugnauth. Pravind Jugnauth remporte les législatives de 2019.
Le 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution demandant au Royaume-Uni de rétrocéder sous six mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos. Ce délai a pris fin le 22 novembre 2019, sans que le Royaume-Uni se conforme à cette résolution, ni à l'avis consultatif formulé en février par la Cour internationale de justice (CIJ) demandant à Londres de mettre fin « dans les plus brefs délais » à son administration des Chagos.
an 2019 : Mauritanie - Le 28 janvier 2019, un projet de loi est voté autorisant un accord de coopération entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite en matière de lutte contre le trafic d'armes et d'êtres humains. L’opposition mauritanienne crie au scandale, pointant le manque de crédibilité du royaume wahhabite en matière du respect des droits de l’homme.
Le 5 mars 2019, à trois mois de la présidentielle, 76 partis politiques sont dissous par décret rendu public par le ministre mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation. Le 9 mai, six candidatures à la présidentielle du 22 juin 2019 sont validées par le Conseil constitutionnel.
Le 20 mai, une série de nominations faites en conseil des ministres dans les semaines qui précèdent l'élection présidentielle sont dénoncées par plusieurs candidats.
Le 1er juillet 2019, la victoire du général Mohamed Ould Ghazouani dès le premier tour, avec 52 % des voix, est proclamée par le Conseil constitutionnel mauritanien, dans un climat délétère, avec une coupure prolongée d'internet et un déploiement des unités d’élite de l’armée, de la garde et de la police anti-émeute dans toute la capitale, Nouakchott. L'opposition dénonce de multiples irrégularités dans le déroulement du scrutin et qualifie la déclaration de victoire du candidat du pouvoir le soir du premier tour de «nouveau coup d'État».
Le 8 août 2019, le président Ghazouani nomme son premier gouvernement, dirigé par le premier ministre désigné le 3 août, Ismael Ould Bodé Ould Cheikh Sidiya.
Le 19 mars 2019, la police mauritanienne refoule une délégation d'Amnesty International à son arrivée à l'aéroport de Nouakchott
Le 22 mars 2019, les blogueurs Abderrahmane Weddady et Cheikh Ould Jiddou, connus pour dénoncer les atteintes aux droits de l'Homme en Mauritanie sont emprisonnés. Amnesty International explique qu'« Ils ont critiqué la corruption qui régnerait au sein du gouvernement dans des commentaires sur Facebook ». Les deux blogueurs avaient repris sur leurs blogs des articles publiés par des médias arabes faisant état d’un placement présumé de deux milliards de dollars aux Émirats arabes unis par un proche du chef de l’État. Amnesty International qualifie par ailleurs leur détention d’illégale. D'autres ONG comme Reporters Sans Frontières et Human Right Watch dénonceront à leur tour l'arrestation des deux blogueurs.
Le 5 juillet 2019, une vingtaine de journalistes manifestent devant le ministère la Communication et demandent la libération de leur confrère Ahmed Ould Wedia, interpellé chez lui trois jours auparavant.
En mai 2019, la France et la Mauritanie signent un accord de financement d'un montant de 4,4 milliards d'ouguiyas (11 millions d'euros), afin de financer des projets hydrauliques destinés à améliorer les conditions de vie de la population.
Esclavage
Le 28 janvier 2019, un projet de loi est voté autorisant un accord de coopération entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite en matière de lutte contre le trafic d'armes et d'êtres humains. L’opposition mauritanienne crie au scandale, pointant le manque de crédibilité du royaume wahhabite en matière du respect des droits de l’homme.
Les séquelles de l'esclavage touchent particulièrement la population Haratine, qui faute d'accès à l'éducation concentre 85 % des analphabètes du pays
Situation sanitaire et humanitaire
En mai 2019, la France et la Mauritanie signent un accord de financement d'un montant de 4,4 milliards d'ouguiyas (11 millions d'euros), afin de financer des projets hydrauliques destinés à améliorer les conditions de vie de la population.
an 2019 : Mozambique - Le président Filipe Nyusi est réélu en octobre 2019 pour un deuxième mandat de cinq ans avec 73 % des suffrages. Son parti, le FRELIMO, remporte 184 des 250 sièges à l’Assemblée nationale et dirige l’ensemble des dix provinces du pays. Ce scrutin a été manipulé comme les précédents pour en garantir le résultat : redécoupage de la carte électorale pour gonfler l’importance des bastions du pouvoir, mise à disposition constante des moyens de l’Etat pour la campagne du parti au pouvoir, tracasseries pour les opposants, usage de la violence, etc., le FRELIMO montre une volonté d’hégémonie. Ceci pose aussi la question d’un processus de paix jamais arrivé à son terme depuis le premier accord avec l’ancienne rébellion de la Résistance nationale mozambicaine (RENAMO), en 1992. Ossufo Momade a été le candidat de la RENAMO, mouvement affaibli par la mort de son chef historique, Afonso Dhlakama, en 2018.
Le Mozambique peut devenir l'un des grands producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, avec d'importantes réserves, et devient à ce titre un pays courtisé. Les ressources en gaz naturel devraient être exploitées en particulier dans la province de Cabo Delgado d’ici à cinq ans. Total, notamment, a finalisé son entrée fin septembre 2019 dans l’un des deux projets majeurs, Mozambique LNG.
an 2019 : Namibie - En 2019 a lieu L'élection présidentielle namibienne de 2019, en même temps que les élections législatives. Le président sortant Hage Geingob, de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (abrégée en SWAPO) est réélu avec un score, en baisse, de 56 % des suffrages. La SWAPO est au pouvoir depuis 1990. La participation au scrutin présidentiel a été de 60 %. Les autres candidats ont été Panduleni Itula, candidat dissident de la SWAPO qui obtient 30 % des suffrages. Il est en tête dans la capitale du pays. Le chef de l’opposition, McHenry Venaani, ne récolte que 5,4 %. La proximité passée de son parti, le Mouvement démocratique populaire (PDM) (ex-Alliance démocratique de la Turnhalle), avec le régime de l'apartheid en Afrique du Sud de l’apartheid, continue à être un repoussoir pour une grande part de l’électorat. Un nouveau parti d’opposition émerge, le Mouvement des sans-terre (LPM) de Bernadus Swartbooi : Bernadus Swartbooi réunit 2,8 % des suffarges exprimés.
La SWAPO est critiquée pour des scandales de corruption et ses résultats politiques sont affectés aussi par la situation économique et l'importance du chômage. Le secteur minier reste important. Mais la chute des cours des matières premières a réduit les recettes. Par ailleurs, une sécheresse persistante depuis plusieurs saisons a contribué aussi à faire reculer le produit intérieur brut (PIB) deux ans de suite, en 2017 et en 2018. « Les moyens de subsistance d’une majorité de Namibiens sont menacés, notamment ceux qui dépendent des activités de l’agriculture », n'a pu que déplorer la première ministre Saara Kuugongelwa-Amadhila. Le chômage touche un tiers de la population.
an 2019 : Niger - La situation sécuritaire continue à se dégrader dans les territoires limites avec le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria. C'est une zone d'instabilité pour l'Afrique de l'Ouest, d'autant que la croissance démographique y est forte. En juillet 2019, 18 soldats nigériens trouvent la mort dans un assaut mené par les hommes d'Abou Walid al-Sahraoui, un djihadiste sahraoui, ayant fait allégeance à l'État islamique. Le 10 décembre 2019, au moins 71 militaires sont tués et un « nombre important d'assaillants neutralisés » dans l'attaque du poste militaire d'Inates situé en zone frontalière avec le Mali. Les assaillants sont des djihadistes en provenance du nord du Mali. La localité d'Inates se situe non loin des villages maliens d'Akabar et de Tabankort qui servent de carrefour aux narcotrafiquants et aux terroristes. La présence militaire nigérienne gênerait ces trafiquants dans leurs acheminements vers la frontière algérienne.
En décembre 2019, l’annonce, par le président ivoirien, et le président français Emmanuel Macron, de la fin du franc CFA pour les huit pays de la CEDEAO dont le Niger, au profit de l'Eco est diversement qualifiée. Décision historique pour certains, d'autres la qualifient d’« arnaque » et de « poudre aux yeux ». Une parité fixe est maintenue pour la future monnaie avec l’euro.
an 2019-2021 : Sainte-Hélène (Île) - Le pouvoir exécutif est détenu par le roi Charles III, qui le délègue à un gouverneur, le gouverneur de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha – résidant à Plantation House –, nommé par lui sur conseil du gouvernement britannique. Le gouverneur est Philip Rushbrook depuis le 11 mai 2019. Suivant le modèle d'un régime parlementaire, le chef d’État et son gouverneur ne jouent cependant qu'un rôle figuratif, le pouvoir exécutif étant réellement exercé par le Ministre en chef de Sainte-Hélène, soit depuis le 25 octobre 2021, Julie Thomas.
an 2019 : Sénégal - Macky Sall, dans son discours d'investiture le 2 avril 2019, met l'accent sur le bilan économique de son premier mandat, et promet « stabilité et continuité » pour son deuxième mandat.
an 2019 : Soudan - En 2019, un vaste mouvement de protestation contre le régime se forme dans les villes de l’extrême nord du pays, en particulier autour d'Atbara, agglomération ouvrière et fief du syndicalisme soudanais. Les manifestants réclament initialement de meilleures conditions de vie (plus de vingt millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté), puis, alors que la répression s’accentue, la démission du président.
Le 11 avril 2019, Omar el-Bechir est renversé par l'armée. Le ministre de la Défense Ahmed Awad Ibn Auf annonce la mise en place d'un gouvernement de transition pour deux ans jusqu'à de nouvelles élections libres.
Le 12 avril 2019, au lendemain de la destitution du président, le Conseil militaire de transition déclare que le futur gouvernement sera un gouvernement civil en promettant un dialogue entre l'armée et les politiciens soudanais. L'armée entame alors des discussions avec les autorités civiles d'opposition et les organisations représentant les manifestants. Le 3 juin 2019, alors que les négociations piétinent et que les manifestants campent devant le QG de l'armée depuis près de deux mois, l'armée et la milice des Forces de soutien rapide tirent sur la foule pour tenter de déloger les manifestants causant un massacre. Le 4 juin 2019, le chef du Conseil militaire de transition, Abdel Fatah al-Burhan, annonce la fin des négociations avec les civils et promet la tenue d'élections d'ici 9 mois.
Le 21 août, à la suite d'un accord, le Conseil militaire de transition devient le Conseil de souveraineté. Il maintient les président et vice-président sortants en place mais dispose de membres civils. Abdallah Hamdok est nommé Premier ministre. Il annonce la composition d'un gouvernement de transition début septembre 2019, un gouvernement composé de dix-huit membres dont quatre femmes, notamment Asma Mohamed Abdallah une diplomate expérimentée qui devient ministre des affaires étrangères : « La première priorité du gouvernement de transition est de mettre un terme à la guerre et de construire une paix durable », est-il précisé, faisant référence aux conflits et rébellions qui pèsent sur le Darfour, le Nil Bleu et le Kordofan du Sud.
an 2019 : Tunisie - Président de la République – 23 octobre 2019 : Kaïs Saïed, né le 22 février 1958 à Tunis. Il est élu au second tour avec 72,7 % des suffrages exprimés, face à l'homme d'affaires Nabil Karoui.
an 2020 : UNION AFRICAINE - Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud, prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi.
an 2020 : Algérie -
février : le premier foyer de contagion du Covid-19 est déclaré dans la wilaya de Blida
octobre : les autorités algériennes annoncent que le président Abdelmadjid Tebboune est atteint du Covid-19
an 2020 : Burundi - La situation économique continue à se dégrader. Début 2020, le général Évariste Ndayishimiye est désigné comme candidat pour l’élection présidentielle du 20 mai 2020 par le parti au pouvoir, pour succéder à Pierre Nkurunziza. Il remporte l'élection présidentielle du 20 mai 2020, en obtenant 68,72 % des voix et devance très largement le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, président du Conseil national pour la liberté (CNL), qui réunit 24,19 % des voix.
an 2020 : Cameroun - Au cours de l'année 2020, de nombreuses attaques terroristes - dont beaucoup ont été menées sans revendication - et les représailles du gouvernement ont fait couler le sang dans tout le pays. Depuis 2016, plus de 450 000 personnes ont fui leurs foyers. Le conflit a indirectement conduit à une recrudescence des attaques de Boko Haram, l'armée camerounaise s'étant largement retirée du nord pour se concentrer sur la lutte contre les séparatistes ambazoniens. Paul Biya est réélu pour un septième mandat en 2018, dans un scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition. Il lance un « grand dialogue national », mais aucune avancée décisive n'en ressort sur le conflit dans les régions anglophones. Paul Biya fait libérer des détenus, mais les leaders du mouvement restent en prison.
Les élections législatives et municipales du 9 février 2020 entraînent un regain de violence dans les régions anglophones du Cameroun, autour de la tentative d'indépendance de l'Ambazonie. Les groupes armés séparatistes promettent des représailles à ceux qui iraient voter, en réaction le gouvernement central du Cameroun augmente ses effectifs militaires dans la zone. Dans les deux semaines précédant les élections, selon Human Rights Watch, les rebelles séparatistes enlèvent plus d'une centaine de personnes dans les deux régions anglophones, tandis que les forces de sécurité commettent de nombreux abus de pouvoir. Le 7 février 2020, c'est depuis sa cellule à la prison centrale de Yaoundé que Sisiku Julius Ayuk Tabe, président du gouvernement intérimaire d’Ambazonie, déclare, qu’ils sont plus que jamais engagés dans une indépendance totale ou une résistance à jamais.
Les violences se poursuivent après les élections. Ainsi, le 16 février 2020, 22 civils dont 14 enfants et 1 femme enceinte sont massacrés à Ntumbaw, un village du Nord-Ouest. l'opposition camerounaise (surtout le Mouvement pour la renaissance du Cameroun) et les ONG locales accusent l'Armée et le gouvernement d'avoir perpétré le massacre, dans un contexte de répression de la tentative de sécession de l'Ambazonie.
Le 21 avril 2020, le régime camerounais admet sa responsabilité, expliquant que l'Armée et un groupe d'autodéfense allié avaient attaqué des indépendantistes, tuant 5 d'entre-eux, puis s'étaient rendus compte que leur assaut avait également tué accidentellement les femmes et les enfants, et avaient alors décidé de déclencher l'incendie pour tenter de masquer leurs faits.
Le 2 juillet 2020, déjà très impliquée lors de la tenue des assises du « grand dialogue national », l'Église catholique a de nouveau joué les facilitateurs lors de la récente prise de contact entre les séparatistes anglophones emprisonnés à Yaoundé et des émissaires du gouvernement. C'est d'ailleurs au centre épiscopal de Mvolyé, dans la capitale camerounaise, que cette rencontre s'est tenue. Pour l'occasion, Julius Ayuk Tabé, le président autoproclamé de l'Ambazonie et quelques-uns de ses partisans avaient été spécialement extraits de leurs cellules pour entamer des discussions avec les autorités du gouvernement. Entre eux, un témoin privilégié : Monseigneur Andrew Nkea Fuanya, archevêque de Bamenda. Cette nouvelle implication de l'Église catholique pour tenter de rapprocher les parties en conflit de la crise dans les régions anglophones a été plutôt bien perçue par nombre d'observateurs, alors que jusqu'ici une sorte de crise de confiance semble installée de part et d'autre entre protagonistes. D'autant que dix mois après la tenue du Grand dialogue national, les résolutions qui en avaient été issues tardent à être mises en application. Notamment le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le 20 août 2020, Le procès en appel du leader séparatiste anglophone Sisiku Ayuk Tabe et de ses neuf co-accusés a été une nouvelle fois reporté. Une partie des magistrats affectés à ce dossier ayant été récemment mutés, la cause a été renvoyée au 17 septembre 2020.
Le 17 septembre 2020, Une Cour d’appel camerounaise a confirmé, la condamnation à la prison à vie prononcée en 2018 contre Sisiku Ayuk Tabe. Sisiku Ayuk Tabe avait été jugé coupable « sécession » et « terrorisme », en lien avec le conflit dans les régions anglophones du Cameroun. Il s’était autoproclamé président de l’Ambazonie, nom donné par les indépendantistes anglophones à l’ancien Cameroun du Sud britannique, non reconnu internationalement. Lors de l’audience la Cour d’appel a estimé que le tribunal militaire qui avait condamné Sisiku Ayuk Tabe et ses coaccusés le 20 août 2019 a bien dit le droit. Elle a donc confirmé la prison à vie pour les accusés, assortie d’une amende de 250 milliards de francs CFA.
Dans les deux régions à majorité anglophones du Cameroun, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, des indépendantistes s’opposent violemment à l’armée depuis 2017 et les deux camps sont régulièrement accusés d’exactions contre des civils par des ONG. Au moins 3 000 personnes ont perdu la vie et plus de 700 000 autres ont dû fuir leur domicile, selon les Nations unies.
an 2020-2021 : République de Centrafrique - En décembre 2020, des mercenaires russes du groupe Wagner s'engagent aux côtés de l'armée centrafricaine, des forces de la MINUSCA et des forces rwandaises contre les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement qui veulent prendre Bangui et empêcher la tenue des élections présidentielle et législatives. Le 31 mars 2021, le Groupe de travail des Nations unies sur les mercenaires a dit sa préoccupations sur des violations répétées des droits de l'Homme par les mercenaires du groupe Wagner. Une enquête de RFI a collecté de nombreux indices, dont des documents confidentiels et des témoignages allant en ce sens. Le gouvernement centrafricain a réagi en mettant en place une commission d'enquête. La Russie a dénoncé « de fausses nouvelles » qui « servent les intérêts des malfaiteurs qui complotent pour renverser le gouvernement ».
an 2020 : Côte d'Ivoire - Le scrutin présidentiel d'octobre 2020 se déroule dans des conditions difficiles. Le président Ouattara, qui finissait son deuxième mandat et qui souhaitait en tout état de cause se retirer, fait volte-face en raison du décès brutal de son dauphin, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il doit pour cela s'appuyer sur une jurisprudence contestée pour remettre le "compteur des mandats" à zéro (la Constitution de 2016 limite à deux le nombre de mandats présidentiels mais les partisans du chef de l’État invoquent le caractère non rétroactif de celle-ci), sans convaincre l'opposition qui dénonce un troisième mandat inconstitutionnel36. Parallèlement, le pouvoir limite fortement le nombre de candidatures. Ainsi, le conseil constitutionnel rejette 40 dossiers sur les 44 reçus. Deux poids lourds politique de l'opposition sont en outre bloqués en Europe, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Henri Konan Bédié, dernière grande figure en lice, lance un appel à la désobéissance, entraînant la non ouvert de plus de 5 000 bureaux sur un total 22 301. Le score final du président Ouattara est le reflet des extrêmes tensions qui ont empêché finalement le déroulement du scrutin, avec un score de 94,2%.
an 2020-2021 : Éthiopie - les relations entre le gouvernement fédéral et celui de la région du Tigré se dégradent rapidement après les élections. Le 4 novembre 2020, le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) lance une attaque contre des bases des Forces de défense nationale éthiopiennes à Mekele, la capitale du Tigré, et à Dansha, une ville de l’ouest de la région. La guerre du Tigré escalade et se poursuit depuis cette date.
Les Forces de défense tigréennes ont repris la capitale régionale, Mekele, forçant le gouvernement éthiopien à décréter, le lundi 28 juin 2021, un « cessez-le-feu unilatéral »
Le 28 juin 2021, sept mois après avoir dû abandonner Mekele face aux assauts de l’armée gouvernementale éthiopienne, les forces du Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) reprennent le contrôle de la capitale provinciale du Tigré. Dans cette région du nord de l’Éthiopie, en guerre depuis novembre 2020, les derniers jours ont été le théâtre d’un spectaculaire renversement de situation militaire, forçant le gouvernement éthiopien à décréter un cessez-le-feu.
En marge du conflit au Tigré éthiopien, l’armée soudanaise tente de reprendre la main sur le triangle d’Al-Fashaga, un territoire agricole disputé par L’Éthiopie et le Soudan, pays de la Corne de l'Afrique. C’est un bras de fer qui menace de dégénérer, dans le sillage du conflit en cours dans la province éthiopienne du Tigré. En jeu : le triangle d’Al-Fashaga, soit 250 km2 de terres fertiles coincées entre les rivières Tekezé et Atbara, au cœur d’une dispute historique entre le Soudan et l’Éthiopie.
Début novembre 2021, plusieurs États occidentaux ordonnent à leurs nationaux de quitter l'Éthiopie, en prévision d'une éventuelle prise d'Addis-Abeba par le TPLF accompagnée d'exactions tribales. À ce stade le conflit a coûté, outre des milliers de morts, le déplacement forcé de plus de deux millions de personnes et un risque de famine pour cinq millions.
an 2020 - 2023 : Ghana - En décembre 2020, le président Nana Akufo-Addo a été réélu pour un second et dernier mandat, avec une courte majorité face à John Dramani Mahama, chef de l’Etat entre 2012 et 2016, mais dans de bonnes conditions (79% de participation, violences mineures pour la sous-région). Les deux principaux partis ghanéens (National Patriotic Party - majorité, et National Democratic Congress - opposition) sont maintenant tournés vers l’élection présidentielle de 2024. Il s’agira pour le NPP de tenter, pour la première fois depuis le rétablissement du multipartisme en 1992, de remporter un troisième scrutin présidentiel d’affilé. A la suite des élections législatives de décembre 2020, le NPP compte le même nombre de députés que le NDC au Parlement. Les débats au sein du Parlement ghanéen ont donc été vifs, à propos de l’adoption des budgets 2022 et 2023 par exemple.
Sur le plan sécuritaire, le Ghana, qui a jusqu’ici été épargné par les attaques terroristes, craint une expansion des groupes armés terroristes sahéliens depuis le Burkina Faso. Le Nord-Est du pays (Upper-East) connaît régulièrement des affrontements entre deux communautés pour le contrôle du trône de Bawku.
Le Ghana siège au Conseil de Sécurité des Nations Unies depuis le 1er janvier 2022, et ce jusqu’à la fin de l’année 2023. A cet égard, il s’est engagé à travailler avec les autres membres du Conseil pour promouvoir la paix et la sécurité internationales.
an 2020 : Guinée - En mars 2020, en dépit des manifestations et du désaccord de la grande partie de la population et de l'opposition et ce malgré une loi stipulant qu'aucun président ne peut se présenter pour plus 2 mandats consécutifs, Alpha Condé modifie la Constitution pour pouvoir légalement se représenter. Il est alors officiellement candidat pour un troisième mandat pour les élections s'étant tenues en octobre 2020.
an 2020 : Guinée-Bissau - L'investiture d'Umaro Sissoco Embaló a lieu le 27 février 2020. La passation de pouvoir s'effectue ensuite au palais présidentiel. Nuno Gomes Nabiam est nommé Premier ministre le lendemain, le 28 février 2020. Mais une incertitude subsiste : une partie des députés investissent comme président, le 28 février au soir, le président de l’Assemblée nationale, Cipriano Cassama, par intérim. Pour eux, l'investiture de Umaro Sissoco Embalo n'est pas légale.
an 2020 : Libéria - Le 1er octobre 2020, le Président Weah a procédé à un remaniement de son gouvernement et a formé un gouvernement d’union nationale pour faire face notamment aux défis sociaux, économiques et sanitaires auxquels le pays est confronté.
La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2023.
an 2020 : Libye - Une nouvelle initiative de médiation, turco-russe cette fois, pour obtenir la signature à Moscou d’un cessez-le-feu en Libye tourne court, en janvier 2020.
an 2020 : Malawi - Le 3 février 2020, la cour constitutionnelle, constatant des irrégularités, annule l'élection. Le 23 juin 2020, Lazarus Chakwera, né le 5 avril 1955 à Lilongwe, remporte largement la nouvelle élection présidentielle avec 59,34% des voix. Il devance Mutharika, qui cumule 39,92% des voix.
an 2020 : Mali - En 2020, dans un contexte d'élections législatives contestées et de manifestations massives menées par le M5-RFP, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrêté par des mutins et démissionne sur les ondes de l'ORTM, à minuit le 19 août 2020. Quelques heures plus tard, le Comité national pour le salut du peuple prend le pouvoir. Il est présidé par Assimi Goïta et dispose des services d'Ismaël Wagué comme porte-parole. Ce coup d'État est condamné de manière unanime par la communauté internationale.
Assimi Goïta en tant que président du CNSP la junte militaire qui a renversé Ibrahim Boubacar Keîta le 18 août 2020.
Bah N'Daw après avoir été désigné par le CNSP Président de la Transition le 21 septembre 2020 puis renversé par un coup d'État.
an 2020 : Iles Maurice - Le 15 janvier 2020, Pravind Jugnauth premier ministre des île Maurice, était à Londres pour assister à un sommet sur les investissements de la Grande-Bretagne en Afrique. il s'est entretenu avec les chefs des gouvernements de l'Afrique du Sud, du Kenya, de Côte d'Ivoire et du Mozambique. Il a indiqué que : « Port-Louis étudiait la possibilité d’entamer des poursuites contre des responsables britanniques devant la Cour pénale internationale pour crime contre l’humanité ».
an 2020 : Mauritanie - août 2020, le Premier ministre Mohamed Ould Bilal pilote la mise en œuvre du Programme prioritaire élargi du Président de la République Mohamed Ould Ghazouani.
an 2020 : Mozambique - Depuis deux ans un groupe d’islamistes armés a déclenché une insurrection dans cette région du nord du pays. Les combats se déroulent à quelques kilomètres des futures installations gazières et le port de Mocimboa da Praia est pris par les insurgés en août 2020.
an 2020 : Namibie - Le 21 mars 2020, la Namibie célèbre son trentième anniversaire d'indépendance.
an 2020 : Niger - Lors du premier tour de l'élection présidentielle le 27 décembre 2020, Mohamed Bazoum obtient 39,33 % des voix, suivi par l'ancien président Mahamane Ousmane qui recueille 16,99 % des votes. Le second tour se tient le 21 février 2021 et est remporté par Mohamed Bazoum avec 55,75 % des suffrages.
an 2020 : Nigeria - En octobre 2020, le pays est secoué par d'importantes manifestations protestant contre l'oppression et la brutalité policières – connues nationalement, et mondialement, sous le nom de EndSARS (abréviation de “End Special Anti-Robbery Squad”). Ce mouvement populaire est violemment réprimé par les autorités.
an 2020 : Seychelles - En 2020, des élections législatives et une élection présidentielle sont organisées : les élections législatives, scrutin uninominal majoritaire à un tour, se déroulent le même jour que le premier rour de l'élection présidentielle, scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Les élections législatives sont remportées par le Linyon Demokratik Seselwa, qui accroît sa majorité absolue à l'assemblée. Et le candidat de ce parti, Wavel Ramkalawan, né le 15 mars 1961 à Mahé, obtient la victoire à la présidentielle, dès le premier tour, conduisant à la première alternance à la Présidence des Seychelles depuis l'indépendance du pays en 1976.
an 2020 : Somalie - Le pays se mobilise début 2020 contre une invasion de criquets pèlerins qui touche la Corne d'Afrique et plusieurs régions d'Afrique de l'Est.
an 2021 : Swaziland (Estwatini) - En 2021, Eswatini (ex-Swaziland), une monarchie absolue dirigée par le roi Mswati III depuis 1986, a été secouée par des vagues de protestations.
an 2020 - 2021 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - John Magufuli acquiert une popularité, notamment grâce à sa lutte contre le gaspillage de l'argent public et contre la corruption, mais fait preuve également de dérives autoritaires, contre ses opposants, contre les libertés individuelles, contre la presse, etc. Il est réélu pour un second mandat en octobre 2020. Il meurt en fonction en mars 2021 et sa vice-présidente Samia Suluhu lui succède.
an 2020 : Togo - Faure Gnassingbé se présente pour un quatrième mandat lors de l'élection présidentielle du 22 février 2020, qui oppose sept candidats. Un changement constitutionnel limite le président de la République à deux mandats, qui sera applicable à partir de 2020.
Il est réélu le 22 février 2020, dès le premier tour, avec 72,36 % des suffrages exprimés contre 4,35 % pour son adversaire Jean-Pierre Fabre et 18,37 % pour le chef de file de l'opposition, la société civile dénonçant également des bourrages d’urnes et des inversions de résultats.
Premier ministre – 28 septembre 2020 : Victoire Tomegah Dogbé, née le 23 décembre 1959 à Lomé.
an 2021 : Afrique du Sud - la ville sud-africaine de Port Elizabeth est officiellement renommée Gqeberha, le nom en xhosa du fleuve côtier Baakens (en) qui traverse la ville.
an 2021 : Algérie -
18 mai 2021 : le Haut conseil de sécurité algérien décide de classer le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK) et le Mouvement Rachad, basés à l'étranger comme organisations terroristes, suite à « des actes hostiles et subversifs commis par les mouvements dits Rachad et MAK pour déstabiliser le pays et attenter à sa sécurité »
juillet-août : des feux de forêts d'ampleur importante déclarés dans 35 wilayas
24 août 2021 : l'Algérie annonce la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, en dénonçant une série d’« actes hostiles de la part du Maroc » pour justifier sa décision
22 septembre 2021 : l'Algérie décide la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains et à tous ceux immatriculés dans le royaume marocain, évoquant « la poursuite des provocations et des pratiques hostiles de la part du Maroc »
an 2021 : Bénin (anc. Dahomey) - Le 11 avril 2021, Patrice Talon est réélu Président de la République.
an 2021 : Cap Vert - En octobre 2021, se déroule l'élection présidentielle cap-verdienne de 2021, remportée par José Maria Neves.
Le président de la République du Cap-Vert est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un mandat de 5 ans. Depuis l'amendement constitutionnel du 3 mai 2010, le nombre de mandat n'est plus illimité, mais renouvelable une seule fois de manière consécutive. Un président ayant déjà accomplis deux mandats consécutifs doit ainsi attendre un minimum de cinq ans pour se représenter à une élection présidentielle. Cette durée est portée à dix ans en cas de démission, et à vie en cas de haute trahison.
an 2021 : Congo (Brazaville) - Fin décembre 2019, Denis Sassou-Nguesso est à nouveau désigné candidat de son parti (le PCT) à la présidentielle de 2021. Le 23 mars 2021, la commission électorale annonce que Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 88,57 % (résultats provisoires officiels). La participation est estimée à 67,55 % et son principal opposant, Guy Brice Parfait Kolélas, (mort de la Covid-19 le lendemain de l'élection), recueille 7,84 % des voix. Ses opposants annoncent former des recours. Le 6 avril 2021, la Cour constitutionnelle de la République du Congo a entériné la réélection du président Denis Sassou-Nguesso au scrutin du 21 mars, après avoir rejeté les recours de l'opposition.
Le Président de la République pour un quatrième mandat consécutif, nomme Anatole Collinet Makosso au poste de Premier Ministre le 12 mai 2021.
an 2021 : Afrique Côte d'Ivoire - Le 6 mars 2021, pour la première fois depuis une décennie, les trois principaux partis du pays, à savoir le RHDP au pouvoir, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et le Front populaire ivoirien (FPI), participent à une même élection, et ce dans un climat qui s'est relativement apaisé depuis le scrutin présidentiel quelques mois auparavant. Sur 254 sièges de députés, le RHDP en remporte 137 et obtient donc la majorité absolue tandis que la coalition formée par le PDCI et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), la plateforme de formations pro-Laurent Gbagbo, en récole 50. Avec un taux de participation qui s'établit autour de 37 %, les pro-Gbagbo opèrent lors de ce scrutin leur grand retour sur la scène politique.
an 2021 : République de Djibouti - Le 9 avril 2021, Ismaël Omar Guelleh a été réélu, avec 98,58 % des voix, selon les chiffres officiels provisoires.
an 2021 : Ethiopie - Les élections législatives éthiopiennes de 2021 ont lieu le 21 juin 2021 afin de renouveler les membres de la Chambre des représentants des peuples de Éthiopie. Initialement prévues pour le 29 août 2020, les élections sont reportées en raison de la pandémie de COVID-19 qui touche alors le pays.
Les élections provoquent une effervescence politique du fait de la volonté du Premier ministre Abiy Ahmed d'organiser un scrutin libre et démocratique, le premier de l'histoire du pays. Le scrutin se tient cependant en pleine Guerre du Tigré opposant l'armée éthiopienne au gouvernement régional du Tigré en rébellion contre le gouvernement central, un conflit entaché de massacres à caractère ethnique.
Sans adversaire sérieux, le Parti de la prospérité dirigé par Abiy Ahmed remporte une large majorité des sièges.
an 2021 : Gambie - Adama Barrow est réélu président de la République le 5 décembre 2021.
an 2021 : Guinée - Le 5 septembre 2021, un coup d'État des forces spéciales, dirigées par Mamadi Doumbouya, mène à la capture d'Alpha Condé. Une junte prend le pouvoir.
Mamadi Doumbouya devient alors président du Comité national du rassemblement pour le développement et président de la Transition.
an 2021-2022 : Libye - Le 24 décembre 2021 devraient avoir lieu une élection présidentielle et en janvier 2022 des élections législatives.
an 2021 : Mali - Le 24 mai 2021, le président de transition Bah N'Daw et le premier ministre de transition Moctar Ouane sont interpellés et conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta démet N'Daw et Ouane de leurs fonctions. Suite à ce coup d’État, la France décide de mettre un terme à l'Opération Barkhane et appuie le développement international de la Task Force Takuba notamment pour sécuriser la région du Liptako
Assimi Goïta (Vice-président) de facto président de la transition après l'arrestation et la démission du Premier Ministre Moctar Ouane et du président de la transition Bah N'Daw par Assimi Goïta le lundi 24 mai 2021 et le mardi 25 mai 2021.
an 2021 : Maroc - Les élections législatives marocaines de 2021 ont lieu le 8 septembre 2021 afin de renouveler les 395 sièges de la Chambre des représentants du Maroc. Des élections communales et régionales ont lieu le même jour.
Le scrutin est marqué par la défaite du Parti de la justice et du développement (PJD) au profit du Rassemblement national des indépendants (RNI) et du Parti de l'Istiqlal (PI), respectivement en tête et en troisième place du scrutin. Malgré un recul, le Parti authenticité et modernité (PAM) conserve quant à lui la seconde place.
Fort de la victoire de son parti, le dirigeant du RNI, Aziz Akhannouch est nommé Chef du gouvernement par le roi Mohammed VI en remplacement de Saâdeddine El Othmani, qui démissionne également de la direction du PJD.
Aziz Akhannouch forme dans les semaines qui suivent un gouvernement de coalition réunissant RNI, PAM et PI, qui entre en fonction le 7 octobre 2021.
an 2021 : Namibie - En mai 2021 l’Allemagne et la Namibie sont parvenus à se mettre d’accord sur un document qui établit les responsabilités de l'Allemagne ex-puissance coloniale durant le Génocide des Héréro et des Namas.
an 2021 : Niger - Une tentative de coup d'état a lieu dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, à quelques jours de l'investiture de Mohamed Bazoum, président élu.
Le 2 avril 2021, Mohamed Bazoum (1960-) prête serment est entre en fonction.
Le 3 avril 2021, le Président Mohamed Bazoum, nouvellement en fonction, nomme Ouhoumoudou Mahamadou comme Premier ministre du Niger
an 2021 : Ouganda - L'élection présidentielle ougandaise de 2021 a lieu le 14 janvier 2021 afin d'élire le président de l'Ouganda pour un mandat de cinq ans. Le premier tour a lieu en même temps que les élections législatives.
Le président sortant Yoweri Museveni l'emporte dès le premier tour à une large majorité, dans un contexte de répression de l'opposition.
Le 12 mai 2021, Yoweri Museveni prête serment pour un sixième mandat.
Robinah Nabbanja, née le 17 décembre 1969, est 1ere Ministre depuis le 8 juin 2021. Elle est officiellement confirmée par le Parlement le 21 juin 2021.
an 2021 : Sainte-Hélène (Île) - Suivant le modèle d'un régime parlementaire, le chef d’État et son gouverneur ne jouent cependant qu'un rôle figuratif, le pouvoir exécutif étant réellement exercé par le Ministre en chef de Sainte-Hélène, soit depuis le 25 octobre 2021, Julie Thomas.
La fonction de Ministre en chef a été mise en place après les élections législatives de 2021. Auparavant, le pouvoir exécutif local était exercé par un conseil exécutif présidé par le gouverneur et cinq membres du Conseil législatif choisis par le gouverneur. Ceux-ci formaient ensuite des comités sur des sujets donnés, tandis que le gouverneur exerçait ainsi de fait la fonction de chef du gouvernement. Lors du référendum consultatif de mars 2021, la population a cependant approuvé la création du poste de ministre en chef, qui nomme ensuite quatre ministres parmi les membres du Conseil, sur le modèle d'un système parlementaire classique. Le gouverneur continue de présider le Conseil exécutif, qui comporte également le procureur général pour membre de droit, mais l'essentiel du pouvoir exécutif est détenu par le ministre en chef.
an 2021 : Sao Tomé-et-Principe - 2 octobre 2021, Président de la République : Carlos Vila Nova, né le 27 juillet 1959 à Neves
an 2021-2022 : Somalie - En 2021 et 2022, le pays connait une importante sécheresse, provoquant des problèmes de disette importante pour près de 7,8 millions de personnes soit presque 50 % de la population.
an 2021 : Soudan - Une tentative de putsch a lieu le 21 septembre 2021. Les responsables sont arrêtés.
Un coup d'État militaire a lieu en octobre 2021, menant à l'arrestation de civils dont le premier ministre. Le 25 octobre, des membres de l'armée tirent sur des civils refusant le putsch.
Président du Conseil de Souveraineté de transition – 11 novembre 2021 : Abdel Fattah al-Burhan ou Abdel Fattah Abdelrahmane al-Bourhane
an 2021 : Tanzanie (Zanzibar) - Samia Suluhu, née le 27 janvier 1960 au Zanzibar (actuellement Tanzanie) est élu Présidente de la République depuis le 19 mars 2021.
an 2021 : Tchad - Le 20 avril 2021, un Conseil militaire de Transition dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, alors général de l'armée tchadienne et fils du président Idriss Déby Itno, prend le pouvoir à la suite du décès de ce dernier, dont on soupçonne que la mort soudaine soit liée à un assassinat non ciblé lié à des affrontements avec le Fact, un groupe armé libyen. Cette prise du pouvoir ne respecte pas la Constitution de la République du Tchad, promulguée le 4 mai 2018, qui est alors suspendue par l'Armée, en même temps que l'Assemblée nationale est dissoute.
Au moment de prendre le pouvoir, l'armée promet que des élections libres et démocratiques seront organisées au Tchad sous dix-huit mois, après une période de transition et d'apaisement.
an 2021 : Togo - En 2021, David Ekoué Dosseh, un professeur de médecine à l'origine de Togo Debout, la « plateforme citoyenne » créée le 22 septembre 2017, est sur la liste établie par le collectif Forbidden Stories de 300 Togolais espionnés par le logiciel Pegasus.
an 2021-2022 : Tunisie - Crise politique de 2021-2022
Le 25 juillet 2021, invoquant l'article 80 de la Constitution, Kaïs Saïed limoge le gouvernement, annonce la suspension de l'Assemblée des représentants du peuple — dont il lève l'immunité des membres —, la formation d'un nouveau gouvernement — qui sera responsable devant lui — et sa décision de gouverner par décrets ; il indique également qu'il présidera le parquet. Ennahdha dénonce aussitôt un « coup d'État ». Cette qualification de coup d'État est partagée par des analystes politiques et juristes, notamment en ce qui concerne la suspension des travaux parlementaires.
Le 22 septembre, il confirme par décret le prolongement des décisions ainsi que la dissolution de l'Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, et décide de suspendre les salaires et les bénéfices accordés au président de l'Assemblée des représentants du peuple et ses membres, et s'octroie le droit de gouverner par décret, récupérant de facto le pouvoir législatif. Le 13 décembre, il annonce la tenue d'un référendum constitutionnel, prévu à l'été 2022.
Le 30 mars 2022, après la réunion virtuelle de 120 députés pour voter la fin des mesures d'exception en vigueur, Kaïs Saïed dissout le Parlement, ce qu'interdit pourtant la Constitution durant la période où l'état d'exception est appliqué, et menace les députés de poursuites judiciaires.
an 2021 : Zambie - Membre du Parti Unifié pour le Développement National (UPND), candidat sans succès aux élections présidentielles de 2006, 2008, 2011, 2015 et 2016, Hakainde Hichilema, né le 4 juin 1962, est élu Président de la République le 24 août 2021. Il l’emporte dès le premier tour avec 59,0 % des suffrages exprimés, plus de vingt points devant le président sortant, Edgar Lungu.
an 2022 : Angola Si les élections angolaises ont systématiquement conduit à la victoire du Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) depuis leur première tenue en 1992, force est de constater que la campagne des élections générales d’août 2022 avait soulevé chez ses opposant·e·s un espoir sérieux d’alternance politique. Avec Adalberto Costa Júnior, un nouveau candidat populaire au-delà du cercle de ses soutiens traditionnels, le parti d’opposition historique UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) est parvenu à rassembler une large coalition de partis et de mouvements citoyens pour le changement politique, suscitant un enthousiasme inhabituel traversant les couches sociales, géographiques et démographiques de la société angolaise. L’hypothèse que nous soulevons est que cette victoire contestée, qui confirme l’effritement continu du socle d’électeur·ice·s du MPLA depuis 2008 (date des premières élections générales depuis la fin de la guerre civile en 2002), marque la fin d’un cycle en Angola. Le basculement dans l’opposition de la capitale, Luanda, en est d’ailleurs un signe fort. Bastion historique du MPLA, Luanda a joué un rôle-clef dans l’ascension du parti à la tête de l’État au moment de l’indépendance en 1975. De même, lors des violences post-électorales de 1992, le régime n’avait pas hésité à armer la population pour chasser l’UNITA. Vitrine de la reconstruction du pays menée par le MPLA après 2002, la capitale apparaît pourtant aujourd’hui comme le principal foyer de contestation du pouvoir. Si dans les provinces le parti-État résiste mieux, il ne semble cependant pas pressé d’y organiser des élections locales, qu’il escompte défavorables.
Les élections générales angolaises de 2022 se déroulent le 24 août 2022 afin d'élire les membres de l'Assemblée nationale ainsi que le président de la République d'Angola.
Le président de la République sortant, João Lourenço, se présente à sa réélection, la constitution lui autorisant un deuxième et dernier mandat. Son parti, le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), arrive en tête des suffrages, permettant ainsi à João Lourenço d'être réélu. Le scrutin se révèle néanmoins très serré pour le MPLA, qui essuie un nouveau recul et frôle la perte de sa majorité absolue.
Au lendemain de la proclamation des résultats des élections générales de 2022, le découragement et le désespoir de celleux1 qui avaient cru en une véritable alternance, notamment la jeunesse angolaise, étaient palpables.
an 2022 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - En 2022, le Burkina Faso est le théâtre de deux coups d'État, espacés de huit mois.
janvier : premier coup d'État :
Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2022, le président Kaboré est arrêté par des militaires. Cet événement fait suite à de nombreuses mutineries qui ont éclaté dans des camps militaires. Le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) mené par Paul-Henri Sandaogo Damiba fomente ce coup d'État en raison des menaces terroristes qui pèsent sur le Burkina Faso depuis plusieurs années. Le MPSR s'engage à ramener le pays vers la voie constitutionnelle « dans un délai raisonnable »
Le 1er mars 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, signe un plan pour entamer une transition de trois ans vers la démocratie.
septembre : second coup d'État :
Paul-Henri Sandaogo Damiba est renversé le 30 septembre 2022 après une journée de confusion émaillée de tirs.
Dans la foulée, le capitaine Ibrahim Traoré est proclamé président. Le gouvernement est également renversé, la charte de transition et l'assemblée nationale sont dissoutes. Ce second coup d'État militaire dans la même année est motivé par « la dégradation continue de la situation sécuritaire », selon les militaires.
21 octobre 2022, nomination du Chef d’État : Ibrahim Traoré, né le 14 mars 1988 à Kera, dans la commune de Bondokuy
an 2022 : République de Centrafrique - Félix Moloua est nommé Premier Ministre le 7 février 2022.
En avril 2022, une "opération" militaire menée par l’État centrafricain et des paramilitaires russes cause la mort de dizaines de civils dans les villages de Gordil et Ndah, au Nord-Est de la capitale. Suite à ce massacre, l'ONU indique ouvrir une enquête.
an 2022 : Érythrée - Le 2 mars 2022, l'Érythrée est l'un des cinq pays de l'ONU votant contre la résolution ES-11/1 ayant pour but de sanctionner et condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
an 2022 : Gambie - Les élections législatives se sont tenues le 9 avril 2022. Avec un taux de participation de 51%, (contre 90% à la présidentielle de décembre), le parti NPP du président Barrow a obtenu seulement 18 sièges. Le parti d’opposition (UDP) d’Ousainou Darboe a obtenu quant à lui 15 sièges. Avec une alliance de petits partis (NRP, APRC), le président peut compter sur 24 sièges à l’Assemblée nationale mais il n’atteint pas la majorité absolue (29 sur 53).
Le 4 mai 2022, cinq mois après sa réélection, le président Adama Barrow a nommé son nouveau gouvernement (24 membres) avec un profond remaniement, la plupart des portefeuilles étant redistribuée : 9 ministres sortent du gouvernement, 12 sont issus de l’ancien gouvernement et 4 nouveaux ministres entrent au gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, M. Tangara est maintenu à ses fonctions.
an 2022 : Guinée - mars 2022 En Guinée, déchu il y a plus six mois par un coup d’état militaire le 5 septembre 2021, Alpha Condé ne prendra plus la tête du parti qu’il a lui-même créé dans la clandestinité au début des année 1990. En attendant le prochain président du RPG, un intérimaire a été porté à la tête de l’ancien parti au pouvoir. En réunion extraordinaire, ce jeudi 10 mars 2022, les cadres du parti ont désigné l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana comme président par intérim.
mai 2022 Transition prolongée en Guinée : l’opposition dénonce une « décision unilatérale » et une « durée injustifiable ». Le colonel Mamadi Doumbouya, auteur du putsch contre Alpha Condé, prévoit un délai de trente-neuf mois avant d’organiser d’éventuelles élections.
En octobre 2022, sous la pression de la Cedeao et d'une partie de la communauté internationale, Mamadi Doumbouya (1980-) annonce redonner le pouvoir aux civils plus tôt que prévu. Il s'engage en effet à démarrer le calendrier de transition de deux années à compter de janvier 2023 (contre les trois ans qu'il avait préalablement annoncé).
an 2022 : Kenya - A l’issue du scrutin présidentiel du 9 août 2022, les résultats ont donné William Ruto vainqueur. Il a prêté serment le 13 septembre 2022.
Musalia Mudavadi, né le 21 septembre 1960 à Sabatia, dans le Comté de Vihiga, est nommé Premier Ministre le 22 octobre 2022.
an 2022 : Lesotho - Les élections législatives lésothiennes de 2022 ont lieu en septembre 2022 afin de renouveler les membres de l'assemblée nationale du Lesotho.
Le Lesotho est une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement bicaméral dont la chambre basse, l'assemblée nationale est composée de 120 députés élus pour un mandat de cinq ans au suffrage direct. Son mode de scrutin, mixte, s'apparente au système électoral allemand, bien que les électeurs n'aient qu'un seul vote pour exprimer leur choix. Sur les 120 sièges, 80 sont pourvus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales uninominales. L'ensemble des votes pour chacun des partis est ensuite regroupé au niveau national, nonobstant ceux des indépendants, et les quarante sièges restants répartis entre eux de manière à rapprocher la composition de l'assemblée à celles des résultats en part des voix.
Sam Matekane, né le 15 mars 1958 dans le village de Mantsonyane (district de Thaba-Tseka, Lesotho) est proclamé Premier Ministre le 28 octobre 2022. Issu d'une famille modeste de paysans, il se lance dans l'élevage d'ânes puis s'enrichit en diversifiant ses activités, notamment dans les mines. Il est aujourd'hui à la tête du groupe MGC, qui possède des intérêts dans de nombreuses entreprises, dont Gem Diamonds, qui exploite la mine de Letseng, connue pour avoir produit un diamant de 910 carats en 2018. Considéré comme l'homme le plus riche du Lesotho, il finance différents projets collectifs (écoles, stade, théâtre, vaccins contre le Covid).
an 2022 : Mali - Les autorités maliennes responsables du coup d’État s'engagent auprès de la Communauté internationale à « organiser des élections présidentielles et législatives avant le 27 février 2022 ». Cet engagement non tenu et le partenariat des autorités maliennes avec le groupe paramilitaire russe Wagner conduisent le 17 février 2022 à l'annonce du retrait de la Task Force Takuba.
Le 16 mai 2022, le gouvernement d'Assimi Goïta révèle avoir réussi à déjouer un coup d’État mené par des militaires maliens dans la nuit du 11 au 12 mai. Selon les sources officielles du gouvernement, cette tentative de putsch avortée a été « soutenue par un État occidental »
an 2022 : Afrique - Élections à venir dans l'année : dans les prochains mois se tiendraient des processus électoraux cruciaux en République démocratique du Congo, en Angola, à Sao-Tomé, en Guinée équatoriale ainsi qu’au Tchad.
an 2022 : Mozambique - En novembre 2022, les premiers gisements de gaz naturel liquéfié (GNL) sont exportés. Cette première exportation a été produite à l’usine offshore Coral Sul, gérée par le groupe italien Eni.
an 2022 : Sao Tomé-et-Principe - 10 octobre 2022, nomination du Premier Ministre : Patrice Emery Trovoada, né le 18 mars 1962 à Libreville (Gabon)
an 2022 : Somalie - Président de la république – 23 mai 2022 : Hassan Sheikh Mohamoud
Premier ministre – 26 juin 2022 : Hamza Abdi Barre
an 2022 : Soudan - Osman Hussein occupe le poste de Premier Ministre depuis le 19 janvier 2022
an 2023 : Algérie -
6 juin 2023 : 184 pays sur les 193 votants (95% des voix) de l’Assemblée générale des Nations unies, se sont prononcés en faveur de l’Algérie pour qu’elle jouisse de la qualité de membre non-permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025
juillet 2023 : des violents feux de forêts se sont déclenchés dans 17 régions du pays.
11 novembre 2023, nomination du 1er Ministre : Mohamed Ennadir Larbaoui dit Nadir Larbaoui, né le 26 septembre 1949 à Tébessa, est un ancien avocat, diplomate algérien et ancien joueur international de l'équipe algérienne de handball.
an 2023 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Suite au coup d'état de septembre 2023 où Paul-Henri Sandaogo Damiba est renversé le 30 septembre 2022 après une journée de confusion émaillée de tirs. Dans la foulée, le capitaine Ibrahim Traoré est proclamé président. Le gouvernement est également renversé, la charte de transition et l'assemblée nationale sont dissoutes. Ce second coup d'État militaire dans la même année est motivé par « la dégradation continue de la situation sécuritaire », selon les militaires.
Le 28 février 2023, Ibrahim Traoré fait signifier à la France que le Burkina Faso dénonce un accord de 1961 portant sur la coopération militaire entre les deux pays. En remettant en cause cet accord, le Burkina Faso donne « un délai d’un mois » suivant la réception de ce courrier pour « le départ définitif de tous les personnels militaires français en service dans les administrations militaires burkinabè »
Le 26 mars 2023, la junte au pouvoir ordonne l'arrêt de la diffusion de la chaîne France 24 après que cette dernière a diffusé une interview d'un chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). C'est la seconde fois en quelques mois que le gouvernement burkinabé censure France 24. France 24 indique déplorer vivement cette décision.
Début avril 2023, la junte au pouvoir expulse cette fois-ci deux journalistes françaises, correspondantes pour les médias Le Monde et Libération. Elles sont accusées d'avoir diffusé une vidéo mettant en scène des militaires burkinabés tuant des enfants. Le pouvoir nie et impute la responsabilité de ces actes aux groupes terroristes qui, selon lui, travestiraient la vérité en utilisant les uniformes des militaires. L'avis d'expulsion des deux journalistes provoque une onde de chocs dans la profession et suscite des commentaires de la communauté internationale.
an 2023 : Bénin (anc. Dahomey) - Les élections législatives de 2023 sont les premières élections de l’ère Talon dans laquelle l’opposition et la mouvance présidentielle se font face. Le Parti Les Démocrates de l’ancien président Boni Yayi remporte 28 sièges sur 109, ce qui est insuffisant pour s’opposer à la mouvance présidentielle de l’Union Progressiste et du Bloc Républicain.
an 2023 : Centrafrique (République de) - La Constitution centrafricaine de 2023 est la loi fondamentale de la République centrafricaine en vigueur depuis le 30 août 2023, après son adoption par référendum un mois plus tôt. Le projet remplace notamment le quinquennat présidentiel renouvelable une seule fois par un septennat renouvelable indéfiniment. Les binationaux se voient par ailleurs interdits de concourir à une élection présidentielle, dont les candidats doivent obligatoirement être « centrafricain d'origine », être propriétaires en Centrafrique, y résider depuis au moins deux ans, et être titulaires d'un diplôme universitaire. Un poste de vice-président est également créé. Nommé par le président, celui-ci a pour rôle de le suppléer et, en cas de vacance permanente du pouvoir, lui succéder afin d'organiser une élection présidentielle sous trois mois
an 2023 : Congo Brazzaville - Trois formations politiques au Congo-Brazzaville ont lancé une « alliance pour l’alternance démocratique en 2026 », jeudi 13 avril, alors que le président Denis Sassou Nguesso, qui cumule près de quarante ans au pouvoir, est un candidat potentiel à la prochaine élection. Cette nouvelle plateforme de l’opposition regroupe le Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD), du défunt président Jacques Joachim Yhomby Opango (1977-1979), le Mouvement des républicains et le Parti du peuple. Bien que ne disposant pas d’élus au Parlement, ces trois partis rassemblent souvent leurs militants pour les sensibiliser à la nécessité, selon eux, de l’alternance.
an 2023 : Congo (République Démocratique du) - 20 janvier 2024, réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, né le 13 juin 1963 à Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa). Félix Tshisekedi est réélu avec 73,34 % des voix. Le 20 janvier 2024, il prête serment pour un second mandat.
an 2023 : Côte d'Ivoire - Premier Ministre – 16 octobre 2023 : Robert Beugré Mambé, né le 1er janvier 1952 à Abiaté (Dabou). Il forme un gouvernement de 33 ministres le 17 octobre 2023.
Le père de Robert Beugré Mambé est Élie Danho Mambé (Pasteur) et sa mère Jeanne N'Guessan Wahon.
Robert Beugré Mambé est père de cinq enfants avec son épouse Marthe Irma Djedji, décédée le 31 octobre 2021 à Paris.
an 2023 : Égypte - L'élection présidentielle égyptienne de 2023 est la cinquième élection présidentielle de l'histoire de l'Égypte. Initialement prévue en mars 2024, elle a lieu de manière anticipée du 10 au 12 décembre 2023.
Le président sortant, Abdel Fattah al-Sissi, est candidat à sa réélection, dans un contexte de sévère crise économique et de répression de l'opposition, qui le voit n'affronter que des candidats fantoches. Il l'emporte sans surprise dès le premier tour à une écrasante majorité des voix.
L’Égypte est confrontée depuis 2022 à une grave crise économique accompagnée d'une sévère inflation qui provoque des pénuries et voit la livre égyptienne perdre la moitié de sa valeur entre mars 2022 et janvier 2023. La crise intervient dans le contexte d'une forte hausse de l'inflation au niveau mondial provoquée par la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 ainsi que de la crise énergétique qui en découle, puis par le déclenchement en février 2022 de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La situation est aggravée par la politique du gouvernement qui favorise la présence de l'armée dans l'économie et consacre une part importante du budget à la construction de la Nouvelle capitale égyptienne et au doublement du canal de Suez, projets phare du président al-Sissi. En 2023, 30 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, tandis que 30 % de plus est considérée à risque de s'y retrouver.
Déjà confronté à un important déficit de sa balance commerciale qui voit la dette du pays tripler de 2013 à 2023, l'économie du pays est durement touchée, provoquant un manque de devise qui contraint le gouvernement à procéder à la vente d'entreprises et d'actions de l’État. Ces privatisations peinent cependant à contenir la hausse du service de la dette, qui atteint la moitié du montant du budget de 2023. Selon l'agence de notation Moody's, l'Égypte figure cette année là parmi les cinq économies les plus susceptible de tomber en défaut de paiement vis-à-vis de sa dette extérieure.
Initialement prévue en mars 2024, l'élection présidentielle est finalement convoquée de manière anticipée du 10 au 12 décembre 2023 par la Commission électorale, qui l'annonce le 25 septembre précédent. La période de campagne officielle débute quant à elle le 8 novembre. La réélection d'al-Sissi est alors jugée certaine par les observateurs et l'opposition, la répression de cette dernière ne permettant l'émergence que de candidats fantoches en réalité loyaux envers un pouvoir s'en servant comme un simulacre de pluralisme.
Al-Sissi est réélu en mars 2018 dans des conditions similaires à celles de 2014, avant de procéder un an plus tard à une nouvelle révision constitutionnelle par référendum, qui augmente significativement les pouvoirs présidentiels, déjà importants, et allonge notamment le mandat présidentiel de quatre à six ans malgré une clause interdisant toute modification de la durée et du nombre de mandats. Celui en cours est lui même prolongé de deux ans, tandis que la révision permet exceptionnellement à al-Sissi d'en effectuer un troisième malgré la limite constitutionnelle à deux mandats. Ces modifications permettent ainsi au président égyptien d'être en mesure de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030, au lieu de 2022. Les élections législatives de 2020 consacrent une nouvelle fois la mainmise du Parti pour l'avenir de la nation, lié aux forces armées et soutenant le président Abdel Fattah al-Sissi, sur le parlement redevenu bicaméral.
an 2023 : Érythrée - L’Érythrée, pays le plus fermé d’Afrique, fête ses 30 ans. Dirigé d’une main de fer par le président Isaias Afwerki, le pays a joué un rôle actif dans la guerre menée au Tigré par son voisin éthiopien.
an 2023 : Eswatini (ancien Swaziland) - Russell Dlamini est Premier Ministre depuis le 4 novembre 2023.
an 2023 : Éthiopie - Le 6 juillet 2023, La chambre haute du parlement éthiopien, la Chambre de la Fédération, a formellement approuvé la formation de l'Éthiopie du Sud, 12e état régional de l'Éthiopie.
an 2023 : Gabon - Le 30 août 2023, Un coup d'État militaire renverse le président Ali Bongo. Le coup d'État perpétré au Gabon en août 2023 a marqué la fin du règne de 56 ans de la famille Bongo, dynastie qui symbolise la continuité politique et une gouvernance calamiteuse.
Le président de longue date Ali Bongo Ondimba a été déposé lors du transfert de pouvoir dirigé par des officiers de haut rang de la Garde républicaine. Son éviction a ouvert une nouvelle ère d'incertitude, avec un gouvernement de transition dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema.
Nomination d'un Premier Ministre le 8 septembre 2023 : Raymond Ndong Sima, né le 23 janvier 1955 à Oyem.
an 2023 : Gambie - Le président gambien a suspendu jusqu’à la fin de l’année les déplacements à l’étranger pour lui et tous les ministères afin de réduire les dépenses publiques.
an 2023 : Guinée-Bissau - Le 20 décembre 2023, Rui Duarte de Barros né le 18 février 1960 à Cadique, région de Tombali, est nommé Premier Ministre par le Président Umaro Sissoco Embalo.
an 2023 : Guinée Équatoriale - Le parti au pouvoir en Guinée équatoriale a créé la surprise en ne choisissant pas, lors de son Congrès, son candidat à la présidentielle de 2023, une première dans ce pays dirigé depuis 42 ans d'une main de fer par son président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
Manuela Roka Botey est nommée Première Ministre depuis le 1er février 2023.
an 2023 : Kenya - Après des semaines de manifestations et de violences politiques, l’opposition kényane a annoncé le 29 juillet la conclusion d’un accord avec le gouvernement.
an 2023 : Libéria - La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2023.
an 2023 : Malawi - Au Malawi, le bilan du cyclone Freddy pourrait atteindre 1 200 morts. Au moins 345 000 personnes ont été déplacées par les inondations et les coulées de boue qui ont emporté routes, ponts et maisons. L’épidémie de choléra menace à nouveau.
an 2023 : Mali - la situation économique du Mali 2023 révèle que les sécheresses affectent sérieusement le secteur de l'élevage, l'un des secteurs économiques les plus importants du Mali et de la région.
La junte décide de reporter les élections présidentielles. Ces derniers jours, trois camps militaires ont été ciblés par la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).
an 2023 - 2024 : Mozambique - Le Mozambique est membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2023-2024. Membre fondateur de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), le Mozambique cherche à valoriser son positionnement géostratégique de débouché maritime des régions enclavées d'Afrique australe.
an 2023 : Niger - Le 22 juin 2023, l'Assemblée nationale adopte un nouvel hymne pour remplacer La Nigérienne, qui était utilisé depuis l'indépendance et dont les paroles étaient critiquées. Ce nouvel hymne se nomme Pour l'honneur de la patrie.
Le 26 juillet 2023, un coup d'État est organisé par une partie de l'armée. Le président Bazoum est destitué et les institutions politiques sont suspendues. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie prend le pouvoir. 28 juillet 2023, Abdourahamane Tchiani (1964-) dirige le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
7 août 2023 nomination d'un Premier Ministre : Ali Mahamane Lamine Zeine
an 2023 : Nigeria - 25 février 2023, élu président : Bola Tinubu, de son nom complet Asiwaju Bola Ahmed Adekunle Tinubu, né le 29 mars 1952 à Lagos (Nigeria Britannique).
an 2023 : Seychelles - 7 décembre, de fortes pluies ont entrainé des inondations et une explosion faisant 66 morts dans la zone industrielle de l'île de Mahé.
an 2023 : Sierra Leone - 26 novembre - tentative de putsch à Freetown impliquant des soldats et des gardes de l'ancien président Ernest Bai Koroma.
Le général Julius Maada Bio, né le 12 mai 1964 à Tihun, reste Président de la République de Sierra Leone et certifie que le calme est revenu.
Le 27 juin 2023, il a été réélu pour un deuxième mandat à la tête de la Sierra Leone avec 56,17 % des voix, indique la commission électorale.
Ministre en Chef – 10 juillet 2023 : David Moinina Sengeh. Après avoir obtenu une bourse pour étudier en Norvège, Sengeh étudie le génie biomédical à l'Université Harvard ; il a fait des recherches sur les vaccins en aérosol contre la tuberculose et a obtenu un bachelor en 2010.
an 2023 : Soudan - Le conflit soudanais (parfois surnommé guerre des généraux) est un conflit armé qui a débuté au Soudan le 15 avril 2023
an 2023 : Tunisie - Nomination du Chef du gouvernement – 1er août 2023 : Ahmed Hachani.
an 2023 : Zimbabwe - En octobre 2022, Emmerson Mnangagwa est investi candidat par la Zanu-PF pour la présidentielle de 2023.
Le 26 août 2023, il est élu pour un second mandat à la tête du pays, contesté cependant par une forte opposition qui dénonce un scrutin irrégulier.
Emmerson Mnangagwa, né le 15 septembre 1942 à Shabani (aujourd'hui Zvishavane).
an 2024 : Continent Africain - Avril - Afrique de l’Est : plus de 635.000 personnes touchées par les inondations dont 235.000 déplacées
Des inondations « sans précédent et dévastatrices » en Afrique de l’Est ont provoqué des déplacements massifs de centaines de milliers de personnes forcées de quitter leur foyer au Burundi, au Kenya, au Rwanda, en Somalie, en Éthiopie et en Tanzanie, ont averti les organisations humanitaires de l’ONU mercredi, appelant également à des efforts soutenus pour faire face à la mobilité climatique.
Septembre : Après les sommets France-Afrique, Pékin accueille en septembre 2024 la neuvième édition du sommet Chine-Afrique (le FOCAC), où une cinquantaine de pays africains se sont empressés de participer. La Chine y promet de continuer d’y financer des infrastructures (exemple construction d’un aéroport à N’Djamena), mais ce qui l’intéresse désormais davantage sont les marchés technologiques, surtout ceux liés à la transition écologique : panneaux photovoltaïques, voitures électriques… même si de nombreux pays africains espèrent réduire leur déficit commercial avec l’empire du Milieu. Celui-ci promet une aide au continent africain d’un peu plus de cinquante milliards de dollars (contre quarante lors du précédent FOCAC de 2021). Xi Jinping déclare que la Chine et l’Afrique ont désormais une « relation stratégique » et constitue « une communauté avec un futur partagé »
an 2024 : Continent Africain - Septembre-octobre : L’Afrique est le continent le plus touché par les conséquences du réchauffement climatique. Les prochaines années s’annoncent rudes alors que les catastrophes vont se multiplier.
Ces dernières années, l’Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique. S’il n’est pas le seul touché par cette crise environnementale, le continent déjà fortement impacté par la pauvreté et les conflits dans certaines régions, est le plus vulnérable face aux conséquences du réchauffement climatique.
La saison des pluies de juillet à septembre 2024 a été marquée par des précipitations extrêmement abondantes et parfois sans précédent dans une grande partie de la région du Sahel, entraînant des inondations catastrophiques au Soudan en août dernier. Une situation qui a aggravé la crise humanitaire déjà complexe que subissait le pays, mettant à rude épreuve les capacités de réaction des organisations d'aide et des organismes gouvernementaux.
D’autres pays comme le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun ont aussi été touché par les inondations en septembre 2024. Au total, plus de 2000 personnes ont perdu la vie et des millions d'autres ont été déplacées.
Une solution de toute urgence
Selon une étude du World Weather Attribution, les catastrophes liées au climat sont susceptibles de se multiplier dans les prochaines années. Une situation compliquée provoquée par les actions néfastes de l’homme sur la planète, qui se sont accumulées sur plusieurs années d’après le réseau de scientifique international.
Si aucune mesure concrète n’est prise, jusqu’à 118 millions de personnes extrêmement pauvres pourraient être exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique d’ici à 2030.
an 2024 - Afrique du Sud - Lors des élections générales de 2024, le Congrès National Africain (ANC) mené par le président Cyril Ramaphosa obtient son score le plus faible de son histoire avec 40,18 % des suffrages exprimés et perd la majorité absolue des sièges, une première depuis la fin de l'apartheid trente ans plus tôt. Si l'alliance démocratique de John Steenhuisen conserve la seconde place et demeure le principal parti d'opposition, le recul de l'ANC profite principalement au parti Umkhonto we Sizwe (MK) de l'ancien président Jacob Zuma, qui arrive troisième pour sa première participation à un scrutin national. Outre le recul historique de l'ANC, les élections de 2024 aboutissent pour la première fois depuis 1924 à un parlement sans majorité, contraignant les formations politiques à s'entendre sur un gouvernement de coalition. L'élection Présidentielle à la laquelle le président sortant Ramaphosa est candidat, sera organisée au scrutin indirect dans le mois suivant le scrutin, le 19 juin 2024, Cyril Ramaphosa est investi pour un second mandat en prêtant serment.
2024 : Algérie - Manifestations interdites en ce début d'année.
Septembre 2024 : le président sortant Abdelmadjid Tebboune est réélu.
an 2024 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Le 25 mai 2024, au terme de nouvelles assises de la transition auxquelles ne participent pas les collectifs de la société civile et les partis opposés à Ibrahim Traoré, la transition est prolongée de cinq ans (à partir du 2 juillet 2024) par l'adoption d'une nouvelle charte qui accorde à celui-ci le titre de président du Faso, et lui permet de se présenter aux prochaines élections. Ces assises ont lieu quelques jours après des assises similaires chez l'allié malien, qui prolongent également la transition de cinq ans. Le jour même, Traoré signe la nouvelle charte, ce qui permet son entrée en vigueur.
Les élections au Burkina Faso ne sont pas "une priorité" contrairement à la "sécurité", dans ce pays miné par les violences jihadistes, a affirmé le capitaine Ibrahim Traoré, à la télévision nationale, vendredi 29 septembre, près d'un an après son arrivée au pouvoir par un coup d'État.
Les élections, "ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement, c'est la sécurité qui est la priorité", dans ce pays miné par les violences jihadistes, a répondu Ibrahim Traoré aux journalistes qui l'interviewaient vendredi soir à la Radio télévision burkinabè (RTB).
septembre 2024 : Le Burkina Faso vient de connaitre en septembre 2024 une terrible tragédie. Les terroristes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à al-Qaida, ont revendiqué le massacre de plus de trois cents personnes en plus de centaines de blessés dans la région de Barsalogho.
an 2024 : Burundi : Son Excellence Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi a tenu ce jeudi 7 mars 2024 à l’hôtel de ville, une réunion à l’intention des responsables de l’administration et de sécurité à la base de la Mairie de Bujumbura, sur le rôle dans l’encadrement de la population et dans le suivi du respect de la loi, où Il les a exhortés à l’indépendance financière et à la salubrité dans la ville de Bujumbura pour redorer l’image du Burundi et pour rappeler à ces Administratifs le rôle d’ encadreurs principaux de la population pour promouvoir le développement de tout citoyen, au lieu d’œuvrer en commissionnaire.
Lors de cette réunion, Son Excellence Evariste Ndayishimiye a également appelé la population Burundaise à l’auto-développement et à l’échange d’expériences pour le développement du pays afin d’atteindre à un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060 où il a également interpellé la population Burundaise à la création de richesses à partir des ressources naturelles du Burundi.
Le Président Evariste Ndayishimiye a en outre appelé les administratifs à intégrer le système de production où il a suggéré la création d’un partenariat entre ceux qui possèdent des terres et ceux capables de fournir des semences sélectionnées et engrais chimiques, et la transformation de la production. Il a également ordonné la population de la Mairie de Bujumbura à l’éclairage public.
Le Numéro un Burundais a recommandé à ces administratifs de ramener l’ordre dans la ville de Bujumbura en ce qui concerne la salubrité et les constructions anarchiques. Il a également exhorté le Maire de la ville de Bujumbura à adopter des mesures contraignantes du côté des ménages et des sociétés impliquées dans ce secteur de la salubrité, dans l’objectif de protéger la vie des citoyens.
Le Président de la République du Burundi, Son Excellence Evariste Ndayishimiye a plaidé pour les Initiatives à Résultats Rapides (IRR) qui devraient être exécutées l’une après l’autre, pour pouvoir ramener l’ordre dans la ville de Bujumbura tout en favorisant la lutte progressive contre l’insalubrité, les drogues, les boissons prohibées, et les grossesses non désirées pour les jeunes adolescents et une évaluation rigoureuse devrait suivre.
an 2024 : Cameroun - Lancement d’une campagne de vaccination contre le paludisme au Cameroun
Afin de contrer le paludisme, ou malaria, une maladie infectieuse faisant des ravages sur le continent africain, le Cameroun innove en adoptant une stratégie nationale de vaccination systématique. Les enfants en bas âge sont au cœur de cette campagne que l’on souhaite imiter dans d’autres pays d’Afrique.
an 2024 : Cameroun - Élection 2025 : Le président camerounais, qui aura 91 ans ce 13 février, n’a pas encore déclaré sa candidature à l’élection présidentielle de 2025. En mars 2024, un documentaire consacré à Paul Biya est diffusé sur plusieurs chaînes de télévision, ainsi que lors d'un événement au Palais des Congrès de Yaoundé. Une projection qui a relancé les spéculations sur les intentions de Paul Biya à une candidature à l'élection présidentielle de 2025.
an 2024 : Cameroun - 16 septembre : Depuis plusieurs semaines, l’Extrême-Nord du Cameroun est frappé par des pluies diluviennes sans précédent, mettant à l’épreuve la ville de Yagoua et ses environs. Le bilan de cette catastrophe naturelle est alarmant : une dizaine de morts, des quartiers inondés, 185 écoles primaires et 13 lycées touchés, ainsi que 1178 têtes de bétail perdues. Les habitants se débattent pour survivre, avec certains éprouvant de graves difficultés à se nourrir. Plus de 200 000 personnes ont été affectées, avec 8000 maisons détruites. Les sinistrés ont été relogés dans un camp de déplacés construit en périphérie de la ville pour pallier la situation. Les appels à l’aide se multiplient, car beaucoup ont tout perdu.
an 2024 : Cap Vert - Le Cap-Vert a un système politique démocratique stable, sans risque significatif de violence politique ou de troubles civils et sans menace actuelle.
an 2024 : Centrafrique (République de) - La croissance devrait augmenter progressivement en 2023 (+2,2 %) et 2024 (+3 %), mais celle-ci est soumise à de nombreux aléas
an 2024 : Comores (Archipel des) - L'élection présidentielle comorienne de 2024 se déroule le 14 janvier 2024 afin d'élire le président de l'union des Comores.
Le président sortant Azali Assoumani est candidat à un troisième mandat consécutif, après avoir fait modifier la constitution par référendum en 2018. L'élection fait l'objet d'appels au boycott de la part de l'opposition, qui accuse le gouvernement de répression de ses candidats et de fraude électorale lors des précédents scrutins nationaux.
Assoumani l'emporte sans surprise dés le premier tour avec près de 63 % des voix, tandis que le taux d'abstention atteint un record avec 83 % des inscrits selon les résultats provisoires. Comme en 2019, le scrutin est accusé de fraude, et suivi de plusieurs jours d'émeutes qui contraignent le gouvernement à imposer un couvre feu.
La Cour suprême rectifie largement les résultats le 24 janvier et donne vainqueur Assoumani avec 57 % des voix ainsi qu'un taux d'abstention révisé à 43 %, soit une participation de 57 % finalement supérieure à celle du scrutin précédent.
an 2024 : Congo Brazzaville -
Le Conseil des Ministres s’est réuni ce Jeudi 18 Janvier 2024 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de Son Excellence, Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat.
Le point principal à l’ordre du jour de la réunion de ce 18 janvier 2024 est la suite logique des annonces faites par SEM. le Président de la République à l’endroit de la nation ; ces orientations ont été rendues public lors de son Message sur l’État de la Nation délivré le 28 novembre dernier, mais également durant son allocution de vœux aux populations le 31 décembre 2023 et, enfin, lors de sa réponse aux vœux des corps constitués nationaux le 05 janvier 2024.
Outre le bilan de l’action gouvernementale pour 2023, ces interventions ont principalement porté sur :
– L’urgence de mettre en œuvre un programme vigoureux d’employabilité et de prise en charge particulière de la Jeunesse en cette année 2024 déclarée par le Chef de l’État « année de la jeunesse ».
– La mise en œuvre immédiate des actions humanitaires d’urgence, afin de répondre à la détresse des populations sinistrées par les intempéries notamment causées par les effets du changement climatiques que nous subissons ;
– La nécessité d’accélérer la mise en œuvre du plan national de développement (PND) 2022-2026.
an 2024 : Congo (République Démocratique du) - En RDC, coup d'envoi du retrait progressif de la force de l'ONU. Le départ des casques bleus se fera d'abord au Sud-Kivu, puis en Ituri et au Nord-Kivu. Le désengagement des quelque 15 000 militaires devrait être achevé à la fin de 2024.
le 02/02/2024 - Une épidémie de Choléra est actuellement signalée dans certaines zones de santé du Nord Kivu, du Sud Kivu.
12 juin 2024, nomination de la Première Ministre : Judith Suminwa Tuluka, née le 19 octobre 1967.
Octobre 2024 : Plus de 6 300 personnes sont retournées dans le territoire de Mwenga
Plus de 6 300 personnes sont retournées dans le territoire de Mwenga, dans le sud Kivu, selon des sources locales. Ce
retour a été signalé entre le 12 et le 16 octobre dans les zones de santé de Mikalati et Chakira dans la région du Kasaï, au centre et au sud du pays. Il est motivé par l'amélioration de la sécurité dans leurs villages d'origine. Néanmoins, ces personnes restent extrêmement vulnérables et ont un besoin urgent d’assistance en matière d'abris, de nourriture, de biens non alimentaires, de soins médicaux et de protection. Suite à des conflits intercommunautaires, ces populations avaient été déplacées entre 2019 et 2022 et avaient trouvé refuge dans les zones de santé de Kanguli, Kilumbi, Lutabura et Nakiele dans l’est du pays.
an 2024 : Côte d'Ivoire - À l’approche de la présidentielle d’octobre 2025, à laquelle le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) n’a toujours pas de candidat officiel, Alassane Ouattara souhaite resserrer les rangs. Le président ivoirien prévoit de réformer le parti présidentiel d’ici à avril 2024, afin de donner plus de pouvoir aux jeunes.
Le Parti des Peuples Africains (PPA-CI) a désigné l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo comme son candidat à l'élection présidentielle de 2025, bien qu'il ne soit pas éligible.
an 2024 : Djibouti (République de) - Le congrès extraordinaire du parti au pouvoir à Djibouti se tiend le 4 mars.
an 2024 : Égypte - Le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouly s'est rendu le dimanche 11 février 2024 aux Émirats arabes unis à l'invitation du vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, pour participer à la 11e édition du Sommet mondial des gouvernements 2024 à Dubaï.
an 2024 : Gabon - Le chef de la junte gabonaise Brice Clotaire Oligui Nguema pousse à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Pour un scénario de l'organisation d'élection présidentiel en avril 2025 au lieu d'août 2025.
an 2024 : Guinée - Nomination du Premier Ministre le 27 février 2024 en remplacement de Bernard Goumou : Bah Oury, de son nom de naissance Amadou Oury Bah, né à Pita en mars 1958.
an 2024 : Libye - En janvier 2024, le Président du Conseil Présidentiel Abdel Hamid Dbeibah soutient l'idée de restauration de la monarchie constitutionnelle en la personne du prince Sidi Mohammed El-Senussi, prétendant au trône et petit-fils du roi Idris 1er, afin de résoudre l'impasse politique dans le pays.
Le 10 mars 2024, Trois hauts dirigeants libyens ont annonce, qu’ils se sont mis d’accord sur la nécessité de former un nouveau gouvernement d’union nationale. qui superviserait les élections législatives et présidentielle longtemps retardées.
an 2024 : Madagascar - Après trois de semaines de suspense, le président Andry Rajoelina né le 30 mai 1974 à Antsirabe est réélu a annoncé dans la soirée du 4 janvier la reconduction de Christian Ntsay comme Premier ministre. Le président mise sur la stabilité… et pense déjà aux prochaines batailles électorales.
Le nouveau gouvernement malgache a été dévoilé le 14 janvier par Andry Rajoelina. Le président, réélu en novembre, espère mettre derrière lui la contestation électorale et lancer son deuxième mandat, aidé par des fidèles mais aussi par quelques jeunes pousses.
an 2024 : Malawi - Le Malawi, un pays fortement exposé à la pauvreté
an 2024 : Mali - Assimi Goïta félicite le président Poutine pour sa réélection. Le chef de la junte malienne a tenu à assurer a russie de l'amitié de son pays.
Le site de Loulo-Gounkoto, dans le sud du Mali, est la plus grande mine d’or du pays. Un site aujourd’hui possédé à 80 % par le canadien Barrick Gold sur lequel les mercenaires de la nébuleuse russe Wagner ont désormais des vues. Décryptage en infographies.
an 2024 : Mali - La période de transition se termine le 26 mars 2024 sans que des élections ne soient organisées. Courant avril 2024, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, de son nom de naissance Chouaïbou Issoufi Souleymane, annonce la tenue du scrutin après le dialogue inter-malien et la fin de la « stabilisation » du pays. En parallèle, l'activité des partis est suspendue par la junte, qui interdit à l'ensemble des médias de couvrir leurs activités. Le 10 mai, le dialogue inter-malien propose de prolonger la transition de deux à cinq années supplémentaires, de réduire le nombre de partis politiques, qui ne bénéficieront plus de financement public, et appelle Goïta à se présenter à la prochaine présidentielle, proposant que ce dernier et quatre autres membres de la junte soient promus au grade de général.
an 2024 : Maroc - Face aux multiples crises qui ont secoué le Maroc en 2023, le gouvernement a adopté une loi de Finances 2024 ambitieuse et innovante.
an 2024 : Maurice (Ile) - Les élections législatives mauriciennes de 2024 devraient avoir lieu courant décembre 2024 afin de renouveler les députés de l'Assemblée nationale de Maurice au terme de son mandat.
an 2024 : Mauritanie - En avril 2024, Mohamed Ould Ghazouani annonce sa candidature à Présidence. Le 1er juillet 2024, il est réélu avec 56,1 % des voix dès le premier tour du scrutin.
an 2024 : Mozambique - Le Mozambique organise ses élections présidentielle, législatives et provinciales le 9 octobre 2024.
Octobre 2024 : Daniel Chapo, le candidat du Front de libération du Mozambique (Frelimo), a remporté le vote à Maputo avec 54 % des suffrages, selon la commission électorale. L’indépendant Venancio Mondlane, soutenu par le petit parti Podemos, en a obtenu 34 %, tandis qu’ Ossufo Momade, du principal parti d’opposition, le Renamo, en a recueilli 9,6%.
an 2024 : Namibie - 4 février, le président namibien, Hage Geingob, est mort. Le vice-président Nangolo Mbumba sera président par intérim. il assume pleinement la fonction présidentielle pour la durée restante du mandat de ce dernier (21 mars 2025), en accord avec l'article 34 de la constitution.
L'élection présidentielle namibienne de 2024 a lieu le 27 novembre 2024, en même temps que les élections législatives.
an 2024 : Niger - la Cedeao lève une grande partie des sanctions prises après le coup d’État militaire.
Octobre 2024 : Les inondations retardent la rentrée scolaire au 28 octobre. Le Niger a reporté la rentrée scolaire du 1er octobre au 28 octobre 2024, en raison des pluies persistantes affectant les écoles, notamment par l'utilisation des salles de classe comme abris temporaires. Le 10 octobre, le Premier ministre a appelé au relogement des personnes déplacées hébergées dans les écoles. L'UNICEF signale que 1 969 salles de classe sont
toujours occupées, et 5 520 ont été détruites. Plus de 10 000 personnes restent dans les salles de classe rien qu’à Maradi, dans le centre-sud du Niger, qui est la région la plus touchée.
Les partenaires humanitaires soutiennent le gouvernement dans le relogement et la réhabilitation des classes, mais des défis persistent en raison des besoins en abris et en biens non alimentaires. Les inondations de cette année sont les pires en 20 ans, touchant 1 481 730 personnes et causant 395 décès.
an 2024 : Nigeria - La politique économique du président nigérian est critiquée par la rue, qui l'accuse de faire grimper l'inflation à 30 % sur un an.
Octobre 2024 - AFRICANEWS :
"Le changement climatique remet en cause le mode de vie des éleveurs
Les éleveurs peuls sont traditionnellement nomades et dominent l’industrie du bétail en Afrique de l’Ouest. Ils dépendent normalement des campagnes sauvages pour faire paître leur bétail en pâturages gratuits, mais les pressions de la modernisation, le besoin de terres pour le logement et l’agriculture et le changement climatique causé par l’homme remettent en cause leur mode de vie.
Pour empêcher le bétail de s’installer sur les principales routes et les jardins d’Abuja, certains suggèrent que les éleveurs devraient commencer à acquérir des terres privées et à fonctionner comme les autres entreprises. Mais pour ce faire, ils auraient besoin d’argent et d’incitations gouvernementales.
« C’est décourageant », a déclaré Baba Ngelzarma, le président de l’Association des éleveurs de bétail. Miyetti Allah du Nigeria, un groupe de défense des éleveurs peuls. « Le Nigeria est présenté comme un peuple désorganisé. Les éleveurs emmènent le bétail là où ils peuvent trouver de l’herbe verte et de l’eau, au moins pour que les vaches survivent, sans se soucier de savoir si c’est en ville ou sur la terre de quelqu’un. »
Il a ajouté qu’une partie du problème est l’incapacité du gouvernement à exploiter le potentiel de l’industrie de l’élevage en offrant des incitations telles que des infrastructures telles que des sources d’eau et des services vétérinaires dans des réserves de pâturage désignées et en accordant des subventions.
De son côté, le gouvernement a déclaré qu’il s’attaquerait au problème, promettant auparavant des réserves clôturées pour les éleveurs de bétail. Le président Bola Tinubu a annoncé en juillet la création d’un nouveau ministère du développement de l’élevage, qui, selon Ngelzarma, aiderait à relancer les réserves de pâturage abandonnées. Aucun ministre n’a été nommé.
Moins d’endroits où aller
Le Nigeria abrite plus de 20 millions de vaches, la plupart appartenant à des éleveurs peuls. Il possède la quatrième plus grande population bovine d’Afrique et son marché laitier est évalué à 1,5 milliard de dollars. Cependant, malgré sa taille, près de 90 % de la demande locale est satisfaite par les importations, selon l'Administration américaine du commerce international.
Pour Abuja, l'environnement de la ville en subit les conséquences, tout comme les entreprises lorsque la circulation est interrompue par des vaches traversant des routes très fréquentées. Et dans d'autres régions du Nigéria, les éleveurs sont souvent impliqués dans des violences avec les agriculteurs au sujet de l'accès à la terre, en particulier dans le centre et le sud du pays où les deux industries se chevauchent avec les divisions religieuses et ethniques.
Il existe quatre réserves de pâturage désignées dans les zones rurales autour d'Abuja, mais elles manquent d'infrastructures nécessaires et ont été envahies par d'autres agriculteurs et des colons illégaux.
Comme ces réserves ne fonctionnent pas, les éleveurs établissent des colonies n'importe où et y restent aussi longtemps qu'ils le peuvent avant que des propriétaires légitimes ne les réclament ou que le gouvernement ne les construise.
Mohammed Abbas, 67 ans, a dû déménager à plusieurs reprises au fil des ans. La majeure partie de son implantation actuelle dans le quartier de Life Camp, à Abuja, a été occupée par une station-service récemment construite, et il sait que les terres restantes seront bientôt revendiquées par un autre propriétaire.
En tant que petit éleveur, il dit qu'il n'a pas les moyens d'acheter un terrain à Abuja pour s'installer de manière permanente et élever du bétail. Pour se le permettre, « je dois vendre toutes mes vaches et cela signifie qu'il ne restera rien à cultiver sur la terre », dit-il en haoussa, assis devant sa hutte.
D'autres éleveurs préfèrent résister : « Nous n'irons plus nulle part », dit Hassan Mohammed, dont la famille occupe désormais une bande de terre en bordure d'un nouveau lotissement près de la gare d'Idu. Autrefois vaste zone de brousse, la zone a été engloutie par des projets d'infrastructures et de logements. Mohammed conduit désormais également un camion à côté en raison de la diminution des ressources nécessaires pour élever du bétail.
Malgré les ordres répétés des propriétaires de quitter les lieux, Mohammed dit que sa famille restera sur place, utilisant la bande de terre en déclin comme base de départ tout en emmenant chaque jour leur bétail ailleurs pour le pâturage. Les propriétaires fonciers ont demandé à plusieurs reprises au gouvernement de réinstaller la famille de Mohammed, mais le gouvernement n'a pas encore pris de mesures."
an 2024 : Ouganda - Le président Yoweri Museveni, à la tête de l’Ouganda depuis 1986, a promu à la tête de l’armée son fils Muhoozi Kainerugaba, pressenti pour prendre un jour sa succession.
16 septembre : On connaissait les ambitions du fils, Muhoozi Kainerugaba, l’impétueux chef de l’armée ougandaise. Il faut désormais compter avec celles du gendre, Odrek Rwabwogo, conseiller influent du président vieillissant. À Kampala, la querelle s’étale sur la place publique.
an 2024 : Réunion (Île de la) - Le cyclone tropical Belal a frappé l'île de La Réunion et a impacté fortement l'Île Maurice ce lundi 15 janvier 2024.
Depuis le 5 mars 2024, une augmentation de la sismicité est observée sous le Piton de la Fournaise.
an 2024 : Rwanda - le président Paul Kagamé candidat à un quatrième mandat en 2024. La victoire écrasante du président rwandais Paul Kagame au scrutin du 15 juillet a été confirmée avec la publication des résultats définitifs, donnant 99,18 % des voix au chef de l’État sortant, même si son parti a vu sa représentation au Parlement réduite. Le chef de l’État, âgé de 66 ans et qui dirige de fait le petit pays d’Afrique de l’Est depuis trente ans, réalise un score encore supérieur à ses 98,79 % de la présidentielle 2017, après avoir obtenu 95,05 % en 2003 et 93,08 % en 2010. Il a obtenu 99,18 % des voix, a déclaré lundi 22 juillet au soir la Commission nationale électorale (NEC).
Seuls deux candidats avaient été autorisés à concourir : Frank Habineza, leader du seul parti d’opposition autorisé (Parti démocratique vert, DGPR), et l’indépendant Philippe Mpayimana, qui ont obtenu respectivement 0,5 % et 0,32 %.
Cérémonie d'investiture du Président de la République du Rwanda, Paul Kagame, le dimanche 11 août 2024, à Kigali
an 2024 : Sao Tomé et Principe - Le Pape nomme Mgr Nazaré, évêque du diocèse de São Tomé et Príncipe. Le Saint-Père a nommé mardi 09 janvier 2024.
an 2024 : Sahel - 19 septembre 2024, l'alliance des États du Sahel (Mali, le Niger et le Burkina Faso) va lancer son passeport biométrique
an 2024 : Sénégal - Présidentiel 24 mars 2024 : Bassirou Diomaye Faye, élu, a certifié vouloir travailler avec tous les pays.
Bassirou Diomaye Faye, né le 25 mars 1980 à Ndiaganiao. Il devient à 44 ans, la plus jeune personne à occuper cette fonction. Il nomme le même jour Ousmane Sonko, Premier Ministre. Le nouveau gouvernement est nommé par Diomaye Faye le 5 avril suivant.
octobre : Le Sénégal mobilise l'armée pour venir en aide aux zones touchées par les inondations
Après des inondations historiques, l'armée sénégalaise a été mobilisée pour évacuer les villageois et le bétail dans les zones le long du fleuve Sénégal, dans le nord et l'est du pays. Malgré l'absence de pluies récentes, de nombreuses zones restent inondées. Les besoins incluent la nourriture, de l'eau potable et des abris. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a visité les zones sinistrées dans l'est et le nord du pays, où, selon les chiffres officiels du gouvernement, plus de 55 600 personnes réparties dans 51 villages et 44 autres sites ont été touchées par la montée du fleuve Sénégal. Plus de 1 000 hectares de cultures ont été endommagés dans les régions de Tambacounda, Bakel, Matam et Saint-Louis. Des caravanes de solidarité sont organisées, et le Premier ministre Ousmane Sonko a convoqué une réunion d’urgence le 20 octobre, à la suite de l'annonce de l'allocation de 13,3 millions de dollars US pour une assistance.
an 2024 : Seychelles - Lancement du premier site de panneaux solaires flottant en mer.
an 2024 : Sierra Leone - La Sierra Leone, connu pour son sous-sol riche en minerai, s'apprête à adopter une loi qui consiste à protéger l'environnement et les intérêts des populations locales.
an 2024 : Somalie - La Somalie adopte le passage à un suffrage universel direct pour les présidentiel.
an 2024 : Somaliland (ou Somalie Britannique) - Élection présidentielle en 2024
an 2024 : Soudan - Les conflit au Soudan : En date du 11 février 2024, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime que 6 217 222 individus ont été déplacés.
an 2024 : Tchad - Le 13 janvier 2024, Mahamat Idriss Déby Itno est désigné candidat à l'élection présidentielle du 6 mai 2024 par son parti le Mouvement Patriotique du Salut, réuni en congrès à N’Djamena. Le 2 mars 2024, il confirme sa candidature, validée le 24 mars 2024 par le Conseil constitutionnel.
Le 6 mai 2024, il est élu président de la République avec 61 % des voix selon les résultats provisoire de l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE). Le 16 mai, le Conseil constitutionnel le proclame vainqueur avec 61 % des suffrages. Il est investi président de la République le 23 mai 2024.
Allah-Maye Halina né le 1er janvier 1967 à Gounou Gaya, est nommé Premier Ministre le 23 mai 2024.
an 2024 : Tunisie - Sur les 17 prétendants à avoir déposé un dossier, seul trois candidats ont été retenus pour se présenter au élection présidentielle du 6 octobre 2024 : Kaïs Saïed - le Président en place, Zouhair Maghzaoui, secrétaire général du parti Echaâb et Ayachi Zammel - ancien député et homme d'affaire.
16 septembre : Alors que la campagne officielle pour le scrutin présidentiel du 6 octobre a débuté officiellement le 14 septembre, Tunis a connu la veille une large mobilisation de l’opposition, qui juge que le pouvoir tente de confisquer l’élection. Quant aux concurrents de Kaïs Saïed, ils tentent de se faire entendre dans un contexte très compliqué.
Histoire contemporenne
Histoire contemporenne
an 2000 : Burundi - Le 28 août 2000 est signé à Arusha, en Tanzanie, sous l'égide de Nelson Mandela un accord de paix.
an 2000 : Congo Kinshasa - En mai-juin 2000 de nouveaux combats rwando-ougandais ont lieu à Kisangani.
an 2000 : Côte d'Ivoire - Laurent Gbagbo, vainqueur des élections de 2000, et porté au pouvoir par les manifestants devant le refus de Guéï de reconnaître le résultat des élections.
Robert Guéï se proclame vainqueur des élections d'octobre 2000, dont la candidature d'Alasaane Ouattara du RDR avait été exclue pour doutes sur la nationalité, ainsi que celle de Bédié pour ne pas avoir consulté le collège médical désigné par le Conseil constitutionnel. Des manifestations mêlant le peuple et l'armée imposent Laurent Gbagbo, dont la victoire électorale est finalement reconnue. Son parti, le FPI, remporte les législatives de décembre avec 96 sièges (98 au PDCI-RDA), le RDR ayant décidé de les boycotter. Le RDR participe aux élections municipales et sort vainqueur dans la majorité des villes, dont Gagnoa, la principale ville du Centre Ouest du pays, région d'origine de Laurent Gbagbo.
an 2000 : Eswatini (Swaziland) - Depuis 2000, le Swaziland réclame plusieurs kilomètres carrés de territoires à l'Afrique du Sud au prétexte qu'ils leur auraient été volés par les colons blancs au XIXe siècle et annexés illégalement à l'Afrique du Sud. Le royaume swazi base sa réclamation sur un engagement du gouvernement sud-africain signé en 1982 par lequel il s'engageait à rétrocéder au Swaziland plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoires sud-africains en échange de la collaboration dans la lutte anti-terroriste du royaume swazi. Ces territoires situés principalement au Mpumalanga et dans le KwaZulu-Natal et concernent les villes de Nelspruit, Malelane, Barberton, Ermelo, Piet Retief, Badplaas et Pongola. En novembre 2006, Mswati III prit la décision de porter l'affaire devant la cour internationale de La Haye
an 2000-2005 : Ghana - Lors de l'élection présidentielle de décembre 2000, Jerry Rawlings approuve le choix de son vice-président, John Atta-Mills, comme le candidat de la décision du NDC, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d’État en 1981, puis élu en 1992 et en 1996, n'a pas de briguer un troisième mandat, selon la constitution. Il quitte le pouvoir à cinquante-trois ans, après une vingtaine d'années durant lesquelles il a joué les premiers rôles. Mais John Kufuor, candidat du Nouveau Parti patriotique (NPP), parti d'opposition, remporte l'élection, et devient le président le 7 janvier 2001, ce résultat marquant une alternance politique. Le vice-président est Aliu Mahama. Kufuor remporte une autre échéance présidentielle en 2004. Pendant quatre ans, il a su préserver une stabilité économique et politique, et réduire l'inflation.
Durant les deux mandats présidentiels de Kufuor, plusieurs réformes sociales sont menées, telles que la réforme du système d'Assurance Nationale de Santé du Ghana. En 2005, est mis en place un programme d'alimentation en milieu scolaire, avec la fourniture d'un repas chaud gratuit par jour dans les écoles publiques et les écoles maternelles dans les quartiers les plus pauvres. Bien que certains projets sont critiqués comme étant inachevés ou non-financés, les progrès du Ghana sont remarqués à l'échelle international.
an 2000-2003 : Guinée-Bissau - Kumba Ialá est élu président en 2000 mais renversé par un coup d'État sans effusion de sang en septembre 2003. D'ethnie ballante, celui-ci était accusé de favoriser sa communauté et s'était discrédité en dissolvant en 2002 l'Assemblée nationale tout en repoussant sans cesse de nouvelles élections législatives. Le coup d'État ne suscita que peu de protestations tant de la part de la population que de la communauté internationale.
an 2000 - 2003 : Libye - En dépit des sanctions occidentales la Libye maintient une politique internationale de tradition panafricaniste. Elle prend en charge l'essentiel des couts de construction d'un satellite de communication africain, s'engage auprès de l'UNESCO à financer le projet de réécriture de l'Histoire générale de l'Afrique, à payer les cotisations des États défaillants auprès des organisations africaines et à briser le monopole des compagnies aériennes occidentales en Afrique à travers la création de la compagnie Ifriqyiah en 2001.
Dans les années 2000, grâce notamment au contexte de la guerre contre le terrorisme suivant les attentats du 11 septembre 2001, suivi en 2003 par l'arrêt du programme nucléaire de la Libye visant à acquérir la bombe atomique, la Libye de Kadhafi connaît un net retour en grâce diplomatique. Elle renoue de bonnes relations avec le monde occidental, qui voit en elle un allié contre le terrorisme islamiste; la lutte contre l'immigration illégale fournit en outre un argument à la Libye pour entretenir des liens d'alliance avec les pays de l'Union européenne, notamment l'Italie, son principal partenaire commercial. Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de Mouammar Kadhafi, fait figure de réformateur au sein du régime, pour le compte duquel il multiplie les contacts dans le monde occidental, ce qui le fait apparaître comme un « ministre des affaires étrangères bis », souvent décrit comme un potentiel successeur de son père.
an 2000-2019 : Iles Maurice - Anerood Jugnauth redevient Premier ministre après les élections de septembre 2000, puis après trois ans, comme convenu, cède son poste à son allié du Mouvement militant mauricien, Paul Bérenger, dirigeant de la principale formation d'opposition de gauche depuis l'indépendance. Paul Bérenger reste Premier ministre pendant moins de deux ans, puis, dans une nouvelle alternance, Navin Ramgoolam revient au pouvoir pendant neuf ans et demi, jusqu'à décembre 2014, passant alors le relais à nouveau à Anerood Jugnauth, jusqu'à janvier 2017. Le 21 janvier 2017, il annonce sa démission lors d'une allocution télévisée. Il est remplacé par son fils, ministre des Finances Pravind Jugnauth. À la lignée des Ramgoolam succède ainsi celle des Jugnauth. Pravind Jugnauth remporte les législatives de 2019.
Le 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution41 demandant au Royaume-Uni de rétrocéder sous six mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos. Ce délai a pris fin le 22 novembre 2019, sans que le Royaume-Uni se conforme à cette résolution, ni à l'avis consultatif formulé en février par la Cour internationale de justice (CIJ) demandant à Londres de mettre fin « dans les plus brefs délais » à son administration des Chagos.
an 2000-2005 : Ouganda - En mars 2001, Museveni fut réélu dès le premier tour avec 69,3 % des voix alors que son rival Kizza Besigye en obtint 27,8 %.
Malgré un referendum similaire ayant eu lieu en 2000, lors duquel un retour au multipartisme avait été rejeté par 90,7 % des votants, un nouveau referendum, organisé en juillet 2005, vit la population approuver à 92,5 % un abandon du système sans partis pour un retour au multipartisme.
an 2000 : Rwanda - Après la prolongation de la période de transition, plusieurs changements de premiers ministres, la démission du président de l'assemblée nationale, Pasteur Bizimungu démissionne en 2000. Paul Kagame est élu président de la République par l'assemblée nationale de transition.
an 2000 : Sénégal - Mars 2000 : Le président sortant, Abdou Diouf, est battu au deuxième tour des élections présidentielles par Abdoulaye Wade. L’arrivée au pouvoir de Me. Wade met un terme à 40 ans de pouvoir du Parti Socialiste. Porté par son slogan “SOPI” (“changement” en wolof), l’opposant de longue date Abdoulaye Wade, chef de file du Parti démocratique sénégalais, remporte l’élection présidentielle du 19 mars 2000, avec 58,5% des suffrages au second tour, devant le président sortant Abdou Diouf.
Le 9 décembre 2000 le Sénat et le Conseil économique et social sont supprimés.
an 2000-2003 : Somalie - Le 26 août 2000, le Parlement de transition en exil élit un nouveau président en la personne de Abdiqasim Salad Hassan, dans un contexte particulièrement difficile. Le pays reste aux prises avec des rivalités claniques. Après diverses tentatives infructueuses de conciliation, une conférence de réconciliation aboutit en juillet 2003 à un projet de charte nationale prévoyant le fédéralisme et mettant sur pied des institutions fédérales de transition.
an 2000-2003 : Togo - Le président s'était engagé à dissoudre l'Assemblée nationale et à organiser des élections législatives en mars 2000 pour que d'autres formations politiques puissent entrer au Parlement. Il s'était aussi engagé à respecter la Constitution et à ne pas se présenter pour un troisième mandat. Mais ces promesses ne sont pas tenues. Le général Gnassingbé Eyadema et son parti modifient par la suite le code électoral et la constitution que le peuple togolais avait massivement adoptés en 1992, pour lui permettre de faire un troisième mandat, lors des élections de 2003. Le président Gnassingbé Eyadema est donc réélu en juin 2003 pour un nouveau mandat de cinq ans. La Commission électorale annonce que Eyadéma, détenteur du record de longévité politique à la tête d'un État africain, a réuni 57,2 % des suffrages lors du scrutin.
an 2000 : Zambie - Le gouvernement suit les recommandations du Fonds monétaire international (FMI) et privatise de nombreuses entreprises, dont celles du cuivre, principale ressource du pays, et les compagnies aériennes. Au début des années 2000, la poursuite du programme de privatisation provoque des licenciements massifs et une hausse de la pauvreté.
an 2000 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En février 2000, les occupations de terres par des paysans noirs et d'anciens combattants de la guerre d’indépendance se multiplient. Quelque 4 000 propriétaires possèdent alors plus d'un tiers des terres cultivables dans les zones les plus fertiles, sous forme de grandes exploitations commerciales, tandis que plus de 700 000 familles paysannes noires se partagent le reste sur des « terres communales » beaucoup moins propices à la culture. Les propriétaires blancs avaient continué de s'enrichir pendant les vingt années ayant suivi la chute du régime ségrégationniste, attisant le ressentiment d'une partie de la population noire dans un contexte de crise économique et de montée du chômage. Le président zimbabwéen, qui les avait jusqu'alors défendu, vit mal leur soutien à la nouvelle formation de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique. Dépassé par le mouvement d'occupation de terres, Mugabe tente de sauver la face en officialisant les expropriations et en installant sur les terres réquisitionnées des proches du régime, officiellement anciens combattants de la guerre d’indépendance. Ceux-ci n’ont cependant pas les connaissances ni le matériel nécessaires pour cultiver leurs lopins et beaucoup de terres restent en friches. Des dizaines de milliers d'ouvriers agricoles perdent leur emploi et la production chute.
an 2001 : Burundi - L'Afrique du Sud envoie 700 militaires pour veiller à la mise en place de l'accord et assurer la sécurité des membres de l'opposition de retour d'exil. Le 10 janvier 2001, une assemblée nationale de transition est nommée et son président est Jean Minani, président du Frodebu. L'accord d'Arusha entre en vigueur le 1er novembre 2001 et prévoit, en attendant des élections législatives et municipales pour 2003 et présidentielles pour 2004, une période de transition de 3 ans avec pour les 18 premiers mois, le major Buyoya à la présidence et Domitien Ndayizeye du Frodebu au poste de vice-président avant que les rôles ne soient échangés. L'alternance prévue est respectée par Pierre Buyoya qui cède le pouvoir au bout de dix-huit mois. Les différents portefeuilles du gouvernement sont partagés entre Uprona et Frodebu. Le 4 février 2002, le Sénat de transition élit l'uproniste Libère Bararunyeretse à sa présidence.
Malgré les critiques du comité de suivi des accords d'Arusha à l'encontre du gouvernement, en particulier en ce qui concerne la modification de la composition ethnique de l'armée et de l'administration, c'est-à-dire un rééquilibrage ethnique de ces deux institutions, l'exécutif Hutu-Tutsi fonctionne.
an 2001 : Cap Vert - En 2001, Pedro Pires, du PAICV est élu président contre Carlos Veiga, du MPD avec une majorité de 12 voix seulement. Tous deux avaient exercé précédemment la charge de premier ministre.
an 2001 : République de Centrafrique - Si les accords de Bangui de janvier 1997 semblent mettre un terme aux conflits et le scrutin présidentiel de 1999 ouvre la voie d'un deuxième mandat à Ange-Félix Patassé, en 2001, l’ancien président André Kolingba tente un coup d’État contre le président Patassé le 28 mai 2001 que seule l’intervention de la Libye et des combattants du Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba permet de contrer.
La tentative de coup d'État provoque de violents affrontements dans la capitale, Bangui.
De nouvelles périodes de troubles suivront et le général François Bozizé, ancien chef d’état-major des forces armées centrafricaines, est impliqué dans un putsch avorté en mai 2001 contre le président Patassé et doit fuir au Tchad le 9 novembre 2001.
an 2001 : Congo Kinshasa - Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné par un de ses gardes du corps. Son fils Joseph Kabila est désigné par le gouvernement pour assurer l'intérim (en attendant « le rétablissement du blessé », que tous savent pourtant déjà décédé). Kinshasa reconnaît enfin le décès de Laurent-Désiré Kabila le 18 janvier.
Joseph Kabila, proclamé chef de l'État, prête serment le 26 janvier et appelle à des négociations pour la paix. À Gaborone, s'ouvre une réunion préparatoire au Dialogue intercongolais : celui-ci ne s'ouvrira officiellement à Addis-Abeba que le 15 octobre, et les négociations continuent sans mettre réellement fin au désordre.
En février 2001, un accord de paix est signé entre Kabila, le Rwanda et l'Ouganda, suivi de l'apparent retrait des troupes étrangères. Les troupes de maintien de la paix de l'ONU, la MONUC, arrivent en avril, afin de soutenir les difficiles efforts de paix ou au moins soutenir le cessez-le-feu, protéger les populations et les organisations humanitaires prêtant assistance aux nombreux réfugiés et déplacés.
an 2001-2002 : Gambie - Vers la fin de l'an 2001 et au début 2002, la Gambie termine un cycle complet d'élections présidentielles, législatives et locales, que les observateurs étrangers jugent libres, justes et transparentes, malgré quelques lacunes. Réélu, le président Yahya Jammeh, installé le 21 décembre 2001, conserve un pouvoir obtenu à l'origine par un coup d'État. Son parti, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), conserve une large majorité à l'Assemblée nationale, en particulier après que la principale force d'opposition Parti démocratique unifié (UDP) a boycotté les élections législatives.
an 2001 - 2002 : Madagascar - Le résultat de l'élection de décembre 2001 est contesté entre Didier Ratsikara et Marc Ravalomanana, maire de Tananarive. Marc Ravalomanana devient président à l'issue d'une crise politique qui dure tout le premier semestre 2002. Sous prétexte de controverse sur les résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 16 décembre 2001, Marc Ravalomanana se fait proclamer vainqueur au premier tour, puis est installé Président de la République le 22 février 2002. Un recomptage des voix prévu par les Accords de Dakar permet d’attribuer officiellement à Marc Ravalomanana la victoire au premier tour qu’il revendiquait. Didier Ratsiraka quitte Madagascar en juillet 2002 pour la France et l'élection de Marc Ravalomanana est reconnue par la France et les États-Unis.
an 2001-2002 : Mali - Le 1er septembre 2001, Amadou Toumani Touré, dit ATT, demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l’armée pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle. Il est élu président du Mali en mai 2002 avec 64,35 % des voix au second tour. Son adversaire Soumaïla Cissé, ancien ministre, obtient 35,65 % des voix. Il nomme Ahmed Mohamed ag Hamani comme premier ministre en le chargeant de réunir un gouvernement de grande coalition.
an 2001-2004 : Mozambique - En 2001, Joaquim Chissano indique qu'il ne se présente pas une troisième fois,. Armando Guebuza lui succède à la tête du FRELIMO, et remporte encore les élections de décembre 2004.
an 2001 : Namibie - En 2001, la crise de la réforme agraire se poursuit, en dépit d'un nouvel impôt foncier. Le président Samuel Nujoma s'en prend aussi aux homosexuels, accusés d'être les responsables de la propagation du sida qui ravage le pays.
En politique étrangère, les forces de sécurité namibiennes participent en Angola à la lutte contre l'UNITA. Au côté de l'armée du Zimbabwe, l'armée namibienne est impliquée militairement au Congo-Kinshasa en faveur du régime de Laurent-Désiré Kabila puis de son fils Joseph.
an 2001 : Sénégal - En 2001 une nouvelle constitution réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans.
L’Assemblée nationale – au sein de laquelle le Parti socialiste est majoritaire – est dissoute le 5 février 2001.
25 formations politiques sont autorisées à participer aux élections législatives anticipées.
Pour la première fois au Sénégal, un parti écologiste, Les Verts, entre en lice dans une consultation électorale, mais n’obtient aucun siège.
Suite à la démission de Moustapha Niasse, la juriste Mame Madior Boye est la première femme à occuper les fonctions de Premier ministre dans le pays, du 3 mars 2001 au 4 novembre 2002.
Les élections législatives du 12 mai 2001 voient la victoire de la coalition Sopi proche du président Wade, ce qui permet à 9 nouveaux ministres d’entrer au gouvernement, renforçant ainsi le poids du PDS.
Quelques jours plus tard, 10 partis d’opposition s’unissent pour créer un « Cadre permanent de concertation » (CPC).
Le 25 août 2001 : 25 partis créent cette fois une structure de soutien à l’action du président Wade : « Convergence des actions autour du Président en perspective du 21e siècle » (CPC).
an 2002-2009 : Congo Brazzaville - En 2002 est adopté une nouvelle constitution supprimant le poste de Premier ministre, renforçant les pouvoirs du président de la République. Le président est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. La même année a lieu l'élection du président de la République : Denis Sassou-Nguesso est reconduit à ce poste. Le septennat de Denis Sassou-Nguesso de 2002 à 2009 est marqué par le retour à la paix civile, même si des troubles subsistent dans l'Ouest du Pool. La flambée des cours du pétrole enrichit considérablement l'État, dont le budget annuel dépasse pour la première fois les 100000 milliards de francs CFA. De nombreux projets de construction d'infrastructures sont entrepris (port de Pointe-Noire, autoroute Pointe-Noire - Brazzaville...) en coopération avec des États et entreprises étrangers (France, Chine...).
an 2002 : Congo Kinshasa - Le conflit éclate à nouveau en janvier 2002 à la suite d'affrontements entre des groupes ethniques dans le Nord-est ; l'Ouganda et le Rwanda mettent alors fin au retrait de leurs troupes et en envoient de nouvelles. Des négociations entre Kabila et les chefs rebelles aboutissent à la signature d'un accord de paix par lequel Kabila devra désormais partager le pouvoir avec les anciens rebelles.
Le 15 février 2002 s'ouvre réellement en Afrique du Sud le Dialogue intercongolais : l'accord de paix est signé à Prétoria en décembre; le Dialogue sera clôturé en avril 2003.
an 2002 : Côte d'Ivoire - Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles tentent de prendre le contrôle des villes d’Abidjan, Bouaké et Korhogo. Ils échouent dans leur tentative en ce qui concerne Abidjan mais sont victorieux dans les deux autres villes, situées respectivement dans le centre et le nord du pays. Robert Guéï est assassiné dans des circonstances non encore élucidées. La rébellion qui se présente sous le nom MPCI crée plus tard le MJP et le MPIGO et forme avec ces dernières composantes le mouvement des Forces nouvelles (FN). Il occupe progressivement plus de la moitié nord du pays (estimée à 60 % du territoire), scindant ainsi le territoire en deux zones : le sud tenu par les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et le nord tenu par les Forces armées des forces nouvelles (FAFN).
Les pourparlers entamés à Lomé permettent d’obtenir le 17 octobre 2002, un accord de cessez-le-feu qui ouvre la voie à des négociations sur un accord politique entre le gouvernement et le MPCI sous l’égide du président du Togo, Gnassingbé Eyadema. Ces négociations échouent cependant sur les mesures politiques à prendre, en dépit de réunions entre les dirigeants de la CEDEAO à Kara (Togo), puis à Abidjan et à Dakar. 10 000 casques bleus de l’ONUCI98 dont 4 600 soldats français de la Licorne sont placés en interposition entre les belligérants.
an 2002-2005 : Kenya - En août 2002, le Président Moi — qui constitutionnellement ne peut plus être élu ni président, ni député — surprend tout le monde en annonçant qu'il soutient personnellement la candidature du jeune et inexpérimenté Uhuru Kenyatta — un des fils de Jomo Kenyatta — dans la course à la présidence lors des élections de décembre. En opposition totale avec les vues de Moi, des membres importants du cartel KANU-NDP tels Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, George Saitoti et Joseph Kamotho rejoignent le Liberal Democratic Party (LDP). Pour contrer le dessein de Moi, le LDP, dont Raila a pris la tête, fait alliance avec le National Alliance Party of Kenya (NAK), le Democratic Party (en) (DP), le Forum for the Restoration of Democracy-Kenya (FORD-K) et le National Party of Kenya (NPK). Cette alliance appelée National Rainbow Coalition (NARC) pousse la candidature de Mwai Kibaki le prétendant du DP au poste de président de la République.
Mwai Kibaki gagne largement l'élection présidentielle du 27 décembre avec 62,2 % des suffrages devant Uhuru Kenyatta (31,3 %) et trois autres candidats. Le LDP de Raila Odinga devient le premier parti politique du pays avec 59 sièges de députés à l'Assemblée nationale.
Présidence de Mwai Kibaki - Entre 2002 et 2005, une équipe de constitutionnalistes rédigent au Bomas of Kenya, un texte portant révision de la Constitution. Ce texte, connu sous le nom de Bomas Draft, limite, entre autres, les pouvoirs du président de la République et crée un poste de Premier ministre. En 2005, Mwai Kibaki rejette ce texte et présente un texte de réforme donnant plus de pouvoirs politiques au chef de l'État. Ce texte connu sous le nom de Wako Draft est soumis le 21 novembre 2005, à un référendum national et rejeté par 58,12 % des votants. En réaction, le président Kibaki congédie l'intégralité du gouvernement deux jours après le résultat du référendum et, deux semaines plus tard, forme un nouveau gouvernement qui ne comporte plus aucun membre du LDP.
C'est à ce moment que Raila Odinga décide d'être candidat à l'élection présidentielle de décembre 2007 et crée son propre parti politique : l′Orange Democratic Movement (ODM). Son symbole est une orange en référence au symbole visuel qui représentait le « non » lors du référendum (le « oui » était imagé par une banane)
an 2002 : Nigéria - Depuis 2002 et plus particulièrement depuis 2009, le gouvernement nigérian est confronté, au nord-est du pays, au mouvement terroriste Boko Haram. Ce mouvement salafiste, prônant un islam radical et rigoriste, est à l'origine de nombreux attentats et massacres à l'encontre des populations civiles.
an 2002-2004 : Rwanda - En 2002, l'armée rwandaise quitte officiellement la République démocratique du Congo (Zaïre de 1971 à 1997). Toutefois, dès le début de 2003, le troupes rwandaises envahissent de nouveau l'est de la RDC, et ne commencent à être évacuées que six mois plus tard, après l'envoi de casques bleus. Le 1er juin 2004, les troupes rwandaises et leurs alliés rwandophones occupent la ville de Bukavu, dans le sud du Kivu, mais, dès le
8 juin, les pressions de l'ONU contraignent les troupes à se retirer. Le mouvement RDC-Goma reste armé et soutenu par Kigali.
Malgré les immenses difficultés pour reconstruire le pays qui ont marqué la période de transition, la pression de la communauté internationale aidant, le pouvoir rwandais prépare une constitution et des élections au suffrage universel pour 2003. À tort ou à raison, la crainte manifestée par certains rescapés tutsi de voir le pouvoir à nouveau entre les mains de supposés proches des génocidaires est réveillée. Des intimidations de candidats et d'électeurs, afin qu'ils votent pour le pouvoir en place, sont remarquées.
En 2002, accusé de corruption, l'ancien président de la république, Pasteur Bizimungu, est arrêté et mis en prison. Il est accusé d'avoir constitué un parti politique d'opposition non autorisé par les accords d'Arusha (qui limitaient les partis à ceux qui les avaient signés), de malversations financières et d'avoir publié un article où il manipule les concepts « hutu/tutsi ». Il est condamné à quinze ans de prison. Des associations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, voient en M. Bizimungu un « prisonnier d'opinion », incarcéré pour son opposition au président Kagame plutôt que pour les motifs officiellement invoqués53. Le MDR, signataire des accords d'Arusha, accusé d'abriter en son sein un courant idéologique génocidaire, est dissous par les députés. Une association des droits de l'homme est aussi menacée pour les mêmes raisons. La rigueur qui paraissait excessive chez Paul Kagame est guidée par le fait que la paix intérieure du Rwanda demeurait très fragile à l'époque.
C'est dans ce climat de suspicion de « division » que se déroulent les élections en 2003.
an 2002 : Sénégal - Le 15 février 2002 : la création d’une Commission électorale nationale autonome (CENA) est décidée, en remplacement de l’Observatoire national des élections (ONEL). Elle prendra ses fonctions en 2005.
Le 26 septembre 2002 : le Sénégal vit une tragédie nationale avec le naufrage du Joola, le ferry qui reliait Dakar à Ziguinchor en Casamance. Plus de 1 800 passagers y perdent la vie. Les négligences constatées suscitent un forte rancœur à l’égard des pouvoirs publics. La région, déjà affectée par son enclavement, perd sa liaison maritime pendant trois ans et l’île de Karabane, ancienne escale, ne peut plus compter que sur les pirogues. Ce drame n’est pas sans conséquences sur la carrière de Mame Madior Boye qui est remplacée par Idrissa Seck, maire de Thiès et numéro deux du Parti démocratique sénégalais (PDS).
Seck sera Premier ministre du 4 novembre 2002 au 21 avril 2004. Son ministre de l’Intérieur Macky Sall lui succède lorsqu’il tombe en disgrâce en raison de ses responsabilités dans la gestion des chantiers de Thiès et peut-être de ses ambitions nationales.
an 2002-2004 : Sierra Leone - Le 14 mai 2002, le président sortant, Ahmad Tejan Kabbah, est réélu avec 70,6 % des voix.
Le pays est désormais en paix, après 10 ans d'une guerre civile atroce. Les différentes mesures prises par l'ONU sont progressivement réduites, voire supprimées, comme l'atteste la levée de l'embargo sur les exportations de diamants du sang. De même, les effectifs de la MINUSIL (casques bleus) sont diminués. Après un pic de 17 500 hommes en mars 2001, les effectifs sont ramenés à 13 000 en juin 2003 et à 5 000 en octobre 2004.
Cependant, pour des raisons économiques, de nombreux enfants travaillent toujours dans les mines de diamants, qui sont très dangereuses. La propagation du SIDA chez eux est également très importante : 16 000 enfants de moins de 15 ans sont séropositifs.
an 2002 : Zambie - En 2002, en raison de la sécheresse, la famine menace trois millions de personnes.
Après avoir tenté de faire amender la Constitution qu'il a lui-même promulguée afin de briguer un troisième mandat, Chiluba, face aux protestations populaires, doit céder la place en janvier 2002 à son vice-président et successeur désigné, Levy Mwanawasa, qui est élu président, au cours d’un scrutin contesté. Le Parlement vote à l'unanimité la levée de l'immunité de l'ancien président Chiluba qui est mis en examen au titre d'une soixantaine d'inculpation concernant principalement des détournements de fonds. Les charges seront levées en 2009.
an 2002 - 2003 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
Mugabe est désavoué lors d’un référendum sur une réforme constitutionnelle. En 2002, il gagne l’élection présidentielle lors d’un scrutin dont l’honnêteté est contestée. En 2003, une grave crise agraire et politique éclate à la suite de l’expropriation par Mugabe des fermiers blancs. Une crise politique survient quand les mouvements d’opposition comme la MDC sont réprimés et les élections truquées. À la suite d'une campagne intensive des mouvements des droits de l’Homme, des Britanniques et de l’opposition, le Commonwealth impose des mesures de rétorsion contre les principaux dirigeants du Zimbabwe. Au sein du Commonwealth, Mugabe reçoit cependant le soutien de plusieurs pays africains et dénonce des mesures prises à l’instigation des pays « blancs » (Canada, Grande-Bretagne, Australie). L’opposition locale du MDC est réprimée.
an 2003 : Burundi - le 7 juillet 2003, les forces hutu des CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie), en coalition avec le PALIPEHUTU-FNL (Parti pour la libération du peuple hutu-Forces de libération nationale) attaquent Bujumbura.
40 000 habitants fuient la capitale. Un accord de paix (protocole de Pretoria) est néanmoins signé le 15 novembre 2003 entre le président Ndayizeye et le chef des CNDD-FDD. La principale branche de la rébellion (CNDD-FDD) entre au gouvernement, au sein duquel elle détient quatre ministères et dispose également de postes de haut rang dans les autres institutions, conformément à l'accord d'Arusha.
an 2003 : République de Centrafrique - Après une nouvelle série de troubles et malgré l'intervention de la communauté internationale (MINURCA). Malgré l'intervention de la communauté internationale, Ange-Félix Patassé est finalement renversé le 15 mars 2003 par François Bozizé grâce à une rébellion dont l'élément central est constituée par plusieurs centaines de « libérateurs », qui sont souvent d’anciens soldats tchadiens ayant repris du service avec l’assentiment d’Idriss Déby. Une bonne partie des « libérateurs » retournera au Tchad en 2003 ou 2004, d'autres intégreront les forces de sécurité ou se reconvertiront dans le commerce sur le grand marché PK5
Le 15 mars 2003, le général François Bozizé réussit, avec l'aide de militaires français (deux avions de chasse de l'armée française survolaient Bangui pour filmer les positions des loyalistes pour le compte de Bozizé) et de miliciens tchadiens (dont une bonne partie va rester avec lui après son installation au pouvoir), un nouveau coup d'État et renverse le président Patassé. Le général Bozizé chasse alors les rebelles congolais, auteurs de méfaits et crimes innombrables, notamment dans et autour de Bangui.
Toutefois, le coup d’État de François Bozizé, en 2003, a déchaîné un cycle de rébellion dans lequel le pays est toujours plongé en 2019.
an 2003 : Congo Kinshasa - Le 4 avril 2003, la Cour d'ordre militaire (COM), condamne, sans convaincre, 30 personnes à mort pour l'assassinat de Laurent Kabila.
La même année se met en place le gouvernement de transition « 4+1 » (quatre vice-présidents et un président) : Abdoulaye Yerodia Ndombasi (PPRD), Jean-Pierre Bemba (MLC), Azarias Ruberwa (RCD), Arthur Z'ahidi Ngoma (société civile), ainsi que Joseph Kabila (PPRD).
En juin 2003, l'armée rwandaise est la seule de toutes les armées étrangères à ne pas s'être retirée du Congo. L'essentiel du conflit était centré sur la prise de contrôle des importantes ressources naturelles du pays, qui incluent les diamants, le cuivre, le zinc, et le coltan.
an 2003 : Afrique Côte d'Ivoire - Dans une nouvelle initiative, la France abrite à Linas-Marcoussis du 15 au 23 janvier 2003, sous la présidence de Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel français, secondé par le juge sénégalais Kéba Mbaye, une table ronde avec les forces politiques ivoiriennes et obtient la signature des accords de Linas-Marcoussis. Cet accord prévoit la création d’un gouvernement de réconciliation nationale dirigé par un premier ministre nommé par le Président de la République après consultation des autres partis politiques, l’établissement d’un calendrier pour des élections nationales crédibles et transparentes, la restructuration des forces de défense et de sécurité, l’organisation du regroupement et du désarmement de tous les groupes armés, le règlement des questions relatives à l’éligibilité à la présidence du pays et à la condition des étrangers vivant en Côte d’Ivoire. Un comité de suivi de l’application de l’accord, présidé par l’ONU, est institué.
an 2003 : Guinée - Après avoir révisé la Constitution pour pouvoir se présenter une troisième fois en décembre 2003, le chef de l'État, pourtant gravement malade, est réélu avec 95,63 % des suffrages face à un candidat issu d'un parti allié, les autres opposants ayant préféré ne pas participer à un scrutin joué d'avance.
an 2003 : Libéria - Les combats s'intensifient, les rebelles encerclent progressivement dans la capitale les forces de Charles Taylor, le risque d'une tragédie humanitaire se profile à nouveau. Le 8 juillet 2003, le Secrétaire général décide de nommer Jacques Paul Klein (États-Unis) comme son Représentant spécial pour le Liberia. Il lui confie la tâche de coordonner les activités des organismes des Nations unies au Liberia et d'appuyer les nouveaux accords. Le 29 juillet 2003, le Secrétaire général décrit le déploiement en trois phases des troupes internationales au Liberia, aboutissant à la création d'une opération de maintien de la paix pluridimensionnelle des Nations unies (S/2003/769). La nomination de Jacques Paul Klein et la création d'une opération des Nations unies au Liberia mettent fin au mandat du BANUL. La situation au Liberia évolue ensuite rapidement. Le 1er août 2003, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1497 (2003): autorisation de la mise en place d'une force multinationale au Liberia et d'une force de stabilisation de l'ONU déployée au plus tard le 1er octobre 2003. Parallèlement, le 18 août 2003, les parties libériennes signent à Accra un accord de paix global, dans lequel les parties demandent à l'Organisation des Nations unies de déployer une force au Liberia, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Celle-ci est chargée d'appuyer le Gouvernement transitoire national du Liberia et de faciliter l'application de cet accord. Grâce au déploiement ultérieur de la Mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Liberia, la situation en matière de sécurité dans le pays s'améliore.
Les événements aboutissent à la création de la Mission des Nations unies au Liberia (MINUL), à la démission de Charles Taylor, le 11 août et à une passation pacifique des pouvoirs.
Le Secrétaire général recommande que le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, autorise le déploiement d'une opération de maintien de la paix des Nations unies dotée d'effectifs d'un maximum de 15 000 hommes, dont 250 observateurs militaires, 160 officiers d'état-major et un maximum de 875 membres de la police civile, 5 unités armées constituées supplémentaires fortes chacune de 120 personnes, ainsi que d'une composante civile de taille appréciable et du personnel d'appui requis. La Mission des Nations unies au Liberia comporte des volets politiques, militaires, concernant la police civile, la justice pénale, les affaires civiles, les droits de l'homme, la parité hommes-femmes, la protection de l'enfance, un programme « Désarmement, Démobilisation, Réinsertion », ainsi que, le moment venu, un volet électoral. Elle comporte un mécanisme de coordination de ses activités avec celles des organismes humanitaires et de la communauté du développement. Elle agit en étroite coordination avec la CEDEAO et l'Union africaine. Afin d'assurer une action coordonnée des Nations unies face aux nombreux problèmes de la sous-région, la Mission doit travailler également en étroite collaboration avec la Mission des Nations unies en Sierra Leone (MINUSIL), la Mission des Nations unies en Côte d'Ivoire (MINUCI) et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest.
Dans son rapport, le Secrétaire général fait observer que la passation des pouvoirs du Président Charles Taylor au Vice-Président Moses Blah et la signature, par les parties libériennes, de l'accord de paix global offrent une occasion unique de mettre un terme aux souffrances du peuple libérien et de trouver une solution pacifique à un conflit qui avait été l'épicentre de l'instabilité dans la sous-région. Il souligne que si l'Organisation des Nations unies et la communauté internationale dans son ensemble sont prêtes à soutenir le processus de paix libérien, c'est aux parties libériennes elles-mêmes qu'incombe la responsabilité première de la réussite de l'accord de paix.
Le 19 septembre 2003, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 1509 (2003), en remerciant le Secrétaire général de son rapport du 11 septembre 2003 et de ses recommandations. Il a décidé que la MINUL comprendrait 15 000 membres du personnel militaire des Nations unies, dont un maximum de 250 observateurs militaires et 160 officiers d'état-major, et jusqu'à 1 115 fonctionnaires de la police civile, dont des unités constituées pour prêter leur concours au maintien de l'ordre sur tout le territoire du Liberia, ainsi que la composante civile appropriée. La Mission a été créée pour une période de 12 mois. Il a prié le Secrétaire général d'assurer le 1er octobre 2003 la passation des pouvoirs des forces de l'ECOMOG dirigées par la CEDEAO à la MINUL.
Comme prévu, la Mission des Nations unies au Liberia (MINUL) a assuré les fonctions de maintien de la paix des forces de la Mission de la CEDEAO au Liberia (ECOMIL) le 1er octobre. Les quelque 3 500 soldats ouest-africains qui avaient fait partie des troupes avancées de l'ECOMIL ont provisoirement coiffé un béret de soldat de la paix des Nations unies. Dans un communiqué paru le même jour, le Secrétaire général a accueilli avec satisfaction cette très importante évolution et a salué le rôle joué par la CEDEAO dans l'instauration du climat de sécurité qui a ouvert la voie au déploiement de la MINUL. Il a rendu hommage aux gouvernements du Bénin, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Nigeria, du Sénégal et du Togo pour leur contribution à la MINUL, ainsi qu'aux États-Unis pour leur appui à la force régionale. Le Secrétaire général s'est dit confiant dans le fait que la MINUL pourrait être en mesure de contribuer de manière importante au règlement du conflit au Liberia pour autant que toutes les parties concernées coopèrent pleinement avec elle et que la communauté internationale fournisse les ressources nécessaires.
an 2003 : Mauritanie - En novembre 2003, Ould Taya est réélu président de la République avec 67 % des voix.
an 2003 : Tchad - En 2003, les recherches de gisements pétroliers permettent au Tchad de lancer les premières phases d'exploitation de son sous-sol, entraînant avec elles l'espoir que le Tchad puisse enfin connaître une phase d'essor économique et de développement humain
an 2003-2005 : Togo - Gnassingbé Eyadema est réélu en 2003 à la suite d'un changement dans la constitution pour l’autoriser à se présenter à nouveau. Il décède le 5 février 2005.
an 2003-2007 : Rwanda - La constitution adoptée par référendum – 26 mai 2003 - Inspirée des principales constitutions occidentales, la constitution rwandaise laisse néanmoins une large place aux problèmes spécifiques du Rwanda post-génocide, inscrivant notamment dans la constitution le refus de l'ethnisme hérité du colonialisme et ayant conduit au génocide. Des opposants au FPR, des courants liés à l'ancien régime génocidaire, et des observateurs occidentaux y voient une hypocrisie visant à renforcer un pouvoir politique disposant d'une faible base ethnique et voulant de ce fait forcer la marche vers l'apparence d'une nation composée de citoyens débarrassés du concept ethnique. Elle crée aussi des outils juridiques pour favoriser la place des femmes dans la vie politique (art. 185 et 187). Selon Human Rights Watch, certaines dispositions de la Constitution de 2003 violent « le droit d'association, de libre expression et de représentation politique assurée par des élections libres.
L'élection présidentielle au suffrage universel – 25 août 2003 - Paul Kagame est élu président de la République avec 95 % des voix contre son principal opposant, Faustin Twagiramungu, du MDR dissous. Des membres du comité de soutien à Faustin Twagiramungu ont été arrêtés la veille du scrutin. Certains ont subi des violences avant d'être relâchés. Les observateurs de la communauté européenne ont émis des critiques, regrettant des pressions exercées sur le corps électoral, et ont constaté des fraudes, mais estiment qu'un pas important vers la démocratie a été franchi. Amnesty International et Human Rights Watch ont en revanche manifesté un grand scepticisme sur la démocratisation du Rwanda.
Les élections législatives au suffrage universel – 2 octobre 2003 - Les députés favorables à Paul Kagame obtiennent la majorité des sièges. 49 % des députés sont des femmes, ainsi qu'une très forte proportion de sénateurs et de ministres.
Pour résoudre la difficulté de juger les nombreux prisonniers, qui attendent dans les prisons rwandaises l'idée germe d'adapter les gacaca, structures de justice traditionnelle (de agacaca, « petite herbe » ou « gazon » en kinyarwanda). On forme rapidement des personnes intègres pour présider ces tribunaux populaires. Pour désengorger les prisons, des prisonniers de certaines catégories sont relâchés, sans être amnistiés, avant de passer devant les gacaca. Ces décisions ravivent, dans la société rwandaise et la diaspora, les inquiétudes des rescapés qui craignent pour leur vie et le débat controversé sur la réconciliation, politiquement souhaitée, entre tueurs et rescapés.
Après plusieurs années de réflexions et de mises au point, le 15 janvier 2005, huit mille nouvelles juridictions « gacaca », (tribunaux populaires chargés de juger les auteurs présumés du génocide de 1994), entament la phase administrative de leur travail. Elles se rajoutent aux 750 « gacaca » pilotes mises en place depuis 2001. L'expérience des « gacaca » pilotes laisse penser qu'il y aurait au moins sept cent cinquante mille personnes, soit un quart de la population adulte, dénoncées et jugées par ces assemblées populaires.
Amnesty International estime que « cette volonté de traiter les affaires aussi rapidement que possible a accru la suspicion régnant sur l’équité du système. Certaines décisions rendues par les tribunaux gacaca faisaient douter de leur impartialité. » L'association souligne également que « Le 7 septembre 2005, Jean Léonard Ruganbage, du journal indépendant Umuco, a été arrêté à la suite de l’enquête qu’il avait menée sur l’appareil judiciaire et le gacaca ». Les autorités rwandaises estiment que ces critiques sont déplacées en rappelant que l'aide qu'elles avaient demandée à la communauté internationale pour juger les génocidaires a été gaspillée dans la mise en place d'un Tribunal pénal international, qui fut sa réponse à la demande rwandaise et qui n'a achevé en 2007 qu'une trentaine de jugements.
an 2003 : Soudan - En 2003, la guerre civile éclate au Darfour, où le Mouvement de libération du Soudan (MLS ou SLM) et le Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE ou JEM) se posent en protecteurs des populations civiles face aux exactions des « janjawids » (expression arabe qui signifie les diables à cheval, milices soutenues par le gouvernement de Khartoum). L'année suivante, l’Union africaine (UA) envoie des troupes au Darfour pour veiller au respect d'un cessez-le-feu et assurer la protection des populations civiles.
an 2004-2008 : République de Botswana - En 2004, le Président Festus Mogae, réélu pour cinq ans, s'engage à améliorer l'économie du pays et à tenter d'enrayer l'épidémie de sida laquelle toucherait près de 25 % de la population du pays d'après l'Organisation mondiale de la santé. Il se voit décerner en 2008 le prix Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique pour avoir su faire bon usage des richesses du sous-sol du pays, notamment en diamants. Il laisse le pouvoir au vice-président, Ian Khama, fils de Seretse Khama, père de l'indépendance du Botswana et de son épouse britannique Ruth Williams. Celui-ci est confirmé comme président par des élections l'année suivante. Il reste au pouvoir, réélu démocratiquement, pendant dix ans et fait ses adieux 18 mois avant la fin de son deuxième mandat, en respectant ainsi la Constitution.
an 2004 : Algérie - De nouvelles élections sont organisées au mois d'avril, le principal concurrent du président sortant étant son ancien Premier ministre Ali Benflis. Abdelaziz Bouteflika est réélu avec un taux de 85 %. Son programme pour le deuxième mandat prévoit un plan quinquennal pour la relance de l'économie, au profit duquel il consacre une enveloppe financière de 150 milliards de dollars.
an 2004 : Congo Kinshasa - En mars 2004 échoue une tentative de coup d'état attribuée à d'anciens mobutistes.
En mai 2004, des militaires banyamulenge déclenchent une mutinerie à Bukavu, sous les ordres du général tutsi congolais Laurent Nkunda, et prennent Bukavu le 2 juin. Ces mutins abandonnent la ville le 9 juin sous la pression internationale. Les 3 et 4 juin, dans les grandes villes congolaises, sont organisées des manifestations anti-rwandaises par des étudiants, qui tournent à l'émeute anti-ONU au Kivu. Le 11 juin, des membres de la garde présidentielle tentent un coup d'état. Le RCD-Goma suspend sa participation au gouvernement; il reviendra sur sa décision le 1er septembre.
an 2004-2006 : Guinée - Fin avril 2004, le premier ministre François Louceny Fall profite d'un voyage à l'étranger pour démissionner, arguant que « le président bloque tout ». Le poste reste vacant plusieurs mois avant d'être confié à Cellou Dalein Diallo, qui sera démis de ses fonctions en avril 2006.
an 2004-2005 : Guinée-Bissau - Le pays entreprend alors à nouveau avec difficulté une phase de normalisation démocratique, culminant avec l'organisation d'élections législatives en 2004 et d'une élection présidentielle le 24 juillet 2005 qui voit le retour à la tête du pays de João Bernardo Vieira dit « Nino Vieira », l'ancien président déposé en 1999 par un coup d’État militaire qui s'était présenté en indépendant. Pour gouverner, Nino Vieira, fortement contesté au sein du PAIGC, conclut une alliance tactique avec son ennemi historique, le général Batista Tagme Na Waie, en nommant chef d'état-major10 ce personnage rustre et illettré qui voue une haine farouche à l'ancien président Vieira, qui l'aurait torturé et jeté sur une île prison à la suite de la tentative de coup d'État de novembre 1985.
an 2004-2005 : Malawi - Le mois de mai 2004 voit l’élection de Bingu wa Mutharika, du FDU, contre le candidat du PCM, John Tembo. Durant la campagne électorale, les médias contrôlés par l'Etat (radio et télévision) privilégient la communication de la coalition au pouvoir. Des observateurs de l'Union Européenne mettent également en exergue des « distributions manifestes et répandues d'argent aux électeurs » et « l'utilisation de fonds publics par le parti au pouvoir ». Quand il prend ses fonctions, le Malawi est en pleine crise alimentaire. Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime que le nombre de personnes vulnérables au Malawi s’élève à plus de 5 millions, et en octobre 2005, le président déclare le Malawi en état de crise. Tout en demandant de l’aide alimentaire, le président engage le pays, après cette année désastreuse,dans une « révolution verte ». En faisant de l’agriculture une priorité, en mettant l'accent sur l'irrigation, en subventionnant 1 700 000 fermiers pauvres, il permet au pays de sortir de la disette et de devenir exportateur de maïs.
Bingu wa Mutharika se représente pour un deuxième mandat à l'élection du 19 mai 2009, cette fois à la tête du Parti démocrate progressiste qu'il a fondé en 2005 après avoir quitté le Front uni démocratique, et est réélu. L’image du Malawi à l'étranger s’améliore grâce à cette politiques de développement et aux avancées en sécurité alimentaire, ainsi qu'aux actions pour combattre la mortalité infantile et maternelle et les maladies telles que le malaria, la tuberculose et le SIDA. Le Malawi ouvre de nouvelles ambassades en Chine, Inde et Brésil.
an 2004 : Namibie - En 2004, Sam Nujoma renonce à modifier la constitution une nouvelle fois pour obtenir un nouveau mandat.
Les élections générales de novembre 2004 sont remportées par la SWAPO, qui renforce son emprise à chaque échéance électorale.
Les élections des 15 et 16 novembre sont sans surprise avec la victoire écrasante de la SWAPO qui remporte 55 des 72 sièges du parlement.
an 2004 : Somalie - Le 10 octobre 2004, le Parlement fédéral de transition de la République de Somalie, exilé au Kenya en raison des affrontements entre seigneurs de la guerre à Mogadiscio, et formé en nombres égaux de représentants de chacun des quatre grands clans somalis, a élu en tant que président intérimaire Abdullahi Yusuf Ahmed, président du Pays de Pount. À la tête du Gouvernement fédéral de transition, celui-ci a nommé Ali Mohamed Gedi, un vétérinaire de profession, en tant que Premier ministre, avec pour mission de former un gouvernement de coalition avec les différents chefs de guerre du pays. Les institutions somaliennes siègent au Kenya par mesure de sécurité à l'égard de la situation intérieure de la Somalie. Les institutions en exil n'ont aucun contrôle sur le pays en dehors de certains quartiers de la capitale Mogadiscio, leur autorité n'est pas reconnue à l'intérieur du pays, mais uniquement par les gouvernements étrangers.
an 2004 - 2005 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 2004, le pays ne peut plus subvenir à ses besoins et 70 % de la population se retrouve sans emploi. Le Zimbabwe se retire du Commonwealth. Le pays est alors au bord de la famine, ce que chercherait à dissimuler le régime. Le pays apparait dans la liste du nouvel « axe du mal » rebaptisé « avant poste de la tyrannie » par Condoleezza Rice en 2005.
En 2005, le parti de Robert Mugabe, la ZANU, remporte les élections législatives sur fond de violence et de fraudes électorales face à un MDC divisé et affaibli. Entre 120 000 et 1 500 000 habitants des bidonvilles d'Harare, bastions de l'opposition, sont expulsés à la fin du printemps lors de la destruction de leurs habitations sur ordre du gouvernement ; c'est l'opération Murambatsvina. Adoption d'une réforme constitutionnelle restreignant les droits de propriété et permettant au gouvernement de priver n'importe qui de passeport pour des raisons « d'intérêt national ». Afin de gagner l'appui de la population, Mugabe persécute la minorité ndébélé[réf. nécessaire]. Nombre d'entre eux fuient en Afrique du Sud. On empêche les propriétaires de terres d'aller en appel au sujet de leur expropriation. Un Sénat de 66 membres est créé mais celui-ci est soupçonné d'être une simple chambre d'enregistrement au service du président Mugabe. L'inflation dépasse les 1 000 % en 2006, et les 100 000 % en 2007, alors qu'a lieu une purge au sein de l'armée. L'exode de la population vers les pays voisins s’accélère.
an 2005 : Burkina Faso -Blaise Compaoré est élu président de la République (taux d'abstention : 74 %). Il est réélu en 2005 et en 2010.
an 2005 : Burundi - Le CNDD-FDD, dirigé par Pierre Nkurunziza, s'impose dès lors comme l'un des principaux acteurs politiques, en obtenant la majorité absolue aux élections communales du 5 juin 2005 (1 781 sièges sur les 3 225 à pourvoir) avec 62,9 % des voix, contre 20,5 % pour le FRODEBU et seulement 5,3 % pour l'Uprona. Le CNDD-FDD, majoritairement hutu, dispose désormais de la majorité absolue dans 11 des 17 provinces du pays. Une victoire sans appel qui annonce la recomposition du paysage politique après douze années de guerre civile et met un terme au long tête-à-tête entre l'UPRONA et le FRODEBU. Mais le vote rappelle aussi que certains rebelles (PALIPEHUTU-FNL) n'ont pas encore déposé les armes (le jour du scrutin, 6 communes ont été la cible de violences). Ces opérations d'intimidation révèlent que la trêve conclue le 15 mai 2005 à Dar es Salaam avec les forces du PALIPEHUTU-FNL reste fragile.
Le CNDD-FDD remporte également les élections législatives du 4 juillet 2005 et les sénatoriales du 29 juillet. Nkurunziza est donc élu président le 19 août et investi le 26 août 2005.
an 2005 : République de Centrafrique - Une élection présidentielle a lieu, après plusieurs reports, le 13 mars 2005, sous la direction d'une Commission Électorale Mixte Indépendante (CIME), présidée par Jean Willybiro-Sako. On peut relever comme candidatures, celles de François Bozizé (déjà chef de l'État), l'ancien président André Kolingba, et l'ancien vice-président Abel Goumba. Les candidatures de plusieurs autres candidats, dont celles de Charles Massi du FODEM, de l'ancien premier ministre Martin Ziguélé, de l'ancien ministre et ancien maire de Bangui Olivier Gabirault et de Jean-Jacques Démafouth, sont refusées par la commission électorale avant la médiation gabonaise et les accords de Libreville. À la suite de ces accords, seule la candidature de l'ancien président Ange-Félix Patassé est définitivement rejetée par la commission élue.
L'accession à la présidence de Bozizé est violemment contestée et une première guerre civile centrafricaine ravage le pays entre 2004 et 2007, jusqu'à la signature d'un accord de paix.
an 2005 : Congo Kinshasa - En janvier 2005 des émeutes se déclenchent à Kinshasa lorsque la Commission électorale envisage publiquement un report de la date des élections, comme le lui permettent les textes. La MONUC déclenche une offensive militaire, médiatique et diplomatique contre les milices lendues et hemas, après la mort de neuf casques bleus banglashis, tués en Ituri par ces dernières. La Cour pénale internationale annonce ses premiers mandats d'arrêts pour 2005 dont un accusé en Ituri.
En mai, l'avant-projet de constitution est approuvé par le parlement. Fin juin, celui-ci décide de prolonger la transition de six mois. Un gouvernement de transition est établi jusqu'aux résultats de l'élection.
an 2005 : Afrique République de Djibouti - Ismaïl Omar Guelleh est réélu en 2005, puis, après une modification de la Constitution, en 2011, 2016 et 2021.
an 2005-2006 : Eswatini (Swaziland) - Le 26 juillet 2005, après 30 ans de suspension de la loi fondamentale, le roi ratifie une nouvelle constitution entrée en vigueur le 8 février 2006. Le pays demeure une monarchie absolue. Les partis politiques sont toujours interdits et ne sont en pratique perçus que comme des associations. La Cour suprême ne peut juger d'affaires pouvant impliquer le régime royal. Le pays est par ailleurs toujours totalement dépendant économiquement de l'Afrique du Sud.
an 2005 : Kenya - Un premier projet de nouvelle constitution est rejeté en 2005 par un référendum.
an 2005-2006 : Libéria - Après le départ de Charles Taylor, une transition politique débute par la tenue d'élections législatives et présidentielles. La campagne électorale se déroule sans incidents notoires, notamment grâce à la présence de 15 000 Casques bleus de l'UNMIL, présents dans le pays depuis d'octobre 2003. Deux courtes courtes présidences se succèdent, avec tout d'abord Moses Blah, ancien vice-président de Charles Taylor à qui celui-ci a transmis le flambeau lorsqu'il a démissionné : Moses Blah assure un intérim pendant quelques mois, le temps que des négociations, organisées à Accra entre les différentes parties, aboutissent. Gyude Bryant lui succède12. C'est un homme d’affaires. Mais il est aussi l’un des fondateurs, en 1984, du Liberia Action Party (LAP), dont il est devenu le président en 1992, deux ans après le début de la première guerre civile. Bryant n’a pas quitté son pays pendant les guerres civiles. Il a ensuite été un président de transition, pendant deux ans et quelques mois, avant les élections présidentielles prévues par la paix d'Accra, et organisées fin 2005.
Le 11 octobre 2005, les Libériens sont effectivement appelés aux urnes pour élire leur président, comme prévu dans l'Accord de paix d'Accra. Parmi les vingt-deux candidats, George Weah (un ancien footballeur reconverti dans la politique) et Ellen Johnson-Sirleaf (une économiste et ancienne responsable au sein de la Banque mondiale), sont les favoris dans les sondages.
Le 21 octobre, la Commission nationale électorale (NEC) annonce que George Weah a obtenu 28,3 % des voix, devançant Ellen Johnson-Sirleaf qui a obtenu 19,8 %. Ces derniers participent donc au second tour qui a eu lieu le 8 novembre. Les résultats définitifs de ce premier tour sont rendus public le 26 octobre, après l'examen des vingt réclamations concernant des fraudes éventuelles. Concernant les élections législatives, le Congrès pour le changement démocratique (CDC) de George Weah a obtenu 3 sièges sur 26 au Sénat et 15 sur 64 à la Chambre des représentants. Le Parti de l'unité d'Ellen Johnson-Sirleaf a obtenu 3 sièges au Sénat et 9 à la Chambre des représentants. Le taux de participation a été de 74,9 %.
Le 8 novembre a lieu le second tour de l'élection présidentielle. George Weah a réuni autour de lui plusieurs hommes politiques de poids, comme Winston Tubman (quatrième au premier tour), Varney Sherman (cinquième au premier tour) et Sekou Conneh (ancien chef de la rébellion du LURD (Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie)). Ellen Johnson-Sirleaf a comme soutien uniquement des hommes politiques de second plan, mais elle espère profiter d'un vote massif des femmes en sa faveur au moment de l'élection qui fasse d'elle la première femme démocratiquement élue président en Afrique. Le 23 novembre, la Commission électorale nationale (NEC) annonce les résultats définitifs qui déclarent vainqueur Ellen Johnson Sirleaf avec 59,4 % des votes, contre 40,6 % pour George Weah. Le nouveau président doit prêter serment le 16 janvier 2006.
an 2005 : Mauritanie - Le 3 août 2005, l'armée, au travers du Conseil militaire pour la justice et la démocratie (CMJD) présidé par le colonel Ely Ould Mohamed Vall, prend le pouvoir pour officiellement « mettre fin aux pratiques totalitaires du régime » du président Ould Taya. Le putsch se déroule alors que le président revient de Riyad où il a assisté la veille aux funérailles du roi Fahd d'Arabie Saoudite.
an 2005-2009 : Namibie - Le ministre des terres, Hifikepunye Pohamba, est imposé par Nujoma pour lui succéder à la présidence de la république en mars 2005. Nujoma reste toutefois à la présidence de la SWAPO jusqu'en 2007, date à laquelle Hifikepunye Pohamba lui succéda à la présidence du parti. Hifikepunye Pohamba a été réélu avec plus de 75 % des suffrages lors des élections de novembre 2009.
an 2005 : Ouganda - En août 2005, le Parlement (dominé par le NRM) vota une modification de la constitution qui, en enlevant la limite de deux mandats présidentiels, permit à Museveni de se représenter pour un troisième mandat. Kizza Besigye, revint d'exil en octobre 2005, et fut le principal opposant lors de l'élection de février 2006, remportée par Museveni avec 59,3 % des voix (au premier tour). Les résultats furent contestés par l'opposition du FDC (Forum for Democratic Changes, dirigé par Besigye).
an 2005 - 2015 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Après les élections de décembre 2005, Jakaya Kikwete devient le nouveau président de la République, le quatrième depuis la création de la Tanzanie. Il effectue les deux mandats que lui permettent la constitution. Le parti au pouvoir, le Chama cha Mapinduzi, choisit ensuite John Magufuli comme candidat à la succession pour les présidentielles de 2015. John Magufuli l'emporte et devient ainsi le cinquième président de la République de Tanzanie. Celui-ci acquiert une popularité, notamment grâce à sa lutte contre le gaspillage de l'argent public et contre la corruption, mais faitpreuve également de dérives autoritaires, contre ses opposants, contre les libertés individuelles, contre la presse, etc.
an 2005 : Togo - Le 5 février 2005, le président Étienne Eyadéma Gnassingbé, décède d'une crise cardiaque à 69 ans, après avoir présidé durant 38 ans le pays. Sa mort surprend autant la population du pays que le gouvernemen.
À la suite du décès de Gnassingbé Eyadema et profitant de l’absence au pays du président de l’Assemblée nationale qui, selon l’article 65 de la Constitution, doit assurer l’intérim de la présidence, l’armée togolaise prend la décision de confier le pouvoir au fils de Gnassingbé Eyadema, Faure Gnassingbé. L'Union africaine par la voix du président de la Commission Alpha Oumar Konaré dénonce un coup d’État militaire.
Le 25 février 2005, à la suite des pressions de la CEDEAO et de l’Union européenne, Faure Gnassingbé se retire et laisse la place au vice-président de l’Assemblée nationale togolaise, Abbas Bonfoh. Ce dernier assure l’intérim de la fonction présidentielle jusqu’à la tenue d'élections le 24 avril 2005. Quatre candidats se présentent : Faure Gnassingbé, soutenu par le Rassemblement du peuple togolais (RPT), Emmanuel Bob Akitani, candidat de la coalition de l’opposition radicale, Harry Olympio (en), candidat du Rassemblement pour le soutien à la démocratie et au développement (RSDD, opposition modérée) et Nicolas Lawson, homme d’affaires qui annonce le retrait de sa candidature le 22 avril 2005.
Le scrutin se déroule dans des conditions très controversées, l’opposition dénonçant des fraudes. Emmanuel Bob Akitani, chef de l’opposition, se déclare vainqueur avec 70 % des voix alors que le gouvernement déclare Faure Gnassingbé élu. Dès l’annonce des résultats, des manifestations émaillées de violences éclatent dans les principales villes. Elles seront violemment réprimées par les forces de l'ordre. Le gouvernement décide de mettre en place une commission nationale d'enquête qui estime le nombre de morts à des centaines, plus de 800 selon la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH). De nombreux Togolais, environ 40 000, se réfugient dans les pays voisins, le Bénin et le Ghana. Le 3 mai 2005, Faure Gnassingbé prête serment et déclare qu’il se concentrera sur « la promotion du développement, le bien commun, la paix et l’unité nationale ».
Le 8 juin 2005, Edem Kodjo, président de la Convergence patriotique panafricaine (CPP, opposition modérée), est nommé Premier ministre. Il est chargé de constituer un gouvernement d’union nationale.
Amnesty International publie en juillet 2005 un rapport dénonçant selon ses propres termes « un scrutin entaché d’irrégularités et de graves violences » tout en montrant que « les forces de sécurité togolaises aidées par des milices proches du parti au pouvoir (le Rassemblement du peuple togolais) s’en sont violemment prises à des opposants présumés ou à de simples citoyens en ayant recours à un usage systématique de la violence ». Le rapport reproche aussi à la France son rôle ambigu dans la situation actuelle15. Les violences consécutives aux événements politiques de 2005 auraient entraîné entre 400 et 500 morts.
an 2005 : Soudan - En 2005, un accord de paix est signé à Nairobi entre le gouvernement de Khartoum et l’APLS. Cet accord prévoit pour une période de six ans une large autonomie pour le Sud, qui disposera de son propre gouvernement et d'une armée autonome. À l’issue de cette période, un référendum d’autodétermination sera organisé. Les revenus issus du pétrole seront partagés en part égale entre le Sud et le Nord . D’autre part, le gouvernement aura 70 % des postes dans l’administration centrale contre 30 % pour la rébellion du Sud. Enfin, la charia ne sera appliquée que dans le Nord, à majorité musulmane. John Garang, le dirigeant de la rébellion contre le régime islamiste du général Omar el-Béchir, trouve la mort dans un accident d’hélicoptère, quelques semaines après sa nomination comme vice-président du Soudan pour pacifier la situation.
an 2006-2007 : Algérie - Les actions terroristes se poursuivent néanmoins dans plusieurs régions du pays : le quotidien L'Expression estime en 2006 qu'il y aurait de 600 à 900 membres de groupes terroristes encore en activité dans le maquis algérien, la majorité appartenant au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC). Ils se manifestent notamment par les attentats du 11 décembre 2007 à Alger (entre 30 et 72 victimes suivant les sources)
an 2006-2016 : Bénin (anc. Dahomey) - En mars 2006, Thomas Yayi Boni, ancien directeur de la Banque ouest-africaine de développement, est élu président du Bénin et de nouveau en mars 2011. Boni Yayi tente d'imposer, contre la volonté de sa famille politique, les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), un dauphin, le Franco-Béninois, Lionel Zinsou, un banquier d'affaires. Il est battu à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 par son ex-bras financier et allié, l'homme d'affaires Patrice Talon. Ce dernier accède au pouvoir le 6 avril 2016.
an 2006 : Burkina Faso - Avec l'arrestation de certains étudiants à la suite d'une conférence de presse à l'université de Ouagadougou, en 2007-2008 contre le coût élevé de la vie.
an 2006-2008 : Congo Kinshasa - Une constitution est approuvée par les électeurs, et le 30 juillet 2006, les premières élections multipartites du Congo depuis son indépendance (en 1960) se tiennent :
-
Joseph Kabila obtient 45 % des voix,
-
Son opposant, Jean-Pierre Bemba, 20 %.
Les résultats de l'élection sont contestés et cela se transforme en une lutte frontale, entre les partisans des deux partis, dans les rues de la capitale, Kinshasa, du 20 au 22 août 2006. Seize personnes sont tuées avant que la police et les troupes MONUC de l'ONU ne reprennent le contrôle de la ville.
Une nouvelle élection a lieu le 29 octobre 2006, et Kabila remporte 58 % des voix. Bien que tous les observateurs neutres se félicitent de ces élections, Bemba fait plusieurs déclarations publiques dénonçant des irrégularités dans les élections.
Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila prête serment comme président de la République et le gouvernement de transition prend fin. La fragilité du nouveau gouvernement a permis l'installation d'affrontements répétés et de violations des droits de l'homme.
Dans l'affrontement se déroulant dans la région du Kivu, les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) continuent de menacer la frontière rwandaise et les Banyarwandas ; le Rwanda soutient les rebelles du RCD-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie) contre Kinshasa; et une offensive rebelle ayant eu lieu fin octobre 2008 a causé une crise de réfugiés à Ituri, où les forces de MONUC se sont révélées incapables de maîtriser les nombreuses milices et groupes à l'origine du conflit d'Ituri.
Dans le Nord-Est, la LRA de Joseph Kony (LRA pour Lord's Resistance Army, l'Armée de résistance du Seigneur), s'est déplacée depuis sa base originelle en Ouganda (où elle a mené une rébellion pendant vingt ans) ou au Sud-Soudan, jusqu'en république démocratique du Congo, en 2005, et a établi des campements dans le parc national de Garamba.
Dans le Nord du Katanga, les Maï-Maï (anciennes milices créées par Laurent-Désiré Kabila pour lutter contre les milices rwandaises et ougandaises dans le Kivu, mais oubliées dans l'accord de Lusaka en 1999) ont échappé au contrôle de Kinshasa.
an 2006 : Gambie - En 2006 Jammeh est réélu pour un troisième mandat à 66 %. Une tentative de coup d’État a eu lieu en 2006 : l’ancien chef de l’armée est accusé.
an 2006 : Libéria - Au sujet de la formation de son gouvernement, Ellen Johnson Sirleaf a affirmé son intention de « former un gouvernement d'unité qui dépassera les lignes de fracture entre les partis, les ethnies, et les religions ». Avançant comme unique condition le fait de ne pas être corrompu, elle n'exclut pas la participation de George Weah au gouvernement, en déclarant : « Mais le pays ne va pas cesser de fonctionner s'il n'est pas dans le gouvernement. Nous allons avancer, avec ou sans lui ».
Ellen Johnson Sirleaf prête serment le 16 janvier en présence de nombreux personnages politiques, dont le perdant du second tour, George Weah. Au niveau international on peut noter la présence marquée pour l'aboutissement du processus de transition de la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, accompagnée de la première dame Laura Bush et de sa fille. Les officiels présents pour l'Afrique étaient le président Thabo Mbeki (Afrique du Sud), Abdoulaye Wade (Sénégal), Mamadou Tandja (Niger), John Kufuor (Ghana) et Ahmad Tejan Kabbah (Sierra Leone). La France était représentée par Brigitte Girardin, ministre délégué à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, la Chine par le ministre des Affaires étrangères Li Zhaoxing, la Guinée par le Premier ministre Cellou Dalein Diallo et la Côte d'Ivoire par Simone Gbagbo, épouse du président Laurent Gbagbo. Lors de son discours, elle a une fois de plus mis l'accent sur le fait que son gouvernement sera d'union nationale : « Mon gouvernement tendra la main de l'amitié et de la solidarité pour rallier tous les partis politiques [...] en tournant le dos à nos différences » et que la lutte contre la corruption sera l'une de ses priorités. Elle remplace donc officiellement Gyude Bryant. Concernant le Parlement, les deux nouveaux présidents de chacune des chambres ont également prêté serment ce même jour. Il s'agit d'Isaac Nyenabo pour le Sénat et d'Edwin Snowe pour l'Assemblée nationale.
an 2006 - 2007 : Madagascar - Après avoir lancé la reconstruction de routes et d'une partie des infrastructures du pays, Marc Ravalomanana est réélu lors de l'élection du 3 décembre 2006 en gagnant au premier tour avec la majorité absolue devant 13 autres prétendants, et est investi de nouveau président de la République de Madagascar pour un nouveau mandat de 5 ans.
Il appelle de nouveau les Malgaches aux urnes pour le 4 avril 2007 pour un référendum qui a pour objet principal la suppression des six « provinces autonomes » et l'instauration des « régions » au nombre de 22.
an 2006-2009 : Mali - Troisième rébellion touarègue.
an 2006 : Mozambique - En 2006, le pays compte 19 millions de Mozambicains dont un tiers vivant dans les villes, conséquence d'une urbanisation rapide intervenue au cours de l’interminable guerre civile.
S’il demeure l’un des pays les plus pauvres du monde, où l’espérance de vie est d’à peine 41 ans, le Mozambique connaît depuis 1995 une croissance annuelle exceptionnelle qui atteint 9 % en 2005. La Banque mondiale cite ainsi le Mozambique comme « un modèle de réussite. Une réussite en termes de croissance, et un modèle qui montre aux autres pays comment tirer le meilleur parti de l’aide internationale », même si la pauvreté reste omniprésente, plus de la moitié des habitants vivant encore en dessous du seuil de pauvreté.
an 2006 : Somalie - Depuis le 26 février 2006, le gouvernement de transition siège à Baidoa, en Somalie.
Au début du mois de juin 2006, les affrontements entre les membres de l'Alliance pour la restauration de la paix et contre le terrorisme (ARPCT), une alliance entre des chefs de guerre et le gouvernement fédéral de transition, soutenu par Washington, et l'Union des tribunaux islamiques, soutenus par de nombreux entrepreneurs de la capitale, ont vu la victoire de ces derniers pour le contrôle de Mogadiscio. Le nouveau régime serait soutenu par l'Érythrée, l'Iran et divers pays arabes, tandis que le gouvernement fédéral de transition, replié sur Baidoa, bénéficierait de l'appui militaire de l'Éthiopie. Le rétablissement de l'ordre se fait au nom de la seule structure législative stable et consensuelle du pays, la jurisprudence chaféite.
Le 13 juin 2006 à Nairobi, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui regroupe le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée et le gouvernement de transition de Somalie, décide d'interdire l'accès au territoire de ses pays membres aux miliciens de l'ARPCT fuyant devant l'avancée des tribunaux islamiques dont le plus important, celui de Mogadiscio, est nommé Hifka-Halane. Il sert de pouvoir judiciaire (civil et pénal), en jugeant les affaires en appliquant la charia.
Début décembre 2006, les Nations unies autorisent le déploiement d'une force de maintien de la paix, composée de 8 000 hommes, sous l'égide de l'Union africaine24 (résolution 1725). Fin décembre 2006, l'armée éthiopienne intervient et les tribunaux islamiques fuient Mogadiscio. Elle prend ainsi le contrôle de la majeure partie du pays et le gouvernement de transition se déclare le gouvernement de facto du pays.
Du 20 au 31 décembre 2006, l'Éthiopie est entrée en guerre contre l'Union des tribunaux islamiques. La loi martiale a été décrétée le 30 décembre 2006 par le premier ministre somalien du gouvernement fédéral de transition, Ali Mohamed Gedi, et un délai de trois jours a été donné aux Somaliens pour remettre leurs armes à feu aux troupes éthiopiennes ou fédérales, avec un suivi très faible.
an 2006 : Soudan - En 2006, le gouvernement de Khartoum rejette le déploiement de « Casques bleus » au Darfour. Mais il accepte finalement l'année suivante le déploiement au Darfour d’une « force hybride » associant l’ONU et l’Union africaine (la MINUAD).
an 2006-2010 : Tchad - Alors que le président Déby fait modifier la constitution pour supprimer la limite de deux mandats présidentiels, une guerre civile éclate, contestant cette mainmise sur le pouvoir. Le président réussit à se maintenir au pouvoir et à être réélu, lors d'élections contestées boycottées par l'opposition. Entre 2006 et 2008, les forces d'opposition rebelles tentent plusieurs fois de prendre la capitale par la force, mais échouent systématiquement.
Le 13 avril 2006, des combats éclatent entre les troupes du président de la République et une faction de la rébellion, le Front uni pour le Changement (FUC), dans la périphérie de N'Djaména. Idriss Déby Itno accuse le Soudan, en pleine guerre du Darfour, de soutenir ses adversaires, à l’aube des élections présidentielles.
Malgré l’opposition et les appels au boycott, le 3 mai 2006, Idriss Déby Itno est réélu au suffrage universel avec 64,67 % des votes exprimés.
Le 2 février 2008, les rebelles, en provenance du Soudan frontalier, s’emparent de la capitale du Tchad, N'Djaména, à l'exception du palais présidentiel où le président Idriss Déby Itno semble s'être cloîtré. La France décide d’évacuer une partie de ses ressortissants. Le 4 février 2008, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques contre le gouvernement tchadien, dont l’armée rencontre des difficultés à repousser les rebelles. La France, via l’opération Épervier, apporte alors une aide logistique qui permet d’assurer la stabilité régionale au Tchad.
Mais les rebelles mènent une guerre de mouvement dans l’Est du Tchad, afin de faire tomber le gouvernement au pouvoir. Les attaques répétées ont pour conséquence de provoquer en juin 2008 un combat opposant pour la première fois la mission militaire européenne EUFOR et les rebelles au sud d’Abéché, autour de la ville de Goz Beïda. En novembre 2008, dans l’Est du pays, deux véhicules militaires belges sont brûlés, à la suite de tirs provenant d’hélicoptères soudanais.
En mai 2009 a lieu une autre offensive de la rébellion partant du Soudan, toujours dans l'objectif de renverser Idriss Déby. Le contingent militaire français de l'opération Épervier est suppléé, entre 2007 et 2009, par la force d'interposition EUFOR, forte de 3 000 soldats, mandatée par l'Union européenne à la demande de la France, en principe neutre mais qui assure un soutien de fait au régime du président Déby.
Finalement, en 2010, le président soudanais Omar el-Bechir se rend au Tchad pour normaliser les relations entre les deux pays. Le gouvernement du Tchad refuse d’arrêter ce dernier, pourtant visé par des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale émis à son encontre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour.
an 2007-2008 : Burkina Faso - contre le coût élevé de la vie. En juin 2008, l'université de Ouagadougou connaît une grève massive, qui se solde par une reprise en main brutale de l'université par le pouvoir : suppression de toutes les prestations sociales étudiantes (bourses, restauration, résidences universitaires vidées en deux jours) après tirs à balles réelles sur les étudiants.
an 2007 : Afrique Côte d'Ivoire - Appliqué avec beaucoup de difficultés, l’accord de Linas-Marcoussis est suivi par plusieurs autres, conclus en Afrique et mis en œuvre par les gouvernements successifs de Seydou Diarra, Charles Konan Banny.
L’accord politique de Ouagadougou conclu en 2007 avec Laurent Gbagbo, sous l’égide du président burkinabé Blaise Compaoré, qui fait office de facilitateur, offre aux Forces nouvelles le poste de Premier ministre. Les Forces nouvelles désignent leur secrétaire général, Guillaume Soro, le 26 mars 2007 pour exercer cette fonction.
Guillaume Soro entre en fonction le 4 avril et son gouvernement est installé trois jours plus tard. Le gouvernement doit mettre en place notamment deux points clefs de l'accord politique de Ouagadougou : la préparation d'élections devant se tenir dans les dix mois à compter de mars 2007, puis l'unification des Forces armées des Forces nouvelles (FAFN) et des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire (FANCI).
Dans le gouvernement Soro I composé de 33 membres, la formation militaro-politique de celui-ci (les Forces nouvelles de Côte d'Ivoire) et le Front populaire ivoirien (FPI), formation politique dont est issu le président Laurent Gbagbo, disposent chacun de huit portefeuilles (le Premier ministre y compris). Les autres portefeuilles sont répartis entre divers autres partis politiques. Ainsi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) en détient 5, le Rassemblement des républicains (RDR) 5, le Mouvement des forces d'Avenir (MFA) un, le Parti ivoirien des travailleurs (PIT) un, l’Union démocratique de Côte d'Ivoire (UDCI) un et l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) un ; deux autres ministres sont réputés proches du Président de la République et un ministre est issu de la société civile.
Concrètement, outre la gestion des affaires relevant de ses compétences traditionnelles, le gouvernement coordonne la mise en œuvre du processus de sortie de crise au moyen de programmes spécifiques. Il s’agit d’un dispositif technique comprenant notamment le Centre de commandement intégré (désarmement des combattants), le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire, le Comité national de pilotage du redéploiement de l'Administration (restauration de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire et reprise du fonctionnement des services publics), l’Office national d'identification (identification des populations et des électeurs) et la Commission électorale indépendante (organisation des élections).
an 2007 : Guinée - Le pouvoir du président, sous influence d'hommes d'affaires comme Mamadou Sylla, est de plus en plus contesté. Début 2007 éclate une grève générale réprimée dans le sang.
an 2007 : Kenya - Lors de l'élection présidentielle du 27 décembre 2007, Raila Odinga reçoit un soutien massif dans les provinces de Nyanza, occidentale, de la vallée du Rift et de la côte mais aussi de personnalités emblématiques telle Wangari Maathai. Dans la soirée du 30 décembre 2007, Samuel Kivuitu (en), qui vient juste d'être reconduit, pour cinq ans, par Kibaki à son poste de président de la commission électorale (Electoral Commission of Kenya), déclare Raila Odinga battu par 232 000 voix de différence en faveur du président sortant contrairement aux tendances des derniers résultats enregistrés. Controversée par les observateurs de l'Union européenne qui demande un recomptage des bulletins de vote, cette annonce est immédiatement contestée par le camp de Raila et entraine la plus grande crise de violence survenue au Kenya.
an 2007 : Mali - Le 29 avril 2007, Amadou Toumani Touré est réélu au premier tour avec 71,20 % des voix, mais cette élection est contestée par les principaux candidats de l’opposition. Les relations commerciales, politiques et culturelles avec la France se ralentissent tandis que celles avec la Chine, la péninsule arabique et les États-Unis se renforcent.
an 2007-2008 : Mauritanie - Le 25 mars 2007, Sidi Ould Cheikh Abdallahi est le premier civil à être élu président de le République démocratiquement, le colonel Ely Ould Mohamed Vall, conformément à ses engagements, ne s’étant pas présenté. En avril 2007 la Mauritanie réintègre l’Union Africaine, dont elle avait été exclue après le coup d’État de 2005. Pour la première fois, des membres du parti islamique modéré rejoignent le gouvernement en mai 2008.
Esclavage :
La société mauritanienne reste dominée par la caste des Beydanes, qui a historiquement fondé son pouvoir sur l'esclavage des castes inférieures.
L’esclavage reste courant en Mauritanie, le président de l’IRA (Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste) Biram Dah Abeid considère la Mauritanie comme un régime « d’apartheid non écrit ». Certains parmi la minorité Maures (arabo-berbère) y exploitent des Haratines dans les quartiers riches des grandes villes. Selon le rapport de l’ONG Walk Free publié en 2014 environ 4% de la population mauritanienne, soit 150 000 personnes vit en situation d’esclavage. La Mauritanie est le pays le plus touché au monde par ce phénomène. Selon Biram Abeid, la réalité se rapproche plus des 20% de la population.
L'esclavage a été officiellement aboli à quatre reprises (la dernière fois en 1980, avec un succès mitigé) mais les ségrégations raciales, tribales ou de castes y subsistent. En 2007 a été votée une loi criminalisant l'esclavage, et des actions sont prévues par le gouvernement pour lutter contre ses séquelles, car l'ethnie haratine des anciens esclaves reste parmi la plus défavorisée. Selon le Global Slavery Index, l'esclavage concerne 4 % de la population mauritanienne.
an 2007-2010 : Nigéria - En 2007 des élections une nouvelle fois agitées amènent au pouvoir le successeur désigné d'Olusegun Obasanjo : Umaru Yar'Adua, qui décède le 5 mai 2010. Son vice-président Goodluck Jonathan lui succède alors.
an 2007-2009 : Rwanda - La veille de la commémoration du 7 avril 2007, l'ancien Président de la République, Pasteur Bizimungu, est gracié par le Président Paul Kagame. Cette incarcération était vivement contestée par des ONG qui y voyaient un prétexte pour écarter un éventuel rival politique. Pasteur Bizimungu avait en effet symbolisé une réconciliation possible entre Tutsi et Hutu après le génocide.
La peine de mort est abolie au Rwanda en milieu d'année 2007. Cette abolition était demandée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda afin que, dans le cadre de la cessation de ses activités, prévue dans ses statuts en 2008 et 2010 pour la cour d'appel, il puisse transférer des détenus et des dossiers de présumés génocidaires au Rwanda.
Le président du Parti Vert rwandais, Frank Habineza, fait également état de menaces. En octobre 2009, une réunion du Parti des Verts rwandais est violemment interrompue par la police Quelques semaines seulement avant les élections, le 14 juillet 2009, André Kagwa Rwisereka, le vice-président du Parti vert démocratique, est retrouvé mort, à Butare, au sud du Rwanda. Le climat interne est marqué par des meurtres ou des arrestations de journalistes toujours selon Amnesty International.
L'analyse publique des politiques et pratiques du gouvernement est limitée au sein du pays par les limites de la liberté de la presse. En juin 2009, le journaliste du journal Umuvugizi Jean-Leonard Rugambage est abattu devant son domicile à Kigali. En juillet 2009, Agnes Nkusi Uwimana, rédactrice en chef du journal Umurabyo, est accusée d'« idéologie du génocide" ».
an 2007: Sénégal - Abdoulaye Wade est facilement réélu lors de l’élection présidentielle de 2007, et malgré le mot d’ordre de boycott de l’opposition lors des élections législatives consécutives, il dispose d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale et au Sénat, rétabli en début d’année. Le Président mène une politique libérale ouvertement revendiquée qui donne certains résultats. En effet le Sénégal devient une terre d’élection pour les investisseurs d’Europe, mais aussi des émirats du Golfe – c’est le cas de Dubaï Ports World qui enlève l’exploitation du port de Dakar –, du Brésil, de Chine, d’Iran ou d’Inde – par exemple avec le géant mondial de la sidérurgie, Arcelor Mittal. Abdoulaye Wade appelle également à la création d’États-Unis d’Afrique et de grands travaux d’infrastructures ont été lancés en vue du 11e sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) qui s’est tenu à Dakar en mars 2008.
Mais la politique gouvernementale essuie aussi des revers, comme l’inexorable recul du secteur agricole (arachide, coton…), l’effondrement de l’industrie chimique en 2006, le développement insuffisant du secteur tertiaire ou l’engorgement persistant de la capitale.
Le pays reste très dépendant de l’aide extérieure, notamment des subsides envoyés par l’importante diaspora sénégalaise. Le ralentissement de la crois sance et un taux de chômage élevé poussent bien des jeunes Sénégalais à l’émigration, parfois au péril de leur vie. L’augmentation du coût de la vie, notamment liée à la hausse des cours du pétrole, suscite des manifestations de rue en novembre 2007.
Beaucoup dénoncent aussi une dérive autoritaire du pouvoir, – guère tempérée par un Premier ministre généralement présenté avant tout comme un technocrate, Cheikh Hadjibou Soumaré , et qui laisse une marge de manœuvre réduite à l’opposition, ainsi qu’aux médias, pour la plupart solidaires de l’action présidentielle.
La question de la future succession d’Abdoulaye Wade, réélu à 80 ans, apparaît en filigrane dans le débat politique actuel, alimenté notamment par les spéculations sur les intentions de son fils Karim Wade.
an 2007 : Somalie - En janvier 2007, les États-Unis interviennent dans le sud de la Somalie pour pourchasser des membres présumés d'Al-Qaïda.
Le 23 janvier 2007, les troupes éthiopiennes commencent officiellement à se retirer de Somalie. Peu fréquent auparavant, les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du 29 octobre 2008 sont attribués au groupe al-Shabaab)
an 2008 : Afrique du Sud - En 2008, une grave pénurie d'électricité achève le bilan économique du président, à qui la presse reproche l'imprévoyance de son gouvernement, ainsi qu'à celui de Nelson Mandela, pour avoir refusé, en 1996, d'investir dans la construction de nouvelles centrales électriques alors que le pays connait une croissance de la demande en électricité de 10 % chaque année. Les grandes villes sont, pendant plusieurs semaines, périodiquement plongées pendant quelques heures dans l'obscurité alors que le gouvernement est contraint de promouvoir le rationnement, de renoncer à certains grands projets créateurs d'emplois et de suspendre ses exportations d'électricité vers les pays voisins. En mai, le gouvernement est confronté à une vague de violences contre les immigrés, caractérisée notamment par des meurtres, des pillages et des lynchages.
Mis en cause indirectement pour des « interférences » politiques dans des affaires judiciaires impliquant son ancien vice-président, Thabo Mbeki est contraint de démissionner de la présidence sud-africaine le 21 septembre 2008 après avoir été désavoué par son parti.
L'ANC nomme alors le vice-président du parti, Kgalema Motlanthe, pour lui succéder. Cela s'accompagne d'un schisme au sein de l'ANC et la création du Congrès du Peuple (COPE) par les partisans de l'ancien président.
an 2008 : République de Botswana - Le nouveau président est le lieutenant-général Ian Khama qui entre en fonction 2008, en prévision des élections de 2009. Il est le fils du premier président du Botswana, et un ancien chef de l'armée du Botswana (BDF). Élu formellement en 2009 et réélu en 2014, il demeure en fonction jusqu'en 2018, date à laquelle il démissionne pour laisser la place au vice-président Mokgweetsi Masisi qui lui succède.
an 2008 : Cameroun - En février 2008, des émeutes éclatent, réclamant la baisse des prix et le départ de Paul Biya. Les manifestants sont sévèrement réprimés : une centaine de morts, des milliers d’arrestations.
Le projet de Paul Biya de modifier la Constitution en février 2008 donne lieu à des manifestations brutalement réprimées ; une centaine de personnes sont tuées.
an 2008 : Cap Vert - Le 23 juillet 2008, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) accueille le Cap-Vert qui devient le 153e pays membre. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux principaux partis, le Mouvement pour la démocratie (MPD), et le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV, l'ancien parti unique), qui se succèdent au pouvoir, et quelquefois y cohabitent (avec un président de l'un et un premier ministre de l'autre). L'archipel souffre par contre du réchauffement climatique et de sécheresses, d'autant plus que l'eau douce y est rare. Les gouvernements ont opté pour une politique de développement des énergies renouvelables, ainsi que de l'écotourisme.
an 2008 : Afrique République de Djibouti - La frontière reste donc inchangée, l'île est indivise entre les deux pays. Douméra est le prétexte de l'affrontement entre les forces érythréennes et djiboutiennes de juin 2008.
an 2008-2009 : Afrique République de Djibouti - Le 10 juin 2008 éclate la guerre djibouto-érythréenne qui a opposé l'Érythrée à Djibouti autour du cap (ras) Douméra. Djibouti accuse Asmara d'avoir financé le mouvement armé anti-gouvernemental du Front pour la restauration de l’unité et la démocratie entre 1991 à 1994. L'Érythrée revendique la zone du cap Douméra, point littoral de la frontière entre les deux pays. En janvier 2009, par la résolution 1862 du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil de sécurité des Nations unies impose des sanctions contre l'Érythrée.
an 2008-2018 : Érythrée - Enfin, un différend territorial oppose par ailleurs l'Érythrée à Djibouti sur sa frontière sud depuis 2008 qui vaut à l'Érythrée des sanctions des Nations unies, sanctions levées le 14 novembre 2018. Le Conseil a ainsi adopté à l'unanimité cette résolution élaborée par la Grande-Bretagne et levé l'embargo sur les armes, toutes les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et autres sanctions.
an 2008-2012 : Ghana - Le président Kufuor quitte le pouvoir en 2008, respectant comme son prédécesseur, la limite du nombre de mandat possible. La décision du Nouveau Parti Patriotique est de choisir Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le fils de Edward Akufo-Addo comme leur candidat, tandis que le Congrès National Démocratique choisit John Atta Mills pour la troisième fois.
Le 28 décembre 2008, au terme d'une élection présidentielle très disputée et unanimement saluée pour son caractère démocratique, le candidat du Congrès démocratique national (Ghana), John Atta Mills, devient le nouveau président du pays. La passation de pouvoir s'est déroulée le 7 janvier 2009. John Atta Mills bénéficie ensuite de l'exploitation de forages pétroliers qui créent une dynamique nouvelle. La gestion de cette manne, qui soulève de grands espoirs dans la population, se veut basée sur un modèle norvégien avec « une industrie pétrolière où le sens de l’équité et de la justice doivent être reproduits localement pour le bénéfice de tous les Ghanéens »
Le 24 juillet 2012, le président meurt. Le pouvoir est transmis au vice-président, John Dramani Mahama, et des élections sont convoquées18. Il choisit le Gouverneur de la Banque du Ghana, Amissah Arthur, comme nouveau vice-président. Il est confirmé à son poste par le scrutin de décembre 201220. Son mandat est perturbé par une croissance en berne et des scandales de corruption et il perd l'élection présidentielle de 2016 face au chef de l'opposition Nana Akufo-Addo.
Industrialisation, opération séduction des investisseurs étrangers, lutte contre le paludisme, les initiatives s'enchaînent. Réputé pour sa stabilité politique, son fonctionnement démocratique et son dynamisme, le pays accueille Melania Trump après Barack Obama, mais aussi Angela Merkel ou encore Emmanuel Macron.
an 2008-2009 : Guinée - Le 22 décembre 2008, Lansana Conté décède des suites d'une longue maladie (leucémie et diabète aigu) à l'âge de 74 ans. Au cours de la nuit suivante, les proches du régime s'affairent pour organiser l'intérim suivant les procédures prévues par la Constitution mais le 23 décembre 2008 au matin, à la suite de l'annonce du décès de Lansana Conté, des dignitaires de l'armée annoncent unilatéralement la dissolution du gouvernement ainsi que la suspension de la Constitution, dans un discours à teneur résolument sociale. Ces événements laissent planer le doute sur l'effectivité d'un nouveau coup d'État. Le même jour, le capitaine Moussa Dadis Camara est porté à la tête du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et devient le lendemain, le troisième président de la République de Guinée.
an 2008 : Kenya - Fin février 2008, grâce à la médiation de Kofi Annan, l'ancien Secrétaire général des Nations unies, un accord de partage du pouvoir entre le président Kibaki et Raila est signé et entériné à l'unanimité par le Parlement le 18 mars pour résoudre la crise. Il se matérialise par la nomination de Raila Odinga au poste de Premier ministre le 13 avril suivant. Quatre jours plus tard, il prête serment et un gouvernement de coalition est constitué.
an 2008 : Libéria - L'ancien président Charles Taylor est jugé pour l'armement et le soutien aux rebelles de Sierra Leone depuis le 7 janvier 2008 à La Haye. Il plaide non coupable.
an 2008 : Mauritanie - Le 6 août 2008, à la suite du limogeage d'officiers supérieurs, les militaires conduits par le chef du bataillon chargé de la sécurité présidentielle, le général Mohamed Ould Abdelaziz, déposent le président Abdallahi. Il est assigné à résidence durant 4 mois et demi. Les principaux partis d’opposition, à l'exception du RFD d’Ahmed Ould Daddah se réunissent en un Front national pour la défense de la démocratie (FNDD) et s'opposent au coup d’État.
an 2008 : Somalie - les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du 29 octobre 2008 sont attribués au groupe al-Shabaab)
Le 29 décembre 2008, le président Abdullahi Yusuf Ahmed annonce sa démission, déclarant qu'il regrette n'avoir pas pu mettre fin au conflit somalien. Le Parlement, réuni à Djibouti en raison du désordre en Somalie, élit alors le cheikh Sharif Ahmed, ancien dirigeant de l'Union des tribunaux islamiques, à la présidence de la République. Il l'emporta face à Maslah Mohamed Siad Barre, fils de l'ancien président Mohamed Siad Barre, et au Premier ministre sortant Nur Hassan Hussei.
an 2008 - 2010 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 2008, les élections présidentielle et législatives du 29 mars constituent un revers pour la ZANU. Le MDC remporte la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale (109 élus contre 97 élus à la ZANU). Publiés le 2 mai, le résultat de l’élection présidentielle est contesté. En obtenant officiellement près de 48 % des suffrages en dépit des fraudes, Morgan Tsvangirai devance néanmoins Robert Mugabe (43 %). Lors de la campagne du second tour, le pays est le théâtre de violences politiques continues marquées par des exactions commises par la police contre des membres de l'opposition et leur famille mais aussi par l’arrestation de ses principaux chefs31. Dans ce climat de terreur, Morgan Tsvangirai décide à cinq jours du second tour de l’élection présidentielle de boycotter celle-ci, permettant ainsi à Robert Mugabe d’être réélu. L’inflation dépassant les 10 millions de % en rythme annuel, l'édition de billets de 100 milliards de dollars zimbabwéens (environ 3 EUR fin juillet 2008) devient nécessaire. La population est contrainte de revenir à une économie de troc et à la marche à pied : il n'y a plus de gazole pour faire rouler les bus.
De plus, à partir du mois d'août, une épidémie de choléra sévit dans le pays ; elle fait, selon l'OMS, 2 971 morts, pour 56 123 personnes contaminées (chiffres officiels au 27 janvier 2009). Toujours d'après l'OMS, jusqu'à la moitié des 12 millions de Zimbabwéens sont susceptibles de contracter la maladie en raison de l'insalubrité des conditions de vie dans le pays. En 2009, sous la pression de l'ONU quant aux fraudes concernant l'élection présidentielle, Robert Mugabe décide de partager le pouvoir avec son opposant et rival personnel Morgan Tsvangirai, chef du Mouvement pour le changement démocratique (MDC). En avril 2010, Mugabe reçoit le président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, avec lequel il conclut huit accords commerciaux entre les deux pays. Cette visite n'est pas bien perçue par l'opposition et par le reste du monde.
an 2009-2010 : Afrique du Sud - En mai 2009, Jacob Zuma est élu président de la république après la victoire de l'ANC (65,90 %), lors des élections générales, face notamment à l'alliance démocratique (16,66 %) d'Helen Zille, qui remporte la province du Cap occidental, et face au Congrès du Peuple (7,42 %) de Mosiuoa Lekota. Il hérite d'un pays toujours considéré comme le poumon économique de l'Afrique subsaharienne (40 % du PIB de l'Afrique subsaharienne) mais où le crime, sans distinction raciale, est omniprésent, faisant de ce pays l'un des plus dangereux du monde au côté de l'Irak et de la Colombie, où l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'est accentué, où la politique de discrimination positive est contestée pour son inefficacité et où les tentatives de réforme agraire n'ont débouché que sur des échecs. Le nouveau gouvernement qu'il forme est alors plus ouvert aux autres partis et autres races que ne l'était celui de Mbeki. Il fait notamment entrer au gouvernement Jeremy Cronin, un Blanc par ailleurs secrétaire général adjoint du parti communiste sud-africain et Pieter Mulder, chef du front de la liberté, le parti de la droite afrikaner qui a succédé à l'ancien parti conservateur.
En 2010, quinze ans après avoir organisé avec succès la coupe du monde de rugby, marquée par la victoire de l'équipe nationale, les Springboks, l'Afrique du Sud est le pays hôte de la coupe du monde de football. Deux mois avant l'évènement sportif, le 3 avril 2010, l'assassinat, dans sa ferme, d'Eugène Terre'Blanche par deux de ses ouvriers agricoles fait craindre un moment un réveil des tensions raciales dans une Afrique du Sud toujours minée par ces conflits latents. Le très influent leader de la Jeunesse de l'ANC, Julius Malema, connu pour ses outrances verbales à l'encontre de Thabo Mbeki et des opposants à Zuma, pour qui il se déclarait prêt à tuer, est mis en cause pour avoir repris dans ses discours une chanson prônant de « tuer les Boers » parce que « ce sont des violeurs ». Dans les campagnes sud-africaines, le modèle zimbabwéen reposant sur la carte raciale et la carte de la terre a beaucoup de partisans. L'épisode du meurtre de Terre'Blanche souligne ce malaise en zone rurale où plus de 2 500 fermiers blancs ont été tués en une dizaine d'années, souvent dans d'atroces conditions et le fait que des ouvriers agricoles noirs sont souvent mal payés et maltraités par leurs employeurs.
an 2009 : Algérie - Pendant les mois de mars et d'avril de l'année 2009, la campagne électorale pour la présidentielle se déclenche à la suite d'un nouvel amendement constitutionnel. Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014.
an 2009-2011 : Afrique - les Comores - Il est organisé le 29 mars 2009 et 95,2 % des votants acceptent le changement de statut, faisant de Mayotte le 5e département d'outre-mer (DOM) et le 101e département français en 2011.
Mayotte fait partie des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Elle devrait devenir une région ultrapériphérique de l'Union européenne au moment de sa départementalisation. Le pays souverain formé par les trois îles s'appelle aujourd'hui Union des Comores.
an 2009 : Congo Brazzaville - Denis Sassou-Nguesso est de nouveau réélu président du Congo, avec 78,61 % des voix à l'issue du vote du 12 juillet.
an 2009-2016 : Gabon - Le 3 septembre 2009, Ali Bongo, ministre de la Défense et fils d'Omar Bongo Ondimba, devient le troisième président du Gabon, élu à l'occasion d'un scrutin majoritaire à un tour, avec 41,79 % des suffrages exprimés, soit environ 141 000 voix sur un total de 800 000 électeurs inscrits. Il devance Pierre Mamboundou, crédité de 25,64 % des voix, et André Mba Obame, le nouveau chef de l'opposition gabonaise et ancien ministre de l'Intérieur. Les résultats sont fortement contestés et à la suite des forts soupçons de fraude, des émeutes éclatent et sont violemment réprimées par les forces de l'ordre, fidèles au pouvoir.
Par la suite, plusieurs enquêtes attestèrent que les scores avaient été truqués. Dans un documentaire diffusé sur France 2 en décembre 2010, le diplomate Michel de Bonnecorse, ex-conseiller Afrique du président Jacques Chirac, confirmera cette version des faits. L’ambassadeur américain Charles Rivkin, dans un télégramme transmis en novembre 2009 à la secrétaire d’État, le confirme également : « octobre 2009, Ali Bongo inverse le décompte des voix et se déclare président » (le télégramme sera divulgué par WikiLeaks en février 2011).
Depuis, le président Bongo prône le concept de « Gabon émergent », politique visant notamment à la diversification de l'économie afin de diminuer sa dépendance aux cours mondiaux du pétrole.
an 2009 Guinée - Le 28 septembre 2009, des mouvements civils organisent une manifestation pacifique pour demander à Dadis Camara de respecter sa parole et de ne pas se présenter aux présidentielles. Une foule de plusieurs milliers de personnes s'était rendu au stade à la demande de l'opposition pour protester contre le désir du président Dadis de se porter candidat à l'élection présidentielle. Le 28 septembre 2009, au stade de Conakry, à la surprise générale les militaires ouvrent le feu sur les manifestants ainsi bloqués dans le stade sans possibilité de fuite. Ce massacre délibéré et manifestement planifié fait plusieurs centaines de morts. De plus, les militaires violent et enlèvent plusieurs dizaines de jeunes femmes, dont certaines seront libérées quelques jours plus tard après avoir subi des viols à répétition, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de trace.
À la suite du tollé international soulevé par cet évènement, des dissensions apparaissent au sein du CNDD34 et le 3 décembre 2009, alors que Sékouba Konaté est en voyage au Liban, le président est grièvement blessé par son aide de camp Aboubacar Sidiki Diakité - ce dernier avait été mis en cause explicitement par des diplomates étrangers pour son rôle dans le massacre du 28 septembre, et craignait d'être « lâché » par son président et livré à la justice. Dadis Camara est hospitalisé au Maroc le 4, et Sékouba Konaté rentre au pays pour assurer l'intérim.
an 2009 : Guinée-Bissau - le 1er mars 2009, le chef d'état-major des forces armées, le général Batista Tagme Na Waie, est tué dans un attentat à la bombe. Le président João Bernardo Vieira, que certains militaires tiennent pour responsable de cet attentat dans la mesure où il entretenait des relations historiquement exécrables avec ce dernier, est assassiné à son tour, le 2 mars 2009, par des hommes en armes. Pour lui succéder, Malam Bacai Sanhá, candidat du PAIGC, est élu président le 26 juillet 2009.
Parallèlement, la Guinée-Bissau est gangrenée par le trafic de drogue et qualifiée à ce titre de « narco-État » par l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime. Ainsi, les attentats contre le chef d'état-major Tagmé Na Waié et le président Vieira ont probablement été fomentés par les trafiquants colombiens, peut-être en représailles de la destitution en août 2008 du contre-amiral José Américo Bubo Na Tchuto, chef de la marine nationale, qui couvrait le trafic avec Antonio Indjai. Ce dernier, après bien des péripéties, tombera d'ailleurs en mars 2013 dans un piège tendu par la DEA et envoyé aux États-Unis pour y être jugé pour trafic de drogue tandis qu'Antonio Indjai est depuis lors inculpé par la justice américaine et sous mandat d'arrêt international.
Le mandat de Malam Bacaï Sanha est émaillé de graves incidents en lien avec le narcotrafic. Le 1er avril 2010, une tentative de coup d'État menée par Antonio Indjai et l'ancien contre-amiral José Américo Bubo Na Tchuto aboutit à l'arrestation du Premier ministre Carlos Gomes Júnior et d'une quarantaine d'officiers dont le chef d'état-major de l'armée, José Zamora Induta, dans un coup de force présenté comme « un problème purement militaire ». À la suite de manifestations de soutien au Premier ministre, Antonio Indjai menace de tuer ce dernier avant d'expliquer dans une allocution que l'armée « réitérait son attachement et sa soumission au pouvoir politique ». Le Premier ministre est relâché le lendemain tandis qu'Indjai se présente comme le nouvel homme fort de l'armée. Ce dernier est relâché le lendemain, mais demeure en résidence surveillée, tandis qu'Antonio Indjai devient le nouvel homme fort de l'armée.
an 2009 : Libéria - Constatant une certaine stabilité politique, la Banque européenne d'investissement accorde le 15 mai 2009 un prêt de 3,5 millions d'euros au Liberia pour le soutien de la micro finance dans ce pays ainsi que la suspension des remboursements de l'encours du solde de la dette jusqu'en 2012. Mais la corruption continue de gangrener le système politique, malgré les intentions initialement affichées.
an 2009 : Madagascar - À partir de janvier 2009, une crise politique entre le maire de la capitale Andry Rajoelina et le président Marc Ravalomanana fait une centaine de victimes. Le 16 mars 2009, le président Marc Ravalomanana démissionne. Il transfère les pleins pouvoirs à un Directoire militaire composé des plus hauts gradés de l'Armée malgache, en lieu et place du président du Sénat comme le prévoyait la constitution, lequel directoire (re)transfère le jour même le pouvoir à Andry Rajoelina. Cette prise de pouvoir, validée par la Haute Cour Constitutionnelle malgache (HCC), est toutefois considérée par une grande partie de la Communauté internationale comme un coup d'État. Du 17 mars 2009 au 25 janvier 2014, Andry Rajoelina dirige l’État malgache sous le régime de la Transition.
an 2009 : Mauritanie - En avril 2009, Mohamed Ould Abdel Aziz abandonne le pouvoir afin de se présenter à l'élection présidentielle promise par la junte. Un accord pour préparer les futures élections est signé à Dakar entre les représentants de l’opposition et de la junte.
Le 18 juillet, Mohamed Ould Abdelaziz, qui durant sa campagne se présente comme le « président des pauvres », est élu au premier tour face à 8 autres candidats, avec 52,58% des voix. Ses opposants dénoncent un « coup d’État électoral » et fondent une Coordination de l’opposition démocratique, qui inclut le RFD.
L'arrivée du président actuel Mohamed Ould Abdel Aziz, le 18 juin 2009, fut marquée notamment par la coupure de ces relations diplomatiques avec Israël.
an 2009 : Mozambique - Le 28 octobre 2009, Armando Guebuza est réélu président pour un deuxième mandat, dès le premier tour de scrutin avec 75 % des voix
an 2009 : Ouganda - Des tensions apparaissent également avec le Kabaka (roi) du Buganda et dégénèrent en affrontements en 2009.
Dans un mouvement de populisme, une loi anti-homosexualité fut proposée en 2009 prévoyant jusqu'à la peine de mort pour les homosexuels et pénalisant les individus, entreprises, médias et ONG soutenant les droits des LGBT.
an 2009 : Sénégal - Lors des élections locales du 22 mars 2009, le PDS, parti au pouvoir, essuie un sérieux revers dans la plupart des grandes villes dont Dakar convoité par Karim Wade, au profit de la coalition d’opposition Bennoo Siggil Senegaal.
Après la démission de Cheikh Hadjibou Soumaré le 30 avril 2009, Souleymane Ndéné Ndiaye est nommé Premier ministre.
Septembre 2009 : des pluies torrentielles provoquent de violentes inondations dans le pays.
an 2009 : Somalie - Dès février 2009, divers groupes islamistes fusionnèrent au sein du Hizbul Islam et déclarèrent la guerre au gouvernement modéré de Sharif Ahmed. Cette coalition inclut l'Alliance pour la nouvelle libération de la Somalie, dirigée par Hassan Dahir Aweys, l'un des chefs radicaux de l'Union des tribunaux islamiques, Hassan Abdullah Hersi al-Turki, un autre commandant de l'Union des tribunaux islamiques et leader des brigades de Ras Kamboni et le groupe Muaskar Anole. Cette nouvelle coalition islamiste est, avec le groupe al-Shabaab, la plus active dans le conflit. De plus, en mars 2009, ben Laden appelait dans un enregistrement au renversement de Sharif Ahmed.
an 2009 : Soudan - En 2009, la Cour pénale internationale (CPI) lance un mandat d’arrêt contre le président soudanais Omar el-Béchir 4 mars 2009 pour crimes contre l’humanité (l’année suivante, l’accusation de génocide sera rajoutée).
an 2010 : Burkina Faso -Blaise Compaoré est réélu en 2010.
an 2010 : Burundi - Après cinq années, l'érosion du pouvoir conduit à un certain agacement au sein des autres groupes Hutus. Lorsque le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) de Pierre Nkurunziza obtient une majorité des 2/3 aux élections communales du 26 mai 2010, les partis Hutus signataires des accords d'Arusha dénoncent immédiatement des fraudes massives. L'ONU et l'Union européenne, qui supervisent le scrutin, assurent ne pas avoir observé de graves irrégularités.
Peu après, une émeute éclate dans un faubourg de Bujumbura : les manifestants ont découvert une urne remplie de bulletins non-décachetés dans un quartier acquis aux Hutus anti-Nkurunziza ; il y a plusieurs blessés. Le 2 juin, des dirigeants de l'opposition Hutu sont arrêtés, tandis que Ban Ki-moon arrive au Burundi pour appeler à la poursuite du processus électoral. Il ne rencontre que le président, ce qui est vécu par les opposants comme une trahison de la communauté internationale.
Le lendemain, les partis Hutu d'opposition (FNL, etc.) décident le boycott total de l'élection présidentielle du 28 juin. Le 5 juin, l'ancien président Domitien Ndayizeye décide de rejoindre la contestation. Le 7 juin, le gouvernement interdit toute campagne pour l'abstention, ce qui radicalise la divergence.
L'opposition burundaise refuse de participer à l'élection présidentielle du 28 juin 2010 et dénonce des fraudes lors des élections municipales de mai (le CNDD-FDD a remporté les municipales avec 64 % des voix et le déroulement de l'élection est jugé correct en regard des standards internationaux par les observateurs de l'Union européenne). La campagne est émaillée d'incidents, plusieurs membres de l'opposition sont arrêtés. Pierre Nkurunziza a été réélu président en 2010 avec plus de 91 % des voix, étant le seul candidat de l'élection. Les candidats de l’opposition s’étaient retirés pour protester contre les irrégularités du scrutin.
an 2010 : Congo Kinshasa - Depuis novembre 2010, l'ancienne mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUC qui n'était pas parvenue à désarmer les milices rwandaises, est renforcée militairement pour intervenir dans l'est du pays et devient la MONUSCO, mais plusieurs dissidences et révoltes persistent et de nombreuses violences continuent.
an 2010 : Afrique Côte d'Ivoire - À l'issue d'une élection présidentielle sous tension, les deux candidats arrivés au second tour, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, se déclarent vainqueurs et prêtent serment comme président du pays. Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur par Youssouf Bakayoko, le président de la Commission électorale indépendante, au siège du camp de Ouattara contrairement aux dispositions de ladite CEI, et a reçu le soutien du Premier ministre Guillaume Soro et d'une partie de la Communauté internationale. Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel et a reçu le soutien du général Philippe Mangou, commandant de l'armée. La Côte d'Ivoire se retrouve alors avec deux présidents tentant de s'imposer sur l'ensemble du pays.
Mais Alassane Ouattara bénéficie du soutien de la plus grande partie de la communauté internationale, ainsi que celui d'instances économiques et financières tant régionales qu'internationales. L'économie ivoirienne est paralysée par les sanctions et les finances de l'État ivoirien asséchées, notamment les zones encore contrôlées par Laurent Gbagbo.
an 2010 : Guinée - Arrivé au pouvoir, le capitaine précise que le nouveau régime est provisoire et qu'aucun membre de la junte ne se présentera aux élections présidentielles prévues en 2010.
Au fil de ses interventions médiatiques, Moussa Dadis Camara envisage de plus en plus explicitement de se présenter, décevant les espoirs de véritable transition démocratique et déclenchant des mouvements de protestation.
Le 12 janvier 2010, Moussa Dadis Camara est renvoyé vers le Burkina Faso par le Maroc pour y continuer sa convalescence. C'est ainsi que le 15 janvier, un accord sera trouvé entre Dadis et Sékouba pour que ce dernier soit reconnu Président de la transition. Cet accord stipule qu'un premier ministre issu des Forces Vives (Partis d'opposition, syndicats, société civile) soit nommé dans le but de former un gouvernement d'Union nationale et de conduire le pays vers des élections libres et transparentes dans les six mois. Aussi, aucun membre du gouvernement d'union nationale, de la junte, du Conseil national de la transition et des Forces de Défense et de Sécurité n'aura le droit de se porter candidat aux prochaines échéances électorales.
Le 16 janvier, Dadis, dans une allocution à partir du palais présidentiel burkinabé, dit que la question de sa candidature est définitivement réglée, ainsi que celle des autres membres de la junte. Jean-Marie Doré, doyen de l'opposition, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement d'union nationale chargé d'organiser les futures élections présidentielles.
Le 8 février 2010, la justice guinéenne ouvre un instruction judiciaire pour les crimes commis le 28 septembre 2009 à Conakry, trois magistrats instructeurs sont nommés et le 3 juin 2010, la FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen (OGDH), trois autres organisations guinéennes de victimes (AVIPA, AFADIS, AGORA) et 67 victimes se constituent parties civiles.
Le 7 mars 2010, Sékouba Konaté fixe par décret la date du premier tour de l'élection présidentielle au 27 juin 2010. Il tient parole et pour la première fois une élection présidentielle en Guinée se déroule sans qu'aucun militaire ne soit candidat. Le second tour des élections présidentielles devait se tenir le 19 septembre 2010 mais a été reporté à une date ultérieure.
Le 28 septembre 2010, un an après le massacre, les victimes et les ONG de défense des droits de l'homme demandent le jugement des auteurs présumés des faits.
Le 7 novembre 2010, Alpha Condé (candidat du RPG et de l'Alliance Arc-En-Ciel) obtient 52,5 % des suffrages face à son adversaire Cellou Dalein Diallo (candidat de l'UFDG et de l'Alliance des bâtisseurs), qui a fini par accepter les résultats de la cour suprême qu'il avait initialement contestés en raison de soupçons d'irrégularités. Le président Alpha Condé est élu pour un mandat de 5 ans.
an 2010 : Kenya - Le 4 août 2010, le texte de réforme de la Constitution, incluant la Charte des droits et libertés16, chère à Raila — et maintenant soutenu par Kibaki — est accepté, contre la position d'un autre membre influent de l'ODM, le ministre des Hautes études William Ruto — soutenu, lui, par l'ex-président Moi —, par la majorité des 72,1 % de Kényans ayant participé au référendum populaire (70 % de votes favorables contre 30 % de défavorables).
La cérémonie publique de promulgation par le président Mwai Kibaki de cette Constitution moderne16 le 27 août 2010 est entachée par la présence du président soudanais Omar el-Béchir alors qu'il est notifié d'un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Cette invitation, directement adressée par le président Kibaki suscite l'émotion et la réprobation des Kényans, de leur Premier ministre et des parlementaires. Les protestations de la Communauté internationale et en particulier celles du président américain Barack Obama — bien que les États-Unis n'aie pas ratifié le statut de Rome — et de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan sont rapides.
an 2010 : Leshoto - En 2010, peu avant la Coupe du monde de football, des milliers d’habitants ont demandé au gouvernement sud-africain l'annexion du pays pour en faire la dixième province d'Afrique du Sud. Fin mai, plusieurs centaines de personnes ont défilé dans la capitale, Maseru, et remis au Parlement et à l'ambassade d'Afrique du Sud une pétition demandant le rattachement. Plus de 30 000 signatures ont été recueillis et les raisons sont multiples : une situation économique extrêmement précaire, un taux de sida très élevé (400 000 personnes en sont atteints), une espérance de vie très basse (34 ans) et l'effondrement de l'industrie textile, ce qui rend la survie du pays extrêmement difficile, d'autant plus qu'il est totalement encerclé par l'Afrique du Sud et qu'il y a plus de Sothos vivant en Afrique du Sud qu'au Lesotho lui-même.
an 2010-2012 : Malawi - Mutharika remplace Muammar al-Gaddafi à la tête de l’Union africaine, devenant le premier chef d’état malawite à exercer la charge de secrétaire général de cette organisation. En 2011, le Malawi établit des relations diplomatiques avec 10 pays. Mais le second mandat de Mutharika est vite marqué par une dégradation brusque de l'économie, une dégradation des conditions de vie et des pénuries d'essence dues à un manque de confiance des bailleurs de fonds. Des émeutes éclatent, et le régime se durcit, s'appuyant sur l'armée. Finalement, le président Bingu wa Mutharika est victime d'un arrêt cardiaque le 5 avril 2012.
an 2010-2013 : Mali - En septembre 2010, sept étrangers, dont cinq Français, sont enlevés par Al-Qaida au Maghreb islamique. Treize mois plus tard, des Touareg maliens, ex-mercenaires en Libye, reviennent dans la partie nord du Mali : le contrôle de cette partie du pays semble échapper de plus en plus au pouvoir en place à Bamako entre les interventions de Al-Qaida au Maghreb islamique et ces forces Touaregs. Le 22 mars 2012, le capitaine Amadou Haya Sanogo dirige un coup d’État militaire. Quelques mois plus tard, soumis également à une pression internationale, il rend le pouvoir à des autorités civiles, pour une période de transition, avec comme président par intérim Dioncounda Traoré. Celui-ci organise une élection présidentielle qui se tient les 28 juillet et 11 août 2013 et s'achève par la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta auquel Dioncounda Traoré transmet le pouvoir le 4 septembre suivant.
Pendant ce temps, durant cette même année 2012, profitant des bouleversements politiques successifs à Bamako, les événements s'accélèrent dans le nord du pays et dans le Sahel, au centre du pays. De mars à septembre 2012, les villes de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti tombent aux mains des islamistes qui se rapprochent des régions du sud. Le 23 septembre 2012, Le Mali et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) s'accordent sur le déploiement d'une force africaine. Le 21 décembre 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies autorise par une résolution le déploiement d'une force africaine au Mali. Le 11 janvier 2013, les troupes françaises interviennent en appui de cette force africaine, c'est le début de l'opération Serval.
an 2010 : Mauritanie - La Mauritanie a suspendu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009 avant de "rompre complètement et définitivement les relations avec Israël" le 21 mars 2010. Ces relations avaient été établies en 1999 par le président de la République à l'époque, Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya.
Sous le président Abdel Aziz, la Mauritanie s’est érigée en garante de la lutte contre la menace terroriste, tout en adoptant des lois qui définissent les infractions terroristes en termes vagues. La loi antiterroriste adoptée en 2010 a ainsi permis aux autorités de museler plusieurs opposants politiques, comme Abdallahi Salem Ould Yali, activiste issu de la communauté «haratine», descendants d’esclaves, qui a été poursuivi pour incitation au fanatisme ethnique ou racial pour avoir diffusé des messages dénonçant la discrimination dont est victime son groupe ethnique dans un groupe de discussion WhatsApp, ou encore, en 2015, le colonel de la Garde nationale à la retraite Oumar Ould Beibacar, qui dénonçait les exécutions sommaires de ses co-officiers en 1992 dans une purge d’officiers noirs de l’armée mauritanienne.
an 2010 : Rwanda - En 2010, les opposants ont une marge de manœuvre très réduite. Ainsi, par exemple, l'opposante Victoire Ingabire, présidente des FDU-Inkingi (Forces démocratiques unies) est arrêtée pour négation du génocide, lorsqu'elle exprime la nécessité de réconciliation. Une loi de 2008 punit de dix à vingt-cinq ans de prison « l'idéologie du génocide », avec une formulation « rédigée en termes vagues et ambigus », selon Amnesty International, qui y voit un moyen de « museler de manière abusive la liberté d'expression ».
À l'approche de l'élection présidentielle rwandaise de 2010, deux autres rédacteurs en chef de journaux sont contraints de quitter le Rwanda. Les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis, la France et l'Espagne expriment publiquement leurs préoccupations. Paul Kagame est réélu à cette élection présidentielle, avec plus de 93 % des suffrages exprimés.
an 2010 : Sénégal - Février 2010 : un projet de loi déclarant l’esclavage “crime contre l’humanité” est exposé par le chef de l’Etat.
Abdoulaye Wade annonce également la fermeture de la base militaire française à Dakar.
an 2010 : Togo - En 2010 est organisée une élection présidentielle, où le président Faure Gnassingbé est réélu avec 61 % des voix. Gilchrist Olympio, candidat naturel de l'UFC, a été remplacé au dernier moment par Jean-Pierre Fabre.
Des heurts ont lieu en protestation à cette élection entre militants de la coalition et forces de l'ordre. Les élections ont été dénoncées par l'Union européenne, finançant les élections, qui au travers de ses observateurs a constaté des irrégularités dans la campagne électorale.
an 2010 - 2011 : Tunisie - En décembre 2010, la situation économique et sociale est très difficile. Le chômage, en particulier celui des jeunes diplômés, est très important. Le suicide d'un jeune commerçant empêché par la police de pratiquer son commerce déclenche un vaste mouvement de protestations. Des manifestations répétées, qui s'appuient sur les réseaux sociaux permis par l'internet, parviennent le 14 janvier 2011 à chasser du pouvoir le président Ben Ali. C'est la révolution tunisienne de 2010-2011, qui a lieu en même temps que d'autres mouvements dans des pays arabes : le Printemps arabe.
an 2011 : Burkina Faso - La révolte de 2011 secoue le pays en même temps que le Printemps arabe.
an 2011 : Cap Vert - Depuis 2011, le président est le dirigeant du MPD Jorge Carlos Fonseca.
En raison de sa stabilité politique et de la régularité des élections, le Cap-Vert est considéré comme l'un des pays africains les plus démocratiques.
an 2011 : Afrique Côte d'Ivoire - Les combats éclatent à Abidjan à la fin du mois de février 2011 entre le « Commando invisible » hostile à Gbagbo et l'armée régulière. Puis, début mars, la tension gagne l'ouest du pays, où les Forces nouvelles prennent le contrôle de nouveaux territoires. L'ensemble du front finit par s'embraser à la fin mars, et les forces pro-Ouattara, rebaptisées Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), prennent Yamoussoukro, la capitale politique du pays, le 30 mars. À partir de ce moment-là, les événements s'accélèrent : le sud du pays est conquis en quelques heures et les troupes pro-Ouattara entrent dans Abidjan sans rencontrer de réelle résistance (mais non sans commettre de nombreuses exactions sur les populations civiles).
Laurent Gbagbo et son épouse se retranchent à la Résidence présidentielle, protégés par un dernier carré de fidèles dont la Garde Républicaine dirigé par le colonel Dogbo Blé Bruno. La Résidence est assiégée par les forces pro-Ouattara qui ont du mal à accéder à la Résidence malgré plusieurs tentatives. Un assaut final est lancé contre le domicile le 11 avril avec l'appui des forces onusiennes et surtout de l'armée française (en application de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU). Laurent Gbagbo (accompagné de sa famille) est fait prisonnier, puis placé en état d'arrestation à l'hôtel du Golf. Il est ensuite transféré à Korhogo dans le nord du pays, où il est placé en résidence surveillée. Quelques jours plus tard, son épouse, qui n'a pas été autorisée à le suivre, sera placée quant à elle en résidence surveillée à Odienné, une autre localité du nord ivoirien. Depuis le 30 novembre 2011, Laurent Gbagbo est incarcéré à la Cour pénale internationale où il est inculpé pour quatre chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Les forces pro-Ouattara sont soupçonnées de s'être livrées à des exactions sur des populations supportant Laurent Gbagbo (massacre du camp de Nahibly et Duekoué). Dans le cas de Duekoué, l'ONU explique que les forces pro-Gbagbo seraient aussi impliquées.
an 2011 : Afrique République de Djibouti - Au début de 2011, des manifestations inspirées par le Printemps arabe sont réprimées.
an 2011 : Gambie - En 2011, Jammeh est réélu à 72 % des suffrages. Il déclare être « prêt à diriger le pays un milliard d’années ». Son opposant Darboe qualifie le scrutin de « frauduleux et grotesque ». La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest estime elle aussi que les élec Le gouvernement de Jammeh devient de plus en plus policier, il ignore les ONG et la Commission Africaine des droits de l’homme. Sont dénoncés par ces derniers le traitement discriminatoire des homosexuels, l’usage de la torture et la violence des services de renseignement, surnommés les « Jungelers ».
an 2011 : Kenya - Faisant suite à l'enlèvement d'une touriste britannique et à l'assassinat de son mari le 11 septembre 2011, à l'enlèvement d'une résidente franco-kényane le 1er octobre et enfin, le 13 octobre, à l’enlèvement de deux volontaires humanitaires espagnoles ainsi qu'à l'assassinat de leur chauffeur kényan, des unités militaires des forces armées kényanes entrent en Somalie le 16 octobre à la poursuite des miliciens d'Al-Shabaab. Cependant, Alfred Mutua, le porte-parole du gouvernement déclare, le 26 octobre, que l'opération militaire était planifiée depuis longtemps et que les enlèvements n'ont été qu'une aire de lancement (« the kidnappings were more of a good launchpad. »). Cette « invasion » donne lieu à des représailles de la part d'Al-Shabaab (cf. section détaillée : « Attentats »).
2011-2013 : Égypte - Hosni Moubarak est Président de la République jusqu'en février 2011, date de sa démission contrainte à la suite de la Révolution égyptienne de 2011. Hosni Moubarak poursuit la politique de libéralisation de l’économie, notamment par la réduction des subventions à l'agriculture et à la consommation, et par la libéralisation des prix. En 1992, il fait annuler les dispositions régissant la location des terres. Généralement appelée « loi pour chasser les paysans de leurs terres », cette loi, combinée aux autres mesures de désengagement de l’État dans l’économie, accroît le mécontentement des populations rurales pauvres en particulier en Haute-Égypte. Hosni Moubarak devient un pilier de la stratégie régionale des États-Unis et la Constitution qu'il met en place reconnait les « principes de la charia » comme source principale de la législation.
En janvier et février 2011, une série de manifestations d'ampleur inégalée se déroulent à travers le pays et mènent à la démission d'Hosni Moubarak le 11 février. Les nouvelles élections législatives et présidentielle sont remportées par le Parti de la liberté et de la justice, le bras politique des Frères musulmans.
Le pouvoir n'est cependant resté que peu de temps entre leurs mains car d'importantes manifestations contre le président élu, Mohamed Morsi, critiquant des dérives dictatoriales, et le retournement de l'armée contre celui-ci le destitue en faveur d'un gouvernement transitoire un an seulement après son élection. L'Égypte connait depuis une période de troubles causée par l'instabilité et les tensions politiques, notamment entre les opposants à l'ex-président et ceux qui continuent à le soutenir et n'acceptent pas ce qu'ils voient comme un coup d'État illégal.
an 2011-2018 : Éthiopie - En 2011, une crise alimentaire touche une grande partie de la Corne de l'Afrique. Dans la nuit du 20 au 21 août 2012, Meles Zenawi décède en pleine fonction après 21 ans au pouvoir. Conformément à la Constitution (article 73), Haile Mariam Dessalegn est désigné comme Premier ministre par la Chambre des représentants des peuples. Les Oromos, ethnie majoritaire avec plus du tiers de la population, entrent en rébellion en novembre 2015. Les Amharas, un quart de la population, font de même en août 2016. L'état d'urgence est décrété le
9 octobre 2016. Haile Mariam Dessalegn démissionne en février 2018 à la surprise générale. Le 2 avril 2018, Abiy Ahmed lui succède. Cet homme politique de longue date est populaire parmi les Oromos dont il est issu. Dès son discours d’investiture, il tend la main à l’Érythrée, en appelant à mettre fin à un conflit qui dure depuis l’indépendance du pays, en 1993. Il qualifie également les partis d’opposition de frères et non d’ennemis. La situation intérieure et les relations avec les pays voisins s’apaisent.
an 2011 : Libéria - Ellen Johnson Sirleaf remporte à nouveau l’élection présidentielle de 2011. Le taux de participation aux votes est faible, 37,4 %
an 2011 : Libye - La guerre civile de 2011
En 2011, dans le contexte du « Printemps arabe », le mécontentement populaire contre le régime de Kadhafi s'affirme désormais ouvertement. La violente répression des manifestations dans le pays, durant laquelle la troupe tire à l'arme lourde sur la population, débouche en février sur une véritable guerre civile. L'Est du pays échappe bientôt au contrôle de Kadhafi, et un gouvernement provisoire, le Conseil national de transition (CNT), est formé à Benghazi. Mais les troupes de Kadhafi contre-attaquent rapidement, et reprennent progressivement le contrôle du pays. Alors que Benghazi est directement menacée, le Conseil de sécurité des Nations unies vote la résolution 1973, autorisant en mars une intervention militaire internationale qui fournit aux rebelles un appui aérien et leur évite d'être écrasés. Au bout de six mois de conflit, les forces du CNT prennent Tripoli le 23 août. Kadhafi, ayant quitté la capitale, est mis à prix et visé par un mandat d'arrêt international. Le 16 septembre, le CNT est reconnu comme gouvernement de la Libye par l'Assemblée générale des Nations unies. À l'automne 2011, les partisans de Kadhafi tiennent encore plusieurs bastions, principalement Syrte et Bani Walid.
Le 20 octobre 2011, Syrte est la dernière ville kadhafiste à tomber aux mains des forces du Conseil national de transition. Mouhammar Kadhafi est capturé et tué le jour même.
La « libération » du pays est officiellement proclamée le 23 octobre; le même jour, le président du CNT, Moustafa Abdel Jalil, annonce que la future législation de la Libye serait fondée sur la charia. Cette déclaration ayant suscité l'inquiétude des gouvernements occidentaux, il déclare vouloir « assurer à la communauté internationale que nous, les Libyens, sommes des musulmans modérés ». Un référendum est annoncé pour approuver la future constitution. Le 22 novembre, un nouveau gouvernement, dirigé par Abdel Rahim al-Kib, est mis en place41. Kadhafi ayant laissé derrière lui un vide politique, et un pays dépourvu d'institutions réelles, d'armée structurée, et de traditions démocratiques, la Libye apparaît bientôt comme un pays très instable, en proie au désordre et à la violence.
an 2011 : Mauritanie - Durant deux mois, entre le 24 septembre et le 28 novembre 2011, le collectif "Touche pas à ma nationalité" organise plusieurs manifestations pour protester contre le recensement national.
an 2011-2021 : Ouganda - Museveni se fit réélire à nouveau en 2011 et 2016, nouveaux scrutins présidentiels après ceux de 1996, 2001, et 2006, chaque fois au premier tour, et avec des soupçons de fraude. Il fit procéder aussi à un nouveau changement de constitution fin 2017,pour supprimer la limite d'âge de 75 ans s'appliquant aux candidats à cette élection présidentielle et à lui en tout premier lieu. Il instaura également une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux et fin août 2018, fit arrêter et battre un député d'opposition, Robert Kyagulanyi Ssentamu (en), connu également comme ex-chanteur sous le nom de Bobi Wine. Libéré, celui-ci se fit soigner aux États-Unis avant de revenir en Ouganda en septembre 2018 et d'être à nouveau inculpé. Constituant l'un des leaders de l'opposition ougandaise, Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine, affrontera le président sortant Yoweri Museveni, qui est au pouvoir depuis 1986, lors des élections présidentielles qui se tient le 14 janvier 2021, Yoweri Museveni est réélu.
an 2011 : Sénégal - Février 2011 : Dakar rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran, accusé d’avoir livré des armes aux rebelles indépendantistes de Casamance, où la recrudescence de la violence depuis fin décembre 2010 a causé la mort d’au moins seize soldats sénégalais.
Juin 2011 : face à la fronde de la rue, Abdoulaye Wade renonce à une réforme constitutionnelle qui prévoyait de faire élire un ticket présidentiel, au premier tour, avec 25% seulement des suffrages exprimés. On le soupçonnait de vouloir assurer sa réélection et de préparer la succession pour son fils Karim.
an 2011 : Seychelles - L'élection présidentielle de mai 2011 voit la réélection du président Michel qui remporte 55,4 % des suffrages exprimés, contre 41,4 % à Wavel Ramkalawan. Il se présente une troisième et dernière fois à l'élection présidentielle de 2015, remportant le scrutin avec 50,15 % des suffrages exprimés contre 49,85 % à son adversaire, Wavel Ramkalawan. Mais il est contraint d'attendre le second tour de l'élection, alors qu'il avait été élu dès le premier tour aux élections précédentes.
an 2011-2017 : Somalie - En octobre 2011, l'armée kényane, appuyée par les troupes somaliennes, intervient dans le conflit, lançant l'opération Linda Nchi (« protéger le pays » en swahili) contre les positions d'Al-Shabaab.
Les relations entre la Somalie et la Turquie (en) contribuent à la relative stabilisation du pays. La Turquie, qui fournit une aide humanitaire et économique importante depuis 2011, ouvre une base militaire à Mogadiscio en septembre 2017
an 2011 : Soudan - En 2011, le Sud du Soudan accède à son indépendance sous le nom de Soudan du Sud. Mais en 2012, Le conflit au Kordofan du Sud s'envenime.
an 2011 : Tchad - Jusqu'en 2011, le Tchad alimentait un flux migratoire important vers la Libye : on estime qu'au moins 500 000 Tchadiens vivaient dans ce pays en 2006. Les échanges transsahariens assuraient une relative prospérité à des villes frontalières comme Abéché. Cependant, depuis la première guerre civile libyenne en 2011, l'instabilité de ce pays rend ces échanges aléatoires ; la frontière entre la Libye et le Tchad est devenue une zone de non-droit dominée par les contrebandiers et les groupes armés.
an 2011 : Tunisie - Après la révolution et l'élection de l'Assemblée constituante, celle-ci vote une loi constituante le 10 décembre 2011 ; le nouveau texte indique dans son article 9 que le candidat à la présidence doit être musulman, de nationalité tunisienne uniquement, issu de parents tunisiens et âgé d'au moins 35 ans ; il doit démissionner, une fois élu, de toute responsabilité à l'Assemblée constituante et au sein de son parti.
an 2011 - 2014 : Zambie - À la suite de la dégradation de l'état de santé de Mwanawasa, le vice-président Rupiah Banda assure l'intérim. Après la mort du président en août 2008, Banda est élu quatrième président du pays et le reste jusqu'en septembre 2011. Le chef de l'opposition Michael Sata lui succède, et devient le cinquième président de la Zambie. Il décède à son tour, à la suite d'une maladie à Londres le 28 octobre 2014.
an 2012 : Afrique du Sud - Le massacre de Marikana en 2012, où la police tire sur des salariés grévistes faisant des dizaines de morts, entache la gouvernance de l'ANC au sein de son électorat mais lors des élections générales sud-africaines de 2014.
an 2012-2013 : République de Centrafrique - En décembre 2012, le pays est à nouveau dans une situation insurrectionnelle. Une coalition rebelle prenant le nom de Séléka (Alliance en langue sango) s'est constituée contre le régime de Bozizé. Réunissant au moins trois mouvements préexistants, cette coalition, qui dispose de troupes bien armées et disciplinées, a pris le contrôle de la ville diamantifère de Bria le 18 décembre, avant de progresser rapidement vers la capitale. Le président Bozizé espéra un temps obtenir un soutien militaire de la France ou des États-Unis, mais ces deux pays choisissent de ne pas intervenir.
Les rebelles dénoncent la non-tenue des accords par le président Bozizé, et reprennent les armes fin 2012, lançant une série d'attaques démarrant la deuxième guerre civile centrafricaine. Le 24 mars 2013, les rebelles de la coalition Seleka s'emparent de Bangui et Bozizé s'enfuit. Michel Djotodia s’auto-proclame président de la République centrafricaine. Mais les nombreuses exactions commises par les miliciens de la Seleka, majoritairement musulmans, amènent l'insécurité dans le pays, et des milices d'auto-défense, les anti-balaka se forment. Le conflit débouche sur une situation « pré-génocidaire » selon la France et les États-Unis. Le 5 décembre 2013, une résolution de l'ONU permet à la France d'envoyer des troupes armées en République centrafricaine (opération Sangaris) aux fins annoncées de désamorcer le conflit et de protéger les civils.
an 2012-2013 : Égypte - En juin 2012, Mohamed Morsi remporte l'élection présidentielle et devient ainsi le premier président du pays élu au suffrage universel dans une élection libre. Un an après son arrivée au pouvoir, le président Morsi est massivement contesté par l'opposition qui regroupe diverses factions entre laïcs de gauche, anciens partisans du régime de Moubarak et différents groupes révolutionnaires, dont Tamarod (Rebellion). Une grande partie de la population reproche au nouveau président une dérive dictatoriale et une politique menée dans le seul intérêt de son organisation, les Frères musulmans. Après des rassemblements massifs dans tout le pays, l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Sissi, lance un dernier ultimatum le 1er juillet 2013. Celui-ci est rejeté le lendemain par Mohamed Morsi qui défend sa légitimité en soulignant qu'il a été élu démocratiquement, avec 52 % des voix. Cependant, selon des observateurs, l'ultimatum a été lancé dès le mois d'avril 2013, par la coalition des opposants, alors que la situation économique était au plus mal.
an 2012 : Ghana - À la suite du décès du président en exercice le 24 juillet 2012, le vice-président John Dramani Mahama lui succède à la tête de l’État
an 2012 : Guinée-Bissau - Le 12 avril 2012, un coup d'État mené par l'armée dépose le premier ministre Carlos Gomes Júnior dans le contexte d'une élection présidentielle contestée. La CEDEAO et la CPLP prennent des positions fortes contre ce coup d'état et examinent les possibilités d'intervention politique et militaire. L'Union africaine suspend la Guinée-Bissau le 17 avril 2012. Mamadu Ture Kuruma devient de facto le dirigeant du pays. Manuel Serifo Nhamadjo, président de l'Assemblée nationale populaire, devient président de la République par intérim.
an 2012 : Libye - Le 7 juillet 2012, la Libye organise l'élection du Congrès général national, premier scrutin démocratique de son histoire. Elle se déroule dans un climat de tensions, les milices fédéralistes de Cyrénaïque se montrant hostiles au pouvoir central de Tripoli. Parmi les nombreux partis politiques formés après la chute de Kadhafi, les islamistes apparaissent comme les grands perdants du premier scrutin : l'avantage revient aux libéraux, et notamment à l'Alliance des forces nationales dirigé par Mahmoud Jibril, qui n'a cependant pas la majorité absolue. Le Congrès général national (CGN), une assemblée de 200 membres, succède au Conseil national de transition48. Mohamed Youssef el-Megaryef, islamiste modéré et opposant de longue date à Kadhafi, est élu en août président du CGN, soit chef de l'État par intérim ; en octobre, le diplomate Ali Zeidan, ancien porte-parole du CNT, devient chef du gouvernement. Le climat de violence ne cesse pas pour autant en Libye :
le 11 septembre 2012 — anniversaire des attentats de 2001, mais également dans le contexte de l'affaire du film L'Innocence des musulmans — le consulat des États-Unis à Benghazi est attaqué par un groupe armé. Quatre Américains sont tués, dont l'ambassadeur J. Christopher Stevens.
an 2012-2014 : Malawi - Conformément à la Constitution, la vice-présidente Joyce Banda est officiellement investie présidente du Malawi le 7 avril 2012 à la suite du décès de Bingu wa Mutharika. Ses premières décisions politiques la démarquent de son prédécesseur. Elle s'efforce notamment de restaurer les bonnes relations du Malawi avec les pays développés afin que l'aide internationale reprenne pleinement, notamment en revenant sur des décisions monétaires et, dans le domaine social, en dépénalisant les actes homosexuels.
an 2012 : Mauritanie - En mars 2012, Abdallah al-Senoussi, le beau-frère de Mouammar Kadhafi et ancien chef des renseignements militaires libyens recherché par la Cour pénale internationale est arrêté à Nouakchott. Il est finalement remis aux autorités libyennes, six mois plus tard, après de longues tractations. Le premier ministre libyen Ali Zeidan accuse la Mauritanie d'avoir exigé un paiement de 200 millions de dollars en échange de l'extradition Abdallah al-Senoussi.
Le 12 octobre 2012, le président Mohamed Ould Abdelaziz est blessé par balle par une patrouille militaire. Il est évacué vers la France pour y être soigné à l'hôpital Percy-Clamart près de Paris.
Situation sanitaire et humanitaire
Depuis 2012, près de 60.000 réfugiés peuls, touaregs et arabes venus du Mali, fuyant les violences des groupes jihadistes ou de l’armée malienne, ont élu domicile dans le camp de Mbera, en Mauritanie. Leur accès à l'eau potable est précaire.
an 2012 : Sénégal - Janvier 2012 : le Conseil constitutionnel se prononce pour une nouvelle candidature, jugée anticonstitutionnelle par ses opposants, du chef de l’Etat à la présidentielle de février. Il rejette la candidature du chanteur Youssou N’Dour. Cette décision provoque la colère de l’opposition.
25 mars 2012 : L’ex-premier ministre Macky Sall devient le nouveau chef de l’État sénégalais en battant au second tour de la présidentielle son rival Abdoulaye Wade qui a reconnu sa défaite avant même les résultats officiels d’un scrutin qui s’est déroulé pacifiquement.
“Mes chers compatriotes, à l’issue du second tour de scrutin de dimanche, les résultats en cours indiquent que M. Macky Sall a remporté la victoire“, a déclaré le président Wade, selon un communiqué diffusé dans la soirée par la présidence.
“Comme je l’avais toujours promis, je l’ai donc appelé dès la soirée du 25 mars au téléphone pour le féliciter“, a expliqué le chef de l’État sortant.
“Ce soir, un résultat est sorti des urnes, le grand vainqueur reste le peuple sénégalais“, a déclaré de son côté Macky Sall lors d’une conférence de presse dans la nuit dans un grand hôtel de la capitale. “Je serai le président de tous les Sénégalais“, a-t-il promis, remerciant notamment le président Wade pour son appel téléphonique.
27 mars 2012 : Macky Sall est le vainqueur de l’élection présidentielle avec 65,80% des suffrages, selon les résultats officiels provisoires annoncés par la Commission nationale de recensement des votes. Le président sortant Abdoulaye Wade obtient, lui, 34,20% des voix. Le taux de participation est à 55% des inscrits, toujours selon les mêmes résultats officiels provisoires.
Résultats officiels mardi 27 ou mercredi 28. “Ce soir une ère nouvelle commence pour le Sénégal”, s’est félicité le vainqueur du scrutin, qui lui aussi a salué la maturité des électeurs et de la démocratie sénégalaise. “L’ampleur de cette victoire aux allures de plébiscite exprime l’immensité des attentes de la population, j’en prends toute la mesure. Ensemble, nous allons nous atteler au travail“, a-t-il conclu. “C’est encore une preuve de la maturité du peuple sénégalais et de la classe politique“, a commenté le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), chargée de superviser le scrutin.
Macky Sall prendra ses fonctions le 1er avril 2012.
3 avril 2012 : Le président Macky Sall nomme Abdoul Mbaye Premier ministre. Chef d’entreprise et banquier de formation, 59 ans, Abdoul Mbaye doit former le nouveau gouvernement du Sénégal sans dépasser les 25 personnes. La nomination de M. Mbaye a été précédée du premier discours à la nation de Macky Sall qui a dit vouloir un règlement pacifique du conflit casamançais qui dure depuis près de trente ans.
an 2012 : Sierra Leone - Ernest Bai Koroma, principal opposant, candidat du Congrès de tout le peuple (APC), ex-parti unique écarté du pouvoir depuis quinze ans, succède à Ahmad Tejan Kabbah, battant au second tour son adversaire, Solomon Berewa, vice-président et candidat du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) avec 54,6 % des suffrages. Il est réélu pour un deuxième et dernier mandat le 17 novembre 2012 en remportant 58,7 % des suffrages contre 37,4 % pour son adversaire, le général Julius Maada Bio, brièvement chef de l'État en 1996. Il a maintenu la paix, amélioré le réseau routier et la fourniture en électricité, même si celle-ci reste déficiente. Pour autant, le pays reste un des plus pauvres d'Afrique, malgré ses mines de diamant.
an 2013 : République de Centrafrique - Face au risque de génocide, la France annonce, le 26 novembre 2013, l'envoi d'un millier de soldats pour rétablir la sécurité dans le pays. Le 5 décembre 2013, par la résolution 2127, le conseil de sécurité des Nations unies autorise le « déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) pour une période de 12 mois » officiellement pour mettre fin à la « faillite totale de l'ordre public, l'absence de l'état de droit et les tensions interconfessionnelles ». La MISCA est appuyée par des forces françaises (opération Sangaris), autorisées à prendre « toutes les mesures nécessaires ».
an 2013 : Congo Kinshasa - Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise appuyée par une brigade d'intervention de l'ONU chasse les rebelles du M23 des dernières positions qu'ils occupaient dans les montagnes du Nord-Kivu, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda, les rebelles déposent les armes et dissolvent leur mouvement en décembre 2013 dans un traité de paix signé à Nairobi.
an 2013-2014 : Afrique République de Djibouti - En 2013, les élections législatives aboutissent à une grave crise électorale et une répression du régime contre l'Union pour le salut national (USN), coalition des sept partis djiboutiens d'opposition. Elle aboutit à la signature entre cette dernière et le gouvernement d'un accord-cadre politique le 30 décembre 2014. Les dix députés de l'opposition qui commencent à siéger peu de temps après sont les premiers depuis l’indépendance.
an 2013-2013 : Égypte - Mohamed Morsi est remplacé par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Adli Mansour, qui prête serment comme président par intérim. Le 4 juillet 2013, on apprend que Mohamed Morsi est détenu par l'armée et que des mandats d'arrêt sont émis à l'encontre des dirigeants des Frères musulmans. Le 5 juillet 2013, le Parlement est dissous. Le 26 juillet 2013, l'armée déclare que Mohamed Morsi est en prison dans l'attente de son procès pour collusion avec le mouvement palestinien du Hamas.
Fin 2013, le nouveau pouvoir militaire est à son tour la cible de contestations, notamment à cause de la répression de manifestations et de l'arrestation d'activistes démocrates.
an 2013 : Gambie - Alors qu'elle en est membre depuis 1965, la Gambie, par la voix de son ministre de l'Intérieur, annonce le 2 octobre 2013 son retrait du Commonwealth. Le pays refuse les injonctions du Royaume-Uni au sujet des droits de l'homme alors que le régime du président Yahya Jammeh se fait plus autoritaire et accuse l'organisation d'être néo-coloniale.
an 2013 : Kenya - Pour la première fois des débats présidentiels télévisés sont organisés les 11 et 25 février 2013. Également, pour la première fois, certains bureaux de vote sont équipés pour transmettre électroniquement les résultats vers la commission indépendante IEBC chargée de comptabiliser les résultats des élections générales.
Huit candidats ont posé leur candidature lors de l'élection présidentielle du 4 mars 2013. Pour l'emporter au premier tour, un candidat doit réunir au moins 25 % des votes dans au moins 24 comtés différents et 50 % de l'ensemble des votes plus un (majorité absolue).
Depuis la première élection présidentielle multipartisme de 1992, l'appartenance d'un candidat à tel ou tel groupe tribal a toujours été un élément important dans le choix des électeurs. Uhuru Kenyatta avec son colistier William Ruto sont respectivement kikuyu et kalenjin (premier et quatrième groupe tribal du pays) alors que son adversaire Raila Odinga et son colistier Kalonzo Musyoka sont luo et kamba (troisième et cinquième groupe). Uhuru Kenyatta est déclaré vainqueur dès le premier tour de l'élection du 4 mars 2013 avec 50,07 % des suffrages devant Raila Odinga avec 43,31 %. Ce dernier conteste les élections et, conformément à la possibilité donnée par l'article 140.1 de la Constitution, dépose, en date du 16 mars 2013 une pétition à la Cour suprême pour contester la validité du scrutin présidentiel arguant des bourrages d'urnes, les dysfonctionnements du système électronique de transmission vers l'IEBC et l'inorganisation de cette dernière. La Cour rend son jugement le 30 mars suivant en déclarant que « l'élection générale fut libre et impartiale » et que « Uhuru et son colistier Ruto ont été valablement élus » et en publie la version intégrale le 16 avril.
Présidence de Uhuru Kenyatta
Uhuru Kenyatta est investi en tant que 4e président du Kenya le 9 avril 2013 au centre sportif international Moi de Kasarani (Nairobi).
D'emblée, il s'oppose à la demande des députés d'obtenir une augmentation de 60 % de leur salaire29 et réduit le nombre de ministères et secrétariats d’État, de quarante-deux sous la présidence de son prédécesseur, à dix-huit30. Cinq femmes deviennent ministres31 dont deux à des postes très importants comme Amina Mohamed aux Affaires étrangères et Raychelle Omano à la Défense.
Lors de son discours prononcé lors du Madaraka Day (célébration de l'autonomie du pays au 1er juin 1963) du 1er juin 2013, il réaffirme la teneur de la Constitution à propos de la gouvernance des comtés, rappelle les huit anciens commissaires provinciaux vers d'autres fonctions et met, ainsi, fin aux dissensions entre les gouverneurs et les commissaires.
L'organisation État islamique et les chebabs multiplient les attaques au Kenya dans les années 2010, mettant en échec la politique sécuritaire du gouvernement. À ces attaques, s'ajoute une instabilité politique interne dans les mois qui précèdent les élections générales d'août 2017. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, est finalement réélu et affiche un score électoral de 54,28 % des suffrages exprimés. Son rival Raila Odinga parle de fraudes. Des émeutes éclatent avant un appel au calme par l'opposant Raila Odinga, qui s'en remet à la Cour suprême. Celle-ci, à la surprise générale, lui donne cette fois raison et invalide les élections, qui sont réorganisés en octobre 2017. Cette décision montre une consolidation des contre-pouvoirs au Kenya à la suite de la constitution de 2010. Uhuru Kenyatta fait procéder à des modifications de la loi électorale avant ce nouveau scrutin, ce qui provoque le retrait de Raila Odinga, qui appelle au boycott de l'élection. Finalement, le président sortant Uhuru Kenyatta remporte le nouveau scrutin avec 98,26 % des voix, mais la participation le 26 octobre 2017 n'est que de 38,8 % des électeurs inscrits, à comparer à 79 % le 8 août 2017, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême. Le 13 mai 2021, le projet de réforme constitutionnelle de Uhuru Kenyatta est jugé illégal. Le 20 août 2021, La Cour d'appel du Kenya a confirmé l'illégalité du processus de révision constitutionnelle lancé par le président Uhuru Kenyatta mettant fin définitivement à ce projet de révision constitutionnelle.
an 2013 : Libye - En mai 2013, sous la pression des milices révolutionnaires, le parlement libyen adopte une loi dite de « bannissement politique », excluant de toute fonction officielle les personnes ayant occupé des responsabilités, à un moment ou à un autre, sous le régime de Kadhafi. Le radicalisme de cette loi, qui frappe de fait une grande partie des dirigeants libyens, provoque une crise politique et plusieurs démissions, privant la Libye d'un personnel politique expérimenté. Le président du Congrès général national Mohamed Youssef el-Megaryef, qui avait été ambassadeur sous Kadhafi avant de rejoindre la dissidence, est contraint de quitter ses fonctions. Fin juin, Nouri Bousahmein est élu président du GNC. Le premier ministre Ali Zeidan a quant à lui le plus grand mal à imposer son autorité face aux différents chefs de milices, qui tiennent notamment les champs pétroliers de Cyrénaïque, avec le soutien des tribus : en octobre 2013, il est séquestré quelques heures par un groupe armé, avant d'être relâché. En novembre 2013, des rebelles autonomistes proclament en Cyrénaïque un gouvernement, défiant celui de Tripoli qu'ils disent aux mains des islamistes.
an 2013 - 2018 : Madagascar - L’élection présidentielle malgache de 2013 fait de Hery Rajaonarimampianina le président de la IVe république et son Premier ministre est Roger Kolo. Mais Hery Rajaonarimampianina, qui remporte cette élection considérée par les observateurs comme démocratique, dispose alors du soutien politique d'Andry Rajoelina, avec qui il est conduit à prendre progressivement ses distances. Le nouveau président manque dès lors de soutien politique tout en étant confronté à une ploutocratie aux commandes du pays. La crise politique est doublée d'une crise économique persistante. Le 14 janvier 2015, le général de brigade aérienne Jean Ravelonarivo est nommé Premier ministre en remplacement de Roger Kolo. En mai 2015, le président est destitué par l’Assemblée nationale, mais la décision est ensuite annulée par la justice malgache. Olivier Mahafaly Solonandrasana remplace Jean Ravelonarivo le 10 avril 2016, mais pour calmer le pays en proie aux émeutes, il est contraint à la démission et remplacé par Christian Ntsay le 4 juin 2018. Les élections de décembre 2018 portent au pouvoir pour 5 ans Andry Rajoelina. Celui-ci remporte également les élections législatives de mai 2019 et obtient la majoprité absolue à l'Assemblée nationale.
an 2013 : Mauritanie - Le 18 février 2013, les forces armées mauritaniennes annoncent le début d'exercices militaires dans le sud-est du pays avec la participation de dix-neuf pays européens, africains et arabes.
En 2013, les élections législatives de novembre et décembre confortent la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale.
an 2013-2015 : Nigéria - En 2013, le Nigeria devient aussi la première économie d'Afrique, avec un Produit intérieur brut de 510 milliards de dollars, dépassant l'Afrique du Sud, même si ce dernier pays reste en tête en termes de PIB par habitant.
À la suite de l'élection présidentielle de 2015, Muhammadu Buhari est élu. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine du Nigéria qu'une transition à la tête de l'État se fait de façon démocratique.
an 2013-2019 : Somalie - Le 11 janvier 2013, l'armée française lance une opération militaire afin de libérer l'otage Denis Allex de la DGSE détenu par les Al-Shabbaab à Buulo Mareer depuis 2009 mais celle-ci s'avérera être un échec.
Le groupe terroriste Harakat al-Chabab al-Moudjahidin multiplie les attaques depuis 2008, et notamment en 2019 : en juillet, contre un hôtel de Kismaayo, puis sur la route d’accès à l’aéroport de Mogadiscio et quelques jours plus tard contre la mairie de Mogadiscio, contre un hôtel de hôtel à Mogadiscio le 10 décembre 2019 puis le 28 décembre sur un poste de contrôle à l'entrée de Mogadiscio (cette dernière attaque faisant 81 morts).
Outre le terrorisme, les Somaliens sont victimes de la violence d’État de certains pays de la région. Ainsi, 42 réfugiés sont tués en mars 2017 dans une attaque aérienne saoudienne sur la mer Rouge.
Les Nations unies estiment que 1,7 million de personnes manquent de nourriture à cause de la sécheresse en mai 2019, et que leur nombre va augmenter d'un demi-million d'ici à juillet. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont contraintes d'abandonner leur foyer pour tenter de trouver de la nourriture, venant ainsi s'ajouter aux 2,6 millions de personnes déjà déplacées dans le pays du fait de la sécheresse et de la guerre.
an 2013-2015 : Togo - En 2013, de nouvelles élections législatives sont organisées. Le parti Unir obtient 62 sièges sur 91 soit la majorité absolue. L'ANC devient le premier parti de l'opposition avec 19 sièges. Un regroupement des principaux partis d'opposition (le Combat pour l'alternance politique) dénonce par avance des fraudes massives pour l'élection présidentielle de 2015.
an 2014 : Afrique du Sud - Jacob Zuma est réélu pour un second mandat, l'ANC restant nettement en tête dans l'électorat bien qu'en recul face à l'Alliance démocratique et aux Combattants pour la liberté économique de Julius Malema.
an 2014 : Algérie - Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014
an 2014 : Burkina Faso - Le 30 octobre 2014, Blaise Compaoré fait face à un soulèvement populaire contre son projet de modification de l'article 37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels, afin de se représenter en 2015. À la suite des émeutes, Blaise Compaoré quitte le pouvoir.
Le chef d'état-major des armées Honoré Traoré annonce le 31 octobre la création d'un « organe de transition », chargé des pouvoirs exécutif et législatif, dont l'objectif est un retour à l'ordre constitutionnel « dans un délai de douze mois ». Le 1er novembre 2014, l'armée publie un communiqué qui affirme son soutien à Isaac Zida comme président de transition. Honoré Traoré en est un des signataires, ce qui implique son renoncement au pouvoir. Le 17 novembre 2014, le diplomate Michel Kafando est nommé président de transition. Il nomme Isaac Zida Premier ministre.
an 2014-2018 : Afrique du Sud - Jacob Zuma est, en 2014, réélu pour un second mandat avec Cyril Ramaphosa comme vice-président. Il ne peut achever son second mandat et est poussé par son parti à la démission en février 2018.
La presse dresse alors un bilan négatif de ses deux mandats marqués par de multiples scandales de corruption, des accusations de prévarication, un échec aux élections municipales sud-africaines de 2016, marquées par un recul de l'ANC dans les métropoles et une popularité en berne affectant son parti.
an 2014-2015 : Algérie - L'attentat du 19 avril 2014 contre l'Armée nationale populaire (ANP) entraîne la mort de 11 militaires, celle du 17 juillet 2015 la mort de 11 à 13 soldats
an 2014 : République de Centrafrique - Le 10 janvier 2014, le président de la transition centrafricaine Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaye annoncent leur démission lors d'un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).
Le 20 janvier 2014, le Conseil national de transition de la République centrafricaine élit Catherine Samba-Panza comme chef de l'État de transition de la République centrafricaine. Au printemps 2014, trois journalistes sont tués, dont la française Camille Lepage, sur fond de sanctions de l'ONU.
Le 23 juillet 2014, les belligérants signent un accord de cessation des hostilités à Brazzaville. En dépit de cet accord, le pays est divisé en régions contrôlées par des milices, « sur lesquelles ni l’État ni la mission de l’ONU n’ont prise ».
an 2014 : République de Djibouti - En mai 2014, le pays est victime d'un attentat suicide dans le restaurant La Chaumière. Selon les informations, deux ou trois kamikazes (dont une femme) se seraient fait exploser en entrant dans le restaurant. Un mort, un ressortissant turc, a été recensé, et plusieurs blessés, dont des coopérants français présents dans le restaurant, ainsi qu'une jeune femme originaire des Pays-Bas. L'un des kamikazes n'a pas pu entrer dans le restaurant. Il s'est jeté sur la terrasse en déclenchant sa ceinture explosive.
2014 - 2030 : Égypte - En mai 2014, Abdel Fattah al-Sissi, déjà considéré comme le dirigeant de fait de l'Égypte, remporte l'élection présidentielle. Il est réélu pour un deuxième mandat en 2018. Par une révision constitutionnelle validée par un référendum en avril 2019, il se donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Il impose une logique autoritaire, réprime toute opposition et toute voix critique , et met sous contrôle les médias et la justice. La répression touche notamment des médias, des blogueurs, des journalistes, dont des personnalités féminines comme Israa Abdel Fattah ou Solafa Magdy.
La population égyptienne dépasse les cent millions d’habitants en février 2020. Elle progresse d’un million supplémentaire tous les six mois. Le taux de fécondité est passé de 5,3 enfants par femme en 1980 à 3 en 2008, puis est remonté à 3,5 en 2014. A titre de comparaison, l’Iran connaît un taux de fécondité de 1,8 enfants par femme et la Tunisie de 2,2. Cette croissance de la population égyptienne intervient de plus sur une bande de terre limitée essentiellement à la vallée du Nil et à son delta, représentant moins de 5% de la superficie d’un pays relativement désertique. La proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté semble un élément déterminant. Les Égyptiens les plus pauvres, ne disposant pas d'aide publique adaptée, veulent s'appuyer sur leur progéniture pour assurer leur besoins quotidiens.
Par ailleurs, l'armée égyptienne semble perdre progressivement le contrôle de la péninsule du Sinaï face à la guérilla jihadiste, une branche locale de l'État islamique.
an 2014 : Gambie - Le 30 décembre 2014, une autre tentative de coup d’État a lieu en Gambie pendant que Jammeh est à Dubaï. Il accuse fortement les puissances occidentales d’avoir aidé des terroristes pour le renverser. La répression et les accusations arbitraires s'accentuent.
an 2014-2015 : Guinée - En 2014 et 2015, le pays est touché par l'épidémie Ebola mais se mobilise pour en contenir les impacts.
an 2014 : Guinée-Bissau - En 2014, José Mário Vaz remporte l'élection présidentielle du 13 avril 2014, marquant le retour progressif à la légalité constitutionnelle. Pour autant, l'instabilité persiste, et les premiers ministres se succèdent.
an 2014 : Leshoto - Le Lesotho demeure l'un des pays les plus pauvres du monde : en 2014, l'indice de développement humain (IDH) le classe au 162e rang sur 187 pays.
an 2014 : Libéria - En 2014, le Liberia, avec ses voisins la Guinée et la Sierra Leone, est touché par une épidémie de maladie à virus Ebola, qui désorganise sérieusement la vie du pays. Cette épidémie fait des milliers de morts.
an 2014 : Libye - Le 20 février 2014, sans passion et au milieu d'épisodes de violences, les Libyens élisent leur assemblée constituante. Le scrutin se déroule dans un contexte d'instabilité politique persistante, alors que le gouvernement d'Ali Zeidan, qui tente de poser les bases d'un État, est de plus en plus discrédité. Le Congrès général national provoque également le mécontentement de la population et de la classe politique en prolongeant son mandat d'un an, jusqu'en décembre 2014, et en laissant à un futur parlement, dont la date n'est toujours pas décidée, la tâche de décider de la nature d'une élection présidentielle. Minoritaires au Congrès, les islamistes gagnent cependant en influence dans l'assemblée et accaparent de plus en plus de pouvoir, laissant peu de marge de manœuvre au gouvernement. Un bras de fer oppose le premier ministre au Congrès général national jusqu'en mars 2014, date à laquelle le Congrès démet par un vote le chef du gouvernement : les islamistes se débarrassent ainsi d'un de leurs principaux adversaires. Abdallah al-Thani assure l'intérim après le départ de Zeidan. La Libye n'a alors toujours pas réussi à former d'armée ou de police réellement professionnels, laissant en grande partie le terrain à diverses factions armées et des ex-chefs rebelles.
Le 30 mars, le Congrès général national décide de laisser la place à une Chambre des représentants, qui devra être élue en juin. Le 4 mai, le Congrès général national élit Ahmed Miitig au poste de premier ministre : la validité de cette élection est aussitôt contestée, les rebelles autonomistes de l'Est annonçant quant à eux qu'ils refusent de reconnaître ce gouvernement. Le général Khalifa Haftar, chef d'état-major de l'Armée nationale libyenne, défie ouvertement le Congrès général national dominé par les islamistes, exigeant sa dissolution et la mise en place d'un « Conseil présidentiel » pour mieux assurer l'autorité de l'État. Les 16 et 18 mai, des forces loyales à Haftar attaquent des milices à Benghazi, puis le siège du CGN à Tripoli, faisant plusieurs dizaines de morts60. En juin, la justice invalide l'élection de Miitig ; Abdallah al-Thani revient alors à la tête du gouvernement. Les élections législatives se déroulent le 25 juin : 12 des 200 sièges du nouveau parlement ne sont pas pourvus, les votes ayant été annulés dans diverses localités en raison des violences. Le Parti de la justice et de la construction, proche des islamistes, est nettement minoritaire.
L'instabilité persiste ensuite en Libye, qui s'avère incapable de construire un véritable pouvoir central et de mettre un terme au désordre et à la violence dans le pays, où les milices continuent de s'arroger un pouvoir de fait. En juillet 2014, la mission de l'ONU évacue son personnel après des affrontements à Tripoli et Benghazi, qui font plusieurs victimes. Toujours en juillet, la milice de Misrata alliée à des groupes islamistes affronte la milice de Zenten alliée à d'anciens soutiens de Khadafi pour le contrôle de l'aéroport de Tripoli, tandis que d'autres groupes combattent en Cyrénaïque pour le contrôle des ressources pétrolières.
Après les élections, la passation de pouvoir entre le Congrès général national et la nouvelle Chambre des représentants est annulée : le nouveau parlement, boycotté par les élus islamistes et présidé par Aguila Salah Issa, tient sa session inaugurale à Tobrouk. Fin août, la coalition « Aube de la Libye » (Fajr Libya) formée par les groupes islamistes, prend le contrôle de Tripoli et reforme le Congrès général national : Nouri Bousahmein est réélu au poste qu'il occupait avant les élections, tandis qu'Omar al-Hassi devient le nouveau premier ministre. L'Égypte et les Émirats arabes unis mènent des bombardements répétés sur la capitale libyenne.
an 2014 : Malawi - En mai 2014, Joyce Banda perd l'élection présidentielle, au profit du frère de Bingu wa Mutharika, Peter Mutharika. Le pays, comme d'autres en Afrique australe, est confronté à des phénomènes climatiques difficiles, alternant sécheresse et inondations, dont les effets sont aggravés par la déforestation, mais connait une croissance de son PIB. Peter Mutharika est réélu pour un deuxième mandat lors de l’élection présidentielle de 2019, dans un scrutin serré. L'opposition dénonce des résultats frauduleux. Le 3 février 2020, la cour constitutionnelle, constatant des irrégularités, annule l'élection.
an 2014 : Mali - Interventions de troupes françaises (opération Serval puis Barkhane)
Cette opération Serval semble être un succès dans un premiers temps : les villes ont été reprises ainsi que le territoire du nord du pays, un dialogue est rétabli avec les différentes composantes Touareg et l’État malien est stabilisé. Mais Al-Qaida au Maghreb islamique change d'approche,et se reconstitue. L'organisation procède désormais par des incursions ponctuelles et par des attentats, et le maintien sur place des troupes françaises et africaines, dans l'organisation initiale de ces forces, se révèle coûteux. Il est décidé de substituer l’opération Barkhane à l'opération Serval, pour sécuriser la bande sahélo-saharienne, avec la mission de lutter contre les groupes djihadistes et d’empêcher la constitution de sanctuaires terroristes dont le quartier-général semble établi à N’Djamena. Le nouveau dispositif est officiellement lancée le 1er août 2014.
an 2014 : Mauritanie - Le 2 février 2014, le Premier ministre Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf, en poste depuis le début du mandat du président Aziz, présente la démission de son gouvernement. Il est reconduit dans ses fonctions dès le lendemain et chargé de former un nouveau gouvernement qui compte onze nouvelles personnalités dont cinq femmes.
Le 21 mai 2014, les ministres de l'Intérieur du groupe des Cinq du Sahel, dont fait partie la Mauritanie, créent une « plateforme de coopération sécuritaire » destinée notamment à « lutter contre le terrorisme » à Nouakchott.
Le 4 juin 2014, des milliers de sympathisants manifestent à Nouakchott contre le mode d'organisation des élections présidentielles à l'appel du Forum national pour la démocratie et l'unité (FNDU, opposition radicale).
Mohamed Ould Abdel Aziz remporte une victoire écrasante et attendue à la présidentielle le 21 juin 2014, et recueille 81,94% des suffrages, avec un taux de participation de 56,55%. Investi le 2 août pour son second mandat, il nomme comme Premier ministre Yahya Ould Hademine, ancien ministre de l'Equipement et des Transports du précédent gouvernement.
Le 3 novembre 2014, le responsable du parti islamiste modéré Tewassoul Elhacen Ould Mohamed est nommé à la tête de l'opposition démocratique.
Le 25 décembre 2014, pour la première fois depuis son indépendance, une condamnation à mort pour apostasie est prononcée en Mauritanie à Nouadhibou (au nord-ouest du pays) à l'encontre d'un citoyen mauritanien musulman, inculpé après avoir publié sur internet un texte considéré comme blasphématoire. Le 21 avril 2015, la peine de mort est confirmée pour le blogueur Mohamed Cheikh ould Mkheitir, qui est détenu depuis janvier 2014 pour un article jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. Le 31 janvier 2017 la Cour suprême renvoie devant une autre cour d'appel le dossier de Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir, le blogueur condamné à mort pour apostasie et emprisonné depuis 3 ans. Il est libéré le 29 juillet 2019 et ne cesse de dénoncer les discriminations ethniques et sociales en Mauritanie.
Esclavage
Le 6 mars 2014, avec l'appui de l'ONU, la Mauritanie adopte un plan pour l'éradication de l'esclavage.
En novembre 2014, les autorités mauritaniennes ferme le siège de l'IRA, une ONG anti-esclavagiste qu'elles accusent de propager la haine entre les populations.
Situation sanitaire et humanitaire
Le 24 octobre 2014, le gouvernement annonce le renforcement des contrôles de sa frontière avec le Mali à la suite de l'annonce du premier cas d'Ebola dans ce pays.
an 2014 : Mozambique - Le 15 octobre 2014, le FRELIMO propose un nouveau candidat à l'élection présidentielle, Filipe Nyusi qui est élu au premier tour, au cours d’un scrutin parsemé de fraudes et contesté par l’opposition, comme chaque fois. Afonso Dhlakama, chef du RENAMO, principale force d'opposition, double cependant son score de 2009, et réunit 37 % des suffrages exprimés. La situation post-électorale est tendue et le RENAMO semble pendant quelques mois reprendre une insurrection militaire, comme pendant les heures noires de la guerre civile qui a duré de 1976 à 1992.
an 2014 : Namibie - En 2014 a lieu l'Élection présidentielle namibienne de 2014, Elle est remportée par le candidat de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO), Hage Geingob, avec 86,73 % des suffrages.
an 2014 : Nigéria - L'année 2014 est marquée par la montée en puissance du groupe, qui kidnappe notamment plus de 200 lycéennes, provoquant des réactions d'indignations mondiales.
an 2014-2015 : Sierra Leone - Le pays est touché par l'épidémie d’Ebola en 2014 et 2015, qui fait 4 000 morts, et, en 2017, par des inondations meurtrières.
an 2014 : Tunisie - L'article 37 de la loi électorale, votée en application de l'article 74 de la Constitution de 2014, permet à tout électeur de confession musulmane, âgé d'au moins 35 ans et jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance de se présenter à l'élection présidentielle ; il doit présenter, s'il est titulaire d'une autre nationalité, un engagement stipulant l'abandon de son autre nationalité en cas d'élection. L'article 38 de la même loi exige que le candidat soit parrainé par dix élus de l'Assemblée des représentants du peuple ou par 10 000 électeurs, tout en stipulant qu'il est interdit au même parrain de parrainer plus d'un candidat. L'article 39 exige enfin le dépôt d'une caution de 10 000 dinars auprès du trésor public, qui est restituée au candidat s'il obtient plus de 3 % des suffrages exprimés.
L'Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de statuer et de fixer la liste des candidatures approuvées dans un délai de quatre jours à compter de la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures ; toute décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.
an 2015 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - la présidence Kaboré (2015-2022). - Des élections sont prévues initialement en octobre 2015, pour passer de cette période de transition à un fonctionnement démocratique stabilisé. Mais une tentative de coup d'état, (qualifié par des burkinabés de « coup d'état le plus bête du monde ») retarde l'échéance prévue pour cette consultation électorale.
Le 16 septembre 2015, en effet, le président de transition, le premier ministre et quelques membres du gouvernement sont pris en otages par des troupes armées, le Régiment de sécurité présidentielle, sous les ordres du général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Comparé. Des manifestations sont réprimées. Finalement, les autorités de transition sont rétablies, et le fameux régiment de sécurité présidentielle est désarmé fin septembre 2015. Les élections ont lieu en novembre 2015.
Le 30 novembre 2015, à la suite des élections présidentielles et législatives, Roch Marc Christian Kaboré (MPP) est élu au premier tour président du Burkina Faso avec 53,49 % des voix devant Zéphirin Diabré (UPC), qui récolte 29,65 % des voix, les douze autres candidats se partageant le reste. Il est le deuxième président civil depuis l'accès à l'indépendance du Burkina Faso après Maurice Yaméogo.
Depuis 2016, le Burkina Faso est touché par un certain nombre d'attaques menées par des groupes armés djihadistes : le 15 janvier 2016 ont lieu les attentats de Ouagadougou, des hommes armés attaquent le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ces lieux sont fréquentés principalement par des occidentaux. L'attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fait 30 morts. En août 2017, une autre attaque djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou. Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste visant l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou fait 8 morts, tous des militaires et plus de 80 blessés (civils et militaires). Cette attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
an 2015 : Burundi - Pierre Nkurunziza décide de briguer un troisième mandat à la présidence de la République et s'impose en avril comme le candidat du pouvoir pour l'élection présidentielle du 26 juin 2015. Cette décision est contraire à la constitution du Burundi, promulguée en mars 2005. Sa candidature est néanmoins validée par une décision controversée de la Cour constitutionnelle.
Le 13 mai 2015, Pierre Nkurunziza, en déplacement, est victime d'une tentative de coup d'État de la part du général Godefroid Niyombare.
Le 15 mai, après de violents combats dans le centre-ville de Bujumbura, les putschistes annoncent leur reddition et le pouvoir indique le retour imminent du président Nkurunziza. Les jours qui suivent voient une répression sanglante de l'opposition de la part du président. Cette répression fait des centaines morts et provoque des départs massifs : des centaines de milliers de burandais se réfugient à l'extérieur du pays . Après plusieurs reports, l'élection présidentielle, jugée illégale et truquée par tous les observateurs de la politique burundaise, se tient finalement le
21 juillet. Le 24 juillet, la commission électorale nationale indépendante proclame Nkurunziza vainqueur avec 69,41 % des suffrages.
.
an 2015-2016 : République de Centrafrique - Une élection présidentielle est organisée en décembre 2015 et janvier 2016. Faustin-Archange Touadéra arrive deuxième du premier tour avec 19 % des voix, derrière son opposant, Anicet-Georges Dologuélé qui arrive en tête avec 23,7 %. Il est finalement élu président de la République à l'issue du deuxième tour, avec 62,7 % des suffrages contre 37,3 % à Anicet-Georges Dologuélé. Ce nouveau président de la République lance un processus de réconciliation nationale afin de rendre justice aux victimes des guerres civiles, la plupart déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pour ce faire, il charge par décret son ministre conseiller, Regina Konzi Mongot, d'élaborer le Programme national de réconciliation nationale et de paix, proposé en décembre 2016, adopté en séance tenante à l'unanimité par les organismes internationaux.
an 2015 : Congo Brazzaville - En 2015, Denis Sassou-Nguesso organise une série de consultations avec des personnalités politiques du pays afin d’examiner une possible modification de la constitution en vigueur dans le pays depuis 2002. La démarche est vivement critiquée par une partie de l’opposition qui y voit une manœuvre afin de pouvoir se présenter une troisième fois à la présidence de la République (la Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels à deux et l’âge pour se présenter à la présidence de la République à 70 ans). La majorité assure de son côté souhaiter renforcer les institutions du pays en passant d’un régime présidentiel à un régime semi-parlementaire.
Le 25 octobre 2015, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Elle entre en vigueur le 6 novembre 2015, après sa promulgation par Denis Sassou-Nguesso.
an 2015-2017 : Congo Kinshasa - En 2015, des tensions apparaissent dans la perspective de l'élection présidentielle de 2016 et d'un éventuel prolongement de mandat de Joseph Kabila. L'article 70 de la Constitution du pays, datée de 2006, dispose que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Prétextant un délai supplémentaire de seize mois et un jour pour finaliser l’enregistrement des 30 millions d’électeurs, la commission électorale a annoncé le 20 août 2016, que l'élection présidentielle ne pouvait pas se dérouler avant juillet 2017. Le 19 septembre 2016, lors d’un rassemblement à Kinshasa contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, au moins dix-sept personnes sont mortes (3 policiers et 14 civils) durant la manifestation. Après la crise de confiance dans les institutions résultant de cette décision, des mouvements insurrectionnels sont signalés dans différentes provinces : milice Kamwina Napsu dans le Kasaï central, Bundu dia Kongo dans le Kongo central, Pygmées contre Bantous dans le Tanganyika, réactivation du M23. L'économie pâtit de la situation, et le phénomène des enfants soldats est en recrudescence.
Le 11 octobre 2017, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Corneille Nangaa, annonce que le scrutin pour remplacer Joseph Kabila ne pourra pas avoir lieu avant 504 jours, en raison du recensement encore en cours dans les régions du Kasaï, jusqu'en décembre 2017, puis de l’audit du fichier électoral par les experts, de l’élaboration de la loi portant répartition des sièges au parlement et de plusieurs autres opérations techniques et logistiques nécessaires avant la tenue des élections, prévue au premier semestre 2019. Ce nouveau report des élections suscite l'indignation de l'opposition, ainsi que nombre d'ONG.
an 2015-2016 : Afrique Côte d'Ivoire - À la suite de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015, le président Ouattara est réélu pour cinq ans. Il souhaite consolider les efforts de réconciliation nationale et rédiger une nouvelle Constitution. Cette nouvelle Constitution, qui entraine la création d'un sénat et d'un poste de vice-président, est approuvée par référendum le 30 octobre 2016. La troisième République Ivoirienne est proclamée le 8 novembre 2016.
an 2015 : Guinée - Le 11 octobre 2015, le président Alpha Condé obtient 58 % des suffrages et est réélu au premier tour de l'élection présidentielle pour un nouveau mandat de 5 ans.
an 2015 : Libye - Le gouvernement de Tobrouk — seul à être reconnu par la communauté internationale — et celui de Tripoli se disputent dès lors le pouvoir, en même temps que le contrôle des puits de pétrole, tandis que le pays entier est en proie à la violence et aux affrontements de groupes armés, tribaux ou djihadistes. La déliquescence de la Libye contribue à faire du pays l'une des principales zones de transit de l'immigration clandestine à destination de l'Europe. Par ailleurs, à la faveur du chaos politique, l'État islamique s'implante en Libye et lance des attaques, notamment à Misrata et à Syrte. L'ONU s'efforce d'amener les belligérants libyens à s'unir pour contrer l'État islamique. Le 10 juillet 2015, le gouvernement de Tobrouk signe finalement avec une partie des groupes armés un accord de paix proposé par l’ONU : celui de Tripoli rejette au contraire le texte et n'envoie pas de délégation à la signature.
an 2015 : Mauritanie - Le 28 janvier 2015 débute une grève de 9 semaines affectant les sites de production et d'exportation de la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM). Les revendications portent sur des augmentations de salaire. Après 9 semaines de grève la reprise du travail se déroule le 3 avril à la suite de l'ouverture de négociations et de la réintégration de grévistes licenciés.
Le 6 aout 2015, un islamiste malien, ancien porte-parole d'Ansar Dine, un groupe lié à Al Qaïda, et visé par un mandat d'arrêt international l'accusant de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, meurtre et actes terroristes est libéré par la Mauritanie, où il était détenu depuis plusieurs mois.
Le 2 septembre 2015, un remaniement ministériel remercie huit ministres, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Equipement.
Le 17 novembre 2015, la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM) ouvre un nouveau complexe minier sur le site de Zouerate, dans le nord du pays. Dénommé Guelb II, c'est le plus important projet industriel de l’histoire de la Mauritanie, dans lequel près d’un milliard de dollars ont été investis.
Le 10 février la présidence annonce un nouveau remaniement et le départ de cinq ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de l'Économie.
Le 7 mai 2015 l'opposition appelle a manifester contre le projet de révision constitutionnelle annoncé par le président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui prévoit entre autres choses la suppression du Sénat. Des heurts avec les forces de l'ordre feront plusieurs blessés. Le 29 septembre 2015, après de longues négociations entre pouvoir et opposition, s'ouvre un nouveau dialogue national. L'initiative est le point de départ qui doit amener à une réforme constitutionnelle, portant notamment sur la suppression du Sénat et la création du poste de vice-président. Une partie importante de l'opposition accuse le président Mohamed Ould Abdel Aziz de vouloir modifier le texte fondamental dans le but se présenter pour un troisième mandat. Le 20 octobre 2015 un accord politique marquant la fin du dialogue national est signé entre la majorité et quelques partis d'opposition. Plusieurs révisions constitutionnelles sont retenues, mais pas la suppression de la limitation des mandats présidentiels est rejetée.
Esclavage
Le 1er juillet 2015, six militants anti-esclavage de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) sont arrêtés, marquant le début d'une série d'arrestations dans les rangs de l'IRA. Leur procès débute le 3 août 2015 et dure quinze jours à l'issue desquels la Cour criminelle condamne la plupart des accusés à des peines de prison allant de trois à huit ans. Treize d'entre eux disent avoir été torturés durant leur détention.
Le 13 août 2015, le Parlement adopte une loi durcissant la répression de l'esclavage, considéré désormais comme un « crime contre
l'humanité ».
Situation sanitaire et humanitaire
Le 9 octobre 2015, la Mauritanie alerte l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'épidémie de fièvre qui sévit dans la vallée du rift
an 2015 : Nigéria - Début 2015, Boko Haram rase plusieurs villes et villages du nord-est du pays. Cette série d'attaques pousse les voisins du Nigéria, le Tchad, le Niger et le Cameroun à intervenir contre la secte islamiste. En 2015, Boko Haram fait allégeance à l'État islamique.
an 2015 : Tchad - Depuis 2015, l'armée tchadienne est engagée dans le conflit contre le groupe djihadiste Boko Haram, répandu dans le Nord du Nigeria et du Cameroun. En représailles, ce groupe a commis plusieurs attaques en territoire tchadien.
an 2015-2020 : Togo - Faure Gnassingbé est à nouveau réélu lors de l'élection présidentielle d'avril 2015, avec 58,75 % des suffrages exprimés, contre 34,95 % pour son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Une élection jugée libre et transparente par l'UE et les principaux observateurs internationaux. L'abstention s'élève à 40,01 %, contre 35,32 % à la précédente présidentielle de 2010. Du côté de l'opposition, Tchabouré Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI), a obtenu 3,08 % des suffrages, Komandega Taama, président du Nouvel engagement togolais (NET), 1,06 %, et Mouhamed Tchassona-Traoré, président du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (MCD, opposition), 0,99 %. Il nomme Premier ministre Komi Sélom Klassou le 5 juin 2015 jusque-là premier président de l'Assemblée nationale. Faure Gnassingbé se présente pour un quatrième mandat lors des élections présidentielles de 202022. Il est reconduit et l'élection est contestée une nouvelle fois par l'opposition.
an 2015 : Zambie - Edgar Lungu est élu en 2015 pour le remplacer et terminer son mandat présidentiel. Edgar Lungu est à la tête du Front patriotique (PF) qu'il a créé en 2001 après avoir quitté le Mouvement pour la démocratie multipartite (MMD). Il est vainqueur du scrutin présidentiel, d'une courte tête.
an 2016 : Algérie - Le pays enregistre sa première grande attaque terroriste dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016. Bilan : une trentaine de morts et une centaine de blessés.
an 2016-2018 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Depuis 2016, le Burkina Faso est touché par un certain nombre d'attaques menées par des groupes armés djihadistes : le 15 janvier 2016 ont lieu les attentats de Ouagadougou, des hommes armés attaquent le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ces lieux sont fréquentés principalement par des occidentaux. L'attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fait 30 morts. En août 2017, une autre attaque djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou. Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste visant l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou fait 8 morts, tous des militaires et plus de 80 blessés (civils et militaires). Cette attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
an 2016 : Cameroun - Depuis novembre 2016, des manifestants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, majoritairement anglophones, font pression pour le maintien de l'usage de la langue anglaise dans les écoles et les tribunaux. Des personnes ont été tuées et des centaines emprisonnées à la suite de ces protestations.
an 2016 : Cap Vert - Jorge Carlos Fonseca, du MPD, est réélu Président en 2016. José Maria Neves, du PAICV, est, dans le même temps, désigné premier ministre, de 2001 à 2016. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux partis au pouvoir, et même d'une cohabitation de ces deux partis pendant certaines périodes. Il est considéré comme ayant une bonne gouvernance, avec l'une et l'autre de ces formations, même si l'économie, peu diversifiée, est dépendante à 20 % du tourisme. Cet état ne dispense pas de grandes ressources naturelles. En 2016, le MPD revient au pouvoir à la suite des législatives, et la dirigeante relativement récente du PAICV, Janira Hopffer Almada, reconnaît sa défaite sans drame. L'archipel, qui souffre du réchauffement climatique, d'autant plus que l'eau douce y est rare, a une politique de développement des énergies renouvelables9, ainsi que de l'écotourisme.
an 2016 : Congo Brazzaville - Le 20 mars 2016, après avoir fait modifier la constitution (cf. infra), Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 60,07 % des voix, score validé par la Cour constitutionnelle le 4 avril suivant.
an 2016-2019 : Gabon - Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin à cinq mille voix près. L'opposition dénonce immédiatement ces résultats. Des émeutes encore plus violemment réprimées que celles de 2009 éclatent, avec comme point d'orgue l'attaque du quartier général de l'opposition par la garde présidentielle qui fait de nombreux morts. Le 24 septembre 2016, Ali Bongo est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec 50,66 % des voix, suivi de Jean Ping avec 47,24 % des suffrages.
Le président Bongo prône le concept de « Gabon émergent », politique visant notamment à la diversification de l'économie afin de diminuer sa dépendance aux cours mondiaux du pétrole. En 2018, cela ne s'est pourtant pas concrétisé, notamment du fait de la baisse des cours du pétrole et d'investissements peu judicieux, tandis que le chômage des jeunes reste élevé.
Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin à cinq mille voix près. L'opposition dénonce immédiatement ces résultats. Des émeutes encore plus violemment réprimées que celles de 2009 éclatent, avec comme point d'orgue l'attaque du quartier général de l'opposition par la garde présidentielle qui fait de nombreux morts. Le 24 septembre 2016, Ali Bongo est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec 50,66 % des voix, suivi de Jean Ping avec 47,24 % des suffrages.
Le 2 février 2017, le Parlement européen adopte une résolution déclarant que les résultats de la présidentielle « manquent de transparence » et sont « extrêmement douteux ».
Le 7 janvier 2019, une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence après un accident vasculaire cérébral, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour ; sur cinq mutins, deux sont tués et les autres arrêtés. Le 12 janvier, un nouveau Premier ministre est nommé, Julien Nkoghe Bekalé. Le pouvoir gabonais connaît une guerre des clans au sommet. Les remaniements ministériels se succèdent entre janvier et décembre 2019, alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé d'Ali Bongo. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée première ministre en juillet 2020.
an 2016-2017 : Gambie - En décembre 2016, sept partis d'opposition choisissent un candidat unique, Adama Barrow, pour l'élection présidentielle. Adama Barrow remporte l'élection à l'unique tour de scrutin en recueillant 43,3 % des suffrages, contre le président sortant qui arrive second avec 39,6 % des suffrages. Le 17 janvier 2017, Yahya Jammeh instaure l'état d'urgence et le lendemain, le Parlement prolonge son mandat de trois mois, jusqu'au 19 avril 2017. Le 19 janvier, Adama Barrow prête serment à l'ambassade de Gambie à Dakar. Devant le refus de Yahya Jammeh de lui céder le pouvoir, malgré les injonctions de la CÉDÉAO, l'armée sénégalaise pénètre en territoire gambien dans le courant de l'après-midi. Le soir même, le chef de l'armée gambienne, le général Ousman Badjie, déclare à des ressortissants occidentaux qu'il n'ordonnera pas à ses hommes de résister en cas d’intervention des troupes africaines.
L'élection présidentielle de décembre 2016 voit Adama Barrow, candidat de l'opposition, remporter la victoire sur le président sortant13 dont le mandat court jusqu'au 18 janvier 2017. Le 19 janvier 2017, Adama Barrow prête serment dans l'ambassade gambienne à Dakar au Sénégal, après le refus du président sortant de céder le pouvoir. Le même jour, l'armée sénégalaise entre en Gambie, forte d'une résolution de l'ONU. Le 20 janvier 2017, Jammeh accepte de quitter le pouvoir, et part en exil le lendemain soir pour Conakry, avant de rejoindre la Guinée équatoriale.
an 2016 : Guinée - En juillet 2016, la Guinée est le premier pays à majorité musulmane d'Afrique à renouer ses liens diplomatiques avec Israël.
an 2016-2018 : Guinée-Bissau - Au mois de septembre 2016, le président guinéen Alpha Condé, médiateur de la crise bissau-guinéenne, et son homologue de la Sierra Leone Ernest Baï Koroma obtiennent un compromis politique signé le 10 septembre par toutes les parties : ce sont les accords de Conakry. Successivement, Umaro Sissoco Embaló en novembre 2016, puis Artur Silvafin janvier 2018, puis Aristides Gomes mi-avril 2018 sont nommés premier ministres.
an 2016 : Libye - Devant la gravité de la situation et la progression de l'EI, la communauté internationale pousse à la création d'un gouvernement unitaire. Le 12 mars 2016 Fayez el-Sarraj prend la tête d'un gouvernement « d'union nationale », formé à Tunis, initialement rejeté par les parlements de Tripoli et de Tobrouk. Grâce au soutien occidental, le gouvernement peut s'installer à Tripoli à la fin du mois. Il obtient le 23 avril le soutien de la majorité des parlementaires de Tobrouk, et s'installe progressivement dans ses fonctions.
L’Organisation internationale pour les migrations note le développement de la traite d’êtres humains dans la Libye post-kadhafiste. Selon l'organisation, de nombreux migrants sont vendus sur des « marchés aux esclaves » pour 190 à 280 euros. Ils sont égalent sujets à la malnutrition, aux violences sexuelles, voire aux meurtres.
La ville de Syrte, place forte de l’organisation Etat islamique (EI) en Afrique du Nord, est reconquise début décembre 2016 par les forces du gouvernement libyen d’union nationale de Faïez Sarraj, soutenu par les capitales occidentales et les Nations unies, stoppant les vélléités de l'EI dans ce pays.
an 2016 : Mauritanie - Torture
Le 4 février 2016, après une inspection de dix jours, Juan Ernest Mendez, le rapporteur spécial de l'ONU fait part de ses regrets quant à la non application de la loi sur la prévention et la répression de la torture, promulguée en septembre 2015. La Mauritanie est dénoncée par plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, qui rapportent de nombreux actes de tortures et de mauvais traitement infligés aux détenus lors des interrogatoires.
Le 14 novembre 2016, une plainte visant de hauts responsables mauritaniens est déposée à au tribunal de grande instance de Paris. Ils sont accusés de « tortures et de traitements cruels » à l'encontre de militants anti-esclavage.
Situation sanitaire et humanitaire
En novembre 2016, le Programme alimentaire mondial (PAM) appelle à la mobilisation de 17 millions de dollars pour faire face à la situation des réfugiés maliens qui ont fui les exactions des groupes terroristes, confrontés à une crise alimentaire.
an 2016-2018 : Sao Tomé et Principe - Chef de l’Etat : M. Evaristo Carvalho, Président de la République (élu le 7 août 2016)
Chef du Gouvernement : M. Jorge Bom Jesus
L’élection présidentielle du 7 août 2016 voit Evaristo Carvalho, candidat de l’ADI (action démocratique indépendante), élu président de la République contre le président sortant Manuel Pinto da Costa. Le Président a un rôle non exécutif, d’arbitre et de représentation.
Malgré deux tentatives de coup d’Etat en 2003 et 2009, la démocratie parlementaire s’affirme et permet à plusieurs reprises une alternance entre les deux grandes forces qui animent la vie politique : l’ADI de Patrice Trovoada (fils de Miguel Trovoada, il est premier ministre de 2010 à 2012 et de 2014 à 2018) et le MLSTP de Jorge Bom Jesus.
Aux élections législatives d’octobre 2018, une coalition menée par le MLSTP l’emporte d’une très courte avance (28 sièges contre 27) et, après une courte période d’incertitude rapidement tranchée par la Cour constitutionnelle et acceptée par toutes les parties, Jorge Bom Jesus est chargé de former un gouvernement, début décembre 2018. Le gouvernement, toujours dirigé par Jorge Bom Jesus, a été remanié en septembre 2020.
an 2016 : Seychelles - À la suite de la défaite de son parti Lepep (issu de l'ancien parti unique) aux élections législatives de septembre 2016, James Michel annonce sa démission de son poste de président de la République en septembre 2016. Le 16 octobre suivant, il est remplacé par son vice-président, Danny Faure. Une période de cohabitation commence entre ce nouveau président et un Parlement contrôlé par l'opposition à l'ex-parti unique (qui était au pouvoir depuis 1977).
an 2016 : Tchad - Depuis 2016, le Tchad est confronté à un mouvement insurrectionnel dans le Nord du pays : plusieurs groupes armés d'exilés tchadiens ayant combattu dans la guerre civile libyenne reviennent en force dans leur pays d'origine.
an 2016 : Zambie - Edgar Lungu est réélu en 2016, dans un scrutin là encore serré, contre Hakainde Hichilema.
an 2017-2019 : Algérie - Bouteflika est critiqué pour ses manières autocratiques, et le chômage affecte encore plus d'un tiers de la population. En 2009, Bouteflika est réélu pour un troisième mandat après avoir fait amender la Constitution algérienne à cet effet. Victime en 2013 d'un accident vasculaire cérébral affectant son élocution et l'obligeant à se déplacer en chaise roulante, il fait en mars 2017 une apparition publique qui alimente les inquiétudes sur son état de santé. Il est alors âgé de 80 ans et des voix commencent à mettre en doute sa capacité à gouverner le pays.
Sous la pression de manifestations populaires de masse, et alors qu'il se présente pour un cinquième mandat, Abdelaziz Bouteflika démissionne le 2 avril 2019.
an 2017 : Angola - L'Angola présente un paysage de cités martyres, de provinces jadis agricoles stérilisées par la présence de millions de mines. Une bonne partie des infrastructures coloniales a été laissée à l'état de ruines (routes, ponts, aéroports, voies de chemin de fer, écoles), pendant que d'autres ont été reconstruites et même augmentées. L’agriculture et les transports ont été fortement endommagés et se trouvent en récupération lente. Malgré l’aide alimentaire, la famine sévit et le pays ne vit que de l’exportation du pétrole. Comme d’autres pays, l’Angola réclame des indemnisations et des aides financières, que le Portugal et l’Union européenne lui accordent sous forme d’aide au développement (écoles, eau potable, routes, hôpitaux) ou de visas de travail. En dépit de la guerre civile, la scolarité, certes médiocre, s'est améliorée (15 % d’enfants scolarisés en 1975, 88 % en 2005). De nombreuses missions catholiques et protestantes encadrent également les populations depuis l’indépendance. D'un point de vue politique, José Eduardo dos Santos confirme sa retraite, resté trente-sept ans de pouvoir. Il annonce début février 2017, se mettre en retrait de la politique fin 2017, après avoir, pendant 38 ans, muselé l’opposition par une répression policière, limité la liberté d'expression et imposé son autorité17. Il choisit pour lui succéder João Lourenço.
Le parti au pouvoir depuis plus de quatre décennies en Angola, le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), remporte les élections générales, en août 2017, avec plus de 64 % des suffrages. Le candidat du MPLA, Joao Lourenço, succède donc comme prévu à la tête du pays au président José Eduardo dos Santos. Les deux principaux partis dans l'opposition, l’Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (Unita) et la CASA-CE, obtiennent respectivement 24,04 % et 8,56 % des voix exprimées. Au terme de ce scrutin, le MPLA, au pouvoir depuis l’indépendance en 1975, conserve la majorité absolue des 220 sièges du Parlement18. En septembre 2018, Joao Lourenço succède également à José Eduardo dos Santos à la tête du MPLA.
an 2017-2018 : Cameroun - En 2017, le gouvernement de Biya a bloqué l'accès de ces régions à Internet pendant trois mois. En septembre, des séparatistes ont lancé une guérilla pour l'indépendance des régions anglophones en tant que République fédérale d'Ambazonie. Le gouvernement a répondu par une offensive militaire, et l'insurrection s'est étendue aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le 1er octobre 2017, Sisiku Julius Ayuk Tabe déclare symboliquement l'indépendance de la république fédérale d'Ambazonie, déclenchant une répression par les forces de l'ordre se soldant par des morts, des blessés, des émeutes, barricades, manifestations, couvre-feu, etc. En janvier 2018, le Nigéria compte entre 7 000 et 30 000 réfugiés liés au conflit et à la répression à la suite de cette déclaration d'indépendance. Le 5 janvier 2018, des membres du gouvernement intérimaire d'Ambazonie, dont le président Sisiku Julius Ayuk Tabe, sont arrêtés au Nigéria et déportés au Cameroun. Ils y sont arrêtés et passent 10 mois dans un quartier général de gendarmerie avant d’être transférés dans une prison à sécurité maximale de Yaoundé. Un procès débute en décembre 2018. Le 4 février 2018, il a été annoncé que Samuel Ikome Sako deviendrait le président par intérim de la République fédérale d'Ambazonie, succédant temporairement à Tabe. Sa présidence a vu l'escalade du conflit armé et son extension à tout le Cameroun anglophone. Le 31 décembre 2018, Ikome Sako déclare que 2019 verrait le passage d'une guerre défensive à une guerre offensive et que les séparatistes s'efforceraient d'obtenir une indépendance de facto sur le terrain. Le 20 août 2019 au matin le tribunal militaire de Yaoundé condamne Julius Ayuk Tabe et neuf autres de ses partisans à la réclusion criminelle à vie.
an 2017 : République de Centrafrique - En juin 2017, les affrontements à Bria, dans le centre-est du pays, font une centaine de morts. Par ailleurs, un comité est également mis en place afin de juger les principaux acteurs et dédommager les victimes.
an 2017 : Afrique République de Djibouti - En 2017, après les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon, la Chine obtient de pouvoir y implanter une base militaire. L'Espagne et l’Allemagne y ont aussi disposé de petits contingents.
an 2017 : Gabon - Le 2 février 2017, le Parlement européen adopte une résolution déclarant que les résultats de la présidentielle « manquent de transparence » et sont « extrêmement douteux ».
an 2017 : Ghana - Depuis 2017, Nana Akufo-Addo est président de la République.
an 2017 : Guinée-équatoriale - Le père et le fils Obiang sont poursuivis par la justice française sur des biens mal acquis, provenant notamment de détournements de fonds publics. Le fils Teodorin est finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Ce procès dit « des biens mal acquis », révélateur du pillage des richesses nationales, aboutit à une condamnation en octobre 2017, en première instance.
an 2017 : Kenya - L'organisation État islamique et les chebabs multiplient les attaques au Kenya depuis les années 2010, mettant en échec la politique sécuritaire du gouvernement. À ces attaques s'ajoute une instabilité politique interne dans les mois qui précèdent les élections générales d'août 2017. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, est finalement réélu et affiche un score électoral de 54,28 % des suffrages exprimés. Son rival Raila Odinga parle à nouveau de fraudes. Des émeutes éclatent avant un appel au calme par Raila Odinga, qui s'en remet une fois encore à la Cour suprême. Celle-ci, à la surprise générale, lui donne cette fois raison et invalide les élections, qui sont réorganisés en octobre 2017. Cette décision montre une consolidation progressive des contre-pouvoirs au Kenya à la suite de la constitution de 2010. À la suite des modifications de la loi électorale avant ce nouveau scrutin, Raila Odinga se retire et appelle au boycott de l'élection. Finalement, le président sortant Uhuru Kenyatta remporte le nouveau scrutin avec 98,26 % des voix, mais la participation le 26 octobre 2017 n'est que de 38,8 % des électeurs inscrits, à comparer à 79 % le 8 août 2017, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême.
an 2017-2022 : Lesotho - Les élections législatives de juin 2017, organisées de manière anticipées à la suite du vote d'une motion de censure à l'encontre du Premier ministre Pakalitha Mosisili après la dislocation de la coalition le soutenant, aboutissent à une alternance.
Le parti d'opposition Convention de tous les Basotho (ABC) remporte arrive en effet en tête des suffrages et remporte la majorité relative des sièges, tandis que le Congrès démocratique (DC) de Mosisili perd plus du tiers des siens. Mené par Tom Thabane, l'ABC forme un gouvernement de coalition avec trois autres partis, l'Alliance des démocrates (AD), le Parti national basotho (BNP) et le Congrès réformé du Lesotho (RCL), permettant à Thabane de devenir premier ministre.
Accusé d'avoir commandité le meurtre de son ex épouse Lipolelo Thabane deux jours avant sa prise de fonction en 2017, le Premier ministre est cependant conduit à la démission le 19 mai 2020. Remplacé le lendemain par lendemain par le ministre des Finances Moeketsi Majoro, qui prend également la tête de l'ABC, Thabane est par la suite officiellement inculpé pour meurtre fin novembre 2021.
L'organisation des législatives de 2022 est compliquée par la pandémie de Covid-19 et le manque de budget, qui pousse le gouvernement à repousser le scrutin de juin à septembre.
an 2017-2018 : Libéria - Le 26 décembre 2017, lors d'une nouvelle présidentielle; George Weah est élu avec 61,5 % des voix au suffrage universel face au vice-président sortant, Joseph Boakai, qui en obtient 38,5 %. Il met l'accent sur la lutte anticorruption et sur l'éducation. La situation économique dont hérite le nouveau président reste délicate, avec le poids de la dette sur le budget de l'État, et une inflation importante. À partir de juin 2019, l'état de grâce de George Weah est terminé : des manifestations sont organisées contre sa politique économique.
George Weah s’est fixé comme principal objectif d’améliorer la vie des Libériens grâce à la mise en œuvre d’un programme « pro-poor » qui vise les plus défavorisés. Il entend également parachever la réconciliation nationale, lutter contre la corruption, et développer les infrastructures, en particulier routières, dont le pays est largement dépourvu.
L’élection de George Weah marque par ailleurs un pas supplémentaire dans la stabilisation du pays, confirmée par le départ de la mission des Nations unies pour le Libéria (MINUL), le 30 mars 2018.
an 2017 : Mauritanie - Le 17 mars 2017, le projet de révision constitutionnelle soumis par le gouvernement est rejeté par le Sénat. Le président Aziz annonce l'organisation d'un référendum pour le 5 août 2017.
Le 6 juin 2017, la Mauritanie annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec le Qatar, et accuse le pays de propager l'extrémisme et l'anarchie dans de nombreux pays arabes.
Le référendum du 5 août 2017 donnent un «oui» qui l'emporte à plus de 85 %. Il comporte deux volets, la modification du drapeau national (85,6 % de «oui» et 9,9 % pour le «non») ainsi que la suppression du Sénat (85,6 % pour le « oui » et 10,02 % pour le « non »). Malgré le boycott de l'opposition et de la société civile, le taux de participation est de 53,75 % selon la commission électorale49. Leader des opposants à la suppression du Sénat, le sénateur d'opposition Mohamed ould Ghadde est arrêté le 10 août50. Plusieurs personnalités de l'opposition sont interrogées51. Plusieurs sénateurs, journalistes et représentants syndicaux, accusés de faits de corruption et tous opposants à la réforme constitutionnelle, comparaitront devant un juge d'instruction.
À la fin du mois d'octobre 2017, la première opération conduite par la Force antiterroriste G5 Sahel est lancée. Dénommée Hawbi, elle est constituée du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad et compte jusqu'à 5.000 hommes répartis dans sept bataillons.
Le 13 novembre 2017, le Sénat est dissout, les grilles de l’institution sont fermées et l'accès au bâtiment fermé, mais des sénateurs frondeurs forcent l'entrée et ouvrent une session parlementaire symbolique, qui ne dure en réalité que le temps que la police intervienne et déloge les élus.
Le 28 novembre 2017, le 57e anniversaire de l’indépendance est l'occasion de présenter le nouveau drapeau mauritanien ainsi que le nouvel hymne national, nouveaux emblèmes adoptés à l'issue du référendum constitutionnel du 5 août.
Esclavage
Le 28 avril 2017, la journaliste Tiphaine Gosse et la juriste Marie Foray qui enquêtent sur l'esclavage en Mauritanie sont expulsées du pays. Elles dénoncent aux côtés d'organisations engagées dans la lutte contre l’esclavage en Mauritanie telles que SOS-Esclaves, l’AMDH et l’Association des femmes chefs de famille (AFCF) « l’hypocrisie des autorités mauritaniennes », qui cherchent selon elles par la ratification des traités internationaux et l’adoption de lois qu'elle jugent incomplètes, à plaire à la communauté internationale sans lutter pour autant contre l’esclavage dans le pays.
Le 22 juin 2017, une plainte contre l’esclavagisme et la torture en Mauritanie est déposée devant l'ONU et l'UA. L'eurodéputé Louis Michel souligne que l'esclavage continue en Mauritanie. Biram Dah Abeid, le président de l'association IRA déplore l'acharnement des autorités mauritaniennes à l'encontre des militants anti-esclavagisme.
an 2017 : Mozambique - le spectre d'une nouvelle guerre civile s'éloigne début 2017. Par contre, un scandale de dettes cachées, à la fin du deuxième mandat d'Armando Guebuza, touche le FRELIMO même si le président a changé, et fragilise le pays. Des médias anglo-saxons démontrent l'existence d'emprunts contractés de façon opaque mais garantis par le gouvernement de l'époque, pour 1,8 milliard d’euros, par trois entreprises publiques. L'affectation précise des sommes reste floue, même s'il est indiqué que ces emprunts auraient financé un programme d'armement. Depuis, le Mozambique, incapable d’honorer les remboursements de ces dettes, est plongé dans une crise financière.
an 2017 : Rwanda - Une opposante, Diane Rwigara annonce son intention de se présenter à l'Élection présidentielle rwandaise de 2017. 72 heures plus tard, des photos d'elle dénudée sont divulguées, dans un but d'intimidation. Elle persiste dans sa candidature, mais cette candidature est invalidée le 7 juillet 2017, par la Commission électorale nationale. Cette candidate semble disparaître fin août 2017, puis la police rwandaise annonce son arrestation, pour atteinte à la sureté de l’État. Début octobre, elle est inculpée, ainsi que sa mère et sa sœur, d’« incitation à l’insurrection ». Elle est libérée sous caution quelques mois plus tard en signe d'apaisement, et finalement acquittée par un tribunal de Kigali le 6 décembre 2018, ainsi que les co-accusés. Selon le jugement, « les charges retenues par l’accusation sont sans fondement »
an 2018 : Afrique du Sud - Visé par des affaires de corruption, Jacob Zuma démissionne sous la pression de son parti début 2018, après avoir été menacé de destitution, et Cyril Ramaphosa lui succède comme président de la République par intérim. Le 15 février 2018, le Parlement élit formellement Cyril Ramaphosa président de la République.
Après avoir été élu président de l'ANC le 18 décembre 2017 contre Nkosazana Dlamini-Zuma (ex-femme de Jacob Zuma et ex-présidente de la commission de l'Union africaine), Cyril Ramaphosa obtient de haute lutte le 14 février 2018 la démission de Jacob Zuma de la présidence de la République. Ramaphosa lui succède comme président de la République par intérim avant d'être élu formellement par le parlement. Acculé par la gauche de l'ANC et par la surenchère des Economic Freedom Fighters (EFF), il se prononce en faveur d'une redistribution des terres aux Sud-Africains noirs afin de « panser les plaies du passé » alors que 72 % des terres agricoles restent détenues par des Blancs (personnes physiques ou sociétés commerciales) contre 85 % à la fin de l’apartheid. Le Parlement adopte alors une motion présentée par Julius Malema, le chef des EFF, visant à faire modifier la constitution sud-africaine et permettre, sans compensation financière, l'expropriation de terres agricoles. Une partie de l'opposition invoque une violation du droit de propriété, tandis que des investisseurs et le South African Institute of Race Relations déclarent craindre que cette réforme ne porte atteinte à l'agriculture commerciale et ne provoque une crise durable. En juillet 2018, le président sud-africain annonce que l'ANC compte amender la Constitution pour y faire entrer le principe d'expropriation des fermiers sans compensation, provoquant la chute de la devise nationale. Au delà des fermes, des experts sud-africains de l'Institute for Poverty, Land and Agragian Studies (Université du Cap-Occidental) et du Mapungubwe Institute for Strategic Reflection soulignent que d'autres types de propriétés pourraient être soumises au nouveau Code foncier, notamment en centre-ville (friches et terrains non exploités, bâtiments non entretenus...) ou en zone périphérique rurale (terrains miniers notamment). Mais cette réforme avance avec lenteur. Il est réélu chef de l’État le 22 mai 2019, à l’issue d’élections générales lors desquelles l’ANC obtient le plus faible score de son histoire (57,5 %), passant sous la barre des 60 % pour la première fois depuis un quart de siècle et payant ainsi les errements et les scandales de l'ère Zuma, son prédécesseur.
Il doit également faire face à une opposition interne au sein de l'ANC, avec un clan resté fidèle à Jacob Zuma, ayant à sa tête le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, et son adjointe, Jessie Duarte. Mais le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, connaît également des divisions internes : son leader, Mmusi Maimane, démissionne le 24 octobre 2019, dénonçant une « campagne de dénigrement », de « diffamation » et des « comportements de lâches », quittant à la fois la direction du parti, le parti lui-même et ses fonctions de parlementaire. Ce départ, ou cette éviction, risque de réduire à nouveau ce parti à un «parti de Blancs».
Une vague de xénophobie vis-à-vis des migrants, les «étrangers», secoue également le pays. Par ailleurs, plusieurs sociétés importantes pour l'économie africaine sont en difficulté, notamment la compagnie nationale d'électricité Eskom. Le 19 novembre 2019,au PDG est nommé pour cette entreprise, qui lance dans la foulée un nouveau plan de restructuration.
Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi.
En mars-avril 2020 il doit faire face à la pandémie mondiale de Covid-19 et obtient un certain succès.
an 2018-2019 : Bénin (anc. Dahomey) - En 2018 et 2019, des mouvements sociaux sont constatés mais ne remettent pas en cause la stabilité de la République béninoise. Par contre, une « contagion » djihadiste est constatée avec l'enlèvement de deux Français dans le parc national de la Pendjari, un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Afrique. Cet événement, même si les otages sont libérés par une intervention de forces françaises, confirme la possibilité de voir les groupes djihadistes descendre vers le golfe de Guinée au fur et à mesure de la déstabilisation du Burkina Faso, et du centre du Mali. Cela contrarie également les objectifs du président béninois, Patrice Talon, de développer le tourisme dans son pays.
an 2018-2019 : République de Botswana - Le 1er avril 2018, son vice-président, Mokgweetsi Masisi est désigné pour le remplacer comme président du Botswana. L'année suivante, en 2019, il remporte les élections générales.
an 2018-2019 : Cameroun - Paul Biya est réélu pour un septième mandat en 2018, dans un scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition. Il lance un «grand dialogue national» en 2019. Aucune avancée décisive n'en ressort sur le conflit dans les régions anglophones. Paul Biya fait libérer des détenus, mais les leaders du mouvement restent en prison.
an 2018 : République de Centrafrique - Depuis 2018, des mercenaires russes du Groupe Wagner et de la société privée Sewa Security Services (SSS) sont présents en Centrafrique, où ils participent à la formation de militaires des Forces Armées Centrafricaines (FACA) et à la protection rapprochée du Président centrafricain.
an 2018 : Congo Kinshasa - Le 30 décembre 2018, les élections ont lieu et le 10 janvier 2019, le président de la CENI, Corneille Nangaa proclame Félix Tshisekedi comme président de la république démocratique du Congo. Le président Tshisekedi prête serment le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation, résidence officielle des présidents congolais.
Félix Tshisekedi a noué une alliance de circonstance pendant la campagne électorale avec le parti de Joseph Kabila, devenu sénateur à vie et qui conserve ainsi une influence sur le pouvoir. Leur principal opposant, Martin Fayulu, donné un moment vainqueur de l'élection présidentielle, sur la base d'une fuite de données de la CENI et par la mission d’observation de l’Église catholique congolaise, est contraint de s'incliner devant le résultat annoncé, probablement truqué. La Cour constitutionnelle a rejeté son recours. Par cette alliance, Félix Tshisekedi joue aussi la stabilité et prépare la suite de son mandat en composant avec l'assemblée législative où le parti de Kabila possède 337 sièges sur 50064,65. Le 6 décembre 2020, le président met fin à la coalition avec Kabila. Les proches de ce dernier sont alors écartés et les autres politiciens rejoignent Félix Tshisekedi. Le nouvel exécutif compte 56 membres dont 14 femmes. Leur objectif sera de « lutter contre la corruption et la misère qui touche les deux tiers de la population et ramener la paix dans l’est du pays, ensanglanté par les violences des groupes armés".
2018-2019 : Égypte - En mai 2014, Abdel Fattah al-Sissi, est réélu pour un deuxième mandat.
Par une révision constitutionnelle validée par un référendum en avril 2019, il se donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Il impose un régime autoritaire, réprime toute opposition et toute voix critique, et met sous contrôle les médias et la justice.
an 2018-2019 : Eswatini (Swaziland) - En avril 2018, à l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance, le roi annonce que le pays reprend son nom d'origine d'avant la colonisation : Eswatini. En octobre 2019, la livraison de voitures de luxe flambant neuves, des Rolls Royce, à la famille royale d’Eswatini provoque des réactions négatives dans ce royaume très pauvre d’Afrique australe, alors que des fonctionnaires manifestent pour demander une revalorisation de leurs salaires.
an 2018 : Gambie - Le 8 février 2018, la Gambie adhère à nouveau au Commonwealth.
an 2018-2021 : Ghana - En 2018, cette nation est également endeuillée par la mort d'un de ses plus célèbres compatriotes, Kofi Annan. Sur le plan économique, le Ghana s'associe avec la Côte d'Ivoire, en 2019, pour obtenir des marchés un prix juste pour le cacao, en suspendant pendant quelques semaines la vente des récoltes 2020-2021. Il cherche à développer le tourisme vers ses terres au sein de la communauté afro-américaine, en mettant l'accent sur la mémoire de la traite négrière. Nana Akufo-Ado, d’inspiration libérale, mise aussi sur le développement de l’esprit d’entreprise. Il incite également la diaspora formée dans les pays occidentaux à revenir au pays, ou à y investir.
an 2018 : Guinée - D'après la Banque mondiale, en 2018, le chômage frappe 80 % des jeunes et près de 80 % de la population active travaille dans le secteur informel. Surtout, 55 % des Guinéens vivent sous le seuil de pauvreté.
an 2018 : Guinée-Bissau - Lors d'une réunion du 30 août 2018 du Conseil de sécurité de l'ONU, les signes d'une amélioration de la situation politique sont soulignés, mais il est rappelé que des points des accords de Conakry restent à réaliser : réforme constitutionnelle et réforme électorale.
an 2018-2020 : Libye - Par contre, la situation reste bloquée entre le Premier ministre Fayez el-Sarraj issu du gouvernement d'accord national (GAN) et le chef de l'Armée nationale libyenne (ANL) du Khalifa Haftar. Des médiations diplomatiques entre ces deux partis sont menées en France, en juillet 2017 à La-Celle-Saint-Cloud, en France toujours en mai 2018 au palais de l'Élysée, puis à Palerme en Italie en novembre 2018, laissant espérer la reprise d'un dialogue. Mais l'assaut militaire déclenché en avril 2019 par les troupes de l'Armée nationale libyenne (ANL) du Khalifa Haftar sur Tripoli, un assaut qui s'enlise ensuite, pulvérise à court terme les espoirs d'un règlement politique. Chacune des forces en présences, le GAN et l'ALN, multiplie les contacts et les alliances avec des puissances extérieures : notamment la Turquie pour le GAN, les Émirats arabes unis,l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Russie pour l'ALN. Une nouvelle initiative de médiation, turco-russe cette fois, pour obtenir la signature à Moscou d’un cessez-le-feu en Libye tourne court, en janvier 2020.
an 2018 - 2023 : Madagascar - Les élections de décembre 2018 portent au pouvoir pour 5 ans Andry Rajoelina. Celui-ci remporte également les élections législatives de mai 2019 et obtient la majoprité absolue à l'Assemblée nationale.
an 2018-2019 : Mali - La situation sécuritaire reste très précaire, avec de nombreuses attaques djihadistes. Les conflits communautaires persistent, occasionnant des centaines de morts, particulièrement dans la région de Mopti. En 2018, l'armée française poursuit ses opérations et particulièrement dans le Liptako Gourma, une zone entre le centre du Mali, le sud-ouest du Niger et le Burkina Faso.
Les djihadistes opèrent une guerre asymétrique : ils procèdent surtout par attaques surprises, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires. Le 23 mars 2019, des miliciens dogons font 157 morts lors du massacre d'Ogossagou, village peul situé près de Bankass, toujours dans le centre du pays. Beaucoup des victimes avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d’autres affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts en 2018 dans le centre du Mali, selon l’ONU. Les troupes françaises sont de plus en plus critiquées localement : poursuivre le combat accroît le risque d’enlisement et de compromission.
an 2018 : Mauritanie - Le premier janvier 2018, la Mauritanie change l'unité de sa monnaie. L'ouguiya passe d'une échelle de 10 à 1, dix ouguiyas deviennent un ouguiya. De nouveaux billets sont émis mais la monnaie conserve le même nom. Avant même l’annonce de la mise en circulation des nouveaux billets, la monnaie mauritanienne se déprécie au marché noir face à l’euro et au dollar, une tendance qui s'aggrave dès l'annonce officielle.
Le 20 mai 2018, le régime durcit la loi sur les partis politiques et un décret ouvre la voie à la dissolution des partis sous-représentés à l'échelle nationale et régionale.
Les élections locales et législatives du 15 septembre 2018 voient la victoire du parti au pouvoir, l'UPR, qui remporte les 13 Conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat, ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale et plus des deux tiers des communes. Le 8 octobre Cheikh ould Baya, député de l'UPR et proche du président, est élu président de l'Assemblée. Le 29 octobre 2018 Mohamed Salem Ould Bechir est nommé Premier ministre et nomme le lendemain un nouveau gouvernement.
Esclavage
Le 12 février 2018, l'ONG Human Right Watch présente à Nouakchott son rapport sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Intitulé « Ethnicité, discrimination et autres lignes rouges : répression à l’encontre de défenseurs des droits humains en Mauritanie » le rapport pointe les difficultés rencontrées par les militants traitant des questions sociales sensibles comme l'esclavage, la discrimination entre communautés ou le passif humanitaire du pays.
Le 25 mars 2018, un rapport sur la répression contre les militants des droits de l'Homme en Mauritanie est publié par Amnesty International. Le rapport avance que 43.000 personnes vivent en situation d'esclavage dans le pays. Amnesty International détaille également la façon dont les militants abolitionnistes et les associations qui dénoncent ces discriminations sont la cible des autorités108. Trois jours plus tard, la cour criminelle de Nouadhibou condamne un homme et une femme à respectivement 20 et 10 ans de prison ferme pour esclavagisme. Une première en Mauritanie.
Le 4 novembre 2018, les États-Unis, constatant le manque de progrès du pays en matière de lutte contre l'esclavage, suspendent la Mauritanie de l'AGOA.
Situation sanitaire et humanitaire
Le 26 juin 2018, la Mauritanie alerte sur des cas de malnutrution sévères touchant plusieurs dizaines d’enfants dans l’est du pays. La région du Hod Ech Chargui, non loin de la frontière avec le Mali, est particulièrement touchée.
En juin 2018, un rapport de l’ONU établi que les trois quarts des mauritaniens vivent dans une extrême pauvreté. Présenté durant la 35e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU par le rapporteur spécial Philip Alston, le rapport pointe les difficultés dans l'accès à l'eau, à l'alimentation, à l'éducation et à la santé de la population.
En décembre 2018, grâce à un don chinois, la capitale Nouakchott se dote d'un véritable réseau d'assainissement, absent jusqu'ici
an 2018-2020 : Nigéria - Entre 2011 et 2018, le bilan humain de ce violent conflit a été estimé à 37 530 morts.
Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest prend également part à l'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria. En août 2018, Mamman Nour, le numéro 2 de l'organisation, accusé d'être trop modéré, est assassiné par d'autres membres de l'EIAO et les partisans d'une ligne plus dure reprennent le dessus. Le groupe s'en prend alors de plus en plus aux civils. Le 26 décembre 2019, le groupe diffuse notamment une vidéo montrant l'exécution par balles de 11 chrétiens.
En novembre 2020, au moins 110 civils sont tués par des jihadistes présumés dans l'État de Borno sans que le massacre ne soit revendiqué par l'un des deux groupes.
an 2018 : Sierra Leone - En 2018, le pays connaît une nouvelle alternance politique entre les deux principaux partis. Le candidat de l’opposition, Julius Maada Bio, ancien militaire de 53 ans, remporte les présidentielles avec 51,81 % des voix, contre 48,19 % pour Samura Kamara, le candidat du parti précédemment au pouvoir, le Congrès de tout le peuple (APC)
an 2018 : Soudan - En 2018, le régime applique en 2018 un plan d'austérité du Fonds monétaire international, transférant certains secteurs des importations au secteur privé. En conséquence, le prix du pain est doublé et celui de l’essence augmente de 30 %. L’inflation atteint les 40 %. Des mouvements étudiants et le Parti communiste soudanais organisent des manifestations pour contester cette politique. Omar el-Bechir réagit en faisant arrêter le secrétaire général du Parti communiste et deux autres dirigeants du parti, et par la fermeture de six journaux.
an 2019 : Afrique du Sud - Cyril Ramaphosa est réélu chef de l’État le 22 mai 2019, à l’issue d’élections générales lors desquelles l’ANC obtient le plus faible score de son histoire (57,5 %), passant sous la barre des 60 % pour la première fois depuis un quart de siècle et payant ainsi les errements et les scandales de l'ère Zuma, son prédécesseur.
Il doit également faire face à une opposition interne au sein de l'ANC, avec un clan resté fidèle à Jacob Zuma, ayant à sa tête le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, et son adjointe, Jessie Duarte. Une vague de xénophobie vis-à-vis les migrants, les « étrangers », secoue également le pays.
an 2019-2022 : Algérie - Depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika et l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, le pays est dirigé par le président Abdelmadjid Tebboune.
an 2019 : Bénin (anc. Dahomey) - En décembre 2019, l’annonce, par le président ivoirien Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron, de la fin du franc CFA pour les huit pays de la CEDEAO, au profit de l'Eco est diversement qualifiée. Décision historique pour certains, d'autres la qualifient d’« arnaque » et de « poudre aux yeux ». Une parité fixe est maintenue pour la future monnaie avec l’euro
an 2019 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - - Dans la nuit du 3 au 4 février 2019, un groupe terroriste attaque la ville de Kaïn dans le département du même nom, au nord de la province du Yatenga. Le bilan est de 14 morts civils. L'armée réagit rapidement, avec des actions contre les groupes terroristes dans le nord-ouest du pays, déclarant avoir alors « neutralisé » 146 terroristes. À la veille du début de l'année de la présidence par le pays du G5 Sahel, l'attaque terroriste porte à près de 300 le nombre d'habitants assassinés par ces groupes depuis 201541. Le jour inaugural du G5 Sahel, mardi 5 février, un détachement de la gendarmerie est attaqué à Oursi, cinq militaires meurent, contre selon l'armée, 21 assaillants tués lors de l'attaque. L'insécurité croissante a entrainé la multiplication des milices. En 2020, le pays compterait près de 4 500 groupes de koglweogo, mobilisant entre 20 000 et 45 000 membres.
Pour faire face au crime organisé (attaques à main armée dans les lieux de travail et habitations, vols d'animaux et autres formes de violences ciblant notamment les populations rurales et périurbaines), des groupes d'autodéfense se sont constitués au sein de certaines communautés. Dénommés « koglwéogo », ils sont indépendants vis-à-vis de l'État, ne rendent comptes à personne. Ils agissent hors de tout cadre légal. Ils ont localement fait reculer la délinquance, mais des exactions commises par certains de leurs membres créent une nouvelle source d'insécurité et de péril pour les droits humains, et affaiblissent encore le système judiciaire légal (déjà critiqué pour son inefficacité par la population et les médias). Au sein de koglwéogo qui, sous prétexte d'une réponse citoyenne à la crise sécuritaire, « s'arrogent le droit d'arrêter, de juger et de sanctionner, par des amendes, sévices corporels et humiliations, au terme de tribunaux populaires expéditifs », de graves violences (torture notamment) sont observées. « De présumés voleurs sont ligotés au pied d'un arbre, fouettés avec des branches enflammées de tamarinier, le tout en public, et ce jusqu'à ce qu'ils avouent leur crime », bafouant les droits humains via une justice expéditive. Selon Amnesty international, « les Koglwéogo ont commis des exactions, telles que des passages à tabac et des enlèvements, poussant ainsi des organisations de la société civile à reprocher à l’État de ne pas agir suffisamment pour empêcher ces violences et y remédier ; une levée de boucliers qui avait amené l'Etat à condamner en septembre 2016 Koglwéogo à 6 mois d'emprisonnement, et 26 autres à des peines allant de 10 à 12 mois de prison avec sursis. Les 29 et 30 mai 2020, plusieurs attaques djihadistes ont fait une cinquantaine de morts à Kompienga48. Dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, une nouvelle attaque djihadiste tue plus de 160 personnes dont « une vingtaine d'enfants » à Solhan, un village situé au nord-est du pays. C'est l'attaque la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso depuis le début des assauts djihadistes, en 2015. En six ans, les violences ont déjà fait plusieurs milliers de morts, plus particulièrement dans les zones proches des frontières avec le Mali et le Niger
an 2019 : Afrique - Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa, Président d'Afrique du Sud, prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi
an 2019 : Cameroun - En 2019, les combats entre les guérillas séparatistes et les forces gouvernementales se poursuivent.
an 2019 : République de Centrafrique - Le 6 février 2019, l'État centrafricain signe avec les 14 principaux groupes armés du pays un nouvel accord de paix négocié en janvier à Khartoum (Soudan). Malgré cet accord, 80 % du territoire restent contrôlés par des groupes armés et les massacres de populations civiles continuent.
an 2019-2020 : Gabon - Le 7 janvier 2019, une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence après un accident vasculaire cérébral, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour ; sur cinq mutins, deux sont tués et les autres arrêtés. Le 12 janvier, un nouveau Premier ministre est nommé, Julien Nkoghe Bekalé. Le pouvoir gabonais connaît une guerre des clans au sommet. Les remaniements ministériels se succèdent entre janvier et décembre 2019, alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé d'Ali Bongo. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée première ministre en juillet 2020.
an 2019 : Gambie - Le 27 août 2019, Dawda Jawara décède, il avait était premier Premier ministre de Gambie entre 1962 et 1970, puis le premier président de la République de Gambie de 1970 à 1994.
an 2019 : Guinée-Bissau - élection présidentielle de fin 2019 voit la défaite du candidat de l'ex-parti unique, au pouvoir depuis 1974, le PAIGC, et la victoire d'Umaro Sissoco Embaló, ancien général et ancien Premier ministre devenu opposant. La confirmation de ce résultat est compliquée, donnant lieu à des allers et retours entre la Commission électorale et la Cour suprême (saisie par le PAIGC), mais c'est la première transition politique qui s'effectue pacifiquement.
an 2019 : Guinée équatoriale - La population de Guinée équatoriale vit dans des conditions précaires. Bata, seconde ville du pays et capitale économique, a été ainsi privée d'eau courante pendant trois semaines en 2019, sans que les autorités s'expliquent sur les difficultés rencontrées.
an 2019 : Mali - Les djihadistes opèrent une guerre asymétrique : ils procèdent surtout par attaques surprises, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires. Le 23 mars 2019, des miliciens dogons font 157 morts lors du massacre d'Ogossagou, village peul situé près de Bankass, toujours dans le centre du pays. Beaucoup des victimes avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d’autres affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts en 2018 dans le centre du Mali, selon l’ONU. Les troupes françaises sont de plus en plus critiquées localement : poursuivre le combat accroît le risque d’enlisement et de compromission.
an 2019 : Iles Maurice - À la lignée des Ramgoolam succède celle des Jugnauth. Pravind Jugnauth remporte les législatives de 2019.
Le 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution demandant au Royaume-Uni de rétrocéder sous six mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos. Ce délai a pris fin le 22 novembre 2019, sans que le Royaume-Uni se conforme à cette résolution, ni à l'avis consultatif formulé en février par la Cour internationale de justice (CIJ) demandant à Londres de mettre fin « dans les plus brefs délais » à son administration des Chagos.
an 2019 : Mauritanie - Le 28 janvier 2019, un projet de loi est voté autorisant un accord de coopération entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite en matière de lutte contre le trafic d'armes et d'êtres humains. L’opposition mauritanienne crie au scandale, pointant le manque de crédibilité du royaume wahhabite en matière du respect des droits de l’homme.
Le 5 mars 2019, à trois mois de la présidentielle, 76 partis politiques sont dissous par décret rendu public par le ministre mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation. Le 9 mai, six candidatures à la présidentielle du 22 juin 2019 sont validées par le Conseil constitutionnel.
Le 20 mai, une série de nominations faites en conseil des ministres dans les semaines qui précèdent l'élection présidentielle sont dénoncées par plusieurs candidats.
Le 1er juillet 2019, la victoire du général Mohamed Ould Ghazouani dès le premier tour, avec 52 % des voix, est proclamée par le Conseil constitutionnel mauritanien, dans un climat délétère, avec une coupure prolongée d'internet et un déploiement des unités d’élite de l’armée, de la garde et de la police anti-émeute dans toute la capitale, Nouakchott. L'opposition dénonce de multiples irrégularités dans le déroulement du scrutin et qualifie la déclaration de victoire du candidat du pouvoir le soir du premier tour de «nouveau coup d'État».
Le 8 août 2019, le président Ghazouani nomme son premier gouvernement, dirigé par le premier ministre désigné le 3 août, Ismael Ould Bodé Ould Cheikh Sidiya.
Le 19 mars 2019, la police mauritanienne refoule une délégation d'Amnesty International à son arrivée à l'aéroport de Nouakchott
Le 22 mars 2019, les blogueurs Abderrahmane Weddady et Cheikh Ould Jiddou, connus pour dénoncer les atteintes aux droits de l'Homme en Mauritanie sont emprisonnés. Amnesty International explique qu'« Ils ont critiqué la corruption qui régnerait au sein du gouvernement dans des commentaires sur Facebook ». Les deux blogueurs avaient repris sur leurs blogs des articles publiés par des médias arabes faisant état d’un placement présumé de deux milliards de dollars aux Émirats arabes unis par un proche du chef de l’État. Amnesty International qualifie par ailleurs leur détention d’illégale. D'autres ONG comme Reporters Sans Frontières et Human Right Watch dénonceront à leur tour l'arrestation des deux blogueurs.
Le 5 juillet 2019, une vingtaine de journalistes manifestent devant le ministère la Communication et demandent la libération de leur confrère Ahmed Ould Wedia, interpellé chez lui trois jours auparavant.
En mai 2019, la France et la Mauritanie signent un accord de financement d'un montant de 4,4 milliards d'ouguiyas (11 millions d'euros), afin de financer des projets hydrauliques destinés à améliorer les conditions de vie de la population.
Esclavage
Le 28 janvier 2019, un projet de loi est voté autorisant un accord de coopération entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite en matière de lutte contre le trafic d'armes et d'êtres humains. L’opposition mauritanienne crie au scandale, pointant le manque de crédibilité du royaume wahhabite en matière du respect des droits de l’homme.
Les séquelles de l'esclavage touchent particulièrement la population Haratine, qui faute d'accès à l'éducation concentre 85 % des analphabètes du pays
Situation sanitaire et humanitaire
En mai 2019, la France et la Mauritanie signent un accord de financement d'un montant de 4,4 milliards d'ouguiyas (11 millions d'euros), afin de financer des projets hydrauliques destinés à améliorer les conditions de vie de la population.
an 2019 : Mozambique - Le président Filipe Nyusi est réélu en octobre 2019 pour un deuxième mandat de cinq ans avec 73 % des suffrages. Son parti, le FRELIMO, remporte 184 des 250 sièges à l’Assemblée nationale et dirige l’ensemble des dix provinces du pays. Ce scrutin a été manipulé comme les précédents pour en garantir le résultat : redécoupage de la carte électorale pour gonfler l’importance des bastions du pouvoir, mise à disposition constante des moyens de l’Etat pour la campagne du parti au pouvoir, tracasseries pour les opposants, usage de la violence, etc., le FRELIMO montre une volonté d’hégémonie. Ceci pose aussi la question d’un processus de paix jamais arrivé à son terme depuis le premier accord avec l’ancienne rébellion de la Résistance nationale mozambicaine (RENAMO), en 1992. Ossufo Momade a été le candidat de la RENAMO, mouvement affaibli par la mort de son chef historique, Afonso Dhlakama, en 2018.
Le Mozambique peut devenir l'un des grands producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, avec d'importantes réserves, et devient à ce titre un pays courtisé. Les ressources en gaz naturel devraient être exploitées en particulier dans la province de Cabo Delgado d’ici à cinq ans. Total, notamment, a finalisé son entrée fin septembre 2019 dans l’un des deux projets majeurs, Mozambique LNG.
an 2019 : Namibie - En 2019 a lieu L'élection présidentielle namibienne de 2019, en même temps que les élections législatives. Le président sortant Hage Geingob, de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (abrégée en SWAPO) est réélu avec un score, en baisse, de 56 % des suffrages. La SWAPO est au pouvoir depuis 1990. La participation au scrutin présidentiel a été de 60 %. Les autres candidats ont été Panduleni Itula, candidat dissident de la SWAPO qui obtient 30 % des suffrages. Il est en tête dans la capitale du pays. Le chef de l’opposition, McHenry Venaani, ne récolte que 5,4 %. La proximité passée de son parti, le Mouvement démocratique populaire (PDM) (ex-Alliance démocratique de la Turnhalle), avec le régime de l'apartheid en Afrique du Sud de l’apartheid, continue à être un repoussoir pour une grande part de l’électorat. Un nouveau parti d’opposition émerge, le Mouvement des sans-terre (LPM) de Bernadus Swartbooi : Bernadus Swartbooi réunit 2,8 % des suffarges exprimés.
La SWAPO est critiquée pour des scandales de corruption et ses résultats politiques sont affectés aussi par la situation économique et l'importance du chômage. Le secteur minier reste important. Mais la chute des cours des matières premières a réduit les recettes. Par ailleurs, une sécheresse persistante depuis plusieurs saisons a contribué aussi à faire reculer le produit intérieur brut (PIB) deux ans de suite, en 2017 et en 2018. « Les moyens de subsistance d’une majorité de Namibiens sont menacés, notamment ceux qui dépendent des activités de l’agriculture », n'a pu que déplorer la première ministre Saara Kuugongelwa-Amadhila. Le chômage touche un tiers de la population.
an 2019 : Soudan - En 2019, un vaste mouvement de protestation contre le régime se forme dans les villes de l’extrême nord du pays, en particulier autour d'Atbara, agglomération ouvrière et fief du syndicalisme soudanais. Les manifestants réclament initialement de meilleures conditions de vie (plus de vingt millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté), puis, alors que la répression s’accentue, la démission du président.
Le 11 avril 2019, Omar el-Bechir est renversé par l'armée. Le ministre de la Défense Ahmed Awad Ibn Auf annonce la mise en place d'un gouvernement de transition pour deux ans jusqu'à de nouvelles élections libres.
Le 12 avril 2019, au lendemain de la destitution du président, le Conseil militaire de transition déclare que le futur gouvernement sera un gouvernement civil en promettant un dialogue entre l'armée et les politiciens soudanais. L'armée entame alors des discussions avec les autorités civiles d'opposition et les organisations représentant les manifestants. Le 3 juin 2019, alors que les négociations piétinent et que les manifestants campent devant le QG de l'armée depuis près de deux mois, l'armée et la milice des Forces de soutien rapide tirent sur la foule pour tenter de déloger les manifestants causant un massacre. Le 4 juin 2019, le chef du Conseil militaire de transition, Abdel Fatah al-Burhan, annonce la fin des négociations avec les civils et promet la tenue d'élections d'ici 9 mois.
Le 21 août, à la suite d'un accord, le Conseil militaire de transition devient le Conseil de souveraineté. Il maintient les président et vice-président sortants en place mais dispose de membres civils. Abdallah Hamdok est nommé Premier ministre. Il annonce la composition d'un gouvernement de transition début septembre 2019, un gouvernement composé de dix-huit membres dont quatre femmes, notamment Asma Mohamed Abdallah une diplomate expérimentée qui devient ministre des affaires étrangères : « La première priorité du gouvernement de transition est de mettre un terme à la guerre et de construire une paix durable », est-il précisé, faisant référence aux conflits et rébellions qui pèsent sur le Darfour, le Nil Bleu et le Kordofan du Sud.
an 2020 : UNION AFRICAINE - Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud, prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi.
an 2020 : Burundi - La situation économique continue à se dégrader. Début 2020, le général Évariste Ndayishimiye est désigné comme candidat pour l’élection présidentielle du 20 mai 2020 par le parti au pouvoir, pour succéder à Pierre Nkurunziza. Il remporte l'élection présidentielle du 20 mai 2020, en obtenant 68,72 % des voix et devance très largement le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, président du Conseil national pour la liberté (CNL), qui réunit 24,19 % des voix.
an 2020 : Cameroun - Au cours de l'année 2020, de nombreuses attaques terroristes - dont beaucoup ont été menées sans revendication - et les représailles du gouvernement ont fait couler le sang dans tout le pays. Depuis 2016, plus de 450 000 personnes ont fui leurs foyers. Le conflit a indirectement conduit à une recrudescence des attaques de Boko Haram, l'armée camerounaise s'étant largement retirée du nord pour se concentrer sur la lutte contre les séparatistes ambazoniens. Paul Biya est réélu pour un septième mandat en 2018, dans un scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition. Il lance un « grand dialogue national », mais aucune avancée décisive n'en ressort sur le conflit dans les régions anglophones. Paul Biya fait libérer des détenus, mais les leaders du mouvement restent en prison.
Les élections législatives et municipales du 9 février 2020 entraînent un regain de violence dans les régions anglophones du Cameroun, autour de la tentative d'indépendance de l'Ambazonie. Les groupes armés séparatistes promettent des représailles à ceux qui iraient voter, en réaction le gouvernement central du Cameroun augmente ses effectifs militaires dans la zone. Dans les deux semaines précédant les élections, selon Human Rights Watch, les rebelles séparatistes enlèvent plus d'une centaine de personnes dans les deux régions anglophones, tandis que les forces de sécurité commettent de nombreux abus de pouvoir. Le 7 février 2020, c'est depuis sa cellule à la prison centrale de Yaoundé que Sisiku Julius Ayuk Tabe, président du gouvernement intérimaire d’Ambazonie, déclare, qu’ils sont plus que jamais engagés dans une indépendance totale ou une résistance à jamais.
Les violences se poursuivent après les élections. Ainsi, le 16 février 2020, 22 civils dont 14 enfants et 1 femme enceinte sont massacrés à Ntumbaw, un village du Nord-Ouest. l'opposition camerounaise (surtout le Mouvement pour la renaissance du Cameroun) et les ONG locales accusent l'Armée et le gouvernement d'avoir perpétré le massacre, dans un contexte de répression de la tentative de sécession de l'Ambazonie.
Le 21 avril 2020, le régime camerounais admet sa responsabilité, expliquant que l'Armée et un groupe d'autodéfense allié avaient attaqué des indépendantistes, tuant 5 d'entre-eux, puis s'étaient rendus compte que leur assaut avait également tué accidentellement les femmes et les enfants, et avaient alors décidé de déclencher l'incendie pour tenter de masquer leurs faits.
Le 2 juillet 2020, déjà très impliquée lors de la tenue des assises du « grand dialogue national », l'Église catholique a de nouveau joué les facilitateurs lors de la récente prise de contact entre les séparatistes anglophones emprisonnés à Yaoundé et des émissaires du gouvernement. C'est d'ailleurs au centre épiscopal de Mvolyé, dans la capitale camerounaise, que cette rencontre s'est tenue. Pour l'occasion, Julius Ayuk Tabé, le président autoproclamé de l'Ambazonie et quelques-uns de ses partisans avaient été spécialement extraits de leurs cellules pour entamer des discussions avec les autorités du gouvernement. Entre eux, un témoin privilégié : Monseigneur Andrew Nkea Fuanya, archevêque de Bamenda. Cette nouvelle implication de l'Église catholique pour tenter de rapprocher les parties en conflit de la crise dans les régions anglophones a été plutôt bien perçue par nombre d'observateurs, alors que jusqu'ici une sorte de crise de confiance semble installée de part et d'autre entre protagonistes. D'autant que dix mois après la tenue du Grand dialogue national, les résolutions qui en avaient été issues tardent à être mises en application. Notamment le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le 20 août 2020, Le procès en appel du leader séparatiste anglophone Sisiku Ayuk Tabe et de ses neuf co-accusés a été une nouvelle fois reporté. Une partie des magistrats affectés à ce dossier ayant été récemment mutés, la cause a été renvoyée au 17 septembre 2020.
Le 17 septembre 2020, Une Cour d’appel camerounaise a confirmé, la condamnation à la prison à vie prononcée en 2018 contre Sisiku Ayuk Tabe. Sisiku Ayuk Tabe avait été jugé coupable « sécession » et « terrorisme », en lien avec le conflit dans les régions anglophones du Cameroun. Il s’était autoproclamé président de l’Ambazonie, nom donné par les indépendantistes anglophones à l’ancien Cameroun du Sud britannique, non reconnu internationalement. Lors de l’audience la Cour d’appel a estimé que le tribunal militaire qui avait condamné Sisiku Ayuk Tabe et ses coaccusés le 20 août 2019 a bien dit le droit. Elle a donc confirmé la prison à vie pour les accusés, assortie d’une amende de 250 milliards de francs CFA.
Dans les deux régions à majorité anglophones du Cameroun, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, des indépendantistes s’opposent violemment à l’armée depuis 2017 et les deux camps sont régulièrement accusés d’exactions contre des civils par des ONG. Au moins 3 000 personnes ont perdu la vie et plus de 700 000 autres ont dû fuir leur domicile, selon les Nations unies.
an 2020-2021 : République de Centrafrique - En décembre 2020, des mercenaires russes du groupe Wagner s'engagent aux côtés de l'armée centrafricaine, des forces de la MINUSCA et des forces rwandaises contre les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement qui veulent prendre Bangui et empêcher la tenue des élections présidentielle et législatives. Le 31 mars 2021, le Groupe de travail des Nations unies sur les mercenaires a dit sa préoccupations sur des violations répétées des droits de l'Homme par les mercenaires du groupe Wagner. Une enquête de RFI a collecté de nombreux indices, dont des documents confidentiels et des témoignages allant en ce sens. Le gouvernement centrafricain a réagi en mettant en place une commission d'enquête. La Russie a dénoncé « de fausses nouvelles » qui « servent les intérêts des malfaiteurs qui complotent pour renverser le gouvernement ».
an 2020 : Afrique Côte d'Ivoire - En novembre 2020, Alassane Ouattara est réélu pour un troisième mandat avec 94,27 % des voix lors d'un scrutin très critiqué puisque l'opposition avait demandé à le boycotter, contestant la constitutionnalité d'un troisième mandat. Finalement, seuls 53,90 % des électeurs se sont rendus aux urnes pour élire le président sortant.
an 2020-2021 : Éthiopie - les relations entre le gouvernement fédéral et celui de la région du Tigré se dégradent rapidement après les élections. Le 4 novembre 2020, le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) lance une attaque contre des bases des Forces de défense nationale éthiopiennes à Mekele, la capitale du Tigré, et à Dansha, une ville de l’ouest de la région. La guerre du Tigré escalade et se poursuit depuis cette date.
Les Forces de défense tigréennes ont repris la capitale régionale, Mekele, forçant le gouvernement éthiopien à décréter, le lundi 28 juin 2021, un « cessez-le-feu unilatéral »
Le 28 juin 2021, sept mois après avoir dû abandonner Mekele face aux assauts de l’armée gouvernementale éthiopienne, les forces du Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) reprennent le contrôle de la capitale provinciale du Tigré. Dans cette région du nord de l’Éthiopie, en guerre depuis novembre 2020, les derniers jours ont été le théâtre d’un spectaculaire renversement de situation militaire, forçant le gouvernement éthiopien à décréter un cessez-le-feu.
En marge du conflit au Tigré éthiopien, l’armée soudanaise tente de reprendre la main sur le triangle d’Al-Fashaga, un territoire agricole disputé par L’Éthiopie et le Soudan, pays de la Corne de l'Afrique. C’est un bras de fer qui menace de dégénérer, dans le sillage du conflit en cours dans la province éthiopienne du Tigré. En jeu : le triangle d’Al-Fashaga, soit 250 km2 de terres fertiles coincées entre les rivières Tekezé et Atbara, au cœur d’une dispute historique entre le Soudan et l’Éthiopie.
Début novembre 2021, plusieurs États occidentaux ordonnent à leurs nationaux de quitter l'Éthiopie, en prévision d'une éventuelle prise d'Addis-Abeba par le TPLF accompagnée d'exactions tribales. À ce stade le conflit a coûté, outre des milliers de morts, le déplacement forcé de plus de deux millions de personnes et un risque de famine pour cinq millions.
an 2020 : Guinée - En mars 2020, en dépit des manifestations et du désaccord de la grande partie de la population et de l'opposition et ce malgré une loi stipulant qu'aucun président ne peut se présenter pour plus 2 mandats consécutifs, Alpha Condé modifie la Constitution pour pouvoir légalement se représenter. Il est alors officiellement candidat pour un troisième mandat pour les élections s'étant tenues en octobre 2020.
an 2020 : Guinée-Bissau - L'investiture d'Umaro Sissoco Embaló a lieu le 27 février 2020. La passation de pouvoir s'effectue ensuite au palais présidentiel. Nuno Gomes Nabiam est nommé Premier ministre le lendemain, le 28 février 2020. Mais une incertitude subsiste : une partie des députés investissent comme président, le 28 février au soir, le président de l’Assemblée nationale, Cipriano Cassama, par intérim. Pour eux, l'investiture de Umaro Sissoco Embalo n'est pas légale.
an 2020 : Libéria - Le 1er octobre 2020, le Président Weah a procédé à un remaniement de son gouvernement et a formé un gouvernement d’union nationale pour faire face notamment aux défis sociaux, économiques et sanitaires auxquels le pays est confronté.
La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2023.
an 2020 : Mali - En 2020, dans un contexte d'élections législatives contestées et de manifestations massives menées par le M5-RFP, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrêté par des mutins et démissionne sur les ondes de l'ORTM, à minuit le 19 août 2020. Quelques heures plus tard, le Comité national pour le salut du peuple prend le pouvoir. Il est présidé par Assimi Goïta et dispose des services d'Ismaël Wagué comme porte-parole. Ce coup d'État est condamné de manière unanime par la communauté internationale.
Assimi Goïta en tant que président du CNSP la junte militaire qui a renversé Ibrahim Boubacar Keîta le 18 août 2020.
Bah N'Daw après avoir été designé par le CNSP Président de la Transition le 21 septembre 2020 puis renversé par un coup d'État.
an 2020 : Iles Maurice - Le 15 janvier 2020, Pravind Jugnauth premier ministre des île Maurice, était à Londres pour assister à un sommet sur les investissements de la Grande-Bretagne en Afrique. il s'est entretenu avec les chefs des gouvernements de l'Afrique du Sud, du Kenya, de Côte d'Ivoire et du Mozambique. Il a indiqué que : « Port-Louis étudiait la possibilité d’entamer des poursuites contre des responsables britanniques devant la Cour pénale internationale pour crime contre l’humanité ».
an 2020 : Mozambique - Depuis deux ans un groupe d’islamistes armés a déclenché une insurrection dans cette région du nord du pays. Les combats se déroulent à quelques kilomètres des futures installations gazières et le port de Mocimboa da Praia est pris par les insurgés en août 2020.
an 2020 : Namibie - Le 21 mars 2020, la Namibie célèbre son trentième anniversaire d'indépendance.
an 2020 : Nigéria - En octobre 2020, le pays est secoué par d'importantes manifestations protestant contre l'oppression et la brutalité policières – connues nationalement, et mondialement, sous le nom de #EndSARS (abréviation de “End Special Anti-Robbery Squad”). Ce mouvement populaire est violemment réprimé par les autorités.
an 2020 : Somalie - Le pays se mobilise également début 2020 contre une invasion de criquets pèlerins qui touche la Corne d'Afrique et plusieurs régions d'Afrique de l'Est.
an 2020 - 2021 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - John Magufuli acquiert une popularité, notamment grâce à sa lutte contre le gaspillage de l'argent public et contre la corruption, mais fait preuve également de dérives autoritaires, contre ses opposants, contre les libertés individuelles, contre la presse, etc. Il est réélu pour un second mandat en octobre 2020. Il meurt en fonction en mars 2021 et sa vice-présidente Samia Suluhu lui succède.
an 2021 : Bénin (anc. Dahomey) - Le 11 avril 2021, Patrice Talon est réélu Président de la République.
an 2021 : Cap Vert - En octobre 2021, se déroule l'élection présidentielle cap-verdienne de 2021, remportée par José Maria Neves
an 2021 : Congo Brazzaville - Fin décembre 2019, Denis Sassou-Nguesso est à nouveau désigné candidat de son parti (le PCT) à la présidentielle de 2021. Le 23 mars 2021, la commission électorale annonce que Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 88,57 % (résultats provisoires officiels). La participation est estimée à 67,55 % et son principal opposant, Guy Brice Parfait Kolélas, (mort de la Covid-19 le lendemain de l'élection), recueille 7,84 % des voix. Ses opposants annoncent former des recours. Le 6 avril 2021, la Cour constitutionnelle de la République du Congo a entériné la réélection du président Denis Sassou-Nguesso au scrutin du 21 mars, après avoir rejeté les recours de l'opposition.
an 2021 : République de Djibouti - Le 9 avril 2021, Ismaël Omar Guelleh a été réélu, avec 98,58 % des voix, selon les chiffres officiels provisoires.
an 2021 : Gambie - Adama Barrow est réélu président de la République le 5 décembre 2021.
an 2021 : Guinée - Le 5 septembre 2021, un coup d'État des forces spéciales, dirigées par Mamadi Doumbouya, mène à la capture d'Alpha Condé. Une junte prend le pouvoir.
Mamadi Doumbouya devient alors président du Comité national du rassemblement pour le développement et président de la Transition.
an 2021-2022 : Libye - Le 24 décembre 2021 devraient avoir lieu une élection présidentielle et en janvier 2022 des élections législatives.
an 2021 : Mali - Le 24 mai 2021, le président de transition Bah N'Daw et le premier ministre de transition Moctar Ouane sont interpellés et conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta démet N'Daw et Ouane de leurs fonctions. Suite à ce coup d'Etat, la France décide de mettre un terme à l'Opération Barkhane et appuie le développement international de la Task Force Takuba notamment pour sécuriser la région du Liptako
Assimi Goïta (Vice-président) de facto président de la transition après l'arrestation et la démission du Premier Ministre Moctar Ouane et du président de la transition Bah N'Daw par Assimi Goïta le lundi 24 mai 2021 et le mardi 25 mai 2021.
an 2021 : Namibie - En mai 2021 l’Allemagne et la Namibie sont parvenus à se mettre d’accord sur un document qui établit les responsabilités de l'Allemagne ex-puissance coloniale durant le Génocide des Héréro et des Namas.
an 2021-2022 : Somalie - En 2021 et 2022, le pays connait une importante sécheresse, provoquant des problèmes de disette importante pour près de 7,8 millions de personnes soit presque 50 % de la population.
an 2021 : Togo - En 2021, David Ekoué Dosseh, un professeur de médecine à l'origine de Togo Debout, la « plateforme citoyenne » créée le 22 septembre 2017, est sur la liste établie par le collectif Forbidden Stories de 300 Togolais espionnés par le logiciel Pegasus.
an 2021 : Soudan - Une tentative de putsch a lieu le 21 septembre 2021. Les responsables sont arrêtés.
Un coup d'État militaire a lieu en octobre 2021, menant à l'arrestation de civils dont le premier ministre. Le 25 octobre, des membres de l'armée tirent sur des civils refusant le putsch.
an 2021 : Tchad - Le 20 avril 2021, un Conseil militaire de Transition dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, alors général de l'armée tchadienne et fils du président Idriss Déby Itno, prend le pouvoir à la suite du décès de ce dernier, dont on soupçonne que la mort soudaine soit liée à un assassinat non ciblé lié à des affrontements avec le Fact, un groupe armé libyen. Cette prise du pouvoir ne respecte pas la Constitution de la République du Tchad, promulguée le 4 mai 2018, qui est alors suspendue par l'Armée, en même temps que l'Assemblée nationale est dissoute.
Au moment de prendre le pouvoir, l'armée promet que des élections libres et démocratiques seront organisées au Tchad sous dix-huit mois, après une période de transition et d'apaisement.
an 2021 : Togo - En 2021, David Ekoué Dosseh, un professeur de médecine à l'origine de Togo Debout, la « plateforme citoyenne » créée le 22 septembre 2017, est sur la liste établie par le collectif Forbidden Stories de 300 Togolais espionnés par le logiciel Pegasus.
an 2021-2022 : Tunisie - Crise politique de 2021-2022
Le 25 juillet 2021, invoquant l'article 80 de la Constitution, Kaïs Saïed limoge le gouvernement, annonce la suspension de l'Assemblée des représentants du peuple — dont il lève l'immunité des membres —, la formation d'un nouveau gouvernement — qui sera responsable devant lui — et sa décision de gouverner par décrets ; il indique également qu'il présidera le parquet. Ennahdha dénonce aussitôt un « coup d'État ». Cette qualification de coup d'État est partagée par des analystes politiques et juristes, notamment en ce qui concerne la suspension des travaux parlementaires.
Le 22 septembre, il confirme par décret le prolongement des décisions ainsi que la dissolution de l'Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, et décide de suspendre les salaires et les bénéfices accordés au président de l'Assemblée des représentants du peuple et ses membres, et s'octroie le droit de gouverner par décret, récupérant de facto le pouvoir législatif. Le 13 décembre, il annonce la tenue d'un référendum constitutionnel, prévu à l'été 2022.
Le 30 mars 2022, après la réunion virtuelle de 120 députés pour voter la fin des mesures d'exception en vigueur, Kaïs Saïed dissout le Parlement, ce qu'interdit pourtant la Constitution durant la période où l'état d'exception est appliqué, et menace les députés de poursuites judiciaires.
an 2022 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Le 23 janvier 2022 a lieu un coup d'État. Les putschistes, rassemblés sous la bannière du « Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration » et menés par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, annoncent la fermeture des frontières terrestres et aériennes à partir de minuit, la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale ainsi que la « suspension » de la Constitution. Le 24 janvier 2022, certains médias locaux et internationaux relaient une information selon laquelle le président de Faso serait détenu par des soldats mutins. D'autres médias assurent que c'est une information erronée. Le 1er mars 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, signe un plan pour entamer une transition de trois ans vers la démocratie.
an 2022 : République de Centrafrique - En avril 2022, une "opération" militaire menée par l’État centrafricain et des paramilitaires russes cause la mort de dizaines de civils dans les villages de Gordil et Ndah, au Nord-Est de la capitale. Suite à ce massacre, l'ONU indique ouvrir une enquête.
an 2022 : Érythrée - Le 2 mars 2022, l'Érythrée est l'un des cinq pays de l'ONU votant contre la résolution ES-11/1 ayant pour but de sanctionner et condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
an 2022 : Guinée - mars 2022 En Guinée, déchu il y a plus six mois par un coup d’état militaire le 5 septembre 2021, Alpha Condé ne prendra plus la tête du parti qu’il a lui-même créé dans la clandestinité au début des année 1990. En attendant le prochain président du RPG, un intérimaire a été porté à la tête de l’ancien parti au pouvoir. En réunion extraordinaire, ce jeudi 10 mars 2022, les cadres du parti ont désigné l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana comme président par intérim.
mai 2022 Transition prolongée en Guinée : l’opposition dénonce une « décision unilatérale » et une « durée injustifiable ». Le colonel Mamadi Doumbouya, auteur du putsch contre Alpha Condé, prévoit un délai de trente-neuf mois avant d’organiser d’éventuelles élections.
an 2022 : Lesotho - Les élections législatives lésothiennes de 2022 ont lieu en septembre 2022 afin de renouveler les membres de l'assemblée nationale du Lesotho.
Le Lesotho est une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement bicaméral dont la chambre basse, l'assemblée nationale est composée de 120 députés élus pour un mandat de cinq ans au suffrage direct. Son mode de scrutin, mixte, s'apparente au système électoral allemand, bien que les électeurs n'aient qu'un seul vote pour exprimer leur choix. Sur les 120 sièges, 80 sont pourvus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales uninominales. L'ensemble des votes pour chacun des partis est ensuite regroupé au niveau national, nonobstant ceux des indépendants, et les quarante sièges restants répartis entre eux de manière à rapprocher la composition de l'assemblée à celles des résultats en part des voix.
an 2022 : Mali - Les autorités maliennes responsables du coup d'Etat s'engagent auprès de la Communauté internationale à « organiser des élections présidentielles et législatives avant le 27 février 2022 ». Cet engagement non tenu et le partenariat des autorités maliennes avec le groupe paramilitaire russe Wagner conduisent le 17 février 2022 à l'annonce du retrait de la Task Force Takuba.
Le 16 mai 2022, le gouvernement d'Assimi Goïta révèle avoir réussi à déjouer un coup d'Etat mené par des militaires maliens dans la nuit du 11 au 12 mai. Selon les sources officielles du gouvernement, cette tentative de putsch avortée a été « soutenue par un Etat occidental »
an 2022 : Afrique - Élections à venir dans l'année : dans les prochains mois se tiendraient des processus électoraux cruciaux en République démocratique du Congo, en Angola, à Sao-Tomé, en Guinée équatoriale ainsi qu’au Tchad.
an 2023 : Libéria - La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2023.
an 2023 :
Histoire contemporenne
Histoire contemporenne
Histoire contemporenne
an 2000 : Burundi - Le 28 août 2000 est signé à Arusha, en Tanzanie, sous l'égide de Nelson Mandela un accord de paix.
an 2000 : Congo Kinshasa - En mai-juin 2000 de nouveaux combats rwando-ougandais ont lieu à Kisangani.
an 2000 : Côte d'Ivoire - Laurent Gbagbo, vainqueur des élections de 2000, et porté au pouvoir par les manifestants devant le refus de Guéï de reconnaître le résultat des élections.
Robert Guéï se proclame vainqueur des élections d'octobre 2000, dont la candidature d'Alasaane Ouattara du RDR avait été exclue pour doutes sur la nationalité, ainsi que celle de Bédié pour ne pas avoir consulté le collège médical désigné par le Conseil constitutionnel. Des manifestations mêlant le peuple et l'armée imposent Laurent Gbagbo, dont la victoire électorale est finalement reconnue. Son parti, le FPI, remporte les législatives de décembre avec 96 sièges (98 au PDCI-RDA), le RDR ayant décidé de les boycotter. Le RDR participe aux élections municipales et sort vainqueur dans la majorité des villes, dont Gagnoa, la principale ville du Centre Ouest du pays, région d'origine de Laurent Gbagbo.
an 2000 : Eswatini (Swaziland) - Depuis 2000, le Swaziland réclame plusieurs kilomètres carrés de territoires à l'Afrique du Sud au prétexte qu'ils leur auraient été volés par les colons blancs au XIXe siècle et annexés illégalement à l'Afrique du Sud. Le royaume swazi base sa réclamation sur un engagement du gouvernement sud-africain signé en 1982 par lequel il s'engageait à rétrocéder au Swaziland plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoires sud-africains en échange de la collaboration dans la lutte anti-terroriste du royaume swazi. Ces territoires situés principalement au Mpumalanga et dans le KwaZulu-Natal et concernent les villes de Nelspruit, Malelane, Barberton, Ermelo, Piet Retief, Badplaas et Pongola. En novembre 2006, Mswati III prit la décision de porter l'affaire devant la cour internationale de La Haye
an 2000-2005 : Ghana - Lors de l'élection présidentielle de décembre 2000, Jerry Rawlings approuve le choix de son vice-président, John Atta-Mills, comme le candidat de la décision du NDC, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d’État en 1981, puis élu en 1992 et en 1996, n'a pas de briguer un troisième mandat, selon la constitution. Il quitte le pouvoir à cinquante-trois ans, après une vingtaine d'années durant lesquelles il a joué les premiers rôles. Mais John Kufuor, candidat du Nouveau Parti patriotique (NPP), parti d'opposition, remporte l'élection, et devient le président le 7 janvier 2001, ce résultat marquant une alternance politique. Le vice-président est Aliu Mahama. Kufuor remporte une autre échéance présidentielle en 2004. Pendant quatre ans, il a su préserver une stabilité économique et politique, et réduire l'inflation.
Durant les deux mandats présidentiels de Kufuor, plusieurs réformes sociales sont menées, telles que la réforme du système d'Assurance Nationale de Santé du Ghana. En 2005, est mis en place un programme d'alimentation en milieu scolaire, avec la fourniture d'un repas chaud gratuit par jour dans les écoles publiques et les écoles maternelles dans les quartiers les plus pauvres. Bien que certains projets sont critiqués comme étant inachevés ou non-financés, les progrès du Ghana sont remarqués à l'échelle international.
an 2000-2003 : Guinée-Bissau - Kumba Ialá est élu président en 2000 mais renversé par un coup d'État sans effusion de sang en septembre 2003. D'ethnie ballante, celui-ci était accusé de favoriser sa communauté et s'était discrédité en dissolvant en 2002 l'Assemblée nationale tout en repoussant sans cesse de nouvelles élections législatives. Le coup d'État ne suscita que peu de protestations tant de la part de la population que de la communauté internationale.
an 2000 - 2003 : Libye - En dépit des sanctions occidentales la Libye maintient une politique internationale de tradition panafricaniste. Elle prend en charge l'essentiel des couts de construction d'un satellite de communication africain, s'engage auprès de l'UNESCO à financer le projet de réécriture de l'Histoire générale de l'Afrique, à payer les cotisations des États défaillants auprès des organisations africaines et à briser le monopole des compagnies aériennes occidentales en Afrique à travers la création de la compagnie Ifriqyiah en 2001.
Dans les années 2000, grâce notamment au contexte de la guerre contre le terrorisme suivant les attentats du 11 septembre 2001, suivi en 2003 par l'arrêt du programme nucléaire de la Libye visant à acquérir la bombe atomique, la Libye de Kadhafi connaît un net retour en grâce diplomatique. Elle renoue de bonnes relations avec le monde occidental, qui voit en elle un allié contre le terrorisme islamiste; la lutte contre l'immigration illégale fournit en outre un argument à la Libye pour entretenir des liens d'alliance avec les pays de l'Union européenne, notamment l'Italie, son principal partenaire commercial. Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de Mouammar Kadhafi, fait figure de réformateur au sein du régime, pour le compte duquel il multiplie les contacts dans le monde occidental, ce qui le fait apparaître comme un « ministre des affaires étrangères bis », souvent décrit comme un potentiel successeur de son père.
an 2000-2019 : Iles Maurice - Anerood Jugnauth redevient Premier ministre après les élections de septembre 2000, puis après trois ans, comme convenu, cède son poste à son allié du Mouvement militant mauricien, Paul Bérenger, dirigeant de la principale formation d'opposition de gauche depuis l'indépendance. Paul Bérenger reste Premier ministre pendant moins de deux ans, puis, dans une nouvelle alternance, Navin Ramgoolam revient au pouvoir pendant neuf ans et demi, jusqu'à décembre 2014, passant alors le relais à nouveau à Anerood Jugnauth, jusqu'à janvier 2017. Le 21 janvier 2017, il annonce sa démission lors d'une allocution télévisée. Il est remplacé par son fils, ministre des Finances Pravind Jugnauth. À la lignée des Ramgoolam succède ainsi celle des Jugnauth. Pravind Jugnauth remporte les législatives de 2019.
Le 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution41 demandant au Royaume-Uni de rétrocéder sous six mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos. Ce délai a pris fin le 22 novembre 2019, sans que le Royaume-Uni se conforme à cette résolution, ni à l'avis consultatif formulé en février par la Cour internationale de justice (CIJ) demandant à Londres de mettre fin « dans les plus brefs délais » à son administration des Chagos.
an 2000-2005 : Ouganda - En mars 2001, Museveni fut réélu dès le premier tour avec 69,3 % des voix alors que son rival Kizza Besigye en obtint 27,8 %.
Malgré un referendum similaire ayant eu lieu en 2000, lors duquel un retour au multipartisme avait été rejeté par 90,7 % des votants, un nouveau referendum, organisé en juillet 2005, vit la population approuver à 92,5 % un abandon du système sans partis pour un retour au multipartisme.
an 2000 : Rwanda - Après la prolongation de la période de transition, plusieurs changements de premiers ministres, la démission du président de l'assemblée nationale, Pasteur Bizimungu démissionne en 2000. Paul Kagame est élu président de la République par l'assemblée nationale de transition.
an 2000 : Sénégal - Mars 2000 : Le président sortant, Abdou Diouf, est battu au deuxième tour des élections présidentielles par Abdoulaye Wade. L’arrivée au pouvoir de Me. Wade met un terme à 40 ans de pouvoir du Parti Socialiste. Porté par son slogan “SOPI” (“changement” en wolof), l’opposant de longue date Abdoulaye Wade, chef de file du Parti démocratique sénégalais, remporte l’élection présidentielle du 19 mars 2000, avec 58,5% des suffrages au second tour, devant le président sortant Abdou Diouf.
Le 9 décembre 2000 le Sénat et le Conseil économique et social sont supprimés.
an 2000-2003 : Somalie - Le 26 août 2000, le Parlement de transition en exil élit un nouveau président en la personne de Abdiqasim Salad Hassan, dans un contexte particulièrement difficile. Le pays reste aux prises avec des rivalités claniques. Après diverses tentatives infructueuses de conciliation, une conférence de réconciliation aboutit en juillet 2003 à un projet de charte nationale prévoyant le fédéralisme et mettant sur pied des institutions fédérales de transition.
an 2000-2003 : Togo - Le président s'était engagé à dissoudre l'Assemblée nationale et à organiser des élections législatives en mars 2000 pour que d'autres formations politiques puissent entrer au Parlement. Il s'était aussi engagé à respecter la Constitution et à ne pas se présenter pour un troisième mandat. Mais ces promesses ne sont pas tenues. Le général Gnassingbé Eyadema et son parti modifient par la suite le code électoral et la constitution que le peuple togolais avait massivement adoptés en 1992, pour lui permettre de faire un troisième mandat, lors des élections de 2003. Le président Gnassingbé Eyadema est donc réélu en juin 2003 pour un nouveau mandat de cinq ans. La Commission électorale annonce que Eyadéma, détenteur du record de longévité politique à la tête d'un État africain, a réuni 57,2 % des suffrages lors du scrutin.
an 2000 : Zambie - Le gouvernement suit les recommandations du Fonds monétaire international (FMI) et privatise de nombreuses entreprises, dont celles du cuivre, principale ressource du pays, et les compagnies aériennes. Au début des années 2000, la poursuite du programme de privatisation provoque des licenciements massifs et une hausse de la pauvreté.
an 2000 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En février 2000, les occupations de terres par des paysans noirs et d'anciens combattants de la guerre d’indépendance se multiplient. Quelque 4 000 propriétaires possèdent alors plus d'un tiers des terres cultivables dans les zones les plus fertiles, sous forme de grandes exploitations commerciales, tandis que plus de 700 000 familles paysannes noires se partagent le reste sur des « terres communales » beaucoup moins propices à la culture. Les propriétaires blancs avaient continué de s'enrichir pendant les vingt années ayant suivi la chute du régime ségrégationniste, attisant le ressentiment d'une partie de la population noire dans un contexte de crise économique et de montée du chômage. Le président zimbabwéen, qui les avait jusqu'alors défendu, vit mal leur soutien à la nouvelle formation de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique. Dépassé par le mouvement d'occupation de terres, Mugabe tente de sauver la face en officialisant les expropriations et en installant sur les terres réquisitionnées des proches du régime, officiellement anciens combattants de la guerre d’indépendance. Ceux-ci n’ont cependant pas les connaissances ni le matériel nécessaires pour cultiver leurs lopins et beaucoup de terres restent en friches. Des dizaines de milliers d'ouvriers agricoles perdent leur emploi et la production chute.
an 2001 : Burundi - L'Afrique du Sud envoie 700 militaires pour veiller à la mise en place de l'accord et assurer la sécurité des membres de l'opposition de retour d'exil. Le 10 janvier 2001, une assemblée nationale de transition est nommée et son président est Jean Minani, président du Frodebu. L'accord d'Arusha entre en vigueur le 1er novembre 2001 et prévoit, en attendant des élections législatives et municipales pour 2003 et présidentielles pour 2004, une période de transition de 3 ans avec pour les 18 premiers mois, le major Buyoya à la présidence et Domitien Ndayizeye du Frodebu au poste de vice-président avant que les rôles ne soient échangés. L'alternance prévue est respectée par Pierre Buyoya qui cède le pouvoir au bout de dix-huit mois. Les différents portefeuilles du gouvernement sont partagés entre Uprona et Frodebu. Le 4 février 2002, le Sénat de transition élit l'uproniste Libère Bararunyeretse à sa présidence.
Malgré les critiques du comité de suivi des accords d'Arusha à l'encontre du gouvernement, en particulier en ce qui concerne la modification de la composition ethnique de l'armée et de l'administration, c'est-à-dire un rééquilibrage ethnique de ces deux institutions, l'exécutif Hutu-Tutsi fonctionne.
an 2001 : Cap Vert - En 2001, Pedro Pires, du PAICV est élu président contre Carlos Veiga, du MPD avec une majorité de 12 voix seulement. Tous deux avaient exercé précédemment la charge de premier ministre.
an 2001 : République de Centrafrique - Si les accords de Bangui de janvier 1997 semblent mettre un terme aux conflits et le scrutin présidentiel de 1999 ouvre la voie d'un deuxième mandat à Ange-Félix Patassé, en 2001, l’ancien président André Kolingba tente un coup d’État contre le président Patassé le 28 mai 2001 que seule l’intervention de la Libye et des combattants du Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba permet de contrer.
La tentative de coup d'État provoque de violents affrontements dans la capitale, Bangui.
De nouvelles périodes de troubles suivront et le général François Bozizé, ancien chef d’état-major des forces armées centrafricaines, est impliqué dans un putsch avorté en mai 2001 contre le président Patassé et doit fuir au Tchad le 9 novembre 2001.
an 2001 : Congo Kinshasa - Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné par un de ses gardes du corps. Son fils Joseph Kabila est désigné par le gouvernement pour assurer l'intérim (en attendant « le rétablissement du blessé », que tous savent pourtant déjà décédé). Kinshasa reconnaît enfin le décès de Laurent-Désiré Kabila le 18 janvier.
Joseph Kabila, proclamé chef de l'État, prête serment le 26 janvier et appelle à des négociations pour la paix. À Gaborone, s'ouvre une réunion préparatoire au Dialogue intercongolais : celui-ci ne s'ouvrira officiellement à Addis-Abeba que le 15 octobre, et les négociations continuent sans mettre réellement fin au désordre.
En février 2001, un accord de paix est signé entre Kabila, le Rwanda et l'Ouganda, suivi de l'apparent retrait des troupes étrangères. Les troupes de maintien de la paix de l'ONU, la MONUC, arrivent en avril, afin de soutenir les difficiles efforts de paix ou au moins soutenir le cessez-le-feu, protéger les populations et les organisations humanitaires prêtant assistance aux nombreux réfugiés et déplacés.
an 2001-2002 : Gambie - Vers la fin de l'an 2001 et au début 2002, la Gambie termine un cycle complet d'élections présidentielles, législatives et locales, que les observateurs étrangers jugent libres, justes et transparentes, malgré quelques lacunes. Réélu, le président Yahya Jammeh, installé le 21 décembre 2001, conserve un pouvoir obtenu à l'origine par un coup d'État. Son parti, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), conserve une large majorité à l'Assemblée nationale, en particulier après que la principale force d'opposition Parti démocratique unifié (UDP) a boycotté les élections législatives.
an 2001 - 2002 : Madagascar - Le résultat de l'élection de décembre 2001 est contesté entre Didier Ratsikara et Marc Ravalomanana, maire de Tananarive. Marc Ravalomanana devient président à l'issue d'une crise politique qui dure tout le premier semestre 2002. Sous prétexte de controverse sur les résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 16 décembre 2001, Marc Ravalomanana se fait proclamer vainqueur au premier tour, puis est installé Président de la République le 22 février 2002. Un recomptage des voix prévu par les Accords de Dakar permet d’attribuer officiellement à Marc Ravalomanana la victoire au premier tour qu’il revendiquait. Didier Ratsiraka quitte Madagascar en juillet 2002 pour la France et l'élection de Marc Ravalomanana est reconnue par la France et les États-Unis.
an 2001-2002 : Mali - Le 1er septembre 2001, Amadou Toumani Touré, dit ATT, demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l’armée pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle. Il est élu président du Mali en mai 2002 avec 64,35 % des voix au second tour. Son adversaire Soumaïla Cissé, ancien ministre, obtient 35,65 % des voix. Il nomme Ahmed Mohamed ag Hamani comme premier ministre en le chargeant de réunir un gouvernement de grande coalition.
an 2001-2004 : Mozambique - En 2001, Joaquim Chissano indique qu'il ne se présente pas une troisième fois,. Armando Guebuza lui succède à la tête du FRELIMO, et remporte encore les élections de décembre 2004.
an 2001 : Namibie - En 2001, la crise de la réforme agraire se poursuit, en dépit d'un nouvel impôt foncier. Le président Samuel Nujoma s'en prend aussi aux homosexuels, accusés d'être les responsables de la propagation du sida qui ravage le pays.
En politique étrangère, les forces de sécurité namibiennes participent en Angola à la lutte contre l'UNITA. Au côté de l'armée du Zimbabwe, l'armée namibienne est impliquée militairement au Congo-Kinshasa en faveur du régime de Laurent-Désiré Kabila puis de son fils Joseph.
an 2001 : Sénégal - En 2001 une nouvelle constitution réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans.
L’Assemblée nationale – au sein de laquelle le Parti socialiste est majoritaire – est dissoute le 5 février 2001.
25 formations politiques sont autorisées à participer aux élections législatives anticipées.
Pour la première fois au Sénégal, un parti écologiste, Les Verts, entre en lice dans une consultation électorale, mais n’obtient aucun siège.
Suite à la démission de Moustapha Niasse, la juriste Mame Madior Boye est la première femme à occuper les fonctions de Premier ministre dans le pays, du 3 mars 2001 au 4 novembre 2002.
Les élections législatives du 12 mai 2001 voient la victoire de la coalition Sopi proche du président Wade, ce qui permet à 9 nouveaux ministres d’entrer au gouvernement, renforçant ainsi le poids du PDS.
Quelques jours plus tard, 10 partis d’opposition s’unissent pour créer un « Cadre permanent de concertation » (CPC).
Le 25 août 2001 : 25 partis créent cette fois une structure de soutien à l’action du président Wade : « Convergence des actions autour du Président en perspective du 21e siècle » (CPC).
an 2002-2009 : Congo Brazzaville - En 2002 est adopté une nouvelle constitution supprimant le poste de Premier ministre, renforçant les pouvoirs du président de la République. Le président est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. La même année a lieu l'élection du président de la République : Denis Sassou-Nguesso est reconduit à ce poste. Le septennat de Denis Sassou-Nguesso de 2002 à 2009 est marqué par le retour à la paix civile, même si des troubles subsistent dans l'Ouest du Pool. La flambée des cours du pétrole enrichit considérablement l'État, dont le budget annuel dépasse pour la première fois les 100000 milliards de francs CFA. De nombreux projets de construction d'infrastructures sont entrepris (port de Pointe-Noire, autoroute Pointe-Noire - Brazzaville...) en coopération avec des États et entreprises étrangers (France, Chine...).
an 2002 : Congo Kinshasa - Le conflit éclate à nouveau en janvier 2002 à la suite d'affrontements entre des groupes ethniques dans le Nord-est ; l'Ouganda et le Rwanda mettent alors fin au retrait de leurs troupes et en envoient de nouvelles. Des négociations entre Kabila et les chefs rebelles aboutissent à la signature d'un accord de paix par lequel Kabila devra désormais partager le pouvoir avec les anciens rebelles.
Le 15 février 2002 s'ouvre réellement en Afrique du Sud le Dialogue intercongolais : l'accord de paix est signé à Prétoria en décembre; le Dialogue sera clôturé en avril 2003.
an 2002 : Côte d'Ivoire - Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles tentent de prendre le contrôle des villes d’Abidjan, Bouaké et Korhogo. Ils échouent dans leur tentative en ce qui concerne Abidjan mais sont victorieux dans les deux autres villes, situées respectivement dans le centre et le nord du pays. Robert Guéï est assassiné dans des circonstances non encore élucidées. La rébellion qui se présente sous le nom MPCI crée plus tard le MJP et le MPIGO et forme avec ces dernières composantes le mouvement des Forces nouvelles (FN). Il occupe progressivement plus de la moitié nord du pays (estimée à 60 % du territoire), scindant ainsi le territoire en deux zones : le sud tenu par les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et le nord tenu par les Forces armées des forces nouvelles (FAFN).
Les pourparlers entamés à Lomé permettent d’obtenir le 17 octobre 2002, un accord de cessez-le-feu qui ouvre la voie à des négociations sur un accord politique entre le gouvernement et le MPCI sous l’égide du président du Togo, Gnassingbé Eyadema. Ces négociations échouent cependant sur les mesures politiques à prendre, en dépit de réunions entre les dirigeants de la CEDEAO à Kara (Togo), puis à Abidjan et à Dakar. 10 000 casques bleus de l’ONUCI98 dont 4 600 soldats français de la Licorne sont placés en interposition entre les belligérants.
an 2002-2005 : Kenya - En août 2002, le Président Moi — qui constitutionnellement ne peut plus être élu ni président, ni député — surprend tout le monde en annonçant qu'il soutient personnellement la candidature du jeune et inexpérimenté Uhuru Kenyatta — un des fils de Jomo Kenyatta — dans la course à la présidence lors des élections de décembre. En opposition totale avec les vues de Moi, des membres importants du cartel KANU-NDP tels Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, George Saitoti et Joseph Kamotho rejoignent le Liberal Democratic Party (LDP). Pour contrer le dessein de Moi, le LDP, dont Raila a pris la tête, fait alliance avec le National Alliance Party of Kenya (NAK), le Democratic Party (en) (DP), le Forum for the Restoration of Democracy-Kenya (FORD-K) et le National Party of Kenya (NPK). Cette alliance appelée National Rainbow Coalition (NARC) pousse la candidature de Mwai Kibaki le prétendant du DP au poste de président de la République.
Mwai Kibaki gagne largement l'élection présidentielle du 27 décembre avec 62,2 % des suffrages devant Uhuru Kenyatta (31,3 %) et trois autres candidats. Le LDP de Raila Odinga devient le premier parti politique du pays avec 59 sièges de députés à l'Assemblée nationale.
Présidence de Mwai Kibaki - Entre 2002 et 2005, une équipe de constitutionnalistes rédigent au Bomas of Kenya, un texte portant révision de la Constitution. Ce texte, connu sous le nom de Bomas Draft, limite, entre autres, les pouvoirs du président de la République et crée un poste de Premier ministre. En 2005, Mwai Kibaki rejette ce texte et présente un texte de réforme donnant plus de pouvoirs politiques au chef de l'État. Ce texte connu sous le nom de Wako Draft est soumis le 21 novembre 2005, à un référendum national et rejeté par 58,12 % des votants. En réaction, le président Kibaki congédie l'intégralité du gouvernement deux jours après le résultat du référendum et, deux semaines plus tard, forme un nouveau gouvernement qui ne comporte plus aucun membre du LDP.
C'est à ce moment que Raila Odinga décide d'être candidat à l'élection présidentielle de décembre 2007 et crée son propre parti politique : l′Orange Democratic Movement (ODM). Son symbole est une orange en référence au symbole visuel qui représentait le « non » lors du référendum (le « oui » était imagé par une banane)
an 2002 : Nigéria - Depuis 2002 et plus particulièrement depuis 2009, le gouvernement nigérian est confronté, au nord-est du pays, au mouvement terroriste Boko Haram. Ce mouvement salafiste, prônant un islam radical et rigoriste, est à l'origine de nombreux attentats et massacres à l'encontre des populations civiles.
an 2002-2004 : Rwanda - En 2002, l'armée rwandaise quitte officiellement la République démocratique du Congo (Zaïre de 1971 à 1997). Toutefois, dès le début de 2003, le troupes rwandaises envahissent de nouveau l'est de la RDC, et ne commencent à être évacuées que six mois plus tard, après l'envoi de casques bleus. Le 1er juin 2004, les troupes rwandaises et leurs alliés rwandophones occupent la ville de Bukavu, dans le sud du Kivu, mais, dès le
8 juin, les pressions de l'ONU contraignent les troupes à se retirer. Le mouvement RDC-Goma reste armé et soutenu par Kigali.
Malgré les immenses difficultés pour reconstruire le pays qui ont marqué la période de transition, la pression de la communauté internationale aidant, le pouvoir rwandais prépare une constitution et des élections au suffrage universel pour 2003. À tort ou à raison, la crainte manifestée par certains rescapés tutsi de voir le pouvoir à nouveau entre les mains de supposés proches des génocidaires est réveillée. Des intimidations de candidats et d'électeurs, afin qu'ils votent pour le pouvoir en place, sont remarquées.
En 2002, accusé de corruption, l'ancien président de la république, Pasteur Bizimungu, est arrêté et mis en prison. Il est accusé d'avoir constitué un parti politique d'opposition non autorisé par les accords d'Arusha (qui limitaient les partis à ceux qui les avaient signés), de malversations financières et d'avoir publié un article où il manipule les concepts « hutu/tutsi ». Il est condamné à quinze ans de prison. Des associations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, voient en M. Bizimungu un « prisonnier d'opinion », incarcéré pour son opposition au président Kagame plutôt que pour les motifs officiellement invoqués53. Le MDR, signataire des accords d'Arusha, accusé d'abriter en son sein un courant idéologique génocidaire, est dissous par les députés. Une association des droits de l'homme est aussi menacée pour les mêmes raisons. La rigueur qui paraissait excessive chez Paul Kagame est guidée par le fait que la paix intérieure du Rwanda demeurait très fragile à l'époque.
C'est dans ce climat de suspicion de « division » que se déroulent les élections en 2003.
an 2002 : Sénégal - Le 15 février 2002 : la création d’une Commission électorale nationale autonome (CENA) est décidée, en remplacement de l’Observatoire national des élections (ONEL). Elle prendra ses fonctions en 2005.
Le 26 septembre 2002 : le Sénégal vit une tragédie nationale avec le naufrage du Joola, le ferry qui reliait Dakar à Ziguinchor en Casamance. Plus de 1 800 passagers y perdent la vie. Les négligences constatées suscitent un forte rancœur à l’égard des pouvoirs publics. La région, déjà affectée par son enclavement, perd sa liaison maritime pendant trois ans et l’île de Karabane, ancienne escale, ne peut plus compter que sur les pirogues. Ce drame n’est pas sans conséquences sur la carrière de Mame Madior Boye qui est remplacée par Idrissa Seck, maire de Thiès et numéro deux du Parti démocratique sénégalais (PDS).
Seck sera Premier ministre du 4 novembre 2002 au 21 avril 2004. Son ministre de l’Intérieur Macky Sall lui succède lorsqu’il tombe en disgrâce en raison de ses responsabilités dans la gestion des chantiers de Thiès et peut-être de ses ambitions nationales.
an 2002-2004 : Sierra Leone - Le 14 mai 2002, le président sortant, Ahmad Tejan Kabbah, est réélu avec 70,6 % des voix.
Le pays est désormais en paix, après 10 ans d'une guerre civile atroce. Les différentes mesures prises par l'ONU sont progressivement réduites, voire supprimées, comme l'atteste la levée de l'embargo sur les exportations de diamants du sang. De même, les effectifs de la MINUSIL (casques bleus) sont diminués. Après un pic de 17 500 hommes en mars 2001, les effectifs sont ramenés à 13 000 en juin 2003 et à 5 000 en octobre 2004.
Cependant, pour des raisons économiques, de nombreux enfants travaillent toujours dans les mines de diamants, qui sont très dangereuses. La propagation du SIDA chez eux est également très importante : 16 000 enfants de moins de 15 ans sont séropositifs.
an 2002 : Zambie - En 2002, en raison de la sécheresse, la famine menace trois millions de personnes.
Après avoir tenté de faire amender la Constitution qu'il a lui-même promulguée afin de briguer un troisième mandat, Chiluba, face aux protestations populaires, doit céder la place en janvier 2002 à son vice-président et successeur désigné, Levy Mwanawasa, qui est élu président, au cours d’un scrutin contesté. Le Parlement vote à l'unanimité la levée de l'immunité de l'ancien président Chiluba qui est mis en examen au titre d'une soixantaine d'inculpation concernant principalement des détournements de fonds. Les charges seront levées en 2009.
an 2002 - 2003 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
Mugabe est désavoué lors d’un référendum sur une réforme constitutionnelle. En 2002, il gagne l’élection présidentielle lors d’un scrutin dont l’honnêteté est contestée. En 2003, une grave crise agraire et politique éclate à la suite de l’expropriation par Mugabe des fermiers blancs. Une crise politique survient quand les mouvements d’opposition comme la MDC sont réprimés et les élections truquées. À la suite d'une campagne intensive des mouvements des droits de l’Homme, des Britanniques et de l’opposition, le Commonwealth impose des mesures de rétorsion contre les principaux dirigeants du Zimbabwe. Au sein du Commonwealth, Mugabe reçoit cependant le soutien de plusieurs pays africains et dénonce des mesures prises à l’instigation des pays « blancs » (Canada, Grande-Bretagne, Australie). L’opposition locale du MDC est réprimée.
an 2003 : Burundi - le 7 juillet 2003, les forces hutu des CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie), en coalition avec le PALIPEHUTU-FNL (Parti pour la libération du peuple hutu-Forces de libération nationale) attaquent Bujumbura.
40 000 habitants fuient la capitale. Un accord de paix (protocole de Pretoria) est néanmoins signé le 15 novembre 2003 entre le président Ndayizeye et le chef des CNDD-FDD. La principale branche de la rébellion (CNDD-FDD) entre au gouvernement, au sein duquel elle détient quatre ministères et dispose également de postes de haut rang dans les autres institutions, conformément à l'accord d'Arusha.
an 2003 : République de Centrafrique - Après une nouvelle série de troubles et malgré l'intervention de la communauté internationale (MINURCA). Malgré l'intervention de la communauté internationale, Ange-Félix Patassé est finalement renversé le 15 mars 2003 par François Bozizé grâce à une rébellion dont l'élément central est constituée par plusieurs centaines de « libérateurs », qui sont souvent d’anciens soldats tchadiens ayant repris du service avec l’assentiment d’Idriss Déby. Une bonne partie des « libérateurs » retournera au Tchad en 2003 ou 2004, d'autres intégreront les forces de sécurité ou se reconvertiront dans le commerce sur le grand marché PK5
Le 15 mars 2003, le général François Bozizé réussit, avec l'aide de militaires français (deux avions de chasse de l'armée française survolaient Bangui pour filmer les positions des loyalistes pour le compte de Bozizé) et de miliciens tchadiens (dont une bonne partie va rester avec lui après son installation au pouvoir), un nouveau coup d'État et renverse le président Patassé. Le général Bozizé chasse alors les rebelles congolais, auteurs de méfaits et crimes innombrables, notamment dans et autour de Bangui.
Toutefois, le coup d’État de François Bozizé, en 2003, a déchaîné un cycle de rébellion dans lequel le pays est toujours plongé en 2019.
an 2003 : Congo Kinshasa - Le 4 avril 2003, la Cour d'ordre militaire (COM), condamne, sans convaincre, 30 personnes à mort pour l'assassinat de Laurent Kabila.
La même année se met en place le gouvernement de transition « 4+1 » (quatre vice-présidents et un président) : Abdoulaye Yerodia Ndombasi (PPRD), Jean-Pierre Bemba (MLC), Azarias Ruberwa (RCD), Arthur Z'ahidi Ngoma (société civile), ainsi que Joseph Kabila (PPRD).
En juin 2003, l'armée rwandaise est la seule de toutes les armées étrangères à ne pas s'être retirée du Congo. L'essentiel du conflit était centré sur la prise de contrôle des importantes ressources naturelles du pays, qui incluent les diamants, le cuivre, le zinc, et le coltan.
an 2003 : Afrique Côte d'Ivoire - Dans une nouvelle initiative, la France abrite à Linas-Marcoussis du 15 au 23 janvier 2003, sous la présidence de Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel français, secondé par le juge sénégalais Kéba Mbaye, une table ronde avec les forces politiques ivoiriennes et obtient la signature des accords de Linas-Marcoussis. Cet accord prévoit la création d’un gouvernement de réconciliation nationale dirigé par un premier ministre nommé par le Président de la République après consultation des autres partis politiques, l’établissement d’un calendrier pour des élections nationales crédibles et transparentes, la restructuration des forces de défense et de sécurité, l’organisation du regroupement et du désarmement de tous les groupes armés, le règlement des questions relatives à l’éligibilité à la présidence du pays et à la condition des étrangers vivant en Côte d’Ivoire. Un comité de suivi de l’application de l’accord, présidé par l’ONU, est institué.
an 2003 : Guinée - Après avoir révisé la Constitution pour pouvoir se présenter une troisième fois en décembre 2003, le chef de l'État, pourtant gravement malade, est réélu avec 95,63 % des suffrages face à un candidat issu d'un parti allié, les autres opposants ayant préféré ne pas participer à un scrutin joué d'avance.
an 2003 : Libéria - Les combats s'intensifient, les rebelles encerclent progressivement dans la capitale les forces de Charles Taylor, le risque d'une tragédie humanitaire se profile à nouveau. Le 8 juillet 2003, le Secrétaire général décide de nommer Jacques Paul Klein (États-Unis) comme son Représentant spécial pour le Liberia. Il lui confie la tâche de coordonner les activités des organismes des Nations unies au Liberia et d'appuyer les nouveaux accords. Le 29 juillet 2003, le Secrétaire général décrit le déploiement en trois phases des troupes internationales au Liberia, aboutissant à la création d'une opération de maintien de la paix pluridimensionnelle des Nations unies (S/2003/769). La nomination de Jacques Paul Klein et la création d'une opération des Nations unies au Liberia mettent fin au mandat du BANUL. La situation au Liberia évolue ensuite rapidement. Le 1er août 2003, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1497 (2003): autorisation de la mise en place d'une force multinationale au Liberia et d'une force de stabilisation de l'ONU déployée au plus tard le 1er octobre 2003. Parallèlement, le 18 août 2003, les parties libériennes signent à Accra un accord de paix global, dans lequel les parties demandent à l'Organisation des Nations unies de déployer une force au Liberia, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Celle-ci est chargée d'appuyer le Gouvernement transitoire national du Liberia et de faciliter l'application de cet accord. Grâce au déploiement ultérieur de la Mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Liberia, la situation en matière de sécurité dans le pays s'améliore.
Les événements aboutissent à la création de la Mission des Nations unies au Liberia (MINUL), à la démission de Charles Taylor, le 11 août et à une passation pacifique des pouvoirs.
Le Secrétaire général recommande que le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, autorise le déploiement d'une opération de maintien de la paix des Nations unies dotée d'effectifs d'un maximum de 15 000 hommes, dont 250 observateurs militaires, 160 officiers d'état-major et un maximum de 875 membres de la police civile, 5 unités armées constituées supplémentaires fortes chacune de 120 personnes, ainsi que d'une composante civile de taille appréciable et du personnel d'appui requis. La Mission des Nations unies au Liberia comporte des volets politiques, militaires, concernant la police civile, la justice pénale, les affaires civiles, les droits de l'homme, la parité hommes-femmes, la protection de l'enfance, un programme « Désarmement, Démobilisation, Réinsertion », ainsi que, le moment venu, un volet électoral. Elle comporte un mécanisme de coordination de ses activités avec celles des organismes humanitaires et de la communauté du développement. Elle agit en étroite coordination avec la CEDEAO et l'Union africaine. Afin d'assurer une action coordonnée des Nations unies face aux nombreux problèmes de la sous-région, la Mission doit travailler également en étroite collaboration avec la Mission des Nations unies en Sierra Leone (MINUSIL), la Mission des Nations unies en Côte d'Ivoire (MINUCI) et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest.
Dans son rapport, le Secrétaire général fait observer que la passation des pouvoirs du Président Charles Taylor au Vice-Président Moses Blah et la signature, par les parties libériennes, de l'accord de paix global offrent une occasion unique de mettre un terme aux souffrances du peuple libérien et de trouver une solution pacifique à un conflit qui avait été l'épicentre de l'instabilité dans la sous-région. Il souligne que si l'Organisation des Nations unies et la communauté internationale dans son ensemble sont prêtes à soutenir le processus de paix libérien, c'est aux parties libériennes elles-mêmes qu'incombe la responsabilité première de la réussite de l'accord de paix.
Le 19 septembre 2003, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 1509 (2003), en remerciant le Secrétaire général de son rapport du 11 septembre 2003 et de ses recommandations. Il a décidé que la MINUL comprendrait 15 000 membres du personnel militaire des Nations unies, dont un maximum de 250 observateurs militaires et 160 officiers d'état-major, et jusqu'à 1 115 fonctionnaires de la police civile, dont des unités constituées pour prêter leur concours au maintien de l'ordre sur tout le territoire du Liberia, ainsi que la composante civile appropriée. La Mission a été créée pour une période de 12 mois. Il a prié le Secrétaire général d'assurer le 1er octobre 2003 la passation des pouvoirs des forces de l'ECOMOG dirigées par la CEDEAO à la MINUL.
Comme prévu, la Mission des Nations unies au Liberia (MINUL) a assuré les fonctions de maintien de la paix des forces de la Mission de la CEDEAO au Liberia (ECOMIL) le 1er octobre. Les quelque 3 500 soldats ouest-africains qui avaient fait partie des troupes avancées de l'ECOMIL ont provisoirement coiffé un béret de soldat de la paix des Nations unies. Dans un communiqué paru le même jour, le Secrétaire général a accueilli avec satisfaction cette très importante évolution et a salué le rôle joué par la CEDEAO dans l'instauration du climat de sécurité qui a ouvert la voie au déploiement de la MINUL. Il a rendu hommage aux gouvernements du Bénin, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Nigeria, du Sénégal et du Togo pour leur contribution à la MINUL, ainsi qu'aux États-Unis pour leur appui à la force régionale. Le Secrétaire général s'est dit confiant dans le fait que la MINUL pourrait être en mesure de contribuer de manière importante au règlement du conflit au Liberia pour autant que toutes les parties concernées coopèrent pleinement avec elle et que la communauté internationale fournisse les ressources nécessaires.
an 2003 : Mauritanie - En novembre 2003, Ould Taya est réélu président de la République avec 67 % des voix.
an 2003 : Tchad - En 2003, les recherches de gisements pétroliers permettent au Tchad de lancer les premières phases d'exploitation de son sous-sol, entraînant avec elles l'espoir que le Tchad puisse enfin connaître une phase d'essor économique et de développement humain
an 2003-2005 : Togo - Gnassingbé Eyadema est réélu en 2003 à la suite d'un changement dans la constitution pour l’autoriser à se présenter à nouveau. Il décède le 5 février 2005.
an 2003-2007 : Rwanda - La constitution adoptée par référendum – 26 mai 2003 - Inspirée des principales constitutions occidentales, la constitution rwandaise laisse néanmoins une large place aux problèmes spécifiques du Rwanda post-génocide, inscrivant notamment dans la constitution le refus de l'ethnisme hérité du colonialisme et ayant conduit au génocide. Des opposants au FPR, des courants liés à l'ancien régime génocidaire, et des observateurs occidentaux y voient une hypocrisie visant à renforcer un pouvoir politique disposant d'une faible base ethnique et voulant de ce fait forcer la marche vers l'apparence d'une nation composée de citoyens débarrassés du concept ethnique. Elle crée aussi des outils juridiques pour favoriser la place des femmes dans la vie politique (art. 185 et 187). Selon Human Rights Watch, certaines dispositions de la Constitution de 2003 violent « le droit d'association, de libre expression et de représentation politique assurée par des élections libres.
L'élection présidentielle au suffrage universel – 25 août 2003 - Paul Kagame est élu président de la République avec 95 % des voix contre son principal opposant, Faustin Twagiramungu, du MDR dissous. Des membres du comité de soutien à Faustin Twagiramungu ont été arrêtés la veille du scrutin. Certains ont subi des violences avant d'être relâchés. Les observateurs de la communauté européenne ont émis des critiques, regrettant des pressions exercées sur le corps électoral, et ont constaté des fraudes, mais estiment qu'un pas important vers la démocratie a été franchi. Amnesty International et Human Rights Watch ont en revanche manifesté un grand scepticisme sur la démocratisation du Rwanda.
Les élections législatives au suffrage universel – 2 octobre 2003 - Les députés favorables à Paul Kagame obtiennent la majorité des sièges. 49 % des députés sont des femmes, ainsi qu'une très forte proportion de sénateurs et de ministres.
Pour résoudre la difficulté de juger les nombreux prisonniers, qui attendent dans les prisons rwandaises l'idée germe d'adapter les gacaca, structures de justice traditionnelle (de agacaca, « petite herbe » ou « gazon » en kinyarwanda). On forme rapidement des personnes intègres pour présider ces tribunaux populaires. Pour désengorger les prisons, des prisonniers de certaines catégories sont relâchés, sans être amnistiés, avant de passer devant les gacaca. Ces décisions ravivent, dans la société rwandaise et la diaspora, les inquiétudes des rescapés qui craignent pour leur vie et le débat controversé sur la réconciliation, politiquement souhaitée, entre tueurs et rescapés.
Après plusieurs années de réflexions et de mises au point, le 15 janvier 2005, huit mille nouvelles juridictions « gacaca », (tribunaux populaires chargés de juger les auteurs présumés du génocide de 1994), entament la phase administrative de leur travail. Elles se rajoutent aux 750 « gacaca » pilotes mises en place depuis 2001. L'expérience des « gacaca » pilotes laisse penser qu'il y aurait au moins sept cent cinquante mille personnes, soit un quart de la population adulte, dénoncées et jugées par ces assemblées populaires.
Amnesty International estime que « cette volonté de traiter les affaires aussi rapidement que possible a accru la suspicion régnant sur l’équité du système. Certaines décisions rendues par les tribunaux gacaca faisaient douter de leur impartialité. » L'association souligne également que « Le 7 septembre 2005, Jean Léonard Ruganbage, du journal indépendant Umuco, a été arrêté à la suite de l’enquête qu’il avait menée sur l’appareil judiciaire et le gacaca ». Les autorités rwandaises estiment que ces critiques sont déplacées en rappelant que l'aide qu'elles avaient demandée à la communauté internationale pour juger les génocidaires a été gaspillée dans la mise en place d'un Tribunal pénal international, qui fut sa réponse à la demande rwandaise et qui n'a achevé en 2007 qu'une trentaine de jugements.
an 2003 : Soudan - En 2003, la guerre civile éclate au Darfour, où le Mouvement de libération du Soudan (MLS ou SLM) et le Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE ou JEM) se posent en protecteurs des populations civiles face aux exactions des « janjawids » (expression arabe qui signifie les diables à cheval, milices soutenues par le gouvernement de Khartoum). L'année suivante, l’Union africaine (UA) envoie des troupes au Darfour pour veiller au respect d'un cessez-le-feu et assurer la protection des populations civiles.
an 2004-2008 : République de Botswana - En 2004, le Président Festus Mogae, réélu pour cinq ans, s'engage à améliorer l'économie du pays et à tenter d'enrayer l'épidémie de sida laquelle toucherait près de 25 % de la population du pays d'après l'Organisation mondiale de la santé. Il se voit décerner en 2008 le prix Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique pour avoir su faire bon usage des richesses du sous-sol du pays, notamment en diamants. Il laisse le pouvoir au vice-président, Ian Khama, fils de Seretse Khama, père de l'indépendance du Botswana et de son épouse britannique Ruth Williams. Celui-ci est confirmé comme président par des élections l'année suivante. Il reste au pouvoir, réélu démocratiquement, pendant dix ans et fait ses adieux 18 mois avant la fin de son deuxième mandat, en respectant ainsi la Constitution.
an 2004 : Algérie - De nouvelles élections sont organisées au mois d'avril, le principal concurrent du président sortant étant son ancien Premier ministre Ali Benflis. Abdelaziz Bouteflika est réélu avec un taux de 85 %. Son programme pour le deuxième mandat prévoit un plan quinquennal pour la relance de l'économie, au profit duquel il consacre une enveloppe financière de 150 milliards de dollars.
an 2004 : Congo Kinshasa - En mars 2004 échoue une tentative de coup d'état attribuée à d'anciens mobutistes.
En mai 2004, des militaires banyamulenge déclenchent une mutinerie à Bukavu, sous les ordres du général tutsi congolais Laurent Nkunda, et prennent Bukavu le 2 juin. Ces mutins abandonnent la ville le 9 juin sous la pression internationale. Les 3 et 4 juin, dans les grandes villes congolaises, sont organisées des manifestations anti-rwandaises par des étudiants, qui tournent à l'émeute anti-ONU au Kivu. Le 11 juin, des membres de la garde présidentielle tentent un coup d'état. Le RCD-Goma suspend sa participation au gouvernement; il reviendra sur sa décision le 1er septembre.
an 2004-2006 : Guinée - Fin avril 2004, le premier ministre François Louceny Fall profite d'un voyage à l'étranger pour démissionner, arguant que « le président bloque tout ». Le poste reste vacant plusieurs mois avant d'être confié à Cellou Dalein Diallo, qui sera démis de ses fonctions en avril 2006.
an 2004-2005 : Guinée-Bissau - Le pays entreprend alors à nouveau avec difficulté une phase de normalisation démocratique, culminant avec l'organisation d'élections législatives en 2004 et d'une élection présidentielle le 24 juillet 2005 qui voit le retour à la tête du pays de João Bernardo Vieira dit « Nino Vieira », l'ancien président déposé en 1999 par un coup d’État militaire qui s'était présenté en indépendant. Pour gouverner, Nino Vieira, fortement contesté au sein du PAIGC, conclut une alliance tactique avec son ennemi historique, le général Batista Tagme Na Waie, en nommant chef d'état-major10 ce personnage rustre et illettré qui voue une haine farouche à l'ancien président Vieira, qui l'aurait torturé et jeté sur une île prison à la suite de la tentative de coup d'État de novembre 1985.
an 2004-2005 : Malawi - Le mois de mai 2004 voit l’élection de Bingu wa Mutharika, du FDU, contre le candidat du PCM, John Tembo. Durant la campagne électorale, les médias contrôlés par l'Etat (radio et télévision) privilégient la communication de la coalition au pouvoir. Des observateurs de l'Union Européenne mettent également en exergue des « distributions manifestes et répandues d'argent aux électeurs » et « l'utilisation de fonds publics par le parti au pouvoir ». Quand il prend ses fonctions, le Malawi est en pleine crise alimentaire. Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime que le nombre de personnes vulnérables au Malawi s’élève à plus de 5 millions, et en octobre 2005, le président déclare le Malawi en état de crise. Tout en demandant de l’aide alimentaire, le président engage le pays, après cette année désastreuse,dans une « révolution verte ». En faisant de l’agriculture une priorité, en mettant l'accent sur l'irrigation, en subventionnant 1 700 000 fermiers pauvres, il permet au pays de sortir de la disette et de devenir exportateur de maïs.
Bingu wa Mutharika se représente pour un deuxième mandat à l'élection du 19 mai 2009, cette fois à la tête du Parti démocrate progressiste qu'il a fondé en 2005 après avoir quitté le Front uni démocratique, et est réélu. L’image du Malawi à l'étranger s’améliore grâce à cette politiques de développement et aux avancées en sécurité alimentaire, ainsi qu'aux actions pour combattre la mortalité infantile et maternelle et les maladies telles que le malaria, la tuberculose et le SIDA. Le Malawi ouvre de nouvelles ambassades en Chine, Inde et Brésil.
an 2004 : Namibie - En 2004, Sam Nujoma renonce à modifier la constitution une nouvelle fois pour obtenir un nouveau mandat.
Les élections générales de novembre 2004 sont remportées par la SWAPO, qui renforce son emprise à chaque échéance électorale.
Les élections des 15 et 16 novembre sont sans surprise avec la victoire écrasante de la SWAPO qui remporte 55 des 72 sièges du parlement.
an 2004 : Somalie - Le 10 octobre 2004, le Parlement fédéral de transition de la République de Somalie, exilé au Kenya en raison des affrontements entre seigneurs de la guerre à Mogadiscio, et formé en nombres égaux de représentants de chacun des quatre grands clans somalis, a élu en tant que président intérimaire Abdullahi Yusuf Ahmed, président du Pays de Pount. À la tête du Gouvernement fédéral de transition, celui-ci a nommé Ali Mohamed Gedi, un vétérinaire de profession, en tant que Premier ministre, avec pour mission de former un gouvernement de coalition avec les différents chefs de guerre du pays. Les institutions somaliennes siègent au Kenya par mesure de sécurité à l'égard de la situation intérieure de la Somalie. Les institutions en exil n'ont aucun contrôle sur le pays en dehors de certains quartiers de la capitale Mogadiscio, leur autorité n'est pas reconnue à l'intérieur du pays, mais uniquement par les gouvernements étrangers.
an 2004 - 2005 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 2004, le pays ne peut plus subvenir à ses besoins et 70 % de la population se retrouve sans emploi. Le Zimbabwe se retire du Commonwealth. Le pays est alors au bord de la famine, ce que chercherait à dissimuler le régime. Le pays apparait dans la liste du nouvel « axe du mal » rebaptisé « avant poste de la tyrannie » par Condoleezza Rice en 2005.
En 2005, le parti de Robert Mugabe, la ZANU, remporte les élections législatives sur fond de violence et de fraudes électorales face à un MDC divisé et affaibli. Entre 120 000 et 1 500 000 habitants des bidonvilles d'Harare, bastions de l'opposition, sont expulsés à la fin du printemps lors de la destruction de leurs habitations sur ordre du gouvernement ; c'est l'opération Murambatsvina. Adoption d'une réforme constitutionnelle restreignant les droits de propriété et permettant au gouvernement de priver n'importe qui de passeport pour des raisons « d'intérêt national ». Afin de gagner l'appui de la population, Mugabe persécute la minorité ndébélé[réf. nécessaire]. Nombre d'entre eux fuient en Afrique du Sud. On empêche les propriétaires de terres d'aller en appel au sujet de leur expropriation. Un Sénat de 66 membres est créé mais celui-ci est soupçonné d'être une simple chambre d'enregistrement au service du président Mugabe. L'inflation dépasse les 1 000 % en 2006, et les 100 000 % en 2007, alors qu'a lieu une purge au sein de l'armée. L'exode de la population vers les pays voisins s’accélère.
an 2005 : Burkina Faso -Blaise Compaoré est élu président de la République (taux d'abstention : 74 %). Il est réélu en 2005 et en 2010.
an 2005 : Burundi - Le CNDD-FDD, dirigé par Pierre Nkurunziza, s'impose dès lors comme l'un des principaux acteurs politiques, en obtenant la majorité absolue aux élections communales du 5 juin 2005 (1 781 sièges sur les 3 225 à pourvoir) avec 62,9 % des voix, contre 20,5 % pour le FRODEBU et seulement 5,3 % pour l'Uprona. Le CNDD-FDD, majoritairement hutu, dispose désormais de la majorité absolue dans 11 des 17 provinces du pays. Une victoire sans appel qui annonce la recomposition du paysage politique après douze années de guerre civile et met un terme au long tête-à-tête entre l'UPRONA et le FRODEBU. Mais le vote rappelle aussi que certains rebelles (PALIPEHUTU-FNL) n'ont pas encore déposé les armes (le jour du scrutin, 6 communes ont été la cible de violences). Ces opérations d'intimidation révèlent que la trêve conclue le 15 mai 2005 à Dar es Salaam avec les forces du PALIPEHUTU-FNL reste fragile.
Le CNDD-FDD remporte également les élections législatives du 4 juillet 2005 et les sénatoriales du 29 juillet. Nkurunziza est donc élu président le 19 août et investi le 26 août 2005.
an 2005 : République de Centrafrique - Une élection présidentielle a lieu, après plusieurs reports, le 13 mars 2005, sous la direction d'une Commission Électorale Mixte Indépendante (CIME), présidée par Jean Willybiro-Sako. On peut relever comme candidatures, celles de François Bozizé (déjà chef de l'État), l'ancien président André Kolingba, et l'ancien vice-président Abel Goumba. Les candidatures de plusieurs autres candidats, dont celles de Charles Massi du FODEM, de l'ancien premier ministre Martin Ziguélé, de l'ancien ministre et ancien maire de Bangui Olivier Gabirault et de Jean-Jacques Démafouth, sont refusées par la commission électorale avant la médiation gabonaise et les accords de Libreville. À la suite de ces accords, seule la candidature de l'ancien président Ange-Félix Patassé est définitivement rejetée par la commission élue.
L'accession à la présidence de Bozizé est violemment contestée et une première guerre civile centrafricaine ravage le pays entre 2004 et 2007, jusqu'à la signature d'un accord de paix.
an 2005 : Congo Kinshasa - En janvier 2005 des émeutes se déclenchent à Kinshasa lorsque la Commission électorale envisage publiquement un report de la date des élections, comme le lui permettent les textes. La MONUC déclenche une offensive militaire, médiatique et diplomatique contre les milices lendues et hemas, après la mort de neuf casques bleus banglashis, tués en Ituri par ces dernières. La Cour pénale internationale annonce ses premiers mandats d'arrêts pour 2005 dont un accusé en Ituri.
En mai, l'avant-projet de constitution est approuvé par le parlement. Fin juin, celui-ci décide de prolonger la transition de six mois. Un gouvernement de transition est établi jusqu'aux résultats de l'élection.
an 2005 : Afrique République de Djibouti - Ismaïl Omar Guelleh est réélu en 2005, puis, après une modification de la Constitution, en 2011, 2016 et 2021.
an 2005-2006 : Eswatini (Swaziland) - Le 26 juillet 2005, après 30 ans de suspension de la loi fondamentale, le roi ratifie une nouvelle constitution entrée en vigueur le 8 février 2006. Le pays demeure une monarchie absolue. Les partis politiques sont toujours interdits et ne sont en pratique perçus que comme des associations. La Cour suprême ne peut juger d'affaires pouvant impliquer le régime royal. Le pays est par ailleurs toujours totalement dépendant économiquement de l'Afrique du Sud.
an 2005 : Kenya - Un premier projet de nouvelle constitution est rejeté en 2005 par un référendum.
an 2005-2006 : Libéria - Après le départ de Charles Taylor, une transition politique débute par la tenue d'élections législatives et présidentielles. La campagne électorale se déroule sans incidents notoires, notamment grâce à la présence de 15 000 Casques bleus de l'UNMIL, présents dans le pays depuis d'octobre 2003. Deux courtes courtes présidences se succèdent, avec tout d'abord Moses Blah, ancien vice-président de Charles Taylor à qui celui-ci a transmis le flambeau lorsqu'il a démissionné : Moses Blah assure un intérim pendant quelques mois, le temps que des négociations, organisées à Accra entre les différentes parties, aboutissent. Gyude Bryant lui succède12. C'est un homme d’affaires. Mais il est aussi l’un des fondateurs, en 1984, du Liberia Action Party (LAP), dont il est devenu le président en 1992, deux ans après le début de la première guerre civile. Bryant n’a pas quitté son pays pendant les guerres civiles. Il a ensuite été un président de transition, pendant deux ans et quelques mois, avant les élections présidentielles prévues par la paix d'Accra, et organisées fin 2005.
Le 11 octobre 2005, les Libériens sont effectivement appelés aux urnes pour élire leur président, comme prévu dans l'Accord de paix d'Accra. Parmi les vingt-deux candidats, George Weah (un ancien footballeur reconverti dans la politique) et Ellen Johnson-Sirleaf (une économiste et ancienne responsable au sein de la Banque mondiale), sont les favoris dans les sondages.
Le 21 octobre, la Commission nationale électorale (NEC) annonce que George Weah a obtenu 28,3 % des voix, devançant Ellen Johnson-Sirleaf qui a obtenu 19,8 %. Ces derniers participent donc au second tour qui a eu lieu le 8 novembre. Les résultats définitifs de ce premier tour sont rendus public le 26 octobre, après l'examen des vingt réclamations concernant des fraudes éventuelles. Concernant les élections législatives, le Congrès pour le changement démocratique (CDC) de George Weah a obtenu 3 sièges sur 26 au Sénat et 15 sur 64 à la Chambre des représentants. Le Parti de l'unité d'Ellen Johnson-Sirleaf a obtenu 3 sièges au Sénat et 9 à la Chambre des représentants. Le taux de participation a été de 74,9 %.
Le 8 novembre a lieu le second tour de l'élection présidentielle. George Weah a réuni autour de lui plusieurs hommes politiques de poids, comme Winston Tubman (quatrième au premier tour), Varney Sherman (cinquième au premier tour) et Sekou Conneh (ancien chef de la rébellion du LURD (Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie)). Ellen Johnson-Sirleaf a comme soutien uniquement des hommes politiques de second plan, mais elle espère profiter d'un vote massif des femmes en sa faveur au moment de l'élection qui fasse d'elle la première femme démocratiquement élue président en Afrique. Le 23 novembre, la Commission électorale nationale (NEC) annonce les résultats définitifs qui déclarent vainqueur Ellen Johnson Sirleaf avec 59,4 % des votes, contre 40,6 % pour George Weah. Le nouveau président doit prêter serment le 16 janvier 2006.
an 2005 : Mauritanie - Le 3 août 2005, l'armée, au travers du Conseil militaire pour la justice et la démocratie (CMJD) présidé par le colonel Ely Ould Mohamed Vall, prend le pouvoir pour officiellement « mettre fin aux pratiques totalitaires du régime » du président Ould Taya. Le putsch se déroule alors que le président revient de Riyad où il a assisté la veille aux funérailles du roi Fahd d'Arabie Saoudite.
an 2005-2009 : Namibie - Le ministre des terres, Hifikepunye Pohamba, est imposé par Nujoma pour lui succéder à la présidence de la république en mars 2005. Nujoma reste toutefois à la présidence de la SWAPO jusqu'en 2007, date à laquelle Hifikepunye Pohamba lui succéda à la présidence du parti. Hifikepunye Pohamba a été réélu avec plus de 75 % des suffrages lors des élections de novembre 2009.
an 2005 : Ouganda - En août 2005, le Parlement (dominé par le NRM) vota une modification de la constitution qui, en enlevant la limite de deux mandats présidentiels, permit à Museveni de se représenter pour un troisième mandat. Kizza Besigye, revint d'exil en octobre 2005, et fut le principal opposant lors de l'élection de février 2006, remportée par Museveni avec 59,3 % des voix (au premier tour). Les résultats furent contestés par l'opposition du FDC (Forum for Democratic Changes, dirigé par Besigye).
an 2005 - 2015 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Après les élections de décembre 2005, Jakaya Kikwete devient le nouveau président de la République, le quatrième depuis la création de la Tanzanie. Il effectue les deux mandats que lui permettent la constitution. Le parti au pouvoir, le Chama cha Mapinduzi, choisit ensuite John Magufuli comme candidat à la succession pour les présidentielles de 2015. John Magufuli l'emporte et devient ainsi le cinquième président de la République de Tanzanie. Celui-ci acquiert une popularité, notamment grâce à sa lutte contre le gaspillage de l'argent public et contre la corruption, mais faitpreuve également de dérives autoritaires, contre ses opposants, contre les libertés individuelles, contre la presse, etc.
an 2005 : Togo - Le 5 février 2005, le président Étienne Eyadéma Gnassingbé, décède d'une crise cardiaque à 69 ans, après avoir présidé durant 38 ans le pays. Sa mort surprend autant la population du pays que le gouvernemen.
À la suite du décès de Gnassingbé Eyadema et profitant de l’absence au pays du président de l’Assemblée nationale qui, selon l’article 65 de la Constitution, doit assurer l’intérim de la présidence, l’armée togolaise prend la décision de confier le pouvoir au fils de Gnassingbé Eyadema, Faure Gnassingbé. L'Union africaine par la voix du président de la Commission Alpha Oumar Konaré dénonce un coup d’État militaire.
Le 25 février 2005, à la suite des pressions de la CEDEAO et de l’Union européenne, Faure Gnassingbé se retire et laisse la place au vice-président de l’Assemblée nationale togolaise, Abbas Bonfoh. Ce dernier assure l’intérim de la fonction présidentielle jusqu’à la tenue d'élections le 24 avril 2005. Quatre candidats se présentent : Faure Gnassingbé, soutenu par le Rassemblement du peuple togolais (RPT), Emmanuel Bob Akitani, candidat de la coalition de l’opposition radicale, Harry Olympio (en), candidat du Rassemblement pour le soutien à la démocratie et au développement (RSDD, opposition modérée) et Nicolas Lawson, homme d’affaires qui annonce le retrait de sa candidature le 22 avril 2005.
Le scrutin se déroule dans des conditions très controversées, l’opposition dénonçant des fraudes. Emmanuel Bob Akitani, chef de l’opposition, se déclare vainqueur avec 70 % des voix alors que le gouvernement déclare Faure Gnassingbé élu. Dès l’annonce des résultats, des manifestations émaillées de violences éclatent dans les principales villes. Elles seront violemment réprimées par les forces de l'ordre. Le gouvernement décide de mettre en place une commission nationale d'enquête qui estime le nombre de morts à des centaines, plus de 800 selon la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH). De nombreux Togolais, environ 40 000, se réfugient dans les pays voisins, le Bénin et le Ghana. Le 3 mai 2005, Faure Gnassingbé prête serment et déclare qu’il se concentrera sur « la promotion du développement, le bien commun, la paix et l’unité nationale ».
Le 8 juin 2005, Edem Kodjo, président de la Convergence patriotique panafricaine (CPP, opposition modérée), est nommé Premier ministre. Il est chargé de constituer un gouvernement d’union nationale.
Amnesty International publie en juillet 2005 un rapport dénonçant selon ses propres termes « un scrutin entaché d’irrégularités et de graves violences » tout en montrant que « les forces de sécurité togolaises aidées par des milices proches du parti au pouvoir (le Rassemblement du peuple togolais) s’en sont violemment prises à des opposants présumés ou à de simples citoyens en ayant recours à un usage systématique de la violence ». Le rapport reproche aussi à la France son rôle ambigu dans la situation actuelle15. Les violences consécutives aux événements politiques de 2005 auraient entraîné entre 400 et 500 morts.
an 2005 : Soudan - En 2005, un accord de paix est signé à Nairobi entre le gouvernement de Khartoum et l’APLS. Cet accord prévoit pour une période de six ans une large autonomie pour le Sud, qui disposera de son propre gouvernement et d'une armée autonome. À l’issue de cette période, un référendum d’autodétermination sera organisé. Les revenus issus du pétrole seront partagés en part égale entre le Sud et le Nord . D’autre part, le gouvernement aura 70 % des postes dans l’administration centrale contre 30 % pour la rébellion du Sud. Enfin, la charia ne sera appliquée que dans le Nord, à majorité musulmane. John Garang, le dirigeant de la rébellion contre le régime islamiste du général Omar el-Béchir, trouve la mort dans un accident d’hélicoptère, quelques semaines après sa nomination comme vice-président du Soudan pour pacifier la situation.
an 2006-2007 : Algérie - Les actions terroristes se poursuivent néanmoins dans plusieurs régions du pays : le quotidien L'Expression estime en 2006 qu'il y aurait de 600 à 900 membres de groupes terroristes encore en activité dans le maquis algérien, la majorité appartenant au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC). Ils se manifestent notamment par les attentats du 11 décembre 2007 à Alger (entre 30 et 72 victimes suivant les sources)
an 2006-2016 : Bénin (anc. Dahomey) - En mars 2006, Thomas Yayi Boni, ancien directeur de la Banque ouest-africaine de développement, est élu président du Bénin et de nouveau en mars 2011. Boni Yayi tente d'imposer, contre la volonté de sa famille politique, les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), un dauphin, le Franco-Béninois, Lionel Zinsou, un banquier d'affaires. Il est battu à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 par son ex-bras financier et allié, l'homme d'affaires Patrice Talon. Ce dernier accède au pouvoir le 6 avril 2016.
an 2006 : Burkina Faso - Avec l'arrestation de certains étudiants à la suite d'une conférence de presse à l'université de Ouagadougou, en 2007-2008 contre le coût élevé de la vie.
an 2006-2008 : Congo Kinshasa - Une constitution est approuvée par les électeurs, et le 30 juillet 2006, les premières élections multipartites du Congo depuis son indépendance (en 1960) se tiennent :
-
Joseph Kabila obtient 45 % des voix,
-
Son opposant, Jean-Pierre Bemba, 20 %.
Les résultats de l'élection sont contestés et cela se transforme en une lutte frontale, entre les partisans des deux partis, dans les rues de la capitale, Kinshasa, du 20 au 22 août 2006. Seize personnes sont tuées avant que la police et les troupes MONUC de l'ONU ne reprennent le contrôle de la ville.
Une nouvelle élection a lieu le 29 octobre 2006, et Kabila remporte 58 % des voix. Bien que tous les observateurs neutres se félicitent de ces élections, Bemba fait plusieurs déclarations publiques dénonçant des irrégularités dans les élections.
Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila prête serment comme président de la République et le gouvernement de transition prend fin. La fragilité du nouveau gouvernement a permis l'installation d'affrontements répétés et de violations des droits de l'homme.
Dans l'affrontement se déroulant dans la région du Kivu, les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) continuent de menacer la frontière rwandaise et les Banyarwandas ; le Rwanda soutient les rebelles du RCD-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie) contre Kinshasa; et une offensive rebelle ayant eu lieu fin octobre 2008 a causé une crise de réfugiés à Ituri, où les forces de MONUC se sont révélées incapables de maîtriser les nombreuses milices et groupes à l'origine du conflit d'Ituri.
Dans le Nord-Est, la LRA de Joseph Kony (LRA pour Lord's Resistance Army, l'Armée de résistance du Seigneur), s'est déplacée depuis sa base originelle en Ouganda (où elle a mené une rébellion pendant vingt ans) ou au Sud-Soudan, jusqu'en république démocratique du Congo, en 2005, et a établi des campements dans le parc national de Garamba.
Dans le Nord du Katanga, les Maï-Maï (anciennes milices créées par Laurent-Désiré Kabila pour lutter contre les milices rwandaises et ougandaises dans le Kivu, mais oubliées dans l'accord de Lusaka en 1999) ont échappé au contrôle de Kinshasa.
an 2006 : Gambie - En 2006 Jammeh est réélu pour un troisième mandat à 66 %. Une tentative de coup d’État a eu lieu en 2006 : l’ancien chef de l’armée est accusé.
an 2006 : Libéria - Au sujet de la formation de son gouvernement, Ellen Johnson Sirleaf a affirmé son intention de « former un gouvernement d'unité qui dépassera les lignes de fracture entre les partis, les ethnies, et les religions ». Avançant comme unique condition le fait de ne pas être corrompu, elle n'exclut pas la participation de George Weah au gouvernement, en déclarant : « Mais le pays ne va pas cesser de fonctionner s'il n'est pas dans le gouvernement. Nous allons avancer, avec ou sans lui ».
Ellen Johnson Sirleaf prête serment le 16 janvier en présence de nombreux personnages politiques, dont le perdant du second tour, George Weah. Au niveau international on peut noter la présence marquée pour l'aboutissement du processus de transition de la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, accompagnée de la première dame Laura Bush et de sa fille. Les officiels présents pour l'Afrique étaient le président Thabo Mbeki (Afrique du Sud), Abdoulaye Wade (Sénégal), Mamadou Tandja (Niger), John Kufuor (Ghana) et Ahmad Tejan Kabbah (Sierra Leone). La France était représentée par Brigitte Girardin, ministre délégué à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, la Chine par le ministre des Affaires étrangères Li Zhaoxing, la Guinée par le Premier ministre Cellou Dalein Diallo et la Côte d'Ivoire par Simone Gbagbo, épouse du président Laurent Gbagbo. Lors de son discours, elle a une fois de plus mis l'accent sur le fait que son gouvernement sera d'union nationale : « Mon gouvernement tendra la main de l'amitié et de la solidarité pour rallier tous les partis politiques [...] en tournant le dos à nos différences » et que la lutte contre la corruption sera l'une de ses priorités. Elle remplace donc officiellement Gyude Bryant. Concernant le Parlement, les deux nouveaux présidents de chacune des chambres ont également prêté serment ce même jour. Il s'agit d'Isaac Nyenabo pour le Sénat et d'Edwin Snowe pour l'Assemblée nationale.
an 2006 - 2007 : Madagascar - Après avoir lancé la reconstruction de routes et d'une partie des infrastructures du pays, Marc Ravalomanana est réélu lors de l'élection du 3 décembre 2006 en gagnant au premier tour avec la majorité absolue devant 13 autres prétendants, et est investi de nouveau président de la République de Madagascar pour un nouveau mandat de 5 ans.
Il appelle de nouveau les Malgaches aux urnes pour le 4 avril 2007 pour un référendum qui a pour objet principal la suppression des six « provinces autonomes » et l'instauration des « régions » au nombre de 22.
an 2006-2009 : Mali - Troisième rébellion touarègue.
an 2006 : Mozambique - En 2006, le pays compte 19 millions de Mozambicains dont un tiers vivant dans les villes, conséquence d'une urbanisation rapide intervenue au cours de l’interminable guerre civile.
S’il demeure l’un des pays les plus pauvres du monde, où l’espérance de vie est d’à peine 41 ans, le Mozambique connaît depuis 1995 une croissance annuelle exceptionnelle qui atteint 9 % en 2005. La Banque mondiale cite ainsi le Mozambique comme « un modèle de réussite. Une réussite en termes de croissance, et un modèle qui montre aux autres pays comment tirer le meilleur parti de l’aide internationale », même si la pauvreté reste omniprésente, plus de la moitié des habitants vivant encore en dessous du seuil de pauvreté.
an 2006 : Somalie - Depuis le 26 février 2006, le gouvernement de transition siège à Baidoa, en Somalie.
Au début du mois de juin 2006, les affrontements entre les membres de l'Alliance pour la restauration de la paix et contre le terrorisme (ARPCT), une alliance entre des chefs de guerre et le gouvernement fédéral de transition, soutenu par Washington, et l'Union des tribunaux islamiques, soutenus par de nombreux entrepreneurs de la capitale, ont vu la victoire de ces derniers pour le contrôle de Mogadiscio. Le nouveau régime serait soutenu par l'Érythrée, l'Iran et divers pays arabes, tandis que le gouvernement fédéral de transition, replié sur Baidoa, bénéficierait de l'appui militaire de l'Éthiopie. Le rétablissement de l'ordre se fait au nom de la seule structure législative stable et consensuelle du pays, la jurisprudence chaféite.
Le 13 juin 2006 à Nairobi, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui regroupe le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée et le gouvernement de transition de Somalie, décide d'interdire l'accès au territoire de ses pays membres aux miliciens de l'ARPCT fuyant devant l'avancée des tribunaux islamiques dont le plus important, celui de Mogadiscio, est nommé Hifka-Halane. Il sert de pouvoir judiciaire (civil et pénal), en jugeant les affaires en appliquant la charia.
Début décembre 2006, les Nations unies autorisent le déploiement d'une force de maintien de la paix, composée de 8 000 hommes, sous l'égide de l'Union africaine24 (résolution 1725). Fin décembre 2006, l'armée éthiopienne intervient et les tribunaux islamiques fuient Mogadiscio. Elle prend ainsi le contrôle de la majeure partie du pays et le gouvernement de transition se déclare le gouvernement de facto du pays.
Du 20 au 31 décembre 2006, l'Éthiopie est entrée en guerre contre l'Union des tribunaux islamiques. La loi martiale a été décrétée le 30 décembre 2006 par le premier ministre somalien du gouvernement fédéral de transition, Ali Mohamed Gedi, et un délai de trois jours a été donné aux Somaliens pour remettre leurs armes à feu aux troupes éthiopiennes ou fédérales, avec un suivi très faible.
an 2006 : Soudan - En 2006, le gouvernement de Khartoum rejette le déploiement de « Casques bleus » au Darfour. Mais il accepte finalement l'année suivante le déploiement au Darfour d’une « force hybride » associant l’ONU et l’Union africaine (la MINUAD).
an 2006-2010 : Tchad - Alors que le président Déby fait modifier la constitution pour supprimer la limite de deux mandats présidentiels, une guerre civile éclate, contestant cette mainmise sur le pouvoir. Le président réussit à se maintenir au pouvoir et à être réélu, lors d'élections contestées boycottées par l'opposition. Entre 2006 et 2008, les forces d'opposition rebelles tentent plusieurs fois de prendre la capitale par la force, mais échouent systématiquement.
Le 13 avril 2006, des combats éclatent entre les troupes du président de la République et une faction de la rébellion, le Front uni pour le Changement (FUC), dans la périphérie de N'Djaména. Idriss Déby Itno accuse le Soudan, en pleine guerre du Darfour, de soutenir ses adversaires, à l’aube des élections présidentielles.
Malgré l’opposition et les appels au boycott, le 3 mai 2006, Idriss Déby Itno est réélu au suffrage universel avec 64,67 % des votes exprimés.
Le 2 février 2008, les rebelles, en provenance du Soudan frontalier, s’emparent de la capitale du Tchad, N'Djaména, à l'exception du palais présidentiel où le président Idriss Déby Itno semble s'être cloîtré. La France décide d’évacuer une partie de ses ressortissants. Le 4 février 2008, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques contre le gouvernement tchadien, dont l’armée rencontre des difficultés à repousser les rebelles. La France, via l’opération Épervier, apporte alors une aide logistique qui permet d’assurer la stabilité régionale au Tchad.
Mais les rebelles mènent une guerre de mouvement dans l’Est du Tchad, afin de faire tomber le gouvernement au pouvoir. Les attaques répétées ont pour conséquence de provoquer en juin 2008 un combat opposant pour la première fois la mission militaire européenne EUFOR et les rebelles au sud d’Abéché, autour de la ville de Goz Beïda. En novembre 2008, dans l’Est du pays, deux véhicules militaires belges sont brûlés, à la suite de tirs provenant d’hélicoptères soudanais.
En mai 2009 a lieu une autre offensive de la rébellion partant du Soudan, toujours dans l'objectif de renverser Idriss Déby. Le contingent militaire français de l'opération Épervier est suppléé, entre 2007 et 2009, par la force d'interposition EUFOR, forte de 3 000 soldats, mandatée par l'Union européenne à la demande de la France, en principe neutre mais qui assure un soutien de fait au régime du président Déby.
Finalement, en 2010, le président soudanais Omar el-Bechir se rend au Tchad pour normaliser les relations entre les deux pays. Le gouvernement du Tchad refuse d’arrêter ce dernier, pourtant visé par des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale émis à son encontre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour.
an 2007-2008 : Burkina Faso - contre le coût élevé de la vie. En juin 2008, l'université de Ouagadougou connaît une grève massive, qui se solde par une reprise en main brutale de l'université par le pouvoir : suppression de toutes les prestations sociales étudiantes (bourses, restauration, résidences universitaires vidées en deux jours) après tirs à balles réelles sur les étudiants.
an 2007 : Afrique Côte d'Ivoire - Appliqué avec beaucoup de difficultés, l’accord de Linas-Marcoussis est suivi par plusieurs autres, conclus en Afrique et mis en œuvre par les gouvernements successifs de Seydou Diarra, Charles Konan Banny.
L’accord politique de Ouagadougou conclu en 2007 avec Laurent Gbagbo, sous l’égide du président burkinabé Blaise Compaoré, qui fait office de facilitateur, offre aux Forces nouvelles le poste de Premier ministre. Les Forces nouvelles désignent leur secrétaire général, Guillaume Soro, le 26 mars 2007 pour exercer cette fonction.
Guillaume Soro entre en fonction le 4 avril et son gouvernement est installé trois jours plus tard. Le gouvernement doit mettre en place notamment deux points clefs de l'accord politique de Ouagadougou : la préparation d'élections devant se tenir dans les dix mois à compter de mars 2007, puis l'unification des Forces armées des Forces nouvelles (FAFN) et des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire (FANCI).
Dans le gouvernement Soro I composé de 33 membres, la formation militaro-politique de celui-ci (les Forces nouvelles de Côte d'Ivoire) et le Front populaire ivoirien (FPI), formation politique dont est issu le président Laurent Gbagbo, disposent chacun de huit portefeuilles (le Premier ministre y compris). Les autres portefeuilles sont répartis entre divers autres partis politiques. Ainsi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) en détient 5, le Rassemblement des républicains (RDR) 5, le Mouvement des forces d'Avenir (MFA) un, le Parti ivoirien des travailleurs (PIT) un, l’Union démocratique de Côte d'Ivoire (UDCI) un et l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) un ; deux autres ministres sont réputés proches du Président de la République et un ministre est issu de la société civile.
Concrètement, outre la gestion des affaires relevant de ses compétences traditionnelles, le gouvernement coordonne la mise en œuvre du processus de sortie de crise au moyen de programmes spécifiques. Il s’agit d’un dispositif technique comprenant notamment le Centre de commandement intégré (désarmement des combattants), le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire, le Comité national de pilotage du redéploiement de l'Administration (restauration de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire et reprise du fonctionnement des services publics), l’Office national d'identification (identification des populations et des électeurs) et la Commission électorale indépendante (organisation des élections).
an 2007 : Guinée - Le pouvoir du président, sous influence d'hommes d'affaires comme Mamadou Sylla, est de plus en plus contesté. Début 2007 éclate une grève générale réprimée dans le sang.
an 2007 : Kenya - Lors de l'élection présidentielle du 27 décembre 2007, Raila Odinga reçoit un soutien massif dans les provinces de Nyanza, occidentale, de la vallée du Rift et de la côte mais aussi de personnalités emblématiques telle Wangari Maathai. Dans la soirée du 30 décembre 2007, Samuel Kivuitu (en), qui vient juste d'être reconduit, pour cinq ans, par Kibaki à son poste de président de la commission électorale (Electoral Commission of Kenya), déclare Raila Odinga battu par 232 000 voix de différence en faveur du président sortant contrairement aux tendances des derniers résultats enregistrés. Controversée par les observateurs de l'Union européenne qui demande un recomptage des bulletins de vote, cette annonce est immédiatement contestée par le camp de Raila et entraine la plus grande crise de violence survenue au Kenya.
an 2007 : Mali - Le 29 avril 2007, Amadou Toumani Touré est réélu au premier tour avec 71,20 % des voix, mais cette élection est contestée par les principaux candidats de l’opposition. Les relations commerciales, politiques et culturelles avec la France se ralentissent tandis que celles avec la Chine, la péninsule arabique et les États-Unis se renforcent.
an 2007-2008 : Mauritanie - Le 25 mars 2007, Sidi Ould Cheikh Abdallahi est le premier civil à être élu président de le République démocratiquement, le colonel Ely Ould Mohamed Vall, conformément à ses engagements, ne s’étant pas présenté. En avril 2007 la Mauritanie réintègre l’Union Africaine, dont elle avait été exclue après le coup d’État de 2005. Pour la première fois, des membres du parti islamique modéré rejoignent le gouvernement en mai 2008.
Esclavage :
La société mauritanienne reste dominée par la caste des Beydanes, qui a historiquement fondé son pouvoir sur l'esclavage des castes inférieures.
L’esclavage reste courant en Mauritanie, le président de l’IRA (Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste) Biram Dah Abeid considère la Mauritanie comme un régime « d’apartheid non écrit ». Certains parmi la minorité Maures (arabo-berbère) y exploitent des Haratines dans les quartiers riches des grandes villes. Selon le rapport de l’ONG Walk Free publié en 2014 environ 4% de la population mauritanienne, soit 150 000 personnes vit en situation d’esclavage. La Mauritanie est le pays le plus touché au monde par ce phénomène. Selon Biram Abeid, la réalité se rapproche plus des 20% de la population.
L'esclavage a été officiellement aboli à quatre reprises (la dernière fois en 1980, avec un succès mitigé) mais les ségrégations raciales, tribales ou de castes y subsistent. En 2007 a été votée une loi criminalisant l'esclavage, et des actions sont prévues par le gouvernement pour lutter contre ses séquelles, car l'ethnie haratine des anciens esclaves reste parmi la plus défavorisée. Selon le Global Slavery Index, l'esclavage concerne 4 % de la population mauritanienne.
an 2007-2010 : Nigéria - En 2007 des élections une nouvelle fois agitées amènent au pouvoir le successeur désigné d'Olusegun Obasanjo : Umaru Yar'Adua, qui décède le 5 mai 2010. Son vice-président Goodluck Jonathan lui succède alors.
an 2007-2009 : Rwanda - La veille de la commémoration du 7 avril 2007, l'ancien Président de la République, Pasteur Bizimungu, est gracié par le Président Paul Kagame. Cette incarcération était vivement contestée par des ONG qui y voyaient un prétexte pour écarter un éventuel rival politique. Pasteur Bizimungu avait en effet symbolisé une réconciliation possible entre Tutsi et Hutu après le génocide.
La peine de mort est abolie au Rwanda en milieu d'année 2007. Cette abolition était demandée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda afin que, dans le cadre de la cessation de ses activités, prévue dans ses statuts en 2008 et 2010 pour la cour d'appel, il puisse transférer des détenus et des dossiers de présumés génocidaires au Rwanda.
Le président du Parti Vert rwandais, Frank Habineza, fait également état de menaces. En octobre 2009, une réunion du Parti des Verts rwandais est violemment interrompue par la police Quelques semaines seulement avant les élections, le 14 juillet 2009, André Kagwa Rwisereka, le vice-président du Parti vert démocratique, est retrouvé mort, à Butare, au sud du Rwanda. Le climat interne est marqué par des meurtres ou des arrestations de journalistes toujours selon Amnesty International.
L'analyse publique des politiques et pratiques du gouvernement est limitée au sein du pays par les limites de la liberté de la presse. En juin 2009, le journaliste du journal Umuvugizi Jean-Leonard Rugambage est abattu devant son domicile à Kigali. En juillet 2009, Agnes Nkusi Uwimana, rédactrice en chef du journal Umurabyo, est accusée d'« idéologie du génocide" ».
an 2007: Sénégal - Abdoulaye Wade est facilement réélu lors de l’élection présidentielle de 2007, et malgré le mot d’ordre de boycott de l’opposition lors des élections législatives consécutives, il dispose d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale et au Sénat, rétabli en début d’année. Le Président mène une politique libérale ouvertement revendiquée qui donne certains résultats. En effet le Sénégal devient une terre d’élection pour les investisseurs d’Europe, mais aussi des émirats du Golfe – c’est le cas de Dubaï Ports World qui enlève l’exploitation du port de Dakar –, du Brésil, de Chine, d’Iran ou d’Inde – par exemple avec le géant mondial de la sidérurgie, Arcelor Mittal. Abdoulaye Wade appelle également à la création d’États-Unis d’Afrique et de grands travaux d’infrastructures ont été lancés en vue du 11e sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) qui s’est tenu à Dakar en mars 2008.
Mais la politique gouvernementale essuie aussi des revers, comme l’inexorable recul du secteur agricole (arachide, coton…), l’effondrement de l’industrie chimique en 2006, le développement insuffisant du secteur tertiaire ou l’engorgement persistant de la capitale.
Le pays reste très dépendant de l’aide extérieure, notamment des subsides envoyés par l’importante diaspora sénégalaise. Le ralentissement de la crois sance et un taux de chômage élevé poussent bien des jeunes Sénégalais à l’émigration, parfois au péril de leur vie. L’augmentation du coût de la vie, notamment liée à la hausse des cours du pétrole, suscite des manifestations de rue en novembre 2007.
Beaucoup dénoncent aussi une dérive autoritaire du pouvoir, – guère tempérée par un Premier ministre généralement présenté avant tout comme un technocrate, Cheikh Hadjibou Soumaré , et qui laisse une marge de manœuvre réduite à l’opposition, ainsi qu’aux médias, pour la plupart solidaires de l’action présidentielle.
La question de la future succession d’Abdoulaye Wade, réélu à 80 ans, apparaît en filigrane dans le débat politique actuel, alimenté notamment par les spéculations sur les intentions de son fils Karim Wade.
an 2007 : Somalie - En janvier 2007, les États-Unis interviennent dans le sud de la Somalie pour pourchasser des membres présumés d'Al-Qaïda.
Le 23 janvier 2007, les troupes éthiopiennes commencent officiellement à se retirer de Somalie. Peu fréquent auparavant, les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du 29 octobre 2008 sont attribués au groupe al-Shabaab)
an 2008 : Afrique du Sud - En 2008, une grave pénurie d'électricité achève le bilan économique du président, à qui la presse reproche l'imprévoyance de son gouvernement, ainsi qu'à celui de Nelson Mandela, pour avoir refusé, en 1996, d'investir dans la construction de nouvelles centrales électriques alors que le pays connait une croissance de la demande en électricité de 10 % chaque année. Les grandes villes sont, pendant plusieurs semaines, périodiquement plongées pendant quelques heures dans l'obscurité alors que le gouvernement est contraint de promouvoir le rationnement, de renoncer à certains grands projets créateurs d'emplois et de suspendre ses exportations d'électricité vers les pays voisins. En mai, le gouvernement est confronté à une vague de violences contre les immigrés, caractérisée notamment par des meurtres, des pillages et des lynchages.
Mis en cause indirectement pour des « interférences » politiques dans des affaires judiciaires impliquant son ancien vice-président, Thabo Mbeki est contraint de démissionner de la présidence sud-africaine le 21 septembre 2008 après avoir été désavoué par son parti.
L'ANC nomme alors le vice-président du parti, Kgalema Motlanthe, pour lui succéder. Cela s'accompagne d'un schisme au sein de l'ANC et la création du Congrès du Peuple (COPE) par les partisans de l'ancien président.
an 2008 : République de Botswana - Le nouveau président est le lieutenant-général Ian Khama qui entre en fonction 2008, en prévision des élections de 2009. Il est le fils du premier président du Botswana, et un ancien chef de l'armée du Botswana (BDF). Élu formellement en 2009 et réélu en 2014, il demeure en fonction jusqu'en 2018, date à laquelle il démissionne pour laisser la place au vice-président Mokgweetsi Masisi qui lui succède.
an 2008 : Cameroun - En février 2008, des émeutes éclatent, réclamant la baisse des prix et le départ de Paul Biya. Les manifestants sont sévèrement réprimés : une centaine de morts, des milliers d’arrestations.
Le projet de Paul Biya de modifier la Constitution en février 2008 donne lieu à des manifestations brutalement réprimées ; une centaine de personnes sont tuées.
an 2008 : Cap Vert - Le 23 juillet 2008, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) accueille le Cap-Vert qui devient le 153e pays membre. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux principaux partis, le Mouvement pour la démocratie (MPD), et le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV, l'ancien parti unique), qui se succèdent au pouvoir, et quelquefois y cohabitent (avec un président de l'un et un premier ministre de l'autre). L'archipel souffre par contre du réchauffement climatique et de sécheresses, d'autant plus que l'eau douce y est rare. Les gouvernements ont opté pour une politique de développement des énergies renouvelables, ainsi que de l'écotourisme.
an 2008 : Afrique République de Djibouti - La frontière reste donc inchangée, l'île est indivise entre les deux pays. Douméra est le prétexte de l'affrontement entre les forces érythréennes et djiboutiennes de juin 2008.
an 2008-2009 : Afrique République de Djibouti - Le 10 juin 2008 éclate la guerre djibouto-érythréenne qui a opposé l'Érythrée à Djibouti autour du cap (ras) Douméra. Djibouti accuse Asmara d'avoir financé le mouvement armé anti-gouvernemental du Front pour la restauration de l’unité et la démocratie entre 1991 à 1994. L'Érythrée revendique la zone du cap Douméra, point littoral de la frontière entre les deux pays. En janvier 2009, par la résolution 1862 du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil de sécurité des Nations unies impose des sanctions contre l'Érythrée.
an 2008-2018 : Érythrée - Enfin, un différend territorial oppose par ailleurs l'Érythrée à Djibouti sur sa frontière sud depuis 2008 qui vaut à l'Érythrée des sanctions des Nations unies, sanctions levées le 14 novembre 2018. Le Conseil a ainsi adopté à l'unanimité cette résolution élaborée par la Grande-Bretagne et levé l'embargo sur les armes, toutes les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et autres sanctions.
an 2008-2012 : Ghana - Le président Kufuor quitte le pouvoir en 2008, respectant comme son prédécesseur, la limite du nombre de mandat possible. La décision du Nouveau Parti Patriotique est de choisir Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le fils de Edward Akufo-Addo comme leur candidat, tandis que le Congrès National Démocratique choisit John Atta Mills pour la troisième fois.
Le 28 décembre 2008, au terme d'une élection présidentielle très disputée et unanimement saluée pour son caractère démocratique, le candidat du Congrès démocratique national (Ghana), John Atta Mills, devient le nouveau président du pays. La passation de pouvoir s'est déroulée le 7 janvier 2009. John Atta Mills bénéficie ensuite de l'exploitation de forages pétroliers qui créent une dynamique nouvelle. La gestion de cette manne, qui soulève de grands espoirs dans la population, se veut basée sur un modèle norvégien avec « une industrie pétrolière où le sens de l’équité et de la justice doivent être reproduits localement pour le bénéfice de tous les Ghanéens »
Le 24 juillet 2012, le président meurt. Le pouvoir est transmis au vice-président, John Dramani Mahama, et des élections sont convoquées18. Il choisit le Gouverneur de la Banque du Ghana, Amissah Arthur, comme nouveau vice-président. Il est confirmé à son poste par le scrutin de décembre 201220. Son mandat est perturbé par une croissance en berne et des scandales de corruption et il perd l'élection présidentielle de 2016 face au chef de l'opposition Nana Akufo-Addo.
Industrialisation, opération séduction des investisseurs étrangers, lutte contre le paludisme, les initiatives s'enchaînent. Réputé pour sa stabilité politique, son fonctionnement démocratique et son dynamisme, le pays accueille Melania Trump après Barack Obama, mais aussi Angela Merkel ou encore Emmanuel Macron.
an 2008-2009 : Guinée - Le 22 décembre 2008, Lansana Conté décède des suites d'une longue maladie (leucémie et diabète aigu) à l'âge de 74 ans. Au cours de la nuit suivante, les proches du régime s'affairent pour organiser l'intérim suivant les procédures prévues par la Constitution mais le 23 décembre 2008 au matin, à la suite de l'annonce du décès de Lansana Conté, des dignitaires de l'armée annoncent unilatéralement la dissolution du gouvernement ainsi que la suspension de la Constitution, dans un discours à teneur résolument sociale. Ces événements laissent planer le doute sur l'effectivité d'un nouveau coup d'État. Le même jour, le capitaine Moussa Dadis Camara est porté à la tête du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et devient le lendemain, le troisième président de la République de Guinée.
an 2008 : Kenya - Fin février 2008, grâce à la médiation de Kofi Annan, l'ancien Secrétaire général des Nations unies, un accord de partage du pouvoir entre le président Kibaki et Raila est signé et entériné à l'unanimité par le Parlement le 18 mars pour résoudre la crise. Il se matérialise par la nomination de Raila Odinga au poste de Premier ministre le 13 avril suivant. Quatre jours plus tard, il prête serment et un gouvernement de coalition est constitué.
an 2008 : Libéria - L'ancien président Charles Taylor est jugé pour l'armement et le soutien aux rebelles de Sierra Leone depuis le 7 janvier 2008 à La Haye. Il plaide non coupable.
an 2008 : Mauritanie - Le 6 août 2008, à la suite du limogeage d'officiers supérieurs, les militaires conduits par le chef du bataillon chargé de la sécurité présidentielle, le général Mohamed Ould Abdelaziz, déposent le président Abdallahi. Il est assigné à résidence durant 4 mois et demi. Les principaux partis d’opposition, à l'exception du RFD d’Ahmed Ould Daddah se réunissent en un Front national pour la défense de la démocratie (FNDD) et s'opposent au coup d’État.
an 2008 : Somalie - les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du 29 octobre 2008 sont attribués au groupe al-Shabaab)
Le 29 décembre 2008, le président Abdullahi Yusuf Ahmed annonce sa démission, déclarant qu'il regrette n'avoir pas pu mettre fin au conflit somalien. Le Parlement, réuni à Djibouti en raison du désordre en Somalie, élit alors le cheikh Sharif Ahmed, ancien dirigeant de l'Union des tribunaux islamiques, à la présidence de la République. Il l'emporta face à Maslah Mohamed Siad Barre, fils de l'ancien président Mohamed Siad Barre, et au Premier ministre sortant Nur Hassan Hussei.
an 2008 - 2010 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 2008, les élections présidentielle et législatives du 29 mars constituent un revers pour la ZANU. Le MDC remporte la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale (109 élus contre 97 élus à la ZANU). Publiés le 2 mai, le résultat de l’élection présidentielle est contesté. En obtenant officiellement près de 48 % des suffrages en dépit des fraudes, Morgan Tsvangirai devance néanmoins Robert Mugabe (43 %). Lors de la campagne du second tour, le pays est le théâtre de violences politiques continues marquées par des exactions commises par la police contre des membres de l'opposition et leur famille mais aussi par l’arrestation de ses principaux chefs31. Dans ce climat de terreur, Morgan Tsvangirai décide à cinq jours du second tour de l’élection présidentielle de boycotter celle-ci, permettant ainsi à Robert Mugabe d’être réélu. L’inflation dépassant les 10 millions de % en rythme annuel, l'édition de billets de 100 milliards de dollars zimbabwéens (environ 3 EUR fin juillet 2008) devient nécessaire. La population est contrainte de revenir à une économie de troc et à la marche à pied : il n'y a plus de gazole pour faire rouler les bus.
De plus, à partir du mois d'août, une épidémie de choléra sévit dans le pays ; elle fait, selon l'OMS, 2 971 morts, pour 56 123 personnes contaminées (chiffres officiels au 27 janvier 2009). Toujours d'après l'OMS, jusqu'à la moitié des 12 millions de Zimbabwéens sont susceptibles de contracter la maladie en raison de l'insalubrité des conditions de vie dans le pays. En 2009, sous la pression de l'ONU quant aux fraudes concernant l'élection présidentielle, Robert Mugabe décide de partager le pouvoir avec son opposant et rival personnel Morgan Tsvangirai, chef du Mouvement pour le changement démocratique (MDC). En avril 2010, Mugabe reçoit le président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, avec lequel il conclut huit accords commerciaux entre les deux pays. Cette visite n'est pas bien perçue par l'opposition et par le reste du monde.
an 2009-2010 : Afrique du Sud - En mai 2009, Jacob Zuma est élu président de la république après la victoire de l'ANC (65,90 %), lors des élections générales, face notamment à l'alliance démocratique (16,66 %) d'Helen Zille, qui remporte la province du Cap occidental, et face au Congrès du Peuple (7,42 %) de Mosiuoa Lekota. Il hérite d'un pays toujours considéré comme le poumon économique de l'Afrique subsaharienne (40 % du PIB de l'Afrique subsaharienne) mais où le crime, sans distinction raciale, est omniprésent, faisant de ce pays l'un des plus dangereux du monde au côté de l'Irak et de la Colombie, où l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'est accentué, où la politique de discrimination positive est contestée pour son inefficacité et où les tentatives de réforme agraire n'ont débouché que sur des échecs. Le nouveau gouvernement qu'il forme est alors plus ouvert aux autres partis et autres races que ne l'était celui de Mbeki. Il fait notamment entrer au gouvernement Jeremy Cronin, un Blanc par ailleurs secrétaire général adjoint du parti communiste sud-africain et Pieter Mulder, chef du front de la liberté, le parti de la droite afrikaner qui a succédé à l'ancien parti conservateur.
En 2010, quinze ans après avoir organisé avec succès la coupe du monde de rugby, marquée par la victoire de l'équipe nationale, les Springboks, l'Afrique du Sud est le pays hôte de la coupe du monde de football. Deux mois avant l'évènement sportif, le 3 avril 2010, l'assassinat, dans sa ferme, d'Eugène Terre'Blanche par deux de ses ouvriers agricoles fait craindre un moment un réveil des tensions raciales dans une Afrique du Sud toujours minée par ces conflits latents. Le très influent leader de la Jeunesse de l'ANC, Julius Malema, connu pour ses outrances verbales à l'encontre de Thabo Mbeki et des opposants à Zuma, pour qui il se déclarait prêt à tuer, est mis en cause pour avoir repris dans ses discours une chanson prônant de « tuer les Boers » parce que « ce sont des violeurs ». Dans les campagnes sud-africaines, le modèle zimbabwéen reposant sur la carte raciale et la carte de la terre a beaucoup de partisans. L'épisode du meurtre de Terre'Blanche souligne ce malaise en zone rurale où plus de 2 500 fermiers blancs ont été tués en une dizaine d'années, souvent dans d'atroces conditions et le fait que des ouvriers agricoles noirs sont souvent mal payés et maltraités par leurs employeurs.
an 2009 : Algérie - Pendant les mois de mars et d'avril de l'année 2009, la campagne électorale pour la présidentielle se déclenche à la suite d'un nouvel amendement constitutionnel. Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014.
an 2009-2011 : Afrique - les Comores - Il est organisé le 29 mars 2009 et 95,2 % des votants acceptent le changement de statut, faisant de Mayotte le 5e département d'outre-mer (DOM) et le 101e département français en 2011.
Mayotte fait partie des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Elle devrait devenir une région ultrapériphérique de l'Union européenne au moment de sa départementalisation. Le pays souverain formé par les trois îles s'appelle aujourd'hui Union des Comores.
an 2009 : Congo Brazzaville - Denis Sassou-Nguesso est de nouveau réélu président du Congo, avec 78,61 % des voix à l'issue du vote du 12 juillet.
an 2009-2016 : Gabon - Le 3 septembre 2009, Ali Bongo, ministre de la Défense et fils d'Omar Bongo Ondimba, devient le troisième président du Gabon, élu à l'occasion d'un scrutin majoritaire à un tour, avec 41,79 % des suffrages exprimés, soit environ 141 000 voix sur un total de 800 000 électeurs inscrits. Il devance Pierre Mamboundou, crédité de 25,64 % des voix, et André Mba Obame, le nouveau chef de l'opposition gabonaise et ancien ministre de l'Intérieur. Les résultats sont fortement contestés et à la suite des forts soupçons de fraude, des émeutes éclatent et sont violemment réprimées par les forces de l'ordre, fidèles au pouvoir.
Par la suite, plusieurs enquêtes attestèrent que les scores avaient été truqués. Dans un documentaire diffusé sur France 2 en décembre 2010, le diplomate Michel de Bonnecorse, ex-conseiller Afrique du président Jacques Chirac, confirmera cette version des faits. L’ambassadeur américain Charles Rivkin, dans un télégramme transmis en novembre 2009 à la secrétaire d’État, le confirme également : « octobre 2009, Ali Bongo inverse le décompte des voix et se déclare président » (le télégramme sera divulgué par WikiLeaks en février 2011).
Depuis, le président Bongo prône le concept de « Gabon émergent », politique visant notamment à la diversification de l'économie afin de diminuer sa dépendance aux cours mondiaux du pétrole.
an 2009 Guinée - Le 28 septembre 2009, des mouvements civils organisent une manifestation pacifique pour demander à Dadis Camara de respecter sa parole et de ne pas se présenter aux présidentielles. Une foule de plusieurs milliers de personnes s'était rendu au stade à la demande de l'opposition pour protester contre le désir du président Dadis de se porter candidat à l'élection présidentielle. Le 28 septembre 2009, au stade de Conakry, à la surprise générale les militaires ouvrent le feu sur les manifestants ainsi bloqués dans le stade sans possibilité de fuite. Ce massacre délibéré et manifestement planifié fait plusieurs centaines de morts. De plus, les militaires violent et enlèvent plusieurs dizaines de jeunes femmes, dont certaines seront libérées quelques jours plus tard après avoir subi des viols à répétition, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de trace.
À la suite du tollé international soulevé par cet évènement, des dissensions apparaissent au sein du CNDD34 et le 3 décembre 2009, alors que Sékouba Konaté est en voyage au Liban, le président est grièvement blessé par son aide de camp Aboubacar Sidiki Diakité - ce dernier avait été mis en cause explicitement par des diplomates étrangers pour son rôle dans le massacre du 28 septembre, et craignait d'être « lâché » par son président et livré à la justice. Dadis Camara est hospitalisé au Maroc le 4, et Sékouba Konaté rentre au pays pour assurer l'intérim.
an 2009 : Guinée-Bissau - le 1er mars 2009, le chef d'état-major des forces armées, le général Batista Tagme Na Waie, est tué dans un attentat à la bombe. Le président João Bernardo Vieira, que certains militaires tiennent pour responsable de cet attentat dans la mesure où il entretenait des relations historiquement exécrables avec ce dernier, est assassiné à son tour, le 2 mars 2009, par des hommes en armes. Pour lui succéder, Malam Bacai Sanhá, candidat du PAIGC, est élu président le 26 juillet 2009.
Parallèlement, la Guinée-Bissau est gangrenée par le trafic de drogue et qualifiée à ce titre de « narco-État » par l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime. Ainsi, les attentats contre le chef d'état-major Tagmé Na Waié et le président Vieira ont probablement été fomentés par les trafiquants colombiens, peut-être en représailles de la destitution en août 2008 du contre-amiral José Américo Bubo Na Tchuto, chef de la marine nationale, qui couvrait le trafic avec Antonio Indjai. Ce dernier, après bien des péripéties, tombera d'ailleurs en mars 2013 dans un piège tendu par la DEA et envoyé aux États-Unis pour y être jugé pour trafic de drogue tandis qu'Antonio Indjai est depuis lors inculpé par la justice américaine et sous mandat d'arrêt international.
Le mandat de Malam Bacaï Sanha est émaillé de graves incidents en lien avec le narcotrafic. Le 1er avril 2010, une tentative de coup d'État menée par Antonio Indjai et l'ancien contre-amiral José Américo Bubo Na Tchuto aboutit à l'arrestation du Premier ministre Carlos Gomes Júnior et d'une quarantaine d'officiers dont le chef d'état-major de l'armée, José Zamora Induta, dans un coup de force présenté comme « un problème purement militaire ». À la suite de manifestations de soutien au Premier ministre, Antonio Indjai menace de tuer ce dernier avant d'expliquer dans une allocution que l'armée « réitérait son attachement et sa soumission au pouvoir politique ». Le Premier ministre est relâché le lendemain tandis qu'Indjai se présente comme le nouvel homme fort de l'armée. Ce dernier est relâché le lendemain, mais demeure en résidence surveillée, tandis qu'Antonio Indjai devient le nouvel homme fort de l'armée.
an 2009 : Libéria - Constatant une certaine stabilité politique, la Banque européenne d'investissement accorde le 15 mai 2009 un prêt de 3,5 millions d'euros au Liberia pour le soutien de la micro finance dans ce pays ainsi que la suspension des remboursements de l'encours du solde de la dette jusqu'en 2012. Mais la corruption continue de gangrener le système politique, malgré les intentions initialement affichées.
an 2009 : Madagascar - À partir de janvier 2009, une crise politique entre le maire de la capitale Andry Rajoelina et le président Marc Ravalomanana fait une centaine de victimes. Le 16 mars 2009, le président Marc Ravalomanana démissionne. Il transfère les pleins pouvoirs à un Directoire militaire composé des plus hauts gradés de l'Armée malgache, en lieu et place du président du Sénat comme le prévoyait la constitution, lequel directoire (re)transfère le jour même le pouvoir à Andry Rajoelina. Cette prise de pouvoir, validée par la Haute Cour Constitutionnelle malgache (HCC), est toutefois considérée par une grande partie de la Communauté internationale comme un coup d'État. Du 17 mars 2009 au 25 janvier 2014, Andry Rajoelina dirige l’État malgache sous le régime de la Transition.
an 2009 : Mauritanie - En avril 2009, Mohamed Ould Abdel Aziz abandonne le pouvoir afin de se présenter à l'élection présidentielle promise par la junte. Un accord pour préparer les futures élections est signé à Dakar entre les représentants de l’opposition et de la junte.
Le 18 juillet, Mohamed Ould Abdelaziz, qui durant sa campagne se présente comme le « président des pauvres », est élu au premier tour face à 8 autres candidats, avec 52,58% des voix. Ses opposants dénoncent un « coup d’État électoral » et fondent une Coordination de l’opposition démocratique, qui inclut le RFD.
L'arrivée du président actuel Mohamed Ould Abdel Aziz, le 18 juin 2009, fut marquée notamment par la coupure de ces relations diplomatiques avec Israël.
an 2009 : Mozambique - Le 28 octobre 2009, Armando Guebuza est réélu président pour un deuxième mandat, dès le premier tour de scrutin avec 75 % des voix
an 2009 : Ouganda - Des tensions apparaissent également avec le Kabaka (roi) du Buganda et dégénèrent en affrontements en 2009.
Dans un mouvement de populisme, une loi anti-homosexualité fut proposée en 2009 prévoyant jusqu'à la peine de mort pour les homosexuels et pénalisant les individus, entreprises, médias et ONG soutenant les droits des LGBT.
an 2009 : Sénégal - Lors des élections locales du 22 mars 2009, le PDS, parti au pouvoir, essuie un sérieux revers dans la plupart des grandes villes dont Dakar convoité par Karim Wade, au profit de la coalition d’opposition Bennoo Siggil Senegaal.
Après la démission de Cheikh Hadjibou Soumaré le 30 avril 2009, Souleymane Ndéné Ndiaye est nommé Premier ministre.
Septembre 2009 : des pluies torrentielles provoquent de violentes inondations dans le pays.
an 2009 : Somalie - Dès février 2009, divers groupes islamistes fusionnèrent au sein du Hizbul Islam et déclarèrent la guerre au gouvernement modéré de Sharif Ahmed. Cette coalition inclut l'Alliance pour la nouvelle libération de la Somalie, dirigée par Hassan Dahir Aweys, l'un des chefs radicaux de l'Union des tribunaux islamiques, Hassan Abdullah Hersi al-Turki, un autre commandant de l'Union des tribunaux islamiques et leader des brigades de Ras Kamboni et le groupe Muaskar Anole. Cette nouvelle coalition islamiste est, avec le groupe al-Shabaab, la plus active dans le conflit. De plus, en mars 2009, ben Laden appelait dans un enregistrement au renversement de Sharif Ahmed.
an 2009 : Soudan - En 2009, la Cour pénale internationale (CPI) lance un mandat d’arrêt contre le président soudanais Omar el-Béchir 4 mars 2009 pour crimes contre l’humanité (l’année suivante, l’accusation de génocide sera rajoutée).
an 2010 : Burkina Faso -Blaise Compaoré est réélu en 2010.
an 2010 : Burundi - Après cinq années, l'érosion du pouvoir conduit à un certain agacement au sein des autres groupes Hutus. Lorsque le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) de Pierre Nkurunziza obtient une majorité des 2/3 aux élections communales du 26 mai 2010, les partis Hutus signataires des accords d'Arusha dénoncent immédiatement des fraudes massives. L'ONU et l'Union européenne, qui supervisent le scrutin, assurent ne pas avoir observé de graves irrégularités.
Peu après, une émeute éclate dans un faubourg de Bujumbura : les manifestants ont découvert une urne remplie de bulletins non-décachetés dans un quartier acquis aux Hutus anti-Nkurunziza ; il y a plusieurs blessés. Le 2 juin, des dirigeants de l'opposition Hutu sont arrêtés, tandis que Ban Ki-moon arrive au Burundi pour appeler à la poursuite du processus électoral. Il ne rencontre que le président, ce qui est vécu par les opposants comme une trahison de la communauté internationale.
Le lendemain, les partis Hutu d'opposition (FNL, etc.) décident le boycott total de l'élection présidentielle du 28 juin. Le 5 juin, l'ancien président Domitien Ndayizeye décide de rejoindre la contestation. Le 7 juin, le gouvernement interdit toute campagne pour l'abstention, ce qui radicalise la divergence.
L'opposition burundaise refuse de participer à l'élection présidentielle du 28 juin 2010 et dénonce des fraudes lors des élections municipales de mai (le CNDD-FDD a remporté les municipales avec 64 % des voix et le déroulement de l'élection est jugé correct en regard des standards internationaux par les observateurs de l'Union européenne). La campagne est émaillée d'incidents, plusieurs membres de l'opposition sont arrêtés. Pierre Nkurunziza a été réélu président en 2010 avec plus de 91 % des voix, étant le seul candidat de l'élection. Les candidats de l’opposition s’étaient retirés pour protester contre les irrégularités du scrutin.
an 2010 : Congo Kinshasa - Depuis novembre 2010, l'ancienne mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUC qui n'était pas parvenue à désarmer les milices rwandaises, est renforcée militairement pour intervenir dans l'est du pays et devient la MONUSCO, mais plusieurs dissidences et révoltes persistent et de nombreuses violences continuent.
an 2010 : Afrique Côte d'Ivoire - À l'issue d'une élection présidentielle sous tension, les deux candidats arrivés au second tour, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, se déclarent vainqueurs et prêtent serment comme président du pays. Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur par Youssouf Bakayoko, le président de la Commission électorale indépendante, au siège du camp de Ouattara contrairement aux dispositions de ladite CEI, et a reçu le soutien du Premier ministre Guillaume Soro et d'une partie de la Communauté internationale. Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel et a reçu le soutien du général Philippe Mangou, commandant de l'armée. La Côte d'Ivoire se retrouve alors avec deux présidents tentant de s'imposer sur l'ensemble du pays.
Mais Alassane Ouattara bénéficie du soutien de la plus grande partie de la communauté internationale, ainsi que celui d'instances économiques et financières tant régionales qu'internationales. L'économie ivoirienne est paralysée par les sanctions et les finances de l'État ivoirien asséchées, notamment les zones encore contrôlées par Laurent Gbagbo.
an 2010 : Guinée - Arrivé au pouvoir, le capitaine précise que le nouveau régime est provisoire et qu'aucun membre de la junte ne se présentera aux élections présidentielles prévues en 2010.
Au fil de ses interventions médiatiques, Moussa Dadis Camara envisage de plus en plus explicitement de se présenter, décevant les espoirs de véritable transition démocratique et déclenchant des mouvements de protestation.
Le 12 janvier 2010, Moussa Dadis Camara est renvoyé vers le Burkina Faso par le Maroc pour y continuer sa convalescence. C'est ainsi que le 15 janvier, un accord sera trouvé entre Dadis et Sékouba pour que ce dernier soit reconnu Président de la transition. Cet accord stipule qu'un premier ministre issu des Forces Vives (Partis d'opposition, syndicats, société civile) soit nommé dans le but de former un gouvernement d'Union nationale et de conduire le pays vers des élections libres et transparentes dans les six mois. Aussi, aucun membre du gouvernement d'union nationale, de la junte, du Conseil national de la transition et des Forces de Défense et de Sécurité n'aura le droit de se porter candidat aux prochaines échéances électorales.
Le 16 janvier, Dadis, dans une allocution à partir du palais présidentiel burkinabé, dit que la question de sa candidature est définitivement réglée, ainsi que celle des autres membres de la junte. Jean-Marie Doré, doyen de l'opposition, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement d'union nationale chargé d'organiser les futures élections présidentielles.
Le 8 février 2010, la justice guinéenne ouvre un instruction judiciaire pour les crimes commis le 28 septembre 2009 à Conakry, trois magistrats instructeurs sont nommés et le 3 juin 2010, la FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen (OGDH), trois autres organisations guinéennes de victimes (AVIPA, AFADIS, AGORA) et 67 victimes se constituent parties civiles.
Le 7 mars 2010, Sékouba Konaté fixe par décret la date du premier tour de l'élection présidentielle au 27 juin 2010. Il tient parole et pour la première fois une élection présidentielle en Guinée se déroule sans qu'aucun militaire ne soit candidat. Le second tour des élections présidentielles devait se tenir le 19 septembre 2010 mais a été reporté à une date ultérieure.
Le 28 septembre 2010, un an après le massacre, les victimes et les ONG de défense des droits de l'homme demandent le jugement des auteurs présumés des faits.
Le 7 novembre 2010, Alpha Condé (candidat du RPG et de l'Alliance Arc-En-Ciel) obtient 52,5 % des suffrages face à son adversaire Cellou Dalein Diallo (candidat de l'UFDG et de l'Alliance des bâtisseurs), qui a fini par accepter les résultats de la cour suprême qu'il avait initialement contestés en raison de soupçons d'irrégularités. Le président Alpha Condé est élu pour un mandat de 5 ans.
an 2010 : Kenya - Le 4 août 2010, le texte de réforme de la Constitution, incluant la Charte des droits et libertés16, chère à Raila — et maintenant soutenu par Kibaki — est accepté, contre la position d'un autre membre influent de l'ODM, le ministre des Hautes études William Ruto — soutenu, lui, par l'ex-président Moi —, par la majorité des 72,1 % de Kényans ayant participé au référendum populaire (70 % de votes favorables contre 30 % de défavorables).
La cérémonie publique de promulgation par le président Mwai Kibaki de cette Constitution moderne16 le 27 août 2010 est entachée par la présence du président soudanais Omar el-Béchir alors qu'il est notifié d'un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Cette invitation, directement adressée par le président Kibaki suscite l'émotion et la réprobation des Kényans, de leur Premier ministre et des parlementaires. Les protestations de la Communauté internationale et en particulier celles du président américain Barack Obama — bien que les États-Unis n'aie pas ratifié le statut de Rome — et de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan sont rapides.
an 2010 : Leshoto - En 2010, peu avant la Coupe du monde de football, des milliers d’habitants ont demandé au gouvernement sud-africain l'annexion du pays pour en faire la dixième province d'Afrique du Sud. Fin mai, plusieurs centaines de personnes ont défilé dans la capitale, Maseru, et remis au Parlement et à l'ambassade d'Afrique du Sud une pétition demandant le rattachement. Plus de 30 000 signatures ont été recueillis et les raisons sont multiples : une situation économique extrêmement précaire, un taux de sida très élevé (400 000 personnes en sont atteints), une espérance de vie très basse (34 ans) et l'effondrement de l'industrie textile, ce qui rend la survie du pays extrêmement difficile, d'autant plus qu'il est totalement encerclé par l'Afrique du Sud et qu'il y a plus de Sothos vivant en Afrique du Sud qu'au Lesotho lui-même.
an 2010-2012 : Malawi - Mutharika remplace Muammar al-Gaddafi à la tête de l’Union africaine, devenant le premier chef d’état malawite à exercer la charge de secrétaire général de cette organisation. En 2011, le Malawi établit des relations diplomatiques avec 10 pays. Mais le second mandat de Mutharika est vite marqué par une dégradation brusque de l'économie, une dégradation des conditions de vie et des pénuries d'essence dues à un manque de confiance des bailleurs de fonds. Des émeutes éclatent, et le régime se durcit, s'appuyant sur l'armée. Finalement, le président Bingu wa Mutharika est victime d'un arrêt cardiaque le 5 avril 2012.
an 2010-2013 : Mali - En septembre 2010, sept étrangers, dont cinq Français, sont enlevés par Al-Qaida au Maghreb islamique. Treize mois plus tard, des Touareg maliens, ex-mercenaires en Libye, reviennent dans la partie nord du Mali : le contrôle de cette partie du pays semble échapper de plus en plus au pouvoir en place à Bamako entre les interventions de Al-Qaida au Maghreb islamique et ces forces Touaregs. Le 22 mars 2012, le capitaine Amadou Haya Sanogo dirige un coup d’État militaire. Quelques mois plus tard, soumis également à une pression internationale, il rend le pouvoir à des autorités civiles, pour une période de transition, avec comme président par intérim Dioncounda Traoré. Celui-ci organise une élection présidentielle qui se tient les 28 juillet et 11 août 2013 et s'achève par la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta auquel Dioncounda Traoré transmet le pouvoir le 4 septembre suivant.
Pendant ce temps, durant cette même année 2012, profitant des bouleversements politiques successifs à Bamako, les événements s'accélèrent dans le nord du pays et dans le Sahel, au centre du pays. De mars à septembre 2012, les villes de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti tombent aux mains des islamistes qui se rapprochent des régions du sud. Le 23 septembre 2012, Le Mali et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) s'accordent sur le déploiement d'une force africaine. Le 21 décembre 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies autorise par une résolution le déploiement d'une force africaine au Mali. Le 11 janvier 2013, les troupes françaises interviennent en appui de cette force africaine, c'est le début de l'opération Serval.
an 2010 : Mauritanie - La Mauritanie a suspendu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009 avant de "rompre complètement et définitivement les relations avec Israël" le 21 mars 2010. Ces relations avaient été établies en 1999 par le président de la République à l'époque, Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya.
Sous le président Abdel Aziz, la Mauritanie s’est érigée en garante de la lutte contre la menace terroriste, tout en adoptant des lois qui définissent les infractions terroristes en termes vagues. La loi antiterroriste adoptée en 2010 a ainsi permis aux autorités de museler plusieurs opposants politiques, comme Abdallahi Salem Ould Yali, activiste issu de la communauté «haratine», descendants d’esclaves, qui a été poursuivi pour incitation au fanatisme ethnique ou racial pour avoir diffusé des messages dénonçant la discrimination dont est victime son groupe ethnique dans un groupe de discussion WhatsApp, ou encore, en 2015, le colonel de la Garde nationale à la retraite Oumar Ould Beibacar, qui dénonçait les exécutions sommaires de ses co-officiers en 1992 dans une purge d’officiers noirs de l’armée mauritanienne.
an 2010 : Rwanda - En 2010, les opposants ont une marge de manœuvre très réduite. Ainsi, par exemple, l'opposante Victoire Ingabire, présidente des FDU-Inkingi (Forces démocratiques unies) est arrêtée pour négation du génocide, lorsqu'elle exprime la nécessité de réconciliation. Une loi de 2008 punit de dix à vingt-cinq ans de prison « l'idéologie du génocide », avec une formulation « rédigée en termes vagues et ambigus », selon Amnesty International, qui y voit un moyen de « museler de manière abusive la liberté d'expression ».
À l'approche de l'élection présidentielle rwandaise de 2010, deux autres rédacteurs en chef de journaux sont contraints de quitter le Rwanda. Les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis, la France et l'Espagne expriment publiquement leurs préoccupations. Paul Kagame est réélu à cette élection présidentielle, avec plus de 93 % des suffrages exprimés.
an 2010 : Sénégal - Février 2010 : un projet de loi déclarant l’esclavage “crime contre l’humanité” est exposé par le chef de l’Etat.
Abdoulaye Wade annonce également la fermeture de la base militaire française à Dakar.
an 2010 : Togo - En 2010 est organisée une élection présidentielle, où le président Faure Gnassingbé est réélu avec 61 % des voix. Gilchrist Olympio, candidat naturel de l'UFC, a été remplacé au dernier moment par Jean-Pierre Fabre.
Des heurts ont lieu en protestation à cette élection entre militants de la coalition et forces de l'ordre. Les élections ont été dénoncées par l'Union européenne, finançant les élections, qui au travers de ses observateurs a constaté des irrégularités dans la campagne électorale.
an 2010 - 2011 : Tunisie - En décembre 2010, la situation économique et sociale est très difficile. Le chômage, en particulier celui des jeunes diplômés, est très important. Le suicide d'un jeune commerçant empêché par la police de pratiquer son commerce déclenche un vaste mouvement de protestations. Des manifestations répétées, qui s'appuient sur les réseaux sociaux permis par l'internet, parviennent le 14 janvier 2011 à chasser du pouvoir le président Ben Ali. C'est la révolution tunisienne de 2010-2011, qui a lieu en même temps que d'autres mouvements dans des pays arabes : le Printemps arabe.
an 2011 : Burkina Faso - La révolte de 2011 secoue le pays en même temps que le Printemps arabe.
an 2011 : Cap Vert - Depuis 2011, le président est le dirigeant du MPD Jorge Carlos Fonseca.
En raison de sa stabilité politique et de la régularité des élections, le Cap-Vert est considéré comme l'un des pays africains les plus démocratiques.
an 2011 : Afrique Côte d'Ivoire - Les combats éclatent à Abidjan à la fin du mois de février 2011 entre le « Commando invisible » hostile à Gbagbo et l'armée régulière. Puis, début mars, la tension gagne l'ouest du pays, où les Forces nouvelles prennent le contrôle de nouveaux territoires. L'ensemble du front finit par s'embraser à la fin mars, et les forces pro-Ouattara, rebaptisées Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), prennent Yamoussoukro, la capitale politique du pays, le 30 mars. À partir de ce moment-là, les événements s'accélèrent : le sud du pays est conquis en quelques heures et les troupes pro-Ouattara entrent dans Abidjan sans rencontrer de réelle résistance (mais non sans commettre de nombreuses exactions sur les populations civiles).
Laurent Gbagbo et son épouse se retranchent à la Résidence présidentielle, protégés par un dernier carré de fidèles dont la Garde Républicaine dirigé par le colonel Dogbo Blé Bruno. La Résidence est assiégée par les forces pro-Ouattara qui ont du mal à accéder à la Résidence malgré plusieurs tentatives. Un assaut final est lancé contre le domicile le 11 avril avec l'appui des forces onusiennes et surtout de l'armée française (en application de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU). Laurent Gbagbo (accompagné de sa famille) est fait prisonnier, puis placé en état d'arrestation à l'hôtel du Golf. Il est ensuite transféré à Korhogo dans le nord du pays, où il est placé en résidence surveillée. Quelques jours plus tard, son épouse, qui n'a pas été autorisée à le suivre, sera placée quant à elle en résidence surveillée à Odienné, une autre localité du nord ivoirien. Depuis le 30 novembre 2011, Laurent Gbagbo est incarcéré à la Cour pénale internationale où il est inculpé pour quatre chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Les forces pro-Ouattara sont soupçonnées de s'être livrées à des exactions sur des populations supportant Laurent Gbagbo (massacre du camp de Nahibly et Duekoué). Dans le cas de Duekoué, l'ONU explique que les forces pro-Gbagbo seraient aussi impliquées.
an 2011 : Afrique République de Djibouti - Au début de 2011, des manifestations inspirées par le Printemps arabe sont réprimées.
an 2011 : Gambie - En 2011, Jammeh est réélu à 72 % des suffrages. Il déclare être « prêt à diriger le pays un milliard d’années ». Son opposant Darboe qualifie le scrutin de « frauduleux et grotesque ». La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest estime elle aussi que les élec Le gouvernement de Jammeh devient de plus en plus policier, il ignore les ONG et la Commission Africaine des droits de l’homme. Sont dénoncés par ces derniers le traitement discriminatoire des homosexuels, l’usage de la torture et la violence des services de renseignement, surnommés les « Jungelers ».
an 2011 : Kenya - Faisant suite à l'enlèvement d'une touriste britannique et à l'assassinat de son mari le 11 septembre 2011, à l'enlèvement d'une résidente franco-kényane le 1er octobre et enfin, le 13 octobre, à l’enlèvement de deux volontaires humanitaires espagnoles ainsi qu'à l'assassinat de leur chauffeur kényan, des unités militaires des forces armées kényanes entrent en Somalie le 16 octobre à la poursuite des miliciens d'Al-Shabaab. Cependant, Alfred Mutua, le porte-parole du gouvernement déclare, le 26 octobre, que l'opération militaire était planifiée depuis longtemps et que les enlèvements n'ont été qu'une aire de lancement (« the kidnappings were more of a good launchpad. »). Cette « invasion » donne lieu à des représailles de la part d'Al-Shabaab (cf. section détaillée : « Attentats »).
2011-2013 : Égypte - Hosni Moubarak est Président de la République jusqu'en février 2011, date de sa démission contrainte à la suite de la Révolution égyptienne de 2011. Hosni Moubarak poursuit la politique de libéralisation de l’économie, notamment par la réduction des subventions à l'agriculture et à la consommation, et par la libéralisation des prix. En 1992, il fait annuler les dispositions régissant la location des terres. Généralement appelée « loi pour chasser les paysans de leurs terres », cette loi, combinée aux autres mesures de désengagement de l’État dans l’économie, accroît le mécontentement des populations rurales pauvres en particulier en Haute-Égypte. Hosni Moubarak devient un pilier de la stratégie régionale des États-Unis et la Constitution qu'il met en place reconnait les « principes de la charia » comme source principale de la législation.
En janvier et février 2011, une série de manifestations d'ampleur inégalée se déroulent à travers le pays et mènent à la démission d'Hosni Moubarak le 11 février. Les nouvelles élections législatives et présidentielle sont remportées par le Parti de la liberté et de la justice, le bras politique des Frères musulmans.
Le pouvoir n'est cependant resté que peu de temps entre leurs mains car d'importantes manifestations contre le président élu, Mohamed Morsi, critiquant des dérives dictatoriales, et le retournement de l'armée contre celui-ci le destitue en faveur d'un gouvernement transitoire un an seulement après son élection. L'Égypte connait depuis une période de troubles causée par l'instabilité et les tensions politiques, notamment entre les opposants à l'ex-président et ceux qui continuent à le soutenir et n'acceptent pas ce qu'ils voient comme un coup d'État illégal.
an 2011-2018 : Éthiopie - En 2011, une crise alimentaire touche une grande partie de la Corne de l'Afrique. Dans la nuit du 20 au 21 août 2012, Meles Zenawi décède en pleine fonction après 21 ans au pouvoir. Conformément à la Constitution (article 73), Haile Mariam Dessalegn est désigné comme Premier ministre par la Chambre des représentants des peuples. Les Oromos, ethnie majoritaire avec plus du tiers de la population, entrent en rébellion en novembre 2015. Les Amharas, un quart de la population, font de même en août 2016. L'état d'urgence est décrété le
9 octobre 2016. Haile Mariam Dessalegn démissionne en février 2018 à la surprise générale. Le 2 avril 2018, Abiy Ahmed lui succède. Cet homme politique de longue date est populaire parmi les Oromos dont il est issu. Dès son discours d’investiture, il tend la main à l’Érythrée, en appelant à mettre fin à un conflit qui dure depuis l’indépendance du pays, en 1993. Il qualifie également les partis d’opposition de frères et non d’ennemis. La situation intérieure et les relations avec les pays voisins s’apaisent.
an 2011 : Libéria - Ellen Johnson Sirleaf remporte à nouveau l’élection présidentielle de 2011. Le taux de participation aux votes est faible, 37,4 %
an 2011 : Libye - La guerre civile de 2011
En 2011, dans le contexte du « Printemps arabe », le mécontentement populaire contre le régime de Kadhafi s'affirme désormais ouvertement. La violente répression des manifestations dans le pays, durant laquelle la troupe tire à l'arme lourde sur la population, débouche en février sur une véritable guerre civile. L'Est du pays échappe bientôt au contrôle de Kadhafi, et un gouvernement provisoire, le Conseil national de transition (CNT), est formé à Benghazi. Mais les troupes de Kadhafi contre-attaquent rapidement, et reprennent progressivement le contrôle du pays. Alors que Benghazi est directement menacée, le Conseil de sécurité des Nations unies vote la résolution 1973, autorisant en mars une intervention militaire internationale qui fournit aux rebelles un appui aérien et leur évite d'être écrasés. Au bout de six mois de conflit, les forces du CNT prennent Tripoli le 23 août. Kadhafi, ayant quitté la capitale, est mis à prix et visé par un mandat d'arrêt international. Le 16 septembre, le CNT est reconnu comme gouvernement de la Libye par l'Assemblée générale des Nations unies. À l'automne 2011, les partisans de Kadhafi tiennent encore plusieurs bastions, principalement Syrte et Bani Walid.
Le 20 octobre 2011, Syrte est la dernière ville kadhafiste à tomber aux mains des forces du Conseil national de transition. Mouhammar Kadhafi est capturé et tué le jour même.
La « libération » du pays est officiellement proclamée le 23 octobre; le même jour, le président du CNT, Moustafa Abdel Jalil, annonce que la future législation de la Libye serait fondée sur la charia. Cette déclaration ayant suscité l'inquiétude des gouvernements occidentaux, il déclare vouloir « assurer à la communauté internationale que nous, les Libyens, sommes des musulmans modérés ». Un référendum est annoncé pour approuver la future constitution. Le 22 novembre, un nouveau gouvernement, dirigé par Abdel Rahim al-Kib, est mis en place41. Kadhafi ayant laissé derrière lui un vide politique, et un pays dépourvu d'institutions réelles, d'armée structurée, et de traditions démocratiques, la Libye apparaît bientôt comme un pays très instable, en proie au désordre et à la violence.
an 2011 : Mauritanie - Durant deux mois, entre le 24 septembre et le 28 novembre 2011, le collectif "Touche pas à ma nationalité" organise plusieurs manifestations pour protester contre le recensement national.
an 2011-2021 : Ouganda - Museveni se fit réélire à nouveau en 2011 et 2016, nouveaux scrutins présidentiels après ceux de 1996, 2001, et 2006, chaque fois au premier tour, et avec des soupçons de fraude. Il fit procéder aussi à un nouveau changement de constitution fin 2017,pour supprimer la limite d'âge de 75 ans s'appliquant aux candidats à cette élection présidentielle et à lui en tout premier lieu. Il instaura également une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux et fin août 2018, fit arrêter et battre un député d'opposition, Robert Kyagulanyi Ssentamu (en), connu également comme ex-chanteur sous le nom de Bobi Wine. Libéré, celui-ci se fit soigner aux États-Unis avant de revenir en Ouganda en septembre 2018 et d'être à nouveau inculpé. Constituant l'un des leaders de l'opposition ougandaise, Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine, affrontera le président sortant Yoweri Museveni, qui est au pouvoir depuis 1986, lors des élections présidentielles qui se tient le 14 janvier 2021, Yoweri Museveni est réélu.
an 2011 : Sénégal - Février 2011 : Dakar rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran, accusé d’avoir livré des armes aux rebelles indépendantistes de Casamance, où la recrudescence de la violence depuis fin décembre 2010 a causé la mort d’au moins seize soldats sénégalais.
Juin 2011 : face à la fronde de la rue, Abdoulaye Wade renonce à une réforme constitutionnelle qui prévoyait de faire élire un ticket présidentiel, au premier tour, avec 25% seulement des suffrages exprimés. On le soupçonnait de vouloir assurer sa réélection et de préparer la succession pour son fils Karim.
an 2011 : Seychelles - L'élection présidentielle de mai 2011 voit la réélection du président Michel qui remporte 55,4 % des suffrages exprimés, contre 41,4 % à Wavel Ramkalawan. Il se présente une troisième et dernière fois à l'élection présidentielle de 2015, remportant le scrutin avec 50,15 % des suffrages exprimés contre 49,85 % à son adversaire, Wavel Ramkalawan. Mais il est contraint d'attendre le second tour de l'élection, alors qu'il avait été élu dès le premier tour aux élections précédentes.
an 2011-2017 : Somalie - En octobre 2011, l'armée kényane, appuyée par les troupes somaliennes, intervient dans le conflit, lançant l'opération Linda Nchi (« protéger le pays » en swahili) contre les positions d'Al-Shabaab.
Les relations entre la Somalie et la Turquie (en) contribuent à la relative stabilisation du pays. La Turquie, qui fournit une aide humanitaire et économique importante depuis 2011, ouvre une base militaire à Mogadiscio en septembre 2017
an 2011 : Soudan - En 2011, le Sud du Soudan accède à son indépendance sous le nom de Soudan du Sud. Mais en 2012, Le conflit au Kordofan du Sud s'envenime.
an 2011 : Tchad - Jusqu'en 2011, le Tchad alimentait un flux migratoire important vers la Libye : on estime qu'au moins 500 000 Tchadiens vivaient dans ce pays en 2006. Les échanges transsahariens assuraient une relative prospérité à des villes frontalières comme Abéché. Cependant, depuis la première guerre civile libyenne en 2011, l'instabilité de ce pays rend ces échanges aléatoires ; la frontière entre la Libye et le Tchad est devenue une zone de non-droit dominée par les contrebandiers et les groupes armés.
an 2011 : Tunisie - Après la révolution et l'élection de l'Assemblée constituante, celle-ci vote une loi constituante le 10 décembre 2011 ; le nouveau texte indique dans son article 9 que le candidat à la présidence doit être musulman, de nationalité tunisienne uniquement, issu de parents tunisiens et âgé d'au moins 35 ans ; il doit démissionner, une fois élu, de toute responsabilité à l'Assemblée constituante et au sein de son parti.
an 2011 - 2014 : Zambie - À la suite de la dégradation de l'état de santé de Mwanawasa, le vice-président Rupiah Banda assure l'intérim. Après la mort du président en août 2008, Banda est élu quatrième président du pays et le reste jusqu'en septembre 2011. Le chef de l'opposition Michael Sata lui succède, et devient le cinquième président de la Zambie. Il décède à son tour, à la suite d'une maladie à Londres le 28 octobre 2014.
an 2012 : Afrique du Sud - Le massacre de Marikana en 2012, où la police tire sur des salariés grévistes faisant des dizaines de morts, entache la gouvernance de l'ANC au sein de son électorat mais lors des élections générales sud-africaines de 2014.
an 2012-2013 : République de Centrafrique - En décembre 2012, le pays est à nouveau dans une situation insurrectionnelle. Une coalition rebelle prenant le nom de Séléka (Alliance en langue sango) s'est constituée contre le régime de Bozizé. Réunissant au moins trois mouvements préexistants, cette coalition, qui dispose de troupes bien armées et disciplinées, a pris le contrôle de la ville diamantifère de Bria le 18 décembre, avant de progresser rapidement vers la capitale. Le président Bozizé espéra un temps obtenir un soutien militaire de la France ou des États-Unis, mais ces deux pays choisissent de ne pas intervenir.
Les rebelles dénoncent la non-tenue des accords par le président Bozizé, et reprennent les armes fin 2012, lançant une série d'attaques démarrant la deuxième guerre civile centrafricaine. Le 24 mars 2013, les rebelles de la coalition Seleka s'emparent de Bangui et Bozizé s'enfuit. Michel Djotodia s’auto-proclame président de la République centrafricaine. Mais les nombreuses exactions commises par les miliciens de la Seleka, majoritairement musulmans, amènent l'insécurité dans le pays, et des milices d'auto-défense, les anti-balaka se forment. Le conflit débouche sur une situation « pré-génocidaire » selon la France et les États-Unis. Le 5 décembre 2013, une résolution de l'ONU permet à la France d'envoyer des troupes armées en République centrafricaine (opération Sangaris) aux fins annoncées de désamorcer le conflit et de protéger les civils.
an 2012-2013 : Égypte - En juin 2012, Mohamed Morsi remporte l'élection présidentielle et devient ainsi le premier président du pays élu au suffrage universel dans une élection libre. Un an après son arrivée au pouvoir, le président Morsi est massivement contesté par l'opposition qui regroupe diverses factions entre laïcs de gauche, anciens partisans du régime de Moubarak et différents groupes révolutionnaires, dont Tamarod (Rebellion). Une grande partie de la population reproche au nouveau président une dérive dictatoriale et une politique menée dans le seul intérêt de son organisation, les Frères musulmans. Après des rassemblements massifs dans tout le pays, l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Sissi, lance un dernier ultimatum le 1er juillet 2013. Celui-ci est rejeté le lendemain par Mohamed Morsi qui défend sa légitimité en soulignant qu'il a été élu démocratiquement, avec 52 % des voix. Cependant, selon des observateurs, l'ultimatum a été lancé dès le mois d'avril 2013, par la coalition des opposants, alors que la situation économique était au plus mal.
an 2012 : Ghana - À la suite du décès du président en exercice le 24 juillet 2012, le vice-président John Dramani Mahama lui succède à la tête de l’État
an 2012 : Guinée-Bissau - Le 12 avril 2012, un coup d'État mené par l'armée dépose le premier ministre Carlos Gomes Júnior dans le contexte d'une élection présidentielle contestée. La CEDEAO et la CPLP prennent des positions fortes contre ce coup d'état et examinent les possibilités d'intervention politique et militaire. L'Union africaine suspend la Guinée-Bissau le 17 avril 2012. Mamadu Ture Kuruma devient de facto le dirigeant du pays. Manuel Serifo Nhamadjo, président de l'Assemblée nationale populaire, devient président de la République par intérim.
an 2012 : Libye - Le 7 juillet 2012, la Libye organise l'élection du Congrès général national, premier scrutin démocratique de son histoire. Elle se déroule dans un climat de tensions, les milices fédéralistes de Cyrénaïque se montrant hostiles au pouvoir central de Tripoli. Parmi les nombreux partis politiques formés après la chute de Kadhafi, les islamistes apparaissent comme les grands perdants du premier scrutin : l'avantage revient aux libéraux, et notamment à l'Alliance des forces nationales dirigé par Mahmoud Jibril, qui n'a cependant pas la majorité absolue. Le Congrès général national (CGN), une assemblée de 200 membres, succède au Conseil national de transition48. Mohamed Youssef el-Megaryef, islamiste modéré et opposant de longue date à Kadhafi, est élu en août président du CGN, soit chef de l'État par intérim ; en octobre, le diplomate Ali Zeidan, ancien porte-parole du CNT, devient chef du gouvernement. Le climat de violence ne cesse pas pour autant en Libye :
le 11 septembre 2012 — anniversaire des attentats de 2001, mais également dans le contexte de l'affaire du film L'Innocence des musulmans — le consulat des États-Unis à Benghazi est attaqué par un groupe armé. Quatre Américains sont tués, dont l'ambassadeur J. Christopher Stevens.
an 2012-2014 : Malawi - Conformément à la Constitution, la vice-présidente Joyce Banda est officiellement investie présidente du Malawi le 7 avril 2012 à la suite du décès de Bingu wa Mutharika. Ses premières décisions politiques la démarquent de son prédécesseur. Elle s'efforce notamment de restaurer les bonnes relations du Malawi avec les pays développés afin que l'aide internationale reprenne pleinement, notamment en revenant sur des décisions monétaires et, dans le domaine social, en dépénalisant les actes homosexuels.
an 2012 : Mauritanie - En mars 2012, Abdallah al-Senoussi, le beau-frère de Mouammar Kadhafi et ancien chef des renseignements militaires libyens recherché par la Cour pénale internationale est arrêté à Nouakchott. Il est finalement remis aux autorités libyennes, six mois plus tard, après de longues tractations. Le premier ministre libyen Ali Zeidan accuse la Mauritanie d'avoir exigé un paiement de 200 millions de dollars en échange de l'extradition Abdallah al-Senoussi.
Le 12 octobre 2012, le président Mohamed Ould Abdelaziz est blessé par balle par une patrouille militaire. Il est évacué vers la France pour y être soigné à l'hôpital Percy-Clamart près de Paris.
Situation sanitaire et humanitaire
Depuis 2012, près de 60.000 réfugiés peuls, touaregs et arabes venus du Mali, fuyant les violences des groupes jihadistes ou de l’armée malienne, ont élu domicile dans le camp de Mbera, en Mauritanie. Leur accès à l'eau potable est précaire.
an 2012 : Sénégal - Janvier 2012 : le Conseil constitutionnel se prononce pour une nouvelle candidature, jugée anticonstitutionnelle par ses opposants, du chef de l’Etat à la présidentielle de février. Il rejette la candidature du chanteur Youssou N’Dour. Cette décision provoque la colère de l’opposition.
25 mars 2012 : L’ex-premier ministre Macky Sall devient le nouveau chef de l’État sénégalais en battant au second tour de la présidentielle son rival Abdoulaye Wade qui a reconnu sa défaite avant même les résultats officiels d’un scrutin qui s’est déroulé pacifiquement.
“Mes chers compatriotes, à l’issue du second tour de scrutin de dimanche, les résultats en cours indiquent que M. Macky Sall a remporté la victoire“, a déclaré le président Wade, selon un communiqué diffusé dans la soirée par la présidence.
“Comme je l’avais toujours promis, je l’ai donc appelé dès la soirée du 25 mars au téléphone pour le féliciter“, a expliqué le chef de l’État sortant.
“Ce soir, un résultat est sorti des urnes, le grand vainqueur reste le peuple sénégalais“, a déclaré de son côté Macky Sall lors d’une conférence de presse dans la nuit dans un grand hôtel de la capitale. “Je serai le président de tous les Sénégalais“, a-t-il promis, remerciant notamment le président Wade pour son appel téléphonique.
27 mars 2012 : Macky Sall est le vainqueur de l’élection présidentielle avec 65,80% des suffrages, selon les résultats officiels provisoires annoncés par la Commission nationale de recensement des votes. Le président sortant Abdoulaye Wade obtient, lui, 34,20% des voix. Le taux de participation est à 55% des inscrits, toujours selon les mêmes résultats officiels provisoires.
Résultats officiels mardi 27 ou mercredi 28. “Ce soir une ère nouvelle commence pour le Sénégal”, s’est félicité le vainqueur du scrutin, qui lui aussi a salué la maturité des électeurs et de la démocratie sénégalaise. “L’ampleur de cette victoire aux allures de plébiscite exprime l’immensité des attentes de la population, j’en prends toute la mesure. Ensemble, nous allons nous atteler au travail“, a-t-il conclu. “C’est encore une preuve de la maturité du peuple sénégalais et de la classe politique“, a commenté le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), chargée de superviser le scrutin.
Macky Sall prendra ses fonctions le 1er avril 2012.
3 avril 2012 : Le président Macky Sall nomme Abdoul Mbaye Premier ministre. Chef d’entreprise et banquier de formation, 59 ans, Abdoul Mbaye doit former le nouveau gouvernement du Sénégal sans dépasser les 25 personnes. La nomination de M. Mbaye a été précédée du premier discours à la nation de Macky Sall qui a dit vouloir un règlement pacifique du conflit casamançais qui dure depuis près de trente ans.
an 2012 : Sierra Leone - Ernest Bai Koroma, principal opposant, candidat du Congrès de tout le peuple (APC), ex-parti unique écarté du pouvoir depuis quinze ans, succède à Ahmad Tejan Kabbah, battant au second tour son adversaire, Solomon Berewa, vice-président et candidat du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) avec 54,6 % des suffrages. Il est réélu pour un deuxième et dernier mandat le 17 novembre 2012 en remportant 58,7 % des suffrages contre 37,4 % pour son adversaire, le général Julius Maada Bio, brièvement chef de l'État en 1996. Il a maintenu la paix, amélioré le réseau routier et la fourniture en électricité, même si celle-ci reste déficiente. Pour autant, le pays reste un des plus pauvres d'Afrique, malgré ses mines de diamant.
an 2013 : République de Centrafrique - Face au risque de génocide, la France annonce, le 26 novembre 2013, l'envoi d'un millier de soldats pour rétablir la sécurité dans le pays. Le 5 décembre 2013, par la résolution 2127, le conseil de sécurité des Nations unies autorise le « déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) pour une période de 12 mois » officiellement pour mettre fin à la « faillite totale de l'ordre public, l'absence de l'état de droit et les tensions interconfessionnelles ». La MISCA est appuyée par des forces françaises (opération Sangaris), autorisées à prendre « toutes les mesures nécessaires ».
an 2013 : Congo Kinshasa - Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise appuyée par une brigade d'intervention de l'ONU chasse les rebelles du M23 des dernières positions qu'ils occupaient dans les montagnes du Nord-Kivu, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda, les rebelles déposent les armes et dissolvent leur mouvement en décembre 2013 dans un traité de paix signé à Nairobi.
an 2013-2014 : Afrique République de Djibouti - En 2013, les élections législatives aboutissent à une grave crise électorale et une répression du régime contre l'Union pour le salut national (USN), coalition des sept partis djiboutiens d'opposition. Elle aboutit à la signature entre cette dernière et le gouvernement d'un accord-cadre politique le 30 décembre 2014. Les dix députés de l'opposition qui commencent à siéger peu de temps après sont les premiers depuis l’indépendance.
an 2013-2013 : Égypte - Mohamed Morsi est remplacé par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Adli Mansour, qui prête serment comme président par intérim. Le 4 juillet 2013, on apprend que Mohamed Morsi est détenu par l'armée et que des mandats d'arrêt sont émis à l'encontre des dirigeants des Frères musulmans. Le 5 juillet 2013, le Parlement est dissous. Le 26 juillet 2013, l'armée déclare que Mohamed Morsi est en prison dans l'attente de son procès pour collusion avec le mouvement palestinien du Hamas.
Fin 2013, le nouveau pouvoir militaire est à son tour la cible de contestations, notamment à cause de la répression de manifestations et de l'arrestation d'activistes démocrates.
an 2013 : Gambie - Alors qu'elle en est membre depuis 1965, la Gambie, par la voix de son ministre de l'Intérieur, annonce le 2 octobre 2013 son retrait du Commonwealth. Le pays refuse les injonctions du Royaume-Uni au sujet des droits de l'homme alors que le régime du président Yahya Jammeh se fait plus autoritaire et accuse l'organisation d'être néo-coloniale.
an 2013 : Kenya - Pour la première fois des débats présidentiels télévisés sont organisés les 11 et 25 février 2013. Également, pour la première fois, certains bureaux de vote sont équipés pour transmettre électroniquement les résultats vers la commission indépendante IEBC chargée de comptabiliser les résultats des élections générales.
Huit candidats ont posé leur candidature lors de l'élection présidentielle du 4 mars 2013. Pour l'emporter au premier tour, un candidat doit réunir au moins 25 % des votes dans au moins 24 comtés différents et 50 % de l'ensemble des votes plus un (majorité absolue).
Depuis la première élection présidentielle multipartisme de 1992, l'appartenance d'un candidat à tel ou tel groupe tribal a toujours été un élément important dans le choix des électeurs. Uhuru Kenyatta avec son colistier William Ruto sont respectivement kikuyu et kalenjin (premier et quatrième groupe tribal du pays) alors que son adversaire Raila Odinga et son colistier Kalonzo Musyoka sont luo et kamba (troisième et cinquième groupe). Uhuru Kenyatta est déclaré vainqueur dès le premier tour de l'élection du 4 mars 2013 avec 50,07 % des suffrages devant Raila Odinga avec 43,31 %. Ce dernier conteste les élections et, conformément à la possibilité donnée par l'article 140.1 de la Constitution, dépose, en date du 16 mars 2013 une pétition à la Cour suprême pour contester la validité du scrutin présidentiel arguant des bourrages d'urnes, les dysfonctionnements du système électronique de transmission vers l'IEBC et l'inorganisation de cette dernière. La Cour rend son jugement le 30 mars suivant en déclarant que « l'élection générale fut libre et impartiale » et que « Uhuru et son colistier Ruto ont été valablement élus » et en publie la version intégrale le 16 avril.
Présidence de Uhuru Kenyatta
Uhuru Kenyatta est investi en tant que 4e président du Kenya le 9 avril 2013 au centre sportif international Moi de Kasarani (Nairobi).
D'emblée, il s'oppose à la demande des députés d'obtenir une augmentation de 60 % de leur salaire29 et réduit le nombre de ministères et secrétariats d’État, de quarante-deux sous la présidence de son prédécesseur, à dix-huit30. Cinq femmes deviennent ministres31 dont deux à des postes très importants comme Amina Mohamed aux Affaires étrangères et Raychelle Omano à la Défense.
Lors de son discours prononcé lors du Madaraka Day (célébration de l'autonomie du pays au 1er juin 1963) du 1er juin 2013, il réaffirme la teneur de la Constitution à propos de la gouvernance des comtés, rappelle les huit anciens commissaires provinciaux vers d'autres fonctions et met, ainsi, fin aux dissensions entre les gouverneurs et les commissaires.
L'organisation État islamique et les chebabs multiplient les attaques au Kenya dans les années 2010, mettant en échec la politique sécuritaire du gouvernement. À ces attaques, s'ajoute une instabilité politique interne dans les mois qui précèdent les élections générales d'août 2017. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, est finalement réélu et affiche un score électoral de 54,28 % des suffrages exprimés. Son rival Raila Odinga parle de fraudes. Des émeutes éclatent avant un appel au calme par l'opposant Raila Odinga, qui s'en remet à la Cour suprême. Celle-ci, à la surprise générale, lui donne cette fois raison et invalide les élections, qui sont réorganisés en octobre 2017. Cette décision montre une consolidation des contre-pouvoirs au Kenya à la suite de la constitution de 2010. Uhuru Kenyatta fait procéder à des modifications de la loi électorale avant ce nouveau scrutin, ce qui provoque le retrait de Raila Odinga, qui appelle au boycott de l'élection. Finalement, le président sortant Uhuru Kenyatta remporte le nouveau scrutin avec 98,26 % des voix, mais la participation le 26 octobre 2017 n'est que de 38,8 % des électeurs inscrits, à comparer à 79 % le 8 août 2017, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême. Le 13 mai 2021, le projet de réforme constitutionnelle de Uhuru Kenyatta est jugé illégal. Le 20 août 2021, La Cour d'appel du Kenya a confirmé l'illégalité du processus de révision constitutionnelle lancé par le président Uhuru Kenyatta mettant fin définitivement à ce projet de révision constitutionnelle.
an 2013 : Libye - En mai 2013, sous la pression des milices révolutionnaires, le parlement libyen adopte une loi dite de « bannissement politique », excluant de toute fonction officielle les personnes ayant occupé des responsabilités, à un moment ou à un autre, sous le régime de Kadhafi. Le radicalisme de cette loi, qui frappe de fait une grande partie des dirigeants libyens, provoque une crise politique et plusieurs démissions, privant la Libye d'un personnel politique expérimenté. Le président du Congrès général national Mohamed Youssef el-Megaryef, qui avait été ambassadeur sous Kadhafi avant de rejoindre la dissidence, est contraint de quitter ses fonctions. Fin juin, Nouri Bousahmein est élu président du GNC. Le premier ministre Ali Zeidan a quant à lui le plus grand mal à imposer son autorité face aux différents chefs de milices, qui tiennent notamment les champs pétroliers de Cyrénaïque, avec le soutien des tribus : en octobre 2013, il est séquestré quelques heures par un groupe armé, avant d'être relâché. En novembre 2013, des rebelles autonomistes proclament en Cyrénaïque un gouvernement, défiant celui de Tripoli qu'ils disent aux mains des islamistes.
an 2013 - 2018 : Madagascar - L’élection présidentielle malgache de 2013 fait de Hery Rajaonarimampianina le président de la IVe république et son Premier ministre est Roger Kolo. Mais Hery Rajaonarimampianina, qui remporte cette élection considérée par les observateurs comme démocratique, dispose alors du soutien politique d'Andry Rajoelina, avec qui il est conduit à prendre progressivement ses distances. Le nouveau président manque dès lors de soutien politique tout en étant confronté à une ploutocratie aux commandes du pays. La crise politique est doublée d'une crise économique persistante. Le 14 janvier 2015, le général de brigade aérienne Jean Ravelonarivo est nommé Premier ministre en remplacement de Roger Kolo. En mai 2015, le président est destitué par l’Assemblée nationale, mais la décision est ensuite annulée par la justice malgache. Olivier Mahafaly Solonandrasana remplace Jean Ravelonarivo le 10 avril 2016, mais pour calmer le pays en proie aux émeutes, il est contraint à la démission et remplacé par Christian Ntsay le 4 juin 2018. Les élections de décembre 2018 portent au pouvoir pour 5 ans Andry Rajoelina. Celui-ci remporte également les élections législatives de mai 2019 et obtient la majoprité absolue à l'Assemblée nationale.
an 2013 : Mauritanie - Le 18 février 2013, les forces armées mauritaniennes annoncent le début d'exercices militaires dans le sud-est du pays avec la participation de dix-neuf pays européens, africains et arabes.
En 2013, les élections législatives de novembre et décembre confortent la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale.
an 2013-2015 : Nigéria - En 2013, le Nigeria devient aussi la première économie d'Afrique, avec un Produit intérieur brut de 510 milliards de dollars, dépassant l'Afrique du Sud, même si ce dernier pays reste en tête en termes de PIB par habitant.
À la suite de l'élection présidentielle de 2015, Muhammadu Buhari est élu. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine du Nigéria qu'une transition à la tête de l'État se fait de façon démocratique.
an 2013-2019 : Somalie - Le 11 janvier 2013, l'armée française lance une opération militaire afin de libérer l'otage Denis Allex de la DGSE détenu par les Al-Shabbaab à Buulo Mareer depuis 2009 mais celle-ci s'avérera être un échec.
Le groupe terroriste Harakat al-Chabab al-Moudjahidin multiplie les attaques depuis 2008, et notamment en 2019 : en juillet, contre un hôtel de Kismaayo, puis sur la route d’accès à l’aéroport de Mogadiscio et quelques jours plus tard contre la mairie de Mogadiscio, contre un hôtel de hôtel à Mogadiscio le 10 décembre 2019 puis le 28 décembre sur un poste de contrôle à l'entrée de Mogadiscio (cette dernière attaque faisant 81 morts).
Outre le terrorisme, les Somaliens sont victimes de la violence d’État de certains pays de la région. Ainsi, 42 réfugiés sont tués en mars 2017 dans une attaque aérienne saoudienne sur la mer Rouge.
Les Nations unies estiment que 1,7 million de personnes manquent de nourriture à cause de la sécheresse en mai 2019, et que leur nombre va augmenter d'un demi-million d'ici à juillet. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont contraintes d'abandonner leur foyer pour tenter de trouver de la nourriture, venant ainsi s'ajouter aux 2,6 millions de personnes déjà déplacées dans le pays du fait de la sécheresse et de la guerre.
an 2013-2015 : Togo - En 2013, de nouvelles élections législatives sont organisées. Le parti Unir obtient 62 sièges sur 91 soit la majorité absolue. L'ANC devient le premier parti de l'opposition avec 19 sièges. Un regroupement des principaux partis d'opposition (le Combat pour l'alternance politique) dénonce par avance des fraudes massives pour l'élection présidentielle de 2015.
an 2013 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
Le 16 mars 2013, le Zimbabwe a adopté par référendum une nouvelle Constitution qui a pour but affiché de moraliser la vie politique. Le président Robert Mugabe et son premier ministre Morgan Tsvangirai appellent à voter oui. Le texte prévoit de limiter les prérogatives présidentielles, mais le chef de l'État conserve le pouvoir de nommer tous les acteurs importants. Seule la durée de la fonction est réduite à deux mandats de cinq ans
an 2014 : Afrique du Sud - Jacob Zuma est réélu pour un second mandat, l'ANC restant nettement en tête dans l'électorat bien qu'en recul face à l'Alliance démocratique et aux Combattants pour la liberté économique de Julius Malema.
an 2014 : Algérie - Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014
an 2014 : Burkina Faso - Le 30 octobre 2014, Blaise Compaoré fait face à un soulèvement populaire contre son projet de modification de l'article 37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels, afin de se représenter en 2015. À la suite des émeutes, Blaise Compaoré quitte le pouvoir.
Le chef d'état-major des armées Honoré Traoré annonce le 31 octobre la création d'un « organe de transition », chargé des pouvoirs exécutif et législatif, dont l'objectif est un retour à l'ordre constitutionnel « dans un délai de douze mois ». Le 1er novembre 2014, l'armée publie un communiqué qui affirme son soutien à Isaac Zida comme président de transition. Honoré Traoré en est un des signataires, ce qui implique son renoncement au pouvoir. Le 17 novembre 2014, le diplomate Michel Kafando est nommé président de transition. Il nomme Isaac Zida Premier ministre.
an 2014-2018 : Afrique du Sud - Jacob Zuma est, en 2014, réélu pour un second mandat avec Cyril Ramaphosa comme vice-président. Il ne peut achever son second mandat et est poussé par son parti à la démission en février 2018.
La presse dresse alors un bilan négatif de ses deux mandats marqués par de multiples scandales de corruption, des accusations de prévarication, un échec aux élections municipales sud-africaines de 2016, marquées par un recul de l'ANC dans les métropoles et une popularité en berne affectant son parti.
an 2014-2015 : Algérie - L'attentat du 19 avril 2014 contre l'Armée nationale populaire (ANP) entraîne la mort de 11 militaires, celle du 17 juillet 2015 la mort de 11 à 13 soldats
an 2014 : République de Centrafrique - Le 10 janvier 2014, le président de la transition centrafricaine Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaye annoncent leur démission lors d'un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).
Le 20 janvier 2014, le Conseil national de transition de la République centrafricaine élit Catherine Samba-Panza comme chef de l'État de transition de la République centrafricaine. Au printemps 2014, trois journalistes sont tués, dont la française Camille Lepage, sur fond de sanctions de l'ONU.
Le 23 juillet 2014, les belligérants signent un accord de cessation des hostilités à Brazzaville. En dépit de cet accord, le pays est divisé en régions contrôlées par des milices, « sur lesquelles ni l’État ni la mission de l’ONU n’ont prise ».
an 2014 : République de Djibouti - En mai 2014, le pays est victime d'un attentat suicide dans le restaurant La Chaumière. Selon les informations, deux ou trois kamikazes (dont une femme) se seraient fait exploser en entrant dans le restaurant. Un mort, un ressortissant turc, a été recensé, et plusieurs blessés, dont des coopérants français présents dans le restaurant, ainsi qu'une jeune femme originaire des Pays-Bas. L'un des kamikazes n'a pas pu entrer dans le restaurant. Il s'est jeté sur la terrasse en déclenchant sa ceinture explosive.
2014 - 2030 : Égypte - En mai 2014, Abdel Fattah al-Sissi, déjà considéré comme le dirigeant de fait de l'Égypte, remporte l'élection présidentielle. Il est réélu pour un deuxième mandat en 2018. Par une révision constitutionnelle validée par un référendum en avril 2019, il se donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Il impose une logique autoritaire, réprime toute opposition et toute voix critique , et met sous contrôle les médias et la justice. La répression touche notamment des médias, des blogueurs, des journalistes, dont des personnalités féminines comme Israa Abdel Fattah ou Solafa Magdy.
La population égyptienne dépasse les cent millions d’habitants en février 2020. Elle progresse d’un million supplémentaire tous les six mois. Le taux de fécondité est passé de 5,3 enfants par femme en 1980 à 3 en 2008, puis est remonté à 3,5 en 2014. A titre de comparaison, l’Iran connaît un taux de fécondité de 1,8 enfants par femme et la Tunisie de 2,2. Cette croissance de la population égyptienne intervient de plus sur une bande de terre limitée essentiellement à la vallée du Nil et à son delta, représentant moins de 5% de la superficie d’un pays relativement désertique. La proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté semble un élément déterminant. Les Égyptiens les plus pauvres, ne disposant pas d'aide publique adaptée, veulent s'appuyer sur leur progéniture pour assurer leur besoins quotidiens.
Par ailleurs, l'armée égyptienne semble perdre progressivement le contrôle de la péninsule du Sinaï face à la guérilla jihadiste, une branche locale de l'État islamique.
an 2014 : Gambie - Le 30 décembre 2014, une autre tentative de coup d’État a lieu en Gambie pendant que Jammeh est à Dubaï. Il accuse fortement les puissances occidentales d’avoir aidé des terroristes pour le renverser. La répression et les accusations arbitraires s'accentuent.
an 2014-2015 : Guinée - En 2014 et 2015, le pays est touché par l'épidémie Ebola mais se mobilise pour en contenir les impacts.
an 2014 : Guinée-Bissau - En 2014, José Mário Vaz remporte l'élection présidentielle du 13 avril 2014, marquant le retour progressif à la légalité constitutionnelle. Pour autant, l'instabilité persiste, et les premiers ministres se succèdent.
an 2014 : Leshoto - Le Lesotho demeure l'un des pays les plus pauvres du monde : en 2014, l'indice de développement humain (IDH) le classe au 162e rang sur 187 pays.
an 2014 : Libéria - En 2014, le Liberia, avec ses voisins la Guinée et la Sierra Leone, est touché par une épidémie de maladie à virus Ebola, qui désorganise sérieusement la vie du pays. Cette épidémie fait des milliers de morts.
an 2014 : Libye - Le 20 février 2014, sans passion et au milieu d'épisodes de violences, les Libyens élisent leur assemblée constituante. Le scrutin se déroule dans un contexte d'instabilité politique persistante, alors que le gouvernement d'Ali Zeidan, qui tente de poser les bases d'un État, est de plus en plus discrédité. Le Congrès général national provoque également le mécontentement de la population et de la classe politique en prolongeant son mandat d'un an, jusqu'en décembre 2014, et en laissant à un futur parlement, dont la date n'est toujours pas décidée, la tâche de décider de la nature d'une élection présidentielle. Minoritaires au Congrès, les islamistes gagnent cependant en influence dans l'assemblée et accaparent de plus en plus de pouvoir, laissant peu de marge de manœuvre au gouvernement. Un bras de fer oppose le premier ministre au Congrès général national jusqu'en mars 2014, date à laquelle le Congrès démet par un vote le chef du gouvernement : les islamistes se débarrassent ainsi d'un de leurs principaux adversaires. Abdallah al-Thani assure l'intérim après le départ de Zeidan. La Libye n'a alors toujours pas réussi à former d'armée ou de police réellement professionnels, laissant en grande partie le terrain à diverses factions armées et des ex-chefs rebelles.
Le 30 mars, le Congrès général national décide de laisser la place à une Chambre des représentants, qui devra être élue en juin. Le 4 mai, le Congrès général national élit Ahmed Miitig au poste de premier ministre : la validité de cette élection est aussitôt contestée, les rebelles autonomistes de l'Est annonçant quant à eux qu'ils refusent de reconnaître ce gouvernement. Le général Khalifa Haftar, chef d'état-major de l'Armée nationale libyenne, défie ouvertement le Congrès général national dominé par les islamistes, exigeant sa dissolution et la mise en place d'un « Conseil présidentiel » pour mieux assurer l'autorité de l'État. Les 16 et 18 mai, des forces loyales à Haftar attaquent des milices à Benghazi, puis le siège du CGN à Tripoli, faisant plusieurs dizaines de morts60. En juin, la justice invalide l'élection de Miitig ; Abdallah al-Thani revient alors à la tête du gouvernement. Les élections législatives se déroulent le 25 juin : 12 des 200 sièges du nouveau parlement ne sont pas pourvus, les votes ayant été annulés dans diverses localités en raison des violences. Le Parti de la justice et de la construction, proche des islamistes, est nettement minoritaire.
L'instabilité persiste ensuite en Libye, qui s'avère incapable de construire un véritable pouvoir central et de mettre un terme au désordre et à la violence dans le pays, où les milices continuent de s'arroger un pouvoir de fait. En juillet 2014, la mission de l'ONU évacue son personnel après des affrontements à Tripoli et Benghazi, qui font plusieurs victimes. Toujours en juillet, la milice de Misrata alliée à des groupes islamistes affronte la milice de Zenten alliée à d'anciens soutiens de Khadafi pour le contrôle de l'aéroport de Tripoli, tandis que d'autres groupes combattent en Cyrénaïque pour le contrôle des ressources pétrolières.
Après les élections, la passation de pouvoir entre le Congrès général national et la nouvelle Chambre des représentants est annulée : le nouveau parlement, boycotté par les élus islamistes et présidé par Aguila Salah Issa, tient sa session inaugurale à Tobrouk. Fin août, la coalition « Aube de la Libye » (Fajr Libya) formée par les groupes islamistes, prend le contrôle de Tripoli et reforme le Congrès général national : Nouri Bousahmein est réélu au poste qu'il occupait avant les élections, tandis qu'Omar al-Hassi devient le nouveau premier ministre. L'Égypte et les Émirats arabes unis mènent des bombardements répétés sur la capitale libyenne.
an 2014 : Malawi - En mai 2014, Joyce Banda perd l'élection présidentielle, au profit du frère de Bingu wa Mutharika, Peter Mutharika. Le pays, comme d'autres en Afrique australe, est confronté à des phénomènes climatiques difficiles, alternant sécheresse et inondations, dont les effets sont aggravés par la déforestation, mais connait une croissance de son PIB. Peter Mutharika est réélu pour un deuxième mandat lors de l’élection présidentielle de 2019, dans un scrutin serré. L'opposition dénonce des résultats frauduleux. Le 3 février 2020, la cour constitutionnelle, constatant des irrégularités, annule l'élection.
an 2014 : Mali - Interventions de troupes françaises (opération Serval puis Barkhane)
Cette opération Serval semble être un succès dans un premiers temps : les villes ont été reprises ainsi que le territoire du nord du pays, un dialogue est rétabli avec les différentes composantes Touareg et l’État malien est stabilisé. Mais Al-Qaida au Maghreb islamique change d'approche,et se reconstitue. L'organisation procède désormais par des incursions ponctuelles et par des attentats, et le maintien sur place des troupes françaises et africaines, dans l'organisation initiale de ces forces, se révèle coûteux. Il est décidé de substituer l’opération Barkhane à l'opération Serval, pour sécuriser la bande sahélo-saharienne, avec la mission de lutter contre les groupes djihadistes et d’empêcher la constitution de sanctuaires terroristes dont le quartier-général semble établi à N’Djamena. Le nouveau dispositif est officiellement lancée le 1er août 2014.
an 2014 : Mauritanie - Le 2 février 2014, le Premier ministre Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf, en poste depuis le début du mandat du président Aziz, présente la démission de son gouvernement. Il est reconduit dans ses fonctions dès le lendemain et chargé de former un nouveau gouvernement qui compte onze nouvelles personnalités dont cinq femmes.
Le 21 mai 2014, les ministres de l'Intérieur du groupe des Cinq du Sahel, dont fait partie la Mauritanie, créent une « plateforme de coopération sécuritaire » destinée notamment à « lutter contre le terrorisme » à Nouakchott.
Le 4 juin 2014, des milliers de sympathisants manifestent à Nouakchott contre le mode d'organisation des élections présidentielles à l'appel du Forum national pour la démocratie et l'unité (FNDU, opposition radicale).
Mohamed Ould Abdel Aziz remporte une victoire écrasante et attendue à la présidentielle le 21 juin 2014, et recueille 81,94% des suffrages, avec un taux de participation de 56,55%. Investi le 2 août pour son second mandat, il nomme comme Premier ministre Yahya Ould Hademine, ancien ministre de l'Equipement et des Transports du précédent gouvernement.
Le 3 novembre 2014, le responsable du parti islamiste modéré Tewassoul Elhacen Ould Mohamed est nommé à la tête de l'opposition démocratique.
Le 25 décembre 2014, pour la première fois depuis son indépendance, une condamnation à mort pour apostasie est prononcée en Mauritanie à Nouadhibou (au nord-ouest du pays) à l'encontre d'un citoyen mauritanien musulman, inculpé après avoir publié sur internet un texte considéré comme blasphématoire. Le 21 avril 2015, la peine de mort est confirmée pour le blogueur Mohamed Cheikh ould Mkheitir, qui est détenu depuis janvier 2014 pour un article jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. Le 31 janvier 2017 la Cour suprême renvoie devant une autre cour d'appel le dossier de Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir, le blogueur condamné à mort pour apostasie et emprisonné depuis 3 ans. Il est libéré le 29 juillet 2019 et ne cesse de dénoncer les discriminations ethniques et sociales en Mauritanie.
Esclavage
Le 6 mars 2014, avec l'appui de l'ONU, la Mauritanie adopte un plan pour l'éradication de l'esclavage.
En novembre 2014, les autorités mauritaniennes ferme le siège de l'IRA, une ONG anti-esclavagiste qu'elles accusent de propager la haine entre les populations.
Situation sanitaire et humanitaire
Le 24 octobre 2014, le gouvernement annonce le renforcement des contrôles de sa frontière avec le Mali à la suite de l'annonce du premier cas d'Ebola dans ce pays.
an 2014 : Mozambique - Le 15 octobre 2014, le FRELIMO propose un nouveau candidat à l'élection présidentielle, Filipe Nyusi qui est élu au premier tour, au cours d’un scrutin parsemé de fraudes et contesté par l’opposition, comme chaque fois. Afonso Dhlakama, chef du RENAMO, principale force d'opposition, double cependant son score de 2009, et réunit 37 % des suffrages exprimés. La situation post-électorale est tendue et le RENAMO semble pendant quelques mois reprendre une insurrection militaire, comme pendant les heures noires de la guerre civile qui a duré de 1976 à 1992.
an 2014 : Namibie - En 2014 a lieu l'Élection présidentielle namibienne de 2014, Elle est remportée par le candidat de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO), Hage Geingob, avec 86,73 % des suffrages.
an 2014 : Nigéria - L'année 2014 est marquée par la montée en puissance du groupe, qui kidnappe notamment plus de 200 lycéennes, provoquant des réactions d'indignations mondiales.
an 2014-2015 : Sierra Leone - Le pays est touché par l'épidémie d’Ebola en 2014 et 2015, qui fait 4 000 morts, et, en 2017, par des inondations meurtrières.
an 2014 : Tunisie - L'article 37 de la loi électorale, votée en application de l'article 74 de la Constitution de 2014, permet à tout électeur de confession musulmane, âgé d'au moins 35 ans et jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance de se présenter à l'élection présidentielle ; il doit présenter, s'il est titulaire d'une autre nationalité, un engagement stipulant l'abandon de son autre nationalité en cas d'élection. L'article 38 de la même loi exige que le candidat soit parrainé par dix élus de l'Assemblée des représentants du peuple ou par 10 000 électeurs, tout en stipulant qu'il est interdit au même parrain de parrainer plus d'un candidat. L'article 39 exige enfin le dépôt d'une caution de 10 000 dinars auprès du trésor public, qui est restituée au candidat s'il obtient plus de 3 % des suffrages exprimés.
L'Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de statuer et de fixer la liste des candidatures approuvées dans un délai de quatre jours à compter de la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures ; toute décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.
an 2015 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - la présidence Kaboré (2015-2022). - Des élections sont prévues initialement en octobre 2015, pour passer de cette période de transition à un fonctionnement démocratique stabilisé. Mais une tentative de coup d'état, (qualifié par des burkinabés de « coup d'état le plus bête du monde ») retarde l'échéance prévue pour cette consultation électorale.
Le 16 septembre 2015, en effet, le président de transition, le premier ministre et quelques membres du gouvernement sont pris en otages par des troupes armées, le Régiment de sécurité présidentielle, sous les ordres du général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Comparé. Des manifestations sont réprimées. Finalement, les autorités de transition sont rétablies, et le fameux régiment de sécurité présidentielle est désarmé fin septembre 2015. Les élections ont lieu en novembre 2015.
Le 30 novembre 2015, à la suite des élections présidentielles et législatives, Roch Marc Christian Kaboré (MPP) est élu au premier tour président du Burkina Faso avec 53,49 % des voix devant Zéphirin Diabré (UPC), qui récolte 29,65 % des voix, les douze autres candidats se partageant le reste. Il est le deuxième président civil depuis l'accès à l'indépendance du Burkina Faso après Maurice Yaméogo.
Depuis 2016, le Burkina Faso est touché par un certain nombre d'attaques menées par des groupes armés djihadistes : le 15 janvier 2016 ont lieu les attentats de Ouagadougou, des hommes armés attaquent le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ces lieux sont fréquentés principalement par des occidentaux. L'attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fait 30 morts. En août 2017, une autre attaque djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou. Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste visant l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou fait 8 morts, tous des militaires et plus de 80 blessés (civils et militaires). Cette attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
an 2015 : Burundi - Pierre Nkurunziza décide de briguer un troisième mandat à la présidence de la République et s'impose en avril comme le candidat du pouvoir pour l'élection présidentielle du 26 juin 2015. Cette décision est contraire à la constitution du Burundi, promulguée en mars 2005. Sa candidature est néanmoins validée par une décision controversée de la Cour constitutionnelle.
Le 13 mai 2015, Pierre Nkurunziza, en déplacement, est victime d'une tentative de coup d'État de la part du général Godefroid Niyombare.
Le 15 mai, après de violents combats dans le centre-ville de Bujumbura, les putschistes annoncent leur reddition et le pouvoir indique le retour imminent du président Nkurunziza. Les jours qui suivent voient une répression sanglante de l'opposition de la part du président. Cette répression fait des centaines morts et provoque des départs massifs : des centaines de milliers de burandais se réfugient à l'extérieur du pays . Après plusieurs reports, l'élection présidentielle, jugée illégale et truquée par tous les observateurs de la politique burundaise, se tient finalement le
21 juillet. Le 24 juillet, la commission électorale nationale indépendante proclame Nkurunziza vainqueur avec 69,41 % des suffrages.
.
an 2015-2016 : République de Centrafrique - Une élection présidentielle est organisée en décembre 2015 et janvier 2016. Faustin-Archange Touadéra arrive deuxième du premier tour avec 19 % des voix, derrière son opposant, Anicet-Georges Dologuélé qui arrive en tête avec 23,7 %. Il est finalement élu président de la République à l'issue du deuxième tour, avec 62,7 % des suffrages contre 37,3 % à Anicet-Georges Dologuélé. Ce nouveau président de la République lance un processus de réconciliation nationale afin de rendre justice aux victimes des guerres civiles, la plupart déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pour ce faire, il charge par décret son ministre conseiller, Regina Konzi Mongot, d'élaborer le Programme national de réconciliation nationale et de paix, proposé en décembre 2016, adopté en séance tenante à l'unanimité par les organismes internationaux.
an 2015 : Congo Brazzaville - En 2015, Denis Sassou-Nguesso organise une série de consultations avec des personnalités politiques du pays afin d’examiner une possible modification de la constitution en vigueur dans le pays depuis 2002. La démarche est vivement critiquée par une partie de l’opposition qui y voit une manœuvre afin de pouvoir se présenter une troisième fois à la présidence de la République (la Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels à deux et l’âge pour se présenter à la présidence de la République à 70 ans). La majorité assure de son côté souhaiter renforcer les institutions du pays en passant d’un régime présidentiel à un régime semi-parlementaire.
Le 25 octobre 2015, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Elle entre en vigueur le 6 novembre 2015, après sa promulgation par Denis Sassou-Nguesso.
an 2015-2017 : Congo Kinshasa - En 2015, des tensions apparaissent dans la perspective de l'élection présidentielle de 2016 et d'un éventuel prolongement de mandat de Joseph Kabila. L'article 70 de la Constitution du pays, datée de 2006, dispose que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Prétextant un délai supplémentaire de seize mois et un jour pour finaliser l’enregistrement des 30 millions d’électeurs, la commission électorale a annoncé le 20 août 2016, que l'élection présidentielle ne pouvait pas se dérouler avant juillet 2017. Le 19 septembre 2016, lors d’un rassemblement à Kinshasa contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, au moins dix-sept personnes sont mortes (3 policiers et 14 civils) durant la manifestation. Après la crise de confiance dans les institutions résultant de cette décision, des mouvements insurrectionnels sont signalés dans différentes provinces : milice Kamwina Napsu dans le Kasaï central, Bundu dia Kongo dans le Kongo central, Pygmées contre Bantous dans le Tanganyika, réactivation du M23. L'économie pâtit de la situation, et le phénomène des enfants soldats est en recrudescence.
Le 11 octobre 2017, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Corneille Nangaa, annonce que le scrutin pour remplacer Joseph Kabila ne pourra pas avoir lieu avant 504 jours, en raison du recensement encore en cours dans les régions du Kasaï, jusqu'en décembre 2017, puis de l’audit du fichier électoral par les experts, de l’élaboration de la loi portant répartition des sièges au parlement et de plusieurs autres opérations techniques et logistiques nécessaires avant la tenue des élections, prévue au premier semestre 2019. Ce nouveau report des élections suscite l'indignation de l'opposition, ainsi que nombre d'ONG.
an 2015-2016 : Afrique Côte d'Ivoire - À la suite de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015, le président Ouattara est réélu pour cinq ans. Il souhaite consolider les efforts de réconciliation nationale et rédiger une nouvelle Constitution. Cette nouvelle Constitution, qui entraine la création d'un sénat et d'un poste de vice-président, est approuvée par référendum le 30 octobre 2016. La troisième République Ivoirienne est proclamée le 8 novembre 2016.
an 2015 : Guinée - Le 11 octobre 2015, le président Alpha Condé obtient 58 % des suffrages et est réélu au premier tour de l'élection présidentielle pour un nouveau mandat de 5 ans.
an 2015 : Libye - Le gouvernement de Tobrouk — seul à être reconnu par la communauté internationale — et celui de Tripoli se disputent dès lors le pouvoir, en même temps que le contrôle des puits de pétrole, tandis que le pays entier est en proie à la violence et aux affrontements de groupes armés, tribaux ou djihadistes. La déliquescence de la Libye contribue à faire du pays l'une des principales zones de transit de l'immigration clandestine à destination de l'Europe. Par ailleurs, à la faveur du chaos politique, l'État islamique s'implante en Libye et lance des attaques, notamment à Misrata et à Syrte. L'ONU s'efforce d'amener les belligérants libyens à s'unir pour contrer l'État islamique. Le 10 juillet 2015, le gouvernement de Tobrouk signe finalement avec une partie des groupes armés un accord de paix proposé par l’ONU : celui de Tripoli rejette au contraire le texte et n'envoie pas de délégation à la signature.
an 2015 : Mauritanie - Le 28 janvier 2015 débute une grève de 9 semaines affectant les sites de production et d'exportation de la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM). Les revendications portent sur des augmentations de salaire. Après 9 semaines de grève la reprise du travail se déroule le 3 avril à la suite de l'ouverture de négociations et de la réintégration de grévistes licenciés.
Le 6 aout 2015, un islamiste malien, ancien porte-parole d'Ansar Dine, un groupe lié à Al Qaïda, et visé par un mandat d'arrêt international l'accusant de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, meurtre et actes terroristes est libéré par la Mauritanie, où il était détenu depuis plusieurs mois.
Le 2 septembre 2015, un remaniement ministériel remercie huit ministres, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Equipement.
Le 17 novembre 2015, la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM) ouvre un nouveau complexe minier sur le site de Zouerate, dans le nord du pays. Dénommé Guelb II, c'est le plus important projet industriel de l’histoire de la Mauritanie, dans lequel près d’un milliard de dollars ont été investis.
Le 10 février la présidence annonce un nouveau remaniement et le départ de cinq ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de l'Économie.
Le 7 mai 2015 l'opposition appelle a manifester contre le projet de révision constitutionnelle annoncé par le président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui prévoit entre autres choses la suppression du Sénat. Des heurts avec les forces de l'ordre feront plusieurs blessés. Le 29 septembre 2015, après de longues négociations entre pouvoir et opposition, s'ouvre un nouveau dialogue national. L'initiative est le point de départ qui doit amener à une réforme constitutionnelle, portant notamment sur la suppression du Sénat et la création du poste de vice-président. Une partie importante de l'opposition accuse le président Mohamed Ould Abdel Aziz de vouloir modifier le texte fondamental dans le but se présenter pour un troisième mandat. Le 20 octobre 2015 un accord politique marquant la fin du dialogue national est signé entre la majorité et quelques partis d'opposition. Plusieurs révisions constitutionnelles sont retenues, mais pas la suppression de la limitation des mandats présidentiels est rejetée.
Esclavage
Le 1er juillet 2015, six militants anti-esclavage de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) sont arrêtés, marquant le début d'une série d'arrestations dans les rangs de l'IRA. Leur procès débute le 3 août 2015 et dure quinze jours à l'issue desquels la Cour criminelle condamne la plupart des accusés à des peines de prison allant de trois à huit ans. Treize d'entre eux disent avoir été torturés durant leur détention.
Le 13 août 2015, le Parlement adopte une loi durcissant la répression de l'esclavage, considéré désormais comme un « crime contre
l'humanité ».
Situation sanitaire et humanitaire
Le 9 octobre 2015, la Mauritanie alerte l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'épidémie de fièvre qui sévit dans la vallée du rift
an 2015 : Nigéria - Début 2015, Boko Haram rase plusieurs villes et villages du nord-est du pays. Cette série d'attaques pousse les voisins du Nigéria, le Tchad, le Niger et le Cameroun à intervenir contre la secte islamiste. En 2015, Boko Haram fait allégeance à l'État islamique.
an 2015 : Tchad - Depuis 2015, l'armée tchadienne est engagée dans le conflit contre le groupe djihadiste Boko Haram, répandu dans le Nord du Nigeria et du Cameroun. En représailles, ce groupe a commis plusieurs attaques en territoire tchadien.
an 2015-2020 : Togo - Faure Gnassingbé est à nouveau réélu lors de l'élection présidentielle d'avril 2015, avec 58,75 % des suffrages exprimés, contre 34,95 % pour son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Une élection jugée libre et transparente par l'UE et les principaux observateurs internationaux. L'abstention s'élève à 40,01 %, contre 35,32 % à la précédente présidentielle de 2010. Du côté de l'opposition, Tchabouré Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI), a obtenu 3,08 % des suffrages, Komandega Taama, président du Nouvel engagement togolais (NET), 1,06 %, et Mouhamed Tchassona-Traoré, président du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (MCD, opposition), 0,99 %. Il nomme Premier ministre Komi Sélom Klassou le 5 juin 2015 jusque-là premier président de l'Assemblée nationale. Faure Gnassingbé se présente pour un quatrième mandat lors des élections présidentielles de 202022. Il est reconduit et l'élection est contestée une nouvelle fois par l'opposition.
an 2015 : Zambie - Edgar Lungu est élu en 2015 pour le remplacer et terminer son mandat présidentiel. Edgar Lungu est à la tête du Front patriotique (PF) qu'il a créé en 2001 après avoir quitté le Mouvement pour la démocratie multipartite (MMD). Il est vainqueur du scrutin présidentiel, d'une courte tête.
an 2016 : Algérie - Le pays enregistre sa première grande attaque terroriste dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016. Bilan : une trentaine de morts et une centaine de blessés.
an 2016-2018 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Depuis 2016, le Burkina Faso est touché par un certain nombre d'attaques menées par des groupes armés djihadistes : le 15 janvier 2016 ont lieu les attentats de Ouagadougou, des hommes armés attaquent le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ces lieux sont fréquentés principalement par des occidentaux. L'attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fait 30 morts. En août 2017, une autre attaque djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou. Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste visant l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou fait 8 morts, tous des militaires et plus de 80 blessés (civils et militaires). Cette attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
an 2016 : Cameroun - Depuis novembre 2016, des manifestants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, majoritairement anglophones, font pression pour le maintien de l'usage de la langue anglaise dans les écoles et les tribunaux. Des personnes ont été tuées et des centaines emprisonnées à la suite de ces protestations.
an 2016 : Cap Vert - Jorge Carlos Fonseca, du MPD, est réélu Président en 2016. José Maria Neves, du PAICV, est, dans le même temps, désigné premier ministre, de 2001 à 2016. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux partis au pouvoir, et même d'une cohabitation de ces deux partis pendant certaines périodes. Il est considéré comme ayant une bonne gouvernance, avec l'une et l'autre de ces formations, même si l'économie, peu diversifiée, est dépendante à 20 % du tourisme. Cet état ne dispense pas de grandes ressources naturelles. En 2016, le MPD revient au pouvoir à la suite des législatives, et la dirigeante relativement récente du PAICV, Janira Hopffer Almada, reconnaît sa défaite sans drame. L'archipel, qui souffre du réchauffement climatique, d'autant plus que l'eau douce y est rare, a une politique de développement des énergies renouvelables9, ainsi que de l'écotourisme.
an 2016 : Congo Brazzaville - Le 20 mars 2016, après avoir fait modifier la constitution (cf. infra), Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 60,07 % des voix, score validé par la Cour constitutionnelle le 4 avril suivant.
an 2016-2019 : Gabon - Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin à cinq mille voix près. L'opposition dénonce immédiatement ces résultats. Des émeutes encore plus violemment réprimées que celles de 2009 éclatent, avec comme point d'orgue l'attaque du quartier général de l'opposition par la garde présidentielle qui fait de nombreux morts. Le 24 septembre 2016, Ali Bongo est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec 50,66 % des voix, suivi de Jean Ping avec 47,24 % des suffrages.
Le président Bongo prône le concept de « Gabon émergent », politique visant notamment à la diversification de l'économie afin de diminuer sa dépendance aux cours mondiaux du pétrole. En 2018, cela ne s'est pourtant pas concrétisé, notamment du fait de la baisse des cours du pétrole et d'investissements peu judicieux, tandis que le chômage des jeunes reste élevé.
Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin à cinq mille voix près. L'opposition dénonce immédiatement ces résultats. Des émeutes encore plus violemment réprimées que celles de 2009 éclatent, avec comme point d'orgue l'attaque du quartier général de l'opposition par la garde présidentielle qui fait de nombreux morts. Le 24 septembre 2016, Ali Bongo est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec 50,66 % des voix, suivi de Jean Ping avec 47,24 % des suffrages.
Le 2 février 2017, le Parlement européen adopte une résolution déclarant que les résultats de la présidentielle « manquent de transparence » et sont « extrêmement douteux ».
Le 7 janvier 2019, une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence après un accident vasculaire cérébral, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour ; sur cinq mutins, deux sont tués et les autres arrêtés. Le 12 janvier, un nouveau Premier ministre est nommé, Julien Nkoghe Bekalé. Le pouvoir gabonais connaît une guerre des clans au sommet. Les remaniements ministériels se succèdent entre janvier et décembre 2019, alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé d'Ali Bongo. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée première ministre en juillet 2020.
an 2016-2017 : Gambie - En décembre 2016, sept partis d'opposition choisissent un candidat unique, Adama Barrow, pour l'élection présidentielle. Adama Barrow remporte l'élection à l'unique tour de scrutin en recueillant 43,3 % des suffrages, contre le président sortant qui arrive second avec 39,6 % des suffrages. Le 17 janvier 2017, Yahya Jammeh instaure l'état d'urgence et le lendemain, le Parlement prolonge son mandat de trois mois, jusqu'au 19 avril 2017. Le 19 janvier, Adama Barrow prête serment à l'ambassade de Gambie à Dakar. Devant le refus de Yahya Jammeh de lui céder le pouvoir, malgré les injonctions de la CÉDÉAO, l'armée sénégalaise pénètre en territoire gambien dans le courant de l'après-midi. Le soir même, le chef de l'armée gambienne, le général Ousman Badjie, déclare à des ressortissants occidentaux qu'il n'ordonnera pas à ses hommes de résister en cas d’intervention des troupes africaines.
L'élection présidentielle de décembre 2016 voit Adama Barrow, candidat de l'opposition, remporter la victoire sur le président sortant13 dont le mandat court jusqu'au 18 janvier 2017. Le 19 janvier 2017, Adama Barrow prête serment dans l'ambassade gambienne à Dakar au Sénégal, après le refus du président sortant de céder le pouvoir. Le même jour, l'armée sénégalaise entre en Gambie, forte d'une résolution de l'ONU. Le 20 janvier 2017, Jammeh accepte de quitter le pouvoir, et part en exil le lendemain soir pour Conakry, avant de rejoindre la Guinée équatoriale.
an 2016 : Guinée - En juillet 2016, la Guinée est le premier pays à majorité musulmane d'Afrique à renouer ses liens diplomatiques avec Israël.
an 2016-2018 : Guinée-Bissau - Au mois de septembre 2016, le président guinéen Alpha Condé, médiateur de la crise bissau-guinéenne, et son homologue de la Sierra Leone Ernest Baï Koroma obtiennent un compromis politique signé le 10 septembre par toutes les parties : ce sont les accords de Conakry. Successivement, Umaro Sissoco Embaló en novembre 2016, puis Artur Silvafin janvier 2018, puis Aristides Gomes mi-avril 2018 sont nommés premier ministres.
an 2016 : Libye - Devant la gravité de la situation et la progression de l'EI, la communauté internationale pousse à la création d'un gouvernement unitaire. Le 12 mars 2016 Fayez el-Sarraj prend la tête d'un gouvernement « d'union nationale », formé à Tunis, initialement rejeté par les parlements de Tripoli et de Tobrouk. Grâce au soutien occidental, le gouvernement peut s'installer à Tripoli à la fin du mois. Il obtient le 23 avril le soutien de la majorité des parlementaires de Tobrouk, et s'installe progressivement dans ses fonctions.
L’Organisation internationale pour les migrations note le développement de la traite d’êtres humains dans la Libye post-kadhafiste. Selon l'organisation, de nombreux migrants sont vendus sur des « marchés aux esclaves » pour 190 à 280 euros. Ils sont égalent sujets à la malnutrition, aux violences sexuelles, voire aux meurtres.
La ville de Syrte, place forte de l’organisation Etat islamique (EI) en Afrique du Nord, est reconquise début décembre 2016 par les forces du gouvernement libyen d’union nationale de Faïez Sarraj, soutenu par les capitales occidentales et les Nations unies, stoppant les vélléités de l'EI dans ce pays.
an 2016 : Mauritanie - Torture
Le 4 février 2016, après une inspection de dix jours, Juan Ernest Mendez, le rapporteur spécial de l'ONU fait part de ses regrets quant à la non application de la loi sur la prévention et la répression de la torture, promulguée en septembre 2015. La Mauritanie est dénoncée par plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, qui rapportent de nombreux actes de tortures et de mauvais traitement infligés aux détenus lors des interrogatoires.
Le 14 novembre 2016, une plainte visant de hauts responsables mauritaniens est déposée à au tribunal de grande instance de Paris. Ils sont accusés de « tortures et de traitements cruels » à l'encontre de militants anti-esclavage.
Situation sanitaire et humanitaire
En novembre 2016, le Programme alimentaire mondial (PAM) appelle à la mobilisation de 17 millions de dollars pour faire face à la situation des réfugiés maliens qui ont fui les exactions des groupes terroristes, confrontés à une crise alimentaire.
an 2016-2018 : Sao Tomé et Principe - Chef de l’Etat : M. Evaristo Carvalho, Président de la République (élu le 7 août 2016)
Chef du Gouvernement : M. Jorge Bom Jesus
L’élection présidentielle du 7 août 2016 voit Evaristo Carvalho, candidat de l’ADI (action démocratique indépendante), élu président de la République contre le président sortant Manuel Pinto da Costa. Le Président a un rôle non exécutif, d’arbitre et de représentation.
Malgré deux tentatives de coup d’Etat en 2003 et 2009, la démocratie parlementaire s’affirme et permet à plusieurs reprises une alternance entre les deux grandes forces qui animent la vie politique : l’ADI de Patrice Trovoada (fils de Miguel Trovoada, il est premier ministre de 2010 à 2012 et de 2014 à 2018) et le MLSTP de Jorge Bom Jesus.
Aux élections législatives d’octobre 2018, une coalition menée par le MLSTP l’emporte d’une très courte avance (28 sièges contre 27) et, après une courte période d’incertitude rapidement tranchée par la Cour constitutionnelle et acceptée par toutes les parties, Jorge Bom Jesus est chargé de former un gouvernement, début décembre 2018. Le gouvernement, toujours dirigé par Jorge Bom Jesus, a été remanié en septembre 2020.
an 2016 : Seychelles - À la suite de la défaite de son parti Lepep (issu de l'ancien parti unique) aux élections législatives de septembre 2016, James Michel annonce sa démission de son poste de président de la République en septembre 2016. Le 16 octobre suivant, il est remplacé par son vice-président, Danny Faure. Une période de cohabitation commence entre ce nouveau président et un Parlement contrôlé par l'opposition à l'ex-parti unique (qui était au pouvoir depuis 1977).
an 2016 : Tchad - Depuis 2016, le Tchad est confronté à un mouvement insurrectionnel dans le Nord du pays : plusieurs groupes armés d'exilés tchadiens ayant combattu dans la guerre civile libyenne reviennent en force dans leur pays d'origine.
an 2016 : Zambie - Edgar Lungu est réélu en 2016, dans un scrutin là encore serré, contre Hakainde Hichilema.
an 2017-2019 : Algérie - Bouteflika est critiqué pour ses manières autocratiques, et le chômage affecte encore plus d'un tiers de la population. En 2009, Bouteflika est réélu pour un troisième mandat après avoir fait amender la Constitution algérienne à cet effet. Victime en 2013 d'un accident vasculaire cérébral affectant son élocution et l'obligeant à se déplacer en chaise roulante, il fait en mars 2017 une apparition publique qui alimente les inquiétudes sur son état de santé. Il est alors âgé de 80 ans et des voix commencent à mettre en doute sa capacité à gouverner le pays.
Sous la pression de manifestations populaires de masse, et alors qu'il se présente pour un cinquième mandat, Abdelaziz Bouteflika démissionne le 2 avril 2019.
an 2017 : Angola - L'Angola présente un paysage de cités martyres, de provinces jadis agricoles stérilisées par la présence de millions de mines. Une bonne partie des infrastructures coloniales a été laissée à l'état de ruines (routes, ponts, aéroports, voies de chemin de fer, écoles), pendant que d'autres ont été reconstruites et même augmentées. L’agriculture et les transports ont été fortement endommagés et se trouvent en récupération lente. Malgré l’aide alimentaire, la famine sévit et le pays ne vit que de l’exportation du pétrole. Comme d’autres pays, l’Angola réclame des indemnisations et des aides financières, que le Portugal et l’Union européenne lui accordent sous forme d’aide au développement (écoles, eau potable, routes, hôpitaux) ou de visas de travail. En dépit de la guerre civile, la scolarité, certes médiocre, s'est améliorée (15 % d’enfants scolarisés en 1975, 88 % en 2005). De nombreuses missions catholiques et protestantes encadrent également les populations depuis l’indépendance. D'un point de vue politique, José Eduardo dos Santos confirme sa retraite, resté trente-sept ans de pouvoir. Il annonce début février 2017, se mettre en retrait de la politique fin 2017, après avoir, pendant 38 ans, muselé l’opposition par une répression policière, limité la liberté d'expression et imposé son autorité17. Il choisit pour lui succéder João Lourenço.
Le parti au pouvoir depuis plus de quatre décennies en Angola, le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), remporte les élections générales, en août 2017, avec plus de 64 % des suffrages. Le candidat du MPLA, Joao Lourenço, succède donc comme prévu à la tête du pays au président José Eduardo dos Santos. Les deux principaux partis dans l'opposition, l’Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (Unita) et la CASA-CE, obtiennent respectivement 24,04 % et 8,56 % des voix exprimées. Au terme de ce scrutin, le MPLA, au pouvoir depuis l’indépendance en 1975, conserve la majorité absolue des 220 sièges du Parlement18. En septembre 2018, Joao Lourenço succède également à José Eduardo dos Santos à la tête du MPLA.
an 2017-2018 : Cameroun - En 2017, le gouvernement de Biya a bloqué l'accès de ces régions à Internet pendant trois mois. En septembre, des séparatistes ont lancé une guérilla pour l'indépendance des régions anglophones en tant que République fédérale d'Ambazonie. Le gouvernement a répondu par une offensive militaire, et l'insurrection s'est étendue aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le 1er octobre 2017, Sisiku Julius Ayuk Tabe déclare symboliquement l'indépendance de la république fédérale d'Ambazonie, déclenchant une répression par les forces de l'ordre se soldant par des morts, des blessés, des émeutes, barricades, manifestations, couvre-feu, etc. En janvier 2018, le Nigéria compte entre 7 000 et 30 000 réfugiés liés au conflit et à la répression à la suite de cette déclaration d'indépendance. Le 5 janvier 2018, des membres du gouvernement intérimaire d'Ambazonie, dont le président Sisiku Julius Ayuk Tabe, sont arrêtés au Nigéria et déportés au Cameroun. Ils y sont arrêtés et passent 10 mois dans un quartier général de gendarmerie avant d’être transférés dans une prison à sécurité maximale de Yaoundé. Un procès débute en décembre 2018. Le 4 février 2018, il a été annoncé que Samuel Ikome Sako deviendrait le président par intérim de la République fédérale d'Ambazonie, succédant temporairement à Tabe. Sa présidence a vu l'escalade du conflit armé et son extension à tout le Cameroun anglophone. Le 31 décembre 2018, Ikome Sako déclare que 2019 verrait le passage d'une guerre défensive à une guerre offensive et que les séparatistes s'efforceraient d'obtenir une indépendance de facto sur le terrain. Le 20 août 2019 au matin le tribunal militaire de Yaoundé condamne Julius Ayuk Tabe et neuf autres de ses partisans à la réclusion criminelle à vie.
an 2017 : République de Centrafrique - En juin 2017, les affrontements à Bria, dans le centre-est du pays, font une centaine de morts. Par ailleurs, un comité est également mis en place afin de juger les principaux acteurs et dédommager les victimes.
an 2017 : Afrique République de Djibouti - En 2017, après les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon, la Chine obtient de pouvoir y implanter une base militaire. L'Espagne et l’Allemagne y ont aussi disposé de petits contingents.
an 2017 : Gabon - Le 2 février 2017, le Parlement européen adopte une résolution déclarant que les résultats de la présidentielle « manquent de transparence » et sont « extrêmement douteux ».
an 2017 : Ghana - Depuis 2017, Nana Akufo-Addo est président de la République.
an 2017 : Guinée-équatoriale - Le père et le fils Obiang sont poursuivis par la justice française sur des biens mal acquis, provenant notamment de détournements de fonds publics. Le fils Teodorin est finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Ce procès dit « des biens mal acquis », révélateur du pillage des richesses nationales, aboutit à une condamnation en octobre 2017, en première instance.
an 2017 : Kenya - L'organisation État islamique et les chebabs multiplient les attaques au Kenya depuis les années 2010, mettant en échec la politique sécuritaire du gouvernement. À ces attaques s'ajoute une instabilité politique interne dans les mois qui précèdent les élections générales d'août 2017. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, est finalement réélu et affiche un score électoral de 54,28 % des suffrages exprimés. Son rival Raila Odinga parle à nouveau de fraudes. Des émeutes éclatent avant un appel au calme par Raila Odinga, qui s'en remet une fois encore à la Cour suprême. Celle-ci, à la surprise générale, lui donne cette fois raison et invalide les élections, qui sont réorganisés en octobre 2017. Cette décision montre une consolidation progressive des contre-pouvoirs au Kenya à la suite de la constitution de 2010. À la suite des modifications de la loi électorale avant ce nouveau scrutin, Raila Odinga se retire et appelle au boycott de l'élection. Finalement, le président sortant Uhuru Kenyatta remporte le nouveau scrutin avec 98,26 % des voix, mais la participation le 26 octobre 2017 n'est que de 38,8 % des électeurs inscrits, à comparer à 79 % le 8 août 2017, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême.
an 2017-2022 : Lesotho - Les élections législatives de juin 2017, organisées de manière anticipées à la suite du vote d'une motion de censure à l'encontre du Premier ministre Pakalitha Mosisili après la dislocation de la coalition le soutenant, aboutissent à une alternance.
Le parti d'opposition Convention de tous les Basotho (ABC) remporte arrive en effet en tête des suffrages et remporte la majorité relative des sièges, tandis que le Congrès démocratique (DC) de Mosisili perd plus du tiers des siens. Mené par Tom Thabane, l'ABC forme un gouvernement de coalition avec trois autres partis, l'Alliance des démocrates (AD), le Parti national basotho (BNP) et le Congrès réformé du Lesotho (RCL), permettant à Thabane de devenir premier ministre.
Accusé d'avoir commandité le meurtre de son ex épouse Lipolelo Thabane deux jours avant sa prise de fonction en 2017, le Premier ministre est cependant conduit à la démission le 19 mai 2020. Remplacé le lendemain par lendemain par le ministre des Finances Moeketsi Majoro, qui prend également la tête de l'ABC, Thabane est par la suite officiellement inculpé pour meurtre fin novembre 2021.
L'organisation des législatives de 2022 est compliquée par la pandémie de Covid-19 et le manque de budget, qui pousse le gouvernement à repousser le scrutin de juin à septembre.
an 2017-2018 : Libéria - Le 26 décembre 2017, lors d'une nouvelle présidentielle; George Weah est élu avec 61,5 % des voix au suffrage universel face au vice-président sortant, Joseph Boakai, qui en obtient 38,5 %. Il met l'accent sur la lutte anticorruption et sur l'éducation. La situation économique dont hérite le nouveau président reste délicate, avec le poids de la dette sur le budget de l'État, et une inflation importante. À partir de juin 2019, l'état de grâce de George Weah est terminé : des manifestations sont organisées contre sa politique économique.
George Weah s’est fixé comme principal objectif d’améliorer la vie des Libériens grâce à la mise en œuvre d’un programme « pro-poor » qui vise les plus défavorisés. Il entend également parachever la réconciliation nationale, lutter contre la corruption, et développer les infrastructures, en particulier routières, dont le pays est largement dépourvu.
L’élection de George Weah marque par ailleurs un pas supplémentaire dans la stabilisation du pays, confirmée par le départ de la mission des Nations unies pour le Libéria (MINUL), le 30 mars 2018.
an 2017 : Mauritanie - Le 17 mars 2017, le projet de révision constitutionnelle soumis par le gouvernement est rejeté par le Sénat. Le président Aziz annonce l'organisation d'un référendum pour le 5 août 2017.
Le 6 juin 2017, la Mauritanie annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec le Qatar, et accuse le pays de propager l'extrémisme et l'anarchie dans de nombreux pays arabes.
Le référendum du 5 août 2017 donnent un «oui» qui l'emporte à plus de 85 %. Il comporte deux volets, la modification du drapeau national (85,6 % de «oui» et 9,9 % pour le «non») ainsi que la suppression du Sénat (85,6 % pour le « oui » et 10,02 % pour le « non »). Malgré le boycott de l'opposition et de la société civile, le taux de participation est de 53,75 % selon la commission électorale49. Leader des opposants à la suppression du Sénat, le sénateur d'opposition Mohamed ould Ghadde est arrêté le 10 août50. Plusieurs personnalités de l'opposition sont interrogées51. Plusieurs sénateurs, journalistes et représentants syndicaux, accusés de faits de corruption et tous opposants à la réforme constitutionnelle, comparaitront devant un juge d'instruction.
À la fin du mois d'octobre 2017, la première opération conduite par la Force antiterroriste G5 Sahel est lancée. Dénommée Hawbi, elle est constituée du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad et compte jusqu'à 5.000 hommes répartis dans sept bataillons.
Le 13 novembre 2017, le Sénat est dissout, les grilles de l’institution sont fermées et l'accès au bâtiment fermé, mais des sénateurs frondeurs forcent l'entrée et ouvrent une session parlementaire symbolique, qui ne dure en réalité que le temps que la police intervienne et déloge les élus.
Le 28 novembre 2017, le 57e anniversaire de l’indépendance est l'occasion de présenter le nouveau drapeau mauritanien ainsi que le nouvel hymne national, nouveaux emblèmes adoptés à l'issue du référendum constitutionnel du 5 août.
Esclavage
Le 28 avril 2017, la journaliste Tiphaine Gosse et la juriste Marie Foray qui enquêtent sur l'esclavage en Mauritanie sont expulsées du pays. Elles dénoncent aux côtés d'organisations engagées dans la lutte contre l’esclavage en Mauritanie telles que SOS-Esclaves, l’AMDH et l’Association des femmes chefs de famille (AFCF) « l’hypocrisie des autorités mauritaniennes », qui cherchent selon elles par la ratification des traités internationaux et l’adoption de lois qu'elle jugent incomplètes, à plaire à la communauté internationale sans lutter pour autant contre l’esclavage dans le pays.
Le 22 juin 2017, une plainte contre l’esclavagisme et la torture en Mauritanie est déposée devant l'ONU et l'UA. L'eurodéputé Louis Michel souligne que l'esclavage continue en Mauritanie. Biram Dah Abeid, le président de l'association IRA déplore l'acharnement des autorités mauritaniennes à l'encontre des militants anti-esclavagisme.
an 2017 : Mozambique - le spectre d'une nouvelle guerre civile s'éloigne début 2017. Par contre, un scandale de dettes cachées, à la fin du deuxième mandat d'Armando Guebuza, touche le FRELIMO même si le président a changé, et fragilise le pays. Des médias anglo-saxons démontrent l'existence d'emprunts contractés de façon opaque mais garantis par le gouvernement de l'époque, pour 1,8 milliard d’euros, par trois entreprises publiques. L'affectation précise des sommes reste floue, même s'il est indiqué que ces emprunts auraient financé un programme d'armement. Depuis, le Mozambique, incapable d’honorer les remboursements de ces dettes, est plongé dans une crise financière.
an 2017 : Rwanda - Une opposante, Diane Rwigara annonce son intention de se présenter à l'Élection présidentielle rwandaise de 2017. 72 heures plus tard, des photos d'elle dénudée sont divulguées, dans un but d'intimidation. Elle persiste dans sa candidature, mais cette candidature est invalidée le 7 juillet 2017, par la Commission électorale nationale. Cette candidate semble disparaître fin août 2017, puis la police rwandaise annonce son arrestation, pour atteinte à la sureté de l’État. Début octobre, elle est inculpée, ainsi que sa mère et sa sœur, d’« incitation à l’insurrection ». Elle est libérée sous caution quelques mois plus tard en signe d'apaisement, et finalement acquittée par un tribunal de Kigali le 6 décembre 2018, ainsi que les co-accusés. Selon le jugement, « les charges retenues par l’accusation sont sans fondement ».
an 2017 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Coup d'État de novembre 2017
En raison de l'âge avancé du président Robert Mugabe, qui célèbre ses 93 ans en février 2017 et est le dirigeant le plus âgé du monde, la question de sa succession devient une question importante de la vie politique zimbabwéenne. Robert Mugabe révèle qu'il souhaite voir son épouse Grace Mugabe lui succéder. Il écarte du parti ZANU-PF et du gouvernement les rivaux potentiels de cette dernière. Grace Mugabe, connue pour ses goûts de luxe et sa brutalité, est toutefois impopulaire. Le 4 novembre, Robert Mugabe annonce qu'il souhaite que son épouse devienne vice-présidente. Le 5 novembre, celle-ci lui demande publiquement de lui céder directement la présidence de la République. Le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, le 6 novembre 2017, a ainsi pour objectif de conforter la première dame, mais déplaît aux forces armées.
Le 15 novembre 2017, le général Sibusiso Moyo annonce à la télévision nationale prendre le contrôle des rues afin « d'éliminer des criminels proches du président Mugabe » et affirme également que l'armée ne mène pas de coup d'État contre le gouvernement. Robert Mugabe et sa femme Grace sont placés en résidence surveillée par les militaires. L'Afrique du Sud, inquiète pour son sort, envoie deux émissaires rencontrer sa famille ainsi que les responsables militaires. L'Union africaine, l'Union européenne ou le Nigeria lancent un appel à la paix. Néanmoins, aucun désordre n’est observé.
Le 16 novembre 2017, Robert Mugabe continue de se considérer comme le seul dirigeant légitime du Zimbabwe et refuse la médiation du prêtre catholique Fidelis Mukonori. Cependant, le 21 novembre 2017, il finit par démissionner.
an 2017-2019 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Emmerson Mnangagwa regagne le Zimbabwe le 22 novembre 2017 et déclare qu'« aujourd'hui, nous voyons naître une nouvelle démocratie ». Mnangagwa est désigné président intérimaire et doit prêter serment dans les deux jours. La date du serment est cependant repoussée au 24 novembre 2017. Il conserve ses fonctions jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle de 2018 au cours de laquelle il porte les couleurs de la ZANU-PF et est donc le candidat favori à sa propre succession. Il emporte de justesse l’élection présidentielle au premier tour, sur fond de soupçons de fraude. Les résultats sont contestés par l'opposition mais la Cour suprême du Zimbabwe confirme finalement la victoire de Mnangagwa, faisant de lui le nouveau président élu après Mugabe. Le début de l'année 2019, dans un contexte de crise économique et d'absence d'avancées démocratiques, est marqué par de violentes manifestations, durement réprimées.
En 2019, après une campagne agricole particulièrement mauvaise en raison de la sécheresse, 2,5 millions de Zimbabwéens « s'acheminent vers la famine » selon le programme alimentaire mondial. Comme le reste de l’Afrique australe, le Zimbabwe est soumis depuis plusieurs saisons à des épisodes récurrents de sécheresse, aggravés par le réchauffement climatique, qui pèsent sur la sécurité alimentaire de la population et de la faune. En octobre, l’ONU évalue à 7,7 millions le nombre de personnes qui seront menacées par la famine en 2020.
an 2018 : Afrique du Sud - Visé par des affaires de corruption, Jacob Zuma démissionne sous la pression de son parti début 2018, après avoir été menacé de destitution, et Cyril Ramaphosa lui succède comme président de la République par intérim. Le 15 février 2018, le Parlement élit formellement Cyril Ramaphosa président de la République.
Après avoir été élu président de l'ANC le 18 décembre 2017 contre Nkosazana Dlamini-Zuma (ex-femme de Jacob Zuma et ex-présidente de la commission de l'Union africaine), Cyril Ramaphosa obtient de haute lutte le 14 février 2018 la démission de Jacob Zuma de la présidence de la République. Ramaphosa lui succède comme président de la République par intérim avant d'être élu formellement par le parlement. Acculé par la gauche de l'ANC et par la surenchère des Economic Freedom Fighters (EFF), il se prononce en faveur d'une redistribution des terres aux Sud-Africains noirs afin de « panser les plaies du passé » alors que 72 % des terres agricoles restent détenues par des Blancs (personnes physiques ou sociétés commerciales) contre 85 % à la fin de l’apartheid. Le Parlement adopte alors une motion présentée par Julius Malema, le chef des EFF, visant à faire modifier la constitution sud-africaine et permettre, sans compensation financière, l'expropriation de terres agricoles. Une partie de l'opposition invoque une violation du droit de propriété, tandis que des investisseurs et le South African Institute of Race Relations déclarent craindre que cette réforme ne porte atteinte à l'agriculture commerciale et ne provoque une crise durable. En juillet 2018, le président sud-africain annonce que l'ANC compte amender la Constitution pour y faire entrer le principe d'expropriation des fermiers sans compensation, provoquant la chute de la devise nationale. Au delà des fermes, des experts sud-africains de l'Institute for Poverty, Land and Agragian Studies (Université du Cap-Occidental) et du Mapungubwe Institute for Strategic Reflection soulignent que d'autres types de propriétés pourraient être soumises au nouveau Code foncier, notamment en centre-ville (friches et terrains non exploités, bâtiments non entretenus...) ou en zone périphérique rurale (terrains miniers notamment). Mais cette réforme avance avec lenteur. Il est réélu chef de l’État le 22 mai 2019, à l’issue d’élections générales lors desquelles l’ANC obtient le plus faible score de son histoire (57,5 %), passant sous la barre des 60 % pour la première fois depuis un quart de siècle et payant ainsi les errements et les scandales de l'ère Zuma, son prédécesseur.
Il doit également faire face à une opposition interne au sein de l'ANC, avec un clan resté fidèle à Jacob Zuma, ayant à sa tête le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, et son adjointe, Jessie Duarte. Mais le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, connaît également des divisions internes : son leader, Mmusi Maimane, démissionne le 24 octobre 2019, dénonçant une « campagne de dénigrement », de « diffamation » et des « comportements de lâches », quittant à la fois la direction du parti, le parti lui-même et ses fonctions de parlementaire. Ce départ, ou cette éviction, risque de réduire à nouveau ce parti à un «parti de Blancs».
Une vague de xénophobie vis-à-vis des migrants, les «étrangers», secoue également le pays. Par ailleurs, plusieurs sociétés importantes pour l'économie africaine sont en difficulté, notamment la compagnie nationale d'électricité Eskom. Le 19 novembre 2019,au PDG est nommé pour cette entreprise, qui lance dans la foulée un nouveau plan de restructuration.
Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi.
En mars-avril 2020 il doit faire face à la pandémie mondiale de Covid-19 et obtient un certain succès.
an 2018-2019 : Bénin (anc. Dahomey) - En 2018 et 2019, des mouvements sociaux sont constatés mais ne remettent pas en cause la stabilité de la République béninoise. Par contre, une « contagion » djihadiste est constatée avec l'enlèvement de deux Français dans le parc national de la Pendjari, un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Afrique. Cet événement, même si les otages sont libérés par une intervention de forces françaises, confirme la possibilité de voir les groupes djihadistes descendre vers le golfe de Guinée au fur et à mesure de la déstabilisation du Burkina Faso, et du centre du Mali. Cela contrarie également les objectifs du président béninois, Patrice Talon, de développer le tourisme dans son pays.
an 2018-2019 : République de Botswana - Le 1er avril 2018, son vice-président, Mokgweetsi Masisi est désigné pour le remplacer comme président du Botswana. L'année suivante, en 2019, il remporte les élections générales.
an 2018-2019 : Cameroun - Paul Biya est réélu pour un septième mandat en 2018, dans un scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition. Il lance un «grand dialogue national» en 2019. Aucune avancée décisive n'en ressort sur le conflit dans les régions anglophones. Paul Biya fait libérer des détenus, mais les leaders du mouvement restent en prison.
an 2018 : République de Centrafrique - Depuis 2018, des mercenaires russes du Groupe Wagner et de la société privée Sewa Security Services (SSS) sont présents en Centrafrique, où ils participent à la formation de militaires des Forces Armées Centrafricaines (FACA) et à la protection rapprochée du Président centrafricain.
an 2018 : Congo Kinshasa - Le 30 décembre 2018, les élections ont lieu et le 10 janvier 2019, le président de la CENI, Corneille Nangaa proclame Félix Tshisekedi comme président de la république démocratique du Congo. Le président Tshisekedi prête serment le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation, résidence officielle des présidents congolais.
Félix Tshisekedi a noué une alliance de circonstance pendant la campagne électorale avec le parti de Joseph Kabila, devenu sénateur à vie et qui conserve ainsi une influence sur le pouvoir. Leur principal opposant, Martin Fayulu, donné un moment vainqueur de l'élection présidentielle, sur la base d'une fuite de données de la CENI et par la mission d’observation de l’Église catholique congolaise, est contraint de s'incliner devant le résultat annoncé, probablement truqué. La Cour constitutionnelle a rejeté son recours. Par cette alliance, Félix Tshisekedi joue aussi la stabilité et prépare la suite de son mandat en composant avec l'assemblée législative où le parti de Kabila possède 337 sièges sur 50064,65. Le 6 décembre 2020, le président met fin à la coalition avec Kabila. Les proches de ce dernier sont alors écartés et les autres politiciens rejoignent Félix Tshisekedi. Le nouvel exécutif compte 56 membres dont 14 femmes. Leur objectif sera de « lutter contre la corruption et la misère qui touche les deux tiers de la population et ramener la paix dans l’est du pays, ensanglanté par les violences des groupes armés".
2018-2019 : Égypte - En mai 2014, Abdel Fattah al-Sissi, est réélu pour un deuxième mandat.
Par une révision constitutionnelle validée par un référendum en avril 2019, il se donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Il impose un régime autoritaire, réprime toute opposition et toute voix critique, et met sous contrôle les médias et la justice.
an 2018-2019 : Eswatini (Swaziland) - En avril 2018, à l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance, le roi annonce que le pays reprend son nom d'origine d'avant la colonisation : Eswatini. En octobre 2019, la livraison de voitures de luxe flambant neuves, des Rolls Royce, à la famille royale d’Eswatini provoque des réactions négatives dans ce royaume très pauvre d’Afrique australe, alors que des fonctionnaires manifestent pour demander une revalorisation de leurs salaires.
an 2018 : Gambie - Le 8 février 2018, la Gambie adhère à nouveau au Commonwealth.
an 2018-2021 : Ghana - En 2018, cette nation est également endeuillée par la mort d'un de ses plus célèbres compatriotes, Kofi Annan. Sur le plan économique, le Ghana s'associe avec la Côte d'Ivoire, en 2019, pour obtenir des marchés un prix juste pour le cacao, en suspendant pendant quelques semaines la vente des récoltes 2020-2021. Il cherche à développer le tourisme vers ses terres au sein de la communauté afro-américaine, en mettant l'accent sur la mémoire de la traite négrière. Nana Akufo-Ado, d’inspiration libérale, mise aussi sur le développement de l’esprit d’entreprise. Il incite également la diaspora formée dans les pays occidentaux à revenir au pays, ou à y investir.
an 2018 : Guinée - D'après la Banque mondiale, en 2018, le chômage frappe 80 % des jeunes et près de 80 % de la population active travaille dans le secteur informel. Surtout, 55 % des Guinéens vivent sous le seuil de pauvreté.
an 2018 : Guinée-Bissau - Lors d'une réunion du 30 août 2018 du Conseil de sécurité de l'ONU, les signes d'une amélioration de la situation politique sont soulignés, mais il est rappelé que des points des accords de Conakry restent à réaliser : réforme constitutionnelle et réforme électorale.
an 2018-2020 : Libye - Par contre, la situation reste bloquée entre le Premier ministre Fayez el-Sarraj issu du gouvernement d'accord national (GAN) et le chef de l'Armée nationale libyenne (ANL) du Khalifa Haftar. Des médiations diplomatiques entre ces deux partis sont menées en France, en juillet 2017 à La-Celle-Saint-Cloud, en France toujours en mai 2018 au palais de l'Élysée, puis à Palerme en Italie en novembre 2018, laissant espérer la reprise d'un dialogue. Mais l'assaut militaire déclenché en avril 2019 par les troupes de l'Armée nationale libyenne (ANL) du Khalifa Haftar sur Tripoli, un assaut qui s'enlise ensuite, pulvérise à court terme les espoirs d'un règlement politique. Chacune des forces en présences, le GAN et l'ALN, multiplie les contacts et les alliances avec des puissances extérieures : notamment la Turquie pour le GAN, les Émirats arabes unis,l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Russie pour l'ALN. Une nouvelle initiative de médiation, turco-russe cette fois, pour obtenir la signature à Moscou d’un cessez-le-feu en Libye tourne court, en janvier 2020.
an 2018 - 2023 : Madagascar - Les élections de décembre 2018 portent au pouvoir pour 5 ans Andry Rajoelina. Celui-ci remporte également les élections législatives de mai 2019 et obtient la majoprité absolue à l'Assemblée nationale.
an 2018-2019 : Mali - La situation sécuritaire reste très précaire, avec de nombreuses attaques djihadistes. Les conflits communautaires persistent, occasionnant des centaines de morts, particulièrement dans la région de Mopti. En 2018, l'armée française poursuit ses opérations et particulièrement dans le Liptako Gourma, une zone entre le centre du Mali, le sud-ouest du Niger et le Burkina Faso.
Les djihadistes opèrent une guerre asymétrique : ils procèdent surtout par attaques surprises, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires. Le 23 mars 2019, des miliciens dogons font 157 morts lors du massacre d'Ogossagou, village peul situé près de Bankass, toujours dans le centre du pays. Beaucoup des victimes avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d’autres affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts en 2018 dans le centre du Mali, selon l’ONU. Les troupes françaises sont de plus en plus critiquées localement : poursuivre le combat accroît le risque d’enlisement et de compromission.
an 2018 : Mauritanie - Le premier janvier 2018, la Mauritanie change l'unité de sa monnaie. L'ouguiya passe d'une échelle de 10 à 1, dix ouguiyas deviennent un ouguiya. De nouveaux billets sont émis mais la monnaie conserve le même nom. Avant même l’annonce de la mise en circulation des nouveaux billets, la monnaie mauritanienne se déprécie au marché noir face à l’euro et au dollar, une tendance qui s'aggrave dès l'annonce officielle.
Le 20 mai 2018, le régime durcit la loi sur les partis politiques et un décret ouvre la voie à la dissolution des partis sous-représentés à l'échelle nationale et régionale.
Les élections locales et législatives du 15 septembre 2018 voient la victoire du parti au pouvoir, l'UPR, qui remporte les 13 Conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat, ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale et plus des deux tiers des communes. Le 8 octobre Cheikh ould Baya, député de l'UPR et proche du président, est élu président de l'Assemblée. Le 29 octobre 2018 Mohamed Salem Ould Bechir est nommé Premier ministre et nomme le lendemain un nouveau gouvernement.
Esclavage
Le 12 février 2018, l'ONG Human Right Watch présente à Nouakchott son rapport sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Intitulé « Ethnicité, discrimination et autres lignes rouges : répression à l’encontre de défenseurs des droits humains en Mauritanie » le rapport pointe les difficultés rencontrées par les militants traitant des questions sociales sensibles comme l'esclavage, la discrimination entre communautés ou le passif humanitaire du pays.
Le 25 mars 2018, un rapport sur la répression contre les militants des droits de l'Homme en Mauritanie est publié par Amnesty International. Le rapport avance que 43.000 personnes vivent en situation d'esclavage dans le pays. Amnesty International détaille également la façon dont les militants abolitionnistes et les associations qui dénoncent ces discriminations sont la cible des autorités108. Trois jours plus tard, la cour criminelle de Nouadhibou condamne un homme et une femme à respectivement 20 et 10 ans de prison ferme pour esclavagisme. Une première en Mauritanie.
Le 4 novembre 2018, les États-Unis, constatant le manque de progrès du pays en matière de lutte contre l'esclavage, suspendent la Mauritanie de l'AGOA.
Situation sanitaire et humanitaire
Le 26 juin 2018, la Mauritanie alerte sur des cas de malnutrution sévères touchant plusieurs dizaines d’enfants dans l’est du pays. La région du Hod Ech Chargui, non loin de la frontière avec le Mali, est particulièrement touchée.
En juin 2018, un rapport de l’ONU établi que les trois quarts des mauritaniens vivent dans une extrême pauvreté. Présenté durant la 35e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU par le rapporteur spécial Philip Alston, le rapport pointe les difficultés dans l'accès à l'eau, à l'alimentation, à l'éducation et à la santé de la population.
En décembre 2018, grâce à un don chinois, la capitale Nouakchott se dote d'un véritable réseau d'assainissement, absent jusqu'ici
an 2018-2020 : Nigéria - Entre 2011 et 2018, le bilan humain de ce violent conflit a été estimé à 37 530 morts.
Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest prend également part à l'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria. En août 2018, Mamman Nour, le numéro 2 de l'organisation, accusé d'être trop modéré, est assassiné par d'autres membres de l'EIAO et les partisans d'une ligne plus dure reprennent le dessus. Le groupe s'en prend alors de plus en plus aux civils. Le 26 décembre 2019, le groupe diffuse notamment une vidéo montrant l'exécution par balles de 11 chrétiens.
En novembre 2020, au moins 110 civils sont tués par des jihadistes présumés dans l'État de Borno sans que le massacre ne soit revendiqué par l'un des deux groupes.
an 2018 : Sierra Leone - En 2018, le pays connaît une nouvelle alternance politique entre les deux principaux partis. Le candidat de l’opposition, Julius Maada Bio, ancien militaire de 53 ans, remporte les présidentielles avec 51,81 % des voix, contre 48,19 % pour Samura Kamara, le candidat du parti précédemment au pouvoir, le Congrès de tout le peuple (APC)
an 2018 : Soudan - En 2018, le régime applique en 2018 un plan d'austérité du Fonds monétaire international, transférant certains secteurs des importations au secteur privé. En conséquence, le prix du pain est doublé et celui de l’essence augmente de 30 %. L’inflation atteint les 40 %. Des mouvements étudiants et le Parti communiste soudanais organisent des manifestations pour contester cette politique. Omar el-Bechir réagit en faisant arrêter le secrétaire général du Parti communiste et deux autres dirigeants du parti, et par la fermeture de six journaux.
an 2019 : Afrique du Sud - Cyril Ramaphosa est réélu chef de l’État le 22 mai 2019, à l’issue d’élections générales lors desquelles l’ANC obtient le plus faible score de son histoire (57,5 %), passant sous la barre des 60 % pour la première fois depuis un quart de siècle et payant ainsi les errements et les scandales de l'ère Zuma, son prédécesseur.
Il doit également faire face à une opposition interne au sein de l'ANC, avec un clan resté fidèle à Jacob Zuma, ayant à sa tête le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, et son adjointe, Jessie Duarte. Une vague de xénophobie vis-à-vis les migrants, les « étrangers », secoue également le pays.
an 2019-2022 : Algérie - Depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika et l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, le pays est dirigé par le président Abdelmadjid Tebboune.
an 2019 : Bénin (anc. Dahomey) - En décembre 2019, l’annonce, par le président ivoirien Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron, de la fin du franc CFA pour les huit pays de la CEDEAO, au profit de l'Eco est diversement qualifiée. Décision historique pour certains, d'autres la qualifient d’« arnaque » et de « poudre aux yeux ». Une parité fixe est maintenue pour la future monnaie avec l’euro
an 2019 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - - Dans la nuit du 3 au 4 février 2019, un groupe terroriste attaque la ville de Kaïn dans le département du même nom, au nord de la province du Yatenga. Le bilan est de 14 morts civils. L'armée réagit rapidement, avec des actions contre les groupes terroristes dans le nord-ouest du pays, déclarant avoir alors « neutralisé » 146 terroristes. À la veille du début de l'année de la présidence par le pays du G5 Sahel, l'attaque terroriste porte à près de 300 le nombre d'habitants assassinés par ces groupes depuis 201541. Le jour inaugural du G5 Sahel, mardi 5 février, un détachement de la gendarmerie est attaqué à Oursi, cinq militaires meurent, contre selon l'armée, 21 assaillants tués lors de l'attaque. L'insécurité croissante a entrainé la multiplication des milices. En 2020, le pays compterait près de 4 500 groupes de koglweogo, mobilisant entre 20 000 et 45 000 membres.
Pour faire face au crime organisé (attaques à main armée dans les lieux de travail et habitations, vols d'animaux et autres formes de violences ciblant notamment les populations rurales et périurbaines), des groupes d'autodéfense se sont constitués au sein de certaines communautés. Dénommés « koglwéogo », ils sont indépendants vis-à-vis de l'État, ne rendent comptes à personne. Ils agissent hors de tout cadre légal. Ils ont localement fait reculer la délinquance, mais des exactions commises par certains de leurs membres créent une nouvelle source d'insécurité et de péril pour les droits humains, et affaiblissent encore le système judiciaire légal (déjà critiqué pour son inefficacité par la population et les médias). Au sein de koglwéogo qui, sous prétexte d'une réponse citoyenne à la crise sécuritaire, « s'arrogent le droit d'arrêter, de juger et de sanctionner, par des amendes, sévices corporels et humiliations, au terme de tribunaux populaires expéditifs », de graves violences (torture notamment) sont observées. « De présumés voleurs sont ligotés au pied d'un arbre, fouettés avec des branches enflammées de tamarinier, le tout en public, et ce jusqu'à ce qu'ils avouent leur crime », bafouant les droits humains via une justice expéditive. Selon Amnesty international, « les Koglwéogo ont commis des exactions, telles que des passages à tabac et des enlèvements, poussant ainsi des organisations de la société civile à reprocher à l’État de ne pas agir suffisamment pour empêcher ces violences et y remédier ; une levée de boucliers qui avait amené l'Etat à condamner en septembre 2016 Koglwéogo à 6 mois d'emprisonnement, et 26 autres à des peines allant de 10 à 12 mois de prison avec sursis. Les 29 et 30 mai 2020, plusieurs attaques djihadistes ont fait une cinquantaine de morts à Kompienga48. Dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, une nouvelle attaque djihadiste tue plus de 160 personnes dont « une vingtaine d'enfants » à Solhan, un village situé au nord-est du pays. C'est l'attaque la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso depuis le début des assauts djihadistes, en 2015. En six ans, les violences ont déjà fait plusieurs milliers de morts, plus particulièrement dans les zones proches des frontières avec le Mali et le Niger
an 2019 : Afrique - Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa, Président d'Afrique du Sud, prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi
an 2019 : Cameroun - En 2019, les combats entre les guérillas séparatistes et les forces gouvernementales se poursuivent.
an 2019 : République de Centrafrique - Le 6 février 2019, l'État centrafricain signe avec les 14 principaux groupes armés du pays un nouvel accord de paix négocié en janvier à Khartoum (Soudan). Malgré cet accord, 80 % du territoire restent contrôlés par des groupes armés et les massacres de populations civiles continuent.
an 2019-2020 : Gabon - Le 7 janvier 2019, une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence après un accident vasculaire cérébral, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour ; sur cinq mutins, deux sont tués et les autres arrêtés. Le 12 janvier, un nouveau Premier ministre est nommé, Julien Nkoghe Bekalé. Le pouvoir gabonais connaît une guerre des clans au sommet. Les remaniements ministériels se succèdent entre janvier et décembre 2019, alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé d'Ali Bongo. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée première ministre en juillet 2020.
an 2019 : Gambie - Le 27 août 2019, Dawda Jawara décède, il avait était premier Premier ministre de Gambie entre 1962 et 1970, puis le premier président de la République de Gambie de 1970 à 1994.
an 2019 : Guinée-Bissau - élection présidentielle de fin 2019 voit la défaite du candidat de l'ex-parti unique, au pouvoir depuis 1974, le PAIGC, et la victoire d'Umaro Sissoco Embaló, ancien général et ancien Premier ministre devenu opposant. La confirmation de ce résultat est compliquée, donnant lieu à des allers et retours entre la Commission électorale et la Cour suprême (saisie par le PAIGC), mais c'est la première transition politique qui s'effectue pacifiquement.
an 2019 : Guinée équatoriale - La population de Guinée équatoriale vit dans des conditions précaires. Bata, seconde ville du pays et capitale économique, a été ainsi privée d'eau courante pendant trois semaines en 2019, sans que les autorités s'expliquent sur les difficultés rencontrées.
an 2019 : Mali - Les djihadistes opèrent une guerre asymétrique : ils procèdent surtout par attaques surprises, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires. Le 23 mars 2019, des miliciens dogons font 157 morts lors du massacre d'Ogossagou, village peul situé près de Bankass, toujours dans le centre du pays. Beaucoup des victimes avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d’autres affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts en 2018 dans le centre du Mali, selon l’ONU. Les troupes françaises sont de plus en plus critiquées localement : poursuivre le combat accroît le risque d’enlisement et de compromission.
an 2019 : Iles Maurice - À la lignée des Ramgoolam succède celle des Jugnauth. Pravind Jugnauth remporte les législatives de 2019.
Le 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution demandant au Royaume-Uni de rétrocéder sous six mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos. Ce délai a pris fin le 22 novembre 2019, sans que le Royaume-Uni se conforme à cette résolution, ni à l'avis consultatif formulé en février par la Cour internationale de justice (CIJ) demandant à Londres de mettre fin « dans les plus brefs délais » à son administration des Chagos.
an 2019 : Mauritanie - Le 28 janvier 2019, un projet de loi est voté autorisant un accord de coopération entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite en matière de lutte contre le trafic d'armes et d'êtres humains. L’opposition mauritanienne crie au scandale, pointant le manque de crédibilité du royaume wahhabite en matière du respect des droits de l’homme.
Le 5 mars 2019, à trois mois de la présidentielle, 76 partis politiques sont dissous par décret rendu public par le ministre mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation. Le 9 mai, six candidatures à la présidentielle du 22 juin 2019 sont validées par le Conseil constitutionnel.
Le 20 mai, une série de nominations faites en conseil des ministres dans les semaines qui précèdent l'élection présidentielle sont dénoncées par plusieurs candidats.
Le 1er juillet 2019, la victoire du général Mohamed Ould Ghazouani dès le premier tour, avec 52 % des voix, est proclamée par le Conseil constitutionnel mauritanien, dans un climat délétère, avec une coupure prolongée d'internet et un déploiement des unités d’élite de l’armée, de la garde et de la police anti-émeute dans toute la capitale, Nouakchott. L'opposition dénonce de multiples irrégularités dans le déroulement du scrutin et qualifie la déclaration de victoire du candidat du pouvoir le soir du premier tour de «nouveau coup d'État».
Le 8 août 2019, le président Ghazouani nomme son premier gouvernement, dirigé par le premier ministre désigné le 3 août, Ismael Ould Bodé Ould Cheikh Sidiya.
Le 19 mars 2019, la police mauritanienne refoule une délégation d'Amnesty International à son arrivée à l'aéroport de Nouakchott
Le 22 mars 2019, les blogueurs Abderrahmane Weddady et Cheikh Ould Jiddou, connus pour dénoncer les atteintes aux droits de l'Homme en Mauritanie sont emprisonnés. Amnesty International explique qu'« Ils ont critiqué la corruption qui régnerait au sein du gouvernement dans des commentaires sur Facebook ». Les deux blogueurs avaient repris sur leurs blogs des articles publiés par des médias arabes faisant état d’un placement présumé de deux milliards de dollars aux Émirats arabes unis par un proche du chef de l’État. Amnesty International qualifie par ailleurs leur détention d’illégale. D'autres ONG comme Reporters Sans Frontières et Human Right Watch dénonceront à leur tour l'arrestation des deux blogueurs.
Le 5 juillet 2019, une vingtaine de journalistes manifestent devant le ministère la Communication et demandent la libération de leur confrère Ahmed Ould Wedia, interpellé chez lui trois jours auparavant.
En mai 2019, la France et la Mauritanie signent un accord de financement d'un montant de 4,4 milliards d'ouguiyas (11 millions d'euros), afin de financer des projets hydrauliques destinés à améliorer les conditions de vie de la population.
Esclavage
Le 28 janvier 2019, un projet de loi est voté autorisant un accord de coopération entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite en matière de lutte contre le trafic d'armes et d'êtres humains. L’opposition mauritanienne crie au scandale, pointant le manque de crédibilité du royaume wahhabite en matière du respect des droits de l’homme.
Les séquelles de l'esclavage touchent particulièrement la population Haratine, qui faute d'accès à l'éducation concentre 85 % des analphabètes du pays
Situation sanitaire et humanitaire
En mai 2019, la France et la Mauritanie signent un accord de financement d'un montant de 4,4 milliards d'ouguiyas (11 millions d'euros), afin de financer des projets hydrauliques destinés à améliorer les conditions de vie de la population.
an 2019 : Mozambique - Le président Filipe Nyusi est réélu en octobre 2019 pour un deuxième mandat de cinq ans avec 73 % des suffrages. Son parti, le FRELIMO, remporte 184 des 250 sièges à l’Assemblée nationale et dirige l’ensemble des dix provinces du pays. Ce scrutin a été manipulé comme les précédents pour en garantir le résultat : redécoupage de la carte électorale pour gonfler l’importance des bastions du pouvoir, mise à disposition constante des moyens de l’Etat pour la campagne du parti au pouvoir, tracasseries pour les opposants, usage de la violence, etc., le FRELIMO montre une volonté d’hégémonie. Ceci pose aussi la question d’un processus de paix jamais arrivé à son terme depuis le premier accord avec l’ancienne rébellion de la Résistance nationale mozambicaine (RENAMO), en 1992. Ossufo Momade a été le candidat de la RENAMO, mouvement affaibli par la mort de son chef historique, Afonso Dhlakama, en 2018.
Le Mozambique peut devenir l'un des grands producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, avec d'importantes réserves, et devient à ce titre un pays courtisé. Les ressources en gaz naturel devraient être exploitées en particulier dans la province de Cabo Delgado d’ici à cinq ans. Total, notamment, a finalisé son entrée fin septembre 2019 dans l’un des deux projets majeurs, Mozambique LNG.
an 2019 : Namibie - En 2019 a lieu L'élection présidentielle namibienne de 2019, en même temps que les élections législatives. Le président sortant Hage Geingob, de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (abrégée en SWAPO) est réélu avec un score, en baisse, de 56 % des suffrages. La SWAPO est au pouvoir depuis 1990. La participation au scrutin présidentiel a été de 60 %. Les autres candidats ont été Panduleni Itula, candidat dissident de la SWAPO qui obtient 30 % des suffrages. Il est en tête dans la capitale du pays. Le chef de l’opposition, McHenry Venaani, ne récolte que 5,4 %. La proximité passée de son parti, le Mouvement démocratique populaire (PDM) (ex-Alliance démocratique de la Turnhalle), avec le régime de l'apartheid en Afrique du Sud de l’apartheid, continue à être un repoussoir pour une grande part de l’électorat. Un nouveau parti d’opposition émerge, le Mouvement des sans-terre (LPM) de Bernadus Swartbooi : Bernadus Swartbooi réunit 2,8 % des suffarges exprimés.
La SWAPO est critiquée pour des scandales de corruption et ses résultats politiques sont affectés aussi par la situation économique et l'importance du chômage. Le secteur minier reste important. Mais la chute des cours des matières premières a réduit les recettes. Par ailleurs, une sécheresse persistante depuis plusieurs saisons a contribué aussi à faire reculer le produit intérieur brut (PIB) deux ans de suite, en 2017 et en 2018. « Les moyens de subsistance d’une majorité de Namibiens sont menacés, notamment ceux qui dépendent des activités de l’agriculture », n'a pu que déplorer la première ministre Saara Kuugongelwa-Amadhila. Le chômage touche un tiers de la population.
an 2019 : Soudan - En 2019, un vaste mouvement de protestation contre le régime se forme dans les villes de l’extrême nord du pays, en particulier autour d'Atbara, agglomération ouvrière et fief du syndicalisme soudanais. Les manifestants réclament initialement de meilleures conditions de vie (plus de vingt millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté), puis, alors que la répression s’accentue, la démission du président.
Le 11 avril 2019, Omar el-Bechir est renversé par l'armée. Le ministre de la Défense Ahmed Awad Ibn Auf annonce la mise en place d'un gouvernement de transition pour deux ans jusqu'à de nouvelles élections libres.
Le 12 avril 2019, au lendemain de la destitution du président, le Conseil militaire de transition déclare que le futur gouvernement sera un gouvernement civil en promettant un dialogue entre l'armée et les politiciens soudanais. L'armée entame alors des discussions avec les autorités civiles d'opposition et les organisations représentant les manifestants. Le 3 juin 2019, alors que les négociations piétinent et que les manifestants campent devant le QG de l'armée depuis près de deux mois, l'armée et la milice des Forces de soutien rapide tirent sur la foule pour tenter de déloger les manifestants causant un massacre. Le 4 juin 2019, le chef du Conseil militaire de transition, Abdel Fatah al-Burhan, annonce la fin des négociations avec les civils et promet la tenue d'élections d'ici 9 mois.
Le 21 août, à la suite d'un accord, le Conseil militaire de transition devient le Conseil de souveraineté. Il maintient les président et vice-président sortants en place mais dispose de membres civils. Abdallah Hamdok est nommé Premier ministre. Il annonce la composition d'un gouvernement de transition début septembre 2019, un gouvernement composé de dix-huit membres dont quatre femmes, notamment Asma Mohamed Abdallah une diplomate expérimentée qui devient ministre des affaires étrangères : « La première priorité du gouvernement de transition est de mettre un terme à la guerre et de construire une paix durable », est-il précisé, faisant référence aux conflits et rébellions qui pèsent sur le Darfour, le Nil Bleu et le Kordofan du Sud.
an 2020 : UNION AFRICAINE - Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud, prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi.
an 2020 : Burundi - La situation économique continue à se dégrader. Début 2020, le général Évariste Ndayishimiye est désigné comme candidat pour l’élection présidentielle du 20 mai 2020 par le parti au pouvoir, pour succéder à Pierre Nkurunziza. Il remporte l'élection présidentielle du 20 mai 2020, en obtenant 68,72 % des voix et devance très largement le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, président du Conseil national pour la liberté (CNL), qui réunit 24,19 % des voix.
an 2020 : Cameroun - Au cours de l'année 2020, de nombreuses attaques terroristes - dont beaucoup ont été menées sans revendication - et les représailles du gouvernement ont fait couler le sang dans tout le pays. Depuis 2016, plus de 450 000 personnes ont fui leurs foyers. Le conflit a indirectement conduit à une recrudescence des attaques de Boko Haram, l'armée camerounaise s'étant largement retirée du nord pour se concentrer sur la lutte contre les séparatistes ambazoniens. Paul Biya est réélu pour un septième mandat en 2018, dans un scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition. Il lance un « grand dialogue national », mais aucune avancée décisive n'en ressort sur le conflit dans les régions anglophones. Paul Biya fait libérer des détenus, mais les leaders du mouvement restent en prison.
Les élections législatives et municipales du 9 février 2020 entraînent un regain de violence dans les régions anglophones du Cameroun, autour de la tentative d'indépendance de l'Ambazonie. Les groupes armés séparatistes promettent des représailles à ceux qui iraient voter, en réaction le gouvernement central du Cameroun augmente ses effectifs militaires dans la zone. Dans les deux semaines précédant les élections, selon Human Rights Watch, les rebelles séparatistes enlèvent plus d'une centaine de personnes dans les deux régions anglophones, tandis que les forces de sécurité commettent de nombreux abus de pouvoir. Le 7 février 2020, c'est depuis sa cellule à la prison centrale de Yaoundé que Sisiku Julius Ayuk Tabe, président du gouvernement intérimaire d’Ambazonie, déclare, qu’ils sont plus que jamais engagés dans une indépendance totale ou une résistance à jamais.
Les violences se poursuivent après les élections. Ainsi, le 16 février 2020, 22 civils dont 14 enfants et 1 femme enceinte sont massacrés à Ntumbaw, un village du Nord-Ouest. l'opposition camerounaise (surtout le Mouvement pour la renaissance du Cameroun) et les ONG locales accusent l'Armée et le gouvernement d'avoir perpétré le massacre, dans un contexte de répression de la tentative de sécession de l'Ambazonie.
Le 21 avril 2020, le régime camerounais admet sa responsabilité, expliquant que l'Armée et un groupe d'autodéfense allié avaient attaqué des indépendantistes, tuant 5 d'entre-eux, puis s'étaient rendus compte que leur assaut avait également tué accidentellement les femmes et les enfants, et avaient alors décidé de déclencher l'incendie pour tenter de masquer leurs faits.
Le 2 juillet 2020, déjà très impliquée lors de la tenue des assises du « grand dialogue national », l'Église catholique a de nouveau joué les facilitateurs lors de la récente prise de contact entre les séparatistes anglophones emprisonnés à Yaoundé et des émissaires du gouvernement. C'est d'ailleurs au centre épiscopal de Mvolyé, dans la capitale camerounaise, que cette rencontre s'est tenue. Pour l'occasion, Julius Ayuk Tabé, le président autoproclamé de l'Ambazonie et quelques-uns de ses partisans avaient été spécialement extraits de leurs cellules pour entamer des discussions avec les autorités du gouvernement. Entre eux, un témoin privilégié : Monseigneur Andrew Nkea Fuanya, archevêque de Bamenda. Cette nouvelle implication de l'Église catholique pour tenter de rapprocher les parties en conflit de la crise dans les régions anglophones a été plutôt bien perçue par nombre d'observateurs, alors que jusqu'ici une sorte de crise de confiance semble installée de part et d'autre entre protagonistes. D'autant que dix mois après la tenue du Grand dialogue national, les résolutions qui en avaient été issues tardent à être mises en application. Notamment le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le 20 août 2020, Le procès en appel du leader séparatiste anglophone Sisiku Ayuk Tabe et de ses neuf co-accusés a été une nouvelle fois reporté. Une partie des magistrats affectés à ce dossier ayant été récemment mutés, la cause a été renvoyée au 17 septembre 2020.
Le 17 septembre 2020, Une Cour d’appel camerounaise a confirmé, la condamnation à la prison à vie prononcée en 2018 contre Sisiku Ayuk Tabe. Sisiku Ayuk Tabe avait été jugé coupable « sécession » et « terrorisme », en lien avec le conflit dans les régions anglophones du Cameroun. Il s’était autoproclamé président de l’Ambazonie, nom donné par les indépendantistes anglophones à l’ancien Cameroun du Sud britannique, non reconnu internationalement. Lors de l’audience la Cour d’appel a estimé que le tribunal militaire qui avait condamné Sisiku Ayuk Tabe et ses coaccusés le 20 août 2019 a bien dit le droit. Elle a donc confirmé la prison à vie pour les accusés, assortie d’une amende de 250 milliards de francs CFA.
Dans les deux régions à majorité anglophones du Cameroun, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, des indépendantistes s’opposent violemment à l’armée depuis 2017 et les deux camps sont régulièrement accusés d’exactions contre des civils par des ONG. Au moins 3 000 personnes ont perdu la vie et plus de 700 000 autres ont dû fuir leur domicile, selon les Nations unies.
an 2020-2021 : République de Centrafrique - En décembre 2020, des mercenaires russes du groupe Wagner s'engagent aux côtés de l'armée centrafricaine, des forces de la MINUSCA et des forces rwandaises contre les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement qui veulent prendre Bangui et empêcher la tenue des élections présidentielle et législatives. Le 31 mars 2021, le Groupe de travail des Nations unies sur les mercenaires a dit sa préoccupations sur des violations répétées des droits de l'Homme par les mercenaires du groupe Wagner. Une enquête de RFI a collecté de nombreux indices, dont des documents confidentiels et des témoignages allant en ce sens. Le gouvernement centrafricain a réagi en mettant en place une commission d'enquête. La Russie a dénoncé « de fausses nouvelles » qui « servent les intérêts des malfaiteurs qui complotent pour renverser le gouvernement ».
an 2020 : Afrique Côte d'Ivoire - En novembre 2020, Alassane Ouattara est réélu pour un troisième mandat avec 94,27 % des voix lors d'un scrutin très critiqué puisque l'opposition avait demandé à le boycotter, contestant la constitutionnalité d'un troisième mandat. Finalement, seuls 53,90 % des électeurs se sont rendus aux urnes pour élire le président sortant.
an 2020-2021 : Éthiopie - les relations entre le gouvernement fédéral et celui de la région du Tigré se dégradent rapidement après les élections. Le 4 novembre 2020, le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) lance une attaque contre des bases des Forces de défense nationale éthiopiennes à Mekele, la capitale du Tigré, et à Dansha, une ville de l’ouest de la région. La guerre du Tigré escalade et se poursuit depuis cette date.
Les Forces de défense tigréennes ont repris la capitale régionale, Mekele, forçant le gouvernement éthiopien à décréter, le lundi 28 juin 2021, un « cessez-le-feu unilatéral »
Le 28 juin 2021, sept mois après avoir dû abandonner Mekele face aux assauts de l’armée gouvernementale éthiopienne, les forces du Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) reprennent le contrôle de la capitale provinciale du Tigré. Dans cette région du nord de l’Éthiopie, en guerre depuis novembre 2020, les derniers jours ont été le théâtre d’un spectaculaire renversement de situation militaire, forçant le gouvernement éthiopien à décréter un cessez-le-feu.
En marge du conflit au Tigré éthiopien, l’armée soudanaise tente de reprendre la main sur le triangle d’Al-Fashaga, un territoire agricole disputé par L’Éthiopie et le Soudan, pays de la Corne de l'Afrique. C’est un bras de fer qui menace de dégénérer, dans le sillage du conflit en cours dans la province éthiopienne du Tigré. En jeu : le triangle d’Al-Fashaga, soit 250 km2 de terres fertiles coincées entre les rivières Tekezé et Atbara, au cœur d’une dispute historique entre le Soudan et l’Éthiopie.
Début novembre 2021, plusieurs États occidentaux ordonnent à leurs nationaux de quitter l'Éthiopie, en prévision d'une éventuelle prise d'Addis-Abeba par le TPLF accompagnée d'exactions tribales. À ce stade le conflit a coûté, outre des milliers de morts, le déplacement forcé de plus de deux millions de personnes et un risque de famine pour cinq millions.
an 2020 : Guinée - En mars 2020, en dépit des manifestations et du désaccord de la grande partie de la population et de l'opposition et ce malgré une loi stipulant qu'aucun président ne peut se présenter pour plus 2 mandats consécutifs, Alpha Condé modifie la Constitution pour pouvoir légalement se représenter. Il est alors officiellement candidat pour un troisième mandat pour les élections s'étant tenues en octobre 2020.
an 2020 : Guinée-Bissau - L'investiture d'Umaro Sissoco Embaló a lieu le 27 février 2020. La passation de pouvoir s'effectue ensuite au palais présidentiel. Nuno Gomes Nabiam est nommé Premier ministre le lendemain, le 28 février 2020. Mais une incertitude subsiste : une partie des députés investissent comme président, le 28 février au soir, le président de l’Assemblée nationale, Cipriano Cassama, par intérim. Pour eux, l'investiture de Umaro Sissoco Embalo n'est pas légale.
an 2020 : Libéria - Le 1er octobre 2020, le Président Weah a procédé à un remaniement de son gouvernement et a formé un gouvernement d’union nationale pour faire face notamment aux défis sociaux, économiques et sanitaires auxquels le pays est confronté.
La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2023.
an 2020 : Mali - En 2020, dans un contexte d'élections législatives contestées et de manifestations massives menées par le M5-RFP, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrêté par des mutins et démissionne sur les ondes de l'ORTM, à minuit le 19 août 2020. Quelques heures plus tard, le Comité national pour le salut du peuple prend le pouvoir. Il est présidé par Assimi Goïta et dispose des services d'Ismaël Wagué comme porte-parole. Ce coup d'État est condamné de manière unanime par la communauté internationale.
Assimi Goïta en tant que président du CNSP la junte militaire qui a renversé Ibrahim Boubacar Keîta le 18 août 2020.
Bah N'Daw après avoir été designé par le CNSP Président de la Transition le 21 septembre 2020 puis renversé par un coup d'État.
an 2020 : Iles Maurice - Le 15 janvier 2020, Pravind Jugnauth premier ministre des île Maurice, était à Londres pour assister à un sommet sur les investissements de la Grande-Bretagne en Afrique. il s'est entretenu avec les chefs des gouvernements de l'Afrique du Sud, du Kenya, de Côte d'Ivoire et du Mozambique. Il a indiqué que : « Port-Louis étudiait la possibilité d’entamer des poursuites contre des responsables britanniques devant la Cour pénale internationale pour crime contre l’humanité ».
an 2020 : Mozambique - Depuis deux ans un groupe d’islamistes armés a déclenché une insurrection dans cette région du nord du pays. Les combats se déroulent à quelques kilomètres des futures installations gazières et le port de Mocimboa da Praia est pris par les insurgés en août 2020.
an 2020 : Namibie - Le 21 mars 2020, la Namibie célèbre son trentième anniversaire d'indépendance.
an 2020 : Nigéria - En octobre 2020, le pays est secoué par d'importantes manifestations protestant contre l'oppression et la brutalité policières – connues nationalement, et mondialement, sous le nom de #EndSARS (abréviation de “End Special Anti-Robbery Squad”). Ce mouvement populaire est violemment réprimé par les autorités.
an 2020 : Somalie - Le pays se mobilise également début 2020 contre une invasion de criquets pèlerins qui touche la Corne d'Afrique et plusieurs régions d'Afrique de l'Est.
an 2020 - 2021 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - John Magufuli acquiert une popularité, notamment grâce à sa lutte contre le gaspillage de l'argent public et contre la corruption, mais fait preuve également de dérives autoritaires, contre ses opposants, contre les libertés individuelles, contre la presse, etc. Il est réélu pour un second mandat en octobre 2020. Il meurt en fonction en mars 2021 et sa vice-présidente Samia Suluhu lui succède.
an 2021 : Bénin (anc. Dahomey) - Le 11 avril 2021, Patrice Talon est réélu Président de la République.
an 2021 : Cap Vert - En octobre 2021, se déroule l'élection présidentielle cap-verdienne de 2021, remportée par José Maria Neves
an 2021 : Congo Brazzaville - Fin décembre 2019, Denis Sassou-Nguesso est à nouveau désigné candidat de son parti (le PCT) à la présidentielle de 2021. Le 23 mars 2021, la commission électorale annonce que Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 88,57 % (résultats provisoires officiels). La participation est estimée à 67,55 % et son principal opposant, Guy Brice Parfait Kolélas, (mort de la Covid-19 le lendemain de l'élection), recueille 7,84 % des voix. Ses opposants annoncent former des recours. Le 6 avril 2021, la Cour constitutionnelle de la République du Congo a entériné la réélection du président Denis Sassou-Nguesso au scrutin du 21 mars, après avoir rejeté les recours de l'opposition.
an 2021 : République de Djibouti - Le 9 avril 2021, Ismaël Omar Guelleh a été réélu, avec 98,58 % des voix, selon les chiffres officiels provisoires.
an 2021 : Gambie - Adama Barrow est réélu président de la République le 5 décembre 2021.
an 2021 : Guinée - Le 5 septembre 2021, un coup d'État des forces spéciales, dirigées par Mamadi Doumbouya, mène à la capture d'Alpha Condé. Une junte prend le pouvoir.
Mamadi Doumbouya devient alors président du Comité national du rassemblement pour le développement et président de la Transition.
an 2021-2022 : Libye - Le 24 décembre 2021 devraient avoir lieu une élection présidentielle et en janvier 2022 des élections législatives.
an 2021 : Mali - Le 24 mai 2021, le président de transition Bah N'Daw et le premier ministre de transition Moctar Ouane sont interpellés et conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta démet N'Daw et Ouane de leurs fonctions. Suite à ce coup d'Etat, la France décide de mettre un terme à l'Opération Barkhane et appuie le développement international de la Task Force Takuba notamment pour sécuriser la région du Liptako
Assimi Goïta (Vice-président) de facto président de la transition après l'arrestation et la démission du Premier Ministre Moctar Ouane et du président de la transition Bah N'Daw par Assimi Goïta le lundi 24 mai 2021 et le mardi 25 mai 2021.
an 2021 : Namibie - En mai 2021 l’Allemagne et la Namibie sont parvenus à se mettre d’accord sur un document qui établit les responsabilités de l'Allemagne ex-puissance coloniale durant le Génocide des Héréro et des Namas.
an 2021-2022 : Somalie - En 2021 et 2022, le pays connait une importante sécheresse, provoquant des problèmes de disette importante pour près de 7,8 millions de personnes soit presque 50 % de la population.
an 2021 : Togo - En 2021, David Ekoué Dosseh, un professeur de médecine à l'origine de Togo Debout, la « plateforme citoyenne » créée le 22 septembre 2017, est sur la liste établie par le collectif Forbidden Stories de 300 Togolais espionnés par le logiciel Pegasus.
an 2021 : Soudan - Une tentative de putsch a lieu le 21 septembre 2021. Les responsables sont arrêtés.
Un coup d'État militaire a lieu en octobre 2021, menant à l'arrestation de civils dont le premier ministre. Le 25 octobre, des membres de l'armée tirent sur des civils refusant le putsch.
an 2021 : Tchad - Le 20 avril 2021, un Conseil militaire de Transition dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, alors général de l'armée tchadienne et fils du président Idriss Déby Itno, prend le pouvoir à la suite du décès de ce dernier, dont on soupçonne que la mort soudaine soit liée à un assassinat non ciblé lié à des affrontements avec le Fact, un groupe armé libyen. Cette prise du pouvoir ne respecte pas la Constitution de la République du Tchad, promulguée le 4 mai 2018, qui est alors suspendue par l'Armée, en même temps que l'Assemblée nationale est dissoute.
Au moment de prendre le pouvoir, l'armée promet que des élections libres et démocratiques seront organisées au Tchad sous dix-huit mois, après une période de transition et d'apaisement.
an 2021 : Togo - En 2021, David Ekoué Dosseh, un professeur de médecine à l'origine de Togo Debout, la « plateforme citoyenne » créée le 22 septembre 2017, est sur la liste établie par le collectif Forbidden Stories de 300 Togolais espionnés par le logiciel Pegasus.
an 2021-2022 : Tunisie - Crise politique de 2021-2022
Le 25 juillet 2021, invoquant l'article 80 de la Constitution, Kaïs Saïed limoge le gouvernement, annonce la suspension de l'Assemblée des représentants du peuple — dont il lève l'immunité des membres —, la formation d'un nouveau gouvernement — qui sera responsable devant lui — et sa décision de gouverner par décrets ; il indique également qu'il présidera le parquet. Ennahdha dénonce aussitôt un « coup d'État ». Cette qualification de coup d'État est partagée par des analystes politiques et juristes, notamment en ce qui concerne la suspension des travaux parlementaires.
Le 22 septembre, il confirme par décret le prolongement des décisions ainsi que la dissolution de l'Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, et décide de suspendre les salaires et les bénéfices accordés au président de l'Assemblée des représentants du peuple et ses membres, et s'octroie le droit de gouverner par décret, récupérant de facto le pouvoir législatif. Le 13 décembre, il annonce la tenue d'un référendum constitutionnel, prévu à l'été 2022.
Le 30 mars 2022, après la réunion virtuelle de 120 députés pour voter la fin des mesures d'exception en vigueur, Kaïs Saïed dissout le Parlement, ce qu'interdit pourtant la Constitution durant la période où l'état d'exception est appliqué, et menace les députés de poursuites judiciaires.
an 2022 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Le 23 janvier 2022 a lieu un coup d'État. Les putschistes, rassemblés sous la bannière du « Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration » et menés par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, annoncent la fermeture des frontières terrestres et aériennes à partir de minuit, la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale ainsi que la « suspension » de la Constitution. Le 24 janvier 2022, certains médias locaux et internationaux relaient une information selon laquelle le président de Faso serait détenu par des soldats mutins. D'autres médias assurent que c'est une information erronée. Le 1er mars 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, signe un plan pour entamer une transition de trois ans vers la démocratie.
an 2022 : République de Centrafrique - En avril 2022, une "opération" militaire menée par l’État centrafricain et des paramilitaires russes cause la mort de dizaines de civils dans les villages de Gordil et Ndah, au Nord-Est de la capitale. Suite à ce massacre, l'ONU indique ouvrir une enquête.
an 2022 : Érythrée - Le 2 mars 2022, l'Érythrée est l'un des cinq pays de l'ONU votant contre la résolution ES-11/1 ayant pour but de sanctionner et condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
an 2022 : Guinée - mars 2022 En Guinée, déchu il y a plus six mois par un coup d’état militaire le 5 septembre 2021, Alpha Condé ne prendra plus la tête du parti qu’il a lui-même créé dans la clandestinité au début des année 1990. En attendant le prochain président du RPG, un intérimaire a été porté à la tête de l’ancien parti au pouvoir. En réunion extraordinaire, ce jeudi 10 mars 2022, les cadres du parti ont désigné l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana comme président par intérim.
mai 2022 Transition prolongée en Guinée : l’opposition dénonce une « décision unilatérale » et une « durée injustifiable ». Le colonel Mamadi Doumbouya, auteur du putsch contre Alpha Condé, prévoit un délai de trente-neuf mois avant d’organiser d’éventuelles élections.
an 2022 : Lesotho - Les élections législatives lésothiennes de 2022 ont lieu en septembre 2022 afin de renouveler les membres de l'assemblée nationale du Lesotho.
Le Lesotho est une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement bicaméral dont la chambre basse, l'assemblée nationale est composée de 120 députés élus pour un mandat de cinq ans au suffrage direct. Son mode de scrutin, mixte, s'apparente au système électoral allemand, bien que les électeurs n'aient qu'un seul vote pour exprimer leur choix. Sur les 120 sièges, 80 sont pourvus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales uninominales. L'ensemble des votes pour chacun des partis est ensuite regroupé au niveau national, nonobstant ceux des indépendants, et les quarante sièges restants répartis entre eux de manière à rapprocher la composition de l'assemblée à celles des résultats en part des voix.
an 2022 : Mali - Les autorités maliennes responsables du coup d'Etat s'engagent auprès de la Communauté internationale à « organiser des élections présidentielles et législatives avant le 27 février 2022 ». Cet engagement non tenu et le partenariat des autorités maliennes avec le groupe paramilitaire russe Wagner conduisent le 17 février 2022 à l'annonce du retrait de la Task Force Takuba.
Le 16 mai 2022, le gouvernement d'Assimi Goïta révèle avoir réussi à déjouer un coup d'Etat mené par des militaires maliens dans la nuit du 11 au 12 mai. Selon les sources officielles du gouvernement, cette tentative de putsch avortée a été « soutenue par un Etat occidental »
an 2022 : Afrique - Élections à venir dans l'année : dans les prochains mois se tiendraient des processus électoraux cruciaux en République démocratique du Congo, en Angola, à Sao-Tomé, en Guinée équatoriale ainsi qu’au Tchad.
an 2023 : Libéria - La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2023.
an 2023 :
Histoire contemporenne
Histoire contemporenne
an 2000 : Burundi - Le 28 août 2000 est signé à Arusha, en Tanzanie, sous l'égide de Nelson Mandela un accord de paix.
an 2000 : Congo Kinshasa - En mai-juin 2000 de nouveaux combats rwando-ougandais ont lieu à Kisangani.
an 2000 : Côte d'Ivoire - Laurent Gbagbo, vainqueur des élections de 2000, et porté au pouvoir par les manifestants devant le refus de Guéï de reconnaître le résultat des élections.
Robert Guéï se proclame vainqueur des élections d'octobre 2000, dont la candidature d'Alasaane Ouattara du RDR avait été exclue pour doutes sur la nationalité, ainsi que celle de Bédié pour ne pas avoir consulté le collège médical désigné par le Conseil constitutionnel. Des manifestations mêlant le peuple et l'armée imposent Laurent Gbagbo, dont la victoire électorale est finalement reconnue. Son parti, le FPI, remporte les législatives de décembre avec 96 sièges (98 au PDCI-RDA), le RDR ayant décidé de les boycotter. Le RDR participe aux élections municipales et sort vainqueur dans la majorité des villes, dont Gagnoa, la principale ville du Centre Ouest du pays, région d'origine de Laurent Gbagbo.
an 2000 : Eswatini (Swaziland) - Depuis 2000, le Swaziland réclame plusieurs kilomètres carrés de territoires à l'Afrique du Sud au prétexte qu'ils leur auraient été volés par les colons blancs au XIXe siècle et annexés illégalement à l'Afrique du Sud. Le royaume swazi base sa réclamation sur un engagement du gouvernement sud-africain signé en 1982 par lequel il s'engageait à rétrocéder au Swaziland plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoires sud-africains en échange de la collaboration dans la lutte anti-terroriste du royaume swazi. Ces territoires situés principalement au Mpumalanga et dans le KwaZulu-Natal et concernent les villes de Nelspruit, Malelane, Barberton, Ermelo, Piet Retief, Badplaas et Pongola. En novembre 2006, Mswati III prit la décision de porter l'affaire devant la cour internationale de La Haye
an 2000-2005 : Ghana - Lors de l'élection présidentielle de décembre 2000, Jerry Rawlings approuve le choix de son vice-président, John Atta-Mills, comme le candidat de la décision du NDC, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d’État en 1981, puis élu en 1992 et en 1996, n'a pas de briguer un troisième mandat, selon la constitution. Il quitte le pouvoir à cinquante-trois ans, après une vingtaine d'années durant lesquelles il a joué les premiers rôles. Mais John Kufuor, candidat du Nouveau Parti patriotique (NPP), parti d'opposition, remporte l'élection, et devient le président le 7 janvier 2001, ce résultat marquant une alternance politique. Le vice-président est Aliu Mahama. Kufuor remporte une autre échéance présidentielle en 2004. Pendant quatre ans, il a su préserver une stabilité économique et politique, et réduire l'inflation.
Durant les deux mandats présidentiels de Kufuor, plusieurs réformes sociales sont menées, telles que la réforme du système d'Assurance Nationale de Santé du Ghana. En 2005, est mis en place un programme d'alimentation en milieu scolaire, avec la fourniture d'un repas chaud gratuit par jour dans les écoles publiques et les écoles maternelles dans les quartiers les plus pauvres. Bien que certains projets sont critiqués comme étant inachevés ou non-financés, les progrès du Ghana sont remarqués à l'échelle international.
an 2000-2003 : Guinée-Bissau - Kumba Ialá est élu président en 2000 mais renversé par un coup d'État sans effusion de sang en septembre 2003. D'ethnie ballante, celui-ci était accusé de favoriser sa communauté et s'était discrédité en dissolvant en 2002 l'Assemblée nationale tout en repoussant sans cesse de nouvelles élections législatives. Le coup d'État ne suscita que peu de protestations tant de la part de la population que de la communauté internationale.
an 2000 - 2003 : Libye - En dépit des sanctions occidentales la Libye maintient une politique internationale de tradition panafricaniste. Elle prend en charge l'essentiel des couts de construction d'un satellite de communication africain, s'engage auprès de l'UNESCO à financer le projet de réécriture de l'Histoire générale de l'Afrique, à payer les cotisations des États défaillants auprès des organisations africaines et à briser le monopole des compagnies aériennes occidentales en Afrique à travers la création de la compagnie Ifriqyiah en 2001.
Dans les années 2000, grâce notamment au contexte de la guerre contre le terrorisme suivant les attentats du 11 septembre 2001, suivi en 2003 par l'arrêt du programme nucléaire de la Libye visant à acquérir la bombe atomique, la Libye de Kadhafi connaît un net retour en grâce diplomatique. Elle renoue de bonnes relations avec le monde occidental, qui voit en elle un allié contre le terrorisme islamiste; la lutte contre l'immigration illégale fournit en outre un argument à la Libye pour entretenir des liens d'alliance avec les pays de l'Union européenne, notamment l'Italie, son principal partenaire commercial. Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de Mouammar Kadhafi, fait figure de réformateur au sein du régime, pour le compte duquel il multiplie les contacts dans le monde occidental, ce qui le fait apparaître comme un « ministre des affaires étrangères bis », souvent décrit comme un potentiel successeur de son père.
an 2000-2019 : Iles Maurice - Anerood Jugnauth redevient Premier ministre après les élections de septembre 2000, puis après trois ans, comme convenu, cède son poste à son allié du Mouvement militant mauricien, Paul Bérenger, dirigeant de la principale formation d'opposition de gauche depuis l'indépendance. Paul Bérenger reste Premier ministre pendant moins de deux ans, puis, dans une nouvelle alternance, Navin Ramgoolam revient au pouvoir pendant neuf ans et demi, jusqu'à décembre 2014, passant alors le relais à nouveau à Anerood Jugnauth, jusqu'à janvier 2017. Le 21 janvier 2017, il annonce sa démission lors d'une allocution télévisée. Il est remplacé par son fils, ministre des Finances Pravind Jugnauth. À la lignée des Ramgoolam succède ainsi celle des Jugnauth. Pravind Jugnauth remporte les législatives de 2019.
Le 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution41 demandant au Royaume-Uni de rétrocéder sous six mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos. Ce délai a pris fin le 22 novembre 2019, sans que le Royaume-Uni se conforme à cette résolution, ni à l'avis consultatif formulé en février par la Cour internationale de justice (CIJ) demandant à Londres de mettre fin « dans les plus brefs délais » à son administration des Chagos.
an 2000-2005 : Ouganda - En mars 2001, Museveni fut réélu dès le premier tour avec 69,3 % des voix alors que son rival Kizza Besigye en obtint 27,8 %.
Malgré un referendum similaire ayant eu lieu en 2000, lors duquel un retour au multipartisme avait été rejeté par 90,7 % des votants, un nouveau referendum, organisé en juillet 2005, vit la population approuver à 92,5 % un abandon du système sans partis pour un retour au multipartisme.
an 2000 : Rwanda - Après la prolongation de la période de transition, plusieurs changements de premiers ministres, la démission du président de l'assemblée nationale, Pasteur Bizimungu démissionne en 2000. Paul Kagame est élu président de la République par l'assemblée nationale de transition.
an 2000 : Sénégal - Mars 2000 : Le président sortant, Abdou Diouf, est battu au deuxième tour des élections présidentielles par Abdoulaye Wade. L’arrivée au pouvoir de Me. Wade met un terme à 40 ans de pouvoir du Parti Socialiste. Porté par son slogan “SOPI” (“changement” en wolof), l’opposant de longue date Abdoulaye Wade, chef de file du Parti démocratique sénégalais, remporte l’élection présidentielle du 19 mars 2000, avec 58,5% des suffrages au second tour, devant le président sortant Abdou Diouf.
Le 9 décembre 2000 le Sénat et le Conseil économique et social sont supprimés.
an 2000-2003 : Somalie - Le 26 août 2000, le Parlement de transition en exil élit un nouveau président en la personne de Abdiqasim Salad Hassan, dans un contexte particulièrement difficile. Le pays reste aux prises avec des rivalités claniques. Après diverses tentatives infructueuses de conciliation, une conférence de réconciliation aboutit en juillet 2003 à un projet de charte nationale prévoyant le fédéralisme et mettant sur pied des institutions fédérales de transition.
an 2000-2003 : Togo - Le président s'était engagé à dissoudre l'Assemblée nationale et à organiser des élections législatives en mars 2000 pour que d'autres formations politiques puissent entrer au Parlement. Il s'était aussi engagé à respecter la Constitution et à ne pas se présenter pour un troisième mandat. Mais ces promesses ne sont pas tenues. Le général Gnassingbé Eyadema et son parti modifient par la suite le code électoral et la constitution que le peuple togolais avait massivement adoptés en 1992, pour lui permettre de faire un troisième mandat, lors des élections de 2003. Le président Gnassingbé Eyadema est donc réélu en juin 2003 pour un nouveau mandat de cinq ans. La Commission électorale annonce que Eyadéma, détenteur du record de longévité politique à la tête d'un État africain, a réuni 57,2 % des suffrages lors du scrutin.
an 2000 : Zambie - Le gouvernement suit les recommandations du Fonds monétaire international (FMI) et privatise de nombreuses entreprises, dont celles du cuivre, principale ressource du pays, et les compagnies aériennes. Au début des années 2000, la poursuite du programme de privatisation provoque des licenciements massifs et une hausse de la pauvreté.
an 2000 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En février 2000, les occupations de terres par des paysans noirs et d'anciens combattants de la guerre d’indépendance se multiplient. Quelque 4 000 propriétaires possèdent alors plus d'un tiers des terres cultivables dans les zones les plus fertiles, sous forme de grandes exploitations commerciales, tandis que plus de 700 000 familles paysannes noires se partagent le reste sur des « terres communales » beaucoup moins propices à la culture. Les propriétaires blancs avaient continué de s'enrichir pendant les vingt années ayant suivi la chute du régime ségrégationniste, attisant le ressentiment d'une partie de la population noire dans un contexte de crise économique et de montée du chômage. Le président zimbabwéen, qui les avait jusqu'alors défendu, vit mal leur soutien à la nouvelle formation de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique. Dépassé par le mouvement d'occupation de terres, Mugabe tente de sauver la face en officialisant les expropriations et en installant sur les terres réquisitionnées des proches du régime, officiellement anciens combattants de la guerre d’indépendance. Ceux-ci n’ont cependant pas les connaissances ni le matériel nécessaires pour cultiver leurs lopins et beaucoup de terres restent en friches. Des dizaines de milliers d'ouvriers agricoles perdent leur emploi et la production chute.
an 2001 : Burundi - L'Afrique du Sud envoie 700 militaires pour veiller à la mise en place de l'accord et assurer la sécurité des membres de l'opposition de retour d'exil. Le 10 janvier 2001, une assemblée nationale de transition est nommée et son président est Jean Minani, président du Frodebu. L'accord d'Arusha entre en vigueur le 1er novembre 2001 et prévoit, en attendant des élections législatives et municipales pour 2003 et présidentielles pour 2004, une période de transition de 3 ans avec pour les 18 premiers mois, le major Buyoya à la présidence et Domitien Ndayizeye du Frodebu au poste de vice-président avant que les rôles ne soient échangés. L'alternance prévue est respectée par Pierre Buyoya qui cède le pouvoir au bout de dix-huit mois. Les différents portefeuilles du gouvernement sont partagés entre Uprona et Frodebu. Le 4 février 2002, le Sénat de transition élit l'uproniste Libère Bararunyeretse à sa présidence.
Malgré les critiques du comité de suivi des accords d'Arusha à l'encontre du gouvernement, en particulier en ce qui concerne la modification de la composition ethnique de l'armée et de l'administration, c'est-à-dire un rééquilibrage ethnique de ces deux institutions, l'exécutif Hutu-Tutsi fonctionne.
an 2001 : Cap Vert - En 2001, Pedro Pires, du PAICV est élu président contre Carlos Veiga, du MPD avec une majorité de 12 voix seulement. Tous deux avaient exercé précédemment la charge de premier ministre.
an 2001 : République de Centrafrique - Si les accords de Bangui de janvier 1997 semblent mettre un terme aux conflits et le scrutin présidentiel de 1999 ouvre la voie d'un deuxième mandat à Ange-Félix Patassé, en 2001, l’ancien président André Kolingba tente un coup d’État contre le président Patassé le 28 mai 2001 que seule l’intervention de la Libye et des combattants du Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba permet de contrer.
La tentative de coup d'État provoque de violents affrontements dans la capitale, Bangui.
De nouvelles périodes de troubles suivront et le général François Bozizé, ancien chef d’état-major des forces armées centrafricaines, est impliqué dans un putsch avorté en mai 2001 contre le président Patassé et doit fuir au Tchad le 9 novembre 2001.
an 2001 : Congo Kinshasa - Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné par un de ses gardes du corps. Son fils Joseph Kabila est désigné par le gouvernement pour assurer l'intérim (en attendant « le rétablissement du blessé », que tous savent pourtant déjà décédé). Kinshasa reconnaît enfin le décès de Laurent-Désiré Kabila le 18 janvier.
Joseph Kabila, proclamé chef de l'État, prête serment le 26 janvier et appelle à des négociations pour la paix. À Gaborone, s'ouvre une réunion préparatoire au Dialogue intercongolais : celui-ci ne s'ouvrira officiellement à Addis-Abeba que le 15 octobre, et les négociations continuent sans mettre réellement fin au désordre.
En février 2001, un accord de paix est signé entre Kabila, le Rwanda et l'Ouganda, suivi de l'apparent retrait des troupes étrangères. Les troupes de maintien de la paix de l'ONU, la MONUC, arrivent en avril, afin de soutenir les difficiles efforts de paix ou au moins soutenir le cessez-le-feu, protéger les populations et les organisations humanitaires prêtant assistance aux nombreux réfugiés et déplacés.
an 2001-2002 : Gambie - Vers la fin de l'an 2001 et au début 2002, la Gambie termine un cycle complet d'élections présidentielles, législatives et locales, que les observateurs étrangers jugent libres, justes et transparentes, malgré quelques lacunes. Réélu, le président Yahya Jammeh, installé le 21 décembre 2001, conserve un pouvoir obtenu à l'origine par un coup d'État. Son parti, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), conserve une large majorité à l'Assemblée nationale, en particulier après que la principale force d'opposition Parti démocratique unifié (UDP) a boycotté les élections législatives.
an 2001 - 2002 : Madagascar - Le résultat de l'élection de décembre 2001 est contesté entre Didier Ratsikara et Marc Ravalomanana, maire de Tananarive. Marc Ravalomanana devient président à l'issue d'une crise politique qui dure tout le premier semestre 2002. Sous prétexte de controverse sur les résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 16 décembre 2001, Marc Ravalomanana se fait proclamer vainqueur au premier tour, puis est installé Président de la République le 22 février 2002. Un recomptage des voix prévu par les Accords de Dakar permet d’attribuer officiellement à Marc Ravalomanana la victoire au premier tour qu’il revendiquait. Didier Ratsiraka quitte Madagascar en juillet 2002 pour la France et l'élection de Marc Ravalomanana est reconnue par la France et les États-Unis.
an 2001-2002 : Mali - Le 1er septembre 2001, Amadou Toumani Touré, dit ATT, demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l’armée pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle. Il est élu président du Mali en mai 2002 avec 64,35 % des voix au second tour. Son adversaire Soumaïla Cissé, ancien ministre, obtient 35,65 % des voix. Il nomme Ahmed Mohamed ag Hamani comme premier ministre en le chargeant de réunir un gouvernement de grande coalition.
an 2001-2004 : Mozambique - En 2001, Joaquim Chissano indique qu'il ne se présente pas une troisième fois,. Armando Guebuza lui succède à la tête du FRELIMO, et remporte encore les élections de décembre 2004.
an 2001 : Namibie - En 2001, la crise de la réforme agraire se poursuit, en dépit d'un nouvel impôt foncier. Le président Samuel Nujoma s'en prend aussi aux homosexuels, accusés d'être les responsables de la propagation du sida qui ravage le pays.
En politique étrangère, les forces de sécurité namibiennes participent en Angola à la lutte contre l'UNITA. Au côté de l'armée du Zimbabwe, l'armée namibienne est impliquée militairement au Congo-Kinshasa en faveur du régime de Laurent-Désiré Kabila puis de son fils Joseph.
an 2001 : Sénégal - En 2001 une nouvelle constitution réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans.
L’Assemblée nationale – au sein de laquelle le Parti socialiste est majoritaire – est dissoute le 5 février 2001.
25 formations politiques sont autorisées à participer aux élections législatives anticipées.
Pour la première fois au Sénégal, un parti écologiste, Les Verts, entre en lice dans une consultation électorale, mais n’obtient aucun siège.
Suite à la démission de Moustapha Niasse, la juriste Mame Madior Boye est la première femme à occuper les fonctions de Premier ministre dans le pays, du 3 mars 2001 au 4 novembre 2002.
Les élections législatives du 12 mai 2001 voient la victoire de la coalition Sopi proche du président Wade, ce qui permet à 9 nouveaux ministres d’entrer au gouvernement, renforçant ainsi le poids du PDS.
Quelques jours plus tard, 10 partis d’opposition s’unissent pour créer un « Cadre permanent de concertation » (CPC).
Le 25 août 2001 : 25 partis créent cette fois une structure de soutien à l’action du président Wade : « Convergence des actions autour du Président en perspective du 21e siècle » (CPC).
an 2002-2009 : Congo Brazzaville - En 2002 est adopté une nouvelle constitution supprimant le poste de Premier ministre, renforçant les pouvoirs du président de la République. Le président est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. La même année a lieu l'élection du président de la République : Denis Sassou-Nguesso est reconduit à ce poste. Le septennat de Denis Sassou-Nguesso de 2002 à 2009 est marqué par le retour à la paix civile, même si des troubles subsistent dans l'Ouest du Pool. La flambée des cours du pétrole enrichit considérablement l'État, dont le budget annuel dépasse pour la première fois les 100000 milliards de francs CFA. De nombreux projets de construction d'infrastructures sont entrepris (port de Pointe-Noire, autoroute Pointe-Noire - Brazzaville...) en coopération avec des États et entreprises étrangers (France, Chine...).
an 2002 : Congo Kinshasa - Le conflit éclate à nouveau en janvier 2002 à la suite d'affrontements entre des groupes ethniques dans le Nord-est ; l'Ouganda et le Rwanda mettent alors fin au retrait de leurs troupes et en envoient de nouvelles. Des négociations entre Kabila et les chefs rebelles aboutissent à la signature d'un accord de paix par lequel Kabila devra désormais partager le pouvoir avec les anciens rebelles.
Le 15 février 2002 s'ouvre réellement en Afrique du Sud le Dialogue intercongolais : l'accord de paix est signé à Prétoria en décembre; le Dialogue sera clôturé en avril 2003.
an 2002 : Côte d'Ivoire - Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles tentent de prendre le contrôle des villes d’Abidjan, Bouaké et Korhogo. Ils échouent dans leur tentative en ce qui concerne Abidjan mais sont victorieux dans les deux autres villes, situées respectivement dans le centre et le nord du pays. Robert Guéï est assassiné dans des circonstances non encore élucidées. La rébellion qui se présente sous le nom MPCI crée plus tard le MJP et le MPIGO et forme avec ces dernières composantes le mouvement des Forces nouvelles (FN). Il occupe progressivement plus de la moitié nord du pays (estimée à 60 % du territoire), scindant ainsi le territoire en deux zones : le sud tenu par les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et le nord tenu par les Forces armées des forces nouvelles (FAFN).
Les pourparlers entamés à Lomé permettent d’obtenir le 17 octobre 2002, un accord de cessez-le-feu qui ouvre la voie à des négociations sur un accord politique entre le gouvernement et le MPCI sous l’égide du président du Togo, Gnassingbé Eyadema. Ces négociations échouent cependant sur les mesures politiques à prendre, en dépit de réunions entre les dirigeants de la CEDEAO à Kara (Togo), puis à Abidjan et à Dakar. 10 000 casques bleus de l’ONUCI98 dont 4 600 soldats français de la Licorne sont placés en interposition entre les belligérants.
an 2002-2005 : Kenya - En août 2002, le Président Moi — qui constitutionnellement ne peut plus être élu ni président, ni député — surprend tout le monde en annonçant qu'il soutient personnellement la candidature du jeune et inexpérimenté Uhuru Kenyatta — un des fils de Jomo Kenyatta — dans la course à la présidence lors des élections de décembre. En opposition totale avec les vues de Moi, des membres importants du cartel KANU-NDP tels Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, George Saitoti et Joseph Kamotho rejoignent le Liberal Democratic Party (LDP). Pour contrer le dessein de Moi, le LDP, dont Raila a pris la tête, fait alliance avec le National Alliance Party of Kenya (NAK), le Democratic Party (en) (DP), le Forum for the Restoration of Democracy-Kenya (FORD-K) et le National Party of Kenya (NPK). Cette alliance appelée National Rainbow Coalition (NARC) pousse la candidature de Mwai Kibaki le prétendant du DP au poste de président de la République.
Mwai Kibaki gagne largement l'élection présidentielle du 27 décembre avec 62,2 % des suffrages devant Uhuru Kenyatta (31,3 %) et trois autres candidats. Le LDP de Raila Odinga devient le premier parti politique du pays avec 59 sièges de députés à l'Assemblée nationale.
Présidence de Mwai Kibaki - Entre 2002 et 2005, une équipe de constitutionnalistes rédigent au Bomas of Kenya, un texte portant révision de la Constitution. Ce texte, connu sous le nom de Bomas Draft, limite, entre autres, les pouvoirs du président de la République et crée un poste de Premier ministre. En 2005, Mwai Kibaki rejette ce texte et présente un texte de réforme donnant plus de pouvoirs politiques au chef de l'État. Ce texte connu sous le nom de Wako Draft est soumis le 21 novembre 2005, à un référendum national et rejeté par 58,12 % des votants. En réaction, le président Kibaki congédie l'intégralité du gouvernement deux jours après le résultat du référendum et, deux semaines plus tard, forme un nouveau gouvernement qui ne comporte plus aucun membre du LDP.
C'est à ce moment que Raila Odinga décide d'être candidat à l'élection présidentielle de décembre 2007 et crée son propre parti politique : l′Orange Democratic Movement (ODM). Son symbole est une orange en référence au symbole visuel qui représentait le « non » lors du référendum (le « oui » était imagé par une banane)
an 2002 : Nigéria - Depuis 2002 et plus particulièrement depuis 2009, le gouvernement nigérian est confronté, au nord-est du pays, au mouvement terroriste Boko Haram. Ce mouvement salafiste, prônant un islam radical et rigoriste, est à l'origine de nombreux attentats et massacres à l'encontre des populations civiles.
an 2002-2004 : Rwanda - En 2002, l'armée rwandaise quitte officiellement la République démocratique du Congo (Zaïre de 1971 à 1997). Toutefois, dès le début de 2003, le troupes rwandaises envahissent de nouveau l'est de la RDC, et ne commencent à être évacuées que six mois plus tard, après l'envoi de casques bleus. Le 1er juin 2004, les troupes rwandaises et leurs alliés rwandophones occupent la ville de Bukavu, dans le sud du Kivu, mais, dès le
8 juin, les pressions de l'ONU contraignent les troupes à se retirer. Le mouvement RDC-Goma reste armé et soutenu par Kigali.
Malgré les immenses difficultés pour reconstruire le pays qui ont marqué la période de transition, la pression de la communauté internationale aidant, le pouvoir rwandais prépare une constitution et des élections au suffrage universel pour 2003. À tort ou à raison, la crainte manifestée par certains rescapés tutsi de voir le pouvoir à nouveau entre les mains de supposés proches des génocidaires est réveillée. Des intimidations de candidats et d'électeurs, afin qu'ils votent pour le pouvoir en place, sont remarquées.
En 2002, accusé de corruption, l'ancien président de la république, Pasteur Bizimungu, est arrêté et mis en prison. Il est accusé d'avoir constitué un parti politique d'opposition non autorisé par les accords d'Arusha (qui limitaient les partis à ceux qui les avaient signés), de malversations financières et d'avoir publié un article où il manipule les concepts « hutu/tutsi ». Il est condamné à quinze ans de prison. Des associations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, voient en M. Bizimungu un « prisonnier d'opinion », incarcéré pour son opposition au président Kagame plutôt que pour les motifs officiellement invoqués53. Le MDR, signataire des accords d'Arusha, accusé d'abriter en son sein un courant idéologique génocidaire, est dissous par les députés. Une association des droits de l'homme est aussi menacée pour les mêmes raisons. La rigueur qui paraissait excessive chez Paul Kagame est guidée par le fait que la paix intérieure du Rwanda demeurait très fragile à l'époque.
C'est dans ce climat de suspicion de « division » que se déroulent les élections en 2003.
an 2002 : Sénégal - Le 15 février 2002 : la création d’une Commission électorale nationale autonome (CENA) est décidée, en remplacement de l’Observatoire national des élections (ONEL). Elle prendra ses fonctions en 2005.
Le 26 septembre 2002 : le Sénégal vit une tragédie nationale avec le naufrage du Joola, le ferry qui reliait Dakar à Ziguinchor en Casamance. Plus de 1 800 passagers y perdent la vie. Les négligences constatées suscitent un forte rancœur à l’égard des pouvoirs publics. La région, déjà affectée par son enclavement, perd sa liaison maritime pendant trois ans et l’île de Karabane, ancienne escale, ne peut plus compter que sur les pirogues. Ce drame n’est pas sans conséquences sur la carrière de Mame Madior Boye qui est remplacée par Idrissa Seck, maire de Thiès et numéro deux du Parti démocratique sénégalais (PDS).
Seck sera Premier ministre du 4 novembre 2002 au 21 avril 2004. Son ministre de l’Intérieur Macky Sall lui succède lorsqu’il tombe en disgrâce en raison de ses responsabilités dans la gestion des chantiers de Thiès et peut-être de ses ambitions nationales.
an 2002-2004 : Sierra Leone - Le 14 mai 2002, le président sortant, Ahmad Tejan Kabbah, est réélu avec 70,6 % des voix.
Le pays est désormais en paix, après 10 ans d'une guerre civile atroce. Les différentes mesures prises par l'ONU sont progressivement réduites, voire supprimées, comme l'atteste la levée de l'embargo sur les exportations de diamants du sang. De même, les effectifs de la MINUSIL (casques bleus) sont diminués. Après un pic de 17 500 hommes en mars 2001, les effectifs sont ramenés à 13 000 en juin 2003 et à 5 000 en octobre 2004.
Cependant, pour des raisons économiques, de nombreux enfants travaillent toujours dans les mines de diamants, qui sont très dangereuses. La propagation du SIDA chez eux est également très importante : 16 000 enfants de moins de 15 ans sont séropositifs.
an 2002 : Zambie - En 2002, en raison de la sécheresse, la famine menace trois millions de personnes.
Après avoir tenté de faire amender la Constitution qu'il a lui-même promulguée afin de briguer un troisième mandat, Chiluba, face aux protestations populaires, doit céder la place en janvier 2002 à son vice-président et successeur désigné, Levy Mwanawasa, qui est élu président, au cours d’un scrutin contesté. Le Parlement vote à l'unanimité la levée de l'immunité de l'ancien président Chiluba qui est mis en examen au titre d'une soixantaine d'inculpation concernant principalement des détournements de fonds. Les charges seront levées en 2009.
an 2002 - 2003 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
Mugabe est désavoué lors d’un référendum sur une réforme constitutionnelle. En 2002, il gagne l’élection présidentielle lors d’un scrutin dont l’honnêteté est contestée. En 2003, une grave crise agraire et politique éclate à la suite de l’expropriation par Mugabe des fermiers blancs. Une crise politique survient quand les mouvements d’opposition comme la MDC sont réprimés et les élections truquées. À la suite d'une campagne intensive des mouvements des droits de l’Homme, des Britanniques et de l’opposition, le Commonwealth impose des mesures de rétorsion contre les principaux dirigeants du Zimbabwe. Au sein du Commonwealth, Mugabe reçoit cependant le soutien de plusieurs pays africains et dénonce des mesures prises à l’instigation des pays « blancs » (Canada, Grande-Bretagne, Australie). L’opposition locale du MDC est réprimée.
an 2003 : Burundi - le 7 juillet 2003, les forces hutu des CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie), en coalition avec le PALIPEHUTU-FNL (Parti pour la libération du peuple hutu-Forces de libération nationale) attaquent Bujumbura.
40 000 habitants fuient la capitale. Un accord de paix (protocole de Pretoria) est néanmoins signé le 15 novembre 2003 entre le président Ndayizeye et le chef des CNDD-FDD. La principale branche de la rébellion (CNDD-FDD) entre au gouvernement, au sein duquel elle détient quatre ministères et dispose également de postes de haut rang dans les autres institutions, conformément à l'accord d'Arusha.
an 2003 : République de Centrafrique - Après une nouvelle série de troubles et malgré l'intervention de la communauté internationale (MINURCA). Malgré l'intervention de la communauté internationale, Ange-Félix Patassé est finalement renversé le 15 mars 2003 par François Bozizé grâce à une rébellion dont l'élément central est constituée par plusieurs centaines de « libérateurs », qui sont souvent d’anciens soldats tchadiens ayant repris du service avec l’assentiment d’Idriss Déby. Une bonne partie des « libérateurs » retournera au Tchad en 2003 ou 2004, d'autres intégreront les forces de sécurité ou se reconvertiront dans le commerce sur le grand marché PK5
Le 15 mars 2003, le général François Bozizé réussit, avec l'aide de militaires français (deux avions de chasse de l'armée française survolaient Bangui pour filmer les positions des loyalistes pour le compte de Bozizé) et de miliciens tchadiens (dont une bonne partie va rester avec lui après son installation au pouvoir), un nouveau coup d'État et renverse le président Patassé. Le général Bozizé chasse alors les rebelles congolais, auteurs de méfaits et crimes innombrables, notamment dans et autour de Bangui.
Toutefois, le coup d’État de François Bozizé, en 2003, a déchaîné un cycle de rébellion dans lequel le pays est toujours plongé en 2019.
an 2003 : Congo Kinshasa - Le 4 avril 2003, la Cour d'ordre militaire (COM), condamne, sans convaincre, 30 personnes à mort pour l'assassinat de Laurent Kabila.
La même année se met en place le gouvernement de transition « 4+1 » (quatre vice-présidents et un président) : Abdoulaye Yerodia Ndombasi (PPRD), Jean-Pierre Bemba (MLC), Azarias Ruberwa (RCD), Arthur Z'ahidi Ngoma (société civile), ainsi que Joseph Kabila (PPRD).
En juin 2003, l'armée rwandaise est la seule de toutes les armées étrangères à ne pas s'être retirée du Congo. L'essentiel du conflit était centré sur la prise de contrôle des importantes ressources naturelles du pays, qui incluent les diamants, le cuivre, le zinc, et le coltan.
an 2003 : Afrique Côte d'Ivoire - Dans une nouvelle initiative, la France abrite à Linas-Marcoussis du 15 au 23 janvier 2003, sous la présidence de Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel français, secondé par le juge sénégalais Kéba Mbaye, une table ronde avec les forces politiques ivoiriennes et obtient la signature des accords de Linas-Marcoussis. Cet accord prévoit la création d’un gouvernement de réconciliation nationale dirigé par un premier ministre nommé par le Président de la République après consultation des autres partis politiques, l’établissement d’un calendrier pour des élections nationales crédibles et transparentes, la restructuration des forces de défense et de sécurité, l’organisation du regroupement et du désarmement de tous les groupes armés, le règlement des questions relatives à l’éligibilité à la présidence du pays et à la condition des étrangers vivant en Côte d’Ivoire. Un comité de suivi de l’application de l’accord, présidé par l’ONU, est institué.
an 2003 : Guinée - Après avoir révisé la Constitution pour pouvoir se présenter une troisième fois en décembre 2003, le chef de l'État, pourtant gravement malade, est réélu avec 95,63 % des suffrages face à un candidat issu d'un parti allié, les autres opposants ayant préféré ne pas participer à un scrutin joué d'avance.
an 2003 : Libéria - Les combats s'intensifient, les rebelles encerclent progressivement dans la capitale les forces de Charles Taylor, le risque d'une tragédie humanitaire se profile à nouveau. Le 8 juillet 2003, le Secrétaire général décide de nommer Jacques Paul Klein (États-Unis) comme son Représentant spécial pour le Liberia. Il lui confie la tâche de coordonner les activités des organismes des Nations unies au Liberia et d'appuyer les nouveaux accords. Le 29 juillet 2003, le Secrétaire général décrit le déploiement en trois phases des troupes internationales au Liberia, aboutissant à la création d'une opération de maintien de la paix pluridimensionnelle des Nations unies (S/2003/769). La nomination de Jacques Paul Klein et la création d'une opération des Nations unies au Liberia mettent fin au mandat du BANUL. La situation au Liberia évolue ensuite rapidement. Le 1er août 2003, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1497 (2003): autorisation de la mise en place d'une force multinationale au Liberia et d'une force de stabilisation de l'ONU déployée au plus tard le 1er octobre 2003. Parallèlement, le 18 août 2003, les parties libériennes signent à Accra un accord de paix global, dans lequel les parties demandent à l'Organisation des Nations unies de déployer une force au Liberia, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Celle-ci est chargée d'appuyer le Gouvernement transitoire national du Liberia et de faciliter l'application de cet accord. Grâce au déploiement ultérieur de la Mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Liberia, la situation en matière de sécurité dans le pays s'améliore.
Les événements aboutissent à la création de la Mission des Nations unies au Liberia (MINUL), à la démission de Charles Taylor, le 11 août et à une passation pacifique des pouvoirs.
Le Secrétaire général recommande que le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, autorise le déploiement d'une opération de maintien de la paix des Nations unies dotée d'effectifs d'un maximum de 15 000 hommes, dont 250 observateurs militaires, 160 officiers d'état-major et un maximum de 875 membres de la police civile, 5 unités armées constituées supplémentaires fortes chacune de 120 personnes, ainsi que d'une composante civile de taille appréciable et du personnel d'appui requis. La Mission des Nations unies au Liberia comporte des volets politiques, militaires, concernant la police civile, la justice pénale, les affaires civiles, les droits de l'homme, la parité hommes-femmes, la protection de l'enfance, un programme « Désarmement, Démobilisation, Réinsertion », ainsi que, le moment venu, un volet électoral. Elle comporte un mécanisme de coordination de ses activités avec celles des organismes humanitaires et de la communauté du développement. Elle agit en étroite coordination avec la CEDEAO et l'Union africaine. Afin d'assurer une action coordonnée des Nations unies face aux nombreux problèmes de la sous-région, la Mission doit travailler également en étroite collaboration avec la Mission des Nations unies en Sierra Leone (MINUSIL), la Mission des Nations unies en Côte d'Ivoire (MINUCI) et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest.
Dans son rapport, le Secrétaire général fait observer que la passation des pouvoirs du Président Charles Taylor au Vice-Président Moses Blah et la signature, par les parties libériennes, de l'accord de paix global offrent une occasion unique de mettre un terme aux souffrances du peuple libérien et de trouver une solution pacifique à un conflit qui avait été l'épicentre de l'instabilité dans la sous-région. Il souligne que si l'Organisation des Nations unies et la communauté internationale dans son ensemble sont prêtes à soutenir le processus de paix libérien, c'est aux parties libériennes elles-mêmes qu'incombe la responsabilité première de la réussite de l'accord de paix.
Le 19 septembre 2003, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 1509 (2003), en remerciant le Secrétaire général de son rapport du 11 septembre 2003 et de ses recommandations. Il a décidé que la MINUL comprendrait 15 000 membres du personnel militaire des Nations unies, dont un maximum de 250 observateurs militaires et 160 officiers d'état-major, et jusqu'à 1 115 fonctionnaires de la police civile, dont des unités constituées pour prêter leur concours au maintien de l'ordre sur tout le territoire du Liberia, ainsi que la composante civile appropriée. La Mission a été créée pour une période de 12 mois. Il a prié le Secrétaire général d'assurer le 1er octobre 2003 la passation des pouvoirs des forces de l'ECOMOG dirigées par la CEDEAO à la MINUL.
Comme prévu, la Mission des Nations unies au Liberia (MINUL) a assuré les fonctions de maintien de la paix des forces de la Mission de la CEDEAO au Liberia (ECOMIL) le 1er octobre. Les quelque 3 500 soldats ouest-africains qui avaient fait partie des troupes avancées de l'ECOMIL ont provisoirement coiffé un béret de soldat de la paix des Nations unies. Dans un communiqué paru le même jour, le Secrétaire général a accueilli avec satisfaction cette très importante évolution et a salué le rôle joué par la CEDEAO dans l'instauration du climat de sécurité qui a ouvert la voie au déploiement de la MINUL. Il a rendu hommage aux gouvernements du Bénin, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Nigeria, du Sénégal et du Togo pour leur contribution à la MINUL, ainsi qu'aux États-Unis pour leur appui à la force régionale. Le Secrétaire général s'est dit confiant dans le fait que la MINUL pourrait être en mesure de contribuer de manière importante au règlement du conflit au Liberia pour autant que toutes les parties concernées coopèrent pleinement avec elle et que la communauté internationale fournisse les ressources nécessaires.
an 2003 : Mauritanie - En novembre 2003, Ould Taya est réélu président de la République avec 67 % des voix.
an 2003 : Tchad - En 2003, les recherches de gisements pétroliers permettent au Tchad de lancer les premières phases d'exploitation de son sous-sol, entraînant avec elles l'espoir que le Tchad puisse enfin connaître une phase d'essor économique et de développement humain
an 2003-2005 : Togo - Gnassingbé Eyadema est réélu en 2003 à la suite d'un changement dans la constitution pour l’autoriser à se présenter à nouveau. Il décède le 5 février 2005.
an 2003-2007 : Rwanda - La constitution adoptée par référendum – 26 mai 2003 - Inspirée des principales constitutions occidentales, la constitution rwandaise laisse néanmoins une large place aux problèmes spécifiques du Rwanda post-génocide, inscrivant notamment dans la constitution le refus de l'ethnisme hérité du colonialisme et ayant conduit au génocide. Des opposants au FPR, des courants liés à l'ancien régime génocidaire, et des observateurs occidentaux y voient une hypocrisie visant à renforcer un pouvoir politique disposant d'une faible base ethnique et voulant de ce fait forcer la marche vers l'apparence d'une nation composée de citoyens débarrassés du concept ethnique. Elle crée aussi des outils juridiques pour favoriser la place des femmes dans la vie politique (art. 185 et 187). Selon Human Rights Watch, certaines dispositions de la Constitution de 2003 violent « le droit d'association, de libre expression et de représentation politique assurée par des élections libres.
L'élection présidentielle au suffrage universel – 25 août 2003 - Paul Kagame est élu président de la République avec 95 % des voix contre son principal opposant, Faustin Twagiramungu, du MDR dissous. Des membres du comité de soutien à Faustin Twagiramungu ont été arrêtés la veille du scrutin. Certains ont subi des violences avant d'être relâchés. Les observateurs de la communauté européenne ont émis des critiques, regrettant des pressions exercées sur le corps électoral, et ont constaté des fraudes, mais estiment qu'un pas important vers la démocratie a été franchi. Amnesty International et Human Rights Watch ont en revanche manifesté un grand scepticisme sur la démocratisation du Rwanda.
Les élections législatives au suffrage universel – 2 octobre 2003 - Les députés favorables à Paul Kagame obtiennent la majorité des sièges. 49 % des députés sont des femmes, ainsi qu'une très forte proportion de sénateurs et de ministres.
Pour résoudre la difficulté de juger les nombreux prisonniers, qui attendent dans les prisons rwandaises l'idée germe d'adapter les gacaca, structures de justice traditionnelle (de agacaca, « petite herbe » ou « gazon » en kinyarwanda). On forme rapidement des personnes intègres pour présider ces tribunaux populaires. Pour désengorger les prisons, des prisonniers de certaines catégories sont relâchés, sans être amnistiés, avant de passer devant les gacaca. Ces décisions ravivent, dans la société rwandaise et la diaspora, les inquiétudes des rescapés qui craignent pour leur vie et le débat controversé sur la réconciliation, politiquement souhaitée, entre tueurs et rescapés.
Après plusieurs années de réflexions et de mises au point, le 15 janvier 2005, huit mille nouvelles juridictions « gacaca », (tribunaux populaires chargés de juger les auteurs présumés du génocide de 1994), entament la phase administrative de leur travail. Elles se rajoutent aux 750 « gacaca » pilotes mises en place depuis 2001. L'expérience des « gacaca » pilotes laisse penser qu'il y aurait au moins sept cent cinquante mille personnes, soit un quart de la population adulte, dénoncées et jugées par ces assemblées populaires.
Amnesty International estime que « cette volonté de traiter les affaires aussi rapidement que possible a accru la suspicion régnant sur l’équité du système. Certaines décisions rendues par les tribunaux gacaca faisaient douter de leur impartialité. » L'association souligne également que « Le 7 septembre 2005, Jean Léonard Ruganbage, du journal indépendant Umuco, a été arrêté à la suite de l’enquête qu’il avait menée sur l’appareil judiciaire et le gacaca ». Les autorités rwandaises estiment que ces critiques sont déplacées en rappelant que l'aide qu'elles avaient demandée à la communauté internationale pour juger les génocidaires a été gaspillée dans la mise en place d'un Tribunal pénal international, qui fut sa réponse à la demande rwandaise et qui n'a achevé en 2007 qu'une trentaine de jugements.
an 2003 : Soudan - En 2003, la guerre civile éclate au Darfour, où le Mouvement de libération du Soudan (MLS ou SLM) et le Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE ou JEM) se posent en protecteurs des populations civiles face aux exactions des « janjawids » (expression arabe qui signifie les diables à cheval, milices soutenues par le gouvernement de Khartoum). L'année suivante, l’Union africaine (UA) envoie des troupes au Darfour pour veiller au respect d'un cessez-le-feu et assurer la protection des populations civiles.
an 2004-2008 : République de Botswana - En 2004, le Président Festus Mogae, réélu pour cinq ans, s'engage à améliorer l'économie du pays et à tenter d'enrayer l'épidémie de sida laquelle toucherait près de 25 % de la population du pays d'après l'Organisation mondiale de la santé. Il se voit décerner en 2008 le prix Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique pour avoir su faire bon usage des richesses du sous-sol du pays, notamment en diamants. Il laisse le pouvoir au vice-président, Ian Khama, fils de Seretse Khama, père de l'indépendance du Botswana et de son épouse britannique Ruth Williams. Celui-ci est confirmé comme président par des élections l'année suivante. Il reste au pouvoir, réélu démocratiquement, pendant dix ans et fait ses adieux 18 mois avant la fin de son deuxième mandat, en respectant ainsi la Constitution.
an 2004 : Algérie - De nouvelles élections sont organisées au mois d'avril, le principal concurrent du président sortant étant son ancien Premier ministre Ali Benflis. Abdelaziz Bouteflika est réélu avec un taux de 85 %. Son programme pour le deuxième mandat prévoit un plan quinquennal pour la relance de l'économie, au profit duquel il consacre une enveloppe financière de 150 milliards de dollars.
an 2004 : Congo Kinshasa - En mars 2004 échoue une tentative de coup d'état attribuée à d'anciens mobutistes.
En mai 2004, des militaires banyamulenge déclenchent une mutinerie à Bukavu, sous les ordres du général tutsi congolais Laurent Nkunda, et prennent Bukavu le 2 juin. Ces mutins abandonnent la ville le 9 juin sous la pression internationale. Les 3 et 4 juin, dans les grandes villes congolaises, sont organisées des manifestations anti-rwandaises par des étudiants, qui tournent à l'émeute anti-ONU au Kivu. Le 11 juin, des membres de la garde présidentielle tentent un coup d'état. Le RCD-Goma suspend sa participation au gouvernement; il reviendra sur sa décision le 1er septembre.
an 2004-2006 : Guinée - Fin avril 2004, le premier ministre François Louceny Fall profite d'un voyage à l'étranger pour démissionner, arguant que « le président bloque tout ». Le poste reste vacant plusieurs mois avant d'être confié à Cellou Dalein Diallo, qui sera démis de ses fonctions en avril 2006.
an 2004-2005 : Guinée-Bissau - Le pays entreprend alors à nouveau avec difficulté une phase de normalisation démocratique, culminant avec l'organisation d'élections législatives en 2004 et d'une élection présidentielle le 24 juillet 2005 qui voit le retour à la tête du pays de João Bernardo Vieira dit « Nino Vieira », l'ancien président déposé en 1999 par un coup d’État militaire qui s'était présenté en indépendant. Pour gouverner, Nino Vieira, fortement contesté au sein du PAIGC, conclut une alliance tactique avec son ennemi historique, le général Batista Tagme Na Waie, en nommant chef d'état-major10 ce personnage rustre et illettré qui voue une haine farouche à l'ancien président Vieira, qui l'aurait torturé et jeté sur une île prison à la suite de la tentative de coup d'État de novembre 1985.
an 2004-2005 : Malawi - Le mois de mai 2004 voit l’élection de Bingu wa Mutharika, du FDU, contre le candidat du PCM, John Tembo. Durant la campagne électorale, les médias contrôlés par l'Etat (radio et télévision) privilégient la communication de la coalition au pouvoir. Des observateurs de l'Union Européenne mettent également en exergue des « distributions manifestes et répandues d'argent aux électeurs » et « l'utilisation de fonds publics par le parti au pouvoir ». Quand il prend ses fonctions, le Malawi est en pleine crise alimentaire. Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime que le nombre de personnes vulnérables au Malawi s’élève à plus de 5 millions, et en octobre 2005, le président déclare le Malawi en état de crise. Tout en demandant de l’aide alimentaire, le président engage le pays, après cette année désastreuse,dans une « révolution verte ». En faisant de l’agriculture une priorité, en mettant l'accent sur l'irrigation, en subventionnant 1 700 000 fermiers pauvres, il permet au pays de sortir de la disette et de devenir exportateur de maïs.
Bingu wa Mutharika se représente pour un deuxième mandat à l'élection du 19 mai 2009, cette fois à la tête du Parti démocrate progressiste qu'il a fondé en 2005 après avoir quitté le Front uni démocratique, et est réélu. L’image du Malawi à l'étranger s’améliore grâce à cette politiques de développement et aux avancées en sécurité alimentaire, ainsi qu'aux actions pour combattre la mortalité infantile et maternelle et les maladies telles que le malaria, la tuberculose et le SIDA. Le Malawi ouvre de nouvelles ambassades en Chine, Inde et Brésil.
an 2004 : Namibie - En 2004, Sam Nujoma renonce à modifier la constitution une nouvelle fois pour obtenir un nouveau mandat.
Les élections générales de novembre 2004 sont remportées par la SWAPO, qui renforce son emprise à chaque échéance électorale.
Les élections des 15 et 16 novembre sont sans surprise avec la victoire écrasante de la SWAPO qui remporte 55 des 72 sièges du parlement.
an 2004 : Somalie - Le 10 octobre 2004, le Parlement fédéral de transition de la République de Somalie, exilé au Kenya en raison des affrontements entre seigneurs de la guerre à Mogadiscio, et formé en nombres égaux de représentants de chacun des quatre grands clans somalis, a élu en tant que président intérimaire Abdullahi Yusuf Ahmed, président du Pays de Pount. À la tête du Gouvernement fédéral de transition, celui-ci a nommé Ali Mohamed Gedi, un vétérinaire de profession, en tant que Premier ministre, avec pour mission de former un gouvernement de coalition avec les différents chefs de guerre du pays. Les institutions somaliennes siègent au Kenya par mesure de sécurité à l'égard de la situation intérieure de la Somalie. Les institutions en exil n'ont aucun contrôle sur le pays en dehors de certains quartiers de la capitale Mogadiscio, leur autorité n'est pas reconnue à l'intérieur du pays, mais uniquement par les gouvernements étrangers.
an 2004 - 2005 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 2004, le pays ne peut plus subvenir à ses besoins et 70 % de la population se retrouve sans emploi. Le Zimbabwe se retire du Commonwealth. Le pays est alors au bord de la famine, ce que chercherait à dissimuler le régime. Le pays apparait dans la liste du nouvel « axe du mal » rebaptisé « avant poste de la tyrannie » par Condoleezza Rice en 2005.
En 2005, le parti de Robert Mugabe, la ZANU, remporte les élections législatives sur fond de violence et de fraudes électorales face à un MDC divisé et affaibli. Entre 120 000 et 1 500 000 habitants des bidonvilles d'Harare, bastions de l'opposition, sont expulsés à la fin du printemps lors de la destruction de leurs habitations sur ordre du gouvernement ; c'est l'opération Murambatsvina. Adoption d'une réforme constitutionnelle restreignant les droits de propriété et permettant au gouvernement de priver n'importe qui de passeport pour des raisons « d'intérêt national ». Afin de gagner l'appui de la population, Mugabe persécute la minorité ndébélé[réf. nécessaire]. Nombre d'entre eux fuient en Afrique du Sud. On empêche les propriétaires de terres d'aller en appel au sujet de leur expropriation. Un Sénat de 66 membres est créé mais celui-ci est soupçonné d'être une simple chambre d'enregistrement au service du président Mugabe. L'inflation dépasse les 1 000 % en 2006, et les 100 000 % en 2007, alors qu'a lieu une purge au sein de l'armée. L'exode de la population vers les pays voisins s’accélère.
an 2005 : Burkina Faso -Blaise Compaoré est élu président de la République (taux d'abstention : 74 %). Il est réélu en 2005 et en 2010.
an 2005 : Burundi - Le CNDD-FDD, dirigé par Pierre Nkurunziza, s'impose dès lors comme l'un des principaux acteurs politiques, en obtenant la majorité absolue aux élections communales du 5 juin 2005 (1 781 sièges sur les 3 225 à pourvoir) avec 62,9 % des voix, contre 20,5 % pour le FRODEBU et seulement 5,3 % pour l'Uprona. Le CNDD-FDD, majoritairement hutu, dispose désormais de la majorité absolue dans 11 des 17 provinces du pays. Une victoire sans appel qui annonce la recomposition du paysage politique après douze années de guerre civile et met un terme au long tête-à-tête entre l'UPRONA et le FRODEBU. Mais le vote rappelle aussi que certains rebelles (PALIPEHUTU-FNL) n'ont pas encore déposé les armes (le jour du scrutin, 6 communes ont été la cible de violences). Ces opérations d'intimidation révèlent que la trêve conclue le 15 mai 2005 à Dar es Salaam avec les forces du PALIPEHUTU-FNL reste fragile.
Le CNDD-FDD remporte également les élections législatives du 4 juillet 2005 et les sénatoriales du 29 juillet. Nkurunziza est donc élu président le 19 août et investi le 26 août 2005.
an 2005 : République de Centrafrique - Une élection présidentielle a lieu, après plusieurs reports, le 13 mars 2005, sous la direction d'une Commission Électorale Mixte Indépendante (CIME), présidée par Jean Willybiro-Sako. On peut relever comme candidatures, celles de François Bozizé (déjà chef de l'État), l'ancien président André Kolingba, et l'ancien vice-président Abel Goumba. Les candidatures de plusieurs autres candidats, dont celles de Charles Massi du FODEM, de l'ancien premier ministre Martin Ziguélé, de l'ancien ministre et ancien maire de Bangui Olivier Gabirault et de Jean-Jacques Démafouth, sont refusées par la commission électorale avant la médiation gabonaise et les accords de Libreville. À la suite de ces accords, seule la candidature de l'ancien président Ange-Félix Patassé est définitivement rejetée par la commission élue.
L'accession à la présidence de Bozizé est violemment contestée et une première guerre civile centrafricaine ravage le pays entre 2004 et 2007, jusqu'à la signature d'un accord de paix.
an 2005 : Congo Kinshasa - En janvier 2005 des émeutes se déclenchent à Kinshasa lorsque la Commission électorale envisage publiquement un report de la date des élections, comme le lui permettent les textes. La MONUC déclenche une offensive militaire, médiatique et diplomatique contre les milices lendues et hemas, après la mort de neuf casques bleus banglashis, tués en Ituri par ces dernières. La Cour pénale internationale annonce ses premiers mandats d'arrêts pour 2005 dont un accusé en Ituri.
En mai, l'avant-projet de constitution est approuvé par le parlement. Fin juin, celui-ci décide de prolonger la transition de six mois. Un gouvernement de transition est établi jusqu'aux résultats de l'élection.
an 2005 : Afrique République de Djibouti - Ismaïl Omar Guelleh est réélu en 2005, puis, après une modification de la Constitution, en 2011, 2016 et 2021.
an 2005-2006 : Eswatini (Swaziland) - Le 26 juillet 2005, après 30 ans de suspension de la loi fondamentale, le roi ratifie une nouvelle constitution entrée en vigueur le 8 février 2006. Le pays demeure une monarchie absolue. Les partis politiques sont toujours interdits et ne sont en pratique perçus que comme des associations. La Cour suprême ne peut juger d'affaires pouvant impliquer le régime royal. Le pays est par ailleurs toujours totalement dépendant économiquement de l'Afrique du Sud.
an 2005 : Kenya - Un premier projet de nouvelle constitution est rejeté en 2005 par un référendum.
an 2005-2006 : Libéria - Après le départ de Charles Taylor, une transition politique débute par la tenue d'élections législatives et présidentielles. La campagne électorale se déroule sans incidents notoires, notamment grâce à la présence de 15 000 Casques bleus de l'UNMIL, présents dans le pays depuis d'octobre 2003. Deux courtes courtes présidences se succèdent, avec tout d'abord Moses Blah, ancien vice-président de Charles Taylor à qui celui-ci a transmis le flambeau lorsqu'il a démissionné : Moses Blah assure un intérim pendant quelques mois, le temps que des négociations, organisées à Accra entre les différentes parties, aboutissent. Gyude Bryant lui succède12. C'est un homme d’affaires. Mais il est aussi l’un des fondateurs, en 1984, du Liberia Action Party (LAP), dont il est devenu le président en 1992, deux ans après le début de la première guerre civile. Bryant n’a pas quitté son pays pendant les guerres civiles. Il a ensuite été un président de transition, pendant deux ans et quelques mois, avant les élections présidentielles prévues par la paix d'Accra, et organisées fin 2005.
Le 11 octobre 2005, les Libériens sont effectivement appelés aux urnes pour élire leur président, comme prévu dans l'Accord de paix d'Accra. Parmi les vingt-deux candidats, George Weah (un ancien footballeur reconverti dans la politique) et Ellen Johnson-Sirleaf (une économiste et ancienne responsable au sein de la Banque mondiale), sont les favoris dans les sondages.
Le 21 octobre, la Commission nationale électorale (NEC) annonce que George Weah a obtenu 28,3 % des voix, devançant Ellen Johnson-Sirleaf qui a obtenu 19,8 %. Ces derniers participent donc au second tour qui a eu lieu le 8 novembre. Les résultats définitifs de ce premier tour sont rendus public le 26 octobre, après l'examen des vingt réclamations concernant des fraudes éventuelles. Concernant les élections législatives, le Congrès pour le changement démocratique (CDC) de George Weah a obtenu 3 sièges sur 26 au Sénat et 15 sur 64 à la Chambre des représentants. Le Parti de l'unité d'Ellen Johnson-Sirleaf a obtenu 3 sièges au Sénat et 9 à la Chambre des représentants. Le taux de participation a été de 74,9 %.
Le 8 novembre a lieu le second tour de l'élection présidentielle. George Weah a réuni autour de lui plusieurs hommes politiques de poids, comme Winston Tubman (quatrième au premier tour), Varney Sherman (cinquième au premier tour) et Sekou Conneh (ancien chef de la rébellion du LURD (Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie)). Ellen Johnson-Sirleaf a comme soutien uniquement des hommes politiques de second plan, mais elle espère profiter d'un vote massif des femmes en sa faveur au moment de l'élection qui fasse d'elle la première femme démocratiquement élue président en Afrique. Le 23 novembre, la Commission électorale nationale (NEC) annonce les résultats définitifs qui déclarent vainqueur Ellen Johnson Sirleaf avec 59,4 % des votes, contre 40,6 % pour George Weah. Le nouveau président doit prêter serment le 16 janvier 2006.
an 2005 : Mauritanie - Le 3 août 2005, l'armée, au travers du Conseil militaire pour la justice et la démocratie (CMJD) présidé par le colonel Ely Ould Mohamed Vall, prend le pouvoir pour officiellement « mettre fin aux pratiques totalitaires du régime » du président Ould Taya. Le putsch se déroule alors que le président revient de Riyad où il a assisté la veille aux funérailles du roi Fahd d'Arabie Saoudite.
an 2005-2009 : Namibie - Le ministre des terres, Hifikepunye Pohamba, est imposé par Nujoma pour lui succéder à la présidence de la république en mars 2005. Nujoma reste toutefois à la présidence de la SWAPO jusqu'en 2007, date à laquelle Hifikepunye Pohamba lui succéda à la présidence du parti. Hifikepunye Pohamba a été réélu avec plus de 75 % des suffrages lors des élections de novembre 2009.
an 2005 : Ouganda - En août 2005, le Parlement (dominé par le NRM) vota une modification de la constitution qui, en enlevant la limite de deux mandats présidentiels, permit à Museveni de se représenter pour un troisième mandat. Kizza Besigye, revint d'exil en octobre 2005, et fut le principal opposant lors de l'élection de février 2006, remportée par Museveni avec 59,3 % des voix (au premier tour). Les résultats furent contestés par l'opposition du FDC (Forum for Democratic Changes, dirigé par Besigye).
an 2005 - 2015 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Après les élections de décembre 2005, Jakaya Kikwete devient le nouveau président de la République, le quatrième depuis la création de la Tanzanie. Il effectue les deux mandats que lui permettent la constitution. Le parti au pouvoir, le Chama cha Mapinduzi, choisit ensuite John Magufuli comme candidat à la succession pour les présidentielles de 2015. John Magufuli l'emporte et devient ainsi le cinquième président de la République de Tanzanie. Celui-ci acquiert une popularité, notamment grâce à sa lutte contre le gaspillage de l'argent public et contre la corruption, mais faitpreuve également de dérives autoritaires, contre ses opposants, contre les libertés individuelles, contre la presse, etc.
an 2005 : Togo - Le 5 février 2005, le président Étienne Eyadéma Gnassingbé, décède d'une crise cardiaque à 69 ans, après avoir présidé durant 38 ans le pays. Sa mort surprend autant la population du pays que le gouvernemen.
À la suite du décès de Gnassingbé Eyadema et profitant de l’absence au pays du président de l’Assemblée nationale qui, selon l’article 65 de la Constitution, doit assurer l’intérim de la présidence, l’armée togolaise prend la décision de confier le pouvoir au fils de Gnassingbé Eyadema, Faure Gnassingbé. L'Union africaine par la voix du président de la Commission Alpha Oumar Konaré dénonce un coup d’État militaire.
Le 25 février 2005, à la suite des pressions de la CEDEAO et de l’Union européenne, Faure Gnassingbé se retire et laisse la place au vice-président de l’Assemblée nationale togolaise, Abbas Bonfoh. Ce dernier assure l’intérim de la fonction présidentielle jusqu’à la tenue d'élections le 24 avril 2005. Quatre candidats se présentent : Faure Gnassingbé, soutenu par le Rassemblement du peuple togolais (RPT), Emmanuel Bob Akitani, candidat de la coalition de l’opposition radicale, Harry Olympio (en), candidat du Rassemblement pour le soutien à la démocratie et au développement (RSDD, opposition modérée) et Nicolas Lawson, homme d’affaires qui annonce le retrait de sa candidature le 22 avril 2005.
Le scrutin se déroule dans des conditions très controversées, l’opposition dénonçant des fraudes. Emmanuel Bob Akitani, chef de l’opposition, se déclare vainqueur avec 70 % des voix alors que le gouvernement déclare Faure Gnassingbé élu. Dès l’annonce des résultats, des manifestations émaillées de violences éclatent dans les principales villes. Elles seront violemment réprimées par les forces de l'ordre. Le gouvernement décide de mettre en place une commission nationale d'enquête qui estime le nombre de morts à des centaines, plus de 800 selon la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH). De nombreux Togolais, environ 40 000, se réfugient dans les pays voisins, le Bénin et le Ghana. Le 3 mai 2005, Faure Gnassingbé prête serment et déclare qu’il se concentrera sur « la promotion du développement, le bien commun, la paix et l’unité nationale ».
Le 8 juin 2005, Edem Kodjo, président de la Convergence patriotique panafricaine (CPP, opposition modérée), est nommé Premier ministre. Il est chargé de constituer un gouvernement d’union nationale.
Amnesty International publie en juillet 2005 un rapport dénonçant selon ses propres termes « un scrutin entaché d’irrégularités et de graves violences » tout en montrant que « les forces de sécurité togolaises aidées par des milices proches du parti au pouvoir (le Rassemblement du peuple togolais) s’en sont violemment prises à des opposants présumés ou à de simples citoyens en ayant recours à un usage systématique de la violence ». Le rapport reproche aussi à la France son rôle ambigu dans la situation actuelle15. Les violences consécutives aux événements politiques de 2005 auraient entraîné entre 400 et 500 morts.
an 2005 : Soudan - En 2005, un accord de paix est signé à Nairobi entre le gouvernement de Khartoum et l’APLS. Cet accord prévoit pour une période de six ans une large autonomie pour le Sud, qui disposera de son propre gouvernement et d'une armée autonome. À l’issue de cette période, un référendum d’autodétermination sera organisé. Les revenus issus du pétrole seront partagés en part égale entre le Sud et le Nord . D’autre part, le gouvernement aura 70 % des postes dans l’administration centrale contre 30 % pour la rébellion du Sud. Enfin, la charia ne sera appliquée que dans le Nord, à majorité musulmane. John Garang, le dirigeant de la rébellion contre le régime islamiste du général Omar el-Béchir, trouve la mort dans un accident d’hélicoptère, quelques semaines après sa nomination comme vice-président du Soudan pour pacifier la situation.
an 2006-2007 : Algérie - Les actions terroristes se poursuivent néanmoins dans plusieurs régions du pays : le quotidien L'Expression estime en 2006 qu'il y aurait de 600 à 900 membres de groupes terroristes encore en activité dans le maquis algérien, la majorité appartenant au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC). Ils se manifestent notamment par les attentats du 11 décembre 2007 à Alger (entre 30 et 72 victimes suivant les sources)
an 2006-2016 : Bénin (anc. Dahomey) - En mars 2006, Thomas Yayi Boni, ancien directeur de la Banque ouest-africaine de développement, est élu président du Bénin et de nouveau en mars 2011. Boni Yayi tente d'imposer, contre la volonté de sa famille politique, les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), un dauphin, le Franco-Béninois, Lionel Zinsou, un banquier d'affaires. Il est battu à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 par son ex-bras financier et allié, l'homme d'affaires Patrice Talon. Ce dernier accède au pouvoir le 6 avril 2016.
an 2006 : Burkina Faso - Avec l'arrestation de certains étudiants à la suite d'une conférence de presse à l'université de Ouagadougou, en 2007-2008 contre le coût élevé de la vie.
an 2006-2008 : Congo Kinshasa - Une constitution est approuvée par les électeurs, et le 30 juillet 2006, les premières élections multipartites du Congo depuis son indépendance (en 1960) se tiennent :
-
Joseph Kabila obtient 45 % des voix,
-
Son opposant, Jean-Pierre Bemba, 20 %.
Les résultats de l'élection sont contestés et cela se transforme en une lutte frontale, entre les partisans des deux partis, dans les rues de la capitale, Kinshasa, du 20 au 22 août 2006. Seize personnes sont tuées avant que la police et les troupes MONUC de l'ONU ne reprennent le contrôle de la ville.
Une nouvelle élection a lieu le 29 octobre 2006, et Kabila remporte 58 % des voix. Bien que tous les observateurs neutres se félicitent de ces élections, Bemba fait plusieurs déclarations publiques dénonçant des irrégularités dans les élections.
Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila prête serment comme président de la République et le gouvernement de transition prend fin. La fragilité du nouveau gouvernement a permis l'installation d'affrontements répétés et de violations des droits de l'homme.
Dans l'affrontement se déroulant dans la région du Kivu, les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) continuent de menacer la frontière rwandaise et les Banyarwandas ; le Rwanda soutient les rebelles du RCD-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie) contre Kinshasa; et une offensive rebelle ayant eu lieu fin octobre 2008 a causé une crise de réfugiés à Ituri, où les forces de MONUC se sont révélées incapables de maîtriser les nombreuses milices et groupes à l'origine du conflit d'Ituri.
Dans le Nord-Est, la LRA de Joseph Kony (LRA pour Lord's Resistance Army, l'Armée de résistance du Seigneur), s'est déplacée depuis sa base originelle en Ouganda (où elle a mené une rébellion pendant vingt ans) ou au Sud-Soudan, jusqu'en république démocratique du Congo, en 2005, et a établi des campements dans le parc national de Garamba.
Dans le Nord du Katanga, les Maï-Maï (anciennes milices créées par Laurent-Désiré Kabila pour lutter contre les milices rwandaises et ougandaises dans le Kivu, mais oubliées dans l'accord de Lusaka en 1999) ont échappé au contrôle de Kinshasa.
an 2006 : Gambie - En 2006 Jammeh est réélu pour un troisième mandat à 66 %. Une tentative de coup d’État a eu lieu en 2006 : l’ancien chef de l’armée est accusé.
an 2006 : Libéria - Au sujet de la formation de son gouvernement, Ellen Johnson Sirleaf a affirmé son intention de « former un gouvernement d'unité qui dépassera les lignes de fracture entre les partis, les ethnies, et les religions ». Avançant comme unique condition le fait de ne pas être corrompu, elle n'exclut pas la participation de George Weah au gouvernement, en déclarant : « Mais le pays ne va pas cesser de fonctionner s'il n'est pas dans le gouvernement. Nous allons avancer, avec ou sans lui ».
Ellen Johnson Sirleaf prête serment le 16 janvier en présence de nombreux personnages politiques, dont le perdant du second tour, George Weah. Au niveau international on peut noter la présence marquée pour l'aboutissement du processus de transition de la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, accompagnée de la première dame Laura Bush et de sa fille. Les officiels présents pour l'Afrique étaient le président Thabo Mbeki (Afrique du Sud), Abdoulaye Wade (Sénégal), Mamadou Tandja (Niger), John Kufuor (Ghana) et Ahmad Tejan Kabbah (Sierra Leone). La France était représentée par Brigitte Girardin, ministre délégué à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, la Chine par le ministre des Affaires étrangères Li Zhaoxing, la Guinée par le Premier ministre Cellou Dalein Diallo et la Côte d'Ivoire par Simone Gbagbo, épouse du président Laurent Gbagbo. Lors de son discours, elle a une fois de plus mis l'accent sur le fait que son gouvernement sera d'union nationale : « Mon gouvernement tendra la main de l'amitié et de la solidarité pour rallier tous les partis politiques [...] en tournant le dos à nos différences » et que la lutte contre la corruption sera l'une de ses priorités. Elle remplace donc officiellement Gyude Bryant. Concernant le Parlement, les deux nouveaux présidents de chacune des chambres ont également prêté serment ce même jour. Il s'agit d'Isaac Nyenabo pour le Sénat et d'Edwin Snowe pour l'Assemblée nationale.
an 2006 - 2007 : Madagascar - Après avoir lancé la reconstruction de routes et d'une partie des infrastructures du pays, Marc Ravalomanana est réélu lors de l'élection du 3 décembre 2006 en gagnant au premier tour avec la majorité absolue devant 13 autres prétendants, et est investi de nouveau président de la République de Madagascar pour un nouveau mandat de 5 ans.
Il appelle de nouveau les Malgaches aux urnes pour le 4 avril 2007 pour un référendum qui a pour objet principal la suppression des six « provinces autonomes » et l'instauration des « régions » au nombre de 22.
an 2006-2009 : Mali - Troisième rébellion touarègue.
an 2006 : Mozambique - En 2006, le pays compte 19 millions de Mozambicains dont un tiers vivant dans les villes, conséquence d'une urbanisation rapide intervenue au cours de l’interminable guerre civile.
S’il demeure l’un des pays les plus pauvres du monde, où l’espérance de vie est d’à peine 41 ans, le Mozambique connaît depuis 1995 une croissance annuelle exceptionnelle qui atteint 9 % en 2005. La Banque mondiale cite ainsi le Mozambique comme « un modèle de réussite. Une réussite en termes de croissance, et un modèle qui montre aux autres pays comment tirer le meilleur parti de l’aide internationale », même si la pauvreté reste omniprésente, plus de la moitié des habitants vivant encore en dessous du seuil de pauvreté.
an 2006 : Somalie - Depuis le 26 février 2006, le gouvernement de transition siège à Baidoa, en Somalie.
Au début du mois de juin 2006, les affrontements entre les membres de l'Alliance pour la restauration de la paix et contre le terrorisme (ARPCT), une alliance entre des chefs de guerre et le gouvernement fédéral de transition, soutenu par Washington, et l'Union des tribunaux islamiques, soutenus par de nombreux entrepreneurs de la capitale, ont vu la victoire de ces derniers pour le contrôle de Mogadiscio. Le nouveau régime serait soutenu par l'Érythrée, l'Iran et divers pays arabes, tandis que le gouvernement fédéral de transition, replié sur Baidoa, bénéficierait de l'appui militaire de l'Éthiopie. Le rétablissement de l'ordre se fait au nom de la seule structure législative stable et consensuelle du pays, la jurisprudence chaféite.
Le 13 juin 2006 à Nairobi, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui regroupe le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée et le gouvernement de transition de Somalie, décide d'interdire l'accès au territoire de ses pays membres aux miliciens de l'ARPCT fuyant devant l'avancée des tribunaux islamiques dont le plus important, celui de Mogadiscio, est nommé Hifka-Halane. Il sert de pouvoir judiciaire (civil et pénal), en jugeant les affaires en appliquant la charia.
Début décembre 2006, les Nations unies autorisent le déploiement d'une force de maintien de la paix, composée de 8 000 hommes, sous l'égide de l'Union africaine24 (résolution 1725). Fin décembre 2006, l'armée éthiopienne intervient et les tribunaux islamiques fuient Mogadiscio. Elle prend ainsi le contrôle de la majeure partie du pays et le gouvernement de transition se déclare le gouvernement de facto du pays.
Du 20 au 31 décembre 2006, l'Éthiopie est entrée en guerre contre l'Union des tribunaux islamiques. La loi martiale a été décrétée le 30 décembre 2006 par le premier ministre somalien du gouvernement fédéral de transition, Ali Mohamed Gedi, et un délai de trois jours a été donné aux Somaliens pour remettre leurs armes à feu aux troupes éthiopiennes ou fédérales, avec un suivi très faible.
an 2006 : Soudan - En 2006, le gouvernement de Khartoum rejette le déploiement de « Casques bleus » au Darfour. Mais il accepte finalement l'année suivante le déploiement au Darfour d’une « force hybride » associant l’ONU et l’Union africaine (la MINUAD).
an 2006-2010 : Tchad - Alors que le président Déby fait modifier la constitution pour supprimer la limite de deux mandats présidentiels, une guerre civile éclate, contestant cette mainmise sur le pouvoir. Le président réussit à se maintenir au pouvoir et à être réélu, lors d'élections contestées boycottées par l'opposition. Entre 2006 et 2008, les forces d'opposition rebelles tentent plusieurs fois de prendre la capitale par la force, mais échouent systématiquement.
Le 13 avril 2006, des combats éclatent entre les troupes du président de la République et une faction de la rébellion, le Front uni pour le Changement (FUC), dans la périphérie de N'Djaména. Idriss Déby Itno accuse le Soudan, en pleine guerre du Darfour, de soutenir ses adversaires, à l’aube des élections présidentielles.
Malgré l’opposition et les appels au boycott, le 3 mai 2006, Idriss Déby Itno est réélu au suffrage universel avec 64,67 % des votes exprimés.
Le 2 février 2008, les rebelles, en provenance du Soudan frontalier, s’emparent de la capitale du Tchad, N'Djaména, à l'exception du palais présidentiel où le président Idriss Déby Itno semble s'être cloîtré. La France décide d’évacuer une partie de ses ressortissants. Le 4 février 2008, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques contre le gouvernement tchadien, dont l’armée rencontre des difficultés à repousser les rebelles. La France, via l’opération Épervier, apporte alors une aide logistique qui permet d’assurer la stabilité régionale au Tchad.
Mais les rebelles mènent une guerre de mouvement dans l’Est du Tchad, afin de faire tomber le gouvernement au pouvoir. Les attaques répétées ont pour conséquence de provoquer en juin 2008 un combat opposant pour la première fois la mission militaire européenne EUFOR et les rebelles au sud d’Abéché, autour de la ville de Goz Beïda. En novembre 2008, dans l’Est du pays, deux véhicules militaires belges sont brûlés, à la suite de tirs provenant d’hélicoptères soudanais.
En mai 2009 a lieu une autre offensive de la rébellion partant du Soudan, toujours dans l'objectif de renverser Idriss Déby. Le contingent militaire français de l'opération Épervier est suppléé, entre 2007 et 2009, par la force d'interposition EUFOR, forte de 3 000 soldats, mandatée par l'Union européenne à la demande de la France, en principe neutre mais qui assure un soutien de fait au régime du président Déby.
Finalement, en 2010, le président soudanais Omar el-Bechir se rend au Tchad pour normaliser les relations entre les deux pays. Le gouvernement du Tchad refuse d’arrêter ce dernier, pourtant visé par des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale émis à son encontre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour.
an 2007-2008 : Burkina Faso - contre le coût élevé de la vie. En juin 2008, l'université de Ouagadougou connaît une grève massive, qui se solde par une reprise en main brutale de l'université par le pouvoir : suppression de toutes les prestations sociales étudiantes (bourses, restauration, résidences universitaires vidées en deux jours) après tirs à balles réelles sur les étudiants.
an 2007 : Afrique Côte d'Ivoire - Appliqué avec beaucoup de difficultés, l’accord de Linas-Marcoussis est suivi par plusieurs autres, conclus en Afrique et mis en œuvre par les gouvernements successifs de Seydou Diarra, Charles Konan Banny.
L’accord politique de Ouagadougou conclu en 2007 avec Laurent Gbagbo, sous l’égide du président burkinabé Blaise Compaoré, qui fait office de facilitateur, offre aux Forces nouvelles le poste de Premier ministre. Les Forces nouvelles désignent leur secrétaire général, Guillaume Soro, le 26 mars 2007 pour exercer cette fonction.
Guillaume Soro entre en fonction le 4 avril et son gouvernement est installé trois jours plus tard. Le gouvernement doit mettre en place notamment deux points clefs de l'accord politique de Ouagadougou : la préparation d'élections devant se tenir dans les dix mois à compter de mars 2007, puis l'unification des Forces armées des Forces nouvelles (FAFN) et des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire (FANCI).
Dans le gouvernement Soro I composé de 33 membres, la formation militaro-politique de celui-ci (les Forces nouvelles de Côte d'Ivoire) et le Front populaire ivoirien (FPI), formation politique dont est issu le président Laurent Gbagbo, disposent chacun de huit portefeuilles (le Premier ministre y compris). Les autres portefeuilles sont répartis entre divers autres partis politiques. Ainsi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) en détient 5, le Rassemblement des républicains (RDR) 5, le Mouvement des forces d'Avenir (MFA) un, le Parti ivoirien des travailleurs (PIT) un, l’Union démocratique de Côte d'Ivoire (UDCI) un et l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) un ; deux autres ministres sont réputés proches du Président de la République et un ministre est issu de la société civile.
Concrètement, outre la gestion des affaires relevant de ses compétences traditionnelles, le gouvernement coordonne la mise en œuvre du processus de sortie de crise au moyen de programmes spécifiques. Il s’agit d’un dispositif technique comprenant notamment le Centre de commandement intégré (désarmement des combattants), le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire, le Comité national de pilotage du redéploiement de l'Administration (restauration de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire et reprise du fonctionnement des services publics), l’Office national d'identification (identification des populations et des électeurs) et la Commission électorale indépendante (organisation des élections).
an 2007 : Guinée - Le pouvoir du président, sous influence d'hommes d'affaires comme Mamadou Sylla, est de plus en plus contesté. Début 2007 éclate une grève générale réprimée dans le sang.
an 2007 : Kenya - Lors de l'élection présidentielle du 27 décembre 2007, Raila Odinga reçoit un soutien massif dans les provinces de Nyanza, occidentale, de la vallée du Rift et de la côte mais aussi de personnalités emblématiques telle Wangari Maathai. Dans la soirée du 30 décembre 2007, Samuel Kivuitu (en), qui vient juste d'être reconduit, pour cinq ans, par Kibaki à son poste de président de la commission électorale (Electoral Commission of Kenya), déclare Raila Odinga battu par 232 000 voix de différence en faveur du président sortant contrairement aux tendances des derniers résultats enregistrés. Controversée par les observateurs de l'Union européenne qui demande un recomptage des bulletins de vote, cette annonce est immédiatement contestée par le camp de Raila et entraine la plus grande crise de violence survenue au Kenya.
an 2007 : Mali - Le 29 avril 2007, Amadou Toumani Touré est réélu au premier tour avec 71,20 % des voix, mais cette élection est contestée par les principaux candidats de l’opposition. Les relations commerciales, politiques et culturelles avec la France se ralentissent tandis que celles avec la Chine, la péninsule arabique et les États-Unis se renforcent.
an 2007-2008 : Mauritanie - Le 25 mars 2007, Sidi Ould Cheikh Abdallahi est le premier civil à être élu président de le République démocratiquement, le colonel Ely Ould Mohamed Vall, conformément à ses engagements, ne s’étant pas présenté. En avril 2007 la Mauritanie réintègre l’Union Africaine, dont elle avait été exclue après le coup d’État de 2005. Pour la première fois, des membres du parti islamique modéré rejoignent le gouvernement en mai 2008.
Esclavage :
La société mauritanienne reste dominée par la caste des Beydanes, qui a historiquement fondé son pouvoir sur l'esclavage des castes inférieures.
L’esclavage reste courant en Mauritanie, le président de l’IRA (Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste) Biram Dah Abeid considère la Mauritanie comme un régime « d’apartheid non écrit ». Certains parmi la minorité Maures (arabo-berbère) y exploitent des Haratines dans les quartiers riches des grandes villes. Selon le rapport de l’ONG Walk Free publié en 2014 environ 4% de la population mauritanienne, soit 150 000 personnes vit en situation d’esclavage. La Mauritanie est le pays le plus touché au monde par ce phénomène. Selon Biram Abeid, la réalité se rapproche plus des 20% de la population.
L'esclavage a été officiellement aboli à quatre reprises (la dernière fois en 1980, avec un succès mitigé) mais les ségrégations raciales, tribales ou de castes y subsistent. En 2007 a été votée une loi criminalisant l'esclavage, et des actions sont prévues par le gouvernement pour lutter contre ses séquelles, car l'ethnie haratine des anciens esclaves reste parmi la plus défavorisée. Selon le Global Slavery Index, l'esclavage concerne 4 % de la population mauritanienne.
an 2007-2010 : Nigéria - En 2007 des élections une nouvelle fois agitées amènent au pouvoir le successeur désigné d'Olusegun Obasanjo : Umaru Yar'Adua, qui décède le 5 mai 2010. Son vice-président Goodluck Jonathan lui succède alors.
an 2007-2009 : Rwanda - La veille de la commémoration du 7 avril 2007, l'ancien Président de la République, Pasteur Bizimungu, est gracié par le Président Paul Kagame. Cette incarcération était vivement contestée par des ONG qui y voyaient un prétexte pour écarter un éventuel rival politique. Pasteur Bizimungu avait en effet symbolisé une réconciliation possible entre Tutsi et Hutu après le génocide.
La peine de mort est abolie au Rwanda en milieu d'année 2007. Cette abolition était demandée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda afin que, dans le cadre de la cessation de ses activités, prévue dans ses statuts en 2008 et 2010 pour la cour d'appel, il puisse transférer des détenus et des dossiers de présumés génocidaires au Rwanda.
Le président du Parti Vert rwandais, Frank Habineza, fait également état de menaces. En octobre 2009, une réunion du Parti des Verts rwandais est violemment interrompue par la police Quelques semaines seulement avant les élections, le 14 juillet 2009, André Kagwa Rwisereka, le vice-président du Parti vert démocratique, est retrouvé mort, à Butare, au sud du Rwanda. Le climat interne est marqué par des meurtres ou des arrestations de journalistes toujours selon Amnesty International.
L'analyse publique des politiques et pratiques du gouvernement est limitée au sein du pays par les limites de la liberté de la presse. En juin 2009, le journaliste du journal Umuvugizi Jean-Leonard Rugambage est abattu devant son domicile à Kigali. En juillet 2009, Agnes Nkusi Uwimana, rédactrice en chef du journal Umurabyo, est accusée d'« idéologie du génocide" ».
an 2007: Sénégal - Abdoulaye Wade est facilement réélu lors de l’élection présidentielle de 2007, et malgré le mot d’ordre de boycott de l’opposition lors des élections législatives consécutives, il dispose d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale et au Sénat, rétabli en début d’année. Le Président mène une politique libérale ouvertement revendiquée qui donne certains résultats. En effet le Sénégal devient une terre d’élection pour les investisseurs d’Europe, mais aussi des émirats du Golfe – c’est le cas de Dubaï Ports World qui enlève l’exploitation du port de Dakar –, du Brésil, de Chine, d’Iran ou d’Inde – par exemple avec le géant mondial de la sidérurgie, Arcelor Mittal. Abdoulaye Wade appelle également à la création d’États-Unis d’Afrique et de grands travaux d’infrastructures ont été lancés en vue du 11e sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) qui s’est tenu à Dakar en mars 2008.
Mais la politique gouvernementale essuie aussi des revers, comme l’inexorable recul du secteur agricole (arachide, coton…), l’effondrement de l’industrie chimique en 2006, le développement insuffisant du secteur tertiaire ou l’engorgement persistant de la capitale.
Le pays reste très dépendant de l’aide extérieure, notamment des subsides envoyés par l’importante diaspora sénégalaise. Le ralentissement de la crois sance et un taux de chômage élevé poussent bien des jeunes Sénégalais à l’émigration, parfois au péril de leur vie. L’augmentation du coût de la vie, notamment liée à la hausse des cours du pétrole, suscite des manifestations de rue en novembre 2007.
Beaucoup dénoncent aussi une dérive autoritaire du pouvoir, – guère tempérée par un Premier ministre généralement présenté avant tout comme un technocrate, Cheikh Hadjibou Soumaré , et qui laisse une marge de manœuvre réduite à l’opposition, ainsi qu’aux médias, pour la plupart solidaires de l’action présidentielle.
La question de la future succession d’Abdoulaye Wade, réélu à 80 ans, apparaît en filigrane dans le débat politique actuel, alimenté notamment par les spéculations sur les intentions de son fils Karim Wade.
an 2007 : Somalie - En janvier 2007, les États-Unis interviennent dans le sud de la Somalie pour pourchasser des membres présumés d'Al-Qaïda.
Le 23 janvier 2007, les troupes éthiopiennes commencent officiellement à se retirer de Somalie. Peu fréquent auparavant, les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du 29 octobre 2008 sont attribués au groupe al-Shabaab)
an 2008 : Afrique du Sud - En 2008, une grave pénurie d'électricité achève le bilan économique du président, à qui la presse reproche l'imprévoyance de son gouvernement, ainsi qu'à celui de Nelson Mandela, pour avoir refusé, en 1996, d'investir dans la construction de nouvelles centrales électriques alors que le pays connait une croissance de la demande en électricité de 10 % chaque année. Les grandes villes sont, pendant plusieurs semaines, périodiquement plongées pendant quelques heures dans l'obscurité alors que le gouvernement est contraint de promouvoir le rationnement, de renoncer à certains grands projets créateurs d'emplois et de suspendre ses exportations d'électricité vers les pays voisins. En mai, le gouvernement est confronté à une vague de violences contre les immigrés, caractérisée notamment par des meurtres, des pillages et des lynchages.
Mis en cause indirectement pour des « interférences » politiques dans des affaires judiciaires impliquant son ancien vice-président, Thabo Mbeki est contraint de démissionner de la présidence sud-africaine le 21 septembre 2008 après avoir été désavoué par son parti.
L'ANC nomme alors le vice-président du parti, Kgalema Motlanthe, pour lui succéder. Cela s'accompagne d'un schisme au sein de l'ANC et la création du Congrès du Peuple (COPE) par les partisans de l'ancien président.
an 2008 : République de Botswana - Le nouveau président est le lieutenant-général Ian Khama qui entre en fonction 2008, en prévision des élections de 2009. Il est le fils du premier président du Botswana, et un ancien chef de l'armée du Botswana (BDF). Élu formellement en 2009 et réélu en 2014, il demeure en fonction jusqu'en 2018, date à laquelle il démissionne pour laisser la place au vice-président Mokgweetsi Masisi qui lui succède.
an 2008 : Cameroun - En février 2008, des émeutes éclatent, réclamant la baisse des prix et le départ de Paul Biya. Les manifestants sont sévèrement réprimés : une centaine de morts, des milliers d’arrestations.
Le projet de Paul Biya de modifier la Constitution en février 2008 donne lieu à des manifestations brutalement réprimées ; une centaine de personnes sont tuées.
an 2008 : Cap Vert - Le 23 juillet 2008, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) accueille le Cap-Vert qui devient le 153e pays membre. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux principaux partis, le Mouvement pour la démocratie (MPD), et le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV, l'ancien parti unique), qui se succèdent au pouvoir, et quelquefois y cohabitent (avec un président de l'un et un premier ministre de l'autre). L'archipel souffre par contre du réchauffement climatique et de sécheresses, d'autant plus que l'eau douce y est rare. Les gouvernements ont opté pour une politique de développement des énergies renouvelables, ainsi que de l'écotourisme.
an 2008 : Afrique République de Djibouti - La frontière reste donc inchangée, l'île est indivise entre les deux pays. Douméra est le prétexte de l'affrontement entre les forces érythréennes et djiboutiennes de juin 2008.
an 2008-2009 : Afrique République de Djibouti - Le 10 juin 2008 éclate la guerre djibouto-érythréenne qui a opposé l'Érythrée à Djibouti autour du cap (ras) Douméra. Djibouti accuse Asmara d'avoir financé le mouvement armé anti-gouvernemental du Front pour la restauration de l’unité et la démocratie entre 1991 à 1994. L'Érythrée revendique la zone du cap Douméra, point littoral de la frontière entre les deux pays. En janvier 2009, par la résolution 1862 du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil de sécurité des Nations unies impose des sanctions contre l'Érythrée.
an 2008-2018 : Érythrée - Enfin, un différend territorial oppose par ailleurs l'Érythrée à Djibouti sur sa frontière sud depuis 2008 qui vaut à l'Érythrée des sanctions des Nations unies, sanctions levées le 14 novembre 2018. Le Conseil a ainsi adopté à l'unanimité cette résolution élaborée par la Grande-Bretagne et levé l'embargo sur les armes, toutes les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et autres sanctions.
an 2008-2012 : Ghana - Le président Kufuor quitte le pouvoir en 2008, respectant comme son prédécesseur, la limite du nombre de mandat possible. La décision du Nouveau Parti Patriotique est de choisir Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le fils de Edward Akufo-Addo comme leur candidat, tandis que le Congrès National Démocratique choisit John Atta Mills pour la troisième fois.
Le 28 décembre 2008, au terme d'une élection présidentielle très disputée et unanimement saluée pour son caractère démocratique, le candidat du Congrès démocratique national (Ghana), John Atta Mills, devient le nouveau président du pays. La passation de pouvoir s'est déroulée le 7 janvier 2009. John Atta Mills bénéficie ensuite de l'exploitation de forages pétroliers qui créent une dynamique nouvelle. La gestion de cette manne, qui soulève de grands espoirs dans la population, se veut basée sur un modèle norvégien avec « une industrie pétrolière où le sens de l’équité et de la justice doivent être reproduits localement pour le bénéfice de tous les Ghanéens »
Le 24 juillet 2012, le président meurt. Le pouvoir est transmis au vice-président, John Dramani Mahama, et des élections sont convoquées18. Il choisit le Gouverneur de la Banque du Ghana, Amissah Arthur, comme nouveau vice-président. Il est confirmé à son poste par le scrutin de décembre 201220. Son mandat est perturbé par une croissance en berne et des scandales de corruption et il perd l'élection présidentielle de 2016 face au chef de l'opposition Nana Akufo-Addo.
Industrialisation, opération séduction des investisseurs étrangers, lutte contre le paludisme, les initiatives s'enchaînent. Réputé pour sa stabilité politique, son fonctionnement démocratique et son dynamisme, le pays accueille Melania Trump après Barack Obama, mais aussi Angela Merkel ou encore Emmanuel Macron.
an 2008-2009 : Guinée - Le 22 décembre 2008, Lansana Conté décède des suites d'une longue maladie (leucémie et diabète aigu) à l'âge de 74 ans. Au cours de la nuit suivante, les proches du régime s'affairent pour organiser l'intérim suivant les procédures prévues par la Constitution mais le 23 décembre 2008 au matin, à la suite de l'annonce du décès de Lansana Conté, des dignitaires de l'armée annoncent unilatéralement la dissolution du gouvernement ainsi que la suspension de la Constitution, dans un discours à teneur résolument sociale. Ces événements laissent planer le doute sur l'effectivité d'un nouveau coup d'État. Le même jour, le capitaine Moussa Dadis Camara est porté à la tête du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et devient le lendemain, le troisième président de la République de Guinée.
an 2008 : Kenya - Fin février 2008, grâce à la médiation de Kofi Annan, l'ancien Secrétaire général des Nations unies, un accord de partage du pouvoir entre le président Kibaki et Raila est signé et entériné à l'unanimité par le Parlement le 18 mars pour résoudre la crise. Il se matérialise par la nomination de Raila Odinga au poste de Premier ministre le 13 avril suivant. Quatre jours plus tard, il prête serment et un gouvernement de coalition est constitué.
an 2008 : Libéria - L'ancien président Charles Taylor est jugé pour l'armement et le soutien aux rebelles de Sierra Leone depuis le 7 janvier 2008 à La Haye. Il plaide non coupable.
an 2008 : Mauritanie - Le 6 août 2008, à la suite du limogeage d'officiers supérieurs, les militaires conduits par le chef du bataillon chargé de la sécurité présidentielle, le général Mohamed Ould Abdelaziz, déposent le président Abdallahi. Il est assigné à résidence durant 4 mois et demi. Les principaux partis d’opposition, à l'exception du RFD d’Ahmed Ould Daddah se réunissent en un Front national pour la défense de la démocratie (FNDD) et s'opposent au coup d’État.
an 2008 : Somalie - les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du 29 octobre 2008 sont attribués au groupe al-Shabaab)
Le 29 décembre 2008, le président Abdullahi Yusuf Ahmed annonce sa démission, déclarant qu'il regrette n'avoir pas pu mettre fin au conflit somalien. Le Parlement, réuni à Djibouti en raison du désordre en Somalie, élit alors le cheikh Sharif Ahmed, ancien dirigeant de l'Union des tribunaux islamiques, à la présidence de la République. Il l'emporta face à Maslah Mohamed Siad Barre, fils de l'ancien président Mohamed Siad Barre, et au Premier ministre sortant Nur Hassan Hussei.
an 2008 - 2010 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 2008, les élections présidentielle et législatives du 29 mars constituent un revers pour la ZANU. Le MDC remporte la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale (109 élus contre 97 élus à la ZANU). Publiés le 2 mai, le résultat de l’élection présidentielle est contesté. En obtenant officiellement près de 48 % des suffrages en dépit des fraudes, Morgan Tsvangirai devance néanmoins Robert Mugabe (43 %). Lors de la campagne du second tour, le pays est le théâtre de violences politiques continues marquées par des exactions commises par la police contre des membres de l'opposition et leur famille mais aussi par l’arrestation de ses principaux chefs31. Dans ce climat de terreur, Morgan Tsvangirai décide à cinq jours du second tour de l’élection présidentielle de boycotter celle-ci, permettant ainsi à Robert Mugabe d’être réélu. L’inflation dépassant les 10 millions de % en rythme annuel, l'édition de billets de 100 milliards de dollars zimbabwéens (environ 3 EUR fin juillet 2008) devient nécessaire. La population est contrainte de revenir à une économie de troc et à la marche à pied : il n'y a plus de gazole pour faire rouler les bus.
De plus, à partir du mois d'août, une épidémie de choléra sévit dans le pays ; elle fait, selon l'OMS, 2 971 morts, pour 56 123 personnes contaminées (chiffres officiels au 27 janvier 2009). Toujours d'après l'OMS, jusqu'à la moitié des 12 millions de Zimbabwéens sont susceptibles de contracter la maladie en raison de l'insalubrité des conditions de vie dans le pays. En 2009, sous la pression de l'ONU quant aux fraudes concernant l'élection présidentielle, Robert Mugabe décide de partager le pouvoir avec son opposant et rival personnel Morgan Tsvangirai, chef du Mouvement pour le changement démocratique (MDC). En avril 2010, Mugabe reçoit le président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, avec lequel il conclut huit accords commerciaux entre les deux pays. Cette visite n'est pas bien perçue par l'opposition et par le reste du monde.
an 2009-2010 : Afrique du Sud - En mai 2009, Jacob Zuma est élu président de la république après la victoire de l'ANC (65,90 %), lors des élections générales, face notamment à l'alliance démocratique (16,66 %) d'Helen Zille, qui remporte la province du Cap occidental, et face au Congrès du Peuple (7,42 %) de Mosiuoa Lekota. Il hérite d'un pays toujours considéré comme le poumon économique de l'Afrique subsaharienne (40 % du PIB de l'Afrique subsaharienne) mais où le crime, sans distinction raciale, est omniprésent, faisant de ce pays l'un des plus dangereux du monde au côté de l'Irak et de la Colombie, où l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'est accentué, où la politique de discrimination positive est contestée pour son inefficacité et où les tentatives de réforme agraire n'ont débouché que sur des échecs. Le nouveau gouvernement qu'il forme est alors plus ouvert aux autres partis et autres races que ne l'était celui de Mbeki. Il fait notamment entrer au gouvernement Jeremy Cronin, un Blanc par ailleurs secrétaire général adjoint du parti communiste sud-africain et Pieter Mulder, chef du front de la liberté, le parti de la droite afrikaner qui a succédé à l'ancien parti conservateur.
En 2010, quinze ans après avoir organisé avec succès la coupe du monde de rugby, marquée par la victoire de l'équipe nationale, les Springboks, l'Afrique du Sud est le pays hôte de la coupe du monde de football. Deux mois avant l'évènement sportif, le 3 avril 2010, l'assassinat, dans sa ferme, d'Eugène Terre'Blanche par deux de ses ouvriers agricoles fait craindre un moment un réveil des tensions raciales dans une Afrique du Sud toujours minée par ces conflits latents. Le très influent leader de la Jeunesse de l'ANC, Julius Malema, connu pour ses outrances verbales à l'encontre de Thabo Mbeki et des opposants à Zuma, pour qui il se déclarait prêt à tuer, est mis en cause pour avoir repris dans ses discours une chanson prônant de « tuer les Boers » parce que « ce sont des violeurs ». Dans les campagnes sud-africaines, le modèle zimbabwéen reposant sur la carte raciale et la carte de la terre a beaucoup de partisans. L'épisode du meurtre de Terre'Blanche souligne ce malaise en zone rurale où plus de 2 500 fermiers blancs ont été tués en une dizaine d'années, souvent dans d'atroces conditions et le fait que des ouvriers agricoles noirs sont souvent mal payés et maltraités par leurs employeurs.
an 2009 : Algérie - Pendant les mois de mars et d'avril de l'année 2009, la campagne électorale pour la présidentielle se déclenche à la suite d'un nouvel amendement constitutionnel. Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014.
an 2009-2011 : Afrique - les Comores - Il est organisé le 29 mars 2009 et 95,2 % des votants acceptent le changement de statut, faisant de Mayotte le 5e département d'outre-mer (DOM) et le 101e département français en 2011.
Mayotte fait partie des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Elle devrait devenir une région ultrapériphérique de l'Union européenne au moment de sa départementalisation. Le pays souverain formé par les trois îles s'appelle aujourd'hui Union des Comores.
an 2009 : Congo Brazzaville - Denis Sassou-Nguesso est de nouveau réélu président du Congo, avec 78,61 % des voix à l'issue du vote du 12 juillet.
an 2009-2016 : Gabon - Le 3 septembre 2009, Ali Bongo, ministre de la Défense et fils d'Omar Bongo Ondimba, devient le troisième président du Gabon, élu à l'occasion d'un scrutin majoritaire à un tour, avec 41,79 % des suffrages exprimés, soit environ 141 000 voix sur un total de 800 000 électeurs inscrits. Il devance Pierre Mamboundou, crédité de 25,64 % des voix, et André Mba Obame, le nouveau chef de l'opposition gabonaise et ancien ministre de l'Intérieur. Les résultats sont fortement contestés et à la suite des forts soupçons de fraude, des émeutes éclatent et sont violemment réprimées par les forces de l'ordre, fidèles au pouvoir.
Par la suite, plusieurs enquêtes attestèrent que les scores avaient été truqués. Dans un documentaire diffusé sur France 2 en décembre 2010, le diplomate Michel de Bonnecorse, ex-conseiller Afrique du président Jacques Chirac, confirmera cette version des faits. L’ambassadeur américain Charles Rivkin, dans un télégramme transmis en novembre 2009 à la secrétaire d’État, le confirme également : « octobre 2009, Ali Bongo inverse le décompte des voix et se déclare président » (le télégramme sera divulgué par WikiLeaks en février 2011).
Depuis, le président Bongo prône le concept de « Gabon émergent », politique visant notamment à la diversification de l'économie afin de diminuer sa dépendance aux cours mondiaux du pétrole.
an 2009 Guinée - Le 28 septembre 2009, des mouvements civils organisent une manifestation pacifique pour demander à Dadis Camara de respecter sa parole et de ne pas se présenter aux présidentielles. Une foule de plusieurs milliers de personnes s'était rendu au stade à la demande de l'opposition pour protester contre le désir du président Dadis de se porter candidat à l'élection présidentielle. Le 28 septembre 2009, au stade de Conakry, à la surprise générale les militaires ouvrent le feu sur les manifestants ainsi bloqués dans le stade sans possibilité de fuite. Ce massacre délibéré et manifestement planifié fait plusieurs centaines de morts. De plus, les militaires violent et enlèvent plusieurs dizaines de jeunes femmes, dont certaines seront libérées quelques jours plus tard après avoir subi des viols à répétition, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de trace.
À la suite du tollé international soulevé par cet évènement, des dissensions apparaissent au sein du CNDD34 et le 3 décembre 2009, alors que Sékouba Konaté est en voyage au Liban, le président est grièvement blessé par son aide de camp Aboubacar Sidiki Diakité - ce dernier avait été mis en cause explicitement par des diplomates étrangers pour son rôle dans le massacre du 28 septembre, et craignait d'être « lâché » par son président et livré à la justice. Dadis Camara est hospitalisé au Maroc le 4, et Sékouba Konaté rentre au pays pour assurer l'intérim.
an 2009 : Guinée-Bissau - le 1er mars 2009, le chef d'état-major des forces armées, le général Batista Tagme Na Waie, est tué dans un attentat à la bombe. Le président João Bernardo Vieira, que certains militaires tiennent pour responsable de cet attentat dans la mesure où il entretenait des relations historiquement exécrables avec ce dernier, est assassiné à son tour, le 2 mars 2009, par des hommes en armes. Pour lui succéder, Malam Bacai Sanhá, candidat du PAIGC, est élu président le 26 juillet 2009.
Parallèlement, la Guinée-Bissau est gangrenée par le trafic de drogue et qualifiée à ce titre de « narco-État » par l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime. Ainsi, les attentats contre le chef d'état-major Tagmé Na Waié et le président Vieira ont probablement été fomentés par les trafiquants colombiens, peut-être en représailles de la destitution en août 2008 du contre-amiral José Américo Bubo Na Tchuto, chef de la marine nationale, qui couvrait le trafic avec Antonio Indjai. Ce dernier, après bien des péripéties, tombera d'ailleurs en mars 2013 dans un piège tendu par la DEA et envoyé aux États-Unis pour y être jugé pour trafic de drogue tandis qu'Antonio Indjai est depuis lors inculpé par la justice américaine et sous mandat d'arrêt international.
Le mandat de Malam Bacaï Sanha est émaillé de graves incidents en lien avec le narcotrafic. Le 1er avril 2010, une tentative de coup d'État menée par Antonio Indjai et l'ancien contre-amiral José Américo Bubo Na Tchuto aboutit à l'arrestation du Premier ministre Carlos Gomes Júnior et d'une quarantaine d'officiers dont le chef d'état-major de l'armée, José Zamora Induta, dans un coup de force présenté comme « un problème purement militaire ». À la suite de manifestations de soutien au Premier ministre, Antonio Indjai menace de tuer ce dernier avant d'expliquer dans une allocution que l'armée « réitérait son attachement et sa soumission au pouvoir politique ». Le Premier ministre est relâché le lendemain tandis qu'Indjai se présente comme le nouvel homme fort de l'armée. Ce dernier est relâché le lendemain, mais demeure en résidence surveillée, tandis qu'Antonio Indjai devient le nouvel homme fort de l'armée.
an 2009 : Libéria - Constatant une certaine stabilité politique, la Banque européenne d'investissement accorde le 15 mai 2009 un prêt de 3,5 millions d'euros au Liberia pour le soutien de la micro finance dans ce pays ainsi que la suspension des remboursements de l'encours du solde de la dette jusqu'en 2012. Mais la corruption continue de gangrener le système politique, malgré les intentions initialement affichées.
an 2009 : Madagascar - À partir de janvier 2009, une crise politique entre le maire de la capitale Andry Rajoelina et le président Marc Ravalomanana fait une centaine de victimes. Le 16 mars 2009, le président Marc Ravalomanana démissionne. Il transfère les pleins pouvoirs à un Directoire militaire composé des plus hauts gradés de l'Armée malgache, en lieu et place du président du Sénat comme le prévoyait la constitution, lequel directoire (re)transfère le jour même le pouvoir à Andry Rajoelina. Cette prise de pouvoir, validée par la Haute Cour Constitutionnelle malgache (HCC), est toutefois considérée par une grande partie de la Communauté internationale comme un coup d'État. Du 17 mars 2009 au 25 janvier 2014, Andry Rajoelina dirige l’État malgache sous le régime de la Transition.
an 2009 : Mauritanie - En avril 2009, Mohamed Ould Abdel Aziz abandonne le pouvoir afin de se présenter à l'élection présidentielle promise par la junte. Un accord pour préparer les futures élections est signé à Dakar entre les représentants de l’opposition et de la junte.
Le 18 juillet, Mohamed Ould Abdelaziz, qui durant sa campagne se présente comme le « président des pauvres », est élu au premier tour face à 8 autres candidats, avec 52,58% des voix. Ses opposants dénoncent un « coup d’État électoral » et fondent une Coordination de l’opposition démocratique, qui inclut le RFD.
L'arrivée du président actuel Mohamed Ould Abdel Aziz, le 18 juin 2009, fut marquée notamment par la coupure de ces relations diplomatiques avec Israël.
an 2009 : Mozambique - Le 28 octobre 2009, Armando Guebuza est réélu président pour un deuxième mandat, dès le premier tour de scrutin avec 75 % des voix
an 2009 : Ouganda - Des tensions apparaissent également avec le Kabaka (roi) du Buganda et dégénèrent en affrontements en 2009.
Dans un mouvement de populisme, une loi anti-homosexualité fut proposée en 2009 prévoyant jusqu'à la peine de mort pour les homosexuels et pénalisant les individus, entreprises, médias et ONG soutenant les droits des LGBT.
an 2009 : Sénégal - Lors des élections locales du 22 mars 2009, le PDS, parti au pouvoir, essuie un sérieux revers dans la plupart des grandes villes dont Dakar convoité par Karim Wade, au profit de la coalition d’opposition Bennoo Siggil Senegaal.
Après la démission de Cheikh Hadjibou Soumaré le 30 avril 2009, Souleymane Ndéné Ndiaye est nommé Premier ministre.
Septembre 2009 : des pluies torrentielles provoquent de violentes inondations dans le pays.
an 2009 : Somalie - Dès février 2009, divers groupes islamistes fusionnèrent au sein du Hizbul Islam et déclarèrent la guerre au gouvernement modéré de Sharif Ahmed. Cette coalition inclut l'Alliance pour la nouvelle libération de la Somalie, dirigée par Hassan Dahir Aweys, l'un des chefs radicaux de l'Union des tribunaux islamiques, Hassan Abdullah Hersi al-Turki, un autre commandant de l'Union des tribunaux islamiques et leader des brigades de Ras Kamboni et le groupe Muaskar Anole. Cette nouvelle coalition islamiste est, avec le groupe al-Shabaab, la plus active dans le conflit. De plus, en mars 2009, ben Laden appelait dans un enregistrement au renversement de Sharif Ahmed.
an 2009 : Soudan - En 2009, la Cour pénale internationale (CPI) lance un mandat d’arrêt contre le président soudanais Omar el-Béchir 4 mars 2009 pour crimes contre l’humanité (l’année suivante, l’accusation de génocide sera rajoutée).
an 2010 : Burkina Faso -Blaise Compaoré est réélu en 2010.
an 2010 : Burundi - Après cinq années, l'érosion du pouvoir conduit à un certain agacement au sein des autres groupes Hutus. Lorsque le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) de Pierre Nkurunziza obtient une majorité des 2/3 aux élections communales du 26 mai 2010, les partis Hutus signataires des accords d'Arusha dénoncent immédiatement des fraudes massives. L'ONU et l'Union européenne, qui supervisent le scrutin, assurent ne pas avoir observé de graves irrégularités.
Peu après, une émeute éclate dans un faubourg de Bujumbura : les manifestants ont découvert une urne remplie de bulletins non-décachetés dans un quartier acquis aux Hutus anti-Nkurunziza ; il y a plusieurs blessés. Le 2 juin, des dirigeants de l'opposition Hutu sont arrêtés, tandis que Ban Ki-moon arrive au Burundi pour appeler à la poursuite du processus électoral. Il ne rencontre que le président, ce qui est vécu par les opposants comme une trahison de la communauté internationale.
Le lendemain, les partis Hutu d'opposition (FNL, etc.) décident le boycott total de l'élection présidentielle du 28 juin. Le 5 juin, l'ancien président Domitien Ndayizeye décide de rejoindre la contestation. Le 7 juin, le gouvernement interdit toute campagne pour l'abstention, ce qui radicalise la divergence.
L'opposition burundaise refuse de participer à l'élection présidentielle du 28 juin 2010 et dénonce des fraudes lors des élections municipales de mai (le CNDD-FDD a remporté les municipales avec 64 % des voix et le déroulement de l'élection est jugé correct en regard des standards internationaux par les observateurs de l'Union européenne). La campagne est émaillée d'incidents, plusieurs membres de l'opposition sont arrêtés. Pierre Nkurunziza a été réélu président en 2010 avec plus de 91 % des voix, étant le seul candidat de l'élection. Les candidats de l’opposition s’étaient retirés pour protester contre les irrégularités du scrutin.
an 2010 : Congo Kinshasa - Depuis novembre 2010, l'ancienne mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUC qui n'était pas parvenue à désarmer les milices rwandaises, est renforcée militairement pour intervenir dans l'est du pays et devient la MONUSCO, mais plusieurs dissidences et révoltes persistent et de nombreuses violences continuent.
an 2010 : Afrique Côte d'Ivoire - À l'issue d'une élection présidentielle sous tension, les deux candidats arrivés au second tour, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, se déclarent vainqueurs et prêtent serment comme président du pays. Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur par Youssouf Bakayoko, le président de la Commission électorale indépendante, au siège du camp de Ouattara contrairement aux dispositions de ladite CEI, et a reçu le soutien du Premier ministre Guillaume Soro et d'une partie de la Communauté internationale. Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel et a reçu le soutien du général Philippe Mangou, commandant de l'armée. La Côte d'Ivoire se retrouve alors avec deux présidents tentant de s'imposer sur l'ensemble du pays.
Mais Alassane Ouattara bénéficie du soutien de la plus grande partie de la communauté internationale, ainsi que celui d'instances économiques et financières tant régionales qu'internationales. L'économie ivoirienne est paralysée par les sanctions et les finances de l'État ivoirien asséchées, notamment les zones encore contrôlées par Laurent Gbagbo.
an 2010 : Guinée - Arrivé au pouvoir, le capitaine précise que le nouveau régime est provisoire et qu'aucun membre de la junte ne se présentera aux élections présidentielles prévues en 2010.
Au fil de ses interventions médiatiques, Moussa Dadis Camara envisage de plus en plus explicitement de se présenter, décevant les espoirs de véritable transition démocratique et déclenchant des mouvements de protestation.
Le 12 janvier 2010, Moussa Dadis Camara est renvoyé vers le Burkina Faso par le Maroc pour y continuer sa convalescence. C'est ainsi que le 15 janvier, un accord sera trouvé entre Dadis et Sékouba pour que ce dernier soit reconnu Président de la transition. Cet accord stipule qu'un premier ministre issu des Forces Vives (Partis d'opposition, syndicats, société civile) soit nommé dans le but de former un gouvernement d'Union nationale et de conduire le pays vers des élections libres et transparentes dans les six mois. Aussi, aucun membre du gouvernement d'union nationale, de la junte, du Conseil national de la transition et des Forces de Défense et de Sécurité n'aura le droit de se porter candidat aux prochaines échéances électorales.
Le 16 janvier, Dadis, dans une allocution à partir du palais présidentiel burkinabé, dit que la question de sa candidature est définitivement réglée, ainsi que celle des autres membres de la junte. Jean-Marie Doré, doyen de l'opposition, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement d'union nationale chargé d'organiser les futures élections présidentielles.
Le 8 février 2010, la justice guinéenne ouvre un instruction judiciaire pour les crimes commis le 28 septembre 2009 à Conakry, trois magistrats instructeurs sont nommés et le 3 juin 2010, la FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen (OGDH), trois autres organisations guinéennes de victimes (AVIPA, AFADIS, AGORA) et 67 victimes se constituent parties civiles.
Le 7 mars 2010, Sékouba Konaté fixe par décret la date du premier tour de l'élection présidentielle au 27 juin 2010. Il tient parole et pour la première fois une élection présidentielle en Guinée se déroule sans qu'aucun militaire ne soit candidat. Le second tour des élections présidentielles devait se tenir le 19 septembre 2010 mais a été reporté à une date ultérieure.
Le 28 septembre 2010, un an après le massacre, les victimes et les ONG de défense des droits de l'homme demandent le jugement des auteurs présumés des faits.
Le 7 novembre 2010, Alpha Condé (candidat du RPG et de l'Alliance Arc-En-Ciel) obtient 52,5 % des suffrages face à son adversaire Cellou Dalein Diallo (candidat de l'UFDG et de l'Alliance des bâtisseurs), qui a fini par accepter les résultats de la cour suprême qu'il avait initialement contestés en raison de soupçons d'irrégularités. Le président Alpha Condé est élu pour un mandat de 5 ans.
an 2010 : Kenya - Le 4 août 2010, le texte de réforme de la Constitution, incluant la Charte des droits et libertés16, chère à Raila — et maintenant soutenu par Kibaki — est accepté, contre la position d'un autre membre influent de l'ODM, le ministre des Hautes études William Ruto — soutenu, lui, par l'ex-président Moi —, par la majorité des 72,1 % de Kényans ayant participé au référendum populaire (70 % de votes favorables contre 30 % de défavorables).
La cérémonie publique de promulgation par le président Mwai Kibaki de cette Constitution moderne16 le 27 août 2010 est entachée par la présence du président soudanais Omar el-Béchir alors qu'il est notifié d'un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Cette invitation, directement adressée par le président Kibaki suscite l'émotion et la réprobation des Kényans, de leur Premier ministre et des parlementaires. Les protestations de la Communauté internationale et en particulier celles du président américain Barack Obama — bien que les États-Unis n'aie pas ratifié le statut de Rome — et de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan sont rapides.
an 2010 : Leshoto - En 2010, peu avant la Coupe du monde de football, des milliers d’habitants ont demandé au gouvernement sud-africain l'annexion du pays pour en faire la dixième province d'Afrique du Sud. Fin mai, plusieurs centaines de personnes ont défilé dans la capitale, Maseru, et remis au Parlement et à l'ambassade d'Afrique du Sud une pétition demandant le rattachement. Plus de 30 000 signatures ont été recueillis et les raisons sont multiples : une situation économique extrêmement précaire, un taux de sida très élevé (400 000 personnes en sont atteints), une espérance de vie très basse (34 ans) et l'effondrement de l'industrie textile, ce qui rend la survie du pays extrêmement difficile, d'autant plus qu'il est totalement encerclé par l'Afrique du Sud et qu'il y a plus de Sothos vivant en Afrique du Sud qu'au Lesotho lui-même.
an 2010-2012 : Malawi - Mutharika remplace Muammar al-Gaddafi à la tête de l’Union africaine, devenant le premier chef d’état malawite à exercer la charge de secrétaire général de cette organisation. En 2011, le Malawi établit des relations diplomatiques avec 10 pays. Mais le second mandat de Mutharika est vite marqué par une dégradation brusque de l'économie, une dégradation des conditions de vie et des pénuries d'essence dues à un manque de confiance des bailleurs de fonds. Des émeutes éclatent, et le régime se durcit, s'appuyant sur l'armée. Finalement, le président Bingu wa Mutharika est victime d'un arrêt cardiaque le 5 avril 2012.
an 2010-2013 : Mali - En septembre 2010, sept étrangers, dont cinq Français, sont enlevés par Al-Qaida au Maghreb islamique. Treize mois plus tard, des Touareg maliens, ex-mercenaires en Libye, reviennent dans la partie nord du Mali : le contrôle de cette partie du pays semble échapper de plus en plus au pouvoir en place à Bamako entre les interventions de Al-Qaida au Maghreb islamique et ces forces Touaregs. Le 22 mars 2012, le capitaine Amadou Haya Sanogo dirige un coup d’État militaire. Quelques mois plus tard, soumis également à une pression internationale, il rend le pouvoir à des autorités civiles, pour une période de transition, avec comme président par intérim Dioncounda Traoré. Celui-ci organise une élection présidentielle qui se tient les 28 juillet et 11 août 2013 et s'achève par la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta auquel Dioncounda Traoré transmet le pouvoir le 4 septembre suivant.
Pendant ce temps, durant cette même année 2012, profitant des bouleversements politiques successifs à Bamako, les événements s'accélèrent dans le nord du pays et dans le Sahel, au centre du pays. De mars à septembre 2012, les villes de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti tombent aux mains des islamistes qui se rapprochent des régions du sud. Le 23 septembre 2012, Le Mali et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) s'accordent sur le déploiement d'une force africaine. Le 21 décembre 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies autorise par une résolution le déploiement d'une force africaine au Mali. Le 11 janvier 2013, les troupes françaises interviennent en appui de cette force africaine, c'est le début de l'opération Serval.
an 2010 : Mauritanie - La Mauritanie a suspendu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009 avant de "rompre complètement et définitivement les relations avec Israël" le 21 mars 2010. Ces relations avaient été établies en 1999 par le président de la République à l'époque, Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya.
Sous le président Abdel Aziz, la Mauritanie s’est érigée en garante de la lutte contre la menace terroriste, tout en adoptant des lois qui définissent les infractions terroristes en termes vagues. La loi antiterroriste adoptée en 2010 a ainsi permis aux autorités de museler plusieurs opposants politiques, comme Abdallahi Salem Ould Yali, activiste issu de la communauté «haratine», descendants d’esclaves, qui a été poursuivi pour incitation au fanatisme ethnique ou racial pour avoir diffusé des messages dénonçant la discrimination dont est victime son groupe ethnique dans un groupe de discussion WhatsApp, ou encore, en 2015, le colonel de la Garde nationale à la retraite Oumar Ould Beibacar, qui dénonçait les exécutions sommaires de ses co-officiers en 1992 dans une purge d’officiers noirs de l’armée mauritanienne.
an 2010 : Rwanda - En 2010, les opposants ont une marge de manœuvre très réduite. Ainsi, par exemple, l'opposante Victoire Ingabire, présidente des FDU-Inkingi (Forces démocratiques unies) est arrêtée pour négation du génocide, lorsqu'elle exprime la nécessité de réconciliation. Une loi de 2008 punit de dix à vingt-cinq ans de prison « l'idéologie du génocide », avec une formulation « rédigée en termes vagues et ambigus », selon Amnesty International, qui y voit un moyen de « museler de manière abusive la liberté d'expression ».
À l'approche de l'élection présidentielle rwandaise de 2010, deux autres rédacteurs en chef de journaux sont contraints de quitter le Rwanda. Les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis, la France et l'Espagne expriment publiquement leurs préoccupations. Paul Kagame est réélu à cette élection présidentielle, avec plus de 93 % des suffrages exprimés.
an 2010 : Sénégal - Février 2010 : un projet de loi déclarant l’esclavage “crime contre l’humanité” est exposé par le chef de l’Etat.
Abdoulaye Wade annonce également la fermeture de la base militaire française à Dakar.
an 2010 : Togo - En 2010 est organisée une élection présidentielle, où le président Faure Gnassingbé est réélu avec 61 % des voix. Gilchrist Olympio, candidat naturel de l'UFC, a été remplacé au dernier moment par Jean-Pierre Fabre.
Des heurts ont lieu en protestation à cette élection entre militants de la coalition et forces de l'ordre. Les élections ont été dénoncées par l'Union européenne, finançant les élections, qui au travers de ses observateurs a constaté des irrégularités dans la campagne électorale.
an 2010 - 2011 : Tunisie - En décembre 2010, la situation économique et sociale est très difficile. Le chômage, en particulier celui des jeunes diplômés, est très important. Le suicide d'un jeune commerçant empêché par la police de pratiquer son commerce déclenche un vaste mouvement de protestations. Des manifestations répétées, qui s'appuient sur les réseaux sociaux permis par l'internet, parviennent le 14 janvier 2011 à chasser du pouvoir le président Ben Ali. C'est la révolution tunisienne de 2010-2011, qui a lieu en même temps que d'autres mouvements dans des pays arabes : le Printemps arabe.
an 2011 : Burkina Faso - La révolte de 2011 secoue le pays en même temps que le Printemps arabe.
an 2011 : Cap Vert - Depuis 2011, le président est le dirigeant du MPD Jorge Carlos Fonseca.
En raison de sa stabilité politique et de la régularité des élections, le Cap-Vert est considéré comme l'un des pays africains les plus démocratiques.
an 2011 : Afrique Côte d'Ivoire - Les combats éclatent à Abidjan à la fin du mois de février 2011 entre le « Commando invisible » hostile à Gbagbo et l'armée régulière. Puis, début mars, la tension gagne l'ouest du pays, où les Forces nouvelles prennent le contrôle de nouveaux territoires. L'ensemble du front finit par s'embraser à la fin mars, et les forces pro-Ouattara, rebaptisées Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), prennent Yamoussoukro, la capitale politique du pays, le 30 mars. À partir de ce moment-là, les événements s'accélèrent : le sud du pays est conquis en quelques heures et les troupes pro-Ouattara entrent dans Abidjan sans rencontrer de réelle résistance (mais non sans commettre de nombreuses exactions sur les populations civiles).
Laurent Gbagbo et son épouse se retranchent à la Résidence présidentielle, protégés par un dernier carré de fidèles dont la Garde Républicaine dirigé par le colonel Dogbo Blé Bruno. La Résidence est assiégée par les forces pro-Ouattara qui ont du mal à accéder à la Résidence malgré plusieurs tentatives. Un assaut final est lancé contre le domicile le 11 avril avec l'appui des forces onusiennes et surtout de l'armée française (en application de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU). Laurent Gbagbo (accompagné de sa famille) est fait prisonnier, puis placé en état d'arrestation à l'hôtel du Golf. Il est ensuite transféré à Korhogo dans le nord du pays, où il est placé en résidence surveillée. Quelques jours plus tard, son épouse, qui n'a pas été autorisée à le suivre, sera placée quant à elle en résidence surveillée à Odienné, une autre localité du nord ivoirien. Depuis le 30 novembre 2011, Laurent Gbagbo est incarcéré à la Cour pénale internationale où il est inculpé pour quatre chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Les forces pro-Ouattara sont soupçonnées de s'être livrées à des exactions sur des populations supportant Laurent Gbagbo (massacre du camp de Nahibly et Duekoué). Dans le cas de Duekoué, l'ONU explique que les forces pro-Gbagbo seraient aussi impliquées.
an 2011 : Afrique République de Djibouti - Au début de 2011, des manifestations inspirées par le Printemps arabe sont réprimées.
an 2011 : Gambie - En 2011, Jammeh est réélu à 72 % des suffrages. Il déclare être « prêt à diriger le pays un milliard d’années ». Son opposant Darboe qualifie le scrutin de « frauduleux et grotesque ». La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest estime elle aussi que les élec Le gouvernement de Jammeh devient de plus en plus policier, il ignore les ONG et la Commission Africaine des droits de l’homme. Sont dénoncés par ces derniers le traitement discriminatoire des homosexuels, l’usage de la torture et la violence des services de renseignement, surnommés les « Jungelers ».
an 2011 : Kenya - Faisant suite à l'enlèvement d'une touriste britannique et à l'assassinat de son mari le 11 septembre 2011, à l'enlèvement d'une résidente franco-kényane le 1er octobre et enfin, le 13 octobre, à l’enlèvement de deux volontaires humanitaires espagnoles ainsi qu'à l'assassinat de leur chauffeur kényan, des unités militaires des forces armées kényanes entrent en Somalie le 16 octobre à la poursuite des miliciens d'Al-Shabaab. Cependant, Alfred Mutua, le porte-parole du gouvernement déclare, le 26 octobre, que l'opération militaire était planifiée depuis longtemps et que les enlèvements n'ont été qu'une aire de lancement (« the kidnappings were more of a good launchpad. »). Cette « invasion » donne lieu à des représailles de la part d'Al-Shabaab (cf. section détaillée : « Attentats »).
2011-2013 : Égypte - Hosni Moubarak est Président de la République jusqu'en février 2011, date de sa démission contrainte à la suite de la Révolution égyptienne de 2011. Hosni Moubarak poursuit la politique de libéralisation de l’économie, notamment par la réduction des subventions à l'agriculture et à la consommation, et par la libéralisation des prix. En 1992, il fait annuler les dispositions régissant la location des terres. Généralement appelée « loi pour chasser les paysans de leurs terres », cette loi, combinée aux autres mesures de désengagement de l’État dans l’économie, accroît le mécontentement des populations rurales pauvres en particulier en Haute-Égypte. Hosni Moubarak devient un pilier de la stratégie régionale des États-Unis et la Constitution qu'il met en place reconnait les « principes de la charia » comme source principale de la législation.
En janvier et février 2011, une série de manifestations d'ampleur inégalée se déroulent à travers le pays et mènent à la démission d'Hosni Moubarak le 11 février. Les nouvelles élections législatives et présidentielle sont remportées par le Parti de la liberté et de la justice, le bras politique des Frères musulmans.
Le pouvoir n'est cependant resté que peu de temps entre leurs mains car d'importantes manifestations contre le président élu, Mohamed Morsi, critiquant des dérives dictatoriales, et le retournement de l'armée contre celui-ci le destitue en faveur d'un gouvernement transitoire un an seulement après son élection. L'Égypte connait depuis une période de troubles causée par l'instabilité et les tensions politiques, notamment entre les opposants à l'ex-président et ceux qui continuent à le soutenir et n'acceptent pas ce qu'ils voient comme un coup d'État illégal.
an 2011-2018 : Éthiopie - En 2011, une crise alimentaire touche une grande partie de la Corne de l'Afrique. Dans la nuit du 20 au 21 août 2012, Meles Zenawi décède en pleine fonction après 21 ans au pouvoir. Conformément à la Constitution (article 73), Haile Mariam Dessalegn est désigné comme Premier ministre par la Chambre des représentants des peuples. Les Oromos, ethnie majoritaire avec plus du tiers de la population, entrent en rébellion en novembre 2015. Les Amharas, un quart de la population, font de même en août 2016. L'état d'urgence est décrété le
9 octobre 2016. Haile Mariam Dessalegn démissionne en février 2018 à la surprise générale. Le 2 avril 2018, Abiy Ahmed lui succède. Cet homme politique de longue date est populaire parmi les Oromos dont il est issu. Dès son discours d’investiture, il tend la main à l’Érythrée, en appelant à mettre fin à un conflit qui dure depuis l’indépendance du pays, en 1993. Il qualifie également les partis d’opposition de frères et non d’ennemis. La situation intérieure et les relations avec les pays voisins s’apaisent.
an 2011 : Libéria - Ellen Johnson Sirleaf remporte à nouveau l’élection présidentielle de 2011. Le taux de participation aux votes est faible, 37,4 %
an 2011 : Libye - La guerre civile de 2011
En 2011, dans le contexte du « Printemps arabe », le mécontentement populaire contre le régime de Kadhafi s'affirme désormais ouvertement. La violente répression des manifestations dans le pays, durant laquelle la troupe tire à l'arme lourde sur la population, débouche en février sur une véritable guerre civile. L'Est du pays échappe bientôt au contrôle de Kadhafi, et un gouvernement provisoire, le Conseil national de transition (CNT), est formé à Benghazi. Mais les troupes de Kadhafi contre-attaquent rapidement, et reprennent progressivement le contrôle du pays. Alors que Benghazi est directement menacée, le Conseil de sécurité des Nations unies vote la résolution 1973, autorisant en mars une intervention militaire internationale qui fournit aux rebelles un appui aérien et leur évite d'être écrasés. Au bout de six mois de conflit, les forces du CNT prennent Tripoli le 23 août. Kadhafi, ayant quitté la capitale, est mis à prix et visé par un mandat d'arrêt international. Le 16 septembre, le CNT est reconnu comme gouvernement de la Libye par l'Assemblée générale des Nations unies. À l'automne 2011, les partisans de Kadhafi tiennent encore plusieurs bastions, principalement Syrte et Bani Walid.
Le 20 octobre 2011, Syrte est la dernière ville kadhafiste à tomber aux mains des forces du Conseil national de transition. Mouhammar Kadhafi est capturé et tué le jour même.
La « libération » du pays est officiellement proclamée le 23 octobre; le même jour, le président du CNT, Moustafa Abdel Jalil, annonce que la future législation de la Libye serait fondée sur la charia. Cette déclaration ayant suscité l'inquiétude des gouvernements occidentaux, il déclare vouloir « assurer à la communauté internationale que nous, les Libyens, sommes des musulmans modérés ». Un référendum est annoncé pour approuver la future constitution. Le 22 novembre, un nouveau gouvernement, dirigé par Abdel Rahim al-Kib, est mis en place41. Kadhafi ayant laissé derrière lui un vide politique, et un pays dépourvu d'institutions réelles, d'armée structurée, et de traditions démocratiques, la Libye apparaît bientôt comme un pays très instable, en proie au désordre et à la violence.
an 2011 : Mauritanie - Durant deux mois, entre le 24 septembre et le 28 novembre 2011, le collectif "Touche pas à ma nationalité" organise plusieurs manifestations pour protester contre le recensement national.
an 2011-2021 : Ouganda - Museveni se fit réélire à nouveau en 2011 et 2016, nouveaux scrutins présidentiels après ceux de 1996, 2001, et 2006, chaque fois au premier tour, et avec des soupçons de fraude. Il fit procéder aussi à un nouveau changement de constitution fin 2017,pour supprimer la limite d'âge de 75 ans s'appliquant aux candidats à cette élection présidentielle et à lui en tout premier lieu. Il instaura également une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux et fin août 2018, fit arrêter et battre un député d'opposition, Robert Kyagulanyi Ssentamu (en), connu également comme ex-chanteur sous le nom de Bobi Wine. Libéré, celui-ci se fit soigner aux États-Unis avant de revenir en Ouganda en septembre 2018 et d'être à nouveau inculpé. Constituant l'un des leaders de l'opposition ougandaise, Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine, affrontera le président sortant Yoweri Museveni, qui est au pouvoir depuis 1986, lors des élections présidentielles qui se tient le 14 janvier 2021, Yoweri Museveni est réélu.
an 2011 : Sénégal - Février 2011 : Dakar rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran, accusé d’avoir livré des armes aux rebelles indépendantistes de Casamance, où la recrudescence de la violence depuis fin décembre 2010 a causé la mort d’au moins seize soldats sénégalais.
Juin 2011 : face à la fronde de la rue, Abdoulaye Wade renonce à une réforme constitutionnelle qui prévoyait de faire élire un ticket présidentiel, au premier tour, avec 25% seulement des suffrages exprimés. On le soupçonnait de vouloir assurer sa réélection et de préparer la succession pour son fils Karim.
an 2011 : Seychelles - L'élection présidentielle de mai 2011 voit la réélection du président Michel qui remporte 55,4 % des suffrages exprimés, contre 41,4 % à Wavel Ramkalawan. Il se présente une troisième et dernière fois à l'élection présidentielle de 2015, remportant le scrutin avec 50,15 % des suffrages exprimés contre 49,85 % à son adversaire, Wavel Ramkalawan. Mais il est contraint d'attendre le second tour de l'élection, alors qu'il avait été élu dès le premier tour aux élections précédentes.
an 2011-2017 : Somalie - En octobre 2011, l'armée kényane, appuyée par les troupes somaliennes, intervient dans le conflit, lançant l'opération Linda Nchi (« protéger le pays » en swahili) contre les positions d'Al-Shabaab.
Les relations entre la Somalie et la Turquie (en) contribuent à la relative stabilisation du pays. La Turquie, qui fournit une aide humanitaire et économique importante depuis 2011, ouvre une base militaire à Mogadiscio en septembre 2017
an 2011 : Soudan - En 2011, le Sud du Soudan accède à son indépendance sous le nom de Soudan du Sud. Mais en 2012, Le conflit au Kordofan du Sud s'envenime.
an 2011 : Tchad - Jusqu'en 2011, le Tchad alimentait un flux migratoire important vers la Libye : on estime qu'au moins 500 000 Tchadiens vivaient dans ce pays en 2006. Les échanges transsahariens assuraient une relative prospérité à des villes frontalières comme Abéché. Cependant, depuis la première guerre civile libyenne en 2011, l'instabilité de ce pays rend ces échanges aléatoires ; la frontière entre la Libye et le Tchad est devenue une zone de non-droit dominée par les contrebandiers et les groupes armés.
an 2011 : Tunisie - Après la révolution et l'élection de l'Assemblée constituante, celle-ci vote une loi constituante le 10 décembre 2011 ; le nouveau texte indique dans son article 9 que le candidat à la présidence doit être musulman, de nationalité tunisienne uniquement, issu de parents tunisiens et âgé d'au moins 35 ans ; il doit démissionner, une fois élu, de toute responsabilité à l'Assemblée constituante et au sein de son parti.
an 2011 - 2014 : Zambie - À la suite de la dégradation de l'état de santé de Mwanawasa, le vice-président Rupiah Banda assure l'intérim. Après la mort du président en août 2008, Banda est élu quatrième président du pays et le reste jusqu'en septembre 2011. Le chef de l'opposition Michael Sata lui succède, et devient le cinquième président de la Zambie. Il décède à son tour, à la suite d'une maladie à Londres le 28 octobre 2014.
an 2012 : Afrique du Sud - Le massacre de Marikana en 2012, où la police tire sur des salariés grévistes faisant des dizaines de morts, entache la gouvernance de l'ANC au sein de son électorat mais lors des élections générales sud-africaines de 2014.
an 2012-2013 : République de Centrafrique - En décembre 2012, le pays est à nouveau dans une situation insurrectionnelle. Une coalition rebelle prenant le nom de Séléka (Alliance en langue sango) s'est constituée contre le régime de Bozizé. Réunissant au moins trois mouvements préexistants, cette coalition, qui dispose de troupes bien armées et disciplinées, a pris le contrôle de la ville diamantifère de Bria le 18 décembre, avant de progresser rapidement vers la capitale. Le président Bozizé espéra un temps obtenir un soutien militaire de la France ou des États-Unis, mais ces deux pays choisissent de ne pas intervenir.
Les rebelles dénoncent la non-tenue des accords par le président Bozizé, et reprennent les armes fin 2012, lançant une série d'attaques démarrant la deuxième guerre civile centrafricaine. Le 24 mars 2013, les rebelles de la coalition Seleka s'emparent de Bangui et Bozizé s'enfuit. Michel Djotodia s’auto-proclame président de la République centrafricaine. Mais les nombreuses exactions commises par les miliciens de la Seleka, majoritairement musulmans, amènent l'insécurité dans le pays, et des milices d'auto-défense, les anti-balaka se forment. Le conflit débouche sur une situation « pré-génocidaire » selon la France et les États-Unis. Le 5 décembre 2013, une résolution de l'ONU permet à la France d'envoyer des troupes armées en République centrafricaine (opération Sangaris) aux fins annoncées de désamorcer le conflit et de protéger les civils.
an 2012-2013 : Égypte - En juin 2012, Mohamed Morsi remporte l'élection présidentielle et devient ainsi le premier président du pays élu au suffrage universel dans une élection libre. Un an après son arrivée au pouvoir, le président Morsi est massivement contesté par l'opposition qui regroupe diverses factions entre laïcs de gauche, anciens partisans du régime de Moubarak et différents groupes révolutionnaires, dont Tamarod (Rebellion). Une grande partie de la population reproche au nouveau président une dérive dictatoriale et une politique menée dans le seul intérêt de son organisation, les Frères musulmans. Après des rassemblements massifs dans tout le pays, l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Sissi, lance un dernier ultimatum le 1er juillet 2013. Celui-ci est rejeté le lendemain par Mohamed Morsi qui défend sa légitimité en soulignant qu'il a été élu démocratiquement, avec 52 % des voix. Cependant, selon des observateurs, l'ultimatum a été lancé dès le mois d'avril 2013, par la coalition des opposants, alors que la situation économique était au plus mal.
an 2012 : Ghana - À la suite du décès du président en exercice le 24 juillet 2012, le vice-président John Dramani Mahama lui succède à la tête de l’État
an 2012 : Guinée-Bissau - Le 12 avril 2012, un coup d'État mené par l'armée dépose le premier ministre Carlos Gomes Júnior dans le contexte d'une élection présidentielle contestée. La CEDEAO et la CPLP prennent des positions fortes contre ce coup d'état et examinent les possibilités d'intervention politique et militaire. L'Union africaine suspend la Guinée-Bissau le 17 avril 2012. Mamadu Ture Kuruma devient de facto le dirigeant du pays. Manuel Serifo Nhamadjo, président de l'Assemblée nationale populaire, devient président de la République par intérim.
an 2012 : Libye - Le 7 juillet 2012, la Libye organise l'élection du Congrès général national, premier scrutin démocratique de son histoire. Elle se déroule dans un climat de tensions, les milices fédéralistes de Cyrénaïque se montrant hostiles au pouvoir central de Tripoli. Parmi les nombreux partis politiques formés après la chute de Kadhafi, les islamistes apparaissent comme les grands perdants du premier scrutin : l'avantage revient aux libéraux, et notamment à l'Alliance des forces nationales dirigé par Mahmoud Jibril, qui n'a cependant pas la majorité absolue. Le Congrès général national (CGN), une assemblée de 200 membres, succède au Conseil national de transition48. Mohamed Youssef el-Megaryef, islamiste modéré et opposant de longue date à Kadhafi, est élu en août président du CGN, soit chef de l'État par intérim ; en octobre, le diplomate Ali Zeidan, ancien porte-parole du CNT, devient chef du gouvernement. Le climat de violence ne cesse pas pour autant en Libye :
le 11 septembre 2012 — anniversaire des attentats de 2001, mais également dans le contexte de l'affaire du film L'Innocence des musulmans — le consulat des États-Unis à Benghazi est attaqué par un groupe armé. Quatre Américains sont tués, dont l'ambassadeur J. Christopher Stevens.
an 2012-2014 : Malawi - Conformément à la Constitution, la vice-présidente Joyce Banda est officiellement investie présidente du Malawi le 7 avril 2012 à la suite du décès de Bingu wa Mutharika. Ses premières décisions politiques la démarquent de son prédécesseur. Elle s'efforce notamment de restaurer les bonnes relations du Malawi avec les pays développés afin que l'aide internationale reprenne pleinement, notamment en revenant sur des décisions monétaires et, dans le domaine social, en dépénalisant les actes homosexuels.
an 2012 : Mauritanie - En mars 2012, Abdallah al-Senoussi, le beau-frère de Mouammar Kadhafi et ancien chef des renseignements militaires libyens recherché par la Cour pénale internationale est arrêté à Nouakchott. Il est finalement remis aux autorités libyennes, six mois plus tard, après de longues tractations. Le premier ministre libyen Ali Zeidan accuse la Mauritanie d'avoir exigé un paiement de 200 millions de dollars en échange de l'extradition Abdallah al-Senoussi.
Le 12 octobre 2012, le président Mohamed Ould Abdelaziz est blessé par balle par une patrouille militaire. Il est évacué vers la France pour y être soigné à l'hôpital Percy-Clamart près de Paris.
Situation sanitaire et humanitaire
Depuis 2012, près de 60.000 réfugiés peuls, touaregs et arabes venus du Mali, fuyant les violences des groupes jihadistes ou de l’armée malienne, ont élu domicile dans le camp de Mbera, en Mauritanie. Leur accès à l'eau potable est précaire.
an 2012 : Sénégal - Janvier 2012 : le Conseil constitutionnel se prononce pour une nouvelle candidature, jugée anticonstitutionnelle par ses opposants, du chef de l’Etat à la présidentielle de février. Il rejette la candidature du chanteur Youssou N’Dour. Cette décision provoque la colère de l’opposition.
25 mars 2012 : L’ex-premier ministre Macky Sall devient le nouveau chef de l’État sénégalais en battant au second tour de la présidentielle son rival Abdoulaye Wade qui a reconnu sa défaite avant même les résultats officiels d’un scrutin qui s’est déroulé pacifiquement.
“Mes chers compatriotes, à l’issue du second tour de scrutin de dimanche, les résultats en cours indiquent que M. Macky Sall a remporté la victoire“, a déclaré le président Wade, selon un communiqué diffusé dans la soirée par la présidence.
“Comme je l’avais toujours promis, je l’ai donc appelé dès la soirée du 25 mars au téléphone pour le féliciter“, a expliqué le chef de l’État sortant.
“Ce soir, un résultat est sorti des urnes, le grand vainqueur reste le peuple sénégalais“, a déclaré de son côté Macky Sall lors d’une conférence de presse dans la nuit dans un grand hôtel de la capitale. “Je serai le président de tous les Sénégalais“, a-t-il promis, remerciant notamment le président Wade pour son appel téléphonique.
27 mars 2012 : Macky Sall est le vainqueur de l’élection présidentielle avec 65,80% des suffrages, selon les résultats officiels provisoires annoncés par la Commission nationale de recensement des votes. Le président sortant Abdoulaye Wade obtient, lui, 34,20% des voix. Le taux de participation est à 55% des inscrits, toujours selon les mêmes résultats officiels provisoires.
Résultats officiels mardi 27 ou mercredi 28. “Ce soir une ère nouvelle commence pour le Sénégal”, s’est félicité le vainqueur du scrutin, qui lui aussi a salué la maturité des électeurs et de la démocratie sénégalaise. “L’ampleur de cette victoire aux allures de plébiscite exprime l’immensité des attentes de la population, j’en prends toute la mesure. Ensemble, nous allons nous atteler au travail“, a-t-il conclu. “C’est encore une preuve de la maturité du peuple sénégalais et de la classe politique“, a commenté le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), chargée de superviser le scrutin.
Macky Sall prendra ses fonctions le 1er avril 2012.
3 avril 2012 : Le président Macky Sall nomme Abdoul Mbaye Premier ministre. Chef d’entreprise et banquier de formation, 59 ans, Abdoul Mbaye doit former le nouveau gouvernement du Sénégal sans dépasser les 25 personnes. La nomination de M. Mbaye a été précédée du premier discours à la nation de Macky Sall qui a dit vouloir un règlement pacifique du conflit casamançais qui dure depuis près de trente ans.
an 2012 : Sierra Leone - Ernest Bai Koroma, principal opposant, candidat du Congrès de tout le peuple (APC), ex-parti unique écarté du pouvoir depuis quinze ans, succède à Ahmad Tejan Kabbah, battant au second tour son adversaire, Solomon Berewa, vice-président et candidat du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) avec 54,6 % des suffrages. Il est réélu pour un deuxième et dernier mandat le 17 novembre 2012 en remportant 58,7 % des suffrages contre 37,4 % pour son adversaire, le général Julius Maada Bio, brièvement chef de l'État en 1996. Il a maintenu la paix, amélioré le réseau routier et la fourniture en électricité, même si celle-ci reste déficiente. Pour autant, le pays reste un des plus pauvres d'Afrique, malgré ses mines de diamant.
an 2013 : République de Centrafrique - Face au risque de génocide, la France annonce, le 26 novembre 2013, l'envoi d'un millier de soldats pour rétablir la sécurité dans le pays. Le 5 décembre 2013, par la résolution 2127, le conseil de sécurité des Nations unies autorise le « déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) pour une période de 12 mois » officiellement pour mettre fin à la « faillite totale de l'ordre public, l'absence de l'état de droit et les tensions interconfessionnelles ». La MISCA est appuyée par des forces françaises (opération Sangaris), autorisées à prendre « toutes les mesures nécessaires ».
an 2013 : Congo Kinshasa - Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise appuyée par une brigade d'intervention de l'ONU chasse les rebelles du M23 des dernières positions qu'ils occupaient dans les montagnes du Nord-Kivu, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda, les rebelles déposent les armes et dissolvent leur mouvement en décembre 2013 dans un traité de paix signé à Nairobi.
an 2013-2014 : Afrique République de Djibouti - En 2013, les élections législatives aboutissent à une grave crise électorale et une répression du régime contre l'Union pour le salut national (USN), coalition des sept partis djiboutiens d'opposition. Elle aboutit à la signature entre cette dernière et le gouvernement d'un accord-cadre politique le 30 décembre 2014. Les dix députés de l'opposition qui commencent à siéger peu de temps après sont les premiers depuis l’indépendance.
an 2013-2013 : Égypte - Mohamed Morsi est remplacé par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Adli Mansour, qui prête serment comme président par intérim. Le 4 juillet 2013, on apprend que Mohamed Morsi est détenu par l'armée et que des mandats d'arrêt sont émis à l'encontre des dirigeants des Frères musulmans. Le 5 juillet 2013, le Parlement est dissous. Le 26 juillet 2013, l'armée déclare que Mohamed Morsi est en prison dans l'attente de son procès pour collusion avec le mouvement palestinien du Hamas.
Fin 2013, le nouveau pouvoir militaire est à son tour la cible de contestations, notamment à cause de la répression de manifestations et de l'arrestation d'activistes démocrates.
an 2013 : Gambie - Alors qu'elle en est membre depuis 1965, la Gambie, par la voix de son ministre de l'Intérieur, annonce le 2 octobre 2013 son retrait du Commonwealth. Le pays refuse les injonctions du Royaume-Uni au sujet des droits de l'homme alors que le régime du président Yahya Jammeh se fait plus autoritaire et accuse l'organisation d'être néo-coloniale.
an 2013 : Kenya - Pour la première fois des débats présidentiels télévisés sont organisés les 11 et 25 février 2013. Également, pour la première fois, certains bureaux de vote sont équipés pour transmettre électroniquement les résultats vers la commission indépendante IEBC chargée de comptabiliser les résultats des élections générales.
Huit candidats ont posé leur candidature lors de l'élection présidentielle du 4 mars 2013. Pour l'emporter au premier tour, un candidat doit réunir au moins 25 % des votes dans au moins 24 comtés différents et 50 % de l'ensemble des votes plus un (majorité absolue).
Depuis la première élection présidentielle multipartisme de 1992, l'appartenance d'un candidat à tel ou tel groupe tribal a toujours été un élément important dans le choix des électeurs. Uhuru Kenyatta avec son colistier William Ruto sont respectivement kikuyu et kalenjin (premier et quatrième groupe tribal du pays) alors que son adversaire Raila Odinga et son colistier Kalonzo Musyoka sont luo et kamba (troisième et cinquième groupe). Uhuru Kenyatta est déclaré vainqueur dès le premier tour de l'élection du 4 mars 2013 avec 50,07 % des suffrages devant Raila Odinga avec 43,31 %. Ce dernier conteste les élections et, conformément à la possibilité donnée par l'article 140.1 de la Constitution, dépose, en date du 16 mars 2013 une pétition à la Cour suprême pour contester la validité du scrutin présidentiel arguant des bourrages d'urnes, les dysfonctionnements du système électronique de transmission vers l'IEBC et l'inorganisation de cette dernière. La Cour rend son jugement le 30 mars suivant en déclarant que « l'élection générale fut libre et impartiale » et que « Uhuru et son colistier Ruto ont été valablement élus » et en publie la version intégrale le 16 avril.
Présidence de Uhuru Kenyatta
Uhuru Kenyatta est investi en tant que 4e président du Kenya le 9 avril 2013 au centre sportif international Moi de Kasarani (Nairobi).
D'emblée, il s'oppose à la demande des députés d'obtenir une augmentation de 60 % de leur salaire29 et réduit le nombre de ministères et secrétariats d’État, de quarante-deux sous la présidence de son prédécesseur, à dix-huit30. Cinq femmes deviennent ministres31 dont deux à des postes très importants comme Amina Mohamed aux Affaires étrangères et Raychelle Omano à la Défense.
Lors de son discours prononcé lors du Madaraka Day (célébration de l'autonomie du pays au 1er juin 1963) du 1er juin 2013, il réaffirme la teneur de la Constitution à propos de la gouvernance des comtés, rappelle les huit anciens commissaires provinciaux vers d'autres fonctions et met, ainsi, fin aux dissensions entre les gouverneurs et les commissaires.
L'organisation État islamique et les chebabs multiplient les attaques au Kenya dans les années 2010, mettant en échec la politique sécuritaire du gouvernement. À ces attaques, s'ajoute une instabilité politique interne dans les mois qui précèdent les élections générales d'août 2017. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, est finalement réélu et affiche un score électoral de 54,28 % des suffrages exprimés. Son rival Raila Odinga parle de fraudes. Des émeutes éclatent avant un appel au calme par l'opposant Raila Odinga, qui s'en remet à la Cour suprême. Celle-ci, à la surprise générale, lui donne cette fois raison et invalide les élections, qui sont réorganisés en octobre 2017. Cette décision montre une consolidation des contre-pouvoirs au Kenya à la suite de la constitution de 2010. Uhuru Kenyatta fait procéder à des modifications de la loi électorale avant ce nouveau scrutin, ce qui provoque le retrait de Raila Odinga, qui appelle au boycott de l'élection. Finalement, le président sortant Uhuru Kenyatta remporte le nouveau scrutin avec 98,26 % des voix, mais la participation le 26 octobre 2017 n'est que de 38,8 % des électeurs inscrits, à comparer à 79 % le 8 août 2017, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême. Le 13 mai 2021, le projet de réforme constitutionnelle de Uhuru Kenyatta est jugé illégal. Le 20 août 2021, La Cour d'appel du Kenya a confirmé l'illégalité du processus de révision constitutionnelle lancé par le président Uhuru Kenyatta mettant fin définitivement à ce projet de révision constitutionnelle.
an 2013 : Libye - En mai 2013, sous la pression des milices révolutionnaires, le parlement libyen adopte une loi dite de « bannissement politique », excluant de toute fonction officielle les personnes ayant occupé des responsabilités, à un moment ou à un autre, sous le régime de Kadhafi. Le radicalisme de cette loi, qui frappe de fait une grande partie des dirigeants libyens, provoque une crise politique et plusieurs démissions, privant la Libye d'un personnel politique expérimenté. Le président du Congrès général national Mohamed Youssef el-Megaryef, qui avait été ambassadeur sous Kadhafi avant de rejoindre la dissidence, est contraint de quitter ses fonctions. Fin juin, Nouri Bousahmein est élu président du GNC. Le premier ministre Ali Zeidan a quant à lui le plus grand mal à imposer son autorité face aux différents chefs de milices, qui tiennent notamment les champs pétroliers de Cyrénaïque, avec le soutien des tribus : en octobre 2013, il est séquestré quelques heures par un groupe armé, avant d'être relâché. En novembre 2013, des rebelles autonomistes proclament en Cyrénaïque un gouvernement, défiant celui de Tripoli qu'ils disent aux mains des islamistes.
an 2013 - 2018 : Madagascar - L’élection présidentielle malgache de 2013 fait de Hery Rajaonarimampianina le président de la IVe république et son Premier ministre est Roger Kolo. Mais Hery Rajaonarimampianina, qui remporte cette élection considérée par les observateurs comme démocratique, dispose alors du soutien politique d'Andry Rajoelina, avec qui il est conduit à prendre progressivement ses distances. Le nouveau président manque dès lors de soutien politique tout en étant confronté à une ploutocratie aux commandes du pays. La crise politique est doublée d'une crise économique persistante. Le 14 janvier 2015, le général de brigade aérienne Jean Ravelonarivo est nommé Premier ministre en remplacement de Roger Kolo. En mai 2015, le président est destitué par l’Assemblée nationale, mais la décision est ensuite annulée par la justice malgache. Olivier Mahafaly Solonandrasana remplace Jean Ravelonarivo le 10 avril 2016, mais pour calmer le pays en proie aux émeutes, il est contraint à la démission et remplacé par Christian Ntsay le 4 juin 2018. Les élections de décembre 2018 portent au pouvoir pour 5 ans Andry Rajoelina. Celui-ci remporte également les élections législatives de mai 2019 et obtient la majoprité absolue à l'Assemblée nationale.
an 2013 : Mauritanie - Le 18 février 2013, les forces armées mauritaniennes annoncent le début d'exercices militaires dans le sud-est du pays avec la participation de dix-neuf pays européens, africains et arabes.
En 2013, les élections législatives de novembre et décembre confortent la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale.
an 2013-2015 : Nigéria - En 2013, le Nigeria devient aussi la première économie d'Afrique, avec un Produit intérieur brut de 510 milliards de dollars, dépassant l'Afrique du Sud, même si ce dernier pays reste en tête en termes de PIB par habitant.
À la suite de l'élection présidentielle de 2015, Muhammadu Buhari est élu. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine du Nigéria qu'une transition à la tête de l'État se fait de façon démocratique.
an 2013-2019 : Somalie - Le 11 janvier 2013, l'armée française lance une opération militaire afin de libérer l'otage Denis Allex de la DGSE détenu par les Al-Shabbaab à Buulo Mareer depuis 2009 mais celle-ci s'avérera être un échec.
Le groupe terroriste Harakat al-Chabab al-Moudjahidin multiplie les attaques depuis 2008, et notamment en 2019 : en juillet, contre un hôtel de Kismaayo, puis sur la route d’accès à l’aéroport de Mogadiscio et quelques jours plus tard contre la mairie de Mogadiscio, contre un hôtel de hôtel à Mogadiscio le 10 décembre 2019 puis le 28 décembre sur un poste de contrôle à l'entrée de Mogadiscio (cette dernière attaque faisant 81 morts).
Outre le terrorisme, les Somaliens sont victimes de la violence d’État de certains pays de la région. Ainsi, 42 réfugiés sont tués en mars 2017 dans une attaque aérienne saoudienne sur la mer Rouge.
Les Nations unies estiment que 1,7 million de personnes manquent de nourriture à cause de la sécheresse en mai 2019, et que leur nombre va augmenter d'un demi-million d'ici à juillet. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont contraintes d'abandonner leur foyer pour tenter de trouver de la nourriture, venant ainsi s'ajouter aux 2,6 millions de personnes déjà déplacées dans le pays du fait de la sécheresse et de la guerre.
an 2013-2015 : Togo - En 2013, de nouvelles élections législatives sont organisées. Le parti Unir obtient 62 sièges sur 91 soit la majorité absolue. L'ANC devient le premier parti de l'opposition avec 19 sièges. Un regroupement des principaux partis d'opposition (le Combat pour l'alternance politique) dénonce par avance des fraudes massives pour l'élection présidentielle de 2015.
an 2013 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
Le 16 mars 2013, le Zimbabwe a adopté par référendum une nouvelle Constitution qui a pour but affiché de moraliser la vie politique. Le président Robert Mugabe et son premier ministre Morgan Tsvangirai appellent à voter oui. Le texte prévoit de limiter les prérogatives présidentielles, mais le chef de l'État conserve le pouvoir de nommer tous les acteurs importants. Seule la durée de la fonction est réduite à deux mandats de cinq ans
an 2014 : Afrique du Sud - Jacob Zuma est réélu pour un second mandat, l'ANC restant nettement en tête dans l'électorat bien qu'en recul face à l'Alliance démocratique et aux Combattants pour la liberté économique de Julius Malema.
an 2014 : Algérie - Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014
an 2014 : Burkina Faso - Le 30 octobre 2014, Blaise Compaoré fait face à un soulèvement populaire contre son projet de modification de l'article 37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels, afin de se représenter en 2015. À la suite des émeutes, Blaise Compaoré quitte le pouvoir.
Le chef d'état-major des armées Honoré Traoré annonce le 31 octobre la création d'un « organe de transition », chargé des pouvoirs exécutif et législatif, dont l'objectif est un retour à l'ordre constitutionnel « dans un délai de douze mois ». Le 1er novembre 2014, l'armée publie un communiqué qui affirme son soutien à Isaac Zida comme président de transition. Honoré Traoré en est un des signataires, ce qui implique son renoncement au pouvoir. Le 17 novembre 2014, le diplomate Michel Kafando est nommé président de transition. Il nomme Isaac Zida Premier ministre.
an 2014-2018 : Afrique du Sud - Jacob Zuma est, en 2014, réélu pour un second mandat avec Cyril Ramaphosa comme vice-président. Il ne peut achever son second mandat et est poussé par son parti à la démission en février 2018.
La presse dresse alors un bilan négatif de ses deux mandats marqués par de multiples scandales de corruption, des accusations de prévarication, un échec aux élections municipales sud-africaines de 2016, marquées par un recul de l'ANC dans les métropoles et une popularité en berne affectant son parti.
an 2014-2015 : Algérie - L'attentat du 19 avril 2014 contre l'Armée nationale populaire (ANP) entraîne la mort de 11 militaires, celle du 17 juillet 2015 la mort de 11 à 13 soldats
an 2014 : République de Centrafrique - Le 10 janvier 2014, le président de la transition centrafricaine Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaye annoncent leur démission lors d'un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).
Le 20 janvier 2014, le Conseil national de transition de la République centrafricaine élit Catherine Samba-Panza comme chef de l'État de transition de la République centrafricaine. Au printemps 2014, trois journalistes sont tués, dont la française Camille Lepage, sur fond de sanctions de l'ONU.
Le 23 juillet 2014, les belligérants signent un accord de cessation des hostilités à Brazzaville. En dépit de cet accord, le pays est divisé en régions contrôlées par des milices, « sur lesquelles ni l’État ni la mission de l’ONU n’ont prise ».
an 2014 : République de Djibouti - En mai 2014, le pays est victime d'un attentat suicide dans le restaurant La Chaumière. Selon les informations, deux ou trois kamikazes (dont une femme) se seraient fait exploser en entrant dans le restaurant. Un mort, un ressortissant turc, a été recensé, et plusieurs blessés, dont des coopérants français présents dans le restaurant, ainsi qu'une jeune femme originaire des Pays-Bas. L'un des kamikazes n'a pas pu entrer dans le restaurant. Il s'est jeté sur la terrasse en déclenchant sa ceinture explosive.
2014 - 2030 : Égypte - En mai 2014, Abdel Fattah al-Sissi, déjà considéré comme le dirigeant de fait de l'Égypte, remporte l'élection présidentielle. Il est réélu pour un deuxième mandat en 2018. Par une révision constitutionnelle validée par un référendum en avril 2019, il se donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Il impose une logique autoritaire, réprime toute opposition et toute voix critique , et met sous contrôle les médias et la justice. La répression touche notamment des médias, des blogueurs, des journalistes, dont des personnalités féminines comme Israa Abdel Fattah ou Solafa Magdy.
La population égyptienne dépasse les cent millions d’habitants en février 2020. Elle progresse d’un million supplémentaire tous les six mois. Le taux de fécondité est passé de 5,3 enfants par femme en 1980 à 3 en 2008, puis est remonté à 3,5 en 2014. A titre de comparaison, l’Iran connaît un taux de fécondité de 1,8 enfants par femme et la Tunisie de 2,2. Cette croissance de la population égyptienne intervient de plus sur une bande de terre limitée essentiellement à la vallée du Nil et à son delta, représentant moins de 5% de la superficie d’un pays relativement désertique. La proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté semble un élément déterminant. Les Égyptiens les plus pauvres, ne disposant pas d'aide publique adaptée, veulent s'appuyer sur leur progéniture pour assurer leur besoins quotidiens.
Par ailleurs, l'armée égyptienne semble perdre progressivement le contrôle de la péninsule du Sinaï face à la guérilla jihadiste, une branche locale de l'État islamique.
an 2014 : Gambie - Le 30 décembre 2014, une autre tentative de coup d’État a lieu en Gambie pendant que Jammeh est à Dubaï. Il accuse fortement les puissances occidentales d’avoir aidé des terroristes pour le renverser. La répression et les accusations arbitraires s'accentuent.
an 2014-2015 : Guinée - En 2014 et 2015, le pays est touché par l'épidémie Ebola mais se mobilise pour en contenir les impacts.
an 2014 : Guinée-Bissau - En 2014, José Mário Vaz remporte l'élection présidentielle du 13 avril 2014, marquant le retour progressif à la légalité constitutionnelle. Pour autant, l'instabilité persiste, et les premiers ministres se succèdent.
an 2014 : Leshoto - Le Lesotho demeure l'un des pays les plus pauvres du monde : en 2014, l'indice de développement humain (IDH) le classe au 162e rang sur 187 pays.
an 2014 : Libéria - En 2014, le Liberia, avec ses voisins la Guinée et la Sierra Leone, est touché par une épidémie de maladie à virus Ebola, qui désorganise sérieusement la vie du pays. Cette épidémie fait des milliers de morts.
an 2014 : Libye - Le 20 février 2014, sans passion et au milieu d'épisodes de violences, les Libyens élisent leur assemblée constituante. Le scrutin se déroule dans un contexte d'instabilité politique persistante, alors que le gouvernement d'Ali Zeidan, qui tente de poser les bases d'un État, est de plus en plus discrédité. Le Congrès général national provoque également le mécontentement de la population et de la classe politique en prolongeant son mandat d'un an, jusqu'en décembre 2014, et en laissant à un futur parlement, dont la date n'est toujours pas décidée, la tâche de décider de la nature d'une élection présidentielle. Minoritaires au Congrès, les islamistes gagnent cependant en influence dans l'assemblée et accaparent de plus en plus de pouvoir, laissant peu de marge de manœuvre au gouvernement. Un bras de fer oppose le premier ministre au Congrès général national jusqu'en mars 2014, date à laquelle le Congrès démet par un vote le chef du gouvernement : les islamistes se débarrassent ainsi d'un de leurs principaux adversaires. Abdallah al-Thani assure l'intérim après le départ de Zeidan. La Libye n'a alors toujours pas réussi à former d'armée ou de police réellement professionnels, laissant en grande partie le terrain à diverses factions armées et des ex-chefs rebelles.
Le 30 mars, le Congrès général national décide de laisser la place à une Chambre des représentants, qui devra être élue en juin. Le 4 mai, le Congrès général national élit Ahmed Miitig au poste de premier ministre : la validité de cette élection est aussitôt contestée, les rebelles autonomistes de l'Est annonçant quant à eux qu'ils refusent de reconnaître ce gouvernement. Le général Khalifa Haftar, chef d'état-major de l'Armée nationale libyenne, défie ouvertement le Congrès général national dominé par les islamistes, exigeant sa dissolution et la mise en place d'un « Conseil présidentiel » pour mieux assurer l'autorité de l'État. Les 16 et 18 mai, des forces loyales à Haftar attaquent des milices à Benghazi, puis le siège du CGN à Tripoli, faisant plusieurs dizaines de morts60. En juin, la justice invalide l'élection de Miitig ; Abdallah al-Thani revient alors à la tête du gouvernement. Les élections législatives se déroulent le 25 juin : 12 des 200 sièges du nouveau parlement ne sont pas pourvus, les votes ayant été annulés dans diverses localités en raison des violences. Le Parti de la justice et de la construction, proche des islamistes, est nettement minoritaire.
L'instabilité persiste ensuite en Libye, qui s'avère incapable de construire un véritable pouvoir central et de mettre un terme au désordre et à la violence dans le pays, où les milices continuent de s'arroger un pouvoir de fait. En juillet 2014, la mission de l'ONU évacue son personnel après des affrontements à Tripoli et Benghazi, qui font plusieurs victimes. Toujours en juillet, la milice de Misrata alliée à des groupes islamistes affronte la milice de Zenten alliée à d'anciens soutiens de Khadafi pour le contrôle de l'aéroport de Tripoli, tandis que d'autres groupes combattent en Cyrénaïque pour le contrôle des ressources pétrolières.
Après les élections, la passation de pouvoir entre le Congrès général national et la nouvelle Chambre des représentants est annulée : le nouveau parlement, boycotté par les élus islamistes et présidé par Aguila Salah Issa, tient sa session inaugurale à Tobrouk. Fin août, la coalition « Aube de la Libye » (Fajr Libya) formée par les groupes islamistes, prend le contrôle de Tripoli et reforme le Congrès général national : Nouri Bousahmein est réélu au poste qu'il occupait avant les élections, tandis qu'Omar al-Hassi devient le nouveau premier ministre. L'Égypte et les Émirats arabes unis mènent des bombardements répétés sur la capitale libyenne.
an 2014 : Malawi - En mai 2014, Joyce Banda perd l'élection présidentielle, au profit du frère de Bingu wa Mutharika, Peter Mutharika. Le pays, comme d'autres en Afrique australe, est confronté à des phénomènes climatiques difficiles, alternant sécheresse et inondations, dont les effets sont aggravés par la déforestation, mais connait une croissance de son PIB. Peter Mutharika est réélu pour un deuxième mandat lors de l’élection présidentielle de 2019, dans un scrutin serré. L'opposition dénonce des résultats frauduleux. Le 3 février 2020, la cour constitutionnelle, constatant des irrégularités, annule l'élection.
an 2014 : Mali - Interventions de troupes françaises (opération Serval puis Barkhane)
Cette opération Serval semble être un succès dans un premiers temps : les villes ont été reprises ainsi que le territoire du nord du pays, un dialogue est rétabli avec les différentes composantes Touareg et l’État malien est stabilisé. Mais Al-Qaida au Maghreb islamique change d'approche,et se reconstitue. L'organisation procède désormais par des incursions ponctuelles et par des attentats, et le maintien sur place des troupes françaises et africaines, dans l'organisation initiale de ces forces, se révèle coûteux. Il est décidé de substituer l’opération Barkhane à l'opération Serval, pour sécuriser la bande sahélo-saharienne, avec la mission de lutter contre les groupes djihadistes et d’empêcher la constitution de sanctuaires terroristes dont le quartier-général semble établi à N’Djamena. Le nouveau dispositif est officiellement lancée le 1er août 2014.
an 2014 : Mauritanie - Le 2 février 2014, le Premier ministre Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf, en poste depuis le début du mandat du président Aziz, présente la démission de son gouvernement. Il est reconduit dans ses fonctions dès le lendemain et chargé de former un nouveau gouvernement qui compte onze nouvelles personnalités dont cinq femmes.
Le 21 mai 2014, les ministres de l'Intérieur du groupe des Cinq du Sahel, dont fait partie la Mauritanie, créent une « plateforme de coopération sécuritaire » destinée notamment à « lutter contre le terrorisme » à Nouakchott.
Le 4 juin 2014, des milliers de sympathisants manifestent à Nouakchott contre le mode d'organisation des élections présidentielles à l'appel du Forum national pour la démocratie et l'unité (FNDU, opposition radicale).
Mohamed Ould Abdel Aziz remporte une victoire écrasante et attendue à la présidentielle le 21 juin 2014, et recueille 81,94% des suffrages, avec un taux de participation de 56,55%. Investi le 2 août pour son second mandat, il nomme comme Premier ministre Yahya Ould Hademine, ancien ministre de l'Equipement et des Transports du précédent gouvernement.
Le 3 novembre 2014, le responsable du parti islamiste modéré Tewassoul Elhacen Ould Mohamed est nommé à la tête de l'opposition démocratique.
Le 25 décembre 2014, pour la première fois depuis son indépendance, une condamnation à mort pour apostasie est prononcée en Mauritanie à Nouadhibou (au nord-ouest du pays) à l'encontre d'un citoyen mauritanien musulman, inculpé après avoir publié sur internet un texte considéré comme blasphématoire. Le 21 avril 2015, la peine de mort est confirmée pour le blogueur Mohamed Cheikh ould Mkheitir, qui est détenu depuis janvier 2014 pour un article jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. Le 31 janvier 2017 la Cour suprême renvoie devant une autre cour d'appel le dossier de Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir, le blogueur condamné à mort pour apostasie et emprisonné depuis 3 ans. Il est libéré le 29 juillet 2019 et ne cesse de dénoncer les discriminations ethniques et sociales en Mauritanie.
Esclavage
Le 6 mars 2014, avec l'appui de l'ONU, la Mauritanie adopte un plan pour l'éradication de l'esclavage.
En novembre 2014, les autorités mauritaniennes ferme le siège de l'IRA, une ONG anti-esclavagiste qu'elles accusent de propager la haine entre les populations.
Situation sanitaire et humanitaire
Le 24 octobre 2014, le gouvernement annonce le renforcement des contrôles de sa frontière avec le Mali à la suite de l'annonce du premier cas d'Ebola dans ce pays.
an 2014 : Mozambique - Le 15 octobre 2014, le FRELIMO propose un nouveau candidat à l'élection présidentielle, Filipe Nyusi qui est élu au premier tour, au cours d’un scrutin parsemé de fraudes et contesté par l’opposition, comme chaque fois. Afonso Dhlakama, chef du RENAMO, principale force d'opposition, double cependant son score de 2009, et réunit 37 % des suffrages exprimés. La situation post-électorale est tendue et le RENAMO semble pendant quelques mois reprendre une insurrection militaire, comme pendant les heures noires de la guerre civile qui a duré de 1976 à 1992.
an 2014 : Namibie - En 2014 a lieu l'Élection présidentielle namibienne de 2014, Elle est remportée par le candidat de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO), Hage Geingob, avec 86,73 % des suffrages.
an 2014 : Nigéria - L'année 2014 est marquée par la montée en puissance du groupe, qui kidnappe notamment plus de 200 lycéennes, provoquant des réactions d'indignations mondiales.
an 2014-2015 : Sierra Leone - Le pays est touché par l'épidémie d’Ebola en 2014 et 2015, qui fait 4 000 morts, et, en 2017, par des inondations meurtrières.
an 2014 : Tunisie - L'article 37 de la loi électorale, votée en application de l'article 74 de la Constitution de 2014, permet à tout électeur de confession musulmane, âgé d'au moins 35 ans et jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance de se présenter à l'élection présidentielle ; il doit présenter, s'il est titulaire d'une autre nationalité, un engagement stipulant l'abandon de son autre nationalité en cas d'élection. L'article 38 de la même loi exige que le candidat soit parrainé par dix élus de l'Assemblée des représentants du peuple ou par 10 000 électeurs, tout en stipulant qu'il est interdit au même parrain de parrainer plus d'un candidat. L'article 39 exige enfin le dépôt d'une caution de 10 000 dinars auprès du trésor public, qui est restituée au candidat s'il obtient plus de 3 % des suffrages exprimés.
L'Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de statuer et de fixer la liste des candidatures approuvées dans un délai de quatre jours à compter de la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures ; toute décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.
an 2015 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - la présidence Kaboré (2015-2022). - Des élections sont prévues initialement en octobre 2015, pour passer de cette période de transition à un fonctionnement démocratique stabilisé. Mais une tentative de coup d'état, (qualifié par des burkinabés de « coup d'état le plus bête du monde ») retarde l'échéance prévue pour cette consultation électorale.
Le 16 septembre 2015, en effet, le président de transition, le premier ministre et quelques membres du gouvernement sont pris en otages par des troupes armées, le Régiment de sécurité présidentielle, sous les ordres du général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Comparé. Des manifestations sont réprimées. Finalement, les autorités de transition sont rétablies, et le fameux régiment de sécurité présidentielle est désarmé fin septembre 2015. Les élections ont lieu en novembre 2015.
Le 30 novembre 2015, à la suite des élections présidentielles et législatives, Roch Marc Christian Kaboré (MPP) est élu au premier tour président du Burkina Faso avec 53,49 % des voix devant Zéphirin Diabré (UPC), qui récolte 29,65 % des voix, les douze autres candidats se partageant le reste. Il est le deuxième président civil depuis l'accès à l'indépendance du Burkina Faso après Maurice Yaméogo.
Depuis 2016, le Burkina Faso est touché par un certain nombre d'attaques menées par des groupes armés djihadistes : le 15 janvier 2016 ont lieu les attentats de Ouagadougou, des hommes armés attaquent le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ces lieux sont fréquentés principalement par des occidentaux. L'attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fait 30 morts. En août 2017, une autre attaque djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou. Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste visant l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou fait 8 morts, tous des militaires et plus de 80 blessés (civils et militaires). Cette attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
an 2015 : Burundi - Pierre Nkurunziza décide de briguer un troisième mandat à la présidence de la République et s'impose en avril comme le candidat du pouvoir pour l'élection présidentielle du 26 juin 2015. Cette décision est contraire à la constitution du Burundi, promulguée en mars 2005. Sa candidature est néanmoins validée par une décision controversée de la Cour constitutionnelle.
Le 13 mai 2015, Pierre Nkurunziza, en déplacement, est victime d'une tentative de coup d'État de la part du général Godefroid Niyombare.
Le 15 mai, après de violents combats dans le centre-ville de Bujumbura, les putschistes annoncent leur reddition et le pouvoir indique le retour imminent du président Nkurunziza. Les jours qui suivent voient une répression sanglante de l'opposition de la part du président. Cette répression fait des centaines morts et provoque des départs massifs : des centaines de milliers de burandais se réfugient à l'extérieur du pays . Après plusieurs reports, l'élection présidentielle, jugée illégale et truquée par tous les observateurs de la politique burundaise, se tient finalement le
21 juillet. Le 24 juillet, la commission électorale nationale indépendante proclame Nkurunziza vainqueur avec 69,41 % des suffrages.
.
an 2015-2016 : République de Centrafrique - Une élection présidentielle est organisée en décembre 2015 et janvier 2016. Faustin-Archange Touadéra arrive deuxième du premier tour avec 19 % des voix, derrière son opposant, Anicet-Georges Dologuélé qui arrive en tête avec 23,7 %. Il est finalement élu président de la République à l'issue du deuxième tour, avec 62,7 % des suffrages contre 37,3 % à Anicet-Georges Dologuélé. Ce nouveau président de la République lance un processus de réconciliation nationale afin de rendre justice aux victimes des guerres civiles, la plupart déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pour ce faire, il charge par décret son ministre conseiller, Regina Konzi Mongot, d'élaborer le Programme national de réconciliation nationale et de paix, proposé en décembre 2016, adopté en séance tenante à l'unanimité par les organismes internationaux.
an 2015 : Congo Brazzaville - En 2015, Denis Sassou-Nguesso organise une série de consultations avec des personnalités politiques du pays afin d’examiner une possible modification de la constitution en vigueur dans le pays depuis 2002. La démarche est vivement critiquée par une partie de l’opposition qui y voit une manœuvre afin de pouvoir se présenter une troisième fois à la présidence de la République (la Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels à deux et l’âge pour se présenter à la présidence de la République à 70 ans). La majorité assure de son côté souhaiter renforcer les institutions du pays en passant d’un régime présidentiel à un régime semi-parlementaire.
Le 25 octobre 2015, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Elle entre en vigueur le 6 novembre 2015, après sa promulgation par Denis Sassou-Nguesso.
an 2015-2017 : Congo Kinshasa - En 2015, des tensions apparaissent dans la perspective de l'élection présidentielle de 2016 et d'un éventuel prolongement de mandat de Joseph Kabila. L'article 70 de la Constitution du pays, datée de 2006, dispose que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Prétextant un délai supplémentaire de seize mois et un jour pour finaliser l’enregistrement des 30 millions d’électeurs, la commission électorale a annoncé le 20 août 2016, que l'élection présidentielle ne pouvait pas se dérouler avant juillet 2017. Le 19 septembre 2016, lors d’un rassemblement à Kinshasa contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, au moins dix-sept personnes sont mortes (3 policiers et 14 civils) durant la manifestation. Après la crise de confiance dans les institutions résultant de cette décision, des mouvements insurrectionnels sont signalés dans différentes provinces : milice Kamwina Napsu dans le Kasaï central, Bundu dia Kongo dans le Kongo central, Pygmées contre Bantous dans le Tanganyika, réactivation du M23. L'économie pâtit de la situation, et le phénomène des enfants soldats est en recrudescence.
Le 11 octobre 2017, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Corneille Nangaa, annonce que le scrutin pour remplacer Joseph Kabila ne pourra pas avoir lieu avant 504 jours, en raison du recensement encore en cours dans les régions du Kasaï, jusqu'en décembre 2017, puis de l’audit du fichier électoral par les experts, de l’élaboration de la loi portant répartition des sièges au parlement et de plusieurs autres opérations techniques et logistiques nécessaires avant la tenue des élections, prévue au premier semestre 2019. Ce nouveau report des élections suscite l'indignation de l'opposition, ainsi que nombre d'ONG.
an 2015-2016 : Afrique Côte d'Ivoire - À la suite de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015, le président Ouattara est réélu pour cinq ans. Il souhaite consolider les efforts de réconciliation nationale et rédiger une nouvelle Constitution. Cette nouvelle Constitution, qui entraine la création d'un sénat et d'un poste de vice-président, est approuvée par référendum le 30 octobre 2016. La troisième République Ivoirienne est proclamée le 8 novembre 2016.
an 2015 : Guinée - Le 11 octobre 2015, le président Alpha Condé obtient 58 % des suffrages et est réélu au premier tour de l'élection présidentielle pour un nouveau mandat de 5 ans.
an 2015 : Libye - Le gouvernement de Tobrouk — seul à être reconnu par la communauté internationale — et celui de Tripoli se disputent dès lors le pouvoir, en même temps que le contrôle des puits de pétrole, tandis que le pays entier est en proie à la violence et aux affrontements de groupes armés, tribaux ou djihadistes. La déliquescence de la Libye contribue à faire du pays l'une des principales zones de transit de l'immigration clandestine à destination de l'Europe. Par ailleurs, à la faveur du chaos politique, l'État islamique s'implante en Libye et lance des attaques, notamment à Misrata et à Syrte. L'ONU s'efforce d'amener les belligérants libyens à s'unir pour contrer l'État islamique. Le 10 juillet 2015, le gouvernement de Tobrouk signe finalement avec une partie des groupes armés un accord de paix proposé par l’ONU : celui de Tripoli rejette au contraire le texte et n'envoie pas de délégation à la signature.
an 2015 : Mauritanie - Le 28 janvier 2015 débute une grève de 9 semaines affectant les sites de production et d'exportation de la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM). Les revendications portent sur des augmentations de salaire. Après 9 semaines de grève la reprise du travail se déroule le 3 avril à la suite de l'ouverture de négociations et de la réintégration de grévistes licenciés.
Le 6 aout 2015, un islamiste malien, ancien porte-parole d'Ansar Dine, un groupe lié à Al Qaïda, et visé par un mandat d'arrêt international l'accusant de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, meurtre et actes terroristes est libéré par la Mauritanie, où il était détenu depuis plusieurs mois.
Le 2 septembre 2015, un remaniement ministériel remercie huit ministres, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Equipement.
Le 17 novembre 2015, la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM) ouvre un nouveau complexe minier sur le site de Zouerate, dans le nord du pays. Dénommé Guelb II, c'est le plus important projet industriel de l’histoire de la Mauritanie, dans lequel près d’un milliard de dollars ont été investis.
Le 10 février la présidence annonce un nouveau remaniement et le départ de cinq ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de l'Économie.
Le 7 mai 2015 l'opposition appelle a manifester contre le projet de révision constitutionnelle annoncé par le président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui prévoit entre autres choses la suppression du Sénat. Des heurts avec les forces de l'ordre feront plusieurs blessés. Le 29 septembre 2015, après de longues négociations entre pouvoir et opposition, s'ouvre un nouveau dialogue national. L'initiative est le point de départ qui doit amener à une réforme constitutionnelle, portant notamment sur la suppression du Sénat et la création du poste de vice-président. Une partie importante de l'opposition accuse le président Mohamed Ould Abdel Aziz de vouloir modifier le texte fondamental dans le but se présenter pour un troisième mandat. Le 20 octobre 2015 un accord politique marquant la fin du dialogue national est signé entre la majorité et quelques partis d'opposition. Plusieurs révisions constitutionnelles sont retenues, mais pas la suppression de la limitation des mandats présidentiels est rejetée.
Esclavage
Le 1er juillet 2015, six militants anti-esclavage de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) sont arrêtés, marquant le début d'une série d'arrestations dans les rangs de l'IRA. Leur procès débute le 3 août 2015 et dure quinze jours à l'issue desquels la Cour criminelle condamne la plupart des accusés à des peines de prison allant de trois à huit ans. Treize d'entre eux disent avoir été torturés durant leur détention.
Le 13 août 2015, le Parlement adopte une loi durcissant la répression de l'esclavage, considéré désormais comme un « crime contre
l'humanité ».
Situation sanitaire et humanitaire
Le 9 octobre 2015, la Mauritanie alerte l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'épidémie de fièvre qui sévit dans la vallée du rift
an 2015 : Nigéria - Début 2015, Boko Haram rase plusieurs villes et villages du nord-est du pays. Cette série d'attaques pousse les voisins du Nigéria, le Tchad, le Niger et le Cameroun à intervenir contre la secte islamiste. En 2015, Boko Haram fait allégeance à l'État islamique.
an 2015 : Tchad - Depuis 2015, l'armée tchadienne est engagée dans le conflit contre le groupe djihadiste Boko Haram, répandu dans le Nord du Nigeria et du Cameroun. En représailles, ce groupe a commis plusieurs attaques en territoire tchadien.
an 2015-2020 : Togo - Faure Gnassingbé est à nouveau réélu lors de l'élection présidentielle d'avril 2015, avec 58,75 % des suffrages exprimés, contre 34,95 % pour son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Une élection jugée libre et transparente par l'UE et les principaux observateurs internationaux. L'abstention s'élève à 40,01 %, contre 35,32 % à la précédente présidentielle de 2010. Du côté de l'opposition, Tchabouré Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI), a obtenu 3,08 % des suffrages, Komandega Taama, président du Nouvel engagement togolais (NET), 1,06 %, et Mouhamed Tchassona-Traoré, président du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (MCD, opposition), 0,99 %. Il nomme Premier ministre Komi Sélom Klassou le 5 juin 2015 jusque-là premier président de l'Assemblée nationale. Faure Gnassingbé se présente pour un quatrième mandat lors des élections présidentielles de 202022. Il est reconduit et l'élection est contestée une nouvelle fois par l'opposition.
an 2015 : Zambie - Edgar Lungu est élu en 2015 pour le remplacer et terminer son mandat présidentiel. Edgar Lungu est à la tête du Front patriotique (PF) qu'il a créé en 2001 après avoir quitté le Mouvement pour la démocratie multipartite (MMD). Il est vainqueur du scrutin présidentiel, d'une courte tête.
an 2016 : Algérie - Le pays enregistre sa première grande attaque terroriste dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016. Bilan : une trentaine de morts et une centaine de blessés.
an 2016-2018 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Depuis 2016, le Burkina Faso est touché par un certain nombre d'attaques menées par des groupes armés djihadistes : le 15 janvier 2016 ont lieu les attentats de Ouagadougou, des hommes armés attaquent le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ces lieux sont fréquentés principalement par des occidentaux. L'attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fait 30 morts. En août 2017, une autre attaque djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou. Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste visant l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou fait 8 morts, tous des militaires et plus de 80 blessés (civils et militaires). Cette attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
an 2016 : Cameroun - Depuis novembre 2016, des manifestants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, majoritairement anglophones, font pression pour le maintien de l'usage de la langue anglaise dans les écoles et les tribunaux. Des personnes ont été tuées et des centaines emprisonnées à la suite de ces protestations.
an 2016 : Cap Vert - Jorge Carlos Fonseca, du MPD, est réélu Président en 2016. José Maria Neves, du PAICV, est, dans le même temps, désigné premier ministre, de 2001 à 2016. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux partis au pouvoir, et même d'une cohabitation de ces deux partis pendant certaines périodes. Il est considéré comme ayant une bonne gouvernance, avec l'une et l'autre de ces formations, même si l'économie, peu diversifiée, est dépendante à 20 % du tourisme. Cet état ne dispense pas de grandes ressources naturelles. En 2016, le MPD revient au pouvoir à la suite des législatives, et la dirigeante relativement récente du PAICV, Janira Hopffer Almada, reconnaît sa défaite sans drame. L'archipel, qui souffre du réchauffement climatique, d'autant plus que l'eau douce y est rare, a une politique de développement des énergies renouvelables9, ainsi que de l'écotourisme.
an 2016 : Congo Brazzaville - Le 20 mars 2016, après avoir fait modifier la constitution (cf. infra), Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 60,07 % des voix, score validé par la Cour constitutionnelle le 4 avril suivant.
an 2016-2019 : Gabon - Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin à cinq mille voix près. L'opposition dénonce immédiatement ces résultats. Des émeutes encore plus violemment réprimées que celles de 2009 éclatent, avec comme point d'orgue l'attaque du quartier général de l'opposition par la garde présidentielle qui fait de nombreux morts. Le 24 septembre 2016, Ali Bongo est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec 50,66 % des voix, suivi de Jean Ping avec 47,24 % des suffrages.
Le président Bongo prône le concept de « Gabon émergent », politique visant notamment à la diversification de l'économie afin de diminuer sa dépendance aux cours mondiaux du pétrole. En 2018, cela ne s'est pourtant pas concrétisé, notamment du fait de la baisse des cours du pétrole et d'investissements peu judicieux, tandis que le chômage des jeunes reste élevé.
Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin à cinq mille voix près. L'opposition dénonce immédiatement ces résultats. Des émeutes encore plus violemment réprimées que celles de 2009 éclatent, avec comme point d'orgue l'attaque du quartier général de l'opposition par la garde présidentielle qui fait de nombreux morts. Le 24 septembre 2016, Ali Bongo est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec 50,66 % des voix, suivi de Jean Ping avec 47,24 % des suffrages.
Le 2 février 2017, le Parlement européen adopte une résolution déclarant que les résultats de la présidentielle « manquent de transparence » et sont « extrêmement douteux ».
Le 7 janvier 2019, une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence après un accident vasculaire cérébral, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour ; sur cinq mutins, deux sont tués et les autres arrêtés. Le 12 janvier, un nouveau Premier ministre est nommé, Julien Nkoghe Bekalé. Le pouvoir gabonais connaît une guerre des clans au sommet. Les remaniements ministériels se succèdent entre janvier et décembre 2019, alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé d'Ali Bongo. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée première ministre en juillet 2020.
an 2016-2017 : Gambie - En décembre 2016, sept partis d'opposition choisissent un candidat unique, Adama Barrow, pour l'élection présidentielle. Adama Barrow remporte l'élection à l'unique tour de scrutin en recueillant 43,3 % des suffrages, contre le président sortant qui arrive second avec 39,6 % des suffrages. Le 17 janvier 2017, Yahya Jammeh instaure l'état d'urgence et le lendemain, le Parlement prolonge son mandat de trois mois, jusqu'au 19 avril 2017. Le 19 janvier, Adama Barrow prête serment à l'ambassade de Gambie à Dakar. Devant le refus de Yahya Jammeh de lui céder le pouvoir, malgré les injonctions de la CÉDÉAO, l'armée sénégalaise pénètre en territoire gambien dans le courant de l'après-midi. Le soir même, le chef de l'armée gambienne, le général Ousman Badjie, déclare à des ressortissants occidentaux qu'il n'ordonnera pas à ses hommes de résister en cas d’intervention des troupes africaines.
L'élection présidentielle de décembre 2016 voit Adama Barrow, candidat de l'opposition, remporter la victoire sur le président sortant13 dont le mandat court jusqu'au 18 janvier 2017. Le 19 janvier 2017, Adama Barrow prête serment dans l'ambassade gambienne à Dakar au Sénégal, après le refus du président sortant de céder le pouvoir. Le même jour, l'armée sénégalaise entre en Gambie, forte d'une résolution de l'ONU. Le 20 janvier 2017, Jammeh accepte de quitter le pouvoir, et part en exil le lendemain soir pour Conakry, avant de rejoindre la Guinée équatoriale.
an 2016 : Guinée - En juillet 2016, la Guinée est le premier pays à majorité musulmane d'Afrique à renouer ses liens diplomatiques avec Israël.
an 2016-2018 : Guinée-Bissau - Au mois de septembre 2016, le président guinéen Alpha Condé, médiateur de la crise bissau-guinéenne, et son homologue de la Sierra Leone Ernest Baï Koroma obtiennent un compromis politique signé le 10 septembre par toutes les parties : ce sont les accords de Conakry. Successivement, Umaro Sissoco Embaló en novembre 2016, puis Artur Silvafin janvier 2018, puis Aristides Gomes mi-avril 2018 sont nommés premier ministres.
an 2016 : Libye - Devant la gravité de la situation et la progression de l'EI, la communauté internationale pousse à la création d'un gouvernement unitaire. Le 12 mars 2016 Fayez el-Sarraj prend la tête d'un gouvernement « d'union nationale », formé à Tunis, initialement rejeté par les parlements de Tripoli et de Tobrouk. Grâce au soutien occidental, le gouvernement peut s'installer à Tripoli à la fin du mois. Il obtient le 23 avril le soutien de la majorité des parlementaires de Tobrouk, et s'installe progressivement dans ses fonctions.
L’Organisation internationale pour les migrations note le développement de la traite d’êtres humains dans la Libye post-kadhafiste. Selon l'organisation, de nombreux migrants sont vendus sur des « marchés aux esclaves » pour 190 à 280 euros. Ils sont égalent sujets à la malnutrition, aux violences sexuelles, voire aux meurtres.
La ville de Syrte, place forte de l’organisation Etat islamique (EI) en Afrique du Nord, est reconquise début décembre 2016 par les forces du gouvernement libyen d’union nationale de Faïez Sarraj, soutenu par les capitales occidentales et les Nations unies, stoppant les vélléités de l'EI dans ce pays.
an 2016 : Mauritanie - Torture
Le 4 février 2016, après une inspection de dix jours, Juan Ernest Mendez, le rapporteur spécial de l'ONU fait part de ses regrets quant à la non application de la loi sur la prévention et la répression de la torture, promulguée en septembre 2015. La Mauritanie est dénoncée par plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, qui rapportent de nombreux actes de tortures et de mauvais traitement infligés aux détenus lors des interrogatoires.
Le 14 novembre 2016, une plainte visant de hauts responsables mauritaniens est déposée à au tribunal de grande instance de Paris. Ils sont accusés de « tortures et de traitements cruels » à l'encontre de militants anti-esclavage.
Situation sanitaire et humanitaire
En novembre 2016, le Programme alimentaire mondial (PAM) appelle à la mobilisation de 17 millions de dollars pour faire face à la situation des réfugiés maliens qui ont fui les exactions des groupes terroristes, confrontés à une crise alimentaire.
an 2016-2018 : Sao Tomé et Principe - Chef de l’Etat : M. Evaristo Carvalho, Président de la République (élu le 7 août 2016)
Chef du Gouvernement : M. Jorge Bom Jesus
L’élection présidentielle du 7 août 2016 voit Evaristo Carvalho, candidat de l’ADI (action démocratique indépendante), élu président de la République contre le président sortant Manuel Pinto da Costa. Le Président a un rôle non exécutif, d’arbitre et de représentation.
Malgré deux tentatives de coup d’Etat en 2003 et 2009, la démocratie parlementaire s’affirme et permet à plusieurs reprises une alternance entre les deux grandes forces qui animent la vie politique : l’ADI de Patrice Trovoada (fils de Miguel Trovoada, il est premier ministre de 2010 à 2012 et de 2014 à 2018) et le MLSTP de Jorge Bom Jesus.
Aux élections législatives d’octobre 2018, une coalition menée par le MLSTP l’emporte d’une très courte avance (28 sièges contre 27) et, après une courte période d’incertitude rapidement tranchée par la Cour constitutionnelle et acceptée par toutes les parties, Jorge Bom Jesus est chargé de former un gouvernement, début décembre 2018. Le gouvernement, toujours dirigé par Jorge Bom Jesus, a été remanié en septembre 2020.
an 2016 : Seychelles - À la suite de la défaite de son parti Lepep (issu de l'ancien parti unique) aux élections législatives de septembre 2016, James Michel annonce sa démission de son poste de président de la République en septembre 2016. Le 16 octobre suivant, il est remplacé par son vice-président, Danny Faure. Une période de cohabitation commence entre ce nouveau président et un Parlement contrôlé par l'opposition à l'ex-parti unique (qui était au pouvoir depuis 1977).
an 2016 : Tchad - Depuis 2016, le Tchad est confronté à un mouvement insurrectionnel dans le Nord du pays : plusieurs groupes armés d'exilés tchadiens ayant combattu dans la guerre civile libyenne reviennent en force dans leur pays d'origine.
an 2016 : Zambie - Edgar Lungu est réélu en 2016, dans un scrutin là encore serré, contre Hakainde Hichilema.
an 2017-2019 : Algérie - Bouteflika est critiqué pour ses manières autocratiques, et le chômage affecte encore plus d'un tiers de la population. En 2009, Bouteflika est réélu pour un troisième mandat après avoir fait amender la Constitution algérienne à cet effet. Victime en 2013 d'un accident vasculaire cérébral affectant son élocution et l'obligeant à se déplacer en chaise roulante, il fait en mars 2017 une apparition publique qui alimente les inquiétudes sur son état de santé. Il est alors âgé de 80 ans et des voix commencent à mettre en doute sa capacité à gouverner le pays.
Sous la pression de manifestations populaires de masse, et alors qu'il se présente pour un cinquième mandat, Abdelaziz Bouteflika démissionne le 2 avril 2019.
an 2017 : Angola - L'Angola présente un paysage de cités martyres, de provinces jadis agricoles stérilisées par la présence de millions de mines. Une bonne partie des infrastructures coloniales a été laissée à l'état de ruines (routes, ponts, aéroports, voies de chemin de fer, écoles), pendant que d'autres ont été reconstruites et même augmentées. L’agriculture et les transports ont été fortement endommagés et se trouvent en récupération lente. Malgré l’aide alimentaire, la famine sévit et le pays ne vit que de l’exportation du pétrole. Comme d’autres pays, l’Angola réclame des indemnisations et des aides financières, que le Portugal et l’Union européenne lui accordent sous forme d’aide au développement (écoles, eau potable, routes, hôpitaux) ou de visas de travail. En dépit de la guerre civile, la scolarité, certes médiocre, s'est améliorée (15 % d’enfants scolarisés en 1975, 88 % en 2005). De nombreuses missions catholiques et protestantes encadrent également les populations depuis l’indépendance. D'un point de vue politique, José Eduardo dos Santos confirme sa retraite, resté trente-sept ans de pouvoir. Il annonce début février 2017, se mettre en retrait de la politique fin 2017, après avoir, pendant 38 ans, muselé l’opposition par une répression policière, limité la liberté d'expression et imposé son autorité17. Il choisit pour lui succéder João Lourenço.
Le parti au pouvoir depuis plus de quatre décennies en Angola, le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), remporte les élections générales, en août 2017, avec plus de 64 % des suffrages. Le candidat du MPLA, Joao Lourenço, succède donc comme prévu à la tête du pays au président José Eduardo dos Santos. Les deux principaux partis dans l'opposition, l’Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (Unita) et la CASA-CE, obtiennent respectivement 24,04 % et 8,56 % des voix exprimées. Au terme de ce scrutin, le MPLA, au pouvoir depuis l’indépendance en 1975, conserve la majorité absolue des 220 sièges du Parlement18. En septembre 2018, Joao Lourenço succède également à José Eduardo dos Santos à la tête du MPLA.
an 2017-2018 : Cameroun - En 2017, le gouvernement de Biya a bloqué l'accès de ces régions à Internet pendant trois mois. En septembre, des séparatistes ont lancé une guérilla pour l'indépendance des régions anglophones en tant que République fédérale d'Ambazonie. Le gouvernement a répondu par une offensive militaire, et l'insurrection s'est étendue aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le 1er octobre 2017, Sisiku Julius Ayuk Tabe déclare symboliquement l'indépendance de la république fédérale d'Ambazonie, déclenchant une répression par les forces de l'ordre se soldant par des morts, des blessés, des émeutes, barricades, manifestations, couvre-feu, etc. En janvier 2018, le Nigéria compte entre 7 000 et 30 000 réfugiés liés au conflit et à la répression à la suite de cette déclaration d'indépendance. Le 5 janvier 2018, des membres du gouvernement intérimaire d'Ambazonie, dont le président Sisiku Julius Ayuk Tabe, sont arrêtés au Nigéria et déportés au Cameroun. Ils y sont arrêtés et passent 10 mois dans un quartier général de gendarmerie avant d’être transférés dans une prison à sécurité maximale de Yaoundé. Un procès débute en décembre 2018. Le 4 février 2018, il a été annoncé que Samuel Ikome Sako deviendrait le président par intérim de la République fédérale d'Ambazonie, succédant temporairement à Tabe. Sa présidence a vu l'escalade du conflit armé et son extension à tout le Cameroun anglophone. Le 31 décembre 2018, Ikome Sako déclare que 2019 verrait le passage d'une guerre défensive à une guerre offensive et que les séparatistes s'efforceraient d'obtenir une indépendance de facto sur le terrain. Le 20 août 2019 au matin le tribunal militaire de Yaoundé condamne Julius Ayuk Tabe et neuf autres de ses partisans à la réclusion criminelle à vie.
an 2017 : République de Centrafrique - En juin 2017, les affrontements à Bria, dans le centre-est du pays, font une centaine de morts. Par ailleurs, un comité est également mis en place afin de juger les principaux acteurs et dédommager les victimes.
an 2017 : Afrique République de Djibouti - En 2017, après les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon, la Chine obtient de pouvoir y implanter une base militaire. L'Espagne et l’Allemagne y ont aussi disposé de petits contingents.
an 2017 : Gabon - Le 2 février 2017, le Parlement européen adopte une résolution déclarant que les résultats de la présidentielle « manquent de transparence » et sont « extrêmement douteux ».
an 2017 : Ghana - Depuis 2017, Nana Akufo-Addo est président de la République.
an 2017 : Guinée-équatoriale - Le père et le fils Obiang sont poursuivis par la justice française sur des biens mal acquis, provenant notamment de détournements de fonds publics. Le fils Teodorin est finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Ce procès dit « des biens mal acquis », révélateur du pillage des richesses nationales, aboutit à une condamnation en octobre 2017, en première instance.
an 2017 : Kenya - L'organisation État islamique et les chebabs multiplient les attaques au Kenya depuis les années 2010, mettant en échec la politique sécuritaire du gouvernement. À ces attaques s'ajoute une instabilité politique interne dans les mois qui précèdent les élections générales d'août 2017. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, est finalement réélu et affiche un score électoral de 54,28 % des suffrages exprimés. Son rival Raila Odinga parle à nouveau de fraudes. Des émeutes éclatent avant un appel au calme par Raila Odinga, qui s'en remet une fois encore à la Cour suprême. Celle-ci, à la surprise générale, lui donne cette fois raison et invalide les élections, qui sont réorganisés en octobre 2017. Cette décision montre une consolidation progressive des contre-pouvoirs au Kenya à la suite de la constitution de 2010. À la suite des modifications de la loi électorale avant ce nouveau scrutin, Raila Odinga se retire et appelle au boycott de l'élection. Finalement, le président sortant Uhuru Kenyatta remporte le nouveau scrutin avec 98,26 % des voix, mais la participation le 26 octobre 2017 n'est que de 38,8 % des électeurs inscrits, à comparer à 79 % le 8 août 2017, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême.
an 2017-2022 : Lesotho - Les élections législatives de juin 2017, organisées de manière anticipées à la suite du vote d'une motion de censure à l'encontre du Premier ministre Pakalitha Mosisili après la dislocation de la coalition le soutenant, aboutissent à une alternance.
Le parti d'opposition Convention de tous les Basotho (ABC) remporte arrive en effet en tête des suffrages et remporte la majorité relative des sièges, tandis que le Congrès démocratique (DC) de Mosisili perd plus du tiers des siens. Mené par Tom Thabane, l'ABC forme un gouvernement de coalition avec trois autres partis, l'Alliance des démocrates (AD), le Parti national basotho (BNP) et le Congrès réformé du Lesotho (RCL), permettant à Thabane de devenir premier ministre.
Accusé d'avoir commandité le meurtre de son ex épouse Lipolelo Thabane deux jours avant sa prise de fonction en 2017, le Premier ministre est cependant conduit à la démission le 19 mai 2020. Remplacé le lendemain par lendemain par le ministre des Finances Moeketsi Majoro, qui prend également la tête de l'ABC, Thabane est par la suite officiellement inculpé pour meurtre fin novembre 2021.
L'organisation des législatives de 2022 est compliquée par la pandémie de Covid-19 et le manque de budget, qui pousse le gouvernement à repousser le scrutin de juin à septembre.
an 2017-2018 : Libéria - Le 26 décembre 2017, lors d'une nouvelle présidentielle; George Weah est élu avec 61,5 % des voix au suffrage universel face au vice-président sortant, Joseph Boakai, qui en obtient 38,5 %. Il met l'accent sur la lutte anticorruption et sur l'éducation. La situation économique dont hérite le nouveau président reste délicate, avec le poids de la dette sur le budget de l'État, et une inflation importante. À partir de juin 2019, l'état de grâce de George Weah est terminé : des manifestations sont organisées contre sa politique économique.
George Weah s’est fixé comme principal objectif d’améliorer la vie des Libériens grâce à la mise en œuvre d’un programme « pro-poor » qui vise les plus défavorisés. Il entend également parachever la réconciliation nationale, lutter contre la corruption, et développer les infrastructures, en particulier routières, dont le pays est largement dépourvu.
L’élection de George Weah marque par ailleurs un pas supplémentaire dans la stabilisation du pays, confirmée par le départ de la mission des Nations unies pour le Libéria (MINUL), le 30 mars 2018.
an 2017 : Mauritanie - Le 17 mars 2017, le projet de révision constitutionnelle soumis par le gouvernement est rejeté par le Sénat. Le président Aziz annonce l'organisation d'un référendum pour le 5 août 2017.
Le 6 juin 2017, la Mauritanie annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec le Qatar, et accuse le pays de propager l'extrémisme et l'anarchie dans de nombreux pays arabes.
Le référendum du 5 août 2017 donnent un «oui» qui l'emporte à plus de 85 %. Il comporte deux volets, la modification du drapeau national (85,6 % de «oui» et 9,9 % pour le «non») ainsi que la suppression du Sénat (85,6 % pour le « oui » et 10,02 % pour le « non »). Malgré le boycott de l'opposition et de la société civile, le taux de participation est de 53,75 % selon la commission électorale49. Leader des opposants à la suppression du Sénat, le sénateur d'opposition Mohamed ould Ghadde est arrêté le 10 août50. Plusieurs personnalités de l'opposition sont interrogées51. Plusieurs sénateurs, journalistes et représentants syndicaux, accusés de faits de corruption et tous opposants à la réforme constitutionnelle, comparaitront devant un juge d'instruction.
À la fin du mois d'octobre 2017, la première opération conduite par la Force antiterroriste G5 Sahel est lancée. Dénommée Hawbi, elle est constituée du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad et compte jusqu'à 5.000 hommes répartis dans sept bataillons.
Le 13 novembre 2017, le Sénat est dissout, les grilles de l’institution sont fermées et l'accès au bâtiment fermé, mais des sénateurs frondeurs forcent l'entrée et ouvrent une session parlementaire symbolique, qui ne dure en réalité que le temps que la police intervienne et déloge les élus.
Le 28 novembre 2017, le 57e anniversaire de l’indépendance est l'occasion de présenter le nouveau drapeau mauritanien ainsi que le nouvel hymne national, nouveaux emblèmes adoptés à l'issue du référendum constitutionnel du 5 août.
Esclavage
Le 28 avril 2017, la journaliste Tiphaine Gosse et la juriste Marie Foray qui enquêtent sur l'esclavage en Mauritanie sont expulsées du pays. Elles dénoncent aux côtés d'organisations engagées dans la lutte contre l’esclavage en Mauritanie telles que SOS-Esclaves, l’AMDH et l’Association des femmes chefs de famille (AFCF) « l’hypocrisie des autorités mauritaniennes », qui cherchent selon elles par la ratification des traités internationaux et l’adoption de lois qu'elle jugent incomplètes, à plaire à la communauté internationale sans lutter pour autant contre l’esclavage dans le pays.
Le 22 juin 2017, une plainte contre l’esclavagisme et la torture en Mauritanie est déposée devant l'ONU et l'UA. L'eurodéputé Louis Michel souligne que l'esclavage continue en Mauritanie. Biram Dah Abeid, le président de l'association IRA déplore l'acharnement des autorités mauritaniennes à l'encontre des militants anti-esclavagisme.
an 2017 : Mozambique - le spectre d'une nouvelle guerre civile s'éloigne début 2017. Par contre, un scandale de dettes cachées, à la fin du deuxième mandat d'Armando Guebuza, touche le FRELIMO même si le président a changé, et fragilise le pays. Des médias anglo-saxons démontrent l'existence d'emprunts contractés de façon opaque mais garantis par le gouvernement de l'époque, pour 1,8 milliard d’euros, par trois entreprises publiques. L'affectation précise des sommes reste floue, même s'il est indiqué que ces emprunts auraient financé un programme d'armement. Depuis, le Mozambique, incapable d’honorer les remboursements de ces dettes, est plongé dans une crise financière.
an 2017 : Rwanda - Une opposante, Diane Rwigara annonce son intention de se présenter à l'Élection présidentielle rwandaise de 2017. 72 heures plus tard, des photos d'elle dénudée sont divulguées, dans un but d'intimidation. Elle persiste dans sa candidature, mais cette candidature est invalidée le 7 juillet 2017, par la Commission électorale nationale. Cette candidate semble disparaître fin août 2017, puis la police rwandaise annonce son arrestation, pour atteinte à la sureté de l’État. Début octobre, elle est inculpée, ainsi que sa mère et sa sœur, d’« incitation à l’insurrection ». Elle est libérée sous caution quelques mois plus tard en signe d'apaisement, et finalement acquittée par un tribunal de Kigali le 6 décembre 2018, ainsi que les co-accusés. Selon le jugement, « les charges retenues par l’accusation sont sans fondement ».
an 2017 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Coup d'État de novembre 2017
En raison de l'âge avancé du président Robert Mugabe, qui célèbre ses 93 ans en février 2017 et est le dirigeant le plus âgé du monde, la question de sa succession devient une question importante de la vie politique zimbabwéenne. Robert Mugabe révèle qu'il souhaite voir son épouse Grace Mugabe lui succéder. Il écarte du parti ZANU-PF et du gouvernement les rivaux potentiels de cette dernière. Grace Mugabe, connue pour ses goûts de luxe et sa brutalité, est toutefois impopulaire. Le 4 novembre, Robert Mugabe annonce qu'il souhaite que son épouse devienne vice-présidente. Le 5 novembre, celle-ci lui demande publiquement de lui céder directement la présidence de la République. Le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, le 6 novembre 2017, a ainsi pour objectif de conforter la première dame, mais déplaît aux forces armées.
Le 15 novembre 2017, le général Sibusiso Moyo annonce à la télévision nationale prendre le contrôle des rues afin « d'éliminer des criminels proches du président Mugabe » et affirme également que l'armée ne mène pas de coup d'État contre le gouvernement. Robert Mugabe et sa femme Grace sont placés en résidence surveillée par les militaires. L'Afrique du Sud, inquiète pour son sort, envoie deux émissaires rencontrer sa famille ainsi que les responsables militaires. L'Union africaine, l'Union européenne ou le Nigeria lancent un appel à la paix. Néanmoins, aucun désordre n’est observé.
Le 16 novembre 2017, Robert Mugabe continue de se considérer comme le seul dirigeant légitime du Zimbabwe et refuse la médiation du prêtre catholique Fidelis Mukonori. Cependant, le 21 novembre 2017, il finit par démissionner.
an 2017-2019 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Emmerson Mnangagwa regagne le Zimbabwe le 22 novembre 2017 et déclare qu'« aujourd'hui, nous voyons naître une nouvelle démocratie ». Mnangagwa est désigné président intérimaire et doit prêter serment dans les deux jours. La date du serment est cependant repoussée au 24 novembre 2017. Il conserve ses fonctions jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle de 2018 au cours de laquelle il porte les couleurs de la ZANU-PF et est donc le candidat favori à sa propre succession. Il emporte de justesse l’élection présidentielle au premier tour, sur fond de soupçons de fraude. Les résultats sont contestés par l'opposition mais la Cour suprême du Zimbabwe confirme finalement la victoire de Mnangagwa, faisant de lui le nouveau président élu après Mugabe. Le début de l'année 2019, dans un contexte de crise économique et d'absence d'avancées démocratiques, est marqué par de violentes manifestations, durement réprimées.
En 2019, après une campagne agricole particulièrement mauvaise en raison de la sécheresse, 2,5 millions de Zimbabwéens « s'acheminent vers la famine » selon le programme alimentaire mondial. Comme le reste de l’Afrique australe, le Zimbabwe est soumis depuis plusieurs saisons à des épisodes récurrents de sécheresse, aggravés par le réchauffement climatique, qui pèsent sur la sécurité alimentaire de la population et de la faune. En octobre, l’ONU évalue à 7,7 millions le nombre de personnes qui seront menacées par la famine en 2020.
an 2018 : Afrique du Sud - Visé par des affaires de corruption, Jacob Zuma démissionne sous la pression de son parti début 2018, après avoir été menacé de destitution, et Cyril Ramaphosa lui succède comme président de la République par intérim. Le 15 février 2018, le Parlement élit formellement Cyril Ramaphosa président de la République.
Après avoir été élu président de l'ANC le 18 décembre 2017 contre Nkosazana Dlamini-Zuma (ex-femme de Jacob Zuma et ex-présidente de la commission de l'Union africaine), Cyril Ramaphosa obtient de haute lutte le 14 février 2018 la démission de Jacob Zuma de la présidence de la République. Ramaphosa lui succède comme président de la République par intérim avant d'être élu formellement par le parlement. Acculé par la gauche de l'ANC et par la surenchère des Economic Freedom Fighters (EFF), il se prononce en faveur d'une redistribution des terres aux Sud-Africains noirs afin de « panser les plaies du passé » alors que 72 % des terres agricoles restent détenues par des Blancs (personnes physiques ou sociétés commerciales) contre 85 % à la fin de l’apartheid. Le Parlement adopte alors une motion présentée par Julius Malema, le chef des EFF, visant à faire modifier la constitution sud-africaine et permettre, sans compensation financière, l'expropriation de terres agricoles. Une partie de l'opposition invoque une violation du droit de propriété, tandis que des investisseurs et le South African Institute of Race Relations déclarent craindre que cette réforme ne porte atteinte à l'agriculture commerciale et ne provoque une crise durable. En juillet 2018, le président sud-africain annonce que l'ANC compte amender la Constitution pour y faire entrer le principe d'expropriation des fermiers sans compensation, provoquant la chute de la devise nationale. Au delà des fermes, des experts sud-africains de l'Institute for Poverty, Land and Agragian Studies (Université du Cap-Occidental) et du Mapungubwe Institute for Strategic Reflection soulignent que d'autres types de propriétés pourraient être soumises au nouveau Code foncier, notamment en centre-ville (friches et terrains non exploités, bâtiments non entretenus...) ou en zone périphérique rurale (terrains miniers notamment). Mais cette réforme avance avec lenteur. Il est réélu chef de l’État le 22 mai 2019, à l’issue d’élections générales lors desquelles l’ANC obtient le plus faible score de son histoire (57,5 %), passant sous la barre des 60 % pour la première fois depuis un quart de siècle et payant ainsi les errements et les scandales de l'ère Zuma, son prédécesseur.
Il doit également faire face à une opposition interne au sein de l'ANC, avec un clan resté fidèle à Jacob Zuma, ayant à sa tête le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, et son adjointe, Jessie Duarte. Mais le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, connaît également des divisions internes : son leader, Mmusi Maimane, démissionne le 24 octobre 2019, dénonçant une « campagne de dénigrement », de « diffamation » et des « comportements de lâches », quittant à la fois la direction du parti, le parti lui-même et ses fonctions de parlementaire. Ce départ, ou cette éviction, risque de réduire à nouveau ce parti à un «parti de Blancs».
Une vague de xénophobie vis-à-vis des migrants, les «étrangers», secoue également le pays. Par ailleurs, plusieurs sociétés importantes pour l'économie africaine sont en difficulté, notamment la compagnie nationale d'électricité Eskom. Le 19 novembre 2019,au PDG est nommé pour cette entreprise, qui lance dans la foulée un nouveau plan de restructuration.
Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi.
En mars-avril 2020 il doit faire face à la pandémie mondiale de Covid-19 et obtient un certain succès.
an 2018-2019 : Bénin (anc. Dahomey) - En 2018 et 2019, des mouvements sociaux sont constatés mais ne remettent pas en cause la stabilité de la République béninoise. Par contre, une « contagion » djihadiste est constatée avec l'enlèvement de deux Français dans le parc national de la Pendjari, un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Afrique. Cet événement, même si les otages sont libérés par une intervention de forces françaises, confirme la possibilité de voir les groupes djihadistes descendre vers le golfe de Guinée au fur et à mesure de la déstabilisation du Burkina Faso, et du centre du Mali. Cela contrarie également les objectifs du président béninois, Patrice Talon, de développer le tourisme dans son pays.
an 2018-2019 : République de Botswana - Le 1er avril 2018, son vice-président, Mokgweetsi Masisi est désigné pour le remplacer comme président du Botswana. L'année suivante, en 2019, il remporte les élections générales.
an 2018-2019 : Cameroun - Paul Biya est réélu pour un septième mandat en 2018, dans un scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition. Il lance un «grand dialogue national» en 2019. Aucune avancée décisive n'en ressort sur le conflit dans les régions anglophones. Paul Biya fait libérer des détenus, mais les leaders du mouvement restent en prison.
an 2018 : République de Centrafrique - Depuis 2018, des mercenaires russes du Groupe Wagner et de la société privée Sewa Security Services (SSS) sont présents en Centrafrique, où ils participent à la formation de militaires des Forces Armées Centrafricaines (FACA) et à la protection rapprochée du Président centrafricain.
an 2018 : Congo Kinshasa - Le 30 décembre 2018, les élections ont lieu et le 10 janvier 2019, le président de la CENI, Corneille Nangaa proclame Félix Tshisekedi comme président de la république démocratique du Congo. Le président Tshisekedi prête serment le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation, résidence officielle des présidents congolais.
Félix Tshisekedi a noué une alliance de circonstance pendant la campagne électorale avec le parti de Joseph Kabila, devenu sénateur à vie et qui conserve ainsi une influence sur le pouvoir. Leur principal opposant, Martin Fayulu, donné un moment vainqueur de l'élection présidentielle, sur la base d'une fuite de données de la CENI et par la mission d’observation de l’Église catholique congolaise, est contraint de s'incliner devant le résultat annoncé, probablement truqué. La Cour constitutionnelle a rejeté son recours. Par cette alliance, Félix Tshisekedi joue aussi la stabilité et prépare la suite de son mandat en composant avec l'assemblée législative où le parti de Kabila possède 337 sièges sur 50064,65. Le 6 décembre 2020, le président met fin à la coalition avec Kabila. Les proches de ce dernier sont alors écartés et les autres politiciens rejoignent Félix Tshisekedi. Le nouvel exécutif compte 56 membres dont 14 femmes. Leur objectif sera de « lutter contre la corruption et la misère qui touche les deux tiers de la population et ramener la paix dans l’est du pays, ensanglanté par les violences des groupes armés".
2018-2019 : Égypte - En mai 2014, Abdel Fattah al-Sissi, est réélu pour un deuxième mandat.
Par une révision constitutionnelle validée par un référendum en avril 2019, il se donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Il impose un régime autoritaire, réprime toute opposition et toute voix critique, et met sous contrôle les médias et la justice.
an 2018-2019 : Eswatini (Swaziland) - En avril 2018, à l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance, le roi annonce que le pays reprend son nom d'origine d'avant la colonisation : Eswatini. En octobre 2019, la livraison de voitures de luxe flambant neuves, des Rolls Royce, à la famille royale d’Eswatini provoque des réactions négatives dans ce royaume très pauvre d’Afrique australe, alors que des fonctionnaires manifestent pour demander une revalorisation de leurs salaires.
an 2018 : Gambie - Le 8 février 2018, la Gambie adhère à nouveau au Commonwealth.
an 2018-2021 : Ghana - En 2018, cette nation est également endeuillée par la mort d'un de ses plus célèbres compatriotes, Kofi Annan. Sur le plan économique, le Ghana s'associe avec la Côte d'Ivoire, en 2019, pour obtenir des marchés un prix juste pour le cacao, en suspendant pendant quelques semaines la vente des récoltes 2020-2021. Il cherche à développer le tourisme vers ses terres au sein de la communauté afro-américaine, en mettant l'accent sur la mémoire de la traite négrière. Nana Akufo-Ado, d’inspiration libérale, mise aussi sur le développement de l’esprit d’entreprise. Il incite également la diaspora formée dans les pays occidentaux à revenir au pays, ou à y investir.
an 2018 : Guinée - D'après la Banque mondiale, en 2018, le chômage frappe 80 % des jeunes et près de 80 % de la population active travaille dans le secteur informel. Surtout, 55 % des Guinéens vivent sous le seuil de pauvreté.
an 2018 : Guinée-Bissau - Lors d'une réunion du 30 août 2018 du Conseil de sécurité de l'ONU, les signes d'une amélioration de la situation politique sont soulignés, mais il est rappelé que des points des accords de Conakry restent à réaliser : réforme constitutionnelle et réforme électorale.
an 2018-2020 : Libye - Par contre, la situation reste bloquée entre le Premier ministre Fayez el-Sarraj issu du gouvernement d'accord national (GAN) et le chef de l'Armée nationale libyenne (ANL) du Khalifa Haftar. Des médiations diplomatiques entre ces deux partis sont menées en France, en juillet 2017 à La-Celle-Saint-Cloud, en France toujours en mai 2018 au palais de l'Élysée, puis à Palerme en Italie en novembre 2018, laissant espérer la reprise d'un dialogue. Mais l'assaut militaire déclenché en avril 2019 par les troupes de l'Armée nationale libyenne (ANL) du Khalifa Haftar sur Tripoli, un assaut qui s'enlise ensuite, pulvérise à court terme les espoirs d'un règlement politique. Chacune des forces en présences, le GAN et l'ALN, multiplie les contacts et les alliances avec des puissances extérieures : notamment la Turquie pour le GAN, les Émirats arabes unis,l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Russie pour l'ALN. Une nouvelle initiative de médiation, turco-russe cette fois, pour obtenir la signature à Moscou d’un cessez-le-feu en Libye tourne court, en janvier 2020.
an 2018 - 2023 : Madagascar - Les élections de décembre 2018 portent au pouvoir pour 5 ans Andry Rajoelina. Celui-ci remporte également les élections législatives de mai 2019 et obtient la majoprité absolue à l'Assemblée nationale.
an 2018-2019 : Mali - La situation sécuritaire reste très précaire, avec de nombreuses attaques djihadistes. Les conflits communautaires persistent, occasionnant des centaines de morts, particulièrement dans la région de Mopti. En 2018, l'armée française poursuit ses opérations et particulièrement dans le Liptako Gourma, une zone entre le centre du Mali, le sud-ouest du Niger et le Burkina Faso.
Les djihadistes opèrent une guerre asymétrique : ils procèdent surtout par attaques surprises, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires. Le 23 mars 2019, des miliciens dogons font 157 morts lors du massacre d'Ogossagou, village peul situé près de Bankass, toujours dans le centre du pays. Beaucoup des victimes avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d’autres affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts en 2018 dans le centre du Mali, selon l’ONU. Les troupes françaises sont de plus en plus critiquées localement : poursuivre le combat accroît le risque d’enlisement et de compromission.
an 2018 : Mauritanie - Le premier janvier 2018, la Mauritanie change l'unité de sa monnaie. L'ouguiya passe d'une échelle de 10 à 1, dix ouguiyas deviennent un ouguiya. De nouveaux billets sont émis mais la monnaie conserve le même nom. Avant même l’annonce de la mise en circulation des nouveaux billets, la monnaie mauritanienne se déprécie au marché noir face à l’euro et au dollar, une tendance qui s'aggrave dès l'annonce officielle.
Le 20 mai 2018, le régime durcit la loi sur les partis politiques et un décret ouvre la voie à la dissolution des partis sous-représentés à l'échelle nationale et régionale.
Les élections locales et législatives du 15 septembre 2018 voient la victoire du parti au pouvoir, l'UPR, qui remporte les 13 Conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat, ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale et plus des deux tiers des communes. Le 8 octobre Cheikh ould Baya, député de l'UPR et proche du président, est élu président de l'Assemblée. Le 29 octobre 2018 Mohamed Salem Ould Bechir est nommé Premier ministre et nomme le lendemain un nouveau gouvernement.
Esclavage
Le 12 février 2018, l'ONG Human Right Watch présente à Nouakchott son rapport sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Intitulé « Ethnicité, discrimination et autres lignes rouges : répression à l’encontre de défenseurs des droits humains en Mauritanie » le rapport pointe les difficultés rencontrées par les militants traitant des questions sociales sensibles comme l'esclavage, la discrimination entre communautés ou le passif humanitaire du pays.
Le 25 mars 2018, un rapport sur la répression contre les militants des droits de l'Homme en Mauritanie est publié par Amnesty International. Le rapport avance que 43.000 personnes vivent en situation d'esclavage dans le pays. Amnesty International détaille également la façon dont les militants abolitionnistes et les associations qui dénoncent ces discriminations sont la cible des autorités108. Trois jours plus tard, la cour criminelle de Nouadhibou condamne un homme et une femme à respectivement 20 et 10 ans de prison ferme pour esclavagisme. Une première en Mauritanie.
Le 4 novembre 2018, les États-Unis, constatant le manque de progrès du pays en matière de lutte contre l'esclavage, suspendent la Mauritanie de l'AGOA.
Situation sanitaire et humanitaire
Le 26 juin 2018, la Mauritanie alerte sur des cas de malnutrution sévères touchant plusieurs dizaines d’enfants dans l’est du pays. La région du Hod Ech Chargui, non loin de la frontière avec le Mali, est particulièrement touchée.
En juin 2018, un rapport de l’ONU établi que les trois quarts des mauritaniens vivent dans une extrême pauvreté. Présenté durant la 35e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU par le rapporteur spécial Philip Alston, le rapport pointe les difficultés dans l'accès à l'eau, à l'alimentation, à l'éducation et à la santé de la population.
En décembre 2018, grâce à un don chinois, la capitale Nouakchott se dote d'un véritable réseau d'assainissement, absent jusqu'ici
an 2018-2020 : Nigéria - Entre 2011 et 2018, le bilan humain de ce violent conflit a été estimé à 37 530 morts.
Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest prend également part à l'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria. En août 2018, Mamman Nour, le numéro 2 de l'organisation, accusé d'être trop modéré, est assassiné par d'autres membres de l'EIAO et les partisans d'une ligne plus dure reprennent le dessus. Le groupe s'en prend alors de plus en plus aux civils. Le 26 décembre 2019, le groupe diffuse notamment une vidéo montrant l'exécution par balles de 11 chrétiens.
En novembre 2020, au moins 110 civils sont tués par des jihadistes présumés dans l'État de Borno sans que le massacre ne soit revendiqué par l'un des deux groupes.
an 2018 : Sierra Leone - En 2018, le pays connaît une nouvelle alternance politique entre les deux principaux partis. Le candidat de l’opposition, Julius Maada Bio, ancien militaire de 53 ans, remporte les présidentielles avec 51,81 % des voix, contre 48,19 % pour Samura Kamara, le candidat du parti précédemment au pouvoir, le Congrès de tout le peuple (APC)
an 2018 : Soudan - En 2018, le régime applique en 2018 un plan d'austérité du Fonds monétaire international, transférant certains secteurs des importations au secteur privé. En conséquence, le prix du pain est doublé et celui de l’essence augmente de 30 %. L’inflation atteint les 40 %. Des mouvements étudiants et le Parti communiste soudanais organisent des manifestations pour contester cette politique. Omar el-Bechir réagit en faisant arrêter le secrétaire général du Parti communiste et deux autres dirigeants du parti, et par la fermeture de six journaux.
an 2019 : Afrique du Sud - Cyril Ramaphosa est réélu chef de l’État le 22 mai 2019, à l’issue d’élections générales lors desquelles l’ANC obtient le plus faible score de son histoire (57,5 %), passant sous la barre des 60 % pour la première fois depuis un quart de siècle et payant ainsi les errements et les scandales de l'ère Zuma, son prédécesseur.
Il doit également faire face à une opposition interne au sein de l'ANC, avec un clan resté fidèle à Jacob Zuma, ayant à sa tête le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, et son adjointe, Jessie Duarte. Une vague de xénophobie vis-à-vis les migrants, les « étrangers », secoue également le pays.
an 2019-2022 : Algérie - Depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika et l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, le pays est dirigé par le président Abdelmadjid Tebboune.
an 2019 : Bénin (anc. Dahomey) - En décembre 2019, l’annonce, par le président ivoirien Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron, de la fin du franc CFA pour les huit pays de la CEDEAO, au profit de l'Eco est diversement qualifiée. Décision historique pour certains, d'autres la qualifient d’« arnaque » et de « poudre aux yeux ». Une parité fixe est maintenue pour la future monnaie avec l’euro
an 2019 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - - Dans la nuit du 3 au 4 février 2019, un groupe terroriste attaque la ville de Kaïn dans le département du même nom, au nord de la province du Yatenga. Le bilan est de 14 morts civils. L'armée réagit rapidement, avec des actions contre les groupes terroristes dans le nord-ouest du pays, déclarant avoir alors « neutralisé » 146 terroristes. À la veille du début de l'année de la présidence par le pays du G5 Sahel, l'attaque terroriste porte à près de 300 le nombre d'habitants assassinés par ces groupes depuis 201541. Le jour inaugural du G5 Sahel, mardi 5 février, un détachement de la gendarmerie est attaqué à Oursi, cinq militaires meurent, contre selon l'armée, 21 assaillants tués lors de l'attaque. L'insécurité croissante a entrainé la multiplication des milices. En 2020, le pays compterait près de 4 500 groupes de koglweogo, mobilisant entre 20 000 et 45 000 membres.
Pour faire face au crime organisé (attaques à main armée dans les lieux de travail et habitations, vols d'animaux et autres formes de violences ciblant notamment les populations rurales et périurbaines), des groupes d'autodéfense se sont constitués au sein de certaines communautés. Dénommés « koglwéogo », ils sont indépendants vis-à-vis de l'État, ne rendent comptes à personne. Ils agissent hors de tout cadre légal. Ils ont localement fait reculer la délinquance, mais des exactions commises par certains de leurs membres créent une nouvelle source d'insécurité et de péril pour les droits humains, et affaiblissent encore le système judiciaire légal (déjà critiqué pour son inefficacité par la population et les médias). Au sein de koglwéogo qui, sous prétexte d'une réponse citoyenne à la crise sécuritaire, « s'arrogent le droit d'arrêter, de juger et de sanctionner, par des amendes, sévices corporels et humiliations, au terme de tribunaux populaires expéditifs », de graves violences (torture notamment) sont observées. « De présumés voleurs sont ligotés au pied d'un arbre, fouettés avec des branches enflammées de tamarinier, le tout en public, et ce jusqu'à ce qu'ils avouent leur crime », bafouant les droits humains via une justice expéditive. Selon Amnesty international, « les Koglwéogo ont commis des exactions, telles que des passages à tabac et des enlèvements, poussant ainsi des organisations de la société civile à reprocher à l’État de ne pas agir suffisamment pour empêcher ces violences et y remédier ; une levée de boucliers qui avait amené l'Etat à condamner en septembre 2016 Koglwéogo à 6 mois d'emprisonnement, et 26 autres à des peines allant de 10 à 12 mois de prison avec sursis. Les 29 et 30 mai 2020, plusieurs attaques djihadistes ont fait une cinquantaine de morts à Kompienga48. Dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, une nouvelle attaque djihadiste tue plus de 160 personnes dont « une vingtaine d'enfants » à Solhan, un village situé au nord-est du pays. C'est l'attaque la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso depuis le début des assauts djihadistes, en 2015. En six ans, les violences ont déjà fait plusieurs milliers de morts, plus particulièrement dans les zones proches des frontières avec le Mali et le Niger
an 2019 : Afrique - Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa, Président d'Afrique du Sud, prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi
an 2019 : Cameroun - En 2019, les combats entre les guérillas séparatistes et les forces gouvernementales se poursuivent.
an 2019 : République de Centrafrique - Le 6 février 2019, l'État centrafricain signe avec les 14 principaux groupes armés du pays un nouvel accord de paix négocié en janvier à Khartoum (Soudan). Malgré cet accord, 80 % du territoire restent contrôlés par des groupes armés et les massacres de populations civiles continuent.
an 2019-2020 : Gabon - Le 7 janvier 2019, une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence après un accident vasculaire cérébral, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour ; sur cinq mutins, deux sont tués et les autres arrêtés. Le 12 janvier, un nouveau Premier ministre est nommé, Julien Nkoghe Bekalé. Le pouvoir gabonais connaît une guerre des clans au sommet. Les remaniements ministériels se succèdent entre janvier et décembre 2019, alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé d'Ali Bongo. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée première ministre en juillet 2020.
an 2019 : Gambie - Le 27 août 2019, Dawda Jawara décède, il avait était premier Premier ministre de Gambie entre 1962 et 1970, puis le premier président de la République de Gambie de 1970 à 1994.
an 2019 : Guinée-Bissau - élection présidentielle de fin 2019 voit la défaite du candidat de l'ex-parti unique, au pouvoir depuis 1974, le PAIGC, et la victoire d'Umaro Sissoco Embaló, ancien général et ancien Premier ministre devenu opposant. La confirmation de ce résultat est compliquée, donnant lieu à des allers et retours entre la Commission électorale et la Cour suprême (saisie par le PAIGC), mais c'est la première transition politique qui s'effectue pacifiquement.
an 2019 : Guinée équatoriale - La population de Guinée équatoriale vit dans des conditions précaires. Bata, seconde ville du pays et capitale économique, a été ainsi privée d'eau courante pendant trois semaines en 2019, sans que les autorités s'expliquent sur les difficultés rencontrées.
an 2019 : Mali - Les djihadistes opèrent une guerre asymétrique : ils procèdent surtout par attaques surprises, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires. Le 23 mars 2019, des miliciens dogons font 157 morts lors du massacre d'Ogossagou, village peul situé près de Bankass, toujours dans le centre du pays. Beaucoup des victimes avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d’autres affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts en 2018 dans le centre du Mali, selon l’ONU. Les troupes françaises sont de plus en plus critiquées localement : poursuivre le combat accroît le risque d’enlisement et de compromission.
an 2019 : Iles Maurice - À la lignée des Ramgoolam succède celle des Jugnauth. Pravind Jugnauth remporte les législatives de 2019.
Le 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution demandant au Royaume-Uni de rétrocéder sous six mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos. Ce délai a pris fin le 22 novembre 2019, sans que le Royaume-Uni se conforme à cette résolution, ni à l'avis consultatif formulé en février par la Cour internationale de justice (CIJ) demandant à Londres de mettre fin « dans les plus brefs délais » à son administration des Chagos.
an 2019 : Mauritanie - Le 28 janvier 2019, un projet de loi est voté autorisant un accord de coopération entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite en matière de lutte contre le trafic d'armes et d'êtres humains. L’opposition mauritanienne crie au scandale, pointant le manque de crédibilité du royaume wahhabite en matière du respect des droits de l’homme.
Le 5 mars 2019, à trois mois de la présidentielle, 76 partis politiques sont dissous par décret rendu public par le ministre mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation. Le 9 mai, six candidatures à la présidentielle du 22 juin 2019 sont validées par le Conseil constitutionnel.
Le 20 mai, une série de nominations faites en conseil des ministres dans les semaines qui précèdent l'élection présidentielle sont dénoncées par plusieurs candidats.
Le 1er juillet 2019, la victoire du général Mohamed Ould Ghazouani dès le premier tour, avec 52 % des voix, est proclamée par le Conseil constitutionnel mauritanien, dans un climat délétère, avec une coupure prolongée d'internet et un déploiement des unités d’élite de l’armée, de la garde et de la police anti-émeute dans toute la capitale, Nouakchott. L'opposition dénonce de multiples irrégularités dans le déroulement du scrutin et qualifie la déclaration de victoire du candidat du pouvoir le soir du premier tour de «nouveau coup d'État».
Le 8 août 2019, le président Ghazouani nomme son premier gouvernement, dirigé par le premier ministre désigné le 3 août, Ismael Ould Bodé Ould Cheikh Sidiya.
Le 19 mars 2019, la police mauritanienne refoule une délégation d'Amnesty International à son arrivée à l'aéroport de Nouakchott
Le 22 mars 2019, les blogueurs Abderrahmane Weddady et Cheikh Ould Jiddou, connus pour dénoncer les atteintes aux droits de l'Homme en Mauritanie sont emprisonnés. Amnesty International explique qu'« Ils ont critiqué la corruption qui régnerait au sein du gouvernement dans des commentaires sur Facebook ». Les deux blogueurs avaient repris sur leurs blogs des articles publiés par des médias arabes faisant état d’un placement présumé de deux milliards de dollars aux Émirats arabes unis par un proche du chef de l’État. Amnesty International qualifie par ailleurs leur détention d’illégale. D'autres ONG comme Reporters Sans Frontières et Human Right Watch dénonceront à leur tour l'arrestation des deux blogueurs.
Le 5 juillet 2019, une vingtaine de journalistes manifestent devant le ministère la Communication et demandent la libération de leur confrère Ahmed Ould Wedia, interpellé chez lui trois jours auparavant.
En mai 2019, la France et la Mauritanie signent un accord de financement d'un montant de 4,4 milliards d'ouguiyas (11 millions d'euros), afin de financer des projets hydrauliques destinés à améliorer les conditions de vie de la population.
Esclavage
Le 28 janvier 2019, un projet de loi est voté autorisant un accord de coopération entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite en matière de lutte contre le trafic d'armes et d'êtres humains. L’opposition mauritanienne crie au scandale, pointant le manque de crédibilité du royaume wahhabite en matière du respect des droits de l’homme.
Les séquelles de l'esclavage touchent particulièrement la population Haratine, qui faute d'accès à l'éducation concentre 85 % des analphabètes du pays
Situation sanitaire et humanitaire
En mai 2019, la France et la Mauritanie signent un accord de financement d'un montant de 4,4 milliards d'ouguiyas (11 millions d'euros), afin de financer des projets hydrauliques destinés à améliorer les conditions de vie de la population.
an 2019 : Mozambique - Le président Filipe Nyusi est réélu en octobre 2019 pour un deuxième mandat de cinq ans avec 73 % des suffrages. Son parti, le FRELIMO, remporte 184 des 250 sièges à l’Assemblée nationale et dirige l’ensemble des dix provinces du pays. Ce scrutin a été manipulé comme les précédents pour en garantir le résultat : redécoupage de la carte électorale pour gonfler l’importance des bastions du pouvoir, mise à disposition constante des moyens de l’Etat pour la campagne du parti au pouvoir, tracasseries pour les opposants, usage de la violence, etc., le FRELIMO montre une volonté d’hégémonie. Ceci pose aussi la question d’un processus de paix jamais arrivé à son terme depuis le premier accord avec l’ancienne rébellion de la Résistance nationale mozambicaine (RENAMO), en 1992. Ossufo Momade a été le candidat de la RENAMO, mouvement affaibli par la mort de son chef historique, Afonso Dhlakama, en 2018.
Le Mozambique peut devenir l'un des grands producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, avec d'importantes réserves, et devient à ce titre un pays courtisé. Les ressources en gaz naturel devraient être exploitées en particulier dans la province de Cabo Delgado d’ici à cinq ans. Total, notamment, a finalisé son entrée fin septembre 2019 dans l’un des deux projets majeurs, Mozambique LNG.
an 2019 : Namibie - En 2019 a lieu L'élection présidentielle namibienne de 2019, en même temps que les élections législatives. Le président sortant Hage Geingob, de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (abrégée en SWAPO) est réélu avec un score, en baisse, de 56 % des suffrages. La SWAPO est au pouvoir depuis 1990. La participation au scrutin présidentiel a été de 60 %. Les autres candidats ont été Panduleni Itula, candidat dissident de la SWAPO qui obtient 30 % des suffrages. Il est en tête dans la capitale du pays. Le chef de l’opposition, McHenry Venaani, ne récolte que 5,4 %. La proximité passée de son parti, le Mouvement démocratique populaire (PDM) (ex-Alliance démocratique de la Turnhalle), avec le régime de l'apartheid en Afrique du Sud de l’apartheid, continue à être un repoussoir pour une grande part de l’électorat. Un nouveau parti d’opposition émerge, le Mouvement des sans-terre (LPM) de Bernadus Swartbooi : Bernadus Swartbooi réunit 2,8 % des suffarges exprimés.
La SWAPO est critiquée pour des scandales de corruption et ses résultats politiques sont affectés aussi par la situation économique et l'importance du chômage. Le secteur minier reste important. Mais la chute des cours des matières premières a réduit les recettes. Par ailleurs, une sécheresse persistante depuis plusieurs saisons a contribué aussi à faire reculer le produit intérieur brut (PIB) deux ans de suite, en 2017 et en 2018. « Les moyens de subsistance d’une majorité de Namibiens sont menacés, notamment ceux qui dépendent des activités de l’agriculture », n'a pu que déplorer la première ministre Saara Kuugongelwa-Amadhila. Le chômage touche un tiers de la population.
an 2019 : Soudan - En 2019, un vaste mouvement de protestation contre le régime se forme dans les villes de l’extrême nord du pays, en particulier autour d'Atbara, agglomération ouvrière et fief du syndicalisme soudanais. Les manifestants réclament initialement de meilleures conditions de vie (plus de vingt millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté), puis, alors que la répression s’accentue, la démission du président.
Le 11 avril 2019, Omar el-Bechir est renversé par l'armée. Le ministre de la Défense Ahmed Awad Ibn Auf annonce la mise en place d'un gouvernement de transition pour deux ans jusqu'à de nouvelles élections libres.
Le 12 avril 2019, au lendemain de la destitution du président, le Conseil militaire de transition déclare que le futur gouvernement sera un gouvernement civil en promettant un dialogue entre l'armée et les politiciens soudanais. L'armée entame alors des discussions avec les autorités civiles d'opposition et les organisations représentant les manifestants. Le 3 juin 2019, alors que les négociations piétinent et que les manifestants campent devant le QG de l'armée depuis près de deux mois, l'armée et la milice des Forces de soutien rapide tirent sur la foule pour tenter de déloger les manifestants causant un massacre. Le 4 juin 2019, le chef du Conseil militaire de transition, Abdel Fatah al-Burhan, annonce la fin des négociations avec les civils et promet la tenue d'élections d'ici 9 mois.
Le 21 août, à la suite d'un accord, le Conseil militaire de transition devient le Conseil de souveraineté. Il maintient les président et vice-président sortants en place mais dispose de membres civils. Abdallah Hamdok est nommé Premier ministre. Il annonce la composition d'un gouvernement de transition début septembre 2019, un gouvernement composé de dix-huit membres dont quatre femmes, notamment Asma Mohamed Abdallah une diplomate expérimentée qui devient ministre des affaires étrangères : « La première priorité du gouvernement de transition est de mettre un terme à la guerre et de construire une paix durable », est-il précisé, faisant référence aux conflits et rébellions qui pèsent sur le Darfour, le Nil Bleu et le Kordofan du Sud.
an 2020 : UNION AFRICAINE - Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud, prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi.
an 2020 : Burundi - La situation économique continue à se dégrader. Début 2020, le général Évariste Ndayishimiye est désigné comme candidat pour l’élection présidentielle du 20 mai 2020 par le parti au pouvoir, pour succéder à Pierre Nkurunziza. Il remporte l'élection présidentielle du 20 mai 2020, en obtenant 68,72 % des voix et devance très largement le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, président du Conseil national pour la liberté (CNL), qui réunit 24,19 % des voix.
an 2020 : Cameroun - Au cours de l'année 2020, de nombreuses attaques terroristes - dont beaucoup ont été menées sans revendication - et les représailles du gouvernement ont fait couler le sang dans tout le pays. Depuis 2016, plus de 450 000 personnes ont fui leurs foyers. Le conflit a indirectement conduit à une recrudescence des attaques de Boko Haram, l'armée camerounaise s'étant largement retirée du nord pour se concentrer sur la lutte contre les séparatistes ambazoniens. Paul Biya est réélu pour un septième mandat en 2018, dans un scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition. Il lance un « grand dialogue national », mais aucune avancée décisive n'en ressort sur le conflit dans les régions anglophones. Paul Biya fait libérer des détenus, mais les leaders du mouvement restent en prison.
Les élections législatives et municipales du 9 février 2020 entraînent un regain de violence dans les régions anglophones du Cameroun, autour de la tentative d'indépendance de l'Ambazonie. Les groupes armés séparatistes promettent des représailles à ceux qui iraient voter, en réaction le gouvernement central du Cameroun augmente ses effectifs militaires dans la zone. Dans les deux semaines précédant les élections, selon Human Rights Watch, les rebelles séparatistes enlèvent plus d'une centaine de personnes dans les deux régions anglophones, tandis que les forces de sécurité commettent de nombreux abus de pouvoir. Le 7 février 2020, c'est depuis sa cellule à la prison centrale de Yaoundé que Sisiku Julius Ayuk Tabe, président du gouvernement intérimaire d’Ambazonie, déclare, qu’ils sont plus que jamais engagés dans une indépendance totale ou une résistance à jamais.
Les violences se poursuivent après les élections. Ainsi, le 16 février 2020, 22 civils dont 14 enfants et 1 femme enceinte sont massacrés à Ntumbaw, un village du Nord-Ouest. l'opposition camerounaise (surtout le Mouvement pour la renaissance du Cameroun) et les ONG locales accusent l'Armée et le gouvernement d'avoir perpétré le massacre, dans un contexte de répression de la tentative de sécession de l'Ambazonie.
Le 21 avril 2020, le régime camerounais admet sa responsabilité, expliquant que l'Armée et un groupe d'autodéfense allié avaient attaqué des indépendantistes, tuant 5 d'entre-eux, puis s'étaient rendus compte que leur assaut avait également tué accidentellement les femmes et les enfants, et avaient alors décidé de déclencher l'incendie pour tenter de masquer leurs faits.
Le 2 juillet 2020, déjà très impliquée lors de la tenue des assises du « grand dialogue national », l'Église catholique a de nouveau joué les facilitateurs lors de la récente prise de contact entre les séparatistes anglophones emprisonnés à Yaoundé et des émissaires du gouvernement. C'est d'ailleurs au centre épiscopal de Mvolyé, dans la capitale camerounaise, que cette rencontre s'est tenue. Pour l'occasion, Julius Ayuk Tabé, le président autoproclamé de l'Ambazonie et quelques-uns de ses partisans avaient été spécialement extraits de leurs cellules pour entamer des discussions avec les autorités du gouvernement. Entre eux, un témoin privilégié : Monseigneur Andrew Nkea Fuanya, archevêque de Bamenda. Cette nouvelle implication de l'Église catholique pour tenter de rapprocher les parties en conflit de la crise dans les régions anglophones a été plutôt bien perçue par nombre d'observateurs, alors que jusqu'ici une sorte de crise de confiance semble installée de part et d'autre entre protagonistes. D'autant que dix mois après la tenue du Grand dialogue national, les résolutions qui en avaient été issues tardent à être mises en application. Notamment le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le 20 août 2020, Le procès en appel du leader séparatiste anglophone Sisiku Ayuk Tabe et de ses neuf co-accusés a été une nouvelle fois reporté. Une partie des magistrats affectés à ce dossier ayant été récemment mutés, la cause a été renvoyée au 17 septembre 2020.
Le 17 septembre 2020, Une Cour d’appel camerounaise a confirmé, la condamnation à la prison à vie prononcée en 2018 contre Sisiku Ayuk Tabe. Sisiku Ayuk Tabe avait été jugé coupable « sécession » et « terrorisme », en lien avec le conflit dans les régions anglophones du Cameroun. Il s’était autoproclamé président de l’Ambazonie, nom donné par les indépendantistes anglophones à l’ancien Cameroun du Sud britannique, non reconnu internationalement. Lors de l’audience la Cour d’appel a estimé que le tribunal militaire qui avait condamné Sisiku Ayuk Tabe et ses coaccusés le 20 août 2019 a bien dit le droit. Elle a donc confirmé la prison à vie pour les accusés, assortie d’une amende de 250 milliards de francs CFA.
Dans les deux régions à majorité anglophones du Cameroun, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, des indépendantistes s’opposent violemment à l’armée depuis 2017 et les deux camps sont régulièrement accusés d’exactions contre des civils par des ONG. Au moins 3 000 personnes ont perdu la vie et plus de 700 000 autres ont dû fuir leur domicile, selon les Nations unies.
an 2020-2021 : République de Centrafrique - En décembre 2020, des mercenaires russes du groupe Wagner s'engagent aux côtés de l'armée centrafricaine, des forces de la MINUSCA et des forces rwandaises contre les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement qui veulent prendre Bangui et empêcher la tenue des élections présidentielle et législatives. Le 31 mars 2021, le Groupe de travail des Nations unies sur les mercenaires a dit sa préoccupations sur des violations répétées des droits de l'Homme par les mercenaires du groupe Wagner. Une enquête de RFI a collecté de nombreux indices, dont des documents confidentiels et des témoignages allant en ce sens. Le gouvernement centrafricain a réagi en mettant en place une commission d'enquête. La Russie a dénoncé « de fausses nouvelles » qui « servent les intérêts des malfaiteurs qui complotent pour renverser le gouvernement ».
an 2020 : Afrique Côte d'Ivoire - En novembre 2020, Alassane Ouattara est réélu pour un troisième mandat avec 94,27 % des voix lors d'un scrutin très critiqué puisque l'opposition avait demandé à le boycotter, contestant la constitutionnalité d'un troisième mandat. Finalement, seuls 53,90 % des électeurs se sont rendus aux urnes pour élire le président sortant.
an 2020-2021 : Éthiopie - les relations entre le gouvernement fédéral et celui de la région du Tigré se dégradent rapidement après les élections. Le 4 novembre 2020, le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) lance une attaque contre des bases des Forces de défense nationale éthiopiennes à Mekele, la capitale du Tigré, et à Dansha, une ville de l’ouest de la région. La guerre du Tigré escalade et se poursuit depuis cette date.
Les Forces de défense tigréennes ont repris la capitale régionale, Mekele, forçant le gouvernement éthiopien à décréter, le lundi 28 juin 2021, un « cessez-le-feu unilatéral »
Le 28 juin 2021, sept mois après avoir dû abandonner Mekele face aux assauts de l’armée gouvernementale éthiopienne, les forces du Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) reprennent le contrôle de la capitale provinciale du Tigré. Dans cette région du nord de l’Éthiopie, en guerre depuis novembre 2020, les derniers jours ont été le théâtre d’un spectaculaire renversement de situation militaire, forçant le gouvernement éthiopien à décréter un cessez-le-feu.
En marge du conflit au Tigré éthiopien, l’armée soudanaise tente de reprendre la main sur le triangle d’Al-Fashaga, un territoire agricole disputé par L’Éthiopie et le Soudan, pays de la Corne de l'Afrique. C’est un bras de fer qui menace de dégénérer, dans le sillage du conflit en cours dans la province éthiopienne du Tigré. En jeu : le triangle d’Al-Fashaga, soit 250 km2 de terres fertiles coincées entre les rivières Tekezé et Atbara, au cœur d’une dispute historique entre le Soudan et l’Éthiopie.
Début novembre 2021, plusieurs États occidentaux ordonnent à leurs nationaux de quitter l'Éthiopie, en prévision d'une éventuelle prise d'Addis-Abeba par le TPLF accompagnée d'exactions tribales. À ce stade le conflit a coûté, outre des milliers de morts, le déplacement forcé de plus de deux millions de personnes et un risque de famine pour cinq millions.
an 2020 : Guinée - En mars 2020, en dépit des manifestations et du désaccord de la grande partie de la population et de l'opposition et ce malgré une loi stipulant qu'aucun président ne peut se présenter pour plus 2 mandats consécutifs, Alpha Condé modifie la Constitution pour pouvoir légalement se représenter. Il est alors officiellement candidat pour un troisième mandat pour les élections s'étant tenues en octobre 2020.
an 2020 : Guinée-Bissau - L'investiture d'Umaro Sissoco Embaló a lieu le 27 février 2020. La passation de pouvoir s'effectue ensuite au palais présidentiel. Nuno Gomes Nabiam est nommé Premier ministre le lendemain, le 28 février 2020. Mais une incertitude subsiste : une partie des députés investissent comme président, le 28 février au soir, le président de l’Assemblée nationale, Cipriano Cassama, par intérim. Pour eux, l'investiture de Umaro Sissoco Embalo n'est pas légale.
an 2020 : Libéria - Le 1er octobre 2020, le Président Weah a procédé à un remaniement de son gouvernement et a formé un gouvernement d’union nationale pour faire face notamment aux défis sociaux, économiques et sanitaires auxquels le pays est confronté.
La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2023.
an 2020 : Mali - En 2020, dans un contexte d'élections législatives contestées et de manifestations massives menées par le M5-RFP, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrêté par des mutins et démissionne sur les ondes de l'ORTM, à minuit le 19 août 2020. Quelques heures plus tard, le Comité national pour le salut du peuple prend le pouvoir. Il est présidé par Assimi Goïta et dispose des services d'Ismaël Wagué comme porte-parole. Ce coup d'État est condamné de manière unanime par la communauté internationale.
Assimi Goïta en tant que président du CNSP la junte militaire qui a renversé Ibrahim Boubacar Keîta le 18 août 2020.
Bah N'Daw après avoir été designé par le CNSP Président de la Transition le 21 septembre 2020 puis renversé par un coup d'État.
an 2020 : Iles Maurice - Le 15 janvier 2020, Pravind Jugnauth premier ministre des île Maurice, était à Londres pour assister à un sommet sur les investissements de la Grande-Bretagne en Afrique. il s'est entretenu avec les chefs des gouvernements de l'Afrique du Sud, du Kenya, de Côte d'Ivoire et du Mozambique. Il a indiqué que : « Port-Louis étudiait la possibilité d’entamer des poursuites contre des responsables britanniques devant la Cour pénale internationale pour crime contre l’humanité ».
an 2020 : Mozambique - Depuis deux ans un groupe d’islamistes armés a déclenché une insurrection dans cette région du nord du pays. Les combats se déroulent à quelques kilomètres des futures installations gazières et le port de Mocimboa da Praia est pris par les insurgés en août 2020.
an 2020 : Namibie - Le 21 mars 2020, la Namibie célèbre son trentième anniversaire d'indépendance.
an 2020 : Nigéria - En octobre 2020, le pays est secoué par d'importantes manifestations protestant contre l'oppression et la brutalité policières – connues nationalement, et mondialement, sous le nom de #EndSARS (abréviation de “End Special Anti-Robbery Squad”). Ce mouvement populaire est violemment réprimé par les autorités.
an 2020 : Somalie - Le pays se mobilise également début 2020 contre une invasion de criquets pèlerins qui touche la Corne d'Afrique et plusieurs régions d'Afrique de l'Est.
an 2020 - 2021 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - John Magufuli acquiert une popularité, notamment grâce à sa lutte contre le gaspillage de l'argent public et contre la corruption, mais fait preuve également de dérives autoritaires, contre ses opposants, contre les libertés individuelles, contre la presse, etc. Il est réélu pour un second mandat en octobre 2020. Il meurt en fonction en mars 2021 et sa vice-présidente Samia Suluhu lui succède.
an 2021 : Bénin (anc. Dahomey) - Le 11 avril 2021, Patrice Talon est réélu Président de la République.
an 2021 : Cap Vert - En octobre 2021, se déroule l'élection présidentielle cap-verdienne de 2021, remportée par José Maria Neves
an 2021 : Congo Brazzaville - Fin décembre 2019, Denis Sassou-Nguesso est à nouveau désigné candidat de son parti (le PCT) à la présidentielle de 2021. Le 23 mars 2021, la commission électorale annonce que Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 88,57 % (résultats provisoires officiels). La participation est estimée à 67,55 % et son principal opposant, Guy Brice Parfait Kolélas, (mort de la Covid-19 le lendemain de l'élection), recueille 7,84 % des voix. Ses opposants annoncent former des recours. Le 6 avril 2021, la Cour constitutionnelle de la République du Congo a entériné la réélection du président Denis Sassou-Nguesso au scrutin du 21 mars, après avoir rejeté les recours de l'opposition.
an 2021 : République de Djibouti - Le 9 avril 2021, Ismaël Omar Guelleh a été réélu, avec 98,58 % des voix, selon les chiffres officiels provisoires.
an 2021 : Gambie - Adama Barrow est réélu président de la République le 5 décembre 2021.
an 2021 : Guinée - Le 5 septembre 2021, un coup d'État des forces spéciales, dirigées par Mamadi Doumbouya, mène à la capture d'Alpha Condé. Une junte prend le pouvoir.
Mamadi Doumbouya devient alors président du Comité national du rassemblement pour le développement et président de la Transition.
an 2021-2022 : Libye - Le 24 décembre 2021 devraient avoir lieu une élection présidentielle et en janvier 2022 des élections législatives.
an 2021 : Mali - Le 24 mai 2021, le président de transition Bah N'Daw et le premier ministre de transition Moctar Ouane sont interpellés et conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta démet N'Daw et Ouane de leurs fonctions. Suite à ce coup d'Etat, la France décide de mettre un terme à l'Opération Barkhane et appuie le développement international de la Task Force Takuba notamment pour sécuriser la région du Liptako
Assimi Goïta (Vice-président) de facto président de la transition après l'arrestation et la démission du Premier Ministre Moctar Ouane et du président de la transition Bah N'Daw par Assimi Goïta le lundi 24 mai 2021 et le mardi 25 mai 2021.
an 2021 : Namibie - En mai 2021 l’Allemagne et la Namibie sont parvenus à se mettre d’accord sur un document qui établit les responsabilités de l'Allemagne ex-puissance coloniale durant le Génocide des Héréro et des Namas.
an 2021-2022 : Somalie - En 2021 et 2022, le pays connait une importante sécheresse, provoquant des problèmes de disette importante pour près de 7,8 millions de personnes soit presque 50 % de la population.
an 2021 : Togo - En 2021, David Ekoué Dosseh, un professeur de médecine à l'origine de Togo Debout, la « plateforme citoyenne » créée le 22 septembre 2017, est sur la liste établie par le collectif Forbidden Stories de 300 Togolais espionnés par le logiciel Pegasus.
an 2021 : Soudan - Une tentative de putsch a lieu le 21 septembre 2021. Les responsables sont arrêtés.
Un coup d'État militaire a lieu en octobre 2021, menant à l'arrestation de civils dont le premier ministre. Le 25 octobre, des membres de l'armée tirent sur des civils refusant le putsch.
an 2021 : Tchad - Le 20 avril 2021, un Conseil militaire de Transition dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, alors général de l'armée tchadienne et fils du président Idriss Déby Itno, prend le pouvoir à la suite du décès de ce dernier, dont on soupçonne que la mort soudaine soit liée à un assassinat non ciblé lié à des affrontements avec le Fact, un groupe armé libyen. Cette prise du pouvoir ne respecte pas la Constitution de la République du Tchad, promulguée le 4 mai 2018, qui est alors suspendue par l'Armée, en même temps que l'Assemblée nationale est dissoute.
Au moment de prendre le pouvoir, l'armée promet que des élections libres et démocratiques seront organisées au Tchad sous dix-huit mois, après une période de transition et d'apaisement.
an 2021 : Togo - En 2021, David Ekoué Dosseh, un professeur de médecine à l'origine de Togo Debout, la « plateforme citoyenne » créée le 22 septembre 2017, est sur la liste établie par le collectif Forbidden Stories de 300 Togolais espionnés par le logiciel Pegasus.
an 2021-2022 : Tunisie - Crise politique de 2021-2022
Le 25 juillet 2021, invoquant l'article 80 de la Constitution, Kaïs Saïed limoge le gouvernement, annonce la suspension de l'Assemblée des représentants du peuple — dont il lève l'immunité des membres —, la formation d'un nouveau gouvernement — qui sera responsable devant lui — et sa décision de gouverner par décrets ; il indique également qu'il présidera le parquet. Ennahdha dénonce aussitôt un « coup d'État ». Cette qualification de coup d'État est partagée par des analystes politiques et juristes, notamment en ce qui concerne la suspension des travaux parlementaires.
Le 22 septembre, il confirme par décret le prolongement des décisions ainsi que la dissolution de l'Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, et décide de suspendre les salaires et les bénéfices accordés au président de l'Assemblée des représentants du peuple et ses membres, et s'octroie le droit de gouverner par décret, récupérant de facto le pouvoir législatif. Le 13 décembre, il annonce la tenue d'un référendum constitutionnel, prévu à l'été 2022.
Le 30 mars 2022, après la réunion virtuelle de 120 députés pour voter la fin des mesures d'exception en vigueur, Kaïs Saïed dissout le Parlement, ce qu'interdit pourtant la Constitution durant la période où l'état d'exception est appliqué, et menace les députés de poursuites judiciaires.
an 2022 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Le 23 janvier 2022 a lieu un coup d'État. Les putschistes, rassemblés sous la bannière du « Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration » et menés par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, annoncent la fermeture des frontières terrestres et aériennes à partir de minuit, la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale ainsi que la « suspension » de la Constitution. Le 24 janvier 2022, certains médias locaux et internationaux relaient une information selon laquelle le président de Faso serait détenu par des soldats mutins. D'autres médias assurent que c'est une information erronée. Le 1er mars 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, signe un plan pour entamer une transition de trois ans vers la démocratie.
an 2022 : République de Centrafrique - En avril 2022, une "opération" militaire menée par l’État centrafricain et des paramilitaires russes cause la mort de dizaines de civils dans les villages de Gordil et Ndah, au Nord-Est de la capitale. Suite à ce massacre, l'ONU indique ouvrir une enquête.
an 2022 : Érythrée - Le 2 mars 2022, l'Érythrée est l'un des cinq pays de l'ONU votant contre la résolution ES-11/1 ayant pour but de sanctionner et condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
an 2022 : Guinée - mars 2022 En Guinée, déchu il y a plus six mois par un coup d’état militaire le 5 septembre 2021, Alpha Condé ne prendra plus la tête du parti qu’il a lui-même créé dans la clandestinité au début des année 1990. En attendant le prochain président du RPG, un intérimaire a été porté à la tête de l’ancien parti au pouvoir. En réunion extraordinaire, ce jeudi 10 mars 2022, les cadres du parti ont désigné l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana comme président par intérim.
mai 2022 Transition prolongée en Guinée : l’opposition dénonce une « décision unilatérale » et une « durée injustifiable ». Le colonel Mamadi Doumbouya, auteur du putsch contre Alpha Condé, prévoit un délai de trente-neuf mois avant d’organiser d’éventuelles élections.
an 2022 : Lesotho - Les élections législatives lésothiennes de 2022 ont lieu en septembre 2022 afin de renouveler les membres de l'assemblée nationale du Lesotho.
Le Lesotho est une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement bicaméral dont la chambre basse, l'assemblée nationale est composée de 120 députés élus pour un mandat de cinq ans au suffrage direct. Son mode de scrutin, mixte, s'apparente au système électoral allemand, bien que les électeurs n'aient qu'un seul vote pour exprimer leur choix. Sur les 120 sièges, 80 sont pourvus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales uninominales. L'ensemble des votes pour chacun des partis est ensuite regroupé au niveau national, nonobstant ceux des indépendants, et les quarante sièges restants répartis entre eux de manière à rapprocher la composition de l'assemblée à celles des résultats en part des voix.
an 2022 : Mali - Les autorités maliennes responsables du coup d'Etat s'engagent auprès de la Communauté internationale à « organiser des élections présidentielles et législatives avant le 27 février 2022 ». Cet engagement non tenu et le partenariat des autorités maliennes avec le groupe paramilitaire russe Wagner conduisent le 17 février 2022 à l'annonce du retrait de la Task Force Takuba.
Le 16 mai 2022, le gouvernement d'Assimi Goïta révèle avoir réussi à déjouer un coup d'Etat mené par des militaires maliens dans la nuit du 11 au 12 mai. Selon les sources officielles du gouvernement, cette tentative de putsch avortée a été « soutenue par un Etat occidental »
an 2022 : Afrique - Élections à venir dans l'année : dans les prochains mois se tiendraient des processus électoraux cruciaux en République démocratique du Congo, en Angola, à Sao-Tomé, en Guinée équatoriale ainsi qu’au Tchad.
an 2023 : Libéria - La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2023.
an 2023 :
Histoire contemporenne
Histoire contemporenne
an 2000 : Burundi - Le 28 août 2000 est signé à Arusha, en Tanzanie, sous l'égide de Nelson Mandela un accord de paix.
an 2000 : Congo Kinshasa - En mai-juin 2000 de nouveaux combats rwando-ougandais ont lieu à Kisangani.
an 2000 : Côte d'Ivoire - Laurent Gbagbo, vainqueur des élections de 2000, et porté au pouvoir par les manifestants devant le refus de Guéï de reconnaître le résultat des élections.
Robert Guéï se proclame vainqueur des élections d'octobre 2000, dont la candidature d'Alasaane Ouattara du RDR avait été exclue pour doutes sur la nationalité, ainsi que celle de Bédié pour ne pas avoir consulté le collège médical désigné par le Conseil constitutionnel. Des manifestations mêlant le peuple et l'armée imposent Laurent Gbagbo, dont la victoire électorale est finalement reconnue. Son parti, le FPI, remporte les législatives de décembre avec 96 sièges (98 au PDCI-RDA), le RDR ayant décidé de les boycotter. Le RDR participe aux élections municipales et sort vainqueur dans la majorité des villes, dont Gagnoa, la principale ville du Centre Ouest du pays, région d'origine de Laurent Gbagbo.
an 2000 : Eswatini (Swaziland) - Depuis 2000, le Swaziland réclame plusieurs kilomètres carrés de territoires à l'Afrique du Sud au prétexte qu'ils leur auraient été volés par les colons blancs au XIXe siècle et annexés illégalement à l'Afrique du Sud. Le royaume swazi base sa réclamation sur un engagement du gouvernement sud-africain signé en 1982 par lequel il s'engageait à rétrocéder au Swaziland plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoires sud-africains en échange de la collaboration dans la lutte anti-terroriste du royaume swazi. Ces territoires situés principalement au Mpumalanga et dans le KwaZulu-Natal et concernent les villes de Nelspruit, Malelane, Barberton, Ermelo, Piet Retief, Badplaas et Pongola. En novembre 2006, Mswati III prit la décision de porter l'affaire devant la cour internationale de La Haye
an 2000-2005 : Ghana - Lors de l'élection présidentielle de décembre 2000, Jerry Rawlings approuve le choix de son vice-président, John Atta-Mills, comme le candidat de la décision du NDC, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d’État en 1981, puis élu en 1992 et en 1996, n'a pas de briguer un troisième mandat, selon la constitution. Il quitte le pouvoir à cinquante-trois ans, après une vingtaine d'années durant lesquelles il a joué les premiers rôles. Mais John Kufuor, candidat du Nouveau Parti patriotique (NPP), parti d'opposition, remporte l'élection, et devient le président le 7 janvier 2001, ce résultat marquant une alternance politique. Le vice-président est Aliu Mahama. Kufuor remporte une autre échéance présidentielle en 2004. Pendant quatre ans, il a su préserver une stabilité économique et politique, et réduire l'inflation.
Durant les deux mandats présidentiels de Kufuor, plusieurs réformes sociales sont menées, telles que la réforme du système d'Assurance Nationale de Santé du Ghana. En 2005, est mis en place un programme d'alimentation en milieu scolaire, avec la fourniture d'un repas chaud gratuit par jour dans les écoles publiques et les écoles maternelles dans les quartiers les plus pauvres. Bien que certains projets sont critiqués comme étant inachevés ou non-financés, les progrès du Ghana sont remarqués à l'échelle international.
an 2000-2003 : Guinée-Bissau - Kumba Ialá est élu président en 2000 mais renversé par un coup d'État sans effusion de sang en septembre 2003. D'ethnie ballante, celui-ci était accusé de favoriser sa communauté et s'était discrédité en dissolvant en 2002 l'Assemblée nationale tout en repoussant sans cesse de nouvelles élections législatives. Le coup d'État ne suscita que peu de protestations tant de la part de la population que de la communauté internationale.
an 2000 - 2003 : Libye - En dépit des sanctions occidentales la Libye maintient une politique internationale de tradition panafricaniste. Elle prend en charge l'essentiel des couts de construction d'un satellite de communication africain, s'engage auprès de l'UNESCO à financer le projet de réécriture de l'Histoire générale de l'Afrique, à payer les cotisations des États défaillants auprès des organisations africaines et à briser le monopole des compagnies aériennes occidentales en Afrique à travers la création de la compagnie Ifriqyiah en 2001.
Dans les années 2000, grâce notamment au contexte de la guerre contre le terrorisme suivant les attentats du 11 septembre 2001, suivi en 2003 par l'arrêt du programme nucléaire de la Libye visant à acquérir la bombe atomique, la Libye de Kadhafi connaît un net retour en grâce diplomatique. Elle renoue de bonnes relations avec le monde occidental, qui voit en elle un allié contre le terrorisme islamiste; la lutte contre l'immigration illégale fournit en outre un argument à la Libye pour entretenir des liens d'alliance avec les pays de l'Union européenne, notamment l'Italie, son principal partenaire commercial. Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de Mouammar Kadhafi, fait figure de réformateur au sein du régime, pour le compte duquel il multiplie les contacts dans le monde occidental, ce qui le fait apparaître comme un « ministre des affaires étrangères bis », souvent décrit comme un potentiel successeur de son père.
an 2000-2019 : Iles Maurice - Anerood Jugnauth redevient Premier ministre après les élections de septembre 2000, puis après trois ans, comme convenu, cède son poste à son allié du Mouvement militant mauricien, Paul Bérenger, dirigeant de la principale formation d'opposition de gauche depuis l'indépendance. Paul Bérenger reste Premier ministre pendant moins de deux ans, puis, dans une nouvelle alternance, Navin Ramgoolam revient au pouvoir pendant neuf ans et demi, jusqu'à décembre 2014, passant alors le relais à nouveau à Anerood Jugnauth, jusqu'à janvier 2017. Le 21 janvier 2017, il annonce sa démission lors d'une allocution télévisée. Il est remplacé par son fils, ministre des Finances Pravind Jugnauth. À la lignée des Ramgoolam succède ainsi celle des Jugnauth. Pravind Jugnauth remporte les législatives de 2019.
Le 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution41 demandant au Royaume-Uni de rétrocéder sous six mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos. Ce délai a pris fin le 22 novembre 2019, sans que le Royaume-Uni se conforme à cette résolution, ni à l'avis consultatif formulé en février par la Cour internationale de justice (CIJ) demandant à Londres de mettre fin « dans les plus brefs délais » à son administration des Chagos.
an 2000 : Mayotte - Le 27 janvier 2000, les principaux partis politiques de Mayotte signent « l’accord sur l’avenir de Mayotte » et sur son édification en collectivité départementale.
an 2000-2005 : Ouganda - En mars 2001, Museveni fut réélu dès le premier tour avec 69,3 % des voix alors que son rival Kizza Besigye en obtint 27,8 %.
Malgré un referendum similaire ayant eu lieu en 2000, lors duquel un retour au multipartisme avait été rejeté par 90,7 % des votants, un nouveau referendum, organisé en juillet 2005, vit la population approuver à 92,5 % un abandon du système sans partis pour un retour au multipartisme.
an 2000 : Réunion (Ile de la) - un projet de bidépartementalisation de La Réunion est abandonné.
an 2000 : Rwanda - Après la prolongation de la période de transition, plusieurs changements de premiers ministres, la démission du président de l'assemblée nationale, Pasteur Bizimungu démissionne en 2000. Paul Kagame est élu président de la République par l'assemblée nationale de transition.
an 2000 : Sénégal - Mars 2000 : Le président sortant, Abdou Diouf, est battu au deuxième tour des élections présidentielles par Abdoulaye Wade. L’arrivée au pouvoir de Me. Wade met un terme à 40 ans de pouvoir du Parti Socialiste. Porté par son slogan “SOPI” (“changement” en wolof), l’opposant de longue date Abdoulaye Wade, chef de file du Parti démocratique sénégalais, remporte l’élection présidentielle du 19 mars 2000, avec 58,5% des suffrages au second tour, devant le président sortant Abdou Diouf.
Le 9 décembre 2000 le Sénat et le Conseil économique et social sont supprimés.
an 2000-2003 : Somalie - Le 26 août 2000, le Parlement de transition en exil élit un nouveau président en la personne de Abdiqasim Salad Hassan, dans un contexte particulièrement difficile. Le pays reste aux prises avec des rivalités claniques. Après diverses tentatives infructueuses de conciliation, une conférence de réconciliation aboutit en juillet 2003 à un projet de charte nationale prévoyant le fédéralisme et mettant sur pied des institutions fédérales de transition.
an 2000-2003 : Togo - Le président s'était engagé à dissoudre l'Assemblée nationale et à organiser des élections législatives en mars 2000 pour que d'autres formations politiques puissent entrer au Parlement. Il s'était aussi engagé à respecter la Constitution et à ne pas se présenter pour un troisième mandat. Mais ces promesses ne sont pas tenues. Le général Gnassingbé Eyadema et son parti modifient par la suite le code électoral et la constitution que le peuple togolais avait massivement adoptés en 1992, pour lui permettre de faire un troisième mandat, lors des élections de 2003. Le président Gnassingbé Eyadema est donc réélu en juin 2003 pour un nouveau mandat de cinq ans. La Commission électorale annonce que Eyadéma, détenteur du record de longévité politique à la tête d'un État africain, a réuni 57,2 % des suffrages lors du scrutin.
an 2000 : Zambie - Le gouvernement suit les recommandations du Fonds monétaire international (FMI) et privatise de nombreuses entreprises, dont celles du cuivre, principale ressource du pays, et les compagnies aériennes. Au début des années 2000, la poursuite du programme de privatisation provoque des licenciements massifs et une hausse de la pauvreté.
an 2000 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En février 2000, les occupations de terres par des paysans noirs et d'anciens combattants de la guerre d’indépendance se multiplient. Quelque 4 000 propriétaires possèdent alors plus d'un tiers des terres cultivables dans les zones les plus fertiles, sous forme de grandes exploitations commerciales, tandis que plus de 700 000 familles paysannes noires se partagent le reste sur des « terres communales » beaucoup moins propices à la culture. Les propriétaires blancs avaient continué de s'enrichir pendant les vingt années ayant suivi la chute du régime ségrégationniste, attisant le ressentiment d'une partie de la population noire dans un contexte de crise économique et de montée du chômage. Le président zimbabwéen, qui les avait jusqu'alors défendu, vit mal leur soutien à la nouvelle formation de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique. Dépassé par le mouvement d'occupation de terres, Mugabe tente de sauver la face en officialisant les expropriations et en installant sur les terres réquisitionnées des proches du régime, officiellement anciens combattants de la guerre d’indépendance. Ceux-ci n’ont cependant pas les connaissances ni le matériel nécessaires pour cultiver leurs lopins et beaucoup de terres restent en friches. Des dizaines de milliers d'ouvriers agricoles perdent leur emploi et la production chute.
an 2001 : Burundi - L'Afrique du Sud envoie 700 militaires pour veiller à la mise en place de l'accord et assurer la sécurité des membres de l'opposition de retour d'exil. Le 10 janvier 2001, une assemblée nationale de transition est nommée et son président est Jean Minani, président du Frodebu. L'accord d'Arusha entre en vigueur le 1er novembre 2001 et prévoit, en attendant des élections législatives et municipales pour 2003 et présidentielles pour 2004, une période de transition de 3 ans avec pour les 18 premiers mois, le major Buyoya à la présidence et Domitien Ndayizeye du Frodebu au poste de vice-président avant que les rôles ne soient échangés. L'alternance prévue est respectée par Pierre Buyoya qui cède le pouvoir au bout de dix-huit mois. Les différents portefeuilles du gouvernement sont partagés entre Uprona et Frodebu. Le 4 février 2002, le Sénat de transition élit l'uproniste Libère Bararunyeretse à sa présidence.
Malgré les critiques du comité de suivi des accords d'Arusha à l'encontre du gouvernement, en particulier en ce qui concerne la modification de la composition ethnique de l'armée et de l'administration, c'est-à-dire un rééquilibrage ethnique de ces deux institutions, l'exécutif Hutu-Tutsi fonctionne.
an 2001 : Cap Vert - En 2001, Pedro Pires, du PAICV est élu président contre Carlos Veiga, du MPD avec une majorité de 12 voix seulement. Tous deux avaient exercé précédemment la charge de premier ministre.
an 2001 : République de Centrafrique - Si les accords de Bangui de janvier 1997 semblent mettre un terme aux conflits et le scrutin présidentiel de 1999 ouvre la voie d'un deuxième mandat à Ange-Félix Patassé, en 2001, l’ancien président André Kolingba tente un coup d’État contre le président Patassé le 28 mai 2001 que seule l’intervention de la Libye et des combattants du Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba permet de contrer.
La tentative de coup d'État provoque de violents affrontements dans la capitale, Bangui.
De nouvelles périodes de troubles suivront et le général François Bozizé, ancien chef d’état-major des forces armées centrafricaines, est impliqué dans un putsch avorté en mai 2001 contre le président Patassé et doit fuir au Tchad le 9 novembre 2001.
an 2001 : Congo Kinshasa - Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné par un de ses gardes du corps. Son fils Joseph Kabila est désigné par le gouvernement pour assurer l'intérim (en attendant « le rétablissement du blessé », que tous savent pourtant déjà décédé). Kinshasa reconnaît enfin le décès de Laurent-Désiré Kabila le 18 janvier.
Joseph Kabila, proclamé chef de l'État, prête serment le 26 janvier et appelle à des négociations pour la paix. À Gaborone, s'ouvre une réunion préparatoire au Dialogue intercongolais : celui-ci ne s'ouvrira officiellement à Addis-Abeba que le 15 octobre, et les négociations continuent sans mettre réellement fin au désordre.
En février 2001, un accord de paix est signé entre Kabila, le Rwanda et l'Ouganda, suivi de l'apparent retrait des troupes étrangères. Les troupes de maintien de la paix de l'ONU, la MONUC, arrivent en avril, afin de soutenir les difficiles efforts de paix ou au moins soutenir le cessez-le-feu, protéger les populations et les organisations humanitaires prêtant assistance aux nombreux réfugiés et déplacés.
an 2001-2002 : Gambie - Vers la fin de l'an 2001 et au début 2002, la Gambie termine un cycle complet d'élections présidentielles, législatives et locales, que les observateurs étrangers jugent libres, justes et transparentes, malgré quelques lacunes. Réélu, le président Yahya Jammeh, installé le 21 décembre 2001, conserve un pouvoir obtenu à l'origine par un coup d'État. Son parti, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), conserve une large majorité à l'Assemblée nationale, en particulier après que la principale force d'opposition Parti démocratique unifié (UDP) a boycotté les élections législatives.
an 2001 - 2002 : Madagascar - Le résultat de l'élection de décembre 2001 est contesté entre Didier Ratsikara et Marc Ravalomanana, maire de Tananarive. Marc Ravalomanana devient président à l'issue d'une crise politique qui dure tout le premier semestre 2002. Sous prétexte de controverse sur les résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 16 décembre 2001, Marc Ravalomanana se fait proclamer vainqueur au premier tour, puis est installé Président de la République le 22 février 2002. Un recomptage des voix prévu par les Accords de Dakar permet d’attribuer officiellement à Marc Ravalomanana la victoire au premier tour qu’il revendiquait. Didier Ratsiraka quitte Madagascar en juillet 2002 pour la France et l'élection de Marc Ravalomanana est reconnue par la France et les États-Unis.
an 2001-2002 : Mali - Le 1er septembre 2001, Amadou Toumani Touré, dit ATT, demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l’armée pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle. Il est élu président du Mali en mai 2002 avec 64,35 % des voix au second tour. Son adversaire Soumaïla Cissé, ancien ministre, obtient 35,65 % des voix. Il nomme Ahmed Mohamed ag Hamani comme premier ministre en le chargeant de réunir un gouvernement de grande coalition.
an 2001 : Mayotte - Le 11 juillet 2001, une nouvelle consultation électorale approuve à 73 % la modification du statut de l'île qui change pour un statut assez proche de celui des départements d'outre-mer : une collectivité départementale d'outre-mer. Le 28 mars 2003, la constitution française est modifiée et le nom de Mayotte est énuméré dans l'article 72 concernant l'outre-mer.
an 2001-2004 : Mozambique - En 2001, Joaquim Chissano indique qu'il ne se présente pas une troisième fois,. Armando Guebuza lui succède à la tête du FRELIMO, et remporte encore les élections de décembre 2004.
an 2001 : Namibie - En 2001, la crise de la réforme agraire se poursuit, en dépit d'un nouvel impôt foncier. Le président Samuel Nujoma s'en prend aussi aux homosexuels, accusés d'être les responsables de la propagation du sida qui ravage le pays.
En politique étrangère, les forces de sécurité namibiennes participent en Angola à la lutte contre l'UNITA. Au côté de l'armée du Zimbabwe, l'armée namibienne est impliquée militairement au Congo-Kinshasa en faveur du régime de Laurent-Désiré Kabila puis de son fils Joseph.
an 2001 : Sénégal - En 2001 une nouvelle constitution réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans.
L’Assemblée nationale – au sein de laquelle le Parti socialiste est majoritaire – est dissoute le 5 février 2001.
25 formations politiques sont autorisées à participer aux élections législatives anticipées.
Pour la première fois au Sénégal, un parti écologiste, Les Verts, entre en lice dans une consultation électorale, mais n’obtient aucun siège.
Suite à la démission de Moustapha Niasse, la juriste Mame Madior Boye est la première femme à occuper les fonctions de Premier ministre dans le pays, du 3 mars 2001 au 4 novembre 2002.
Les élections législatives du 12 mai 2001 voient la victoire de la coalition Sopi proche du président Wade, ce qui permet à 9 nouveaux ministres d’entrer au gouvernement, renforçant ainsi le poids du PDS.
Quelques jours plus tard, 10 partis d’opposition s’unissent pour créer un « Cadre permanent de concertation » (CPC).
Le 25 août 2001 : 25 partis créent cette fois une structure de soutien à l’action du président Wade : « Convergence des actions autour du Président en perspective du 21e siècle » (CPC).
an 2002-2009 : Congo Brazzaville - En 2002 est adopté une nouvelle constitution supprimant le poste de Premier ministre, renforçant les pouvoirs du président de la République. Le président est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. La même année a lieu l'élection du président de la République : Denis Sassou-Nguesso est reconduit à ce poste. Le septennat de Denis Sassou-Nguesso de 2002 à 2009 est marqué par le retour à la paix civile, même si des troubles subsistent dans l'Ouest du Pool. La flambée des cours du pétrole enrichit considérablement l'État, dont le budget annuel dépasse pour la première fois les 100000 milliards de francs CFA. De nombreux projets de construction d'infrastructures sont entrepris (port de Pointe-Noire, autoroute Pointe-Noire - Brazzaville...) en coopération avec des États et entreprises étrangers (France, Chine...).
an 2002 : Congo Kinshasa - Le conflit éclate à nouveau en janvier 2002 à la suite d'affrontements entre des groupes ethniques dans le Nord-est ; l'Ouganda et le Rwanda mettent alors fin au retrait de leurs troupes et en envoient de nouvelles. Des négociations entre Kabila et les chefs rebelles aboutissent à la signature d'un accord de paix par lequel Kabila devra désormais partager le pouvoir avec les anciens rebelles.
Le 15 février 2002 s'ouvre réellement en Afrique du Sud le Dialogue intercongolais : l'accord de paix est signé à Prétoria en décembre; le Dialogue sera clôturé en avril 2003.
an 2002 : Côte d'Ivoire - Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles tentent de prendre le contrôle des villes d’Abidjan, Bouaké et Korhogo. Ils échouent dans leur tentative en ce qui concerne Abidjan mais sont victorieux dans les deux autres villes, situées respectivement dans le centre et le nord du pays. Robert Guéï est assassiné dans des circonstances non encore élucidées. La rébellion qui se présente sous le nom MPCI crée plus tard le MJP et le MPIGO et forme avec ces dernières composantes le mouvement des Forces nouvelles (FN). Il occupe progressivement plus de la moitié nord du pays (estimée à 60 % du territoire), scindant ainsi le territoire en deux zones : le sud tenu par les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et le nord tenu par les Forces armées des forces nouvelles (FAFN).
Les pourparlers entamés à Lomé permettent d’obtenir le 17 octobre 2002, un accord de cessez-le-feu qui ouvre la voie à des négociations sur un accord politique entre le gouvernement et le MPCI sous l’égide du président du Togo, Gnassingbé Eyadema. Ces négociations échouent cependant sur les mesures politiques à prendre, en dépit de réunions entre les dirigeants de la CEDEAO à Kara (Togo), puis à Abidjan et à Dakar. 10 000 casques bleus de l’ONUCI98 dont 4 600 soldats français de la Licorne sont placés en interposition entre les belligérants.
an 2002-2005 : Kenya - En août 2002, le Président Moi — qui constitutionnellement ne peut plus être élu ni président, ni député — surprend tout le monde en annonçant qu'il soutient personnellement la candidature du jeune et inexpérimenté Uhuru Kenyatta — un des fils de Jomo Kenyatta — dans la course à la présidence lors des élections de décembre. En opposition totale avec les vues de Moi, des membres importants du cartel KANU-NDP tels Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, George Saitoti et Joseph Kamotho rejoignent le Liberal Democratic Party (LDP). Pour contrer le dessein de Moi, le LDP, dont Raila a pris la tête, fait alliance avec le National Alliance Party of Kenya (NAK), le Democratic Party (en) (DP), le Forum for the Restoration of Democracy-Kenya (FORD-K) et le National Party of Kenya (NPK). Cette alliance appelée National Rainbow Coalition (NARC) pousse la candidature de Mwai Kibaki le prétendant du DP au poste de président de la République.
Mwai Kibaki gagne largement l'élection présidentielle du 27 décembre avec 62,2 % des suffrages devant Uhuru Kenyatta (31,3 %) et trois autres candidats. Le LDP de Raila Odinga devient le premier parti politique du pays avec 59 sièges de députés à l'Assemblée nationale.
Présidence de Mwai Kibaki - Entre 2002 et 2005, une équipe de constitutionnalistes rédigent au Bomas of Kenya, un texte portant révision de la Constitution. Ce texte, connu sous le nom de Bomas Draft, limite, entre autres, les pouvoirs du président de la République et crée un poste de Premier ministre. En 2005, Mwai Kibaki rejette ce texte et présente un texte de réforme donnant plus de pouvoirs politiques au chef de l'État. Ce texte connu sous le nom de Wako Draft est soumis le 21 novembre 2005, à un référendum national et rejeté par 58,12 % des votants. En réaction, le président Kibaki congédie l'intégralité du gouvernement deux jours après le résultat du référendum et, deux semaines plus tard, forme un nouveau gouvernement qui ne comporte plus aucun membre du LDP.
C'est à ce moment que Raila Odinga décide d'être candidat à l'élection présidentielle de décembre 2007 et crée son propre parti politique : l′Orange Democratic Movement (ODM). Son symbole est une orange en référence au symbole visuel qui représentait le « non » lors du référendum (le « oui » était imagé par une banane)
an 2002 : Nigéria - Depuis 2002 et plus particulièrement depuis 2009, le gouvernement nigérian est confronté, au nord-est du pays, au mouvement terroriste Boko Haram. Ce mouvement salafiste, prônant un islam radical et rigoriste, est à l'origine de nombreux attentats et massacres à l'encontre des populations civiles.
an 2002-2004 : Rwanda - En 2002, l'armée rwandaise quitte officiellement la République démocratique du Congo (Zaïre de 1971 à 1997). Toutefois, dès le début de 2003, le troupes rwandaises envahissent de nouveau l'est de la RDC, et ne commencent à être évacuées que six mois plus tard, après l'envoi de casques bleus. Le 1er juin 2004, les troupes rwandaises et leurs alliés rwandophones occupent la ville de Bukavu, dans le sud du Kivu, mais, dès le
8 juin, les pressions de l'ONU contraignent les troupes à se retirer. Le mouvement RDC-Goma reste armé et soutenu par Kigali.
Malgré les immenses difficultés pour reconstruire le pays qui ont marqué la période de transition, la pression de la communauté internationale aidant, le pouvoir rwandais prépare une constitution et des élections au suffrage universel pour 2003. À tort ou à raison, la crainte manifestée par certains rescapés tutsi de voir le pouvoir à nouveau entre les mains de supposés proches des génocidaires est réveillée. Des intimidations de candidats et d'électeurs, afin qu'ils votent pour le pouvoir en place, sont remarquées.
En 2002, accusé de corruption, l'ancien président de la république, Pasteur Bizimungu, est arrêté et mis en prison. Il est accusé d'avoir constitué un parti politique d'opposition non autorisé par les accords d'Arusha (qui limitaient les partis à ceux qui les avaient signés), de malversations financières et d'avoir publié un article où il manipule les concepts « hutu/tutsi ». Il est condamné à quinze ans de prison. Des associations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, voient en M. Bizimungu un « prisonnier d'opinion », incarcéré pour son opposition au président Kagame plutôt que pour les motifs officiellement invoqués53. Le MDR, signataire des accords d'Arusha, accusé d'abriter en son sein un courant idéologique génocidaire, est dissous par les députés. Une association des droits de l'homme est aussi menacée pour les mêmes raisons. La rigueur qui paraissait excessive chez Paul Kagame est guidée par le fait que la paix intérieure du Rwanda demeurait très fragile à l'époque.
C'est dans ce climat de suspicion de « division » que se déroulent les élections en 2003.
an 2002 : Sénégal - Le 15 février 2002 : la création d’une Commission électorale nationale autonome (CENA) est décidée, en remplacement de l’Observatoire national des élections (ONEL). Elle prendra ses fonctions en 2005.
Le 26 septembre 2002 : le Sénégal vit une tragédie nationale avec le naufrage du Joola, le ferry qui reliait Dakar à Ziguinchor en Casamance. Plus de 1 800 passagers y perdent la vie. Les négligences constatées suscitent un forte rancœur à l’égard des pouvoirs publics. La région, déjà affectée par son enclavement, perd sa liaison maritime pendant trois ans et l’île de Karabane, ancienne escale, ne peut plus compter que sur les pirogues. Ce drame n’est pas sans conséquences sur la carrière de Mame Madior Boye qui est remplacée par Idrissa Seck, maire de Thiès et numéro deux du Parti démocratique sénégalais (PDS).
Seck sera Premier ministre du 4 novembre 2002 au 21 avril 2004. Son ministre de l’Intérieur Macky Sall lui succède lorsqu’il tombe en disgrâce en raison de ses responsabilités dans la gestion des chantiers de Thiès et peut-être de ses ambitions nationales.
an 2002-2004 : Sierra Leone - Le 14 mai 2002, le président sortant, Ahmad Tejan Kabbah, est réélu avec 70,6 % des voix.
Le pays est désormais en paix, après 10 ans d'une guerre civile atroce. Les différentes mesures prises par l'ONU sont progressivement réduites, voire supprimées, comme l'atteste la levée de l'embargo sur les exportations de diamants du sang. De même, les effectifs de la MINUSIL (casques bleus) sont diminués. Après un pic de 17 500 hommes en mars 2001, les effectifs sont ramenés à 13 000 en juin 2003 et à 5 000 en octobre 2004.
Cependant, pour des raisons économiques, de nombreux enfants travaillent toujours dans les mines de diamants, qui sont très dangereuses. La propagation du SIDA chez eux est également très importante : 16 000 enfants de moins de 15 ans sont séropositifs.
an 2002 : Zambie - En 2002, en raison de la sécheresse, la famine menace trois millions de personnes.
Après avoir tenté de faire amender la Constitution qu'il a lui-même promulguée afin de briguer un troisième mandat, Chiluba, face aux protestations populaires, doit céder la place en janvier 2002 à son vice-président et successeur désigné, Levy Mwanawasa, qui est élu président, au cours d’un scrutin contesté. Le Parlement vote à l'unanimité la levée de l'immunité de l'ancien président Chiluba qui est mis en examen au titre d'une soixantaine d'inculpation concernant principalement des détournements de fonds. Les charges seront levées en 2009.
an 2002 - 2003 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
Mugabe est désavoué lors d’un référendum sur une réforme constitutionnelle. En 2002, il gagne l’élection présidentielle lors d’un scrutin dont l’honnêteté est contestée. En 2003, une grave crise agraire et politique éclate à la suite de l’expropriation par Mugabe des fermiers blancs. Une crise politique survient quand les mouvements d’opposition comme la MDC sont réprimés et les élections truquées. À la suite d'une campagne intensive des mouvements des droits de l’Homme, des Britanniques et de l’opposition, le Commonwealth impose des mesures de rétorsion contre les principaux dirigeants du Zimbabwe. Au sein du Commonwealth, Mugabe reçoit cependant le soutien de plusieurs pays africains et dénonce des mesures prises à l’instigation des pays « blancs » (Canada, Grande-Bretagne, Australie). L’opposition locale du MDC est réprimée.
an 2003 : Burundi - le 7 juillet 2003, les forces hutu des CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie), en coalition avec le PALIPEHUTU-FNL (Parti pour la libération du peuple hutu-Forces de libération nationale) attaquent Bujumbura.
40 000 habitants fuient la capitale. Un accord de paix (protocole de Pretoria) est néanmoins signé le 15 novembre 2003 entre le président Ndayizeye et le chef des CNDD-FDD. La principale branche de la rébellion (CNDD-FDD) entre au gouvernement, au sein duquel elle détient quatre ministères et dispose également de postes de haut rang dans les autres institutions, conformément à l'accord d'Arusha.
an 2003 : République de Centrafrique - Après une nouvelle série de troubles et malgré l'intervention de la communauté internationale (MINURCA). Malgré l'intervention de la communauté internationale, Ange-Félix Patassé est finalement renversé le 15 mars 2003 par François Bozizé grâce à une rébellion dont l'élément central est constituée par plusieurs centaines de « libérateurs », qui sont souvent d’anciens soldats tchadiens ayant repris du service avec l’assentiment d’Idriss Déby. Une bonne partie des « libérateurs » retournera au Tchad en 2003 ou 2004, d'autres intégreront les forces de sécurité ou se reconvertiront dans le commerce sur le grand marché PK5
Le 15 mars 2003, le général François Bozizé réussit, avec l'aide de militaires français (deux avions de chasse de l'armée française survolaient Bangui pour filmer les positions des loyalistes pour le compte de Bozizé) et de miliciens tchadiens (dont une bonne partie va rester avec lui après son installation au pouvoir), un nouveau coup d'État et renverse le président Patassé. Le général Bozizé chasse alors les rebelles congolais, auteurs de méfaits et crimes innombrables, notamment dans et autour de Bangui.
Toutefois, le coup d’État de François Bozizé, en 2003, a déchaîné un cycle de rébellion dans lequel le pays est toujours plongé en 2019.
an 2003 : Congo Kinshasa - Le 4 avril 2003, la Cour d'ordre militaire (COM), condamne, sans convaincre, 30 personnes à mort pour l'assassinat de Laurent Kabila.
La même année se met en place le gouvernement de transition « 4+1 » (quatre vice-présidents et un président) : Abdoulaye Yerodia Ndombasi (PPRD), Jean-Pierre Bemba (MLC), Azarias Ruberwa (RCD), Arthur Z'ahidi Ngoma (société civile), ainsi que Joseph Kabila (PPRD).
En juin 2003, l'armée rwandaise est la seule de toutes les armées étrangères à ne pas s'être retirée du Congo. L'essentiel du conflit était centré sur la prise de contrôle des importantes ressources naturelles du pays, qui incluent les diamants, le cuivre, le zinc, et le coltan.
an 2003 : Afrique Côte d'Ivoire - Dans une nouvelle initiative, la France abrite à Linas-Marcoussis du 15 au 23 janvier 2003, sous la présidence de Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel français, secondé par le juge sénégalais Kéba Mbaye, une table ronde avec les forces politiques ivoiriennes et obtient la signature des accords de Linas-Marcoussis. Cet accord prévoit la création d’un gouvernement de réconciliation nationale dirigé par un premier ministre nommé par le Président de la République après consultation des autres partis politiques, l’établissement d’un calendrier pour des élections nationales crédibles et transparentes, la restructuration des forces de défense et de sécurité, l’organisation du regroupement et du désarmement de tous les groupes armés, le règlement des questions relatives à l’éligibilité à la présidence du pays et à la condition des étrangers vivant en Côte d’Ivoire. Un comité de suivi de l’application de l’accord, présidé par l’ONU, est institué.
an 2003 : Guinée - Après avoir révisé la Constitution pour pouvoir se présenter une troisième fois en décembre 2003, le chef de l'État, pourtant gravement malade, est réélu avec 95,63 % des suffrages face à un candidat issu d'un parti allié, les autres opposants ayant préféré ne pas participer à un scrutin joué d'avance.
an 2003 : Libéria - Les combats s'intensifient, les rebelles encerclent progressivement dans la capitale les forces de Charles Taylor, le risque d'une tragédie humanitaire se profile à nouveau. Le 8 juillet 2003, le Secrétaire général décide de nommer Jacques Paul Klein (États-Unis) comme son Représentant spécial pour le Liberia. Il lui confie la tâche de coordonner les activités des organismes des Nations unies au Liberia et d'appuyer les nouveaux accords. Le 29 juillet 2003, le Secrétaire général décrit le déploiement en trois phases des troupes internationales au Liberia, aboutissant à la création d'une opération de maintien de la paix pluridimensionnelle des Nations unies (S/2003/769). La nomination de Jacques Paul Klein et la création d'une opération des Nations unies au Liberia mettent fin au mandat du BANUL. La situation au Liberia évolue ensuite rapidement. Le 1er août 2003, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1497 (2003): autorisation de la mise en place d'une force multinationale au Liberia et d'une force de stabilisation de l'ONU déployée au plus tard le 1er octobre 2003. Parallèlement, le 18 août 2003, les parties libériennes signent à Accra un accord de paix global, dans lequel les parties demandent à l'Organisation des Nations unies de déployer une force au Liberia, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Celle-ci est chargée d'appuyer le Gouvernement transitoire national du Liberia et de faciliter l'application de cet accord. Grâce au déploiement ultérieur de la Mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Liberia, la situation en matière de sécurité dans le pays s'améliore.
Les événements aboutissent à la création de la Mission des Nations unies au Liberia (MINUL), à la démission de Charles Taylor, le 11 août et à une passation pacifique des pouvoirs.
Le Secrétaire général recommande que le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, autorise le déploiement d'une opération de maintien de la paix des Nations unies dotée d'effectifs d'un maximum de 15 000 hommes, dont 250 observateurs militaires, 160 officiers d'état-major et un maximum de 875 membres de la police civile, 5 unités armées constituées supplémentaires fortes chacune de 120 personnes, ainsi que d'une composante civile de taille appréciable et du personnel d'appui requis. La Mission des Nations unies au Liberia comporte des volets politiques, militaires, concernant la police civile, la justice pénale, les affaires civiles, les droits de l'homme, la parité hommes-femmes, la protection de l'enfance, un programme « Désarmement, Démobilisation, Réinsertion », ainsi que, le moment venu, un volet électoral. Elle comporte un mécanisme de coordination de ses activités avec celles des organismes humanitaires et de la communauté du développement. Elle agit en étroite coordination avec la CEDEAO et l'Union africaine. Afin d'assurer une action coordonnée des Nations unies face aux nombreux problèmes de la sous-région, la Mission doit travailler également en étroite collaboration avec la Mission des Nations unies en Sierra Leone (MINUSIL), la Mission des Nations unies en Côte d'Ivoire (MINUCI) et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest.
Dans son rapport, le Secrétaire général fait observer que la passation des pouvoirs du Président Charles Taylor au Vice-Président Moses Blah et la signature, par les parties libériennes, de l'accord de paix global offrent une occasion unique de mettre un terme aux souffrances du peuple libérien et de trouver une solution pacifique à un conflit qui avait été l'épicentre de l'instabilité dans la sous-région. Il souligne que si l'Organisation des Nations unies et la communauté internationale dans son ensemble sont prêtes à soutenir le processus de paix libérien, c'est aux parties libériennes elles-mêmes qu'incombe la responsabilité première de la réussite de l'accord de paix.
Le 19 septembre 2003, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 1509 (2003), en remerciant le Secrétaire général de son rapport du 11 septembre 2003 et de ses recommandations. Il a décidé que la MINUL comprendrait 15 000 membres du personnel militaire des Nations unies, dont un maximum de 250 observateurs militaires et 160 officiers d'état-major, et jusqu'à 1 115 fonctionnaires de la police civile, dont des unités constituées pour prêter leur concours au maintien de l'ordre sur tout le territoire du Liberia, ainsi que la composante civile appropriée. La Mission a été créée pour une période de 12 mois. Il a prié le Secrétaire général d'assurer le 1er octobre 2003 la passation des pouvoirs des forces de l'ECOMOG dirigées par la CEDEAO à la MINUL.
Comme prévu, la Mission des Nations unies au Liberia (MINUL) a assuré les fonctions de maintien de la paix des forces de la Mission de la CEDEAO au Liberia (ECOMIL) le 1er octobre. Les quelque 3 500 soldats ouest-africains qui avaient fait partie des troupes avancées de l'ECOMIL ont provisoirement coiffé un béret de soldat de la paix des Nations unies. Dans un communiqué paru le même jour, le Secrétaire général a accueilli avec satisfaction cette très importante évolution et a salué le rôle joué par la CEDEAO dans l'instauration du climat de sécurité qui a ouvert la voie au déploiement de la MINUL. Il a rendu hommage aux gouvernements du Bénin, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Nigeria, du Sénégal et du Togo pour leur contribution à la MINUL, ainsi qu'aux États-Unis pour leur appui à la force régionale. Le Secrétaire général s'est dit confiant dans le fait que la MINUL pourrait être en mesure de contribuer de manière importante au règlement du conflit au Liberia pour autant que toutes les parties concernées coopèrent pleinement avec elle et que la communauté internationale fournisse les ressources nécessaires.
an 2003 : Mauritanie - En novembre 2003, Ould Taya est réélu président de la République avec 67 % des voix.
an 2003 : Tchad - En 2003, les recherches de gisements pétroliers permettent au Tchad de lancer les premières phases d'exploitation de son sous-sol, entraînant avec elles l'espoir que le Tchad puisse enfin connaître une phase d'essor économique et de développement humain
an 2003-2005 : Togo - Gnassingbé Eyadema est réélu en 2003 à la suite d'un changement dans la constitution pour l’autoriser à se présenter à nouveau. Il décède le 5 février 2005.
an 2003-2007 : Rwanda - La constitution adoptée par référendum – 26 mai 2003 - Inspirée des principales constitutions occidentales, la constitution rwandaise laisse néanmoins une large place aux problèmes spécifiques du Rwanda post-génocide, inscrivant notamment dans la constitution le refus de l'ethnisme hérité du colonialisme et ayant conduit au génocide. Des opposants au FPR, des courants liés à l'ancien régime génocidaire, et des observateurs occidentaux y voient une hypocrisie visant à renforcer un pouvoir politique disposant d'une faible base ethnique et voulant de ce fait forcer la marche vers l'apparence d'une nation composée de citoyens débarrassés du concept ethnique. Elle crée aussi des outils juridiques pour favoriser la place des femmes dans la vie politique (art. 185 et 187). Selon Human Rights Watch, certaines dispositions de la Constitution de 2003 violent « le droit d'association, de libre expression et de représentation politique assurée par des élections libres.
L'élection présidentielle au suffrage universel – 25 août 2003 - Paul Kagame est élu président de la République avec 95 % des voix contre son principal opposant, Faustin Twagiramungu, du MDR dissous. Des membres du comité de soutien à Faustin Twagiramungu ont été arrêtés la veille du scrutin. Certains ont subi des violences avant d'être relâchés. Les observateurs de la communauté européenne ont émis des critiques, regrettant des pressions exercées sur le corps électoral, et ont constaté des fraudes, mais estiment qu'un pas important vers la démocratie a été franchi. Amnesty International et Human Rights Watch ont en revanche manifesté un grand scepticisme sur la démocratisation du Rwanda.
Les élections législatives au suffrage universel – 2 octobre 2003 - Les députés favorables à Paul Kagame obtiennent la majorité des sièges. 49 % des députés sont des femmes, ainsi qu'une très forte proportion de sénateurs et de ministres.
Pour résoudre la difficulté de juger les nombreux prisonniers, qui attendent dans les prisons rwandaises l'idée germe d'adapter les gacaca, structures de justice traditionnelle (de agacaca, « petite herbe » ou « gazon » en kinyarwanda). On forme rapidement des personnes intègres pour présider ces tribunaux populaires. Pour désengorger les prisons, des prisonniers de certaines catégories sont relâchés, sans être amnistiés, avant de passer devant les gacaca. Ces décisions ravivent, dans la société rwandaise et la diaspora, les inquiétudes des rescapés qui craignent pour leur vie et le débat controversé sur la réconciliation, politiquement souhaitée, entre tueurs et rescapés.
Après plusieurs années de réflexions et de mises au point, le 15 janvier 2005, huit mille nouvelles juridictions « gacaca », (tribunaux populaires chargés de juger les auteurs présumés du génocide de 1994), entament la phase administrative de leur travail. Elles se rajoutent aux 750 « gacaca » pilotes mises en place depuis 2001. L'expérience des « gacaca » pilotes laisse penser qu'il y aurait au moins sept cent cinquante mille personnes, soit un quart de la population adulte, dénoncées et jugées par ces assemblées populaires.
Amnesty International estime que « cette volonté de traiter les affaires aussi rapidement que possible a accru la suspicion régnant sur l’équité du système. Certaines décisions rendues par les tribunaux gacaca faisaient douter de leur impartialité. » L'association souligne également que « Le 7 septembre 2005, Jean Léonard Ruganbage, du journal indépendant Umuco, a été arrêté à la suite de l’enquête qu’il avait menée sur l’appareil judiciaire et le gacaca ». Les autorités rwandaises estiment que ces critiques sont déplacées en rappelant que l'aide qu'elles avaient demandée à la communauté internationale pour juger les génocidaires a été gaspillée dans la mise en place d'un Tribunal pénal international, qui fut sa réponse à la demande rwandaise et qui n'a achevé en 2007 qu'une trentaine de jugements.
an 2003 : Soudan - En 2003, la guerre civile éclate au Darfour, où le Mouvement de libération du Soudan (MLS ou SLM) et le Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE ou JEM) se posent en protecteurs des populations civiles face aux exactions des « janjawids » (expression arabe qui signifie les diables à cheval, milices soutenues par le gouvernement de Khartoum). L'année suivante, l’Union africaine (UA) envoie des troupes au Darfour pour veiller au respect d'un cessez-le-feu et assurer la protection des populations civiles.
an 2004-2008 : République de Botswana - En 2004, le Président Festus Mogae, réélu pour cinq ans, s'engage à améliorer l'économie du pays et à tenter d'enrayer l'épidémie de sida laquelle toucherait près de 25 % de la population du pays d'après l'Organisation mondiale de la santé. Il se voit décerner en 2008 le prix Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique pour avoir su faire bon usage des richesses du sous-sol du pays, notamment en diamants. Il laisse le pouvoir au vice-président, Ian Khama, fils de Seretse Khama, père de l'indépendance du Botswana et de son épouse britannique Ruth Williams. Celui-ci est confirmé comme président par des élections l'année suivante. Il reste au pouvoir, réélu démocratiquement, pendant dix ans et fait ses adieux 18 mois avant la fin de son deuxième mandat, en respectant ainsi la Constitution.
an 2004 : Algérie - De nouvelles élections sont organisées au mois d'avril, le principal concurrent du président sortant étant son ancien Premier ministre Ali Benflis. Abdelaziz Bouteflika est réélu avec un taux de 85 %. Son programme pour le deuxième mandat prévoit un plan quinquennal pour la relance de l'économie, au profit duquel il consacre une enveloppe financière de 150 milliards de dollars.
an 2004 : Congo Kinshasa - En mars 2004 échoue une tentative de coup d'état attribuée à d'anciens mobutistes.
En mai 2004, des militaires banyamulenge déclenchent une mutinerie à Bukavu, sous les ordres du général tutsi congolais Laurent Nkunda, et prennent Bukavu le 2 juin. Ces mutins abandonnent la ville le 9 juin sous la pression internationale. Les 3 et 4 juin, dans les grandes villes congolaises, sont organisées des manifestations anti-rwandaises par des étudiants, qui tournent à l'émeute anti-ONU au Kivu. Le 11 juin, des membres de la garde présidentielle tentent un coup d'état. Le RCD-Goma suspend sa participation au gouvernement; il reviendra sur sa décision le 1er septembre.
an 2004-2006 : Guinée - Fin avril 2004, le premier ministre François Louceny Fall profite d'un voyage à l'étranger pour démissionner, arguant que « le président bloque tout ». Le poste reste vacant plusieurs mois avant d'être confié à Cellou Dalein Diallo, qui sera démis de ses fonctions en avril 2006.
an 2004-2005 : Guinée-Bissau - Le pays entreprend alors à nouveau avec difficulté une phase de normalisation démocratique, culminant avec l'organisation d'élections législatives en 2004 et d'une élection présidentielle le 24 juillet 2005 qui voit le retour à la tête du pays de João Bernardo Vieira dit « Nino Vieira », l'ancien président déposé en 1999 par un coup d’État militaire qui s'était présenté en indépendant. Pour gouverner, Nino Vieira, fortement contesté au sein du PAIGC, conclut une alliance tactique avec son ennemi historique, le général Batista Tagme Na Waie, en nommant chef d'état-major10 ce personnage rustre et illettré qui voue une haine farouche à l'ancien président Vieira, qui l'aurait torturé et jeté sur une île prison à la suite de la tentative de coup d'État de novembre 1985.
an 2004-2005 : Malawi - Le mois de mai 2004 voit l’élection de Bingu wa Mutharika, du FDU, contre le candidat du PCM, John Tembo. Durant la campagne électorale, les médias contrôlés par l'Etat (radio et télévision) privilégient la communication de la coalition au pouvoir. Des observateurs de l'Union Européenne mettent également en exergue des « distributions manifestes et répandues d'argent aux électeurs » et « l'utilisation de fonds publics par le parti au pouvoir ». Quand il prend ses fonctions, le Malawi est en pleine crise alimentaire. Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime que le nombre de personnes vulnérables au Malawi s’élève à plus de 5 millions, et en octobre 2005, le président déclare le Malawi en état de crise. Tout en demandant de l’aide alimentaire, le président engage le pays, après cette année désastreuse,dans une « révolution verte ». En faisant de l’agriculture une priorité, en mettant l'accent sur l'irrigation, en subventionnant 1 700 000 fermiers pauvres, il permet au pays de sortir de la disette et de devenir exportateur de maïs.
Bingu wa Mutharika se représente pour un deuxième mandat à l'élection du 19 mai 2009, cette fois à la tête du Parti démocrate progressiste qu'il a fondé en 2005 après avoir quitté le Front uni démocratique, et est réélu. L’image du Malawi à l'étranger s’améliore grâce à cette politiques de développement et aux avancées en sécurité alimentaire, ainsi qu'aux actions pour combattre la mortalité infantile et maternelle et les maladies telles que le malaria, la tuberculose et le SIDA. Le Malawi ouvre de nouvelles ambassades en Chine, Inde et Brésil.
an 2004 : Namibie - En 2004, Sam Nujoma renonce à modifier la constitution une nouvelle fois pour obtenir un nouveau mandat.
Les élections générales de novembre 2004 sont remportées par la SWAPO, qui renforce son emprise à chaque échéance électorale.
Les élections des 15 et 16 novembre sont sans surprise avec la victoire écrasante de la SWAPO qui remporte 55 des 72 sièges du parlement.
an 2004 : Somalie - Le 10 octobre 2004, le Parlement fédéral de transition de la République de Somalie, exilé au Kenya en raison des affrontements entre seigneurs de la guerre à Mogadiscio, et formé en nombres égaux de représentants de chacun des quatre grands clans somalis, a élu en tant que président intérimaire Abdullahi Yusuf Ahmed, président du Pays de Pount. À la tête du Gouvernement fédéral de transition, celui-ci a nommé Ali Mohamed Gedi, un vétérinaire de profession, en tant que Premier ministre, avec pour mission de former un gouvernement de coalition avec les différents chefs de guerre du pays. Les institutions somaliennes siègent au Kenya par mesure de sécurité à l'égard de la situation intérieure de la Somalie. Les institutions en exil n'ont aucun contrôle sur le pays en dehors de certains quartiers de la capitale Mogadiscio, leur autorité n'est pas reconnue à l'intérieur du pays, mais uniquement par les gouvernements étrangers.
an 2004 - 2005 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 2004, le pays ne peut plus subvenir à ses besoins et 70 % de la population se retrouve sans emploi. Le Zimbabwe se retire du Commonwealth. Le pays est alors au bord de la famine, ce que chercherait à dissimuler le régime. Le pays apparait dans la liste du nouvel « axe du mal » rebaptisé « avant poste de la tyrannie » par Condoleezza Rice en 2005.
En 2005, le parti de Robert Mugabe, la ZANU, remporte les élections législatives sur fond de violence et de fraudes électorales face à un MDC divisé et affaibli. Entre 120 000 et 1 500 000 habitants des bidonvilles d'Harare, bastions de l'opposition, sont expulsés à la fin du printemps lors de la destruction de leurs habitations sur ordre du gouvernement ; c'est l'opération Murambatsvina. Adoption d'une réforme constitutionnelle restreignant les droits de propriété et permettant au gouvernement de priver n'importe qui de passeport pour des raisons « d'intérêt national ». Afin de gagner l'appui de la population, Mugabe persécute la minorité ndébélé[réf. nécessaire]. Nombre d'entre eux fuient en Afrique du Sud. On empêche les propriétaires de terres d'aller en appel au sujet de leur expropriation. Un Sénat de 66 membres est créé mais celui-ci est soupçonné d'être une simple chambre d'enregistrement au service du président Mugabe. L'inflation dépasse les 1 000 % en 2006, et les 100 000 % en 2007, alors qu'a lieu une purge au sein de l'armée. L'exode de la population vers les pays voisins s’accélère.
an 2005 : Burkina Faso -Blaise Compaoré est élu président de la République (taux d'abstention : 74 %). Il est réélu en 2005 et en 2010.
an 2005 : Burundi - Le CNDD-FDD, dirigé par Pierre Nkurunziza, s'impose dès lors comme l'un des principaux acteurs politiques, en obtenant la majorité absolue aux élections communales du 5 juin 2005 (1 781 sièges sur les 3 225 à pourvoir) avec 62,9 % des voix, contre 20,5 % pour le FRODEBU et seulement 5,3 % pour l'Uprona. Le CNDD-FDD, majoritairement hutu, dispose désormais de la majorité absolue dans 11 des 17 provinces du pays. Une victoire sans appel qui annonce la recomposition du paysage politique après douze années de guerre civile et met un terme au long tête-à-tête entre l'UPRONA et le FRODEBU. Mais le vote rappelle aussi que certains rebelles (PALIPEHUTU-FNL) n'ont pas encore déposé les armes (le jour du scrutin, 6 communes ont été la cible de violences). Ces opérations d'intimidation révèlent que la trêve conclue le 15 mai 2005 à Dar es Salaam avec les forces du PALIPEHUTU-FNL reste fragile.
Le CNDD-FDD remporte également les élections législatives du 4 juillet 2005 et les sénatoriales du 29 juillet. Nkurunziza est donc élu président le 19 août et investi le 26 août 2005.
an 2005 : République de Centrafrique - Une élection présidentielle a lieu, après plusieurs reports, le 13 mars 2005, sous la direction d'une Commission Électorale Mixte Indépendante (CIME), présidée par Jean Willybiro-Sako. On peut relever comme candidatures, celles de François Bozizé (déjà chef de l'État), l'ancien président André Kolingba, et l'ancien vice-président Abel Goumba. Les candidatures de plusieurs autres candidats, dont celles de Charles Massi du FODEM, de l'ancien premier ministre Martin Ziguélé, de l'ancien ministre et ancien maire de Bangui Olivier Gabirault et de Jean-Jacques Démafouth, sont refusées par la commission électorale avant la médiation gabonaise et les accords de Libreville. À la suite de ces accords, seule la candidature de l'ancien président Ange-Félix Patassé est définitivement rejetée par la commission élue.
L'accession à la présidence de Bozizé est violemment contestée et une première guerre civile centrafricaine ravage le pays entre 2004 et 2007, jusqu'à la signature d'un accord de paix.
an 2005 : Congo Kinshasa - En janvier 2005 des émeutes se déclenchent à Kinshasa lorsque la Commission électorale envisage publiquement un report de la date des élections, comme le lui permettent les textes. La MONUC déclenche une offensive militaire, médiatique et diplomatique contre les milices lendues et hemas, après la mort de neuf casques bleus banglashis, tués en Ituri par ces dernières. La Cour pénale internationale annonce ses premiers mandats d'arrêts pour 2005 dont un accusé en Ituri.
En mai, l'avant-projet de constitution est approuvé par le parlement. Fin juin, celui-ci décide de prolonger la transition de six mois. Un gouvernement de transition est établi jusqu'aux résultats de l'élection.
an 2005 : Afrique République de Djibouti - Ismaïl Omar Guelleh est réélu en 2005, puis, après une modification de la Constitution, en 2011, 2016 et 2021.
an 2005-2006 : Eswatini (Swaziland) - Le 26 juillet 2005, après 30 ans de suspension de la loi fondamentale, le roi ratifie une nouvelle constitution entrée en vigueur le 8 février 2006. Le pays demeure une monarchie absolue. Les partis politiques sont toujours interdits et ne sont en pratique perçus que comme des associations. La Cour suprême ne peut juger d'affaires pouvant impliquer le régime royal. Le pays est par ailleurs toujours totalement dépendant économiquement de l'Afrique du Sud.
an 2005 : Kenya - Un premier projet de nouvelle constitution est rejeté en 2005 par un référendum.
an 2005-2006 : Libéria - Après le départ de Charles Taylor, une transition politique débute par la tenue d'élections législatives et présidentielles. La campagne électorale se déroule sans incidents notoires, notamment grâce à la présence de 15 000 Casques bleus de l'UNMIL, présents dans le pays depuis d'octobre 2003. Deux courtes courtes présidences se succèdent, avec tout d'abord Moses Blah, ancien vice-président de Charles Taylor à qui celui-ci a transmis le flambeau lorsqu'il a démissionné : Moses Blah assure un intérim pendant quelques mois, le temps que des négociations, organisées à Accra entre les différentes parties, aboutissent. Gyude Bryant lui succède12. C'est un homme d’affaires. Mais il est aussi l’un des fondateurs, en 1984, du Liberia Action Party (LAP), dont il est devenu le président en 1992, deux ans après le début de la première guerre civile. Bryant n’a pas quitté son pays pendant les guerres civiles. Il a ensuite été un président de transition, pendant deux ans et quelques mois, avant les élections présidentielles prévues par la paix d'Accra, et organisées fin 2005.
Le 11 octobre 2005, les Libériens sont effectivement appelés aux urnes pour élire leur président, comme prévu dans l'Accord de paix d'Accra. Parmi les vingt-deux candidats, George Weah (un ancien footballeur reconverti dans la politique) et Ellen Johnson-Sirleaf (une économiste et ancienne responsable au sein de la Banque mondiale), sont les favoris dans les sondages.
Le 21 octobre, la Commission nationale électorale (NEC) annonce que George Weah a obtenu 28,3 % des voix, devançant Ellen Johnson-Sirleaf qui a obtenu 19,8 %. Ces derniers participent donc au second tour qui a eu lieu le 8 novembre. Les résultats définitifs de ce premier tour sont rendus public le 26 octobre, après l'examen des vingt réclamations concernant des fraudes éventuelles. Concernant les élections législatives, le Congrès pour le changement démocratique (CDC) de George Weah a obtenu 3 sièges sur 26 au Sénat et 15 sur 64 à la Chambre des représentants. Le Parti de l'unité d'Ellen Johnson-Sirleaf a obtenu 3 sièges au Sénat et 9 à la Chambre des représentants. Le taux de participation a été de 74,9 %.
Le 8 novembre a lieu le second tour de l'élection présidentielle. George Weah a réuni autour de lui plusieurs hommes politiques de poids, comme Winston Tubman (quatrième au premier tour), Varney Sherman (cinquième au premier tour) et Sekou Conneh (ancien chef de la rébellion du LURD (Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie)). Ellen Johnson-Sirleaf a comme soutien uniquement des hommes politiques de second plan, mais elle espère profiter d'un vote massif des femmes en sa faveur au moment de l'élection qui fasse d'elle la première femme démocratiquement élue président en Afrique. Le 23 novembre, la Commission électorale nationale (NEC) annonce les résultats définitifs qui déclarent vainqueur Ellen Johnson Sirleaf avec 59,4 % des votes, contre 40,6 % pour George Weah. Le nouveau président doit prêter serment le 16 janvier 2006.
an 2005 : Mauritanie - Le 3 août 2005, l'armée, au travers du Conseil militaire pour la justice et la démocratie (CMJD) présidé par le colonel Ely Ould Mohamed Vall, prend le pouvoir pour officiellement « mettre fin aux pratiques totalitaires du régime » du président Ould Taya. Le putsch se déroule alors que le président revient de Riyad où il a assisté la veille aux funérailles du roi Fahd d'Arabie Saoudite.
an 2005 : Mayotte - Du côté des Comores, la question de Mayotte perd peu à peu son importance. Ainsi, depuis 1995, la question de Mayotte n'a plus été inscrite à l'ordre du jour de l’Assemblée générale de l'ONU. En 2005, le colonel Azali Assoumani, président des Comores depuis 1999, a déclaré qu'« il ne sert plus à rien de rester figé dans nos positions antagonistes d’antan, consistant à clamer que Mayotte est comorienne, pendant que les Mahorais eux se disent Français ». Il autorisera donc Mayotte à se présenter aux jeux des îles de l'océan Indien sous sa propre bannière.
Depuis le rattachement à la France, l'immigration clandestine venant essentiellement d'Anjouan (l'île la plus proche) n'a fait que s'accentuer. En 2005, près de la moitié des reconduites à la frontière effectuées en France l'ont été à Mayotte.
an 2005-2009 : Namibie - Le ministre des terres, Hifikepunye Pohamba, est imposé par Nujoma pour lui succéder à la présidence de la république en mars 2005. Nujoma reste toutefois à la présidence de la SWAPO jusqu'en 2007, date à laquelle Hifikepunye Pohamba lui succéda à la présidence du parti. Hifikepunye Pohamba a été réélu avec plus de 75 % des suffrages lors des élections de novembre 2009.
an 2005 : Ouganda - En août 2005, le Parlement (dominé par le NRM) vota une modification de la constitution qui, en enlevant la limite de deux mandats présidentiels, permit à Museveni de se représenter pour un troisième mandat. Kizza Besigye, revint d'exil en octobre 2005, et fut le principal opposant lors de l'élection de février 2006, remportée par Museveni avec 59,3 % des voix (au premier tour). Les résultats furent contestés par l'opposition du FDC (Forum for Democratic Changes, dirigé par Besigye).
an 2005 : Réunion (Ile de la) - Le cyclone Dina passe à 45 km des côtes nord l'île (22-23 janvier 2005).
an 2005 - 2015 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Après les élections de décembre 2005, Jakaya Kikwete devient le nouveau président de la République, le quatrième depuis la création de la Tanzanie. Il effectue les deux mandats que lui permettent la constitution. Le parti au pouvoir, le Chama cha Mapinduzi, choisit ensuite John Magufuli comme candidat à la succession pour les présidentielles de 2015. John Magufuli l'emporte et devient ainsi le cinquième président de la République de Tanzanie. Celui-ci acquiert une popularité, notamment grâce à sa lutte contre le gaspillage de l'argent public et contre la corruption, mais faitpreuve également de dérives autoritaires, contre ses opposants, contre les libertés individuelles, contre la presse, etc.
an 2005 : Togo - Le 5 février 2005, le président Étienne Eyadéma Gnassingbé, décède d'une crise cardiaque à 69 ans, après avoir présidé durant 38 ans le pays. Sa mort surprend autant la population du pays que le gouvernemen.
À la suite du décès de Gnassingbé Eyadema et profitant de l’absence au pays du président de l’Assemblée nationale qui, selon l’article 65 de la Constitution, doit assurer l’intérim de la présidence, l’armée togolaise prend la décision de confier le pouvoir au fils de Gnassingbé Eyadema, Faure Gnassingbé. L'Union africaine par la voix du président de la Commission Alpha Oumar Konaré dénonce un coup d’État militaire.
Le 25 février 2005, à la suite des pressions de la CEDEAO et de l’Union européenne, Faure Gnassingbé se retire et laisse la place au vice-président de l’Assemblée nationale togolaise, Abbas Bonfoh. Ce dernier assure l’intérim de la fonction présidentielle jusqu’à la tenue d'élections le 24 avril 2005. Quatre candidats se présentent : Faure Gnassingbé, soutenu par le Rassemblement du peuple togolais (RPT), Emmanuel Bob Akitani, candidat de la coalition de l’opposition radicale, Harry Olympio (en), candidat du Rassemblement pour le soutien à la démocratie et au développement (RSDD, opposition modérée) et Nicolas Lawson, homme d’affaires qui annonce le retrait de sa candidature le 22 avril 2005.
Le scrutin se déroule dans des conditions très controversées, l’opposition dénonçant des fraudes. Emmanuel Bob Akitani, chef de l’opposition, se déclare vainqueur avec 70 % des voix alors que le gouvernement déclare Faure Gnassingbé élu. Dès l’annonce des résultats, des manifestations émaillées de violences éclatent dans les principales villes. Elles seront violemment réprimées par les forces de l'ordre. Le gouvernement décide de mettre en place une commission nationale d'enquête qui estime le nombre de morts à des centaines, plus de 800 selon la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH). De nombreux Togolais, environ 40 000, se réfugient dans les pays voisins, le Bénin et le Ghana. Le 3 mai 2005, Faure Gnassingbé prête serment et déclare qu’il se concentrera sur « la promotion du développement, le bien commun, la paix et l’unité nationale ».
Le 8 juin 2005, Edem Kodjo, président de la Convergence patriotique panafricaine (CPP, opposition modérée), est nommé Premier ministre. Il est chargé de constituer un gouvernement d’union nationale.
Amnesty International publie en juillet 2005 un rapport dénonçant selon ses propres termes « un scrutin entaché d’irrégularités et de graves violences » tout en montrant que « les forces de sécurité togolaises aidées par des milices proches du parti au pouvoir (le Rassemblement du peuple togolais) s’en sont violemment prises à des opposants présumés ou à de simples citoyens en ayant recours à un usage systématique de la violence ». Le rapport reproche aussi à la France son rôle ambigu dans la situation actuelle15. Les violences consécutives aux événements politiques de 2005 auraient entraîné entre 400 et 500 morts.
an 2005 : Soudan - En 2005, un accord de paix est signé à Nairobi entre le gouvernement de Khartoum et l’APLS. Cet accord prévoit pour une période de six ans une large autonomie pour le Sud, qui disposera de son propre gouvernement et d'une armée autonome. À l’issue de cette période, un référendum d’autodétermination sera organisé. Les revenus issus du pétrole seront partagés en part égale entre le Sud et le Nord . D’autre part, le gouvernement aura 70 % des postes dans l’administration centrale contre 30 % pour la rébellion du Sud. Enfin, la charia ne sera appliquée que dans le Nord, à majorité musulmane. John Garang, le dirigeant de la rébellion contre le régime islamiste du général Omar el-Béchir, trouve la mort dans un accident d’hélicoptère, quelques semaines après sa nomination comme vice-président du Soudan pour pacifier la situation.
an 2006-2007 : Algérie - Les actions terroristes se poursuivent néanmoins dans plusieurs régions du pays : le quotidien L'Expression estime en 2006 qu'il y aurait de 600 à 900 membres de groupes terroristes encore en activité dans le maquis algérien, la majorité appartenant au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC). Ils se manifestent notamment par les attentats du 11 décembre 2007 à Alger (entre 30 et 72 victimes suivant les sources)
an 2006-2016 : Bénin (anc. Dahomey) - En mars 2006, Thomas Yayi Boni, ancien directeur de la Banque ouest-africaine de développement, est élu président du Bénin et de nouveau en mars 2011. Boni Yayi tente d'imposer, contre la volonté de sa famille politique, les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), un dauphin, le Franco-Béninois, Lionel Zinsou, un banquier d'affaires. Il est battu à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 par son ex-bras financier et allié, l'homme d'affaires Patrice Talon. Ce dernier accède au pouvoir le 6 avril 2016.
an 2006 : Burkina Faso - Avec l'arrestation de certains étudiants à la suite d'une conférence de presse à l'université de Ouagadougou, en 2007-2008 contre le coût élevé de la vie.
an 2006-2008 : Congo Kinshasa - Une constitution est approuvée par les électeurs, et le 30 juillet 2006, les premières élections multipartites du Congo depuis son indépendance (en 1960) se tiennent :
-
Joseph Kabila obtient 45 % des voix,
-
Son opposant, Jean-Pierre Bemba, 20 %.
Les résultats de l'élection sont contestés et cela se transforme en une lutte frontale, entre les partisans des deux partis, dans les rues de la capitale, Kinshasa, du 20 au 22 août 2006. Seize personnes sont tuées avant que la police et les troupes MONUC de l'ONU ne reprennent le contrôle de la ville.
Une nouvelle élection a lieu le 29 octobre 2006, et Kabila remporte 58 % des voix. Bien que tous les observateurs neutres se félicitent de ces élections, Bemba fait plusieurs déclarations publiques dénonçant des irrégularités dans les élections.
Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila prête serment comme président de la République et le gouvernement de transition prend fin. La fragilité du nouveau gouvernement a permis l'installation d'affrontements répétés et de violations des droits de l'homme.
Dans l'affrontement se déroulant dans la région du Kivu, les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) continuent de menacer la frontière rwandaise et les Banyarwandas ; le Rwanda soutient les rebelles du RCD-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie) contre Kinshasa; et une offensive rebelle ayant eu lieu fin octobre 2008 a causé une crise de réfugiés à Ituri, où les forces de MONUC se sont révélées incapables de maîtriser les nombreuses milices et groupes à l'origine du conflit d'Ituri.
Dans le Nord-Est, la LRA de Joseph Kony (LRA pour Lord's Resistance Army, l'Armée de résistance du Seigneur), s'est déplacée depuis sa base originelle en Ouganda (où elle a mené une rébellion pendant vingt ans) ou au Sud-Soudan, jusqu'en république démocratique du Congo, en 2005, et a établi des campements dans le parc national de Garamba.
Dans le Nord du Katanga, les Maï-Maï (anciennes milices créées par Laurent-Désiré Kabila pour lutter contre les milices rwandaises et ougandaises dans le Kivu, mais oubliées dans l'accord de Lusaka en 1999) ont échappé au contrôle de Kinshasa.
an 2006 : Gambie - En 2006 Jammeh est réélu pour un troisième mandat à 66 %. Une tentative de coup d’État a eu lieu en 2006 : l’ancien chef de l’armée est accusé.
an 2006 : Libéria - Au sujet de la formation de son gouvernement, Ellen Johnson Sirleaf a affirmé son intention de « former un gouvernement d'unité qui dépassera les lignes de fracture entre les partis, les ethnies, et les religions ». Avançant comme unique condition le fait de ne pas être corrompu, elle n'exclut pas la participation de George Weah au gouvernement, en déclarant : « Mais le pays ne va pas cesser de fonctionner s'il n'est pas dans le gouvernement. Nous allons avancer, avec ou sans lui ».
Ellen Johnson Sirleaf prête serment le 16 janvier en présence de nombreux personnages politiques, dont le perdant du second tour, George Weah. Au niveau international on peut noter la présence marquée pour l'aboutissement du processus de transition de la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, accompagnée de la première dame Laura Bush et de sa fille. Les officiels présents pour l'Afrique étaient le président Thabo Mbeki (Afrique du Sud), Abdoulaye Wade (Sénégal), Mamadou Tandja (Niger), John Kufuor (Ghana) et Ahmad Tejan Kabbah (Sierra Leone). La France était représentée par Brigitte Girardin, ministre délégué à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, la Chine par le ministre des Affaires étrangères Li Zhaoxing, la Guinée par le Premier ministre Cellou Dalein Diallo et la Côte d'Ivoire par Simone Gbagbo, épouse du président Laurent Gbagbo. Lors de son discours, elle a une fois de plus mis l'accent sur le fait que son gouvernement sera d'union nationale : « Mon gouvernement tendra la main de l'amitié et de la solidarité pour rallier tous les partis politiques [...] en tournant le dos à nos différences » et que la lutte contre la corruption sera l'une de ses priorités. Elle remplace donc officiellement Gyude Bryant. Concernant le Parlement, les deux nouveaux présidents de chacune des chambres ont également prêté serment ce même jour. Il s'agit d'Isaac Nyenabo pour le Sénat et d'Edwin Snowe pour l'Assemblée nationale.
an 2006 - 2007 : Madagascar - Après avoir lancé la reconstruction de routes et d'une partie des infrastructures du pays, Marc Ravalomanana est réélu lors de l'élection du 3 décembre 2006 en gagnant au premier tour avec la majorité absolue devant 13 autres prétendants, et est investi de nouveau président de la République de Madagascar pour un nouveau mandat de 5 ans.
Il appelle de nouveau les Malgaches aux urnes pour le 4 avril 2007 pour un référendum qui a pour objet principal la suppression des six « provinces autonomes » et l'instauration des « régions » au nombre de 22.
an 2006-2009 : Mali - Troisième rébellion touarègue.
an 2006 : Mozambique - En 2006, le pays compte 19 millions de Mozambicains dont un tiers vivant dans les villes, conséquence d'une urbanisation rapide intervenue au cours de l’interminable guerre civile.
S’il demeure l’un des pays les plus pauvres du monde, où l’espérance de vie est d’à peine 41 ans, le Mozambique connaît depuis 1995 une croissance annuelle exceptionnelle qui atteint 9 % en 2005. La Banque mondiale cite ainsi le Mozambique comme « un modèle de réussite. Une réussite en termes de croissance, et un modèle qui montre aux autres pays comment tirer le meilleur parti de l’aide internationale », même si la pauvreté reste omniprésente, plus de la moitié des habitants vivant encore en dessous du seuil de pauvreté.
an 2006 : Réunion (Ile de la) - épidémie de Chikungunya.
an 2006 : Somalie - Depuis le 26 février 2006, le gouvernement de transition siège à Baidoa, en Somalie.
Au début du mois de juin 2006, les affrontements entre les membres de l'Alliance pour la restauration de la paix et contre le terrorisme (ARPCT), une alliance entre des chefs de guerre et le gouvernement fédéral de transition, soutenu par Washington, et l'Union des tribunaux islamiques, soutenus par de nombreux entrepreneurs de la capitale, ont vu la victoire de ces derniers pour le contrôle de Mogadiscio. Le nouveau régime serait soutenu par l'Érythrée, l'Iran et divers pays arabes, tandis que le gouvernement fédéral de transition, replié sur Baidoa, bénéficierait de l'appui militaire de l'Éthiopie. Le rétablissement de l'ordre se fait au nom de la seule structure législative stable et consensuelle du pays, la jurisprudence chaféite.
Le 13 juin 2006 à Nairobi, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui regroupe le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée et le gouvernement de transition de Somalie, décide d'interdire l'accès au territoire de ses pays membres aux miliciens de l'ARPCT fuyant devant l'avancée des tribunaux islamiques dont le plus important, celui de Mogadiscio, est nommé Hifka-Halane. Il sert de pouvoir judiciaire (civil et pénal), en jugeant les affaires en appliquant la charia.
Début décembre 2006, les Nations unies autorisent le déploiement d'une force de maintien de la paix, composée de 8 000 hommes, sous l'égide de l'Union africaine24 (résolution 1725). Fin décembre 2006, l'armée éthiopienne intervient et les tribunaux islamiques fuient Mogadiscio. Elle prend ainsi le contrôle de la majeure partie du pays et le gouvernement de transition se déclare le gouvernement de facto du pays.
Du 20 au 31 décembre 2006, l'Éthiopie est entrée en guerre contre l'Union des tribunaux islamiques. La loi martiale a été décrétée le 30 décembre 2006 par le premier ministre somalien du gouvernement fédéral de transition, Ali Mohamed Gedi, et un délai de trois jours a été donné aux Somaliens pour remettre leurs armes à feu aux troupes éthiopiennes ou fédérales, avec un suivi très faible.
an 2006 : Soudan - En 2006, le gouvernement de Khartoum rejette le déploiement de « Casques bleus » au Darfour. Mais il accepte finalement l'année suivante le déploiement au Darfour d’une « force hybride » associant l’ONU et l’Union africaine (la MINUAD).
an 2006-2010 : Tchad - Alors que le président Déby fait modifier la constitution pour supprimer la limite de deux mandats présidentiels, une guerre civile éclate, contestant cette mainmise sur le pouvoir. Le président réussit à se maintenir au pouvoir et à être réélu, lors d'élections contestées boycottées par l'opposition. Entre 2006 et 2008, les forces d'opposition rebelles tentent plusieurs fois de prendre la capitale par la force, mais échouent systématiquement.
Le 13 avril 2006, des combats éclatent entre les troupes du président de la République et une faction de la rébellion, le Front uni pour le Changement (FUC), dans la périphérie de N'Djaména. Idriss Déby Itno accuse le Soudan, en pleine guerre du Darfour, de soutenir ses adversaires, à l’aube des élections présidentielles.
Malgré l’opposition et les appels au boycott, le 3 mai 2006, Idriss Déby Itno est réélu au suffrage universel avec 64,67 % des votes exprimés.
Le 2 février 2008, les rebelles, en provenance du Soudan frontalier, s’emparent de la capitale du Tchad, N'Djaména, à l'exception du palais présidentiel où le président Idriss Déby Itno semble s'être cloîtré. La France décide d’évacuer une partie de ses ressortissants. Le 4 février 2008, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques contre le gouvernement tchadien, dont l’armée rencontre des difficultés à repousser les rebelles. La France, via l’opération Épervier, apporte alors une aide logistique qui permet d’assurer la stabilité régionale au Tchad.
Mais les rebelles mènent une guerre de mouvement dans l’Est du Tchad, afin de faire tomber le gouvernement au pouvoir. Les attaques répétées ont pour conséquence de provoquer en juin 2008 un combat opposant pour la première fois la mission militaire européenne EUFOR et les rebelles au sud d’Abéché, autour de la ville de Goz Beïda. En novembre 2008, dans l’Est du pays, deux véhicules militaires belges sont brûlés, à la suite de tirs provenant d’hélicoptères soudanais.
En mai 2009 a lieu une autre offensive de la rébellion partant du Soudan, toujours dans l'objectif de renverser Idriss Déby. Le contingent militaire français de l'opération Épervier est suppléé, entre 2007 et 2009, par la force d'interposition EUFOR, forte de 3 000 soldats, mandatée par l'Union européenne à la demande de la France, en principe neutre mais qui assure un soutien de fait au régime du président Déby.
Finalement, en 2010, le président soudanais Omar el-Bechir se rend au Tchad pour normaliser les relations entre les deux pays. Le gouvernement du Tchad refuse d’arrêter ce dernier, pourtant visé par des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale émis à son encontre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour.
an 2007-2008 : Burkina Faso - contre le coût élevé de la vie. En juin 2008, l'université de Ouagadougou connaît une grève massive, qui se solde par une reprise en main brutale de l'université par le pouvoir : suppression de toutes les prestations sociales étudiantes (bourses, restauration, résidences universitaires vidées en deux jours) après tirs à balles réelles sur les étudiants.
an 2007 : Afrique Côte d'Ivoire - Appliqué avec beaucoup de difficultés, l’accord de Linas-Marcoussis est suivi par plusieurs autres, conclus en Afrique et mis en œuvre par les gouvernements successifs de Seydou Diarra, Charles Konan Banny.
L’accord politique de Ouagadougou conclu en 2007 avec Laurent Gbagbo, sous l’égide du président burkinabé Blaise Compaoré, qui fait office de facilitateur, offre aux Forces nouvelles le poste de Premier ministre. Les Forces nouvelles désignent leur secrétaire général, Guillaume Soro, le 26 mars 2007 pour exercer cette fonction.
Guillaume Soro entre en fonction le 4 avril et son gouvernement est installé trois jours plus tard. Le gouvernement doit mettre en place notamment deux points clefs de l'accord politique de Ouagadougou : la préparation d'élections devant se tenir dans les dix mois à compter de mars 2007, puis l'unification des Forces armées des Forces nouvelles (FAFN) et des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire (FANCI).
Dans le gouvernement Soro I composé de 33 membres, la formation militaro-politique de celui-ci (les Forces nouvelles de Côte d'Ivoire) et le Front populaire ivoirien (FPI), formation politique dont est issu le président Laurent Gbagbo, disposent chacun de huit portefeuilles (le Premier ministre y compris). Les autres portefeuilles sont répartis entre divers autres partis politiques. Ainsi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) en détient 5, le Rassemblement des républicains (RDR) 5, le Mouvement des forces d'Avenir (MFA) un, le Parti ivoirien des travailleurs (PIT) un, l’Union démocratique de Côte d'Ivoire (UDCI) un et l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) un ; deux autres ministres sont réputés proches du Président de la République et un ministre est issu de la société civile.
Concrètement, outre la gestion des affaires relevant de ses compétences traditionnelles, le gouvernement coordonne la mise en œuvre du processus de sortie de crise au moyen de programmes spécifiques. Il s’agit d’un dispositif technique comprenant notamment le Centre de commandement intégré (désarmement des combattants), le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire, le Comité national de pilotage du redéploiement de l'Administration (restauration de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire et reprise du fonctionnement des services publics), l’Office national d'identification (identification des populations et des électeurs) et la Commission électorale indépendante (organisation des élections).
an 2007 : Guinée - Le pouvoir du président, sous influence d'hommes d'affaires comme Mamadou Sylla, est de plus en plus contesté. Début 2007 éclate une grève générale réprimée dans le sang.
an 2007 : Kenya - Lors de l'élection présidentielle du 27 décembre 2007, Raila Odinga reçoit un soutien massif dans les provinces de Nyanza, occidentale, de la vallée du Rift et de la côte mais aussi de personnalités emblématiques telle Wangari Maathai. Dans la soirée du 30 décembre 2007, Samuel Kivuitu (en), qui vient juste d'être reconduit, pour cinq ans, par Kibaki à son poste de président de la commission électorale (Electoral Commission of Kenya), déclare Raila Odinga battu par 232 000 voix de différence en faveur du président sortant contrairement aux tendances des derniers résultats enregistrés. Controversée par les observateurs de l'Union européenne qui demande un recomptage des bulletins de vote, cette annonce est immédiatement contestée par le camp de Raila et entraine la plus grande crise de violence survenue au Kenya.
an 2007 : Mali - Le 29 avril 2007, Amadou Toumani Touré est réélu au premier tour avec 71,20 % des voix, mais cette élection est contestée par les principaux candidats de l’opposition. Les relations commerciales, politiques et culturelles avec la France se ralentissent tandis que celles avec la Chine, la péninsule arabique et les États-Unis se renforcent.
an 2007-2008 : Mauritanie - Le 25 mars 2007, Sidi Ould Cheikh Abdallahi est le premier civil à être élu président de le République démocratiquement, le colonel Ely Ould Mohamed Vall, conformément à ses engagements, ne s’étant pas présenté. En avril 2007 la Mauritanie réintègre l’Union Africaine, dont elle avait été exclue après le coup d’État de 2005. Pour la première fois, des membres du parti islamique modéré rejoignent le gouvernement en mai 2008.
Esclavage :
La société mauritanienne reste dominée par la caste des Beydanes, qui a historiquement fondé son pouvoir sur l'esclavage des castes inférieures.
L’esclavage reste courant en Mauritanie, le président de l’IRA (Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste) Biram Dah Abeid considère la Mauritanie comme un régime « d’apartheid non écrit ». Certains parmi la minorité Maures (arabo-berbère) y exploitent des Haratines dans les quartiers riches des grandes villes. Selon le rapport de l’ONG Walk Free publié en 2014 environ 4% de la population mauritanienne, soit 150 000 personnes vit en situation d’esclavage. La Mauritanie est le pays le plus touché au monde par ce phénomène. Selon Biram Abeid, la réalité se rapproche plus des 20% de la population.
L'esclavage a été officiellement aboli à quatre reprises (la dernière fois en 1980, avec un succès mitigé) mais les ségrégations raciales, tribales ou de castes y subsistent. En 2007 a été votée une loi criminalisant l'esclavage, et des actions sont prévues par le gouvernement pour lutter contre ses séquelles, car l'ethnie haratine des anciens esclaves reste parmi la plus défavorisée. Selon le Global Slavery Index, l'esclavage concerne 4 % de la population mauritanienne.
an 2007-2010 : Nigéria - En 2007 des élections une nouvelle fois agitées amènent au pouvoir le successeur désigné d'Olusegun Obasanjo : Umaru Yar'Adua, qui décède le 5 mai 2010. Son vice-président Goodluck Jonathan lui succède alors.
an 2007-2009 : Rwanda - La veille de la commémoration du 7 avril 2007, l'ancien Président de la République, Pasteur Bizimungu, est gracié par le Président Paul Kagame. Cette incarcération était vivement contestée par des ONG qui y voyaient un prétexte pour écarter un éventuel rival politique. Pasteur Bizimungu avait en effet symbolisé une réconciliation possible entre Tutsi et Hutu après le génocide.
La peine de mort est abolie au Rwanda en milieu d'année 2007. Cette abolition était demandée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda afin que, dans le cadre de la cessation de ses activités, prévue dans ses statuts en 2008 et 2010 pour la cour d'appel, il puisse transférer des détenus et des dossiers de présumés génocidaires au Rwanda.
Le président du Parti Vert rwandais, Frank Habineza, fait également état de menaces. En octobre 2009, une réunion du Parti des Verts rwandais est violemment interrompue par la police Quelques semaines seulement avant les élections, le 14 juillet 2009, André Kagwa Rwisereka, le vice-président du Parti vert démocratique, est retrouvé mort, à Butare, au sud du Rwanda. Le climat interne est marqué par des meurtres ou des arrestations de journalistes toujours selon Amnesty International.
L'analyse publique des politiques et pratiques du gouvernement est limitée au sein du pays par les limites de la liberté de la presse. En juin 2009, le journaliste du journal Umuvugizi Jean-Leonard Rugambage est abattu devant son domicile à Kigali. En juillet 2009, Agnes Nkusi Uwimana, rédactrice en chef du journal Umurabyo, est accusée d'« idéologie du génocide" ».
an 2007: Sénégal - Abdoulaye Wade est facilement réélu lors de l’élection présidentielle de 2007, et malgré le mot d’ordre de boycott de l’opposition lors des élections législatives consécutives, il dispose d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale et au Sénat, rétabli en début d’année. Le Président mène une politique libérale ouvertement revendiquée qui donne certains résultats. En effet le Sénégal devient une terre d’élection pour les investisseurs d’Europe, mais aussi des émirats du Golfe – c’est le cas de Dubaï Ports World qui enlève l’exploitation du port de Dakar –, du Brésil, de Chine, d’Iran ou d’Inde – par exemple avec le géant mondial de la sidérurgie, Arcelor Mittal. Abdoulaye Wade appelle également à la création d’États-Unis d’Afrique et de grands travaux d’infrastructures ont été lancés en vue du 11e sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) qui s’est tenu à Dakar en mars 2008.
Mais la politique gouvernementale essuie aussi des revers, comme l’inexorable recul du secteur agricole (arachide, coton…), l’effondrement de l’industrie chimique en 2006, le développement insuffisant du secteur tertiaire ou l’engorgement persistant de la capitale.
Le pays reste très dépendant de l’aide extérieure, notamment des subsides envoyés par l’importante diaspora sénégalaise. Le ralentissement de la crois sance et un taux de chômage élevé poussent bien des jeunes Sénégalais à l’émigration, parfois au péril de leur vie. L’augmentation du coût de la vie, notamment liée à la hausse des cours du pétrole, suscite des manifestations de rue en novembre 2007.
Beaucoup dénoncent aussi une dérive autoritaire du pouvoir, – guère tempérée par un Premier ministre généralement présenté avant tout comme un technocrate, Cheikh Hadjibou Soumaré , et qui laisse une marge de manœuvre réduite à l’opposition, ainsi qu’aux médias, pour la plupart solidaires de l’action présidentielle.
La question de la future succession d’Abdoulaye Wade, réélu à 80 ans, apparaît en filigrane dans le débat politique actuel, alimenté notamment par les spéculations sur les intentions de son fils Karim Wade.
an 2007 : Somalie - En janvier 2007, les États-Unis interviennent dans le sud de la Somalie pour pourchasser des membres présumés d'Al-Qaïda.
Le 23 janvier 2007, les troupes éthiopiennes commencent officiellement à se retirer de Somalie. Peu fréquent auparavant, les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du 29 octobre 2008 sont attribués au groupe al-Shabaab)
an 2008 : Afrique du Sud - En 2008, une grave pénurie d'électricité achève le bilan économique du président, à qui la presse reproche l'imprévoyance de son gouvernement, ainsi qu'à celui de Nelson Mandela, pour avoir refusé, en 1996, d'investir dans la construction de nouvelles centrales électriques alors que le pays connait une croissance de la demande en électricité de 10 % chaque année. Les grandes villes sont, pendant plusieurs semaines, périodiquement plongées pendant quelques heures dans l'obscurité alors que le gouvernement est contraint de promouvoir le rationnement, de renoncer à certains grands projets créateurs d'emplois et de suspendre ses exportations d'électricité vers les pays voisins. En mai, le gouvernement est confronté à une vague de violences contre les immigrés, caractérisée notamment par des meurtres, des pillages et des lynchages.
Mis en cause indirectement pour des « interférences » politiques dans des affaires judiciaires impliquant son ancien vice-président, Thabo Mbeki est contraint de démissionner de la présidence sud-africaine le 21 septembre 2008 après avoir été désavoué par son parti.
L'ANC nomme alors le vice-président du parti, Kgalema Motlanthe, pour lui succéder. Cela s'accompagne d'un schisme au sein de l'ANC et la création du Congrès du Peuple (COPE) par les partisans de l'ancien président.
an 2008 : République de Botswana - Le nouveau président est le lieutenant-général Ian Khama qui entre en fonction 2008, en prévision des élections de 2009. Il est le fils du premier président du Botswana, et un ancien chef de l'armée du Botswana (BDF). Élu formellement en 2009 et réélu en 2014, il demeure en fonction jusqu'en 2018, date à laquelle il démissionne pour laisser la place au vice-président Mokgweetsi Masisi qui lui succède.
an 2008 : Cameroun - En février 2008, des émeutes éclatent, réclamant la baisse des prix et le départ de Paul Biya. Les manifestants sont sévèrement réprimés : une centaine de morts, des milliers d’arrestations.
Le projet de Paul Biya de modifier la Constitution en février 2008 donne lieu à des manifestations brutalement réprimées ; une centaine de personnes sont tuées.
an 2008 : Cap Vert - Le 23 juillet 2008, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) accueille le Cap-Vert qui devient le 153e pays membre. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux principaux partis, le Mouvement pour la démocratie (MPD), et le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV, l'ancien parti unique), qui se succèdent au pouvoir, et quelquefois y cohabitent (avec un président de l'un et un premier ministre de l'autre). L'archipel souffre par contre du réchauffement climatique et de sécheresses, d'autant plus que l'eau douce y est rare. Les gouvernements ont opté pour une politique de développement des énergies renouvelables, ainsi que de l'écotourisme.
an 2008 : Afrique République de Djibouti - La frontière reste donc inchangée, l'île est indivise entre les deux pays. Douméra est le prétexte de l'affrontement entre les forces érythréennes et djiboutiennes de juin 2008.
an 2008-2009 : Afrique République de Djibouti - Le 10 juin 2008 éclate la guerre djibouto-érythréenne qui a opposé l'Érythrée à Djibouti autour du cap (ras) Douméra. Djibouti accuse Asmara d'avoir financé le mouvement armé anti-gouvernemental du Front pour la restauration de l’unité et la démocratie entre 1991 à 1994. L'Érythrée revendique la zone du cap Douméra, point littoral de la frontière entre les deux pays. En janvier 2009, par la résolution 1862 du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil de sécurité des Nations unies impose des sanctions contre l'Érythrée.
an 2008-2018 : Érythrée - Enfin, un différend territorial oppose par ailleurs l'Érythrée à Djibouti sur sa frontière sud depuis 2008 qui vaut à l'Érythrée des sanctions des Nations unies, sanctions levées le 14 novembre 2018. Le Conseil a ainsi adopté à l'unanimité cette résolution élaborée par la Grande-Bretagne et levé l'embargo sur les armes, toutes les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et autres sanctions.
an 2008-2012 : Ghana - Le président Kufuor quitte le pouvoir en 2008, respectant comme son prédécesseur, la limite du nombre de mandat possible. La décision du Nouveau Parti Patriotique est de choisir Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le fils de Edward Akufo-Addo comme leur candidat, tandis que le Congrès National Démocratique choisit John Atta Mills pour la troisième fois.
Le 28 décembre 2008, au terme d'une élection présidentielle très disputée et unanimement saluée pour son caractère démocratique, le candidat du Congrès démocratique national (Ghana), John Atta Mills, devient le nouveau président du pays. La passation de pouvoir s'est déroulée le 7 janvier 2009. John Atta Mills bénéficie ensuite de l'exploitation de forages pétroliers qui créent une dynamique nouvelle. La gestion de cette manne, qui soulève de grands espoirs dans la population, se veut basée sur un modèle norvégien avec « une industrie pétrolière où le sens de l’équité et de la justice doivent être reproduits localement pour le bénéfice de tous les Ghanéens »
Le 24 juillet 2012, le président meurt. Le pouvoir est transmis au vice-président, John Dramani Mahama, et des élections sont convoquées18. Il choisit le Gouverneur de la Banque du Ghana, Amissah Arthur, comme nouveau vice-président. Il est confirmé à son poste par le scrutin de décembre 201220. Son mandat est perturbé par une croissance en berne et des scandales de corruption et il perd l'élection présidentielle de 2016 face au chef de l'opposition Nana Akufo-Addo.
Industrialisation, opération séduction des investisseurs étrangers, lutte contre le paludisme, les initiatives s'enchaînent. Réputé pour sa stabilité politique, son fonctionnement démocratique et son dynamisme, le pays accueille Melania Trump après Barack Obama, mais aussi Angela Merkel ou encore Emmanuel Macron.
an 2008-2009 : Guinée - Le 22 décembre 2008, Lansana Conté décède des suites d'une longue maladie (leucémie et diabète aigu) à l'âge de 74 ans. Au cours de la nuit suivante, les proches du régime s'affairent pour organiser l'intérim suivant les procédures prévues par la Constitution mais le 23 décembre 2008 au matin, à la suite de l'annonce du décès de Lansana Conté, des dignitaires de l'armée annoncent unilatéralement la dissolution du gouvernement ainsi que la suspension de la Constitution, dans un discours à teneur résolument sociale. Ces événements laissent planer le doute sur l'effectivité d'un nouveau coup d'État. Le même jour, le capitaine Moussa Dadis Camara est porté à la tête du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et devient le lendemain, le troisième président de la République de Guinée.
an 2008 : Kenya - Fin février 2008, grâce à la médiation de Kofi Annan, l'ancien Secrétaire général des Nations unies, un accord de partage du pouvoir entre le président Kibaki et Raila est signé et entériné à l'unanimité par le Parlement le 18 mars pour résoudre la crise. Il se matérialise par la nomination de Raila Odinga au poste de Premier ministre le 13 avril suivant. Quatre jours plus tard, il prête serment et un gouvernement de coalition est constitué.
an 2008 : Libéria - L'ancien président Charles Taylor est jugé pour l'armement et le soutien aux rebelles de Sierra Leone depuis le 7 janvier 2008 à La Haye. Il plaide non coupable.
an 2008 : Mauritanie - Le 6 août 2008, à la suite du limogeage d'officiers supérieurs, les militaires conduits par le chef du bataillon chargé de la sécurité présidentielle, le général Mohamed Ould Abdelaziz, déposent le président Abdallahi. Il est assigné à résidence durant 4 mois et demi. Les principaux partis d’opposition, à l'exception du RFD d’Ahmed Ould Daddah se réunissent en un Front national pour la défense de la démocratie (FNDD) et s'opposent au coup d’État.
an 2008 : Somalie - les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du 29 octobre 2008 sont attribués au groupe al-Shabaab)
Le 29 décembre 2008, le président Abdullahi Yusuf Ahmed annonce sa démission, déclarant qu'il regrette n'avoir pas pu mettre fin au conflit somalien. Le Parlement, réuni à Djibouti en raison du désordre en Somalie, élit alors le cheikh Sharif Ahmed, ancien dirigeant de l'Union des tribunaux islamiques, à la présidence de la République. Il l'emporta face à Maslah Mohamed Siad Barre, fils de l'ancien président Mohamed Siad Barre, et au Premier ministre sortant Nur Hassan Hussei.
an 2008 - 2010 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 2008, les élections présidentielle et législatives du 29 mars constituent un revers pour la ZANU. Le MDC remporte la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale (109 élus contre 97 élus à la ZANU). Publiés le 2 mai, le résultat de l’élection présidentielle est contesté. En obtenant officiellement près de 48 % des suffrages en dépit des fraudes, Morgan Tsvangirai devance néanmoins Robert Mugabe (43 %). Lors de la campagne du second tour, le pays est le théâtre de violences politiques continues marquées par des exactions commises par la police contre des membres de l'opposition et leur famille mais aussi par l’arrestation de ses principaux chefs31. Dans ce climat de terreur, Morgan Tsvangirai décide à cinq jours du second tour de l’élection présidentielle de boycotter celle-ci, permettant ainsi à Robert Mugabe d’être réélu. L’inflation dépassant les 10 millions de % en rythme annuel, l'édition de billets de 100 milliards de dollars zimbabwéens (environ 3 EUR fin juillet 2008) devient nécessaire. La population est contrainte de revenir à une économie de troc et à la marche à pied : il n'y a plus de gazole pour faire rouler les bus.
De plus, à partir du mois d'août, une épidémie de choléra sévit dans le pays ; elle fait, selon l'OMS, 2 971 morts, pour 56 123 personnes contaminées (chiffres officiels au 27 janvier 2009). Toujours d'après l'OMS, jusqu'à la moitié des 12 millions de Zimbabwéens sont susceptibles de contracter la maladie en raison de l'insalubrité des conditions de vie dans le pays. En 2009, sous la pression de l'ONU quant aux fraudes concernant l'élection présidentielle, Robert Mugabe décide de partager le pouvoir avec son opposant et rival personnel Morgan Tsvangirai, chef du Mouvement pour le changement démocratique (MDC). En avril 2010, Mugabe reçoit le président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, avec lequel il conclut huit accords commerciaux entre les deux pays. Cette visite n'est pas bien perçue par l'opposition et par le reste du monde.
an 2009-2010 : Afrique du Sud - En mai 2009, Jacob Zuma est élu président de la république après la victoire de l'ANC (65,90 %), lors des élections générales, face notamment à l'alliance démocratique (16,66 %) d'Helen Zille, qui remporte la province du Cap occidental, et face au Congrès du Peuple (7,42 %) de Mosiuoa Lekota. Il hérite d'un pays toujours considéré comme le poumon économique de l'Afrique subsaharienne (40 % du PIB de l'Afrique subsaharienne) mais où le crime, sans distinction raciale, est omniprésent, faisant de ce pays l'un des plus dangereux du monde au côté de l'Irak et de la Colombie, où l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'est accentué, où la politique de discrimination positive est contestée pour son inefficacité et où les tentatives de réforme agraire n'ont débouché que sur des échecs. Le nouveau gouvernement qu'il forme est alors plus ouvert aux autres partis et autres races que ne l'était celui de Mbeki. Il fait notamment entrer au gouvernement Jeremy Cronin, un Blanc par ailleurs secrétaire général adjoint du parti communiste sud-africain et Pieter Mulder, chef du front de la liberté, le parti de la droite afrikaner qui a succédé à l'ancien parti conservateur.
En 2010, quinze ans après avoir organisé avec succès la coupe du monde de rugby, marquée par la victoire de l'équipe nationale, les Springboks, l'Afrique du Sud est le pays hôte de la coupe du monde de football. Deux mois avant l'évènement sportif, le 3 avril 2010, l'assassinat, dans sa ferme, d'Eugène Terre'Blanche par deux de ses ouvriers agricoles fait craindre un moment un réveil des tensions raciales dans une Afrique du Sud toujours minée par ces conflits latents. Le très influent leader de la Jeunesse de l'ANC, Julius Malema, connu pour ses outrances verbales à l'encontre de Thabo Mbeki et des opposants à Zuma, pour qui il se déclarait prêt à tuer, est mis en cause pour avoir repris dans ses discours une chanson prônant de « tuer les Boers » parce que « ce sont des violeurs ». Dans les campagnes sud-africaines, le modèle zimbabwéen reposant sur la carte raciale et la carte de la terre a beaucoup de partisans. L'épisode du meurtre de Terre'Blanche souligne ce malaise en zone rurale où plus de 2 500 fermiers blancs ont été tués en une dizaine d'années, souvent dans d'atroces conditions et le fait que des ouvriers agricoles noirs sont souvent mal payés et maltraités par leurs employeurs.
an 2009 : Algérie - Pendant les mois de mars et d'avril de l'année 2009, la campagne électorale pour la présidentielle se déclenche à la suite d'un nouvel amendement constitutionnel. Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014.
an 2009-2011 : Afrique - les Comores - Il est organisé le 29 mars 2009 et 95,2 % des votants acceptent le changement de statut, faisant de Mayotte le 5e département d'outre-mer (DOM) et le 101e département français en 2011.
Mayotte fait partie des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Elle devrait devenir une région ultrapériphérique de l'Union européenne au moment de sa départementalisation. Le pays souverain formé par les trois îles s'appelle aujourd'hui Union des Comores.
an 2009 : Congo Brazzaville - Denis Sassou-Nguesso est de nouveau réélu président du Congo, avec 78,61 % des voix à l'issue du vote du 12 juillet.
an 2009-2016 : Gabon - Le 3 septembre 2009, Ali Bongo, ministre de la Défense et fils d'Omar Bongo Ondimba, devient le troisième président du Gabon, élu à l'occasion d'un scrutin majoritaire à un tour, avec 41,79 % des suffrages exprimés, soit environ 141 000 voix sur un total de 800 000 électeurs inscrits. Il devance Pierre Mamboundou, crédité de 25,64 % des voix, et André Mba Obame, le nouveau chef de l'opposition gabonaise et ancien ministre de l'Intérieur. Les résultats sont fortement contestés et à la suite des forts soupçons de fraude, des émeutes éclatent et sont violemment réprimées par les forces de l'ordre, fidèles au pouvoir.
Par la suite, plusieurs enquêtes attestèrent que les scores avaient été truqués. Dans un documentaire diffusé sur France 2 en décembre 2010, le diplomate Michel de Bonnecorse, ex-conseiller Afrique du président Jacques Chirac, confirmera cette version des faits. L’ambassadeur américain Charles Rivkin, dans un télégramme transmis en novembre 2009 à la secrétaire d’État, le confirme également : « octobre 2009, Ali Bongo inverse le décompte des voix et se déclare président » (le télégramme sera divulgué par WikiLeaks en février 2011).
Depuis, le président Bongo prône le concept de « Gabon émergent », politique visant notamment à la diversification de l'économie afin de diminuer sa dépendance aux cours mondiaux du pétrole.
an 2009 Guinée - Le 28 septembre 2009, des mouvements civils organisent une manifestation pacifique pour demander à Dadis Camara de respecter sa parole et de ne pas se présenter aux présidentielles. Une foule de plusieurs milliers de personnes s'était rendu au stade à la demande de l'opposition pour protester contre le désir du président Dadis de se porter candidat à l'élection présidentielle. Le 28 septembre 2009, au stade de Conakry, à la surprise générale les militaires ouvrent le feu sur les manifestants ainsi bloqués dans le stade sans possibilité de fuite. Ce massacre délibéré et manifestement planifié fait plusieurs centaines de morts. De plus, les militaires violent et enlèvent plusieurs dizaines de jeunes femmes, dont certaines seront libérées quelques jours plus tard après avoir subi des viols à répétition, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de trace.
À la suite du tollé international soulevé par cet évènement, des dissensions apparaissent au sein du CNDD34 et le 3 décembre 2009, alors que Sékouba Konaté est en voyage au Liban, le président est grièvement blessé par son aide de camp Aboubacar Sidiki Diakité - ce dernier avait été mis en cause explicitement par des diplomates étrangers pour son rôle dans le massacre du 28 septembre, et craignait d'être « lâché » par son président et livré à la justice. Dadis Camara est hospitalisé au Maroc le 4, et Sékouba Konaté rentre au pays pour assurer l'intérim.
an 2009 : Guinée-Bissau - le 1er mars 2009, le chef d'état-major des forces armées, le général Batista Tagme Na Waie, est tué dans un attentat à la bombe. Le président João Bernardo Vieira, que certains militaires tiennent pour responsable de cet attentat dans la mesure où il entretenait des relations historiquement exécrables avec ce dernier, est assassiné à son tour, le 2 mars 2009, par des hommes en armes. Pour lui succéder, Malam Bacai Sanhá, candidat du PAIGC, est élu président le 26 juillet 2009.
Parallèlement, la Guinée-Bissau est gangrenée par le trafic de drogue et qualifiée à ce titre de « narco-État » par l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime. Ainsi, les attentats contre le chef d'état-major Tagmé Na Waié et le président Vieira ont probablement été fomentés par les trafiquants colombiens, peut-être en représailles de la destitution en août 2008 du contre-amiral José Américo Bubo Na Tchuto, chef de la marine nationale, qui couvrait le trafic avec Antonio Indjai. Ce dernier, après bien des péripéties, tombera d'ailleurs en mars 2013 dans un piège tendu par la DEA et envoyé aux États-Unis pour y être jugé pour trafic de drogue tandis qu'Antonio Indjai est depuis lors inculpé par la justice américaine et sous mandat d'arrêt international.
Le mandat de Malam Bacaï Sanha est émaillé de graves incidents en lien avec le narcotrafic. Le 1er avril 2010, une tentative de coup d'État menée par Antonio Indjai et l'ancien contre-amiral José Américo Bubo Na Tchuto aboutit à l'arrestation du Premier ministre Carlos Gomes Júnior et d'une quarantaine d'officiers dont le chef d'état-major de l'armée, José Zamora Induta, dans un coup de force présenté comme « un problème purement militaire ». À la suite de manifestations de soutien au Premier ministre, Antonio Indjai menace de tuer ce dernier avant d'expliquer dans une allocution que l'armée « réitérait son attachement et sa soumission au pouvoir politique ». Le Premier ministre est relâché le lendemain tandis qu'Indjai se présente comme le nouvel homme fort de l'armée. Ce dernier est relâché le lendemain, mais demeure en résidence surveillée, tandis qu'Antonio Indjai devient le nouvel homme fort de l'armée.
an 2009 : Libéria - Constatant une certaine stabilité politique, la Banque européenne d'investissement accorde le 15 mai 2009 un prêt de 3,5 millions d'euros au Liberia pour le soutien de la micro finance dans ce pays ainsi que la suspension des remboursements de l'encours du solde de la dette jusqu'en 2012. Mais la corruption continue de gangrener le système politique, malgré les intentions initialement affichées.
an 2009 : Madagascar - À partir de janvier 2009, une crise politique entre le maire de la capitale Andry Rajoelina et le président Marc Ravalomanana fait une centaine de victimes. Le 16 mars 2009, le président Marc Ravalomanana démissionne. Il transfère les pleins pouvoirs à un Directoire militaire composé des plus hauts gradés de l'Armée malgache, en lieu et place du président du Sénat comme le prévoyait la constitution, lequel directoire (re)transfère le jour même le pouvoir à Andry Rajoelina. Cette prise de pouvoir, validée par la Haute Cour Constitutionnelle malgache (HCC), est toutefois considérée par une grande partie de la Communauté internationale comme un coup d'État. Du 17 mars 2009 au 25 janvier 2014, Andry Rajoelina dirige l’État malgache sous le régime de la Transition.
an 2009 : Mauritanie - En avril 2009, Mohamed Ould Abdel Aziz abandonne le pouvoir afin de se présenter à l'élection présidentielle promise par la junte. Un accord pour préparer les futures élections est signé à Dakar entre les représentants de l’opposition et de la junte.
Le 18 juillet, Mohamed Ould Abdelaziz, qui durant sa campagne se présente comme le « président des pauvres », est élu au premier tour face à 8 autres candidats, avec 52,58% des voix. Ses opposants dénoncent un « coup d’État électoral » et fondent une Coordination de l’opposition démocratique, qui inclut le RFD.
L'arrivée du président actuel Mohamed Ould Abdel Aziz, le 18 juin 2009, fut marquée notamment par la coupure de ces relations diplomatiques avec Israël.
an 2009 : Réunion (Ile de la) - le 23 juin, la route des Tamarins est ouverte à la circulation.
an 2009 : Mozambique - Le 28 octobre 2009, Armando Guebuza est réélu président pour un deuxième mandat, dès le premier tour de scrutin avec 75 % des voix
an 2009 : Ouganda - Des tensions apparaissent également avec le Kabaka (roi) du Buganda et dégénèrent en affrontements en 2009.
Dans un mouvement de populisme, une loi anti-homosexualité fut proposée en 2009 prévoyant jusqu'à la peine de mort pour les homosexuels et pénalisant les individus, entreprises, médias et ONG soutenant les droits des LGBT.
an 2009 : Sénégal - Lors des élections locales du 22 mars 2009, le PDS, parti au pouvoir, essuie un sérieux revers dans la plupart des grandes villes dont Dakar convoité par Karim Wade, au profit de la coalition d’opposition Bennoo Siggil Senegaal.
Après la démission de Cheikh Hadjibou Soumaré le 30 avril 2009, Souleymane Ndéné Ndiaye est nommé Premier ministre.
Septembre 2009 : des pluies torrentielles provoquent de violentes inondations dans le pays.
an 2009 : Somalie - Dès février 2009, divers groupes islamistes fusionnèrent au sein du Hizbul Islam et déclarèrent la guerre au gouvernement modéré de Sharif Ahmed. Cette coalition inclut l'Alliance pour la nouvelle libération de la Somalie, dirigée par Hassan Dahir Aweys, l'un des chefs radicaux de l'Union des tribunaux islamiques, Hassan Abdullah Hersi al-Turki, un autre commandant de l'Union des tribunaux islamiques et leader des brigades de Ras Kamboni et le groupe Muaskar Anole. Cette nouvelle coalition islamiste est, avec le groupe al-Shabaab, la plus active dans le conflit. De plus, en mars 2009, ben Laden appelait dans un enregistrement au renversement de Sharif Ahmed.
an 2009 : Soudan - En 2009, la Cour pénale internationale (CPI) lance un mandat d’arrêt contre le président soudanais Omar el-Béchir 4 mars 2009 pour crimes contre l’humanité (l’année suivante, l’accusation de génocide sera rajoutée).
an 2010 : Burkina Faso -Blaise Compaoré est réélu en 2010.
an 2010 : Burundi - Après cinq années, l'érosion du pouvoir conduit à un certain agacement au sein des autres groupes Hutus. Lorsque le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) de Pierre Nkurunziza obtient une majorité des 2/3 aux élections communales du 26 mai 2010, les partis Hutus signataires des accords d'Arusha dénoncent immédiatement des fraudes massives. L'ONU et l'Union européenne, qui supervisent le scrutin, assurent ne pas avoir observé de graves irrégularités.
Peu après, une émeute éclate dans un faubourg de Bujumbura : les manifestants ont découvert une urne remplie de bulletins non-décachetés dans un quartier acquis aux Hutus anti-Nkurunziza ; il y a plusieurs blessés. Le 2 juin, des dirigeants de l'opposition Hutu sont arrêtés, tandis que Ban Ki-moon arrive au Burundi pour appeler à la poursuite du processus électoral. Il ne rencontre que le président, ce qui est vécu par les opposants comme une trahison de la communauté internationale.
Le lendemain, les partis Hutu d'opposition (FNL, etc.) décident le boycott total de l'élection présidentielle du 28 juin. Le 5 juin, l'ancien président Domitien Ndayizeye décide de rejoindre la contestation. Le 7 juin, le gouvernement interdit toute campagne pour l'abstention, ce qui radicalise la divergence.
L'opposition burundaise refuse de participer à l'élection présidentielle du 28 juin 2010 et dénonce des fraudes lors des élections municipales de mai (le CNDD-FDD a remporté les municipales avec 64 % des voix et le déroulement de l'élection est jugé correct en regard des standards internationaux par les observateurs de l'Union européenne). La campagne est émaillée d'incidents, plusieurs membres de l'opposition sont arrêtés. Pierre Nkurunziza a été réélu président en 2010 avec plus de 91 % des voix, étant le seul candidat de l'élection. Les candidats de l’opposition s’étaient retirés pour protester contre les irrégularités du scrutin.
an 2010 : Congo Kinshasa - Depuis novembre 2010, l'ancienne mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUC qui n'était pas parvenue à désarmer les milices rwandaises, est renforcée militairement pour intervenir dans l'est du pays et devient la MONUSCO, mais plusieurs dissidences et révoltes persistent et de nombreuses violences continuent.
an 2010 : Afrique Côte d'Ivoire - À l'issue d'une élection présidentielle sous tension, les deux candidats arrivés au second tour, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, se déclarent vainqueurs et prêtent serment comme président du pays. Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur par Youssouf Bakayoko, le président de la Commission électorale indépendante, au siège du camp de Ouattara contrairement aux dispositions de ladite CEI, et a reçu le soutien du Premier ministre Guillaume Soro et d'une partie de la Communauté internationale. Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel et a reçu le soutien du général Philippe Mangou, commandant de l'armée. La Côte d'Ivoire se retrouve alors avec deux présidents tentant de s'imposer sur l'ensemble du pays.
Mais Alassane Ouattara bénéficie du soutien de la plus grande partie de la communauté internationale, ainsi que celui d'instances économiques et financières tant régionales qu'internationales. L'économie ivoirienne est paralysée par les sanctions et les finances de l'État ivoirien asséchées, notamment les zones encore contrôlées par Laurent Gbagbo.
an 2010 : Guinée - Arrivé au pouvoir, le capitaine précise que le nouveau régime est provisoire et qu'aucun membre de la junte ne se présentera aux élections présidentielles prévues en 2010.
Au fil de ses interventions médiatiques, Moussa Dadis Camara envisage de plus en plus explicitement de se présenter, décevant les espoirs de véritable transition démocratique et déclenchant des mouvements de protestation.
Le 12 janvier 2010, Moussa Dadis Camara est renvoyé vers le Burkina Faso par le Maroc pour y continuer sa convalescence. C'est ainsi que le 15 janvier, un accord sera trouvé entre Dadis et Sékouba pour que ce dernier soit reconnu Président de la transition. Cet accord stipule qu'un premier ministre issu des Forces Vives (Partis d'opposition, syndicats, société civile) soit nommé dans le but de former un gouvernement d'Union nationale et de conduire le pays vers des élections libres et transparentes dans les six mois. Aussi, aucun membre du gouvernement d'union nationale, de la junte, du Conseil national de la transition et des Forces de Défense et de Sécurité n'aura le droit de se porter candidat aux prochaines échéances électorales.
Le 16 janvier, Dadis, dans une allocution à partir du palais présidentiel burkinabé, dit que la question de sa candidature est définitivement réglée, ainsi que celle des autres membres de la junte. Jean-Marie Doré, doyen de l'opposition, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement d'union nationale chargé d'organiser les futures élections présidentielles.
Le 8 février 2010, la justice guinéenne ouvre un instruction judiciaire pour les crimes commis le 28 septembre 2009 à Conakry, trois magistrats instructeurs sont nommés et le 3 juin 2010, la FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen (OGDH), trois autres organisations guinéennes de victimes (AVIPA, AFADIS, AGORA) et 67 victimes se constituent parties civiles.
Le 7 mars 2010, Sékouba Konaté fixe par décret la date du premier tour de l'élection présidentielle au 27 juin 2010. Il tient parole et pour la première fois une élection présidentielle en Guinée se déroule sans qu'aucun militaire ne soit candidat. Le second tour des élections présidentielles devait se tenir le 19 septembre 2010 mais a été reporté à une date ultérieure.
Le 28 septembre 2010, un an après le massacre, les victimes et les ONG de défense des droits de l'homme demandent le jugement des auteurs présumés des faits.
Le 7 novembre 2010, Alpha Condé (candidat du RPG et de l'Alliance Arc-En-Ciel) obtient 52,5 % des suffrages face à son adversaire Cellou Dalein Diallo (candidat de l'UFDG et de l'Alliance des bâtisseurs), qui a fini par accepter les résultats de la cour suprême qu'il avait initialement contestés en raison de soupçons d'irrégularités. Le président Alpha Condé est élu pour un mandat de 5 ans.
an 2010 : Kenya - Le 4 août 2010, le texte de réforme de la Constitution, incluant la Charte des droits et libertés16, chère à Raila — et maintenant soutenu par Kibaki — est accepté, contre la position d'un autre membre influent de l'ODM, le ministre des Hautes études William Ruto — soutenu, lui, par l'ex-président Moi —, par la majorité des 72,1 % de Kényans ayant participé au référendum populaire (70 % de votes favorables contre 30 % de défavorables).
La cérémonie publique de promulgation par le président Mwai Kibaki de cette Constitution moderne16 le 27 août 2010 est entachée par la présence du président soudanais Omar el-Béchir alors qu'il est notifié d'un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Cette invitation, directement adressée par le président Kibaki suscite l'émotion et la réprobation des Kényans, de leur Premier ministre et des parlementaires. Les protestations de la Communauté internationale et en particulier celles du président américain Barack Obama — bien que les États-Unis n'aie pas ratifié le statut de Rome — et de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan sont rapides.
an 2010 : Leshoto - En 2010, peu avant la Coupe du monde de football, des milliers d’habitants ont demandé au gouvernement sud-africain l'annexion du pays pour en faire la dixième province d'Afrique du Sud. Fin mai, plusieurs centaines de personnes ont défilé dans la capitale, Maseru, et remis au Parlement et à l'ambassade d'Afrique du Sud une pétition demandant le rattachement. Plus de 30 000 signatures ont été recueillis et les raisons sont multiples : une situation économique extrêmement précaire, un taux de sida très élevé (400 000 personnes en sont atteints), une espérance de vie très basse (34 ans) et l'effondrement de l'industrie textile, ce qui rend la survie du pays extrêmement difficile, d'autant plus qu'il est totalement encerclé par l'Afrique du Sud et qu'il y a plus de Sothos vivant en Afrique du Sud qu'au Lesotho lui-même.
an 2010-2012 : Malawi - Mutharika remplace Muammar al-Gaddafi à la tête de l’Union africaine, devenant le premier chef d’état malawite à exercer la charge de secrétaire général de cette organisation. En 2011, le Malawi établit des relations diplomatiques avec 10 pays. Mais le second mandat de Mutharika est vite marqué par une dégradation brusque de l'économie, une dégradation des conditions de vie et des pénuries d'essence dues à un manque de confiance des bailleurs de fonds. Des émeutes éclatent, et le régime se durcit, s'appuyant sur l'armée. Finalement, le président Bingu wa Mutharika est victime d'un arrêt cardiaque le 5 avril 2012.
an 2010-2013 : Mali - En septembre 2010, sept étrangers, dont cinq Français, sont enlevés par Al-Qaida au Maghreb islamique. Treize mois plus tard, des Touareg maliens, ex-mercenaires en Libye, reviennent dans la partie nord du Mali : le contrôle de cette partie du pays semble échapper de plus en plus au pouvoir en place à Bamako entre les interventions de Al-Qaida au Maghreb islamique et ces forces Touaregs. Le 22 mars 2012, le capitaine Amadou Haya Sanogo dirige un coup d’État militaire. Quelques mois plus tard, soumis également à une pression internationale, il rend le pouvoir à des autorités civiles, pour une période de transition, avec comme président par intérim Dioncounda Traoré. Celui-ci organise une élection présidentielle qui se tient les 28 juillet et 11 août 2013 et s'achève par la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta auquel Dioncounda Traoré transmet le pouvoir le 4 septembre suivant.
Pendant ce temps, durant cette même année 2012, profitant des bouleversements politiques successifs à Bamako, les événements s'accélèrent dans le nord du pays et dans le Sahel, au centre du pays. De mars à septembre 2012, les villes de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti tombent aux mains des islamistes qui se rapprochent des régions du sud. Le 23 septembre 2012, Le Mali et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) s'accordent sur le déploiement d'une force africaine. Le 21 décembre 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies autorise par une résolution le déploiement d'une force africaine au Mali. Le 11 janvier 2013, les troupes françaises interviennent en appui de cette force africaine, c'est le début de l'opération Serval.
an 2010 : Mauritanie - La Mauritanie a suspendu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009 avant de "rompre complètement et définitivement les relations avec Israël" le 21 mars 2010. Ces relations avaient été établies en 1999 par le président de la République à l'époque, Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya.
Sous le président Abdel Aziz, la Mauritanie s’est érigée en garante de la lutte contre la menace terroriste, tout en adoptant des lois qui définissent les infractions terroristes en termes vagues. La loi antiterroriste adoptée en 2010 a ainsi permis aux autorités de museler plusieurs opposants politiques, comme Abdallahi Salem Ould Yali, activiste issu de la communauté «haratine», descendants d’esclaves, qui a été poursuivi pour incitation au fanatisme ethnique ou racial pour avoir diffusé des messages dénonçant la discrimination dont est victime son groupe ethnique dans un groupe de discussion WhatsApp, ou encore, en 2015, le colonel de la Garde nationale à la retraite Oumar Ould Beibacar, qui dénonçait les exécutions sommaires de ses co-officiers en 1992 dans une purge d’officiers noirs de l’armée mauritanienne.
an 2010 : Rwanda - En 2010, les opposants ont une marge de manœuvre très réduite. Ainsi, par exemple, l'opposante Victoire Ingabire, présidente des FDU-Inkingi (Forces démocratiques unies) est arrêtée pour négation du génocide, lorsqu'elle exprime la nécessité de réconciliation. Une loi de 2008 punit de dix à vingt-cinq ans de prison « l'idéologie du génocide », avec une formulation « rédigée en termes vagues et ambigus », selon Amnesty International, qui y voit un moyen de « museler de manière abusive la liberté d'expression ».
À l'approche de l'élection présidentielle rwandaise de 2010, deux autres rédacteurs en chef de journaux sont contraints de quitter le Rwanda. Les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis, la France et l'Espagne expriment publiquement leurs préoccupations. Paul Kagame est réélu à cette élection présidentielle, avec plus de 93 % des suffrages exprimés.
an 2010 : Sénégal - Février 2010 : un projet de loi déclarant l’esclavage “crime contre l’humanité” est exposé par le chef de l’Etat.
Abdoulaye Wade annonce également la fermeture de la base militaire française à Dakar.
an 2010 : Togo - En 2010 est organisée une élection présidentielle, où le président Faure Gnassingbé est réélu avec 61 % des voix. Gilchrist Olympio, candidat naturel de l'UFC, a été remplacé au dernier moment par Jean-Pierre Fabre.
Des heurts ont lieu en protestation à cette élection entre militants de la coalition et forces de l'ordre. Les élections ont été dénoncées par l'Union européenne, finançant les élections, qui au travers de ses observateurs a constaté des irrégularités dans la campagne électorale.
an 2010 - 2011 : Tunisie - En décembre 2010, la situation économique et sociale est très difficile. Le chômage, en particulier celui des jeunes diplômés, est très important. Le suicide d'un jeune commerçant empêché par la police de pratiquer son commerce déclenche un vaste mouvement de protestations. Des manifestations répétées, qui s'appuient sur les réseaux sociaux permis par l'internet, parviennent le 14 janvier 2011 à chasser du pouvoir le président Ben Ali. C'est la révolution tunisienne de 2010-2011, qui a lieu en même temps que d'autres mouvements dans des pays arabes : le Printemps arabe.
an 2011 : Burkina Faso - La révolte de 2011 secoue le pays en même temps que le Printemps arabe.
an 2011 : Cap Vert - Depuis 2011, le président est le dirigeant du MPD Jorge Carlos Fonseca.
En raison de sa stabilité politique et de la régularité des élections, le Cap-Vert est considéré comme l'un des pays africains les plus démocratiques.
an 2011 : Afrique Côte d'Ivoire - Les combats éclatent à Abidjan à la fin du mois de février 2011 entre le « Commando invisible » hostile à Gbagbo et l'armée régulière. Puis, début mars, la tension gagne l'ouest du pays, où les Forces nouvelles prennent le contrôle de nouveaux territoires. L'ensemble du front finit par s'embraser à la fin mars, et les forces pro-Ouattara, rebaptisées Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), prennent Yamoussoukro, la capitale politique du pays, le 30 mars. À partir de ce moment-là, les événements s'accélèrent : le sud du pays est conquis en quelques heures et les troupes pro-Ouattara entrent dans Abidjan sans rencontrer de réelle résistance (mais non sans commettre de nombreuses exactions sur les populations civiles).
Laurent Gbagbo et son épouse se retranchent à la Résidence présidentielle, protégés par un dernier carré de fidèles dont la Garde Républicaine dirigé par le colonel Dogbo Blé Bruno. La Résidence est assiégée par les forces pro-Ouattara qui ont du mal à accéder à la Résidence malgré plusieurs tentatives. Un assaut final est lancé contre le domicile le 11 avril avec l'appui des forces onusiennes et surtout de l'armée française (en application de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU). Laurent Gbagbo (accompagné de sa famille) est fait prisonnier, puis placé en état d'arrestation à l'hôtel du Golf. Il est ensuite transféré à Korhogo dans le nord du pays, où il est placé en résidence surveillée. Quelques jours plus tard, son épouse, qui n'a pas été autorisée à le suivre, sera placée quant à elle en résidence surveillée à Odienné, une autre localité du nord ivoirien. Depuis le 30 novembre 2011, Laurent Gbagbo est incarcéré à la Cour pénale internationale où il est inculpé pour quatre chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Les forces pro-Ouattara sont soupçonnées de s'être livrées à des exactions sur des populations supportant Laurent Gbagbo (massacre du camp de Nahibly et Duekoué). Dans le cas de Duekoué, l'ONU explique que les forces pro-Gbagbo seraient aussi impliquées.
an 2011 : Afrique République de Djibouti - Au début de 2011, des manifestations inspirées par le Printemps arabe sont réprimées.
an 2011 : Gambie - En 2011, Jammeh est réélu à 72 % des suffrages. Il déclare être « prêt à diriger le pays un milliard d’années ». Son opposant Darboe qualifie le scrutin de « frauduleux et grotesque ». La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest estime elle aussi que les élec Le gouvernement de Jammeh devient de plus en plus policier, il ignore les ONG et la Commission Africaine des droits de l’homme. Sont dénoncés par ces derniers le traitement discriminatoire des homosexuels, l’usage de la torture et la violence des services de renseignement, surnommés les « Jungelers ».
an 2011 : Kenya - Faisant suite à l'enlèvement d'une touriste britannique et à l'assassinat de son mari le 11 septembre 2011, à l'enlèvement d'une résidente franco-kényane le 1er octobre et enfin, le 13 octobre, à l’enlèvement de deux volontaires humanitaires espagnoles ainsi qu'à l'assassinat de leur chauffeur kényan, des unités militaires des forces armées kényanes entrent en Somalie le 16 octobre à la poursuite des miliciens d'Al-Shabaab. Cependant, Alfred Mutua, le porte-parole du gouvernement déclare, le 26 octobre, que l'opération militaire était planifiée depuis longtemps et que les enlèvements n'ont été qu'une aire de lancement (« the kidnappings were more of a good launchpad. »). Cette « invasion » donne lieu à des représailles de la part d'Al-Shabaab (cf. section détaillée : « Attentats »).
2011-2013 : Égypte - Hosni Moubarak est Président de la République jusqu'en février 2011, date de sa démission contrainte à la suite de la Révolution égyptienne de 2011. Hosni Moubarak poursuit la politique de libéralisation de l’économie, notamment par la réduction des subventions à l'agriculture et à la consommation, et par la libéralisation des prix. En 1992, il fait annuler les dispositions régissant la location des terres. Généralement appelée « loi pour chasser les paysans de leurs terres », cette loi, combinée aux autres mesures de désengagement de l’État dans l’économie, accroît le mécontentement des populations rurales pauvres en particulier en Haute-Égypte. Hosni Moubarak devient un pilier de la stratégie régionale des États-Unis et la Constitution qu'il met en place reconnait les « principes de la charia » comme source principale de la législation.
En janvier et février 2011, une série de manifestations d'ampleur inégalée se déroulent à travers le pays et mènent à la démission d'Hosni Moubarak le 11 février. Les nouvelles élections législatives et présidentielle sont remportées par le Parti de la liberté et de la justice, le bras politique des Frères musulmans.
Le pouvoir n'est cependant resté que peu de temps entre leurs mains car d'importantes manifestations contre le président élu, Mohamed Morsi, critiquant des dérives dictatoriales, et le retournement de l'armée contre celui-ci le destitue en faveur d'un gouvernement transitoire un an seulement après son élection. L'Égypte connait depuis une période de troubles causée par l'instabilité et les tensions politiques, notamment entre les opposants à l'ex-président et ceux qui continuent à le soutenir et n'acceptent pas ce qu'ils voient comme un coup d'État illégal.
an 2011-2018 : Éthiopie - En 2011, une crise alimentaire touche une grande partie de la Corne de l'Afrique. Dans la nuit du 20 au 21 août 2012, Meles Zenawi décède en pleine fonction après 21 ans au pouvoir. Conformément à la Constitution (article 73), Haile Mariam Dessalegn est désigné comme Premier ministre par la Chambre des représentants des peuples. Les Oromos, ethnie majoritaire avec plus du tiers de la population, entrent en rébellion en novembre 2015. Les Amharas, un quart de la population, font de même en août 2016. L'état d'urgence est décrété le
9 octobre 2016. Haile Mariam Dessalegn démissionne en février 2018 à la surprise générale. Le 2 avril 2018, Abiy Ahmed lui succède. Cet homme politique de longue date est populaire parmi les Oromos dont il est issu. Dès son discours d’investiture, il tend la main à l’Érythrée, en appelant à mettre fin à un conflit qui dure depuis l’indépendance du pays, en 1993. Il qualifie également les partis d’opposition de frères et non d’ennemis. La situation intérieure et les relations avec les pays voisins s’apaisent.
an 2011 : Libéria - Ellen Johnson Sirleaf remporte à nouveau l’élection présidentielle de 2011. Le taux de participation aux votes est faible, 37,4 %
an 2011 : Libye - La guerre civile de 2011
En 2011, dans le contexte du « Printemps arabe », le mécontentement populaire contre le régime de Kadhafi s'affirme désormais ouvertement. La violente répression des manifestations dans le pays, durant laquelle la troupe tire à l'arme lourde sur la population, débouche en février sur une véritable guerre civile. L'Est du pays échappe bientôt au contrôle de Kadhafi, et un gouvernement provisoire, le Conseil national de transition (CNT), est formé à Benghazi. Mais les troupes de Kadhafi contre-attaquent rapidement, et reprennent progressivement le contrôle du pays. Alors que Benghazi est directement menacée, le Conseil de sécurité des Nations unies vote la résolution 1973, autorisant en mars une intervention militaire internationale qui fournit aux rebelles un appui aérien et leur évite d'être écrasés. Au bout de six mois de conflit, les forces du CNT prennent Tripoli le 23 août. Kadhafi, ayant quitté la capitale, est mis à prix et visé par un mandat d'arrêt international. Le 16 septembre, le CNT est reconnu comme gouvernement de la Libye par l'Assemblée générale des Nations unies. À l'automne 2011, les partisans de Kadhafi tiennent encore plusieurs bastions, principalement Syrte et Bani Walid.
Le 20 octobre 2011, Syrte est la dernière ville kadhafiste à tomber aux mains des forces du Conseil national de transition. Mouhammar Kadhafi est capturé et tué le jour même.
La « libération » du pays est officiellement proclamée le 23 octobre; le même jour, le président du CNT, Moustafa Abdel Jalil, annonce que la future législation de la Libye serait fondée sur la charia. Cette déclaration ayant suscité l'inquiétude des gouvernements occidentaux, il déclare vouloir « assurer à la communauté internationale que nous, les Libyens, sommes des musulmans modérés ». Un référendum est annoncé pour approuver la future constitution. Le 22 novembre, un nouveau gouvernement, dirigé par Abdel Rahim al-Kib, est mis en place41. Kadhafi ayant laissé derrière lui un vide politique, et un pays dépourvu d'institutions réelles, d'armée structurée, et de traditions démocratiques, la Libye apparaît bientôt comme un pays très instable, en proie au désordre et à la violence.
an 2011 : Mauritanie - Durant deux mois, entre le 24 septembre et le 28 novembre 2011, le collectif "Touche pas à ma nationalité" organise plusieurs manifestations pour protester contre le recensement national.
an 2011-2021 : Ouganda - Museveni se fit réélire à nouveau en 2011 et 2016, nouveaux scrutins présidentiels après ceux de 1996, 2001, et 2006, chaque fois au premier tour, et avec des soupçons de fraude. Il fit procéder aussi à un nouveau changement de constitution fin 2017,pour supprimer la limite d'âge de 75 ans s'appliquant aux candidats à cette élection présidentielle et à lui en tout premier lieu. Il instaura également une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux et fin août 2018, fit arrêter et battre un député d'opposition, Robert Kyagulanyi Ssentamu (en), connu également comme ex-chanteur sous le nom de Bobi Wine. Libéré, celui-ci se fit soigner aux États-Unis avant de revenir en Ouganda en septembre 2018 et d'être à nouveau inculpé. Constituant l'un des leaders de l'opposition ougandaise, Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine, affrontera le président sortant Yoweri Museveni, qui est au pouvoir depuis 1986, lors des élections présidentielles qui se tient le 14 janvier 2021, Yoweri Museveni est réélu.
an 2011 : Sénégal - Février 2011 : Dakar rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran, accusé d’avoir livré des armes aux rebelles indépendantistes de Casamance, où la recrudescence de la violence depuis fin décembre 2010 a causé la mort d’au moins seize soldats sénégalais.
Juin 2011 : face à la fronde de la rue, Abdoulaye Wade renonce à une réforme constitutionnelle qui prévoyait de faire élire un ticket présidentiel, au premier tour, avec 25% seulement des suffrages exprimés. On le soupçonnait de vouloir assurer sa réélection et de préparer la succession pour son fils Karim.
an 2011 : Seychelles - L'élection présidentielle de mai 2011 voit la réélection du président Michel qui remporte 55,4 % des suffrages exprimés, contre 41,4 % à Wavel Ramkalawan. Il se présente une troisième et dernière fois à l'élection présidentielle de 2015, remportant le scrutin avec 50,15 % des suffrages exprimés contre 49,85 % à son adversaire, Wavel Ramkalawan. Mais il est contraint d'attendre le second tour de l'élection, alors qu'il avait été élu dès le premier tour aux élections précédentes.
an 2011-2017 : Somalie - En octobre 2011, l'armée kényane, appuyée par les troupes somaliennes, intervient dans le conflit, lançant l'opération Linda Nchi (« protéger le pays » en swahili) contre les positions d'Al-Shabaab.
Les relations entre la Somalie et la Turquie (en) contribuent à la relative stabilisation du pays. La Turquie, qui fournit une aide humanitaire et économique importante depuis 2011, ouvre une base militaire à Mogadiscio en septembre 2017
an 2011 : Soudan - En 2011, le Sud du Soudan accède à son indépendance sous le nom de Soudan du Sud. Mais en 2012, Le conflit au Kordofan du Sud s'envenime.
an 2011 : Tchad - Jusqu'en 2011, le Tchad alimentait un flux migratoire important vers la Libye : on estime qu'au moins 500 000 Tchadiens vivaient dans ce pays en 2006. Les échanges transsahariens assuraient une relative prospérité à des villes frontalières comme Abéché. Cependant, depuis la première guerre civile libyenne en 2011, l'instabilité de ce pays rend ces échanges aléatoires ; la frontière entre la Libye et le Tchad est devenue une zone de non-droit dominée par les contrebandiers et les groupes armés.
an 2011 : Tunisie - Après la révolution et l'élection de l'Assemblée constituante, celle-ci vote une loi constituante le 10 décembre 2011 ; le nouveau texte indique dans son article 9 que le candidat à la présidence doit être musulman, de nationalité tunisienne uniquement, issu de parents tunisiens et âgé d'au moins 35 ans ; il doit démissionner, une fois élu, de toute responsabilité à l'Assemblée constituante et au sein de son parti.
an 2011 - 2014 : Zambie - À la suite de la dégradation de l'état de santé de Mwanawasa, le vice-président Rupiah Banda assure l'intérim. Après la mort du président en août 2008, Banda est élu quatrième président du pays et le reste jusqu'en septembre 2011. Le chef de l'opposition Michael Sata lui succède, et devient le cinquième président de la Zambie. Il décède à son tour, à la suite d'une maladie à Londres le 28 octobre 2014.
an 2012 : Afrique du Sud - Le massacre de Marikana en 2012, où la police tire sur des salariés grévistes faisant des dizaines de morts, entache la gouvernance de l'ANC au sein de son électorat mais lors des élections générales sud-africaines de 2014.
an 2012-2013 : République de Centrafrique - En décembre 2012, le pays est à nouveau dans une situation insurrectionnelle. Une coalition rebelle prenant le nom de Séléka (Alliance en langue sango) s'est constituée contre le régime de Bozizé. Réunissant au moins trois mouvements préexistants, cette coalition, qui dispose de troupes bien armées et disciplinées, a pris le contrôle de la ville diamantifère de Bria le 18 décembre, avant de progresser rapidement vers la capitale. Le président Bozizé espéra un temps obtenir un soutien militaire de la France ou des États-Unis, mais ces deux pays choisissent de ne pas intervenir.
Les rebelles dénoncent la non-tenue des accords par le président Bozizé, et reprennent les armes fin 2012, lançant une série d'attaques démarrant la deuxième guerre civile centrafricaine. Le 24 mars 2013, les rebelles de la coalition Seleka s'emparent de Bangui et Bozizé s'enfuit. Michel Djotodia s’auto-proclame président de la République centrafricaine. Mais les nombreuses exactions commises par les miliciens de la Seleka, majoritairement musulmans, amènent l'insécurité dans le pays, et des milices d'auto-défense, les anti-balaka se forment. Le conflit débouche sur une situation « pré-génocidaire » selon la France et les États-Unis. Le 5 décembre 2013, une résolution de l'ONU permet à la France d'envoyer des troupes armées en République centrafricaine (opération Sangaris) aux fins annoncées de désamorcer le conflit et de protéger les civils.
an 2012-2013 : Égypte - En juin 2012, Mohamed Morsi remporte l'élection présidentielle et devient ainsi le premier président du pays élu au suffrage universel dans une élection libre. Un an après son arrivée au pouvoir, le président Morsi est massivement contesté par l'opposition qui regroupe diverses factions entre laïcs de gauche, anciens partisans du régime de Moubarak et différents groupes révolutionnaires, dont Tamarod (Rebellion). Une grande partie de la population reproche au nouveau président une dérive dictatoriale et une politique menée dans le seul intérêt de son organisation, les Frères musulmans. Après des rassemblements massifs dans tout le pays, l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Sissi, lance un dernier ultimatum le 1er juillet 2013. Celui-ci est rejeté le lendemain par Mohamed Morsi qui défend sa légitimité en soulignant qu'il a été élu démocratiquement, avec 52 % des voix. Cependant, selon des observateurs, l'ultimatum a été lancé dès le mois d'avril 2013, par la coalition des opposants, alors que la situation économique était au plus mal.
an 2012 : Ghana - À la suite du décès du président en exercice le 24 juillet 2012, le vice-président John Dramani Mahama lui succède à la tête de l’État
an 2012 : Guinée-Bissau - Le 12 avril 2012, un coup d'État mené par l'armée dépose le premier ministre Carlos Gomes Júnior dans le contexte d'une élection présidentielle contestée. La CEDEAO et la CPLP prennent des positions fortes contre ce coup d'état et examinent les possibilités d'intervention politique et militaire. L'Union africaine suspend la Guinée-Bissau le 17 avril 2012. Mamadu Ture Kuruma devient de facto le dirigeant du pays. Manuel Serifo Nhamadjo, président de l'Assemblée nationale populaire, devient président de la République par intérim.
an 2012 : Libye - Le 7 juillet 2012, la Libye organise l'élection du Congrès général national, premier scrutin démocratique de son histoire. Elle se déroule dans un climat de tensions, les milices fédéralistes de Cyrénaïque se montrant hostiles au pouvoir central de Tripoli. Parmi les nombreux partis politiques formés après la chute de Kadhafi, les islamistes apparaissent comme les grands perdants du premier scrutin : l'avantage revient aux libéraux, et notamment à l'Alliance des forces nationales dirigé par Mahmoud Jibril, qui n'a cependant pas la majorité absolue. Le Congrès général national (CGN), une assemblée de 200 membres, succède au Conseil national de transition48. Mohamed Youssef el-Megaryef, islamiste modéré et opposant de longue date à Kadhafi, est élu en août président du CGN, soit chef de l'État par intérim ; en octobre, le diplomate Ali Zeidan, ancien porte-parole du CNT, devient chef du gouvernement. Le climat de violence ne cesse pas pour autant en Libye :
le 11 septembre 2012 — anniversaire des attentats de 2001, mais également dans le contexte de l'affaire du film L'Innocence des musulmans — le consulat des États-Unis à Benghazi est attaqué par un groupe armé. Quatre Américains sont tués, dont l'ambassadeur J. Christopher Stevens.
an 2012-2014 : Malawi - Conformément à la Constitution, la vice-présidente Joyce Banda est officiellement investie présidente du Malawi le 7 avril 2012 à la suite du décès de Bingu wa Mutharika. Ses premières décisions politiques la démarquent de son prédécesseur. Elle s'efforce notamment de restaurer les bonnes relations du Malawi avec les pays développés afin que l'aide internationale reprenne pleinement, notamment en revenant sur des décisions monétaires et, dans le domaine social, en dépénalisant les actes homosexuels.
an 2012 : Mauritanie - En mars 2012, Abdallah al-Senoussi, le beau-frère de Mouammar Kadhafi et ancien chef des renseignements militaires libyens recherché par la Cour pénale internationale est arrêté à Nouakchott. Il est finalement remis aux autorités libyennes, six mois plus tard, après de longues tractations. Le premier ministre libyen Ali Zeidan accuse la Mauritanie d'avoir exigé un paiement de 200 millions de dollars en échange de l'extradition Abdallah al-Senoussi.
Le 12 octobre 2012, le président Mohamed Ould Abdelaziz est blessé par balle par une patrouille militaire. Il est évacué vers la France pour y être soigné à l'hôpital Percy-Clamart près de Paris.
Situation sanitaire et humanitaire
Depuis 2012, près de 60.000 réfugiés peuls, touaregs et arabes venus du Mali, fuyant les violences des groupes jihadistes ou de l’armée malienne, ont élu domicile dans le camp de Mbera, en Mauritanie. Leur accès à l'eau potable est précaire.
an 2012 : Sénégal - Janvier 2012 : le Conseil constitutionnel se prononce pour une nouvelle candidature, jugée anticonstitutionnelle par ses opposants, du chef de l’Etat à la présidentielle de février. Il rejette la candidature du chanteur Youssou N’Dour. Cette décision provoque la colère de l’opposition.
25 mars 2012 : L’ex-premier ministre Macky Sall devient le nouveau chef de l’État sénégalais en battant au second tour de la présidentielle son rival Abdoulaye Wade qui a reconnu sa défaite avant même les résultats officiels d’un scrutin qui s’est déroulé pacifiquement.
“Mes chers compatriotes, à l’issue du second tour de scrutin de dimanche, les résultats en cours indiquent que M. Macky Sall a remporté la victoire“, a déclaré le président Wade, selon un communiqué diffusé dans la soirée par la présidence.
“Comme je l’avais toujours promis, je l’ai donc appelé dès la soirée du 25 mars au téléphone pour le féliciter“, a expliqué le chef de l’État sortant.
“Ce soir, un résultat est sorti des urnes, le grand vainqueur reste le peuple sénégalais“, a déclaré de son côté Macky Sall lors d’une conférence de presse dans la nuit dans un grand hôtel de la capitale. “Je serai le président de tous les Sénégalais“, a-t-il promis, remerciant notamment le président Wade pour son appel téléphonique.
27 mars 2012 : Macky Sall est le vainqueur de l’élection présidentielle avec 65,80% des suffrages, selon les résultats officiels provisoires annoncés par la Commission nationale de recensement des votes. Le président sortant Abdoulaye Wade obtient, lui, 34,20% des voix. Le taux de participation est à 55% des inscrits, toujours selon les mêmes résultats officiels provisoires.
Résultats officiels mardi 27 ou mercredi 28. “Ce soir une ère nouvelle commence pour le Sénégal”, s’est félicité le vainqueur du scrutin, qui lui aussi a salué la maturité des électeurs et de la démocratie sénégalaise. “L’ampleur de cette victoire aux allures de plébiscite exprime l’immensité des attentes de la population, j’en prends toute la mesure. Ensemble, nous allons nous atteler au travail“, a-t-il conclu. “C’est encore une preuve de la maturité du peuple sénégalais et de la classe politique“, a commenté le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), chargée de superviser le scrutin.
Macky Sall prendra ses fonctions le 1er avril 2012.
3 avril 2012 : Le président Macky Sall nomme Abdoul Mbaye Premier ministre. Chef d’entreprise et banquier de formation, 59 ans, Abdoul Mbaye doit former le nouveau gouvernement du Sénégal sans dépasser les 25 personnes. La nomination de M. Mbaye a été précédée du premier discours à la nation de Macky Sall qui a dit vouloir un règlement pacifique du conflit casamançais qui dure depuis près de trente ans.
an 2012 : Sierra Leone - Ernest Bai Koroma, principal opposant, candidat du Congrès de tout le peuple (APC), ex-parti unique écarté du pouvoir depuis quinze ans, succède à Ahmad Tejan Kabbah, battant au second tour son adversaire, Solomon Berewa, vice-président et candidat du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) avec 54,6 % des suffrages. Il est réélu pour un deuxième et dernier mandat le 17 novembre 2012 en remportant 58,7 % des suffrages contre 37,4 % pour son adversaire, le général Julius Maada Bio, brièvement chef de l'État en 1996. Il a maintenu la paix, amélioré le réseau routier et la fourniture en électricité, même si celle-ci reste déficiente. Pour autant, le pays reste un des plus pauvres d'Afrique, malgré ses mines de diamant.
an 2013 : République de Centrafrique - Face au risque de génocide, la France annonce, le 26 novembre 2013, l'envoi d'un millier de soldats pour rétablir la sécurité dans le pays. Le 5 décembre 2013, par la résolution 2127, le conseil de sécurité des Nations unies autorise le « déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) pour une période de 12 mois » officiellement pour mettre fin à la « faillite totale de l'ordre public, l'absence de l'état de droit et les tensions interconfessionnelles ». La MISCA est appuyée par des forces françaises (opération Sangaris), autorisées à prendre « toutes les mesures nécessaires ».
an 2013 : Congo Kinshasa - Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise appuyée par une brigade d'intervention de l'ONU chasse les rebelles du M23 des dernières positions qu'ils occupaient dans les montagnes du Nord-Kivu, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda, les rebelles déposent les armes et dissolvent leur mouvement en décembre 2013 dans un traité de paix signé à Nairobi.
an 2013-2014 : Afrique République de Djibouti - En 2013, les élections législatives aboutissent à une grave crise électorale et une répression du régime contre l'Union pour le salut national (USN), coalition des sept partis djiboutiens d'opposition. Elle aboutit à la signature entre cette dernière et le gouvernement d'un accord-cadre politique le 30 décembre 2014. Les dix députés de l'opposition qui commencent à siéger peu de temps après sont les premiers depuis l’indépendance.
an 2013-2013 : Égypte - Mohamed Morsi est remplacé par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Adli Mansour, qui prête serment comme président par intérim. Le 4 juillet 2013, on apprend que Mohamed Morsi est détenu par l'armée et que des mandats d'arrêt sont émis à l'encontre des dirigeants des Frères musulmans. Le 5 juillet 2013, le Parlement est dissous. Le 26 juillet 2013, l'armée déclare que Mohamed Morsi est en prison dans l'attente de son procès pour collusion avec le mouvement palestinien du Hamas.
Fin 2013, le nouveau pouvoir militaire est à son tour la cible de contestations, notamment à cause de la répression de manifestations et de l'arrestation d'activistes démocrates.
an 2013 : Gambie - Alors qu'elle en est membre depuis 1965, la Gambie, par la voix de son ministre de l'Intérieur, annonce le 2 octobre 2013 son retrait du Commonwealth. Le pays refuse les injonctions du Royaume-Uni au sujet des droits de l'homme alors que le régime du président Yahya Jammeh se fait plus autoritaire et accuse l'organisation d'être néo-coloniale.
an 2013 : Kenya - Pour la première fois des débats présidentiels télévisés sont organisés les 11 et 25 février 2013. Également, pour la première fois, certains bureaux de vote sont équipés pour transmettre électroniquement les résultats vers la commission indépendante IEBC chargée de comptabiliser les résultats des élections générales.
Huit candidats ont posé leur candidature lors de l'élection présidentielle du 4 mars 2013. Pour l'emporter au premier tour, un candidat doit réunir au moins 25 % des votes dans au moins 24 comtés différents et 50 % de l'ensemble des votes plus un (majorité absolue).
Depuis la première élection présidentielle multipartisme de 1992, l'appartenance d'un candidat à tel ou tel groupe tribal a toujours été un élément important dans le choix des électeurs. Uhuru Kenyatta avec son colistier William Ruto sont respectivement kikuyu et kalenjin (premier et quatrième groupe tribal du pays) alors que son adversaire Raila Odinga et son colistier Kalonzo Musyoka sont luo et kamba (troisième et cinquième groupe). Uhuru Kenyatta est déclaré vainqueur dès le premier tour de l'élection du 4 mars 2013 avec 50,07 % des suffrages devant Raila Odinga avec 43,31 %. Ce dernier conteste les élections et, conformément à la possibilité donnée par l'article 140.1 de la Constitution, dépose, en date du 16 mars 2013 une pétition à la Cour suprême pour contester la validité du scrutin présidentiel arguant des bourrages d'urnes, les dysfonctionnements du système électronique de transmission vers l'IEBC et l'inorganisation de cette dernière. La Cour rend son jugement le 30 mars suivant en déclarant que « l'élection générale fut libre et impartiale » et que « Uhuru et son colistier Ruto ont été valablement élus » et en publie la version intégrale le 16 avril.
Présidence de Uhuru Kenyatta
Uhuru Kenyatta est investi en tant que 4e président du Kenya le 9 avril 2013 au centre sportif international Moi de Kasarani (Nairobi).
D'emblée, il s'oppose à la demande des députés d'obtenir une augmentation de 60 % de leur salaire29 et réduit le nombre de ministères et secrétariats d’État, de quarante-deux sous la présidence de son prédécesseur, à dix-huit30. Cinq femmes deviennent ministres31 dont deux à des postes très importants comme Amina Mohamed aux Affaires étrangères et Raychelle Omano à la Défense.
Lors de son discours prononcé lors du Madaraka Day (célébration de l'autonomie du pays au 1er juin 1963) du 1er juin 2013, il réaffirme la teneur de la Constitution à propos de la gouvernance des comtés, rappelle les huit anciens commissaires provinciaux vers d'autres fonctions et met, ainsi, fin aux dissensions entre les gouverneurs et les commissaires.
L'organisation État islamique et les chebabs multiplient les attaques au Kenya dans les années 2010, mettant en échec la politique sécuritaire du gouvernement. À ces attaques, s'ajoute une instabilité politique interne dans les mois qui précèdent les élections générales d'août 2017. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, est finalement réélu et affiche un score électoral de 54,28 % des suffrages exprimés. Son rival Raila Odinga parle de fraudes. Des émeutes éclatent avant un appel au calme par l'opposant Raila Odinga, qui s'en remet à la Cour suprême. Celle-ci, à la surprise générale, lui donne cette fois raison et invalide les élections, qui sont réorganisés en octobre 2017. Cette décision montre une consolidation des contre-pouvoirs au Kenya à la suite de la constitution de 2010. Uhuru Kenyatta fait procéder à des modifications de la loi électorale avant ce nouveau scrutin, ce qui provoque le retrait de Raila Odinga, qui appelle au boycott de l'élection. Finalement, le président sortant Uhuru Kenyatta remporte le nouveau scrutin avec 98,26 % des voix, mais la participation le 26 octobre 2017 n'est que de 38,8 % des électeurs inscrits, à comparer à 79 % le 8 août 2017, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême. Le 13 mai 2021, le projet de réforme constitutionnelle de Uhuru Kenyatta est jugé illégal. Le 20 août 2021, La Cour d'appel du Kenya a confirmé l'illégalité du processus de révision constitutionnelle lancé par le président Uhuru Kenyatta mettant fin définitivement à ce projet de révision constitutionnelle.
an 2013 : Libye - En mai 2013, sous la pression des milices révolutionnaires, le parlement libyen adopte une loi dite de « bannissement politique », excluant de toute fonction officielle les personnes ayant occupé des responsabilités, à un moment ou à un autre, sous le régime de Kadhafi. Le radicalisme de cette loi, qui frappe de fait une grande partie des dirigeants libyens, provoque une crise politique et plusieurs démissions, privant la Libye d'un personnel politique expérimenté. Le président du Congrès général national Mohamed Youssef el-Megaryef, qui avait été ambassadeur sous Kadhafi avant de rejoindre la dissidence, est contraint de quitter ses fonctions. Fin juin, Nouri Bousahmein est élu président du GNC. Le premier ministre Ali Zeidan a quant à lui le plus grand mal à imposer son autorité face aux différents chefs de milices, qui tiennent notamment les champs pétroliers de Cyrénaïque, avec le soutien des tribus : en octobre 2013, il est séquestré quelques heures par un groupe armé, avant d'être relâché. En novembre 2013, des rebelles autonomistes proclament en Cyrénaïque un gouvernement, défiant celui de Tripoli qu'ils disent aux mains des islamistes.
an 2013 - 2018 : Madagascar - L’élection présidentielle malgache de 2013 fait de Hery Rajaonarimampianina le président de la IVe république et son Premier ministre est Roger Kolo. Mais Hery Rajaonarimampianina, qui remporte cette élection considérée par les observateurs comme démocratique, dispose alors du soutien politique d'Andry Rajoelina, avec qui il est conduit à prendre progressivement ses distances. Le nouveau président manque dès lors de soutien politique tout en étant confronté à une ploutocratie aux commandes du pays. La crise politique est doublée d'une crise économique persistante. Le 14 janvier 2015, le général de brigade aérienne Jean Ravelonarivo est nommé Premier ministre en remplacement de Roger Kolo. En mai 2015, le président est destitué par l’Assemblée nationale, mais la décision est ensuite annulée par la justice malgache. Olivier Mahafaly Solonandrasana remplace Jean Ravelonarivo le 10 avril 2016, mais pour calmer le pays en proie aux émeutes, il est contraint à la démission et remplacé par Christian Ntsay le 4 juin 2018. Les élections de décembre 2018 portent au pouvoir pour 5 ans Andry Rajoelina. Celui-ci remporte également les élections législatives de mai 2019 et obtient la majoprité absolue à l'Assemblée nationale.
an 2013 : Mauritanie - Le 18 février 2013, les forces armées mauritaniennes annoncent le début d'exercices militaires dans le sud-est du pays avec la participation de dix-neuf pays européens, africains et arabes.
En 2013, les élections législatives de novembre et décembre confortent la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale.
an 2013-2015 : Nigéria - En 2013, le Nigeria devient aussi la première économie d'Afrique, avec un Produit intérieur brut de 510 milliards de dollars, dépassant l'Afrique du Sud, même si ce dernier pays reste en tête en termes de PIB par habitant.
À la suite de l'élection présidentielle de 2015, Muhammadu Buhari est élu. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine du Nigéria qu'une transition à la tête de l'État se fait de façon démocratique.
an 2013-2019 : Somalie - Le 11 janvier 2013, l'armée française lance une opération militaire afin de libérer l'otage Denis Allex de la DGSE détenu par les Al-Shabbaab à Buulo Mareer depuis 2009 mais celle-ci s'avérera être un échec.
Le groupe terroriste Harakat al-Chabab al-Moudjahidin multiplie les attaques depuis 2008, et notamment en 2019 : en juillet, contre un hôtel de Kismaayo, puis sur la route d’accès à l’aéroport de Mogadiscio et quelques jours plus tard contre la mairie de Mogadiscio, contre un hôtel de hôtel à Mogadiscio le 10 décembre 2019 puis le 28 décembre sur un poste de contrôle à l'entrée de Mogadiscio (cette dernière attaque faisant 81 morts).
Outre le terrorisme, les Somaliens sont victimes de la violence d’État de certains pays de la région. Ainsi, 42 réfugiés sont tués en mars 2017 dans une attaque aérienne saoudienne sur la mer Rouge.
Les Nations unies estiment que 1,7 million de personnes manquent de nourriture à cause de la sécheresse en mai 2019, et que leur nombre va augmenter d'un demi-million d'ici à juillet. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont contraintes d'abandonner leur foyer pour tenter de trouver de la nourriture, venant ainsi s'ajouter aux 2,6 millions de personnes déjà déplacées dans le pays du fait de la sécheresse et de la guerre.
an 2013-2015 : Togo - En 2013, de nouvelles élections législatives sont organisées. Le parti Unir obtient 62 sièges sur 91 soit la majorité absolue. L'ANC devient le premier parti de l'opposition avec 19 sièges. Un regroupement des principaux partis d'opposition (le Combat pour l'alternance politique) dénonce par avance des fraudes massives pour l'élection présidentielle de 2015.
an 2014 : Afrique du Sud - Jacob Zuma est réélu pour un second mandat, l'ANC restant nettement en tête dans l'électorat bien qu'en recul face à l'Alliance démocratique et aux Combattants pour la liberté économique de Julius Malema.
an 2014 : Algérie - Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014
an 2014 : Burkina Faso - Le 30 octobre 2014, Blaise Compaoré fait face à un soulèvement populaire contre son projet de modification de l'article 37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels, afin de se représenter en 2015. À la suite des émeutes, Blaise Compaoré quitte le pouvoir.
Le chef d'état-major des armées Honoré Traoré annonce le 31 octobre la création d'un « organe de transition », chargé des pouvoirs exécutif et législatif, dont l'objectif est un retour à l'ordre constitutionnel « dans un délai de douze mois ». Le 1er novembre 2014, l'armée publie un communiqué qui affirme son soutien à Isaac Zida comme président de transition. Honoré Traoré en est un des signataires, ce qui implique son renoncement au pouvoir. Le 17 novembre 2014, le diplomate Michel Kafando est nommé président de transition. Il nomme Isaac Zida Premier ministre.
an 2014-2018 : Afrique du Sud - Jacob Zuma est, en 2014, réélu pour un second mandat avec Cyril Ramaphosa comme vice-président. Il ne peut achever son second mandat et est poussé par son parti à la démission en février 2018.
La presse dresse alors un bilan négatif de ses deux mandats marqués par de multiples scandales de corruption, des accusations de prévarication, un échec aux élections municipales sud-africaines de 2016, marquées par un recul de l'ANC dans les métropoles et une popularité en berne affectant son parti.
an 2014-2015 : Algérie - L'attentat du 19 avril 2014 contre l'Armée nationale populaire (ANP) entraîne la mort de 11 militaires, celle du 17 juillet 2015 la mort de 11 à 13 soldats
an 2014 : République de Centrafrique - Le 10 janvier 2014, le président de la transition centrafricaine Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaye annoncent leur démission lors d'un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).
Le 20 janvier 2014, le Conseil national de transition de la République centrafricaine élit Catherine Samba-Panza comme chef de l'État de transition de la République centrafricaine. Au printemps 2014, trois journalistes sont tués, dont la française Camille Lepage, sur fond de sanctions de l'ONU.
Le 23 juillet 2014, les belligérants signent un accord de cessation des hostilités à Brazzaville. En dépit de cet accord, le pays est divisé en régions contrôlées par des milices, « sur lesquelles ni l’État ni la mission de l’ONU n’ont prise ».
an 2014 : République de Djibouti - En mai 2014, le pays est victime d'un attentat suicide dans le restaurant La Chaumière. Selon les informations, deux ou trois kamikazes (dont une femme) se seraient fait exploser en entrant dans le restaurant. Un mort, un ressortissant turc, a été recensé, et plusieurs blessés, dont des coopérants français présents dans le restaurant, ainsi qu'une jeune femme originaire des Pays-Bas. L'un des kamikazes n'a pas pu entrer dans le restaurant. Il s'est jeté sur la terrasse en déclenchant sa ceinture explosive.
2014 - 2030 : Égypte - En mai 2014, Abdel Fattah al-Sissi, déjà considéré comme le dirigeant de fait de l'Égypte, remporte l'élection présidentielle. Il est réélu pour un deuxième mandat en 2018. Par une révision constitutionnelle validée par un référendum en avril 2019, il se donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Il impose une logique autoritaire, réprime toute opposition et toute voix critique , et met sous contrôle les médias et la justice. La répression touche notamment des médias, des blogueurs, des journalistes, dont des personnalités féminines comme Israa Abdel Fattah ou Solafa Magdy.
La population égyptienne dépasse les cent millions d’habitants en février 2020. Elle progresse d’un million supplémentaire tous les six mois. Le taux de fécondité est passé de 5,3 enfants par femme en 1980 à 3 en 2008, puis est remonté à 3,5 en 2014. A titre de comparaison, l’Iran connaît un taux de fécondité de 1,8 enfants par femme et la Tunisie de 2,2. Cette croissance de la population égyptienne intervient de plus sur une bande de terre limitée essentiellement à la vallée du Nil et à son delta, représentant moins de 5% de la superficie d’un pays relativement désertique. La proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté semble un élément déterminant. Les Égyptiens les plus pauvres, ne disposant pas d'aide publique adaptée, veulent s'appuyer sur leur progéniture pour assurer leur besoins quotidiens.
Par ailleurs, l'armée égyptienne semble perdre progressivement le contrôle de la péninsule du Sinaï face à la guérilla jihadiste, une branche locale de l'État islamique.
an 2014 : Gambie - Le 30 décembre 2014, une autre tentative de coup d’État a lieu en Gambie pendant que Jammeh est à Dubaï. Il accuse fortement les puissances occidentales d’avoir aidé des terroristes pour le renverser. La répression et les accusations arbitraires s'accentuent.
an 2014-2015 : Guinée - En 2014 et 2015, le pays est touché par l'épidémie Ebola mais se mobilise pour en contenir les impacts.
an 2014 : Guinée-Bissau - En 2014, José Mário Vaz remporte l'élection présidentielle du 13 avril 2014, marquant le retour progressif à la légalité constitutionnelle. Pour autant, l'instabilité persiste, et les premiers ministres se succèdent.
an 2014 : Leshoto - Le Lesotho demeure l'un des pays les plus pauvres du monde : en 2014, l'indice de développement humain (IDH) le classe au 162e rang sur 187 pays.
an 2014 : Libéria - En 2014, le Liberia, avec ses voisins la Guinée et la Sierra Leone, est touché par une épidémie de maladie à virus Ebola, qui désorganise sérieusement la vie du pays. Cette épidémie fait des milliers de morts.
an 2014 : Libye - Le 20 février 2014, sans passion et au milieu d'épisodes de violences, les Libyens élisent leur assemblée constituante. Le scrutin se déroule dans un contexte d'instabilité politique persistante, alors que le gouvernement d'Ali Zeidan, qui tente de poser les bases d'un État, est de plus en plus discrédité. Le Congrès général national provoque également le mécontentement de la population et de la classe politique en prolongeant son mandat d'un an, jusqu'en décembre 2014, et en laissant à un futur parlement, dont la date n'est toujours pas décidée, la tâche de décider de la nature d'une élection présidentielle. Minoritaires au Congrès, les islamistes gagnent cependant en influence dans l'assemblée et accaparent de plus en plus de pouvoir, laissant peu de marge de manœuvre au gouvernement. Un bras de fer oppose le premier ministre au Congrès général national jusqu'en mars 2014, date à laquelle le Congrès démet par un vote le chef du gouvernement : les islamistes se débarrassent ainsi d'un de leurs principaux adversaires. Abdallah al-Thani assure l'intérim après le départ de Zeidan. La Libye n'a alors toujours pas réussi à former d'armée ou de police réellement professionnels, laissant en grande partie le terrain à diverses factions armées et des ex-chefs rebelles.
Le 30 mars, le Congrès général national décide de laisser la place à une Chambre des représentants, qui devra être élue en juin. Le 4 mai, le Congrès général national élit Ahmed Miitig au poste de premier ministre : la validité de cette élection est aussitôt contestée, les rebelles autonomistes de l'Est annonçant quant à eux qu'ils refusent de reconnaître ce gouvernement. Le général Khalifa Haftar, chef d'état-major de l'Armée nationale libyenne, défie ouvertement le Congrès général national dominé par les islamistes, exigeant sa dissolution et la mise en place d'un « Conseil présidentiel » pour mieux assurer l'autorité de l'État. Les 16 et 18 mai, des forces loyales à Haftar attaquent des milices à Benghazi, puis le siège du CGN à Tripoli, faisant plusieurs dizaines de morts60. En juin, la justice invalide l'élection de Miitig ; Abdallah al-Thani revient alors à la tête du gouvernement. Les élections législatives se déroulent le 25 juin : 12 des 200 sièges du nouveau parlement ne sont pas pourvus, les votes ayant été annulés dans diverses localités en raison des violences. Le Parti de la justice et de la construction, proche des islamistes, est nettement minoritaire.
L'instabilité persiste ensuite en Libye, qui s'avère incapable de construire un véritable pouvoir central et de mettre un terme au désordre et à la violence dans le pays, où les milices continuent de s'arroger un pouvoir de fait. En juillet 2014, la mission de l'ONU évacue son personnel après des affrontements à Tripoli et Benghazi, qui font plusieurs victimes. Toujours en juillet, la milice de Misrata alliée à des groupes islamistes affronte la milice de Zenten alliée à d'anciens soutiens de Khadafi pour le contrôle de l'aéroport de Tripoli, tandis que d'autres groupes combattent en Cyrénaïque pour le contrôle des ressources pétrolières.
Après les élections, la passation de pouvoir entre le Congrès général national et la nouvelle Chambre des représentants est annulée : le nouveau parlement, boycotté par les élus islamistes et présidé par Aguila Salah Issa, tient sa session inaugurale à Tobrouk. Fin août, la coalition « Aube de la Libye » (Fajr Libya) formée par les groupes islamistes, prend le contrôle de Tripoli et reforme le Congrès général national : Nouri Bousahmein est réélu au poste qu'il occupait avant les élections, tandis qu'Omar al-Hassi devient le nouveau premier ministre. L'Égypte et les Émirats arabes unis mènent des bombardements répétés sur la capitale libyenne.
an 2014 : Malawi - En mai 2014, Joyce Banda perd l'élection présidentielle, au profit du frère de Bingu wa Mutharika, Peter Mutharika. Le pays, comme d'autres en Afrique australe, est confronté à des phénomènes climatiques difficiles, alternant sécheresse et inondations, dont les effets sont aggravés par la déforestation, mais connait une croissance de son PIB. Peter Mutharika est réélu pour un deuxième mandat lors de l’élection présidentielle de 2019, dans un scrutin serré. L'opposition dénonce des résultats frauduleux. Le 3 février 2020, la cour constitutionnelle, constatant des irrégularités, annule l'élection.
an 2014 : Mali - Interventions de troupes françaises (opération Serval puis Barkhane)
Cette opération Serval semble être un succès dans un premiers temps : les villes ont été reprises ainsi que le territoire du nord du pays, un dialogue est rétabli avec les différentes composantes Touareg et l’État malien est stabilisé. Mais Al-Qaida au Maghreb islamique change d'approche,et se reconstitue. L'organisation procède désormais par des incursions ponctuelles et par des attentats, et le maintien sur place des troupes françaises et africaines, dans l'organisation initiale de ces forces, se révèle coûteux. Il est décidé de substituer l’opération Barkhane à l'opération Serval, pour sécuriser la bande sahélo-saharienne, avec la mission de lutter contre les groupes djihadistes et d’empêcher la constitution de sanctuaires terroristes dont le quartier-général semble établi à N’Djamena. Le nouveau dispositif est officiellement lancée le 1er août 2014.
an 2014 : Mauritanie - Le 2 février 2014, le Premier ministre Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf, en poste depuis le début du mandat du président Aziz, présente la démission de son gouvernement. Il est reconduit dans ses fonctions dès le lendemain et chargé de former un nouveau gouvernement qui compte onze nouvelles personnalités dont cinq femmes.
Le 21 mai 2014, les ministres de l'Intérieur du groupe des Cinq du Sahel, dont fait partie la Mauritanie, créent une « plateforme de coopération sécuritaire » destinée notamment à « lutter contre le terrorisme » à Nouakchott.
Le 4 juin 2014, des milliers de sympathisants manifestent à Nouakchott contre le mode d'organisation des élections présidentielles à l'appel du Forum national pour la démocratie et l'unité (FNDU, opposition radicale).
Mohamed Ould Abdel Aziz remporte une victoire écrasante et attendue à la présidentielle le 21 juin 2014, et recueille 81,94% des suffrages, avec un taux de participation de 56,55%. Investi le 2 août pour son second mandat, il nomme comme Premier ministre Yahya Ould Hademine, ancien ministre de l'Equipement et des Transports du précédent gouvernement.
Le 3 novembre 2014, le responsable du parti islamiste modéré Tewassoul Elhacen Ould Mohamed est nommé à la tête de l'opposition démocratique.
Le 25 décembre 2014, pour la première fois depuis son indépendance, une condamnation à mort pour apostasie est prononcée en Mauritanie à Nouadhibou (au nord-ouest du pays) à l'encontre d'un citoyen mauritanien musulman, inculpé après avoir publié sur internet un texte considéré comme blasphématoire. Le 21 avril 2015, la peine de mort est confirmée pour le blogueur Mohamed Cheikh ould Mkheitir, qui est détenu depuis janvier 2014 pour un article jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. Le 31 janvier 2017 la Cour suprême renvoie devant une autre cour d'appel le dossier de Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir, le blogueur condamné à mort pour apostasie et emprisonné depuis 3 ans. Il est libéré le 29 juillet 2019 et ne cesse de dénoncer les discriminations ethniques et sociales en Mauritanie.
Esclavage
Le 6 mars 2014, avec l'appui de l'ONU, la Mauritanie adopte un plan pour l'éradication de l'esclavage.
En novembre 2014, les autorités mauritaniennes ferme le siège de l'IRA, une ONG anti-esclavagiste qu'elles accusent de propager la haine entre les populations.
Situation sanitaire et humanitaire
Le 24 octobre 2014, le gouvernement annonce le renforcement des contrôles de sa frontière avec le Mali à la suite de l'annonce du premier cas d'Ebola dans ce pays.
an 2014 : Mozambique - Le 15 octobre 2014, le FRELIMO propose un nouveau candidat à l'élection présidentielle, Filipe Nyusi qui est élu au premier tour, au cours d’un scrutin parsemé de fraudes et contesté par l’opposition, comme chaque fois. Afonso Dhlakama, chef du RENAMO, principale force d'opposition, double cependant son score de 2009, et réunit 37 % des suffrages exprimés. La situation post-électorale est tendue et le RENAMO semble pendant quelques mois reprendre une insurrection militaire, comme pendant les heures noires de la guerre civile qui a duré de 1976 à 1992.
an 2014 : Namibie - En 2014 a lieu l'Élection présidentielle namibienne de 2014, Elle est remportée par le candidat de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO), Hage Geingob, avec 86,73 % des suffrages.
an 2014 : Nigéria - L'année 2014 est marquée par la montée en puissance du groupe, qui kidnappe notamment plus de 200 lycéennes, provoquant des réactions d'indignations mondiales.
an 2014-2015 : Sierra Leone - Le pays est touché par l'épidémie d’Ebola en 2014 et 2015, qui fait 4 000 morts, et, en 2017, par des inondations meurtrières.
an 2014 : Tunisie - L'article 37 de la loi électorale, votée en application de l'article 74 de la Constitution de 2014, permet à tout électeur de confession musulmane, âgé d'au moins 35 ans et jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance de se présenter à l'élection présidentielle ; il doit présenter, s'il est titulaire d'une autre nationalité, un engagement stipulant l'abandon de son autre nationalité en cas d'élection. L'article 38 de la même loi exige que le candidat soit parrainé par dix élus de l'Assemblée des représentants du peuple ou par 10 000 électeurs, tout en stipulant qu'il est interdit au même parrain de parrainer plus d'un candidat. L'article 39 exige enfin le dépôt d'une caution de 10 000 dinars auprès du trésor public, qui est restituée au candidat s'il obtient plus de 3 % des suffrages exprimés.
L'Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de statuer et de fixer la liste des candidatures approuvées dans un délai de quatre jours à compter de la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures ; toute décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.
an 2015 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - la présidence Kaboré (2015-2022). - Des élections sont prévues initialement en octobre 2015, pour passer de cette période de transition à un fonctionnement démocratique stabilisé. Mais une tentative de coup d'état, (qualifié par des burkinabés de « coup d'état le plus bête du monde ») retarde l'échéance prévue pour cette consultation électorale.
Le 16 septembre 2015, en effet, le président de transition, le premier ministre et quelques membres du gouvernement sont pris en otages par des troupes armées, le Régiment de sécurité présidentielle, sous les ordres du général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Comparé. Des manifestations sont réprimées. Finalement, les autorités de transition sont rétablies, et le fameux régiment de sécurité présidentielle est désarmé fin septembre 2015. Les élections ont lieu en novembre 2015.
Le 30 novembre 2015, à la suite des élections présidentielles et législatives, Roch Marc Christian Kaboré (MPP) est élu au premier tour président du Burkina Faso avec 53,49 % des voix devant Zéphirin Diabré (UPC), qui récolte 29,65 % des voix, les douze autres candidats se partageant le reste. Il est le deuxième président civil depuis l'accès à l'indépendance du Burkina Faso après Maurice Yaméogo.
Depuis 2016, le Burkina Faso est touché par un certain nombre d'attaques menées par des groupes armés djihadistes : le 15 janvier 2016 ont lieu les attentats de Ouagadougou, des hommes armés attaquent le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ces lieux sont fréquentés principalement par des occidentaux. L'attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fait 30 morts. En août 2017, une autre attaque djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou. Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste visant l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou fait 8 morts, tous des militaires et plus de 80 blessés (civils et militaires). Cette attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
an 2015 : Burundi - Pierre Nkurunziza décide de briguer un troisième mandat à la présidence de la République et s'impose en avril comme le candidat du pouvoir pour l'élection présidentielle du 26 juin 2015. Cette décision est contraire à la constitution du Burundi, promulguée en mars 2005. Sa candidature est néanmoins validée par une décision controversée de la Cour constitutionnelle.
Le 13 mai 2015, Pierre Nkurunziza, en déplacement, est victime d'une tentative de coup d'État de la part du général Godefroid Niyombare.
Le 15 mai, après de violents combats dans le centre-ville de Bujumbura, les putschistes annoncent leur reddition et le pouvoir indique le retour imminent du président Nkurunziza. Les jours qui suivent voient une répression sanglante de l'opposition de la part du président. Cette répression fait des centaines morts et provoque des départs massifs : des centaines de milliers de burandais se réfugient à l'extérieur du pays . Après plusieurs reports, l'élection présidentielle, jugée illégale et truquée par tous les observateurs de la politique burundaise, se tient finalement le
21 juillet. Le 24 juillet, la commission électorale nationale indépendante proclame Nkurunziza vainqueur avec 69,41 % des suffrages.
.
an 2015-2016 : République de Centrafrique - Une élection présidentielle est organisée en décembre 2015 et janvier 2016. Faustin-Archange Touadéra arrive deuxième du premier tour avec 19 % des voix, derrière son opposant, Anicet-Georges Dologuélé qui arrive en tête avec 23,7 %. Il est finalement élu président de la République à l'issue du deuxième tour, avec 62,7 % des suffrages contre 37,3 % à Anicet-Georges Dologuélé. Ce nouveau président de la République lance un processus de réconciliation nationale afin de rendre justice aux victimes des guerres civiles, la plupart déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pour ce faire, il charge par décret son ministre conseiller, Regina Konzi Mongot, d'élaborer le Programme national de réconciliation nationale et de paix, proposé en décembre 2016, adopté en séance tenante à l'unanimité par les organismes internationaux.
an 2015 : Congo Brazzaville - En 2015, Denis Sassou-Nguesso organise une série de consultations avec des personnalités politiques du pays afin d’examiner une possible modification de la constitution en vigueur dans le pays depuis 2002. La démarche est vivement critiquée par une partie de l’opposition qui y voit une manœuvre afin de pouvoir se présenter une troisième fois à la présidence de la République (la Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels à deux et l’âge pour se présenter à la présidence de la République à 70 ans). La majorité assure de son côté souhaiter renforcer les institutions du pays en passant d’un régime présidentiel à un régime semi-parlementaire.
Le 25 octobre 2015, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Elle entre en vigueur le 6 novembre 2015, après sa promulgation par Denis Sassou-Nguesso.
an 2015-2017 : Congo Kinshasa - En 2015, des tensions apparaissent dans la perspective de l'élection présidentielle de 2016 et d'un éventuel prolongement de mandat de Joseph Kabila. L'article 70 de la Constitution du pays, datée de 2006, dispose que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Prétextant un délai supplémentaire de seize mois et un jour pour finaliser l’enregistrement des 30 millions d’électeurs, la commission électorale a annoncé le 20 août 2016, que l'élection présidentielle ne pouvait pas se dérouler avant juillet 2017. Le 19 septembre 2016, lors d’un rassemblement à Kinshasa contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, au moins dix-sept personnes sont mortes (3 policiers et 14 civils) durant la manifestation. Après la crise de confiance dans les institutions résultant de cette décision, des mouvements insurrectionnels sont signalés dans différentes provinces : milice Kamwina Napsu dans le Kasaï central, Bundu dia Kongo dans le Kongo central, Pygmées contre Bantous dans le Tanganyika, réactivation du M23. L'économie pâtit de la situation, et le phénomène des enfants soldats est en recrudescence.
Le 11 octobre 2017, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Corneille Nangaa, annonce que le scrutin pour remplacer Joseph Kabila ne pourra pas avoir lieu avant 504 jours, en raison du recensement encore en cours dans les régions du Kasaï, jusqu'en décembre 2017, puis de l’audit du fichier électoral par les experts, de l’élaboration de la loi portant répartition des sièges au parlement et de plusieurs autres opérations techniques et logistiques nécessaires avant la tenue des élections, prévue au premier semestre 2019. Ce nouveau report des élections suscite l'indignation de l'opposition, ainsi que nombre d'ONG.
an 2015-2016 : Afrique Côte d'Ivoire - À la suite de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015, le président Ouattara est réélu pour cinq ans. Il souhaite consolider les efforts de réconciliation nationale et rédiger une nouvelle Constitution. Cette nouvelle Constitution, qui entraine la création d'un sénat et d'un poste de vice-président, est approuvée par référendum le 30 octobre 2016. La troisième République Ivoirienne est proclamée le 8 novembre 2016.
an 2015 : Guinée - Le 11 octobre 2015, le président Alpha Condé obtient 58 % des suffrages et est réélu au premier tour de l'élection présidentielle pour un nouveau mandat de 5 ans.
an 2015 : Libye - Le gouvernement de Tobrouk — seul à être reconnu par la communauté internationale — et celui de Tripoli se disputent dès lors le pouvoir, en même temps que le contrôle des puits de pétrole, tandis que le pays entier est en proie à la violence et aux affrontements de groupes armés, tribaux ou djihadistes. La déliquescence de la Libye contribue à faire du pays l'une des principales zones de transit de l'immigration clandestine à destination de l'Europe. Par ailleurs, à la faveur du chaos politique, l'État islamique s'implante en Libye et lance des attaques, notamment à Misrata et à Syrte. L'ONU s'efforce d'amener les belligérants libyens à s'unir pour contrer l'État islamique. Le 10 juillet 2015, le gouvernement de Tobrouk signe finalement avec une partie des groupes armés un accord de paix proposé par l’ONU : celui de Tripoli rejette au contraire le texte et n'envoie pas de délégation à la signature.
an 2015 : Mauritanie - Le 28 janvier 2015 débute une grève de 9 semaines affectant les sites de production et d'exportation de la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM). Les revendications portent sur des augmentations de salaire. Après 9 semaines de grève la reprise du travail se déroule le 3 avril à la suite de l'ouverture de négociations et de la réintégration de grévistes licenciés.
Le 6 aout 2015, un islamiste malien, ancien porte-parole d'Ansar Dine, un groupe lié à Al Qaïda, et visé par un mandat d'arrêt international l'accusant de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, meurtre et actes terroristes est libéré par la Mauritanie, où il était détenu depuis plusieurs mois.
Le 2 septembre 2015, un remaniement ministériel remercie huit ministres, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Equipement.
Le 17 novembre 2015, la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM) ouvre un nouveau complexe minier sur le site de Zouerate, dans le nord du pays. Dénommé Guelb II, c'est le plus important projet industriel de l’histoire de la Mauritanie, dans lequel près d’un milliard de dollars ont été investis.
Le 10 février la présidence annonce un nouveau remaniement et le départ de cinq ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de l'Économie.
Le 7 mai 2015 l'opposition appelle a manifester contre le projet de révision constitutionnelle annoncé par le président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui prévoit entre autres choses la suppression du Sénat. Des heurts avec les forces de l'ordre feront plusieurs blessés. Le 29 septembre 2015, après de longues négociations entre pouvoir et opposition, s'ouvre un nouveau dialogue national. L'initiative est le point de départ qui doit amener à une réforme constitutionnelle, portant notamment sur la suppression du Sénat et la création du poste de vice-président. Une partie importante de l'opposition accuse le président Mohamed Ould Abdel Aziz de vouloir modifier le texte fondamental dans le but se présenter pour un troisième mandat. Le 20 octobre 2015 un accord politique marquant la fin du dialogue national est signé entre la majorité et quelques partis d'opposition. Plusieurs révisions constitutionnelles sont retenues, mais pas la suppression de la limitation des mandats présidentiels est rejetée.
Esclavage
Le 1er juillet 2015, six militants anti-esclavage de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) sont arrêtés, marquant le début d'une série d'arrestations dans les rangs de l'IRA. Leur procès débute le 3 août 2015 et dure quinze jours à l'issue desquels la Cour criminelle condamne la plupart des accusés à des peines de prison allant de trois à huit ans. Treize d'entre eux disent avoir été torturés durant leur détention.
Le 13 août 2015, le Parlement adopte une loi durcissant la répression de l'esclavage, considéré désormais comme un « crime contre
l'humanité ».
Situation sanitaire et humanitaire
Le 9 octobre 2015, la Mauritanie alerte l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'épidémie de fièvre qui sévit dans la vallée du rift
an 2015 : Nigéria - Début 2015, Boko Haram rase plusieurs villes et villages du nord-est du pays. Cette série d'attaques pousse les voisins du Nigéria, le Tchad, le Niger et le Cameroun à intervenir contre la secte islamiste. En 2015, Boko Haram fait allégeance à l'État islamique.
an 2015 : Tchad - Depuis 2015, l'armée tchadienne est engagée dans le conflit contre le groupe djihadiste Boko Haram, répandu dans le Nord du Nigeria et du Cameroun. En représailles, ce groupe a commis plusieurs attaques en territoire tchadien.
an 2015-2020 : Togo - Faure Gnassingbé est à nouveau réélu lors de l'élection présidentielle d'avril 2015, avec 58,75 % des suffrages exprimés, contre 34,95 % pour son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Une élection jugée libre et transparente par l'UE et les principaux observateurs internationaux. L'abstention s'élève à 40,01 %, contre 35,32 % à la précédente présidentielle de 2010. Du côté de l'opposition, Tchabouré Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI), a obtenu 3,08 % des suffrages, Komandega Taama, président du Nouvel engagement togolais (NET), 1,06 %, et Mouhamed Tchassona-Traoré, président du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (MCD, opposition), 0,99 %. Il nomme Premier ministre Komi Sélom Klassou le 5 juin 2015 jusque-là premier président de l'Assemblée nationale. Faure Gnassingbé se présente pour un quatrième mandat lors des élections présidentielles de 202022. Il est reconduit et l'élection est contestée une nouvelle fois par l'opposition.
an 2015 : Zambie - Edgar Lungu est élu en 2015 pour le remplacer et terminer son mandat présidentiel. Edgar Lungu est à la tête du Front patriotique (PF) qu'il a créé en 2001 après avoir quitté le Mouvement pour la démocratie multipartite (MMD). Il est vainqueur du scrutin présidentiel, d'une courte tête.
an 2016 : Algérie - Le pays enregistre sa première grande attaque terroriste dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016. Bilan : une trentaine de morts et une centaine de blessés.
an 2016-2018 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Depuis 2016, le Burkina Faso est touché par un certain nombre d'attaques menées par des groupes armés djihadistes : le 15 janvier 2016 ont lieu les attentats de Ouagadougou, des hommes armés attaquent le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ces lieux sont fréquentés principalement par des occidentaux. L'attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fait 30 morts. En août 2017, une autre attaque djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou. Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste visant l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou fait 8 morts, tous des militaires et plus de 80 blessés (civils et militaires). Cette attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
an 2016 : Cameroun - Depuis novembre 2016, des manifestants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, majoritairement anglophones, font pression pour le maintien de l'usage de la langue anglaise dans les écoles et les tribunaux. Des personnes ont été tuées et des centaines emprisonnées à la suite de ces protestations.
an 2016 : Cap Vert - Jorge Carlos Fonseca, du MPD, est réélu Président en 2016. José Maria Neves, du PAICV, est, dans le même temps, désigné premier ministre, de 2001 à 2016. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux partis au pouvoir, et même d'une cohabitation de ces deux partis pendant certaines périodes. Il est considéré comme ayant une bonne gouvernance, avec l'une et l'autre de ces formations, même si l'économie, peu diversifiée, est dépendante à 20 % du tourisme. Cet état ne dispense pas de grandes ressources naturelles. En 2016, le MPD revient au pouvoir à la suite des législatives, et la dirigeante relativement récente du PAICV, Janira Hopffer Almada, reconnaît sa défaite sans drame. L'archipel, qui souffre du réchauffement climatique, d'autant plus que l'eau douce y est rare, a une politique de développement des énergies renouvelables9, ainsi que de l'écotourisme.
an 2016 : Congo Brazzaville - Le 20 mars 2016, après avoir fait modifier la constitution (cf. infra), Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 60,07 % des voix, score validé par la Cour constitutionnelle le 4 avril suivant.
an 2016-2019 : Gabon - Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin à cinq mille voix près. L'opposition dénonce immédiatement ces résultats. Des émeutes encore plus violemment réprimées que celles de 2009 éclatent, avec comme point d'orgue l'attaque du quartier général de l'opposition par la garde présidentielle qui fait de nombreux morts. Le 24 septembre 2016, Ali Bongo est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec 50,66 % des voix, suivi de Jean Ping avec 47,24 % des suffrages.
Le président Bongo prône le concept de « Gabon émergent », politique visant notamment à la diversification de l'économie afin de diminuer sa dépendance aux cours mondiaux du pétrole. En 2018, cela ne s'est pourtant pas concrétisé, notamment du fait de la baisse des cours du pétrole et d'investissements peu judicieux, tandis que le chômage des jeunes reste élevé.
Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin à cinq mille voix près. L'opposition dénonce immédiatement ces résultats. Des émeutes encore plus violemment réprimées que celles de 2009 éclatent, avec comme point d'orgue l'attaque du quartier général de l'opposition par la garde présidentielle qui fait de nombreux morts. Le 24 septembre 2016, Ali Bongo est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec 50,66 % des voix, suivi de Jean Ping avec 47,24 % des suffrages.
Le 2 février 2017, le Parlement européen adopte une résolution déclarant que les résultats de la présidentielle « manquent de transparence » et sont « extrêmement douteux ».
Le 7 janvier 2019, une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence après un accident vasculaire cérébral, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour ; sur cinq mutins, deux sont tués et les autres arrêtés. Le 12 janvier, un nouveau Premier ministre est nommé, Julien Nkoghe Bekalé. Le pouvoir gabonais connaît une guerre des clans au sommet. Les remaniements ministériels se succèdent entre janvier et décembre 2019, alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé d'Ali Bongo. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée première ministre en juillet 2020.
an 2016-2017 : Gambie - En décembre 2016, sept partis d'opposition choisissent un candidat unique, Adama Barrow, pour l'élection présidentielle. Adama Barrow remporte l'élection à l'unique tour de scrutin en recueillant 43,3 % des suffrages, contre le président sortant qui arrive second avec 39,6 % des suffrages. Le 17 janvier 2017, Yahya Jammeh instaure l'état d'urgence et le lendemain, le Parlement prolonge son mandat de trois mois, jusqu'au 19 avril 2017. Le 19 janvier, Adama Barrow prête serment à l'ambassade de Gambie à Dakar. Devant le refus de Yahya Jammeh de lui céder le pouvoir, malgré les injonctions de la CÉDÉAO, l'armée sénégalaise pénètre en territoire gambien dans le courant de l'après-midi. Le soir même, le chef de l'armée gambienne, le général Ousman Badjie, déclare à des ressortissants occidentaux qu'il n'ordonnera pas à ses hommes de résister en cas d’intervention des troupes africaines.
L'élection présidentielle de décembre 2016 voit Adama Barrow, candidat de l'opposition, remporter la victoire sur le président sortant13 dont le mandat court jusqu'au 18 janvier 2017. Le 19 janvier 2017, Adama Barrow prête serment dans l'ambassade gambienne à Dakar au Sénégal, après le refus du président sortant de céder le pouvoir. Le même jour, l'armée sénégalaise entre en Gambie, forte d'une résolution de l'ONU. Le 20 janvier 2017, Jammeh accepte de quitter le pouvoir, et part en exil le lendemain soir pour Conakry, avant de rejoindre la Guinée équatoriale.
an 2016 : Guinée - En juillet 2016, la Guinée est le premier pays à majorité musulmane d'Afrique à renouer ses liens diplomatiques avec Israël.
an 2016-2018 : Guinée-Bissau - Au mois de septembre 2016, le président guinéen Alpha Condé, médiateur de la crise bissau-guinéenne, et son homologue de la Sierra Leone Ernest Baï Koroma obtiennent un compromis politique signé le 10 septembre par toutes les parties : ce sont les accords de Conakry. Successivement, Umaro Sissoco Embaló en novembre 2016, puis Artur Silvafin janvier 2018, puis Aristides Gomes mi-avril 2018 sont nommés premier ministres.
an 2016 : Libye - Devant la gravité de la situation et la progression de l'EI, la communauté internationale pousse à la création d'un gouvernement unitaire. Le 12 mars 2016 Fayez el-Sarraj prend la tête d'un gouvernement « d'union nationale », formé à Tunis, initialement rejeté par les parlements de Tripoli et de Tobrouk. Grâce au soutien occidental, le gouvernement peut s'installer à Tripoli à la fin du mois. Il obtient le 23 avril le soutien de la majorité des parlementaires de Tobrouk, et s'installe progressivement dans ses fonctions.
L’Organisation internationale pour les migrations note le développement de la traite d’êtres humains dans la Libye post-kadhafiste. Selon l'organisation, de nombreux migrants sont vendus sur des « marchés aux esclaves » pour 190 à 280 euros. Ils sont égalent sujets à la malnutrition, aux violences sexuelles, voire aux meurtres.
La ville de Syrte, place forte de l’organisation Etat islamique (EI) en Afrique du Nord, est reconquise début décembre 2016 par les forces du gouvernement libyen d’union nationale de Faïez Sarraj, soutenu par les capitales occidentales et les Nations unies, stoppant les vélléités de l'EI dans ce pays.
an 2016 : Mauritanie - Torture
Le 4 février 2016, après une inspection de dix jours, Juan Ernest Mendez, le rapporteur spécial de l'ONU fait part de ses regrets quant à la non application de la loi sur la prévention et la répression de la torture, promulguée en septembre 2015. La Mauritanie est dénoncée par plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, qui rapportent de nombreux actes de tortures et de mauvais traitement infligés aux détenus lors des interrogatoires.
Le 14 novembre 2016, une plainte visant de hauts responsables mauritaniens est déposée à au tribunal de grande instance de Paris. Ils sont accusés de « tortures et de traitements cruels » à l'encontre de militants anti-esclavage.
Situation sanitaire et humanitaire
En novembre 2016, le Programme alimentaire mondial (PAM) appelle à la mobilisation de 17 millions de dollars pour faire face à la situation des réfugiés maliens qui ont fui les exactions des groupes terroristes, confrontés à une crise alimentaire.
an 2016 : Réunion (Ile de la) - la quasi-totalité des 5 300 ha de terres agricoles irriguées par l'Irrigation du Littoral Ouest est en service.
an 2016-2018 : Sao Tomé et Principe - Chef de l’Etat : M. Evaristo Carvalho, Président de la République (élu le 7 août 2016)
Chef du Gouvernement : M. Jorge Bom Jesus
L’élection présidentielle du 7 août 2016 voit Evaristo Carvalho, candidat de l’ADI (action démocratique indépendante), élu président de la République contre le président sortant Manuel Pinto da Costa. Le Président a un rôle non exécutif, d’arbitre et de représentation.
Malgré deux tentatives de coup d’Etat en 2003 et 2009, la démocratie parlementaire s’affirme et permet à plusieurs reprises une alternance entre les deux grandes forces qui animent la vie politique : l’ADI de Patrice Trovoada (fils de Miguel Trovoada, il est premier ministre de 2010 à 2012 et de 2014 à 2018) et le MLSTP de Jorge Bom Jesus.
Aux élections législatives d’octobre 2018, une coalition menée par le MLSTP l’emporte d’une très courte avance (28 sièges contre 27) et, après une courte période d’incertitude rapidement tranchée par la Cour constitutionnelle et acceptée par toutes les parties, Jorge Bom Jesus est chargé de former un gouvernement, début décembre 2018. Le gouvernement, toujours dirigé par Jorge Bom Jesus, a été remanié en septembre 2020.
an 2016 : Seychelles - À la suite de la défaite de son parti Lepep (issu de l'ancien parti unique) aux élections législatives de septembre 2016, James Michel annonce sa démission de son poste de président de la République en septembre 2016. Le 16 octobre suivant, il est remplacé par son vice-président, Danny Faure. Une période de cohabitation commence entre ce nouveau président et un Parlement contrôlé par l'opposition à l'ex-parti unique (qui était au pouvoir depuis 1977).
an 2016 : Tchad - Depuis 2016, le Tchad est confronté à un mouvement insurrectionnel dans le Nord du pays : plusieurs groupes armés d'exilés tchadiens ayant combattu dans la guerre civile libyenne reviennent en force dans leur pays d'origine.
an 2016 : Zambie - Edgar Lungu est réélu en 2016, dans un scrutin là encore serré, contre Hakainde Hichilema.
an 2017-2019 : Algérie - Bouteflika est critiqué pour ses manières autocratiques, et le chômage affecte encore plus d'un tiers de la population. En 2009, Bouteflika est réélu pour un troisième mandat après avoir fait amender la Constitution algérienne à cet effet. Victime en 2013 d'un accident vasculaire cérébral affectant son élocution et l'obligeant à se déplacer en chaise roulante, il fait en mars 2017 une apparition publique qui alimente les inquiétudes sur son état de santé. Il est alors âgé de 80 ans et des voix commencent à mettre en doute sa capacité à gouverner le pays.
Sous la pression de manifestations populaires de masse, et alors qu'il se présente pour un cinquième mandat, Abdelaziz Bouteflika démissionne le 2 avril 2019.
an 2017 : Angola - L'Angola présente un paysage de cités martyres, de provinces jadis agricoles stérilisées par la présence de millions de mines. Une bonne partie des infrastructures coloniales a été laissée à l'état de ruines (routes, ponts, aéroports, voies de chemin de fer, écoles), pendant que d'autres ont été reconstruites et même augmentées. L’agriculture et les transports ont été fortement endommagés et se trouvent en récupération lente. Malgré l’aide alimentaire, la famine sévit et le pays ne vit que de l’exportation du pétrole. Comme d’autres pays, l’Angola réclame des indemnisations et des aides financières, que le Portugal et l’Union européenne lui accordent sous forme d’aide au développement (écoles, eau potable, routes, hôpitaux) ou de visas de travail. En dépit de la guerre civile, la scolarité, certes médiocre, s'est améliorée (15 % d’enfants scolarisés en 1975, 88 % en 2005). De nombreuses missions catholiques et protestantes encadrent également les populations depuis l’indépendance. D'un point de vue politique, José Eduardo dos Santos confirme sa retraite, resté trente-sept ans de pouvoir. Il annonce début février 2017, se mettre en retrait de la politique fin 2017, après avoir, pendant 38 ans, muselé l’opposition par une répression policière, limité la liberté d'expression et imposé son autorité17. Il choisit pour lui succéder João Lourenço.
Le parti au pouvoir depuis plus de quatre décennies en Angola, le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), remporte les élections générales, en août 2017, avec plus de 64 % des suffrages. Le candidat du MPLA, Joao Lourenço, succède donc comme prévu à la tête du pays au président José Eduardo dos Santos. Les deux principaux partis dans l'opposition, l’Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (Unita) et la CASA-CE, obtiennent respectivement 24,04 % et 8,56 % des voix exprimées. Au terme de ce scrutin, le MPLA, au pouvoir depuis l’indépendance en 1975, conserve la majorité absolue des 220 sièges du Parlement18. En septembre 2018, Joao Lourenço succède également à José Eduardo dos Santos à la tête du MPLA.
an 2017-2018 : Cameroun - En 2017, le gouvernement de Biya a bloqué l'accès de ces régions à Internet pendant trois mois. En septembre, des séparatistes ont lancé une guérilla pour l'indépendance des régions anglophones en tant que République fédérale d'Ambazonie. Le gouvernement a répondu par une offensive militaire, et l'insurrection s'est étendue aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le 1er octobre 2017, Sisiku Julius Ayuk Tabe déclare symboliquement l'indépendance de la république fédérale d'Ambazonie, déclenchant une répression par les forces de l'ordre se soldant par des morts, des blessés, des émeutes, barricades, manifestations, couvre-feu, etc. En janvier 2018, le Nigéria compte entre 7 000 et 30 000 réfugiés liés au conflit et à la répression à la suite de cette déclaration d'indépendance. Le 5 janvier 2018, des membres du gouvernement intérimaire d'Ambazonie, dont le président Sisiku Julius Ayuk Tabe, sont arrêtés au Nigéria et déportés au Cameroun. Ils y sont arrêtés et passent 10 mois dans un quartier général de gendarmerie avant d’être transférés dans une prison à sécurité maximale de Yaoundé. Un procès débute en décembre 2018. Le 4 février 2018, il a été annoncé que Samuel Ikome Sako deviendrait le président par intérim de la République fédérale d'Ambazonie, succédant temporairement à Tabe. Sa présidence a vu l'escalade du conflit armé et son extension à tout le Cameroun anglophone. Le 31 décembre 2018, Ikome Sako déclare que 2019 verrait le passage d'une guerre défensive à une guerre offensive et que les séparatistes s'efforceraient d'obtenir une indépendance de facto sur le terrain. Le 20 août 2019 au matin le tribunal militaire de Yaoundé condamne Julius Ayuk Tabe et neuf autres de ses partisans à la réclusion criminelle à vie.
an 2017 : République de Centrafrique - En juin 2017, les affrontements à Bria, dans le centre-est du pays, font une centaine de morts. Par ailleurs, un comité est également mis en place afin de juger les principaux acteurs et dédommager les victimes.
an 2017 : Afrique République de Djibouti - En 2017, après les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon, la Chine obtient de pouvoir y implanter une base militaire. L'Espagne et l’Allemagne y ont aussi disposé de petits contingents.
an 2017 : Gabon - Le 2 février 2017, le Parlement européen adopte une résolution déclarant que les résultats de la présidentielle « manquent de transparence » et sont « extrêmement douteux ».
an 2017 : Ghana - Depuis 2017, Nana Akufo-Addo est président de la République.
an 2017 : Guinée-équatoriale - Le père et le fils Obiang sont poursuivis par la justice française sur des biens mal acquis, provenant notamment de détournements de fonds publics. Le fils Teodorin est finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Ce procès dit « des biens mal acquis », révélateur du pillage des richesses nationales, aboutit à une condamnation en octobre 2017, en première instance.
an 2017 : Kenya - L'organisation État islamique et les chebabs multiplient les attaques au Kenya depuis les années 2010, mettant en échec la politique sécuritaire du gouvernement. À ces attaques s'ajoute une instabilité politique interne dans les mois qui précèdent les élections générales d'août 2017. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, est finalement réélu et affiche un score électoral de 54,28 % des suffrages exprimés. Son rival Raila Odinga parle à nouveau de fraudes. Des émeutes éclatent avant un appel au calme par Raila Odinga, qui s'en remet une fois encore à la Cour suprême. Celle-ci, à la surprise générale, lui donne cette fois raison et invalide les élections, qui sont réorganisés en octobre 2017. Cette décision montre une consolidation progressive des contre-pouvoirs au Kenya à la suite de la constitution de 2010. À la suite des modifications de la loi électorale avant ce nouveau scrutin, Raila Odinga se retire et appelle au boycott de l'élection. Finalement, le président sortant Uhuru Kenyatta remporte le nouveau scrutin avec 98,26 % des voix, mais la participation le 26 octobre 2017 n'est que de 38,8 % des électeurs inscrits, à comparer à 79 % le 8 août 2017, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême.
an 2017-2022 : Lesotho - Les élections législatives de juin 2017, organisées de manière anticipées à la suite du vote d'une motion de censure à l'encontre du Premier ministre Pakalitha Mosisili après la dislocation de la coalition le soutenant, aboutissent à une alternance.
Le parti d'opposition Convention de tous les Basotho (ABC) remporte arrive en effet en tête des suffrages et remporte la majorité relative des sièges, tandis que le Congrès démocratique (DC) de Mosisili perd plus du tiers des siens. Mené par Tom Thabane, l'ABC forme un gouvernement de coalition avec trois autres partis, l'Alliance des démocrates (AD), le Parti national basotho (BNP) et le Congrès réformé du Lesotho (RCL), permettant à Thabane de devenir premier ministre.
Accusé d'avoir commandité le meurtre de son ex épouse Lipolelo Thabane deux jours avant sa prise de fonction en 2017, le Premier ministre est cependant conduit à la démission le 19 mai 2020. Remplacé le lendemain par lendemain par le ministre des Finances Moeketsi Majoro, qui prend également la tête de l'ABC, Thabane est par la suite officiellement inculpé pour meurtre fin novembre 2021.
L'organisation des législatives de 2022 est compliquée par la pandémie de Covid-19 et le manque de budget, qui pousse le gouvernement à repousser le scrutin de juin à septembre.
an 2017-2018 : Libéria - Le 26 décembre 2017, lors d'une nouvelle présidentielle; George Weah est élu avec 61,5 % des voix au suffrage universel face au vice-président sortant, Joseph Boakai, qui en obtient 38,5 %. Il met l'accent sur la lutte anticorruption et sur l'éducation. La situation économique dont hérite le nouveau président reste délicate, avec le poids de la dette sur le budget de l'État, et une inflation importante. À partir de juin 2019, l'état de grâce de George Weah est terminé : des manifestations sont organisées contre sa politique économique.
George Weah s’est fixé comme principal objectif d’améliorer la vie des Libériens grâce à la mise en œuvre d’un programme « pro-poor » qui vise les plus défavorisés. Il entend également parachever la réconciliation nationale, lutter contre la corruption, et développer les infrastructures, en particulier routières, dont le pays est largement dépourvu.
L’élection de George Weah marque par ailleurs un pas supplémentaire dans la stabilisation du pays, confirmée par le départ de la mission des Nations unies pour le Libéria (MINUL), le 30 mars 2018.
an 2017 : Mauritanie - Le 17 mars 2017, le projet de révision constitutionnelle soumis par le gouvernement est rejeté par le Sénat. Le président Aziz annonce l'organisation d'un référendum pour le 5 août 2017.
Le 6 juin 2017, la Mauritanie annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec le Qatar, et accuse le pays de propager l'extrémisme et l'anarchie dans de nombreux pays arabes.
Le référendum du 5 août 2017 donnent un «oui» qui l'emporte à plus de 85 %. Il comporte deux volets, la modification du drapeau national (85,6 % de «oui» et 9,9 % pour le «non») ainsi que la suppression du Sénat (85,6 % pour le « oui » et 10,02 % pour le « non »). Malgré le boycott de l'opposition et de la société civile, le taux de participation est de 53,75 % selon la commission électorale49. Leader des opposants à la suppression du Sénat, le sénateur d'opposition Mohamed ould Ghadde est arrêté le 10 août50. Plusieurs personnalités de l'opposition sont interrogées51. Plusieurs sénateurs, journalistes et représentants syndicaux, accusés de faits de corruption et tous opposants à la réforme constitutionnelle, comparaitront devant un juge d'instruction.
À la fin du mois d'octobre 2017, la première opération conduite par la Force antiterroriste G5 Sahel est lancée. Dénommée Hawbi, elle est constituée du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad et compte jusqu'à 5.000 hommes répartis dans sept bataillons.
Le 13 novembre 2017, le Sénat est dissout, les grilles de l’institution sont fermées et l'accès au bâtiment fermé, mais des sénateurs frondeurs forcent l'entrée et ouvrent une session parlementaire symbolique, qui ne dure en réalité que le temps que la police intervienne et déloge les élus.
Le 28 novembre 2017, le 57e anniversaire de l’indépendance est l'occasion de présenter le nouveau drapeau mauritanien ainsi que le nouvel hymne national, nouveaux emblèmes adoptés à l'issue du référendum constitutionnel du 5 août.
Esclavage
Le 28 avril 2017, la journaliste Tiphaine Gosse et la juriste Marie Foray qui enquêtent sur l'esclavage en Mauritanie sont expulsées du pays. Elles dénoncent aux côtés d'organisations engagées dans la lutte ntre l’esclavage en Mauritanie telles que SOS-Esclaves, l’AMDH et l’Association des femmes chefs de famille (AFCF) « l’hypocrisie des autorités mauritaniennes », qui cherchent selon elles par la ratification des traités internationaux et l’adoption de lois qu'elle jugent incomplètes, à plaire à la communauté internationale sans lutter pour autant contre l’esclavage dans le pays.
Le 22 juin 2017, une plainte contre l’esclavagisme et la torture en Mauritanie est déposée devant l'ONU et l'UA. L'eurodéputé Louis Michel souligne que l'esclavage continue en Mauritanie. Biram Dah Abeid, le président de l'association IRA déplore l'acharnement des autorités mauritaniennes à l'encontre des militants anti-esclavagisme.
an 2017 : Mayotte - La question de l'immigration crée aujourd'hui des tensions locales. Jusqu'à présent, les immigrés clandestins comoriens, venus chercher l'Eldorado, servaient souvent de main-d'œuvre bon marché, dans des conditions de travail proches de la condition d'esclave, pratique courante depuis des années et exercée en toute impunité par certains entrepreneurs mahorais. Aujourd'hui, alors que la politique intérieure de la France s'est resserrée et que la démographie locale ne fait qu'augmenter : la maternité de Mamoudzou enregistre le plus grand nombre annuel de naissances en France avec 7 300 bébés nés en 2014 dont 20 % des mères étaient des comoriennes non régularisées (40 % des mères de la maternité sont comoriennes) en 2017. Le désir de refouler ces clandestins vers les Comores se fait de plus en plus sentir. Aucune structure n'existe pour aider ces clandestins, aucun service social hormis la DDASS, et la coopération entre la France et les Comores reste embryonnaire sur la question de la santé, malgré la présence de coopérants français médicaux à Anjouan.
an 2017 : Mozambique - le spectre d'une nouvelle guerre civile s'éloigne début 2017. Par contre, un scandale de dettes cachées, à la fin du deuxième mandat d'Armando Guebuza, touche le FRELIMO même si le président a changé, et fragilise le pays. Des médias anglo-saxons démontrent l'existence d'emprunts contractés de façon opaque mais garantis par le gouvernement de l'époque, pour 1,8 milliard d’euros, par trois entreprises publiques. L'affectation précise des sommes reste floue, même s'il est indiqué que ces emprunts auraient financé un programme d'armement. Depuis, le Mozambique, incapable d’honorer les remboursements de ces dettes, est plongé dans une crise financière.
an 2017 : Rwanda - Une opposante, Diane Rwigara annonce son intention de se présenter à l'Élection présidentielle rwandaise de 2017. 72 heures plus tard, des photos d'elle dénudée sont divulguées, dans un but d'intimidation. Elle persiste dans sa candidature, mais cette candidature est invalidée le 7 juillet 2017, par la Commission électorale nationale. Cette candidate semble disparaître fin août 2017, puis la police rwandaise annonce son arrestation, pour atteinte à la sureté de l’État. Début octobre, elle est inculpée, ainsi que sa mère et sa sœur, d’« incitation à l’insurrection ». Elle est libérée sous caution quelques mois plus tard en signe d'apaisement, et finalement acquittée par un tribunal de Kigali le 6 décembre 2018, ainsi que les co-accusés. Selon le jugement, « les charges retenues par l’accusation sont sans fondement »
an 2018 : Afrique du Sud - Visé par des affaires de corruption, Jacob Zuma démissionne sous la pression de son parti début 2018, après avoir été menacé de destitution, et Cyril Ramaphosa lui succède comme président de la République par intérim. Le 15 février 2018, le Parlement élit formellement Cyril Ramaphosa président de la République.
Après avoir été élu président de l'ANC le 18 décembre 2017 contre Nkosazana Dlamini-Zuma (ex-femme de Jacob Zuma et ex-présidente de la commission de l'Union africaine), Cyril Ramaphosa obtient de haute lutte le 14 février 2018 la démission de Jacob Zuma de la présidence de la République. Ramaphosa lui succède comme président de la République par intérim avant d'être élu formellement par le parlement. Acculé par la gauche de l'ANC et par la surenchère des Economic Freedom Fighters (EFF), il se prononce en faveur d'une redistribution des terres aux Sud-Africains noirs afin de « panser les plaies du passé » alors que 72 % des terres agricoles restent détenues par des Blancs (personnes physiques ou sociétés commerciales) contre 85 % à la fin de l’apartheid. Le Parlement adopte alors une motion présentée par Julius Malema, le chef des EFF, visant à faire modifier la constitution sud-africaine et permettre, sans compensation financière, l'expropriation de terres agricoles. Une partie de l'opposition invoque une violation du droit de propriété, tandis que des investisseurs et le South African Institute of Race Relations déclarent craindre que cette réforme ne porte atteinte à l'agriculture commerciale et ne provoque une crise durable. En juillet 2018, le président sud-africain annonce que l'ANC compte amender la Constitution pour y faire entrer le principe d'expropriation des fermiers sans compensation, provoquant la chute de la devise nationale. Au delà des fermes, des experts sud-africains de l'Institute for Poverty, Land and Agragian Studies (Université du Cap-Occidental) et du Mapungubwe Institute for Strategic Reflection soulignent que d'autres types de propriétés pourraient être soumises au nouveau Code foncier, notamment en centre-ville (friches et terrains non exploités, bâtiments non entretenus...) ou en zone périphérique rurale (terrains miniers notamment). Mais cette réforme avance avec lenteur. Il est réélu chef de l’État le 22 mai 2019, à l’issue d’élections générales lors desquelles l’ANC obtient le plus faible score de son histoire (57,5 %), passant sous la barre des 60 % pour la première fois depuis un quart de siècle et payant ainsi les errements et les scandales de l'ère Zuma, son prédécesseur.
Il doit également faire face à une opposition interne au sein de l'ANC, avec un clan resté fidèle à Jacob Zuma, ayant à sa tête le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, et son adjointe, Jessie Duarte. Mais le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, connaît également des divisions internes : son leader, Mmusi Maimane, démissionne le 24 octobre 2019, dénonçant une « campagne de dénigrement », de « diffamation » et des « comportements de lâches », quittant à la fois la direction du parti, le parti lui-même et ses fonctions de parlementaire. Ce départ, ou cette éviction, risque de réduire à nouveau ce parti à un «parti de Blancs».
Une vague de xénophobie vis-à-vis des migrants, les «étrangers», secoue également le pays. Par ailleurs, plusieurs sociétés importantes pour l'économie africaine sont en difficulté, notamment la compagnie nationale d'électricité Eskom. Le 19 novembre 2019,au PDG est nommé pour cette entreprise, qui lance dans la foulée un nouveau plan de restructuration.
Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi.
En mars-avril 2020 il doit faire face à la pandémie mondiale de Covid-19 et obtient un certain succès.
an 2018-2019 : Bénin (anc. Dahomey) - En 2018 et 2019, des mouvements sociaux sont constatés mais ne remettent pas en cause la stabilité de la République béninoise. Par contre, une « contagion » djihadiste est constatée avec l'enlèvement de deux Français dans le parc national de la Pendjari, un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Afrique. Cet événement, même si les otages sont libérés par une intervention de forces françaises, confirme la possibilité de voir les groupes djihadistes descendre vers le golfe de Guinée au fur et à mesure de la déstabilisation du Burkina Faso, et du centre du Mali. Cela contrarie également les objectifs du président béninois, Patrice Talon, de développer le tourisme dans son pays.
an 2018-2019 : République de Botswana - Le 1er avril 2018, son vice-président, Mokgweetsi Masisi est désigné pour le remplacer comme président du Botswana. L'année suivante, en 2019, il remporte les élections générales.
an 2018-2019 : Cameroun - Paul Biya est réélu pour un septième mandat en 2018, dans un scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition. Il lance un «grand dialogue national» en 2019. Aucune avancée décisive n'en ressort sur le conflit dans les régions anglophones. Paul Biya fait libérer des détenus, mais les leaders du mouvement restent en prison.
an 2018 : République de Centrafrique - Depuis 2018, des mercenaires russes du Groupe Wagner et de la société privée Sewa Security Services (SSS) sont présents en Centrafrique, où ils participent à la formation de militaires des Forces Armées Centrafricaines (FACA) et à la protection rapprochée du Président centrafricain.
an 2018 : Congo Kinshasa - Le 30 décembre 2018, les élections ont lieu et le 10 janvier 2019, le président de la CENI, Corneille Nangaa proclame Félix Tshisekedi comme président de la république démocratique du Congo. Le président Tshisekedi prête serment le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation, résidence officielle des présidents congolais.
Félix Tshisekedi a noué une alliance de circonstance pendant la campagne électorale avec le parti de Joseph Kabila, devenu sénateur à vie et qui conserve ainsi une influence sur le pouvoir. Leur principal opposant, Martin Fayulu, donné un moment vainqueur de l'élection présidentielle, sur la base d'une fuite de données de la CENI et par la mission d’observation de l’Église catholique congolaise, est contraint de s'incliner devant le résultat annoncé, probablement truqué. La Cour constitutionnelle a rejeté son recours. Par cette alliance, Félix Tshisekedi joue aussi la stabilité et prépare la suite de son mandat en composant avec l'assemblée législative où le parti de Kabila possède 337 sièges sur 50064,65. Le 6 décembre 2020, le président met fin à la coalition avec Kabila. Les proches de ce dernier sont alors écartés et les autres politiciens rejoignent Félix Tshisekedi. Le nouvel exécutif compte 56 membres dont 14 femmes. Leur objectif sera de « lutter contre la corruption et la misère qui touche les deux tiers de la population et ramener la paix dans l’est du pays, ensanglanté par les violences des groupes armés".
2018-2019 : Égypte - En mai 2014, Abdel Fattah al-Sissi, est réélu pour un deuxième mandat.
Par une révision constitutionnelle validée par un référendum en avril 2019, il se donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Il impose un régime autoritaire, réprime toute opposition et toute voix critique, et met sous contrôle les médias et la justice.
an 2018-2019 : Eswatini (Swaziland) - En avril 2018, à l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance, le roi annonce que le pays reprend son nom d'origine d'avant la colonisation : Eswatini. En octobre 2019, la livraison de voitures de luxe flambant neuves, des Rolls Royce, à la famille royale d’Eswatini provoque des réactions négatives dans ce royaume très pauvre d’Afrique australe, alors que des fonctionnaires manifestent pour demander une revalorisation de leurs salaires.
an 2018 : Gambie - Le 8 février 2018, la Gambie adhère à nouveau au Commonwealth.
an 2018-2021 : Ghana - En 2018, cette nation est également endeuillée par la mort d'un de ses plus célèbres compatriotes, Kofi Annan. Sur le plan économique, le Ghana s'associe avec la Côte d'Ivoire, en 2019, pour obtenir des marchés un prix juste pour le cacao, en suspendant pendant quelques semaines la vente des récoltes 2020-2021. Il cherche à développer le tourisme vers ses terres au sein de la communauté afro-américaine, en mettant l'accent sur la mémoire de la traite négrière. Nana Akufo-Ado, d’inspiration libérale, mise aussi sur le développement de l’esprit d’entreprise. Il incite également la diaspora formée dans les pays occidentaux à revenir au pays, ou à y investir.
an 2018 : Guinée - D'après la Banque mondiale, en 2018, le chômage frappe 80 % des jeunes et près de 80 % de la population active travaille dans le secteur informel. Surtout, 55 % des Guinéens vivent sous le seuil de pauvreté.
an 2018 : Guinée-Bissau - Lors d'une réunion du 30 août 2018 du Conseil de sécurité de l'ONU, les signes d'une amélioration de la situation politique sont soulignés, mais il est rappelé que des points des accords de Conakry restent à réaliser : réforme constitutionnelle et réforme électorale.
an 2018-2020 : Libye - Par contre, la situation reste bloquée entre le Premier ministre Fayez el-Sarraj issu du gouvernement d'accord national (GAN) et le chef de l'Armée nationale libyenne (ANL) du Khalifa Haftar. Des médiations diplomatiques entre ces deux partis sont menées en France, en juillet 2017 à La-Celle-Saint-Cloud, en France toujours en mai 2018 au palais de l'Élysée, puis à Palerme en Italie en novembre 2018, laissant espérer la reprise d'un dialogue. Mais l'assaut militaire déclenché en avril 2019 par les troupes de l'Armée nationale libyenne (ANL) du Khalifa Haftar sur Tripoli, un assaut qui s'enlise ensuite, pulvérise à court terme les espoirs d'un règlement politique. Chacune des forces en présences, le GAN et l'ALN, multiplie les contacts et les alliances avec des puissances extérieures : notamment la Turquie pour le GAN, les Émirats arabes unis,l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Russie pour l'ALN. Une nouvelle initiative de médiation, turco-russe cette fois, pour obtenir la signature à Moscou d’un cessez-le-feu en Libye tourne court, en janvier 2020.
an 2018 - 2023 : Madagascar - Les élections de décembre 2018 portent au pouvoir pour 5 ans Andry Rajoelina. Celui-ci remporte également les élections législatives de mai 2019 et obtient la majoprité absolue à l'Assemblée nationale.
an 2018-2019 : Mali - La situation sécuritaire reste très précaire, avec de nombreuses attaques djihadistes. Les conflits communautaires persistent, occasionnant des centaines de morts, particulièrement dans la région de Mopti. En 2018, l'armée française poursuit ses opérations et particulièrement dans le Liptako Gourma, une zone entre le centre du Mali, le sud-ouest du Niger et le Burkina Faso.
Les djihadistes opèrent une guerre asymétrique : ils procèdent surtout par attaques surprises, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires. Le 23 mars 2019, des miliciens dogons font 157 morts lors du massacre d'Ogossagou, village peul situé près de Bankass, toujours dans le centre du pays. Beaucoup des victimes avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d’autres affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts en 2018 dans le centre du Mali, selon l’ONU. Les troupes françaises sont de plus en plus critiquées localement : poursuivre le combat accroît le risque d’enlisement et de compromission.
an 2018 : Mauritanie - Le premier janvier 2018, la Mauritanie change l'unité de sa monnaie. L'ouguiya passe d'une échelle de 10 à 1, dix ouguiyas deviennent un ouguiya. De nouveaux billets sont émis mais la monnaie conserve le même nom. Avant même l’annonce de la mise en circulation des nouveaux billets, la monnaie mauritanienne se déprécie au marché noir face à l’euro et au dollar, une tendance qui s'aggrave dès l'annonce officielle.
Le 20 mai 2018, le régime durcit la loi sur les partis politiques et un décret ouvre la voie à la dissolution des partis sous-représentés à l'échelle nationale et régionale.
Les élections locales et législatives du 15 septembre 2018 voient la victoire du parti au pouvoir, l'UPR, qui remporte les 13 Conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat, ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale et plus des deux tiers des communes. Le 8 octobre Cheikh ould Baya, député de l'UPR et proche du président, est élu président de l'Assemblée. Le 29 octobre 2018 Mohamed Salem Ould Bechir est nommé Premier ministre et nomme le lendemain un nouveau gouvernement.
Esclavage
Le 12 février 2018, l'ONG Human Right Watch présente à Nouakchott son rapport sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Intitulé « Ethnicité, discrimination et autres lignes rouges : répression à l’encontre de défenseurs des droits humains en Mauritanie » le rapport pointe les difficultés rencontrées par les militants traitant des questions sociales sensibles comme l'esclavage, la discrimination entre communautés ou le passif humanitaire du pays.
Le 25 mars 2018, un rapport sur la répression contre les militants des droits de l'Homme en Mauritanie est publié par Amnesty International. Le rapport avance que 43.000 personnes vivent en situation d'esclavage dans le pays. Amnesty International détaille également la façon dont les militants abolitionnistes et les associations qui dénoncent ces discriminations sont la cible des autorités108. Trois jours plus tard, la cour criminelle de Nouadhibou condamne un homme et une femme à respectivement 20 et 10 ans de prison ferme pour esclavagisme. Une première en Mauritanie.
Le 4 novembre 2018, les États-Unis, constatant le manque de progrès du pays en matière de lutte contre l'esclavage, suspendent la Mauritanie de l'AGOA.
Situation sanitaire et humanitaire
Le 26 juin 2018, la Mauritanie alerte sur des cas de malnutrution sévères touchant plusieurs dizaines d’enfants dans l’est du pays. La région du Hod Ech Chargui, non loin de la frontière avec le Mali, est particulièrement touchée.
En juin 2018, un rapport de l’ONU établi que les trois quarts des mauritaniens vivent dans une extrême pauvreté. Présenté durant la 35e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU par le rapporteur spécial Philip Alston, le rapport pointe les difficultés dans l'accès à l'eau, à l'alimentation, à l'éducation et à la santé de la population.
En décembre 2018, grâce à un don chinois, la capitale Nouakchott se dote d'un véritable réseau d'assainissement, absent jusqu'ici
an 2018-2020 : Nigéria - Entre 2011 et 2018, le bilan humain de ce violent conflit a été estimé à 37 530 morts.
Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest prend également part à l'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria. En août 2018, Mamman Nour, le numéro 2 de l'organisation, accusé d'être trop modéré, est assassiné par d'autres membres de l'EIAO et les partisans d'une ligne plus dure reprennent le dessus. Le groupe s'en prend alors de plus en plus aux civils. Le 26 décembre 2019, le groupe diffuse notamment une vidéo montrant l'exécution par balles de 11 chrétiens.
En novembre 2020, au moins 110 civils sont tués par des jihadistes présumés dans l'État de Borno sans que le massacre ne soit revendiqué par l'un des deux groupes.
an 2018 : Sierra Leone - En 2018, le pays connaît une nouvelle alternance politique entre les deux principaux partis. Le candidat de l’opposition, Julius Maada Bio, ancien militaire de 53 ans, remporte les présidentielles avec 51,81 % des voix, contre 48,19 % pour Samura Kamara, le candidat du parti précédemment au pouvoir, le Congrès de tout le peuple (APC)
an 2018 : Soudan - En 2018, le régime applique en 2018 un plan d'austérité du Fonds monétaire international, transférant certains secteurs des importations au secteur privé. En conséquence, le prix du pain est doublé et celui de l’essence augmente de 30 %. L’inflation atteint les 40 %. Des mouvements étudiants et le Parti communiste soudanais organisent des manifestations pour contester cette politique. Omar el-Bechir réagit en faisant arrêter le secrétaire général du Parti communiste et deux autres dirigeants du parti, et par la fermeture de six journaux.
an 2019 : Afrique du Sud - Cyril Ramaphosa est réélu chef de l’État le 22 mai 2019, à l’issue d’élections générales lors desquelles l’ANC obtient le plus faible score de son histoire (57,5 %), passant sous la barre des 60 % pour la première fois depuis un quart de siècle et payant ainsi les errements et les scandales de l'ère Zuma, son prédécesseur.
Il doit également faire face à une opposition interne au sein de l'ANC, avec un clan resté fidèle à Jacob Zuma, ayant à sa tête le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, et son adjointe, Jessie Duarte. Une vague de xénophobie vis-à-vis les migrants, les « étrangers », secoue également le pays.
an 2019-2022 : Algérie - Depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika et l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, le pays est dirigé par le président Abdelmadjid Tebboune.
an 2019 : Bénin (anc. Dahomey) - En décembre 2019, l’annonce, par le président ivoirien Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron, de la fin du franc CFA pour les huit pays de la CEDEAO, au profit de l'Eco est diversement qualifiée. Décision historique pour certains, d'autres la qualifient d’« arnaque » et de « poudre aux yeux ». Une parité fixe est maintenue pour la future monnaie avec l’euro
an 2019 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - - Dans la nuit du 3 au 4 février 2019, un groupe terroriste attaque la ville de Kaïn dans le département du même nom, au nord de la province du Yatenga. Le bilan est de 14 morts civils. L'armée réagit rapidement, avec des actions contre les groupes terroristes dans le nord-ouest du pays, déclarant avoir alors « neutralisé » 146 terroristes. À la veille du début de l'année de la présidence par le pays du G5 Sahel, l'attaque terroriste porte à près de 300 le nombre d'habitants assassinés par ces groupes depuis 201541. Le jour inaugural du G5 Sahel, mardi 5 février, un détachement de la gendarmerie est attaqué à Oursi, cinq militaires meurent, contre selon l'armée, 21 assaillants tués lors de l'attaque. L'insécurité croissante a entrainé la multiplication des milices. En 2020, le pays compterait près de 4 500 groupes de koglweogo, mobilisant entre 20 000 et 45 000 membres.
Pour faire face au crime organisé (attaques à main armée dans les lieux de travail et habitations, vols d'animaux et autres formes de violences ciblant notamment les populations rurales et périurbaines), des groupes d'autodéfense se sont constitués au sein de certaines communautés. Dénommés « koglwéogo », ils sont indépendants vis-à-vis de l'État, ne rendent comptes à personne. Ils agissent hors de tout cadre légal. Ils ont localement fait reculer la délinquance, mais des exactions commises par certains de leurs membres créent une nouvelle source d'insécurité et de péril pour les droits humains, et affaiblissent encore le système judiciaire légal (déjà critiqué pour son inefficacité par la population et les médias). Au sein de koglwéogo qui, sous prétexte d'une réponse citoyenne à la crise sécuritaire, « s'arrogent le droit d'arrêter, de juger et de sanctionner, par des amendes, sévices corporels et humiliations, au terme de tribunaux populaires expéditifs », de graves violences (torture notamment) sont observées. « De présumés voleurs sont ligotés au pied d'un arbre, fouettés avec des branches enflammées de tamarinier, le tout en public, et ce jusqu'à ce qu'ils avouent leur crime », bafouant les droits humains via une justice expéditive. Selon Amnesty international, « les Koglwéogo ont commis des exactions, telles que des passages à tabac et des enlèvements, poussant ainsi des organisations de la société civile à reprocher à l’État de ne pas agir suffisamment pour empêcher ces violences et y remédier ; une levée de boucliers qui avait amené l'Etat à condamner en septembre 2016 Koglwéogo à 6 mois d'emprisonnement, et 26 autres à des peines allant de 10 à 12 mois de prison avec sursis. Les 29 et 30 mai 2020, plusieurs attaques djihadistes ont fait une cinquantaine de morts à Kompienga48. Dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, une nouvelle attaque djihadiste tue plus de 160 personnes dont « une vingtaine d'enfants » à Solhan, un village situé au nord-est du pays. C'est l'attaque la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso depuis le début des assauts djihadistes, en 2015. En six ans, les violences ont déjà fait plusieurs milliers de morts, plus particulièrement dans les zones proches des frontières avec le Mali et le Niger
an 2019 : Afrique - Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa, Président d'Afrique du Sud, prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi
an 2019 : Cameroun - En 2019, les combats entre les guérillas séparatistes et les forces gouvernementales se poursuivent.
an 2019 : République de Centrafrique - Le 6 février 2019, l'État centrafricain signe avec les 14 principaux groupes armés du pays un nouvel accord de paix négocié en janvier à Khartoum (Soudan). Malgré cet accord, 80 % du territoire restent contrôlés par des groupes armés et les massacres de populations civiles continuent.
an 2019-2020 : Gabon - Le 7 janvier 2019, une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence après un accident vasculaire cérébral, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour ; sur cinq mutins, deux sont tués et les autres arrêtés. Le 12 janvier, un nouveau Premier ministre est nommé, Julien Nkoghe Bekalé. Le pouvoir gabonais connaît une guerre des clans au sommet. Les remaniements ministériels se succèdent entre janvier et décembre 2019, alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé d'Ali Bongo. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée première ministre en juillet 2020.
an 2019 : Gambie - Le 27 août 2019, Dawda Jawara décède, il avait était premier Premier ministre de Gambie entre 1962 et 1970, puis le premier président de la République de Gambie de 1970 à 1994.
an 2019 : Guinée-Bissau - élection présidentielle de fin 2019 voit la défaite du candidat de l'ex-parti unique, au pouvoir depuis 1974, le PAIGC, et la victoire d'Umaro Sissoco Embaló, ancien général et ancien Premier ministre devenu opposant. La confirmation de ce résultat est compliquée, donnant lieu à des allers et retours entre la Commission électorale et la Cour suprême (saisie par le PAIGC), mais c'est la première transition politique qui s'effectue pacifiquement.
an 2019 : Guinée équatoriale - La population de Guinée équatoriale vit dans des conditions précaires. Bata, seconde ville du pays et capitale économique, a été ainsi privée d'eau courante pendant trois semaines en 2019, sans que les autorités s'expliquent sur les difficultés rencontrées.
an 2019 : Mali - Les djihadistes opèrent une guerre asymétrique : ils procèdent surtout par attaques surprises, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires. Le 23 mars 2019, des miliciens dogons font 157 morts lors du massacre d'Ogossagou, village peul situé près de Bankass, toujours dans le centre du pays. Beaucoup des victimes avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d’autres affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts en 2018 dans le centre du Mali, selon l’ONU. Les troupes françaises sont de plus en plus critiquées localement : poursuivre le combat accroît le risque d’enlisement et de compromission.
an 2019 : Iles Maurice - À la lignée des Ramgoolam succède celle des Jugnauth. Pravind Jugnauth remporte les législatives de 2019.
Le 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution demandant au Royaume-Uni de rétrocéder sous six mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos. Ce délai a pris fin le 22 novembre 2019, sans que le Royaume-Uni se conforme à cette résolution, ni à l'avis consultatif formulé en février par la Cour internationale de justice (CIJ) demandant à Londres de mettre fin « dans les plus brefs délais » à son administration des Chagos.
an 2019 : Mauritanie - Le 28 janvier 2019, un projet de loi est voté autorisant un accord de coopération entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite en matière de lutte contre le trafic d'armes et d'êtres humains. L’opposition mauritanienne crie au scandale, pointant le manque de crédibilité du royaume wahhabite en matière du respect des droits de l’homme.
Le 5 mars 2019, à trois mois de la présidentielle, 76 partis politiques sont dissous par décret rendu public par le ministre mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation. Le 9 mai, six candidatures à la présidentielle du 22 juin 2019 sont validées par le Conseil constitutionnel.
Le 20 mai, une série de nominations faites en conseil des ministres dans les semaines qui précèdent l'élection présidentielle sont dénoncées par plusieurs candidats.
Le 1er juillet 2019, la victoire du général Mohamed Ould Ghazouani dès le premier tour, avec 52 % des voix, est proclamée par le Conseil constitutionnel mauritanien, dans un climat délétère, avec une coupure prolongée d'internet et un déploiement des unités d’élite de l’armée, de la garde et de la police anti-émeute dans toute la capitale, Nouakchott. L'opposition dénonce de multiples irrégularités dans le déroulement du scrutin et qualifie la déclaration de victoire du candidat du pouvoir le soir du premier tour de «nouveau coup d'État».
Le 8 août 2019, le président Ghazouani nomme son premier gouvernement, dirigé par le premier ministre désigné le 3 août, Ismael Ould Bodé Ould Cheikh Sidiya.
Le 19 mars 2019, la police mauritanienne refoule une délégation d'Amnesty International à son arrivée à l'aéroport de Nouakchott
Le 22 mars 2019, les blogueurs Abderrahmane Weddady et Cheikh Ould Jiddou, connus pour dénoncer les atteintes aux droits de l'Homme en Mauritanie sont emprisonnés. Amnesty International explique qu'« Ils ont critiqué la corruption qui régnerait au sein du gouvernement dans des commentaires sur Facebook ». Les deux blogueurs avaient repris sur leurs blogs des articles publiés par des médias arabes faisant état d’un placement présumé de deux milliards de dollars aux Émirats arabes unis par un proche du chef de l’État. Amnesty International qualifie par ailleurs leur détention d’illégale. D'autres ONG comme Reporters Sans Frontières et Human Right Watch dénonceront à leur tour l'arrestation des deux blogueurs.
Le 5 juillet 2019, une vingtaine de journalistes manifestent devant le ministère la Communication et demandent la libération de leur confrère Ahmed Ould Wedia, interpellé chez lui trois jours auparavant.
En mai 2019, la France et la Mauritanie signent un accord de financement d'un montant de 4,4 milliards d'ouguiyas (11 millions d'euros), afin de financer des projets hydrauliques destinés à améliorer les conditions de vie de la population.
Esclavage
Le 28 janvier 2019, un projet de loi est voté autorisant un accord de coopération entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite en matière de lutte contre le trafic d'armes et d'êtres humains. L’opposition mauritanienne crie au scandale, pointant le manque de crédibilité du royaume wahhabite en matière du respect des droits de l’homme.
Les séquelles de l'esclavage touchent particulièrement la population Haratine, qui faute d'accès à l'éducation concentre 85 % des analphabètes du pays
Situation sanitaire et humanitaire
En mai 2019, la France et la Mauritanie signent un accord de financement d'un montant de 4,4 milliards d'ouguiyas (11 millions d'euros), afin de financer des projets hydrauliques destinés à améliorer les conditions de vie de la population.
an 2019 : Mozambique - Le président Filipe Nyusi est réélu en octobre 2019 pour un deuxième mandat de cinq ans avec 73 % des suffrages. Son parti, le FRELIMO, remporte 184 des 250 sièges à l’Assemblée nationale et dirige l’ensemble des dix provinces du pays. Ce scrutin a été manipulé comme les précédents pour en garantir le résultat : redécoupage de la carte électorale pour gonfler l’importance des bastions du pouvoir, mise à disposition constante des moyens de l’Etat pour la campagne du parti au pouvoir, tracasseries pour les opposants, usage de la violence, etc., le FRELIMO montre une volonté d’hégémonie. Ceci pose aussi la question d’un processus de paix jamais arrivé à son terme depuis le premier accord avec l’ancienne rébellion de la Résistance nationale mozambicaine (RENAMO), en 1992. Ossufo Momade a été le candidat de la RENAMO, mouvement affaibli par la mort de son chef historique, Afonso Dhlakama, en 2018.
Le Mozambique peut devenir l'un des grands producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, avec d'importantes réserves, et devient à ce titre un pays courtisé. Les ressources en gaz naturel devraient être exploitées en particulier dans la province de Cabo Delgado d’ici à cinq ans. Total, notamment, a finalisé son entrée fin septembre 2019 dans l’un des deux projets majeurs, Mozambique LNG.
an 2019 : Namibie - En 2019 a lieu L'élection présidentielle namibienne de 2019, en même temps que les élections législatives. Le président sortant Hage Geingob, de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (abrégée en SWAPO) est réélu avec un score, en baisse, de 56 % des suffrages. La SWAPO est au pouvoir depuis 1990. La participation au scrutin présidentiel a été de 60 %. Les autres candidats ont été Panduleni Itula, candidat dissident de la SWAPO qui obtient 30 % des suffrages. Il est en tête dans la capitale du pays. Le chef de l’opposition, McHenry Venaani, ne récolte que 5,4 %. La proximité passée de son parti, le Mouvement démocratique populaire (PDM) (ex-Alliance démocratique de la Turnhalle), avec le régime de l'apartheid en Afrique du Sud de l’apartheid, continue à être un repoussoir pour une grande part de l’électorat. Un nouveau parti d’opposition émerge, le Mouvement des sans-terre (LPM) de Bernadus Swartbooi : Bernadus Swartbooi réunit 2,8 % des suffarges exprimés.
La SWAPO est critiquée pour des scandales de corruption et ses résultats politiques sont affectés aussi par la situation économique et l'importance du chômage. Le secteur minier reste important. Mais la chute des cours des matières premières a réduit les recettes. Par ailleurs, une sécheresse persistante depuis plusieurs saisons a contribué aussi à faire reculer le produit intérieur brut (PIB) deux ans de suite, en 2017 et en 2018. « Les moyens de subsistance d’une majorité de Namibiens sont menacés, notamment ceux qui dépendent des activités de l’agriculture », n'a pu que déplorer la première ministre Saara Kuugongelwa-Amadhila. Le chômage touche un tiers de la population.
an 2019 : Soudan - En 2019, un vaste mouvement de protestation contre le régime se forme dans les villes de l’extrême nord du pays, en particulier autour d'Atbara, agglomération ouvrière et fief du syndicalisme soudanais. Les manifestants réclament initialement de meilleures conditions de vie (plus de vingt millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté), puis, alors que la répression s’accentue, la démission du président.
Le 11 avril 2019, Omar el-Bechir est renversé par l'armée. Le ministre de la Défense Ahmed Awad Ibn Auf annonce la mise en place d'un gouvernement de transition pour deux ans jusqu'à de nouvelles élections libres.
Le 12 avril 2019, au lendemain de la destitution du président, le Conseil militaire de transition déclare que le futur gouvernement sera un gouvernement civil en promettant un dialogue entre l'armée et les politiciens soudanais. L'armée entame alors des discussions avec les autorités civiles d'opposition et les organisations représentant les manifestants. Le 3 juin 2019, alors que les négociations piétinent et que les manifestants campent devant le QG de l'armée depuis près de deux mois, l'armée et la milice des Forces de soutien rapide tirent sur la foule pour tenter de déloger les manifestants causant un massacre. Le 4 juin 2019, le chef du Conseil militaire de transition, Abdel Fatah al-Burhan, annonce la fin des négociations avec les civils et promet la tenue d'élections d'ici 9 mois.
Le 21 août, à la suite d'un accord, le Conseil militaire de transition devient le Conseil de souveraineté. Il maintient les président et vice-président sortants en place mais dispose de membres civils. Abdallah Hamdok est nommé Premier ministre. Il annonce la composition d'un gouvernement de transition début septembre 2019, un gouvernement composé de dix-huit membres dont quatre femmes, notamment Asma Mohamed Abdallah une diplomate expérimentée qui devient ministre des affaires étrangères : « La première priorité du gouvernement de transition est de mettre un terme à la guerre et de construire une paix durable », est-il précisé, faisant référence aux conflits et rébellions qui pèsent sur le Darfour, le Nil Bleu et le Kordofan du Sud.
an 2020 : UNION AFRICAINE - Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud, prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi.
an 2020 : Burundi - La situation économique continue à se dégrader. Début 2020, le général Évariste Ndayishimiye est désigné comme candidat pour l’élection présidentielle du 20 mai 2020 par le parti au pouvoir, pour succéder à Pierre Nkurunziza. Il remporte l'élection présidentielle du 20 mai 2020, en obtenant 68,72 % des voix et devance très largement le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, président du Conseil national pour la liberté (CNL), qui réunit 24,19 % des voix.
an 2020 : Cameroun - Au cours de l'année 2020, de nombreuses attaques terroristes - dont beaucoup ont été menées sans revendication - et les représailles du gouvernement ont fait couler le sang dans tout le pays. Depuis 2016, plus de 450 000 personnes ont fui leurs foyers. Le conflit a indirectement conduit à une recrudescence des attaques de Boko Haram, l'armée camerounaise s'étant largement retirée du nord pour se concentrer sur la lutte contre les séparatistes ambazoniens. Paul Biya est réélu pour un septième mandat en 2018, dans un scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition. Il lance un « grand dialogue national », mais aucune avancée décisive n'en ressort sur le conflit dans les régions anglophones. Paul Biya fait libérer des détenus, mais les leaders du mouvement restent en prison.
Les élections législatives et municipales du 9 février 2020 entraînent un regain de violence dans les régions anglophones du Cameroun, autour de la tentative d'indépendance de l'Ambazonie. Les groupes armés séparatistes promettent des représailles à ceux qui iraient voter, en réaction le gouvernement central du Cameroun augmente ses effectifs militaires dans la zone. Dans les deux semaines précédant les élections, selon Human Rights Watch, les rebelles séparatistes enlèvent plus d'une centaine de personnes dans les deux régions anglophones, tandis que les forces de sécurité commettent de nombreux abus de pouvoir. Le 7 février 2020, c'est depuis sa cellule à la prison centrale de Yaoundé que Sisiku Julius Ayuk Tabe, président du gouvernement intérimaire d’Ambazonie, déclare, qu’ils sont plus que jamais engagés dans une indépendance totale ou une résistance à jamais.
Les violences se poursuivent après les élections. Ainsi, le 16 février 2020, 22 civils dont 14 enfants et 1 femme enceinte sont massacrés à Ntumbaw, un village du Nord-Ouest. l'opposition camerounaise (surtout le Mouvement pour la renaissance du Cameroun) et les ONG locales accusent l'Armée et le gouvernement d'avoir perpétré le massacre, dans un contexte de répression de la tentative de sécession de l'Ambazonie.
Le 21 avril 2020, le régime camerounais admet sa responsabilité, expliquant que l'Armée et un groupe d'autodéfense allié avaient attaqué des indépendantistes, tuant 5 d'entre-eux, puis s'étaient rendus compte que leur assaut avait également tué accidentellement les femmes et les enfants, et avaient alors décidé de déclencher l'incendie pour tenter de masquer leurs faits.
Le 2 juillet 2020, déjà très impliquée lors de la tenue des assises du « grand dialogue national », l'Église catholique a de nouveau joué les facilitateurs lors de la récente prise de contact entre les séparatistes anglophones emprisonnés à Yaoundé et des émissaires du gouvernement. C'est d'ailleurs au centre épiscopal de Mvolyé, dans la capitale camerounaise, que cette rencontre s'est tenue. Pour l'occasion, Julius Ayuk Tabé, le président autoproclamé de l'Ambazonie et quelques-uns de ses partisans avaient été spécialement extraits de leurs cellules pour entamer des discussions avec les autorités du gouvernement. Entre eux, un témoin privilégié : Monseigneur Andrew Nkea Fuanya, archevêque de Bamenda. Cette nouvelle implication de l'Église catholique pour tenter de rapprocher les parties en conflit de la crise dans les régions anglophones a été plutôt bien perçue par nombre d'observateurs, alors que jusqu'ici une sorte de crise de confiance semble installée de part et d'autre entre protagonistes. D'autant que dix mois après la tenue du Grand dialogue national, les résolutions qui en avaient été issues tardent à être mises en application. Notamment le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le 20 août 2020, Le procès en appel du leader séparatiste anglophone Sisiku Ayuk Tabe et de ses neuf co-accusés a été une nouvelle fois reporté. Une partie des magistrats affectés à ce dossier ayant été récemment mutés, la cause a été renvoyée au 17 septembre 2020.
Le 17 septembre 2020, Une Cour d’appel camerounaise a confirmé, la condamnation à la prison à vie prononcée en 2018 contre Sisiku Ayuk Tabe. Sisiku Ayuk Tabe avait été jugé coupable « sécession » et « terrorisme », en lien avec le conflit dans les régions anglophones du Cameroun. Il s’était autoproclamé président de l’Ambazonie, nom donné par les indépendantistes anglophones à l’ancien Cameroun du Sud britannique, non reconnu internationalement. Lors de l’audience la Cour d’appel a estimé que le tribunal militaire qui avait condamné Sisiku Ayuk Tabe et ses coaccusés le 20 août 2019 a bien dit le droit. Elle a donc confirmé la prison à vie pour les accusés, assortie d’une amende de 250 milliards de francs CFA.
Dans les deux régions à majorité anglophones du Cameroun, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, des indépendantistes s’opposent violemment à l’armée depuis 2017 et les deux camps sont régulièrement accusés d’exactions contre des civils par des ONG. Au moins 3 000 personnes ont perdu la vie et plus de 700 000 autres ont dû fuir leur domicile, selon les Nations unies.
an 2020-2021 : République de Centrafrique - En décembre 2020, des mercenaires russes du groupe Wagner s'engagent aux côtés de l'armée centrafricaine, des forces de la MINUSCA et des forces rwandaises contre les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement qui veulent prendre Bangui et empêcher la tenue des élections présidentielle et législatives. Le 31 mars 2021, le Groupe de travail des Nations unies sur les mercenaires a dit sa préoccupations sur des violations répétées des droits de l'Homme par les mercenaires du groupe Wagner. Une enquête de RFI a collecté de nombreux indices, dont des documents confidentiels et des témoignages allant en ce sens. Le gouvernement centrafricain a réagi en mettant en place une commission d'enquête. La Russie a dénoncé « de fausses nouvelles » qui « servent les intérêts des malfaiteurs qui complotent pour renverser le gouvernement ».
an 2020 : Afrique Côte d'Ivoire - En novembre 2020, Alassane Ouattara est réélu pour un troisième mandat avec 94,27 % des voix lors d'un scrutin très critiqué puisque l'opposition avait demandé à le boycotter, contestant la constitutionnalité d'un troisième mandat. Finalement, seuls 53,90 % des électeurs se sont rendus aux urnes pour élire le président sortant.
an 2020-2021 : Éthiopie - les relations entre le gouvernement fédéral et celui de la région du Tigré se dégradent rapidement après les élections. Le 4 novembre 2020, le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) lance une attaque contre des bases des Forces de défense nationale éthiopiennes à Mekele, la capitale du Tigré, et à Dansha, une ville de l’ouest de la région. La guerre du Tigré escalade et se poursuit depuis cette date.
Les Forces de défense tigréennes ont repris la capitale régionale, Mekele, forçant le gouvernement éthiopien à décréter, le lundi 28 juin 2021, un « cessez-le-feu unilatéral »
Le 28 juin 2021, sept mois après avoir dû abandonner Mekele face aux assauts de l’armée gouvernementale éthiopienne, les forces du Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) reprennent le contrôle de la capitale provinciale du Tigré. Dans cette région du nord de l’Éthiopie, en guerre depuis novembre 2020, les derniers jours ont été le théâtre d’un spectaculaire renversement de situation militaire, forçant le gouvernement éthiopien à décréter un cessez-le-feu.
En marge du conflit au Tigré éthiopien, l’armée soudanaise tente de reprendre la main sur le triangle d’Al-Fashaga, un territoire agricole disputé par L’Éthiopie et le Soudan, pays de la Corne de l'Afrique. C’est un bras de fer qui menace de dégénérer, dans le sillage du conflit en cours dans la province éthiopienne du Tigré. En jeu : le triangle d’Al-Fashaga, soit 250 km2 de terres fertiles coincées entre les rivières Tekezé et Atbara, au cœur d’une dispute historique entre le Soudan et l’Éthiopie.
Début novembre 2021, plusieurs États occidentaux ordonnent à leurs nationaux de quitter l'Éthiopie, en prévision d'une éventuelle prise d'Addis-Abeba par le TPLF accompagnée d'exactions tribales. À ce stade le conflit a coûté, outre des milliers de morts, le déplacement forcé de plus de deux millions de personnes et un risque de famine pour cinq millions.
an 2020 : Guinée - En mars 2020, en dépit des manifestations et du désaccord de la grande partie de la population et de l'opposition et ce malgré une loi stipulant qu'aucun président ne peut se présenter pour plus 2 mandats consécutifs, Alpha Condé modifie la Constitution pour pouvoir légalement se représenter. Il est alors officiellement candidat pour un troisième mandat pour les élections s'étant tenues en octobre 2020.
an 2020 : Guinée-Bissau - L'investiture d'Umaro Sissoco Embaló a lieu le 27 février 2020. La passation de pouvoir s'effectue ensuite au palais présidentiel. Nuno Gomes Nabiam est nommé Premier ministre le lendemain, le 28 février 2020. Mais une incertitude subsiste : une partie des députés investissent comme président, le 28 février au soir, le président de l’Assemblée nationale, Cipriano Cassama, par intérim. Pour eux, l'investiture de Umaro Sissoco Embalo n'est pas légale.
an 2020 : Libéria - Le 1er octobre 2020, le Président Weah a procédé à un remaniement de son gouvernement et a formé un gouvernement d’union nationale pour faire face notamment aux défis sociaux, économiques et sanitaires auxquels le pays est confronté.
La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2023.
an 2020 : Mali - En 2020, dans un contexte d'élections législatives contestées et de manifestations massives menées par le M5-RFP, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrêté par des mutins et démissionne sur les ondes de l'ORTM, à minuit le 19 août 2020. Quelques heures plus tard, le Comité national pour le salut du peuple prend le pouvoir. Il est présidé par Assimi Goïta et dispose des services d'Ismaël Wagué comme porte-parole. Ce coup d'État est condamné de manière unanime par la communauté internationale.
Assimi Goïta en tant que président du CNSP la junte militaire qui a renversé Ibrahim Boubacar Keîta le 18 août 2020.
Bah N'Daw après avoir été designé par le CNSP Président de la Transition le 21 septembre 2020 puis renversé par un coup d'État.
an 2020 : Iles Maurice - Le 15 janvier 2020, Pravind Jugnauth premier ministre des île Maurice, était à Londres pour assister à un sommet sur les investissements de la Grande-Bretagne en Afrique. il s'est entretenu avec les chefs des gouvernements de l'Afrique du Sud, du Kenya, de Côte d'Ivoire et du Mozambique. Il a indiqué que : « Port-Louis étudiait la possibilité d’entamer des poursuites contre des responsables britanniques devant la Cour pénale internationale pour crime contre l’humanité ».
an 2020 : Mozambique - Depuis deux ans un groupe d’islamistes armés a déclenché une insurrection dans cette région du nord du pays. Les combats se déroulent à quelques kilomètres des futures installations gazières et le port de Mocimboa da Praia est pris par les insurgés en août 2020.
an 2020 : Namibie - Le 21 mars 2020, la Namibie célèbre son trentième anniversaire d'indépendance.
an 2020 : Nigéria - En octobre 2020, le pays est secoué par d'importantes manifestations protestant contre l'oppression et la brutalité policières – connues nationalement, et mondialement, sous le nom de #EndSARS (abréviation de “End Special Anti-Robbery Squad”). Ce mouvement populaire est violemment réprimé par les autorités.
an 2020 : Somalie - Le pays se mobilise également début 2020 contre une invasion de criquets pèlerins qui touche la Corne d'Afrique et plusieurs régions d'Afrique de l'Est.
an 2020 - 2021 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - John Magufuli acquiert une popularité, notamment grâce à sa lutte contre le gaspillage de l'argent public et contre la corruption, mais fait preuve également de dérives autoritaires, contre ses opposants, contre les libertés individuelles, contre la presse, etc. Il est réélu pour un second mandat en octobre 2020. Il meurt en fonction en mars 2021 et sa vice-présidente Samia Suluhu lui succède.
an 2021 : Bénin (anc. Dahomey) - Le 11 avril 2021, Patrice Talon est réélu Président de la République.
an 2021 : Cap Vert - En octobre 2021, se déroule l'élection présidentielle cap-verdienne de 2021, remportée par José Maria Neves
an 2021 : Congo Brazzaville - Fin décembre 2019, Denis Sassou-Nguesso est à nouveau désigné candidat de son parti (le PCT) à la présidentielle de 2021. Le 23 mars 2021, la commission électorale annonce que Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 88,57 % (résultats provisoires officiels). La participation est estimée à 67,55 % et son principal opposant, Guy Brice Parfait Kolélas, (mort de la Covid-19 le lendemain de l'élection), recueille 7,84 % des voix. Ses opposants annoncent former des recours. Le 6 avril 2021, la Cour constitutionnelle de la République du Congo a entériné la réélection du président Denis Sassou-Nguesso au scrutin du 21 mars, après avoir rejeté les recours de l'opposition.
an 2021 : République de Djibouti - Le 9 avril 2021, Ismaël Omar Guelleh a été réélu, avec 98,58 % des voix, selon les chiffres officiels provisoires.
an 2021 : Gambie - Adama Barrow est réélu président de la République le 5 décembre 2021.
an 2021 : Guinée - Le 5 septembre 2021, un coup d'État des forces spéciales, dirigées par Mamadi Doumbouya, mène à la capture d'Alpha Condé. Une junte prend le pouvoir.
Mamadi Doumbouya devient alors président du Comité national du rassemblement pour le développement et président de la Transition.
an 2021-2022 : Libye - Le 24 décembre 2021 devraient avoir lieu une élection présidentielle et en janvier 2022 des élections législatives.
an 2021 : Mali - Le 24 mai 2021, le président de transition Bah N'Daw et le premier ministre de transition Moctar Ouane sont interpellés et conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta démet N'Daw et Ouane de leurs fonctions. Suite à ce coup d'Etat, la France décide de mettre un terme à l'Opération Barkhane et appuie le développement international de la Task Force Takuba notamment pour sécuriser la région du Liptako
Assimi Goïta (Vice-président) de facto président de la transition après l'arrestation et la démission du Premier Ministre Moctar Ouane et du président de la transition Bah N'Daw par Assimi Goïta le lundi 24 mai 2021 et le mardi 25 mai 2021.
an 2021 : Namibie - En mai 2021 l’Allemagne et la Namibie sont parvenus à se mettre d’accord sur un document qui établit les responsabilités de l'Allemagne ex-puissance coloniale durant le Génocide des Héréro et des Namas.
an 2021-2022 : Somalie - En 2021 et 2022, le pays connait une importante sécheresse, provoquant des problèmes de disette importante pour près de 7,8 millions de personnes soit presque 50 % de la population.
an 2021 : Togo - En 2021, David Ekoué Dosseh, un professeur de médecine à l'origine de Togo Debout, la « plateforme citoyenne » créée le 22 septembre 2017, est sur la liste établie par le collectif Forbidden Stories de 300 Togolais espionnés par le logiciel Pegasus.
an 2021 : Soudan - Une tentative de putsch a lieu le 21 septembre 2021. Les responsables sont arrêtés.
Un coup d'État militaire a lieu en octobre 2021, menant à l'arrestation de civils dont le premier ministre. Le 25 octobre, des membres de l'armée tirent sur des civils refusant le putsch.
an 2021 : Tchad - Le 20 avril 2021, un Conseil militaire de Transition dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, alors général de l'armée tchadienne et fils du président Idriss Déby Itno, prend le pouvoir à la suite du décès de ce dernier, dont on soupçonne que la mort soudaine soit liée à un assassinat non ciblé lié à des affrontements avec le Fact, un groupe armé libyen. Cette prise du pouvoir ne respecte pas la Constitution de la République du Tchad, promulguée le 4 mai 2018, qui est alors suspendue par l'Armée, en même temps que l'Assemblée nationale est dissoute.
Au moment de prendre le pouvoir, l'armée promet que des élections libres et démocratiques seront organisées au Tchad sous dix-huit mois, après une période de transition et d'apaisement.
an 2021 : Togo - En 2021, David Ekoué Dosseh, un professeur de médecine à l'origine de Togo Debout, la « plateforme citoyenne » créée le 22 septembre 2017, est sur la liste établie par le collectif Forbidden Stories de 300 Togolais espionnés par le logiciel Pegasus.
an 2021-2022 : Tunisie - Crise politique de 2021-2022
Le 25 juillet 2021, invoquant l'article 80 de la Constitution, Kaïs Saïed limoge le gouvernement, annonce la suspension de l'Assemblée des représentants du peuple — dont il lève l'immunité des membres —, la formation d'un nouveau gouvernement — qui sera responsable devant lui — et sa décision de gouverner par décrets ; il indique également qu'il présidera le parquet. Ennahdha dénonce aussitôt un « coup d'État ». Cette qualification de coup d'État est partagée par des analystes politiques et juristes, notamment en ce qui concerne la suspension des travaux parlementaires.
Le 22 septembre, il confirme par décret le prolongement des décisions ainsi que la dissolution de l'Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, et décide de suspendre les salaires et les bénéfices accordés au président de l'Assemblée des représentants du peuple et ses membres, et s'octroie le droit de gouverner par décret, récupérant de facto le pouvoir législatif. Le 13 décembre, il annonce la tenue d'un référendum constitutionnel, prévu à l'été 2022.
Le 30 mars 2022, après la réunion virtuelle de 120 députés pour voter la fin des mesures d'exception en vigueur, Kaïs Saïed dissout le Parlement, ce qu'interdit pourtant la Constitution durant la période où l'état d'exception est appliqué, et menace les députés de poursuites judiciaires.
an 2022 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Le 23 janvier 2022 a lieu un coup d'État. Les putschistes, rassemblés sous la bannière du « Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration » et menés par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, annoncent la fermeture des frontières terrestres et aériennes à partir de minuit, la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale ainsi que la « suspension » de la Constitution. Le 24 janvier 2022, certains médias locaux et internationaux relaient une information selon laquelle le président de Faso serait détenu par des soldats mutins. D'autres médias assurent que c'est une information erronée. Le 1er mars 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, signe un plan pour entamer une transition de trois ans vers la démocratie.
an 2022 : République de Centrafrique - En avril 2022, une "opération" militaire menée par l’État centrafricain et des paramilitaires russes cause la mort de dizaines de civils dans les villages de Gordil et Ndah, au Nord-Est de la capitale. Suite à ce massacre, l'ONU indique ouvrir une enquête.
an 2022 : Érythrée - Le 2 mars 2022, l'Érythrée est l'un des cinq pays de l'ONU votant contre la résolution ES-11/1 ayant pour but de sanctionner et condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
an 2022 : Guinée - mars 2022 En Guinée, déchu il y a plus six mois par un coup d’état militaire le 5 septembre 2021, Alpha Condé ne prendra plus la tête du parti qu’il a lui-même créé dans la clandestinité au début des année 1990. En attendant le prochain président du RPG, un intérimaire a été porté à la tête de l’ancien parti au pouvoir. En réunion extraordinaire, ce jeudi 10 mars 2022, les cadres du parti ont désigné l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana comme président par intérim.
mai 2022 Transition prolongée en Guinée : l’opposition dénonce une « décision unilatérale » et une « durée injustifiable ». Le colonel Mamadi Doumbouya, auteur du putsch contre Alpha Condé, prévoit un délai de trente-neuf mois avant d’organiser d’éventuelles élections.
an 2022 : Lesotho - Les élections législatives lésothiennes de 2022 ont lieu en septembre 2022 afin de renouveler les membres de l'assemblée nationale du Lesotho.
Le Lesotho est une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement bicaméral dont la chambre basse, l'assemblée nationale est composée de 120 députés élus pour un mandat de cinq ans au suffrage direct. Son mode de scrutin, mixte, s'apparente au système électoral allemand, bien que les électeurs n'aient qu'un seul vote pour exprimer leur choix. Sur les 120 sièges, 80 sont pourvus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales uninominales. L'ensemble des votes pour chacun des partis est ensuite regroupé au niveau national, nonobstant ceux des indépendants, et les quarante sièges restants répartis entre eux de manière à rapprocher la composition de l'assemblée à celles des résultats en part des voix.
an 2022 : Mali - Les autorités maliennes responsables du coup d'Etat s'engagent auprès de la Communauté internationale à « organiser des élections présidentielles et législatives avant le 27 février 2022 ». Cet engagement non tenu et le partenariat des autorités maliennes avec le groupe paramilitaire russe Wagner conduisent le 17 février 2022 à l'annonce du retrait de la Task Force Takuba.
Le 16 mai 2022, le gouvernement d'Assimi Goïta révèle avoir réussi à déjouer un coup d'Etat mené par des militaires maliens dans la nuit du 11 au 12 mai. Selon les sources officielles du gouvernement, cette tentative de putsch avortée a été « soutenue par un Etat occidental »
an 2022 : Afrique - Élections à venir dans l'année : dans les prochains mois se tiendraient des processus électoraux cruciaux en République démocratique du Congo, en Angola, à Sao-Tomé, en Guinée équatoriale ainsi qu’au Tchad.
an 2023 : Libéria - La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2023.
an 2023 :
Histoire contemporenne
an 2004-2008 : République de Botswana - En 2004, le Président Festus Mogae, réélu pour cinq ans, s'engage à améliorer l'économie du pays et à tenter d'enrayer l'épidémie de sida laquelle toucherait près de 25 % de la population du pays d'après l'Organisation mondiale de la santé. Il se voit décerner en 2008 le prix Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique pour avoir su faire bon usage des richesses du sous-sol du pays, notamment en diamants. Il laisse le pouvoir au vice-président, Ian Khama, fils de Seretse Khama, père de l'indépendance du Botswana et de son épouse britannique Ruth Williams. Celui-ci est confirmé comme président par des élections l'année suivante. Il reste au pouvoir, réélu démocratiquement, pendant dix ans et fait ses adieux 18 mois avant la fin de son deuxième mandat, en respectant ainsi la Constitution.
an 2004 : Algérie - De nouvelles élections sont organisées au mois d'avril, le principal concurrent du président sortant étant son ancien Premier ministre Ali Benflis. Abdelaziz Bouteflika est réélu avec un taux de 85 %. Son programme pour le deuxième mandat prévoit un plan quinquennal pour la relance de l'économie, au profit duquel il consacre une enveloppe financière de 150 milliards de dollars.
an 2004 : Congo Kinshasa - En mars 2004 échoue une tentative de coup d'état attribuée à d'anciens mobutistes.
En mai 2004, des militaires banyamulenge déclenchent une mutinerie à Bukavu, sous les ordres du général tutsi congolais Laurent Nkunda, et prennent Bukavu le 2 juin. Ces mutins abandonnent la ville le 9 juin sous la pression internationale. Les 3 et 4 juin, dans les grandes villes congolaises, sont organisées des manifestations anti-rwandaises par des étudiants, qui tournent à l'émeute anti-ONU au Kivu. Le 11 juin, des membres de la garde présidentielle tentent un coup d'état. Le RCD-Goma suspend sa participation au gouvernement; il reviendra sur sa décision le 1er septembre.
an 2004-2006 : Guinée - Fin avril 2004, le premier ministre François Louceny Fall profite d'un voyage à l'étranger pour démissionner, arguant que « le président bloque tout ». Le poste reste vacant plusieurs mois avant d'être confié à Cellou Dalein Diallo, qui sera démis de ses fonctions en avril 2006.
an 2004-2005 : Guinée-Bissau - Le pays entreprend alors à nouveau avec difficulté une phase de normalisation démocratique, culminant avec l'organisation d'élections législatives en 2004 et d'une élection présidentielle le 24 juillet 2005 qui voit le retour à la tête du pays de João Bernardo Vieira dit « Nino Vieira », l'ancien président déposé en 1999 par un coup d’État militaire qui s'était présenté en indépendant. Pour gouverner, Nino Vieira, fortement contesté au sein du PAIGC, conclut une alliance tactique avec son ennemi historique, le général Batista Tagme Na Waie, en nommant chef d'état-major10 ce personnage rustre et illettré qui voue une haine farouche à l'ancien président Vieira, qui l'aurait torturé et jeté sur une île prison à la suite de la tentative de coup d'État de novembre 1985.
an 2004-2005 : Malawi - Le mois de mai 2004 voit l’élection de Bingu wa Mutharika, du FDU, contre le candidat du PCM, John Tembo. Durant la campagne électorale, les médias contrôlés par l'Etat (radio et télévision) privilégient la communication de la coalition au pouvoir. Des observateurs de l'Union Européenne mettent également en exergue des « distributions manifestes et répandues d'argent aux électeurs » et « l'utilisation de fonds publics par le parti au pouvoir ». Quand il prend ses fonctions, le Malawi est en pleine crise alimentaire. Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime que le nombre de personnes vulnérables au Malawi s’élève à plus de 5 millions, et en octobre 2005, le président déclare le Malawi en état de crise. Tout en demandant de l’aide alimentaire, le président engage le pays, après cette année désastreuse,dans une « révolution verte ». En faisant de l’agriculture une priorité, en mettant l'accent sur l'irrigation, en subventionnant 1 700 000 fermiers pauvres, il permet au pays de sortir de la disette et de devenir exportateur de maïs.
Bingu wa Mutharika se représente pour un deuxième mandat à l'élection du 19 mai 2009, cette fois à la tête du Parti démocrate progressiste qu'il a fondé en 2005 après avoir quitté le Front uni démocratique, et est réélu. L’image du Malawi à l'étranger s’améliore grâce à cette politiques de développement et aux avancées en sécurité alimentaire, ainsi qu'aux actions pour combattre la mortalité infantile et maternelle et les maladies telles que le malaria, la tuberculose et le SIDA. Le Malawi ouvre de nouvelles ambassades en Chine, Inde et Brésil.
an 2004 : Namibie - En 2004, Sam Nujoma renonce à modifier la constitution une nouvelle fois pour obtenir un nouveau mandat.
Les élections générales de novembre 2004 sont remportées par la SWAPO, qui renforce son emprise à chaque échéance électorale.
Les élections des 15 et 16 novembre sont sans surprise avec la victoire écrasante de la SWAPO qui remporte 55 des 72 sièges du parlement.
an 2004 : Somalie - Le 10 octobre 2004, le Parlement fédéral de transition de la République de Somalie, exilé au Kenya en raison des affrontements entre seigneurs de la guerre à Mogadiscio, et formé en nombres égaux de représentants de chacun des quatre grands clans somalis, a élu en tant que président intérimaire Abdullahi Yusuf Ahmed, président du Pays de Pount. À la tête du Gouvernement fédéral de transition, celui-ci a nommé Ali Mohamed Gedi, un vétérinaire de profession, en tant que Premier ministre, avec pour mission de former un gouvernement de coalition avec les différents chefs de guerre du pays. Les institutions somaliennes siègent au Kenya par mesure de sécurité à l'égard de la situation intérieure de la Somalie. Les institutions en exil n'ont aucun contrôle sur le pays en dehors de certains quartiers de la capitale Mogadiscio, leur autorité n'est pas reconnue à l'intérieur du pays, mais uniquement par les gouvernements étrangers.
an 2004 - 2005 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 2004, le pays ne peut plus subvenir à ses besoins et 70 % de la population se retrouve sans emploi. Le Zimbabwe se retire du Commonwealth. Le pays est alors au bord de la famine, ce que chercherait à dissimuler le régime. Le pays apparait dans la liste du nouvel « axe du mal » rebaptisé « avant poste de la tyrannie » par Condoleezza Rice en 2005.
En 2005, le parti de Robert Mugabe, la ZANU, remporte les élections législatives sur fond de violence et de fraudes électorales face à un MDC divisé et affaibli. Entre 120 000 et 1 500 000 habitants des bidonvilles d'Harare, bastions de l'opposition, sont expulsés à la fin du printemps lors de la destruction de leurs habitations sur ordre du gouvernement ; c'est l'opération Murambatsvina. Adoption d'une réforme constitutionnelle restreignant les droits de propriété et permettant au gouvernement de priver n'importe qui de passeport pour des raisons « d'intérêt national ». Afin de gagner l'appui de la population, Mugabe persécute la minorité ndébélé[réf. nécessaire]. Nombre d'entre eux fuient en Afrique du Sud. On empêche les propriétaires de terres d'aller en appel au sujet de leur expropriation. Un Sénat de 66 membres est créé mais celui-ci est soupçonné d'être une simple chambre d'enregistrement au service du président Mugabe. L'inflation dépasse les 1 000 % en 2006, et les 100 000 % en 2007, alors qu'a lieu une purge au sein de l'armée. L'exode de la population vers les pays voisins s’accélère.
an 2005 : Burkina Faso -Blaise Compaoré est élu président de la République (taux d'abstention : 74 %). Il est réélu en 2005 et en 2010.
an 2005 : Burundi - Le CNDD-FDD, dirigé par Pierre Nkurunziza, s'impose dès lors comme l'un des principaux acteurs politiques, en obtenant la majorité absolue aux élections communales du 5 juin 2005 (1 781 sièges sur les 3 225 à pourvoir) avec 62,9 % des voix, contre 20,5 % pour le FRODEBU et seulement 5,3 % pour l'Uprona. Le CNDD-FDD, majoritairement hutu, dispose désormais de la majorité absolue dans 11 des 17 provinces du pays. Une victoire sans appel qui annonce la recomposition du paysage politique après douze années de guerre civile et met un terme au long tête-à-tête entre l'UPRONA et le FRODEBU. Mais le vote rappelle aussi que certains rebelles (PALIPEHUTU-FNL) n'ont pas encore déposé les armes (le jour du scrutin, 6 communes ont été la cible de violences). Ces opérations d'intimidation révèlent que la trêve conclue le 15 mai 2005 à Dar es Salaam avec les forces du PALIPEHUTU-FNL reste fragile.
Le CNDD-FDD remporte également les élections législatives du 4 juillet 2005 et les sénatoriales du 29 juillet. Nkurunziza est donc élu président le 19 août et investi le 26 août 2005.
an 2005 : République de Centrafrique - Une élection présidentielle a lieu, après plusieurs reports, le 13 mars 2005, sous la direction d'une Commission Électorale Mixte Indépendante (CIME), présidée par Jean Willybiro-Sako. On peut relever comme candidatures, celles de François Bozizé (déjà chef de l'État), l'ancien président André Kolingba, et l'ancien vice-président Abel Goumba. Les candidatures de plusieurs autres candidats, dont celles de Charles Massi du FODEM, de l'ancien premier ministre Martin Ziguélé, de l'ancien ministre et ancien maire de Bangui Olivier Gabirault et de Jean-Jacques Démafouth, sont refusées par la commission électorale avant la médiation gabonaise et les accords de Libreville. À la suite de ces accords, seule la candidature de l'ancien président Ange-Félix Patassé est définitivement rejetée par la commission élue.
L'accession à la présidence de Bozizé est violemment contestée et une première guerre civile centrafricaine ravage le pays entre 2004 et 2007, jusqu'à la signature d'un accord de paix.
an 2005 : Congo Kinshasa - En janvier 2005 des émeutes se déclenchent à Kinshasa lorsque la Commission électorale envisage publiquement un report de la date des élections, comme le lui permettent les textes. La MONUC déclenche une offensive militaire, médiatique et diplomatique contre les milices lendues et hemas, après la mort de neuf casques bleus banglashis, tués en Ituri par ces dernières. La Cour pénale internationale annonce ses premiers mandats d'arrêts pour 2005 dont un accusé en Ituri.
En mai, l'avant-projet de constitution est approuvé par le parlement. Fin juin, celui-ci décide de prolonger la transition de six mois. Un gouvernement de transition est établi jusqu'aux résultats de l'élection.
an 2005 : Afrique République de Djibouti - Ismaïl Omar Guelleh est réélu en 2005, puis, après une modification de la Constitution, en 2011, 2016 et 2021.
an 2005-2006 : Eswatini (Swaziland) - Le 26 juillet 2005, après 30 ans de suspension de la loi fondamentale, le roi ratifie une nouvelle constitution entrée en vigueur le 8 février 2006. Le pays demeure une monarchie absolue. Les partis politiques sont toujours interdits et ne sont en pratique perçus que comme des associations. La Cour suprême ne peut juger d'affaires pouvant impliquer le régime royal. Le pays est par ailleurs toujours totalement dépendant économiquement de l'Afrique du Sud.
an 2005 : Kenya - Un premier projet de nouvelle constitution est rejeté en 2005 par un référendum.
an 2005-2006 : Libéria - Après le départ de Charles Taylor, une transition politique débute par la tenue d'élections législatives et présidentielles. La campagne électorale se déroule sans incidents notoires, notamment grâce à la présence de 15 000 Casques bleus de l'UNMIL, présents dans le pays depuis d'octobre 2003. Deux courtes courtes présidences se succèdent, avec tout d'abord Moses Blah, ancien vice-président de Charles Taylor à qui celui-ci a transmis le flambeau lorsqu'il a démissionné : Moses Blah assure un intérim pendant quelques mois, le temps que des négociations, organisées à Accra entre les différentes parties, aboutissent. Gyude Bryant lui succède12. C'est un homme d’affaires. Mais il est aussi l’un des fondateurs, en 1984, du Liberia Action Party (LAP), dont il est devenu le président en 1992, deux ans après le début de la première guerre civile. Bryant n’a pas quitté son pays pendant les guerres civiles. Il a ensuite été un président de transition, pendant deux ans et quelques mois, avant les élections présidentielles prévues par la paix d'Accra, et organisées fin 2005.
Le 11 octobre 2005, les Libériens sont effectivement appelés aux urnes pour élire leur président, comme prévu dans l'Accord de paix d'Accra. Parmi les vingt-deux candidats, George Weah (un ancien footballeur reconverti dans la politique) et Ellen Johnson-Sirleaf (une économiste et ancienne responsable au sein de la Banque mondiale), sont les favoris dans les sondages.
Le 21 octobre, la Commission nationale électorale (NEC) annonce que George Weah a obtenu 28,3 % des voix, devançant Ellen Johnson-Sirleaf qui a obtenu 19,8 %. Ces derniers participent donc au second tour qui a eu lieu le 8 novembre. Les résultats définitifs de ce premier tour sont rendus public le 26 octobre, après l'examen des vingt réclamations concernant des fraudes éventuelles. Concernant les élections législatives, le Congrès pour le changement démocratique (CDC) de George Weah a obtenu 3 sièges sur 26 au Sénat et 15 sur 64 à la Chambre des représentants. Le Parti de l'unité d'Ellen Johnson-Sirleaf a obtenu 3 sièges au Sénat et 9 à la Chambre des représentants. Le taux de participation a été de 74,9 %.
Le 8 novembre a lieu le second tour de l'élection présidentielle. George Weah a réuni autour de lui plusieurs hommes politiques de poids, comme Winston Tubman (quatrième au premier tour), Varney Sherman (cinquième au premier tour) et Sekou Conneh (ancien chef de la rébellion du LURD (Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie)). Ellen Johnson-Sirleaf a comme soutien uniquement des hommes politiques de second plan, mais elle espère profiter d'un vote massif des femmes en sa faveur au moment de l'élection qui fasse d'elle la première femme démocratiquement élue président en Afrique. Le 23 novembre, la Commission électorale nationale (NEC) annonce les résultats définitifs qui déclarent vainqueur Ellen Johnson Sirleaf avec 59,4 % des votes, contre 40,6 % pour George Weah. Le nouveau président doit prêter serment le 16 janvier 2006.
an 2005 : Mauritanie - Le 3 août 2005, l'armée, au travers du Conseil militaire pour la justice et la démocratie (CMJD) présidé par le colonel Ely Ould Mohamed Vall, prend le pouvoir pour officiellement « mettre fin aux pratiques totalitaires du régime » du président Ould Taya. Le putsch se déroule alors que le président revient de Riyad où il a assisté la veille aux funérailles du roi Fahd d'Arabie Saoudite.
an 2005 : Mayotte - Du côté des Comores, la question de Mayotte perd peu à peu son importance. Ainsi, depuis 1995, la question de Mayotte n'a plus été inscrite à l'ordre du jour de l’Assemblée générale de l'ONU. En 2005, le colonel Azali Assoumani, président des Comores depuis 1999, a déclaré qu'« il ne sert plus à rien de rester figé dans nos positions antagonistes d’antan, consistant à clamer que Mayotte est comorienne, pendant que les Mahorais eux se disent Français ». Il autorisera donc Mayotte à se présenter aux jeux des îles de l'océan Indien sous sa propre bannière.
Depuis le rattachement à la France, l'immigration clandestine venant essentiellement d'Anjouan (l'île la plus proche) n'a fait que s'accentuer. En 2005, près de la moitié des reconduites à la frontière effectuées en France l'ont été à Mayotte.
an 2005-2009 : Namibie - Le ministre des terres, Hifikepunye Pohamba, est imposé par Nujoma pour lui succéder à la présidence de la république en mars 2005. Nujoma reste toutefois à la présidence de la SWAPO jusqu'en 2007, date à laquelle Hifikepunye Pohamba lui succéda à la présidence du parti. Hifikepunye Pohamba a été réélu avec plus de 75 % des suffrages lors des élections de novembre 2009.
an 2005 : Ouganda - En août 2005, le Parlement (dominé par le NRM) vota une modification de la constitution qui, en enlevant la limite de deux mandats présidentiels, permit à Museveni de se représenter pour un troisième mandat. Kizza Besigye, revint d'exil en octobre 2005, et fut le principal opposant lors de l'élection de février 2006, remportée par Museveni avec 59,3 % des voix (au premier tour). Les résultats furent contestés par l'opposition du FDC (Forum for Democratic Changes, dirigé par Besigye).
an 2005 : Réunion (Ile de la) - Le cyclone Dina passe à 45 km des côtes nord l'île (22-23 janvier 2005).
an 2005 - 2015 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Après les élections de décembre 2005, Jakaya Kikwete devient le nouveau président de la République, le quatrième depuis la création de la Tanzanie. Il effectue les deux mandats que lui permettent la constitution. Le parti au pouvoir, le Chama cha Mapinduzi, choisit ensuite John Magufuli comme candidat à la succession pour les présidentielles de 2015. John Magufuli l'emporte et devient ainsi le cinquième président de la République de Tanzanie. Celui-ci acquiert une popularité, notamment grâce à sa lutte contre le gaspillage de l'argent public et contre la corruption, mais faitpreuve également de dérives autoritaires, contre ses opposants, contre les libertés individuelles, contre la presse, etc.
an 2005 : Togo - Le 5 février 2005, le président Étienne Eyadéma Gnassingbé, décède d'une crise cardiaque à 69 ans, après avoir présidé durant 38 ans le pays. Sa mort surprend autant la population du pays que le gouvernemen.
À la suite du décès de Gnassingbé Eyadema et profitant de l’absence au pays du président de l’Assemblée nationale qui, selon l’article 65 de la Constitution, doit assurer l’intérim de la présidence, l’armée togolaise prend la décision de confier le pouvoir au fils de Gnassingbé Eyadema, Faure Gnassingbé. L'Union africaine par la voix du président de la Commission Alpha Oumar Konaré dénonce un coup d’État militaire.
Le 25 février 2005, à la suite des pressions de la CEDEAO et de l’Union européenne, Faure Gnassingbé se retire et laisse la place au vice-président de l’Assemblée nationale togolaise, Abbas Bonfoh. Ce dernier assure l’intérim de la fonction présidentielle jusqu’à la tenue d'élections le 24 avril 2005. Quatre candidats se présentent : Faure Gnassingbé, soutenu par le Rassemblement du peuple togolais (RPT), Emmanuel Bob Akitani, candidat de la coalition de l’opposition radicale, Harry Olympio (en), candidat du Rassemblement pour le soutien à la démocratie et au développement (RSDD, opposition modérée) et Nicolas Lawson, homme d’affaires qui annonce le retrait de sa candidature le 22 avril 2005.
Le scrutin se déroule dans des conditions très controversées, l’opposition dénonçant des fraudes. Emmanuel Bob Akitani, chef de l’opposition, se déclare vainqueur avec 70 % des voix alors que le gouvernement déclare Faure Gnassingbé élu. Dès l’annonce des résultats, des manifestations émaillées de violences éclatent dans les principales villes. Elles seront violemment réprimées par les forces de l'ordre. Le gouvernement décide de mettre en place une commission nationale d'enquête qui estime le nombre de morts à des centaines, plus de 800 selon la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH). De nombreux Togolais, environ 40 000, se réfugient dans les pays voisins, le Bénin et le Ghana. Le 3 mai 2005, Faure Gnassingbé prête serment et déclare qu’il se concentrera sur « la promotion du développement, le bien commun, la paix et l’unité nationale ».
Le 8 juin 2005, Edem Kodjo, président de la Convergence patriotique panafricaine (CPP, opposition modérée), est nommé Premier ministre. Il est chargé de constituer un gouvernement d’union nationale.
Amnesty International publie en juillet 2005 un rapport dénonçant selon ses propres termes « un scrutin entaché d’irrégularités et de graves violences » tout en montrant que « les forces de sécurité togolaises aidées par des milices proches du parti au pouvoir (le Rassemblement du peuple togolais) s’en sont violemment prises à des opposants présumés ou à de simples citoyens en ayant recours à un usage systématique de la violence ». Le rapport reproche aussi à la France son rôle ambigu dans la situation actuelle15. Les violences consécutives aux événements politiques de 2005 auraient entraîné entre 400 et 500 morts.
an 2005 : Soudan - En 2005, un accord de paix est signé à Nairobi entre le gouvernement de Khartoum et l’APLS. Cet accord prévoit pour une période de six ans une large autonomie pour le Sud, qui disposera de son propre gouvernement et d'une armée autonome. À l’issue de cette période, un référendum d’autodétermination sera organisé. Les revenus issus du pétrole seront partagés en part égale entre le Sud et le Nord . D’autre part, le gouvernement aura 70 % des postes dans l’administration centrale contre 30 % pour la rébellion du Sud. Enfin, la charia ne sera appliquée que dans le Nord, à majorité musulmane. John Garang, le dirigeant de la rébellion contre le régime islamiste du général Omar el-Béchir, trouve la mort dans un accident d’hélicoptère, quelques semaines après sa nomination comme vice-président du Soudan pour pacifier la situation.
an 2006-2007 : Algérie - Les actions terroristes se poursuivent néanmoins dans plusieurs régions du pays : le quotidien L'Expression estime en 2006 qu'il y aurait de 600 à 900 membres de groupes terroristes encore en activité dans le maquis algérien, la majorité appartenant au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC). Ils se manifestent notamment par les attentats du 11 décembre 2007 à Alger (entre 30 et 72 victimes suivant les sources)
an 2006-2016 : Bénin (anc. Dahomey) - En mars 2006, Thomas Yayi Boni, ancien directeur de la Banque ouest-africaine de développement, est élu président du Bénin et de nouveau en mars 2011. Boni Yayi tente d'imposer, contre la volonté de sa famille politique, les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), un dauphin, le Franco-Béninois, Lionel Zinsou, un banquier d'affaires. Il est battu à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 par son ex-bras financier et allié, l'homme d'affaires Patrice Talon. Ce dernier accède au pouvoir le 6 avril 2016.
an 2006 : Burkina Faso - Avec l'arrestation de certains étudiants à la suite d'une conférence de presse à l'université de Ouagadougou, en 2007-2008 contre le coût élevé de la vie.
an 2006-2008 : Congo Kinshasa - Une constitution est approuvée par les électeurs, et le 30 juillet 2006, les premières élections multipartites du Congo depuis son indépendance (en 1960) se tiennent :
-
Joseph Kabila obtient 45 % des voix,
-
Son opposant, Jean-Pierre Bemba, 20 %.
Les résultats de l'élection sont contestés et cela se transforme en une lutte frontale, entre les partisans des deux partis, dans les rues de la capitale, Kinshasa, du 20 au 22 août 2006. Seize personnes sont tuées avant que la police et les troupes MONUC de l'ONU ne reprennent le contrôle de la ville.
Une nouvelle élection a lieu le 29 octobre 2006, et Kabila remporte 58 % des voix. Bien que tous les observateurs neutres se félicitent de ces élections, Bemba fait plusieurs déclarations publiques dénonçant des irrégularités dans les élections.
Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila prête serment comme président de la République et le gouvernement de transition prend fin. La fragilité du nouveau gouvernement a permis l'installation d'affrontements répétés et de violations des droits de l'homme.
Dans l'affrontement se déroulant dans la région du Kivu, les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) continuent de menacer la frontière rwandaise et les Banyarwandas ; le Rwanda soutient les rebelles du RCD-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie) contre Kinshasa; et une offensive rebelle ayant eu lieu fin octobre 2008 a causé une crise de réfugiés à Ituri, où les forces de MONUC se sont révélées incapables de maîtriser les nombreuses milices et groupes à l'origine du conflit d'Ituri.
Dans le Nord-Est, la LRA de Joseph Kony (LRA pour Lord's Resistance Army, l'Armée de résistance du Seigneur), s'est déplacée depuis sa base originelle en Ouganda (où elle a mené une rébellion pendant vingt ans) ou au Sud-Soudan, jusqu'en république démocratique du Congo, en 2005, et a établi des campements dans le parc national de Garamba.
Dans le Nord du Katanga, les Maï-Maï (anciennes milices créées par Laurent-Désiré Kabila pour lutter contre les milices rwandaises et ougandaises dans le Kivu, mais oubliées dans l'accord de Lusaka en 1999) ont échappé au contrôle de Kinshasa.
an 2006 : Gambie - En 2006 Jammeh est réélu pour un troisième mandat à 66 %. Une tentative de coup d’État a eu lieu en 2006 : l’ancien chef de l’armée est accusé.
an 2006 : Libéria - Au sujet de la formation de son gouvernement, Ellen Johnson Sirleaf a affirmé son intention de « former un gouvernement d'unité qui dépassera les lignes de fracture entre les partis, les ethnies, et les religions ». Avançant comme unique condition le fait de ne pas être corrompu, elle n'exclut pas la participation de George Weah au gouvernement, en déclarant : « Mais le pays ne va pas cesser de fonctionner s'il n'est pas dans le gouvernement. Nous allons avancer, avec ou sans lui ».
Ellen Johnson Sirleaf prête serment le 16 janvier en présence de nombreux personnages politiques, dont le perdant du second tour, George Weah. Au niveau international on peut noter la présence marquée pour l'aboutissement du processus de transition de la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, accompagnée de la première dame Laura Bush et de sa fille. Les officiels présents pour l'Afrique étaient le président Thabo Mbeki (Afrique du Sud), Abdoulaye Wade (Sénégal), Mamadou Tandja (Niger), John Kufuor (Ghana) et Ahmad Tejan Kabbah (Sierra Leone). La France était représentée par Brigitte Girardin, ministre délégué à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, la Chine par le ministre des Affaires étrangères Li Zhaoxing, la Guinée par le Premier ministre Cellou Dalein Diallo et la Côte d'Ivoire par Simone Gbagbo, épouse du président Laurent Gbagbo. Lors de son discours, elle a une fois de plus mis l'accent sur le fait que son gouvernement sera d'union nationale : « Mon gouvernement tendra la main de l'amitié et de la solidarité pour rallier tous les partis politiques [...] en tournant le dos à nos différences » et que la lutte contre la corruption sera l'une de ses priorités. Elle remplace donc officiellement Gyude Bryant. Concernant le Parlement, les deux nouveaux présidents de chacune des chambres ont également prêté serment ce même jour. Il s'agit d'Isaac Nyenabo pour le Sénat et d'Edwin Snowe pour l'Assemblée nationale.
an 2006 - 2007 : Madagascar - Après avoir lancé la reconstruction de routes et d'une partie des infrastructures du pays, Marc Ravalomanana est réélu lors de l'élection du 3 décembre 2006 en gagnant au premier tour avec la majorité absolue devant 13 autres prétendants, et est investi de nouveau président de la République de Madagascar pour un nouveau mandat de 5 ans.
Il appelle de nouveau les Malgaches aux urnes pour le 4 avril 2007 pour un référendum qui a pour objet principal la suppression des six « provinces autonomes » et l'instauration des « régions » au nombre de 22.
an 2006-2009 : Mali - Troisième rébellion touarègue.
an 2006 : Mozambique - En 2006, le pays compte 19 millions de Mozambicains dont un tiers vivant dans les villes, conséquence d'une urbanisation rapide intervenue au cours de l’interminable guerre civile.
S’il demeure l’un des pays les plus pauvres du monde, où l’espérance de vie est d’à peine 41 ans, le Mozambique connaît depuis 1995 une croissance annuelle exceptionnelle qui atteint 9 % en 2005. La Banque mondiale cite ainsi le Mozambique comme « un modèle de réussite. Une réussite en termes de croissance, et un modèle qui montre aux autres pays comment tirer le meilleur parti de l’aide internationale », même si la pauvreté reste omniprésente, plus de la moitié des habitants vivant encore en dessous du seuil de pauvreté.
an 2006 : Réunion (Ile de la) - épidémie de Chikungunya.
an 2006 : Somalie - Depuis le 26 février 2006, le gouvernement de transition siège à Baidoa, en Somalie.
Au début du mois de juin 2006, les affrontements entre les membres de l'Alliance pour la restauration de la paix et contre le terrorisme (ARPCT), une alliance entre des chefs de guerre et le gouvernement fédéral de transition, soutenu par Washington, et l'Union des tribunaux islamiques, soutenus par de nombreux entrepreneurs de la capitale, ont vu la victoire de ces derniers pour le contrôle de Mogadiscio. Le nouveau régime serait soutenu par l'Érythrée, l'Iran et divers pays arabes, tandis que le gouvernement fédéral de transition, replié sur Baidoa, bénéficierait de l'appui militaire de l'Éthiopie. Le rétablissement de l'ordre se fait au nom de la seule structure législative stable et consensuelle du pays, la jurisprudence chaféite.
Le 13 juin 2006 à Nairobi, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui regroupe le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée et le gouvernement de transition de Somalie, décide d'interdire l'accès au territoire de ses pays membres aux miliciens de l'ARPCT fuyant devant l'avancée des tribunaux islamiques dont le plus important, celui de Mogadiscio, est nommé Hifka-Halane. Il sert de pouvoir judiciaire (civil et pénal), en jugeant les affaires en appliquant la charia.
Début décembre 2006, les Nations unies autorisent le déploiement d'une force de maintien de la paix, composée de 8 000 hommes, sous l'égide de l'Union africaine24 (résolution 1725). Fin décembre 2006, l'armée éthiopienne intervient et les tribunaux islamiques fuient Mogadiscio. Elle prend ainsi le contrôle de la majeure partie du pays et le gouvernement de transition se déclare le gouvernement de facto du pays.
Du 20 au 31 décembre 2006, l'Éthiopie est entrée en guerre contre l'Union des tribunaux islamiques. La loi martiale a été décrétée le 30 décembre 2006 par le premier ministre somalien du gouvernement fédéral de transition, Ali Mohamed Gedi, et un délai de trois jours a été donné aux Somaliens pour remettre leurs armes à feu aux troupes éthiopiennes ou fédérales, avec un suivi très faible.
an 2006 : Soudan - En 2006, le gouvernement de Khartoum rejette le déploiement de « Casques bleus » au Darfour. Mais il accepte finalement l'année suivante le déploiement au Darfour d’une « force hybride » associant l’ONU et l’Union africaine (la MINUAD).
an 2006-2010 : Tchad - Alors que le président Déby fait modifier la constitution pour supprimer la limite de deux mandats présidentiels, une guerre civile éclate, contestant cette mainmise sur le pouvoir. Le président réussit à se maintenir au pouvoir et à être réélu, lors d'élections contestées boycottées par l'opposition. Entre 2006 et 2008, les forces d'opposition rebelles tentent plusieurs fois de prendre la capitale par la force, mais échouent systématiquement.
Le 13 avril 2006, des combats éclatent entre les troupes du président de la République et une faction de la rébellion, le Front uni pour le Changement (FUC), dans la périphérie de N'Djaména. Idriss Déby Itno accuse le Soudan, en pleine guerre du Darfour, de soutenir ses adversaires, à l’aube des élections présidentielles.
Malgré l’opposition et les appels au boycott, le 3 mai 2006, Idriss Déby Itno est réélu au suffrage universel avec 64,67 % des votes exprimés.
Le 2 février 2008, les rebelles, en provenance du Soudan frontalier, s’emparent de la capitale du Tchad, N'Djaména, à l'exception du palais présidentiel où le président Idriss Déby Itno semble s'être cloîtré. La France décide d’évacuer une partie de ses ressortissants. Le 4 février 2008, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques contre le gouvernement tchadien, dont l’armée rencontre des difficultés à repousser les rebelles. La France, via l’opération Épervier, apporte alors une aide logistique qui permet d’assurer la stabilité régionale au Tchad.
Mais les rebelles mènent une guerre de mouvement dans l’Est du Tchad, afin de faire tomber le gouvernement au pouvoir. Les attaques répétées ont pour conséquence de provoquer en juin 2008 un combat opposant pour la première fois la mission militaire européenne EUFOR et les rebelles au sud d’Abéché, autour de la ville de Goz Beïda. En novembre 2008, dans l’Est du pays, deux véhicules militaires belges sont brûlés, à la suite de tirs provenant d’hélicoptères soudanais.
En mai 2009 a lieu une autre offensive de la rébellion partant du Soudan, toujours dans l'objectif de renverser Idriss Déby. Le contingent militaire français de l'opération Épervier est suppléé, entre 2007 et 2009, par la force d'interposition EUFOR, forte de 3 000 soldats, mandatée par l'Union européenne à la demande de la France, en principe neutre mais qui assure un soutien de fait au régime du président Déby.
Finalement, en 2010, le président soudanais Omar el-Bechir se rend au Tchad pour normaliser les relations entre les deux pays. Le gouvernement du Tchad refuse d’arrêter ce dernier, pourtant visé par des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale émis à son encontre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour.
an 2007-2008 : Burkina Faso - contre le coût élevé de la vie. En juin 2008, l'université de Ouagadougou connaît une grève massive, qui se solde par une reprise en main brutale de l'université par le pouvoir : suppression de toutes les prestations sociales étudiantes (bourses, restauration, résidences universitaires vidées en deux jours) après tirs à balles réelles sur les étudiants.
an 2007 : Afrique Côte d'Ivoire - Appliqué avec beaucoup de difficultés, l’accord de Linas-Marcoussis est suivi par plusieurs autres, conclus en Afrique et mis en œuvre par les gouvernements successifs de Seydou Diarra, Charles Konan Banny.
L’accord politique de Ouagadougou conclu en 2007 avec Laurent Gbagbo, sous l’égide du président burkinabé Blaise Compaoré, qui fait office de facilitateur, offre aux Forces nouvelles le poste de Premier ministre. Les Forces nouvelles désignent leur secrétaire général, Guillaume Soro, le 26 mars 2007 pour exercer cette fonction.
Guillaume Soro entre en fonction le 4 avril et son gouvernement est installé trois jours plus tard. Le gouvernement doit mettre en place notamment deux points clefs de l'accord politique de Ouagadougou : la préparation d'élections devant se tenir dans les dix mois à compter de mars 2007, puis l'unification des Forces armées des Forces nouvelles (FAFN) et des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire (FANCI).
Dans le gouvernement Soro I composé de 33 membres, la formation militaro-politique de celui-ci (les Forces nouvelles de Côte d'Ivoire) et le Front populaire ivoirien (FPI), formation politique dont est issu le président Laurent Gbagbo, disposent chacun de huit portefeuilles (le Premier ministre y compris). Les autres portefeuilles sont répartis entre divers autres partis politiques. Ainsi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) en détient 5, le Rassemblement des républicains (RDR) 5, le Mouvement des forces d'Avenir (MFA) un, le Parti ivoirien des travailleurs (PIT) un, l’Union démocratique de Côte d'Ivoire (UDCI) un et l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) un ; deux autres ministres sont réputés proches du Président de la République et un ministre est issu de la société civile.
Concrètement, outre la gestion des affaires relevant de ses compétences traditionnelles, le gouvernement coordonne la mise en œuvre du processus de sortie de crise au moyen de programmes spécifiques. Il s’agit d’un dispositif technique comprenant notamment le Centre de commandement intégré (désarmement des combattants), le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire, le Comité national de pilotage du redéploiement de l'Administration (restauration de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire et reprise du fonctionnement des services publics), l’Office national d'identification (identification des populations et des électeurs) et la Commission électorale indépendante (organisation des élections).
an 2007 : Guinée - Le pouvoir du président, sous influence d'hommes d'affaires comme Mamadou Sylla, est de plus en plus contesté. Début 2007 éclate une grève générale réprimée dans le sang.
an 2007 : Kenya - Lors de l'élection présidentielle du 27 décembre 2007, Raila Odinga reçoit un soutien massif dans les provinces de Nyanza, occidentale, de la vallée du Rift et de la côte mais aussi de personnalités emblématiques telle Wangari Maathai. Dans la soirée du 30 décembre 2007, Samuel Kivuitu (en), qui vient juste d'être reconduit, pour cinq ans, par Kibaki à son poste de président de la commission électorale (Electoral Commission of Kenya), déclare Raila Odinga battu par 232 000 voix de différence en faveur du président sortant contrairement aux tendances des derniers résultats enregistrés. Controversée par les observateurs de l'Union européenne qui demande un recomptage des bulletins de vote, cette annonce est immédiatement contestée par le camp de Raila et entraine la plus grande crise de violence survenue au Kenya.
an 2007 : Mali - Le 29 avril 2007, Amadou Toumani Touré est réélu au premier tour avec 71,20 % des voix, mais cette élection est contestée par les principaux candidats de l’opposition. Les relations commerciales, politiques et culturelles avec la France se ralentissent tandis que celles avec la Chine, la péninsule arabique et les États-Unis se renforcent.
an 2007-2008 : Mauritanie - Le 25 mars 2007, Sidi Ould Cheikh Abdallahi est le premier civil à être élu président de le République démocratiquement, le colonel Ely Ould Mohamed Vall, conformément à ses engagements, ne s’étant pas présenté. En avril 2007 la Mauritanie réintègre l’Union Africaine, dont elle avait été exclue après le coup d’État de 2005. Pour la première fois, des membres du parti islamique modéré rejoignent le gouvernement en mai 2008.
Esclavage :
La société mauritanienne reste dominée par la caste des Beydanes, qui a historiquement fondé son pouvoir sur l'esclavage des castes inférieures.
L’esclavage reste courant en Mauritanie, le président de l’IRA (Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste) Biram Dah Abeid considère la Mauritanie comme un régime « d’apartheid non écrit ». Certains parmi la minorité Maures (arabo-berbère) y exploitent des Haratines dans les quartiers riches des grandes villes. Selon le rapport de l’ONG Walk Free publié en 2014 environ 4% de la population mauritanienne, soit 150 000 personnes vit en situation d’esclavage. La Mauritanie est le pays le plus touché au monde par ce phénomène. Selon Biram Abeid, la réalité se rapproche plus des 20% de la population.
L'esclavage a été officiellement aboli à quatre reprises (la dernière fois en 1980, avec un succès mitigé) mais les ségrégations raciales, tribales ou de castes y subsistent. En 2007 a été votée une loi criminalisant l'esclavage, et des actions sont prévues par le gouvernement pour lutter contre ses séquelles, car l'ethnie haratine des anciens esclaves reste parmi la plus défavorisée. Selon le Global Slavery Index, l'esclavage concerne 4 % de la population mauritanienne.
an 2007-2010 : Nigéria - En 2007 des élections une nouvelle fois agitées amènent au pouvoir le successeur désigné d'Olusegun Obasanjo : Umaru Yar'Adua, qui décède le 5 mai 2010. Son vice-président Goodluck Jonathan lui succède alors.
an 2007-2009 : Rwanda - La veille de la commémoration du 7 avril 2007, l'ancien Président de la République, Pasteur Bizimungu, est gracié par le Président Paul Kagame. Cette incarcération était vivement contestée par des ONG qui y voyaient un prétexte pour écarter un éventuel rival politique. Pasteur Bizimungu avait en effet symbolisé une réconciliation possible entre Tutsi et Hutu après le génocide.
La peine de mort est abolie au Rwanda en milieu d'année 2007. Cette abolition était demandée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda afin que, dans le cadre de la cessation de ses activités, prévue dans ses statuts en 2008 et 2010 pour la cour d'appel, il puisse transférer des détenus et des dossiers de présumés génocidaires au Rwanda.
Le président du Parti Vert rwandais, Frank Habineza, fait également état de menaces. En octobre 2009, une réunion du Parti des Verts rwandais est violemment interrompue par la police Quelques semaines seulement avant les élections, le 14 juillet 2009, André Kagwa Rwisereka, le vice-président du Parti vert démocratique, est retrouvé mort, à Butare, au sud du Rwanda. Le climat interne est marqué par des meurtres ou des arrestations de journalistes toujours selon Amnesty International.
L'analyse publique des politiques et pratiques du gouvernement est limitée au sein du pays par les limites de la liberté de la presse. En juin 2009, le journaliste du journal Umuvugizi Jean-Leonard Rugambage est abattu devant son domicile à Kigali. En juillet 2009, Agnes Nkusi Uwimana, rédactrice en chef du journal Umurabyo, est accusée d'« idéologie du génocide" ».
an 2007: Sénégal - Abdoulaye Wade est facilement réélu lors de l’élection présidentielle de 2007, et malgré le mot d’ordre de boycott de l’opposition lors des élections législatives consécutives, il dispose d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale et au Sénat, rétabli en début d’année. Le Président mène une politique libérale ouvertement revendiquée qui donne certains résultats. En effet le Sénégal devient une terre d’élection pour les investisseurs d’Europe, mais aussi des émirats du Golfe – c’est le cas de Dubaï Ports World qui enlève l’exploitation du port de Dakar –, du Brésil, de Chine, d’Iran ou d’Inde – par exemple avec le géant mondial de la sidérurgie, Arcelor Mittal. Abdoulaye Wade appelle également à la création d’États-Unis d’Afrique et de grands travaux d’infrastructures ont été lancés en vue du 11e sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) qui s’est tenu à Dakar en mars 2008.
Mais la politique gouvernementale essuie aussi des revers, comme l’inexorable recul du secteur agricole (arachide, coton…), l’effondrement de l’industrie chimique en 2006, le développement insuffisant du secteur tertiaire ou l’engorgement persistant de la capitale.
Le pays reste très dépendant de l’aide extérieure, notamment des subsides envoyés par l’importante diaspora sénégalaise. Le ralentissement de la crois sance et un taux de chômage élevé poussent bien des jeunes Sénégalais à l’émigration, parfois au péril de leur vie. L’augmentation du coût de la vie, notamment liée à la hausse des cours du pétrole, suscite des manifestations de rue en novembre 2007.
Beaucoup dénoncent aussi une dérive autoritaire du pouvoir, – guère tempérée par un Premier ministre généralement présenté avant tout comme un technocrate, Cheikh Hadjibou Soumaré , et qui laisse une marge de manœuvre réduite à l’opposition, ainsi qu’aux médias, pour la plupart solidaires de l’action présidentielle.
La question de la future succession d’Abdoulaye Wade, réélu à 80 ans, apparaît en filigrane dans le débat politique actuel, alimenté notamment par les spéculations sur les intentions de son fils Karim Wade.
an 2007 : Somalie - En janvier 2007, les États-Unis interviennent dans le sud de la Somalie pour pourchasser des membres présumés d'Al-Qaïda.
Le 23 janvier 2007, les troupes éthiopiennes commencent officiellement à se retirer de Somalie. Peu fréquent auparavant, les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du 29 octobre 2008 sont attribués au groupe al-Shabaab)
an 2008 : Afrique du Sud - En 2008, une grave pénurie d'électricité achève le bilan économique du président, à qui la presse reproche l'imprévoyance de son gouvernement, ainsi qu'à celui de Nelson Mandela, pour avoir refusé, en 1996, d'investir dans la construction de nouvelles centrales électriques alors que le pays connait une croissance de la demande en électricité de 10 % chaque année. Les grandes villes sont, pendant plusieurs semaines, périodiquement plongées pendant quelques heures dans l'obscurité alors que le gouvernement est contraint de promouvoir le rationnement, de renoncer à certains grands projets créateurs d'emplois et de suspendre ses exportations d'électricité vers les pays voisins. En mai, le gouvernement est confronté à une vague de violences contre les immigrés, caractérisée notamment par des meurtres, des pillages et des lynchages.
Mis en cause indirectement pour des « interférences » politiques dans des affaires judiciaires impliquant son ancien vice-président, Thabo Mbeki est contraint de démissionner de la présidence sud-africaine le 21 septembre 2008 après avoir été désavoué par son parti.
L'ANC nomme alors le vice-président du parti, Kgalema Motlanthe, pour lui succéder. Cela s'accompagne d'un schisme au sein de l'ANC et la création du Congrès du Peuple (COPE) par les partisans de l'ancien président.
an 2008 : République de Botswana - Le nouveau président est le lieutenant-général Ian Khama qui entre en fonction 2008, en prévision des élections de 2009. Il est le fils du premier président du Botswana, et un ancien chef de l'armée du Botswana (BDF). Élu formellement en 2009 et réélu en 2014, il demeure en fonction jusqu'en 2018, date à laquelle il démissionne pour laisser la place au vice-président Mokgweetsi Masisi qui lui succède.
an 2008 : Cameroun - En février 2008, des émeutes éclatent, réclamant la baisse des prix et le départ de Paul Biya. Les manifestants sont sévèrement réprimés : une centaine de morts, des milliers d’arrestations.
Le projet de Paul Biya de modifier la Constitution en février 2008 donne lieu à des manifestations brutalement réprimées ; une centaine de personnes sont tuées.
an 2008 : Cap Vert - Le 23 juillet 2008, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) accueille le Cap-Vert qui devient le 153e pays membre. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux principaux partis, le Mouvement pour la démocratie (MPD), et le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV, l'ancien parti unique), qui se succèdent au pouvoir, et quelquefois y cohabitent (avec un président de l'un et un premier ministre de l'autre). L'archipel souffre par contre du réchauffement climatique et de sécheresses, d'autant plus que l'eau douce y est rare. Les gouvernements ont opté pour une politique de développement des énergies renouvelables, ainsi que de l'écotourisme.
an 2008 : Afrique République de Djibouti - La frontière reste donc inchangée, l'île est indivise entre les deux pays. Douméra est le prétexte de l'affrontement entre les forces érythréennes et djiboutiennes de juin 2008.
an 2008-2009 : Afrique République de Djibouti - Le 10 juin 2008 éclate la guerre djibouto-érythréenne qui a opposé l'Érythrée à Djibouti autour du cap (ras) Douméra. Djibouti accuse Asmara d'avoir financé le mouvement armé anti-gouvernemental du Front pour la restauration de l’unité et la démocratie entre 1991 à 1994. L'Érythrée revendique la zone du cap Douméra, point littoral de la frontière entre les deux pays. En janvier 2009, par la résolution 1862 du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil de sécurité des Nations unies impose des sanctions contre l'Érythrée.
an 2008-2018 : Érythrée - Enfin, un différend territorial oppose par ailleurs l'Érythrée à Djibouti sur sa frontière sud depuis 2008 qui vaut à l'Érythrée des sanctions des Nations unies, sanctions levées le 14 novembre 2018. Le Conseil a ainsi adopté à l'unanimité cette résolution élaborée par la Grande-Bretagne et levé l'embargo sur les armes, toutes les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et autres sanctions.
an 2008-2012 : Ghana - Le président Kufuor quitte le pouvoir en 2008, respectant comme son prédécesseur, la limite du nombre de mandat possible. La décision du Nouveau Parti Patriotique est de choisir Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le fils de Edward Akufo-Addo comme leur candidat, tandis que le Congrès National Démocratique choisit John Atta Mills pour la troisième fois.
Le 28 décembre 2008, au terme d'une élection présidentielle très disputée et unanimement saluée pour son caractère démocratique, le candidat du Congrès démocratique national (Ghana), John Atta Mills, devient le nouveau président du pays. La passation de pouvoir s'est déroulée le 7 janvier 2009. John Atta Mills bénéficie ensuite de l'exploitation de forages pétroliers qui créent une dynamique nouvelle. La gestion de cette manne, qui soulève de grands espoirs dans la population, se veut basée sur un modèle norvégien avec « une industrie pétrolière où le sens de l’équité et de la justice doivent être reproduits localement pour le bénéfice de tous les Ghanéens »
Le 24 juillet 2012, le président meurt. Le pouvoir est transmis au vice-président, John Dramani Mahama, et des élections sont convoquées18. Il choisit le Gouverneur de la Banque du Ghana, Amissah Arthur, comme nouveau vice-président. Il est confirmé à son poste par le scrutin de décembre 201220. Son mandat est perturbé par une croissance en berne et des scandales de corruption et il perd l'élection présidentielle de 2016 face au chef de l'opposition Nana Akufo-Addo.
Industrialisation, opération séduction des investisseurs étrangers, lutte contre le paludisme, les initiatives s'enchaînent. Réputé pour sa stabilité politique, son fonctionnement démocratique et son dynamisme, le pays accueille Melania Trump après Barack Obama, mais aussi Angela Merkel ou encore Emmanuel Macron.
an 2008-2009 : Guinée - Le 22 décembre 2008, Lansana Conté décède des suites d'une longue maladie (leucémie et diabète aigu) à l'âge de 74 ans. Au cours de la nuit suivante, les proches du régime s'affairent pour organiser l'intérim suivant les procédures prévues par la Constitution mais le 23 décembre 2008 au matin, à la suite de l'annonce du décès de Lansana Conté, des dignitaires de l'armée annoncent unilatéralement la dissolution du gouvernement ainsi que la suspension de la Constitution, dans un discours à teneur résolument sociale. Ces événements laissent planer le doute sur l'effectivité d'un nouveau coup d'État. Le même jour, le capitaine Moussa Dadis Camara est porté à la tête du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et devient le lendemain, le troisième président de la République de Guinée.
an 2008 : Kenya - Fin février 2008, grâce à la médiation de Kofi Annan, l'ancien Secrétaire général des Nations unies, un accord de partage du pouvoir entre le président Kibaki et Raila est signé et entériné à l'unanimité par le Parlement le 18 mars pour résoudre la crise. Il se matérialise par la nomination de Raila Odinga au poste de Premier ministre le 13 avril suivant. Quatre jours plus tard, il prête serment et un gouvernement de coalition est constitué.
an 2008 : Libéria - L'ancien président Charles Taylor est jugé pour l'armement et le soutien aux rebelles de Sierra Leone depuis le 7 janvier 2008 à La Haye. Il plaide non coupable.
an 2008 : Mauritanie - Le 6 août 2008, à la suite du limogeage d'officiers supérieurs, les militaires conduits par le chef du bataillon chargé de la sécurité présidentielle, le général Mohamed Ould Abdelaziz, déposent le président Abdallahi. Il est assigné à résidence durant 4 mois et demi. Les principaux partis d’opposition, à l'exception du RFD d’Ahmed Ould Daddah se réunissent en un Front national pour la défense de la démocratie (FNDD) et s'opposent au coup d’État.
an 2008 : Somalie - les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du 29 octobre 2008 sont attribués au groupe al-Shabaab)
Le 29 décembre 2008, le président Abdullahi Yusuf Ahmed annonce sa démission, déclarant qu'il regrette n'avoir pas pu mettre fin au conflit somalien. Le Parlement, réuni à Djibouti en raison du désordre en Somalie, élit alors le cheikh Sharif Ahmed, ancien dirigeant de l'Union des tribunaux islamiques, à la présidence de la République. Il l'emporta face à Maslah Mohamed Siad Barre, fils de l'ancien président Mohamed Siad Barre, et au Premier ministre sortant Nur Hassan Hussei.
an 2008 - 2010 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 2008, les élections présidentielle et législatives du 29 mars constituent un revers pour la ZANU. Le MDC remporte la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale (109 élus contre 97 élus à la ZANU). Publiés le 2 mai, le résultat de l’élection présidentielle est contesté. En obtenant officiellement près de 48 % des suffrages en dépit des fraudes, Morgan Tsvangirai devance néanmoins Robert Mugabe (43 %). Lors de la campagne du second tour, le pays est le théâtre de violences politiques continues marquées par des exactions commises par la police contre des membres de l'opposition et leur famille mais aussi par l’arrestation de ses principaux chefs31. Dans ce climat de terreur, Morgan Tsvangirai décide à cinq jours du second tour de l’élection présidentielle de boycotter celle-ci, permettant ainsi à Robert Mugabe d’être réélu. L’inflation dépassant les 10 millions de % en rythme annuel, l'édition de billets de 100 milliards de dollars zimbabwéens (environ 3 EUR fin juillet 2008) devient nécessaire. La population est contrainte de revenir à une économie de troc et à la marche à pied : il n'y a plus de gazole pour faire rouler les bus.
De plus, à partir du mois d'août, une épidémie de choléra sévit dans le pays ; elle fait, selon l'OMS, 2 971 morts, pour 56 123 personnes contaminées (chiffres officiels au 27 janvier 2009). Toujours d'après l'OMS, jusqu'à la moitié des 12 millions de Zimbabwéens sont susceptibles de contracter la maladie en raison de l'insalubrité des conditions de vie dans le pays. En 2009, sous la pression de l'ONU quant aux fraudes concernant l'élection présidentielle, Robert Mugabe décide de partager le pouvoir avec son opposant et rival personnel Morgan Tsvangirai, chef du Mouvement pour le changement démocratique (MDC). En avril 2010, Mugabe reçoit le président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, avec lequel il conclut huit accords commerciaux entre les deux pays. Cette visite n'est pas bien perçue par l'opposition et par le reste du monde.
an 2009-2010 : Afrique du Sud - En mai 2009, Jacob Zuma est élu président de la république après la victoire de l'ANC (65,90 %), lors des élections générales, face notamment à l'alliance démocratique (16,66 %) d'Helen Zille, qui remporte la province du Cap occidental, et face au Congrès du Peuple (7,42 %) de Mosiuoa Lekota. Il hérite d'un pays toujours considéré comme le poumon économique de l'Afrique subsaharienne (40 % du PIB de l'Afrique subsaharienne) mais où le crime, sans distinction raciale, est omniprésent, faisant de ce pays l'un des plus dangereux du monde au côté de l'Irak et de la Colombie, où l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'est accentué, où la politique de discrimination positive est contestée pour son inefficacité et où les tentatives de réforme agraire n'ont débouché que sur des échecs. Le nouveau gouvernement qu'il forme est alors plus ouvert aux autres partis et autres races que ne l'était celui de Mbeki. Il fait notamment entrer au gouvernement Jeremy Cronin, un Blanc par ailleurs secrétaire général adjoint du parti communiste sud-africain et Pieter Mulder, chef du front de la liberté, le parti de la droite afrikaner qui a succédé à l'ancien parti conservateur.
En 2010, quinze ans après avoir organisé avec succès la coupe du monde de rugby, marquée par la victoire de l'équipe nationale, les Springboks, l'Afrique du Sud est le pays hôte de la coupe du monde de football. Deux mois avant l'évènement sportif, le 3 avril 2010, l'assassinat, dans sa ferme, d'Eugène Terre'Blanche par deux de ses ouvriers agricoles fait craindre un moment un réveil des tensions raciales dans une Afrique du Sud toujours minée par ces conflits latents. Le très influent leader de la Jeunesse de l'ANC, Julius Malema, connu pour ses outrances verbales à l'encontre de Thabo Mbeki et des opposants à Zuma, pour qui il se déclarait prêt à tuer, est mis en cause pour avoir repris dans ses discours une chanson prônant de « tuer les Boers » parce que « ce sont des violeurs ». Dans les campagnes sud-africaines, le modèle zimbabwéen reposant sur la carte raciale et la carte de la terre a beaucoup de partisans. L'épisode du meurtre de Terre'Blanche souligne ce malaise en zone rurale où plus de 2 500 fermiers blancs ont été tués en une dizaine d'années, souvent dans d'atroces conditions et le fait que des ouvriers agricoles noirs sont souvent mal payés et maltraités par leurs employeurs.
an 2009 : Algérie - Pendant les mois de mars et d'avril de l'année 2009, la campagne électorale pour la présidentielle se déclenche à la suite d'un nouvel amendement constitutionnel. Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014.
an 2009-2011 : Afrique - les Comores - Il est organisé le 29 mars 2009 et 95,2 % des votants acceptent le changement de statut, faisant de Mayotte le 5e département d'outre-mer (DOM) et le 101e département français en 2011.
Mayotte fait partie des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Elle devrait devenir une région ultrapériphérique de l'Union européenne au moment de sa départementalisation. Le pays souverain formé par les trois îles s'appelle aujourd'hui Union des Comores.
an 2009 : Congo Brazzaville - Denis Sassou-Nguesso est de nouveau réélu président du Congo, avec 78,61 % des voix à l'issue du vote du 12 juillet.
an 2009-2016 : Gabon - Le 3 septembre 2009, Ali Bongo, ministre de la Défense et fils d'Omar Bongo Ondimba, devient le troisième président du Gabon, élu à l'occasion d'un scrutin majoritaire à un tour, avec 41,79 % des suffrages exprimés, soit environ 141 000 voix sur un total de 800 000 électeurs inscrits. Il devance Pierre Mamboundou, crédité de 25,64 % des voix, et André Mba Obame, le nouveau chef de l'opposition gabonaise et ancien ministre de l'Intérieur. Les résultats sont fortement contestés et à la suite des forts soupçons de fraude, des émeutes éclatent et sont violemment réprimées par les forces de l'ordre, fidèles au pouvoir.
Par la suite, plusieurs enquêtes attestèrent que les scores avaient été truqués. Dans un documentaire diffusé sur France 2 en décembre 2010, le diplomate Michel de Bonnecorse, ex-conseiller Afrique du président Jacques Chirac, confirmera cette version des faits. L’ambassadeur américain Charles Rivkin, dans un télégramme transmis en novembre 2009 à la secrétaire d’État, le confirme également : « octobre 2009, Ali Bongo inverse le décompte des voix et se déclare président » (le télégramme sera divulgué par WikiLeaks en février 2011).
Depuis, le président Bongo prône le concept de « Gabon émergent », politique visant notamment à la diversification de l'économie afin de diminuer sa dépendance aux cours mondiaux du pétrole.
an 2009 Guinée - Le 28 septembre 2009, des mouvements civils organisent une manifestation pacifique pour demander à Dadis Camara de respecter sa parole et de ne pas se présenter aux présidentielles. Une foule de plusieurs milliers de personnes s'était rendu au stade à la demande de l'opposition pour protester contre le désir du président Dadis de se porter candidat à l'élection présidentielle. Le 28 septembre 2009, au stade de Conakry, à la surprise générale les militaires ouvrent le feu sur les manifestants ainsi bloqués dans le stade sans possibilité de fuite. Ce massacre délibéré et manifestement planifié fait plusieurs centaines de morts. De plus, les militaires violent et enlèvent plusieurs dizaines de jeunes femmes, dont certaines seront libérées quelques jours plus tard après avoir subi des viols à répétition, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de trace.
À la suite du tollé international soulevé par cet évènement, des dissensions apparaissent au sein du CNDD34 et le 3 décembre 2009, alors que Sékouba Konaté est en voyage au Liban, le président est grièvement blessé par son aide de camp Aboubacar Sidiki Diakité - ce dernier avait été mis en cause explicitement par des diplomates étrangers pour son rôle dans le massacre du 28 septembre, et craignait d'être « lâché » par son président et livré à la justice. Dadis Camara est hospitalisé au Maroc le 4, et Sékouba Konaté rentre au pays pour assurer l'intérim.
an 2009 : Guinée-Bissau - le 1er mars 2009, le chef d'état-major des forces armées, le général Batista Tagme Na Waie, est tué dans un attentat à la bombe. Le président João Bernardo Vieira, que certains militaires tiennent pour responsable de cet attentat dans la mesure où il entretenait des relations historiquement exécrables avec ce dernier, est assassiné à son tour, le 2 mars 2009, par des hommes en armes. Pour lui succéder, Malam Bacai Sanhá, candidat du PAIGC, est élu président le 26 juillet 2009.
Parallèlement, la Guinée-Bissau est gangrenée par le trafic de drogue et qualifiée à ce titre de « narco-État » par l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime. Ainsi, les attentats contre le chef d'état-major Tagmé Na Waié et le président Vieira ont probablement été fomentés par les trafiquants colombiens, peut-être en représailles de la destitution en août 2008 du contre-amiral José Américo Bubo Na Tchuto, chef de la marine nationale, qui couvrait le trafic avec Antonio Indjai. Ce dernier, après bien des péripéties, tombera d'ailleurs en mars 2013 dans un piège tendu par la DEA et envoyé aux États-Unis pour y être jugé pour trafic de drogue tandis qu'Antonio Indjai est depuis lors inculpé par la justice américaine et sous mandat d'arrêt international.
Le mandat de Malam Bacaï Sanha est émaillé de graves incidents en lien avec le narcotrafic. Le 1er avril 2010, une tentative de coup d'État menée par Antonio Indjai et l'ancien contre-amiral José Américo Bubo Na Tchuto aboutit à l'arrestation du Premier ministre Carlos Gomes Júnior et d'une quarantaine d'officiers dont le chef d'état-major de l'armée, José Zamora Induta, dans un coup de force présenté comme « un problème purement militaire ». À la suite de manifestations de soutien au Premier ministre, Antonio Indjai menace de tuer ce dernier avant d'expliquer dans une allocution que l'armée « réitérait son attachement et sa soumission au pouvoir politique ». Le Premier ministre est relâché le lendemain tandis qu'Indjai se présente comme le nouvel homme fort de l'armée. Ce dernier est relâché le lendemain, mais demeure en résidence surveillée, tandis qu'Antonio Indjai devient le nouvel homme fort de l'armée.
an 2009 : Libéria - Constatant une certaine stabilité politique, la Banque européenne d'investissement accorde le 15 mai 2009 un prêt de 3,5 millions d'euros au Liberia pour le soutien de la micro finance dans ce pays ainsi que la suspension des remboursements de l'encours du solde de la dette jusqu'en 2012. Mais la corruption continue de gangrener le système politique, malgré les intentions initialement affichées.
an 2009 : Madagascar - À partir de janvier 2009, une crise politique entre le maire de la capitale Andry Rajoelina et le président Marc Ravalomanana fait une centaine de victimes. Le 16 mars 2009, le président Marc Ravalomanana démissionne. Il transfère les pleins pouvoirs à un Directoire militaire composé des plus hauts gradés de l'Armée malgache, en lieu et place du président du Sénat comme le prévoyait la constitution, lequel directoire (re)transfère le jour même le pouvoir à Andry Rajoelina. Cette prise de pouvoir, validée par la Haute Cour Constitutionnelle malgache (HCC), est toutefois considérée par une grande partie de la Communauté internationale comme un coup d'État. Du 17 mars 2009 au 25 janvier 2014, Andry Rajoelina dirige l’État malgache sous le régime de la Transition.
an 2009 : Mauritanie - En avril 2009, Mohamed Ould Abdel Aziz abandonne le pouvoir afin de se présenter à l'élection présidentielle promise par la junte. Un accord pour préparer les futures élections est signé à Dakar entre les représentants de l’opposition et de la junte.
Le 18 juillet, Mohamed Ould Abdelaziz, qui durant sa campagne se présente comme le « président des pauvres », est élu au premier tour face à 8 autres candidats, avec 52,58% des voix. Ses opposants dénoncent un « coup d’État électoral » et fondent une Coordination de l’opposition démocratique, qui inclut le RFD.
L'arrivée du président actuel Mohamed Ould Abdel Aziz, le 18 juin 2009, fut marquée notamment par la coupure de ces relations diplomatiques avec Israël.
an 2009 : Réunion (Ile de la) - le 23 juin, la route des Tamarins est ouverte à la circulation.
an 2009 : Mozambique - Le 28 octobre 2009, Armando Guebuza est réélu président pour un deuxième mandat, dès le premier tour de scrutin avec 75 % des voix
an 2009 : Ouganda - Des tensions apparaissent également avec le Kabaka (roi) du Buganda et dégénèrent en affrontements en 2009.
Dans un mouvement de populisme, une loi anti-homosexualité fut proposée en 2009 prévoyant jusqu'à la peine de mort pour les homosexuels et pénalisant les individus, entreprises, médias et ONG soutenant les droits des LGBT.
an 2009 : Sénégal - Lors des élections locales du 22 mars 2009, le PDS, parti au pouvoir, essuie un sérieux revers dans la plupart des grandes villes dont Dakar convoité par Karim Wade, au profit de la coalition d’opposition Bennoo Siggil Senegaal.
Après la démission de Cheikh Hadjibou Soumaré le 30 avril 2009, Souleymane Ndéné Ndiaye est nommé Premier ministre.
Septembre 2009 : des pluies torrentielles provoquent de violentes inondations dans le pays.
an 2009 : Somalie - Dès février 2009, divers groupes islamistes fusionnèrent au sein du Hizbul Islam et déclarèrent la guerre au gouvernement modéré de Sharif Ahmed. Cette coalition inclut l'Alliance pour la nouvelle libération de la Somalie, dirigée par Hassan Dahir Aweys, l'un des chefs radicaux de l'Union des tribunaux islamiques, Hassan Abdullah Hersi al-Turki, un autre commandant de l'Union des tribunaux islamiques et leader des brigades de Ras Kamboni et le groupe Muaskar Anole. Cette nouvelle coalition islamiste est, avec le groupe al-Shabaab, la plus active dans le conflit. De plus, en mars 2009, ben Laden appelait dans un enregistrement au renversement de Sharif Ahmed.
an 2009 : Soudan - En 2009, la Cour pénale internationale (CPI) lance un mandat d’arrêt contre le président soudanais Omar el-Béchir 4 mars 2009 pour crimes contre l’humanité (l’année suivante, l’accusation de génocide sera rajoutée).
an 2010 : Burkina Faso -Blaise Compaoré est réélu en 2010.
an 2010 : Burundi - Après cinq années, l'érosion du pouvoir conduit à un certain agacement au sein des autres groupes Hutus. Lorsque le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) de Pierre Nkurunziza obtient une majorité des 2/3 aux élections communales du 26 mai 2010, les partis Hutus signataires des accords d'Arusha dénoncent immédiatement des fraudes massives. L'ONU et l'Union européenne, qui supervisent le scrutin, assurent ne pas avoir observé de graves irrégularités.
Peu après, une émeute éclate dans un faubourg de Bujumbura : les manifestants ont découvert une urne remplie de bulletins non-décachetés dans un quartier acquis aux Hutus anti-Nkurunziza ; il y a plusieurs blessés. Le 2 juin, des dirigeants de l'opposition Hutu sont arrêtés, tandis que Ban Ki-moon arrive au Burundi pour appeler à la poursuite du processus électoral. Il ne rencontre que le président, ce qui est vécu par les opposants comme une trahison de la communauté internationale.
Le lendemain, les partis Hutu d'opposition (FNL, etc.) décident le boycott total de l'élection présidentielle du 28 juin. Le 5 juin, l'ancien président Domitien Ndayizeye décide de rejoindre la contestation. Le 7 juin, le gouvernement interdit toute campagne pour l'abstention, ce qui radicalise la divergence.
L'opposition burundaise refuse de participer à l'élection présidentielle du 28 juin 2010 et dénonce des fraudes lors des élections municipales de mai (le CNDD-FDD a remporté les municipales avec 64 % des voix et le déroulement de l'élection est jugé correct en regard des standards internationaux par les observateurs de l'Union européenne). La campagne est émaillée d'incidents, plusieurs membres de l'opposition sont arrêtés. Pierre Nkurunziza a été réélu président en 2010 avec plus de 91 % des voix, étant le seul candidat de l'élection. Les candidats de l’opposition s’étaient retirés pour protester contre les irrégularités du scrutin.
an 2010 : Congo Kinshasa - Depuis novembre 2010, l'ancienne mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUC qui n'était pas parvenue à désarmer les milices rwandaises, est renforcée militairement pour intervenir dans l'est du pays et devient la MONUSCO, mais plusieurs dissidences et révoltes persistent et de nombreuses violences continuent.
an 2010 : Afrique Côte d'Ivoire - À l'issue d'une élection présidentielle sous tension, les deux candidats arrivés au second tour, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, se déclarent vainqueurs et prêtent serment comme président du pays. Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur par Youssouf Bakayoko, le président de la Commission électorale indépendante, au siège du camp de Ouattara contrairement aux dispositions de ladite CEI, et a reçu le soutien du Premier ministre Guillaume Soro et d'une partie de la Communauté internationale. Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel et a reçu le soutien du général Philippe Mangou, commandant de l'armée. La Côte d'Ivoire se retrouve alors avec deux présidents tentant de s'imposer sur l'ensemble du pays.
Mais Alassane Ouattara bénéficie du soutien de la plus grande partie de la communauté internationale, ainsi que celui d'instances économiques et financières tant régionales qu'internationales. L'économie ivoirienne est paralysée par les sanctions et les finances de l'État ivoirien asséchées, notamment les zones encore contrôlées par Laurent Gbagbo.
an 2010 : Guinée - Arrivé au pouvoir, le capitaine précise que le nouveau régime est provisoire et qu'aucun membre de la junte ne se présentera aux élections présidentielles prévues en 2010.
Au fil de ses interventions médiatiques, Moussa Dadis Camara envisage de plus en plus explicitement de se présenter, décevant les espoirs de véritable transition démocratique et déclenchant des mouvements de protestation.
Le 12 janvier 2010, Moussa Dadis Camara est renvoyé vers le Burkina Faso par le Maroc pour y continuer sa convalescence. C'est ainsi que le 15 janvier, un accord sera trouvé entre Dadis et Sékouba pour que ce dernier soit reconnu Président de la transition. Cet accord stipule qu'un premier ministre issu des Forces Vives (Partis d'opposition, syndicats, société civile) soit nommé dans le but de former un gouvernement d'Union nationale et de conduire le pays vers des élections libres et transparentes dans les six mois. Aussi, aucun membre du gouvernement d'union nationale, de la junte, du Conseil national de la transition et des Forces de Défense et de Sécurité n'aura le droit de se porter candidat aux prochaines échéances électorales.
Le 16 janvier, Dadis, dans une allocution à partir du palais présidentiel burkinabé, dit que la question de sa candidature est définitivement réglée, ainsi que celle des autres membres de la junte. Jean-Marie Doré, doyen de l'opposition, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement d'union nationale chargé d'organiser les futures élections présidentielles.
Le 8 février 2010, la justice guinéenne ouvre un instruction judiciaire pour les crimes commis le 28 septembre 2009 à Conakry, trois magistrats instructeurs sont nommés et le 3 juin 2010, la FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen (OGDH), trois autres organisations guinéennes de victimes (AVIPA, AFADIS, AGORA) et 67 victimes se constituent parties civiles.
Le 7 mars 2010, Sékouba Konaté fixe par décret la date du premier tour de l'élection présidentielle au 27 juin 2010. Il tient parole et pour la première fois une élection présidentielle en Guinée se déroule sans qu'aucun militaire ne soit candidat. Le second tour des élections présidentielles devait se tenir le 19 septembre 2010 mais a été reporté à une date ultérieure.
Le 28 septembre 2010, un an après le massacre, les victimes et les ONG de défense des droits de l'homme demandent le jugement des auteurs présumés des faits.
Le 7 novembre 2010, Alpha Condé (candidat du RPG et de l'Alliance Arc-En-Ciel) obtient 52,5 % des suffrages face à son adversaire Cellou Dalein Diallo (candidat de l'UFDG et de l'Alliance des bâtisseurs), qui a fini par accepter les résultats de la cour suprême qu'il avait initialement contestés en raison de soupçons d'irrégularités. Le président Alpha Condé est élu pour un mandat de 5 ans.
an 2010 : Kenya - Le 4 août 2010, le texte de réforme de la Constitution, incluant la Charte des droits et libertés16, chère à Raila — et maintenant soutenu par Kibaki — est accepté, contre la position d'un autre membre influent de l'ODM, le ministre des Hautes études William Ruto — soutenu, lui, par l'ex-président Moi —, par la majorité des 72,1 % de Kényans ayant participé au référendum populaire (70 % de votes favorables contre 30 % de défavorables).
La cérémonie publique de promulgation par le président Mwai Kibaki de cette Constitution moderne16 le 27 août 2010 est entachée par la présence du président soudanais Omar el-Béchir alors qu'il est notifié d'un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Cette invitation, directement adressée par le président Kibaki suscite l'émotion et la réprobation des Kényans, de leur Premier ministre et des parlementaires. Les protestations de la Communauté internationale et en particulier celles du président américain Barack Obama — bien que les États-Unis n'aie pas ratifié le statut de Rome — et de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan sont rapides.
an 2010 : Leshoto - En 2010, peu avant la Coupe du monde de football, des milliers d’habitants ont demandé au gouvernement sud-africain l'annexion du pays pour en faire la dixième province d'Afrique du Sud. Fin mai, plusieurs centaines de personnes ont défilé dans la capitale, Maseru, et remis au Parlement et à l'ambassade d'Afrique du Sud une pétition demandant le rattachement. Plus de 30 000 signatures ont été recueillis et les raisons sont multiples : une situation économique extrêmement précaire, un taux de sida très élevé (400 000 personnes en sont atteints), une espérance de vie très basse (34 ans) et l'effondrement de l'industrie textile, ce qui rend la survie du pays extrêmement difficile, d'autant plus qu'il est totalement encerclé par l'Afrique du Sud et qu'il y a plus de Sothos vivant en Afrique du Sud qu'au Lesotho lui-même.
an 2010-2012 : Malawi - Mutharika remplace Muammar al-Gaddafi à la tête de l’Union africaine, devenant le premier chef d’état malawite à exercer la charge de secrétaire général de cette organisation. En 2011, le Malawi établit des relations diplomatiques avec 10 pays. Mais le second mandat de Mutharika est vite marqué par une dégradation brusque de l'économie, une dégradation des conditions de vie et des pénuries d'essence dues à un manque de confiance des bailleurs de fonds. Des émeutes éclatent, et le régime se durcit, s'appuyant sur l'armée. Finalement, le président Bingu wa Mutharika est victime d'un arrêt cardiaque le 5 avril 2012.
an 2010-2013 : Mali - En septembre 2010, sept étrangers, dont cinq Français, sont enlevés par Al-Qaida au Maghreb islamique. Treize mois plus tard, des Touareg maliens, ex-mercenaires en Libye, reviennent dans la partie nord du Mali : le contrôle de cette partie du pays semble échapper de plus en plus au pouvoir en place à Bamako entre les interventions de Al-Qaida au Maghreb islamique et ces forces Touaregs. Le 22 mars 2012, le capitaine Amadou Haya Sanogo dirige un coup d’État militaire. Quelques mois plus tard, soumis également à une pression internationale, il rend le pouvoir à des autorités civiles, pour une période de transition, avec comme président par intérim Dioncounda Traoré. Celui-ci organise une élection présidentielle qui se tient les 28 juillet et 11 août 2013 et s'achève par la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta auquel Dioncounda Traoré transmet le pouvoir le 4 septembre suivant.
Pendant ce temps, durant cette même année 2012, profitant des bouleversements politiques successifs à Bamako, les événements s'accélèrent dans le nord du pays et dans le Sahel, au centre du pays. De mars à septembre 2012, les villes de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti tombent aux mains des islamistes qui se rapprochent des régions du sud. Le 23 septembre 2012, Le Mali et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) s'accordent sur le déploiement d'une force africaine. Le 21 décembre 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies autorise par une résolution le déploiement d'une force africaine au Mali. Le 11 janvier 2013, les troupes françaises interviennent en appui de cette force africaine, c'est le début de l'opération Serval.
an 2010 : Mauritanie - La Mauritanie a suspendu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009 avant de "rompre complètement et définitivement les relations avec Israël" le 21 mars 2010. Ces relations avaient été établies en 1999 par le président de la République à l'époque, Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya.
Sous le président Abdel Aziz, la Mauritanie s’est érigée en garante de la lutte contre la menace terroriste, tout en adoptant des lois qui définissent les infractions terroristes en termes vagues. La loi antiterroriste adoptée en 2010 a ainsi permis aux autorités de museler plusieurs opposants politiques, comme Abdallahi Salem Ould Yali, activiste issu de la communauté «haratine», descendants d’esclaves, qui a été poursuivi pour incitation au fanatisme ethnique ou racial pour avoir diffusé des messages dénonçant la discrimination dont est victime son groupe ethnique dans un groupe de discussion WhatsApp, ou encore, en 2015, le colonel de la Garde nationale à la retraite Oumar Ould Beibacar, qui dénonçait les exécutions sommaires de ses co-officiers en 1992 dans une purge d’officiers noirs de l’armée mauritanienne.
an 2010 : Rwanda - En 2010, les opposants ont une marge de manœuvre très réduite. Ainsi, par exemple, l'opposante Victoire Ingabire, présidente des FDU-Inkingi (Forces démocratiques unies) est arrêtée pour négation du génocide, lorsqu'elle exprime la nécessité de réconciliation. Une loi de 2008 punit de dix à vingt-cinq ans de prison « l'idéologie du génocide », avec une formulation « rédigée en termes vagues et ambigus », selon Amnesty International, qui y voit un moyen de « museler de manière abusive la liberté d'expression ».
À l'approche de l'élection présidentielle rwandaise de 2010, deux autres rédacteurs en chef de journaux sont contraints de quitter le Rwanda. Les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis, la France et l'Espagne expriment publiquement leurs préoccupations. Paul Kagame est réélu à cette élection présidentielle, avec plus de 93 % des suffrages exprimés.
an 2010 : Sénégal - Février 2010 : un projet de loi déclarant l’esclavage “crime contre l’humanité” est exposé par le chef de l’Etat.
Abdoulaye Wade annonce également la fermeture de la base militaire française à Dakar.
an 2010 : Togo - En 2010 est organisée une élection présidentielle, où le président Faure Gnassingbé est réélu avec 61 % des voix. Gilchrist Olympio, candidat naturel de l'UFC, a été remplacé au dernier moment par Jean-Pierre Fabre.
Des heurts ont lieu en protestation à cette élection entre militants de la coalition et forces de l'ordre. Les élections ont été dénoncées par l'Union européenne, finançant les élections, qui au travers de ses observateurs a constaté des irrégularités dans la campagne électorale.
an 2010 - 2011 : Tunisie - En décembre 2010, la situation économique et sociale est très difficile. Le chômage, en particulier celui des jeunes diplômés, est très important. Le suicide d'un jeune commerçant empêché par la police de pratiquer son commerce déclenche un vaste mouvement de protestations. Des manifestations répétées, qui s'appuient sur les réseaux sociaux permis par l'internet, parviennent le 14 janvier 2011 à chasser du pouvoir le président Ben Ali. C'est la révolution tunisienne de 2010-2011, qui a lieu en même temps que d'autres mouvements dans des pays arabes : le Printemps arabe.
an 2011 : Burkina Faso - La révolte de 2011 secoue le pays en même temps que le Printemps arabe.
an 2011 : Cap Vert - Depuis 2011, le président est le dirigeant du MPD Jorge Carlos Fonseca.
En raison de sa stabilité politique et de la régularité des élections, le Cap-Vert est considéré comme l'un des pays africains les plus démocratiques.
an 2011 : Afrique Côte d'Ivoire - Les combats éclatent à Abidjan à la fin du mois de février 2011 entre le « Commando invisible » hostile à Gbagbo et l'armée régulière. Puis, début mars, la tension gagne l'ouest du pays, où les Forces nouvelles prennent le contrôle de nouveaux territoires. L'ensemble du front finit par s'embraser à la fin mars, et les forces pro-Ouattara, rebaptisées Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), prennent Yamoussoukro, la capitale politique du pays, le 30 mars. À partir de ce moment-là, les événements s'accélèrent : le sud du pays est conquis en quelques heures et les troupes pro-Ouattara entrent dans Abidjan sans rencontrer de réelle résistance (mais non sans commettre de nombreuses exactions sur les populations civiles).
Laurent Gbagbo et son épouse se retranchent à la Résidence présidentielle, protégés par un dernier carré de fidèles dont la Garde Républicaine dirigé par le colonel Dogbo Blé Bruno. La Résidence est assiégée par les forces pro-Ouattara qui ont du mal à accéder à la Résidence malgré plusieurs tentatives. Un assaut final est lancé contre le domicile le 11 avril avec l'appui des forces onusiennes et surtout de l'armée française (en application de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU). Laurent Gbagbo (accompagné de sa famille) est fait prisonnier, puis placé en état d'arrestation à l'hôtel du Golf. Il est ensuite transféré à Korhogo dans le nord du pays, où il est placé en résidence surveillée. Quelques jours plus tard, son épouse, qui n'a pas été autorisée à le suivre, sera placée quant à elle en résidence surveillée à Odienné, une autre localité du nord ivoirien. Depuis le 30 novembre 2011, Laurent Gbagbo est incarcéré à la Cour pénale internationale où il est inculpé pour quatre chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Les forces pro-Ouattara sont soupçonnées de s'être livrées à des exactions sur des populations supportant Laurent Gbagbo (massacre du camp de Nahibly et Duekoué). Dans le cas de Duekoué, l'ONU explique que les forces pro-Gbagbo seraient aussi impliquées.
an 2011 : Afrique République de Djibouti - Au début de 2011, des manifestations inspirées par le Printemps arabe sont réprimées.
an 2011 : Gambie - En 2011, Jammeh est réélu à 72 % des suffrages. Il déclare être « prêt à diriger le pays un milliard d’années ». Son opposant Darboe qualifie le scrutin de « frauduleux et grotesque ». La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest estime elle aussi que les élec Le gouvernement de Jammeh devient de plus en plus policier, il ignore les ONG et la Commission Africaine des droits de l’homme. Sont dénoncés par ces derniers le traitement discriminatoire des homosexuels, l’usage de la torture et la violence des services de renseignement, surnommés les « Jungelers ».
an 2011 : Kenya - Faisant suite à l'enlèvement d'une touriste britannique et à l'assassinat de son mari le 11 septembre 2011, à l'enlèvement d'une résidente franco-kényane le 1er octobre et enfin, le 13 octobre, à l’enlèvement de deux volontaires humanitaires espagnoles ainsi qu'à l'assassinat de leur chauffeur kényan, des unités militaires des forces armées kényanes entrent en Somalie le 16 octobre à la poursuite des miliciens d'Al-Shabaab. Cependant, Alfred Mutua, le porte-parole du gouvernement déclare, le 26 octobre, que l'opération militaire était planifiée depuis longtemps et que les enlèvements n'ont été qu'une aire de lancement (« the kidnappings were more of a good launchpad. »). Cette « invasion » donne lieu à des représailles de la part d'Al-Shabaab (cf. section détaillée : « Attentats »).
2011-2013 : Égypte - Hosni Moubarak est Président de la République jusqu'en février 2011, date de sa démission contrainte à la suite de la Révolution égyptienne de 2011. Hosni Moubarak poursuit la politique de libéralisation de l’économie, notamment par la réduction des subventions à l'agriculture et à la consommation, et par la libéralisation des prix. En 1992, il fait annuler les dispositions régissant la location des terres. Généralement appelée « loi pour chasser les paysans de leurs terres », cette loi, combinée aux autres mesures de désengagement de l’État dans l’économie, accroît le mécontentement des populations rurales pauvres en particulier en Haute-Égypte. Hosni Moubarak devient un pilier de la stratégie régionale des États-Unis et la Constitution qu'il met en place reconnait les « principes de la charia » comme source principale de la législation.
En janvier et février 2011, une série de manifestations d'ampleur inégalée se déroulent à travers le pays et mènent à la démission d'Hosni Moubarak le 11 février. Les nouvelles élections législatives et présidentielle sont remportées par le Parti de la liberté et de la justice, le bras politique des Frères musulmans.
Le pouvoir n'est cependant resté que peu de temps entre leurs mains car d'importantes manifestations contre le président élu, Mohamed Morsi, critiquant des dérives dictatoriales, et le retournement de l'armée contre celui-ci le destitue en faveur d'un gouvernement transitoire un an seulement après son élection. L'Égypte connait depuis une période de troubles causée par l'instabilité et les tensions politiques, notamment entre les opposants à l'ex-président et ceux qui continuent à le soutenir et n'acceptent pas ce qu'ils voient comme un coup d'État illégal.
an 2011-2018 : Éthiopie - En 2011, une crise alimentaire touche une grande partie de la Corne de l'Afrique. Dans la nuit du 20 au 21 août 2012, Meles Zenawi décède en pleine fonction après 21 ans au pouvoir. Conformément à la Constitution (article 73), Haile Mariam Dessalegn est désigné comme Premier ministre par la Chambre des représentants des peuples. Les Oromos, ethnie majoritaire avec plus du tiers de la population, entrent en rébellion en novembre 2015. Les Amharas, un quart de la population, font de même en août 2016. L'état d'urgence est décrété le
9 octobre 2016. Haile Mariam Dessalegn démissionne en février 2018 à la surprise générale. Le 2 avril 2018, Abiy Ahmed lui succède. Cet homme politique de longue date est populaire parmi les Oromos dont il est issu. Dès son discours d’investiture, il tend la main à l’Érythrée, en appelant à mettre fin à un conflit qui dure depuis l’indépendance du pays, en 1993. Il qualifie également les partis d’opposition de frères et non d’ennemis. La situation intérieure et les relations avec les pays voisins s’apaisent.
an 2011 : Libéria - Ellen Johnson Sirleaf remporte à nouveau l’élection présidentielle de 2011. Le taux de participation aux votes est faible, 37,4 %
an 2011 : Libye - La guerre civile de 2011
En 2011, dans le contexte du « Printemps arabe », le mécontentement populaire contre le régime de Kadhafi s'affirme désormais ouvertement. La violente répression des manifestations dans le pays, durant laquelle la troupe tire à l'arme lourde sur la population, débouche en février sur une véritable guerre civile. L'Est du pays échappe bientôt au contrôle de Kadhafi, et un gouvernement provisoire, le Conseil national de transition (CNT), est formé à Benghazi. Mais les troupes de Kadhafi contre-attaquent rapidement, et reprennent progressivement le contrôle du pays. Alors que Benghazi est directement menacée, le Conseil de sécurité des Nations unies vote la résolution 1973, autorisant en mars une intervention militaire internationale qui fournit aux rebelles un appui aérien et leur évite d'être écrasés. Au bout de six mois de conflit, les forces du CNT prennent Tripoli le 23 août. Kadhafi, ayant quitté la capitale, est mis à prix et visé par un mandat d'arrêt international. Le 16 septembre, le CNT est reconnu comme gouvernement de la Libye par l'Assemblée générale des Nations unies. À l'automne 2011, les partisans de Kadhafi tiennent encore plusieurs bastions, principalement Syrte et Bani Walid.
Le 20 octobre 2011, Syrte est la dernière ville kadhafiste à tomber aux mains des forces du Conseil national de transition. Mouhammar Kadhafi est capturé et tué le jour même.
La « libération » du pays est officiellement proclamée le 23 octobre; le même jour, le président du CNT, Moustafa Abdel Jalil, annonce que la future législation de la Libye serait fondée sur la charia. Cette déclaration ayant suscité l'inquiétude des gouvernements occidentaux, il déclare vouloir « assurer à la communauté internationale que nous, les Libyens, sommes des musulmans modérés ». Un référendum est annoncé pour approuver la future constitution. Le 22 novembre, un nouveau gouvernement, dirigé par Abdel Rahim al-Kib, est mis en place41. Kadhafi ayant laissé derrière lui un vide politique, et un pays dépourvu d'institutions réelles, d'armée structurée, et de traditions démocratiques, la Libye apparaît bientôt comme un pays très instable, en proie au désordre et à la violence.
an 2011 : Mauritanie - Durant deux mois, entre le 24 septembre et le 28 novembre 2011, le collectif "Touche pas à ma nationalité" organise plusieurs manifestations pour protester contre le recensement national.
an 2011-2021 : Ouganda - Museveni se fit réélire à nouveau en 2011 et 2016, nouveaux scrutins présidentiels après ceux de 1996, 2001, et 2006, chaque fois au premier tour, et avec des soupçons de fraude. Il fit procéder aussi à un nouveau changement de constitution fin 2017,pour supprimer la limite d'âge de 75 ans s'appliquant aux candidats à cette élection présidentielle et à lui en tout premier lieu. Il instaura également une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux et fin août 2018, fit arrêter et battre un député d'opposition, Robert Kyagulanyi Ssentamu (en), connu également comme ex-chanteur sous le nom de Bobi Wine. Libéré, celui-ci se fit soigner aux États-Unis avant de revenir en Ouganda en septembre 2018 et d'être à nouveau inculpé. Constituant l'un des leaders de l'opposition ougandaise, Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine, affrontera le président sortant Yoweri Museveni, qui est au pouvoir depuis 1986, lors des élections présidentielles qui se tient le 14 janvier 2021, Yoweri Museveni est réélu.
an 2011 : Sénégal - Février 2011 : Dakar rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran, accusé d’avoir livré des armes aux rebelles indépendantistes de Casamance, où la recrudescence de la violence depuis fin décembre 2010 a causé la mort d’au moins seize soldats sénégalais.
Juin 2011 : face à la fronde de la rue, Abdoulaye Wade renonce à une réforme constitutionnelle qui prévoyait de faire élire un ticket présidentiel, au premier tour, avec 25% seulement des suffrages exprimés. On le soupçonnait de vouloir assurer sa réélection et de préparer la succession pour son fils Karim.
an 2011 : Seychelles - L'élection présidentielle de mai 2011 voit la réélection du président Michel qui remporte 55,4 % des suffrages exprimés, contre 41,4 % à Wavel Ramkalawan. Il se présente une troisième et dernière fois à l'élection présidentielle de 2015, remportant le scrutin avec 50,15 % des suffrages exprimés contre 49,85 % à son adversaire, Wavel Ramkalawan. Mais il est contraint d'attendre le second tour de l'élection, alors qu'il avait été élu dès le premier tour aux élections précédentes.
an 2011-2017 : Somalie - En octobre 2011, l'armée kényane, appuyée par les troupes somaliennes, intervient dans le conflit, lançant l'opération Linda Nchi (« protéger le pays » en swahili) contre les positions d'Al-Shabaab.
Les relations entre la Somalie et la Turquie (en) contribuent à la relative stabilisation du pays. La Turquie, qui fournit une aide humanitaire et économique importante depuis 2011, ouvre une base militaire à Mogadiscio en septembre 2017
an 2011 : Soudan - En 2011, le Sud du Soudan accède à son indépendance sous le nom de Soudan du Sud. Mais en 2012, Le conflit au Kordofan du Sud s'envenime.
an 2011 : Tchad - Jusqu'en 2011, le Tchad alimentait un flux migratoire important vers la Libye : on estime qu'au moins 500 000 Tchadiens vivaient dans ce pays en 2006. Les échanges transsahariens assuraient une relative prospérité à des villes frontalières comme Abéché. Cependant, depuis la première guerre civile libyenne en 2011, l'instabilité de ce pays rend ces échanges aléatoires ; la frontière entre la Libye et le Tchad est devenue une zone de non-droit dominée par les contrebandiers et les groupes armés.
an 2011 : Tunisie - Après la révolution et l'élection de l'Assemblée constituante, celle-ci vote une loi constituante le 10 décembre 2011 ; le nouveau texte indique dans son article 9 que le candidat à la présidence doit être musulman, de nationalité tunisienne uniquement, issu de parents tunisiens et âgé d'au moins 35 ans ; il doit démissionner, une fois élu, de toute responsabilité à l'Assemblée constituante et au sein de son parti.
an 2011 - 2014 : Zambie - À la suite de la dégradation de l'état de santé de Mwanawasa, le vice-président Rupiah Banda assure l'intérim. Après la mort du président en août 2008, Banda est élu quatrième président du pays et le reste jusqu'en septembre 2011. Le chef de l'opposition Michael Sata lui succède, et devient le cinquième président de la Zambie. Il décède à son tour, à la suite d'une maladie à Londres le 28 octobre 2014.
an 2012 : Afrique du Sud - Le massacre de Marikana en 2012, où la police tire sur des salariés grévistes faisant des dizaines de morts, entache la gouvernance de l'ANC au sein de son électorat mais lors des élections générales sud-africaines de 2014.
an 2012-2013 : République de Centrafrique - En décembre 2012, le pays est à nouveau dans une situation insurrectionnelle. Une coalition rebelle prenant le nom de Séléka (Alliance en langue sango) s'est constituée contre le régime de Bozizé. Réunissant au moins trois mouvements préexistants, cette coalition, qui dispose de troupes bien armées et disciplinées, a pris le contrôle de la ville diamantifère de Bria le 18 décembre, avant de progresser rapidement vers la capitale. Le président Bozizé espéra un temps obtenir un soutien militaire de la France ou des États-Unis, mais ces deux pays choisissent de ne pas intervenir.
Les rebelles dénoncent la non-tenue des accords par le président Bozizé, et reprennent les armes fin 2012, lançant une série d'attaques démarrant la deuxième guerre civile centrafricaine. Le 24 mars 2013, les rebelles de la coalition Seleka s'emparent de Bangui et Bozizé s'enfuit. Michel Djotodia s’auto-proclame président de la République centrafricaine. Mais les nombreuses exactions commises par les miliciens de la Seleka, majoritairement musulmans, amènent l'insécurité dans le pays, et des milices d'auto-défense, les anti-balaka se forment. Le conflit débouche sur une situation « pré-génocidaire » selon la France et les États-Unis. Le 5 décembre 2013, une résolution de l'ONU permet à la France d'envoyer des troupes armées en République centrafricaine (opération Sangaris) aux fins annoncées de désamorcer le conflit et de protéger les civils.
an 2012-2013 : Égypte - En juin 2012, Mohamed Morsi remporte l'élection présidentielle et devient ainsi le premier président du pays élu au suffrage universel dans une élection libre. Un an après son arrivée au pouvoir, le président Morsi est massivement contesté par l'opposition qui regroupe diverses factions entre laïcs de gauche, anciens partisans du régime de Moubarak et différents groupes révolutionnaires, dont Tamarod (Rebellion). Une grande partie de la population reproche au nouveau président une dérive dictatoriale et une politique menée dans le seul intérêt de son organisation, les Frères musulmans. Après des rassemblements massifs dans tout le pays, l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Sissi, lance un dernier ultimatum le 1er juillet 2013. Celui-ci est rejeté le lendemain par Mohamed Morsi qui défend sa légitimité en soulignant qu'il a été élu démocratiquement, avec 52 % des voix. Cependant, selon des observateurs, l'ultimatum a été lancé dès le mois d'avril 2013, par la coalition des opposants, alors que la situation économique était au plus mal.
an 2012 : Ghana - À la suite du décès du président en exercice le 24 juillet 2012, le vice-président John Dramani Mahama lui succède à la tête de l’État
an 2012 : Guinée-Bissau - Le 12 avril 2012, un coup d'État mené par l'armée dépose le premier ministre Carlos Gomes Júnior dans le contexte d'une élection présidentielle contestée. La CEDEAO et la CPLP prennent des positions fortes contre ce coup d'état et examinent les possibilités d'intervention politique et militaire. L'Union africaine suspend la Guinée-Bissau le 17 avril 2012. Mamadu Ture Kuruma devient de facto le dirigeant du pays. Manuel Serifo Nhamadjo, président de l'Assemblée nationale populaire, devient président de la République par intérim.
an 2012 : Libye - Le 7 juillet 2012, la Libye organise l'élection du Congrès général national, premier scrutin démocratique de son histoire. Elle se déroule dans un climat de tensions, les milices fédéralistes de Cyrénaïque se montrant hostiles au pouvoir central de Tripoli. Parmi les nombreux partis politiques formés après la chute de Kadhafi, les islamistes apparaissent comme les grands perdants du premier scrutin : l'avantage revient aux libéraux, et notamment à l'Alliance des forces nationales dirigé par Mahmoud Jibril, qui n'a cependant pas la majorité absolue. Le Congrès général national (CGN), une assemblée de 200 membres, succède au Conseil national de transition48. Mohamed Youssef el-Megaryef, islamiste modéré et opposant de longue date à Kadhafi, est élu en août président du CGN, soit chef de l'État par intérim ; en octobre, le diplomate Ali Zeidan, ancien porte-parole du CNT, devient chef du gouvernement. Le climat de violence ne cesse pas pour autant en Libye :
le 11 septembre 2012 — anniversaire des attentats de 2001, mais également dans le contexte de l'affaire du film L'Innocence des musulmans — le consulat des États-Unis à Benghazi est attaqué par un groupe armé. Quatre Américains sont tués, dont l'ambassadeur J. Christopher Stevens.
an 2012-2014 : Malawi - Conformément à la Constitution, la vice-présidente Joyce Banda est officiellement investie présidente du Malawi le 7 avril 2012 à la suite du décès de Bingu wa Mutharika. Ses premières décisions politiques la démarquent de son prédécesseur. Elle s'efforce notamment de restaurer les bonnes relations du Malawi avec les pays développés afin que l'aide internationale reprenne pleinement, notamment en revenant sur des décisions monétaires et, dans le domaine social, en dépénalisant les actes homosexuels.
an 2012 : Mauritanie - En mars 2012, Abdallah al-Senoussi, le beau-frère de Mouammar Kadhafi et ancien chef des renseignements militaires libyens recherché par la Cour pénale internationale est arrêté à Nouakchott. Il est finalement remis aux autorités libyennes, six mois plus tard, après de longues tractations. Le premier ministre libyen Ali Zeidan accuse la Mauritanie d'avoir exigé un paiement de 200 millions de dollars en échange de l'extradition Abdallah al-Senoussi.
Le 12 octobre 2012, le président Mohamed Ould Abdelaziz est blessé par balle par une patrouille militaire. Il est évacué vers la France pour y être soigné à l'hôpital Percy-Clamart près de Paris.
Situation sanitaire et humanitaire
Depuis 2012, près de 60.000 réfugiés peuls, touaregs et arabes venus du Mali, fuyant les violences des groupes jihadistes ou de l’armée malienne, ont élu domicile dans le camp de Mbera, en Mauritanie. Leur accès à l'eau potable est précaire.
an 2012 : Sénégal - Janvier 2012 : le Conseil constitutionnel se prononce pour une nouvelle candidature, jugée anticonstitutionnelle par ses opposants, du chef de l’Etat à la présidentielle de février. Il rejette la candidature du chanteur Youssou N’Dour. Cette décision provoque la colère de l’opposition.
25 mars 2012 : L’ex-premier ministre Macky Sall devient le nouveau chef de l’État sénégalais en battant au second tour de la présidentielle son rival Abdoulaye Wade qui a reconnu sa défaite avant même les résultats officiels d’un scrutin qui s’est déroulé pacifiquement.
“Mes chers compatriotes, à l’issue du second tour de scrutin de dimanche, les résultats en cours indiquent que M. Macky Sall a remporté la victoire“, a déclaré le président Wade, selon un communiqué diffusé dans la soirée par la présidence.
“Comme je l’avais toujours promis, je l’ai donc appelé dès la soirée du 25 mars au téléphone pour le féliciter“, a expliqué le chef de l’État sortant.
“Ce soir, un résultat est sorti des urnes, le grand vainqueur reste le peuple sénégalais“, a déclaré de son côté Macky Sall lors d’une conférence de presse dans la nuit dans un grand hôtel de la capitale. “Je serai le président de tous les Sénégalais“, a-t-il promis, remerciant notamment le président Wade pour son appel téléphonique.
27 mars 2012 : Macky Sall est le vainqueur de l’élection présidentielle avec 65,80% des suffrages, selon les résultats officiels provisoires annoncés par la Commission nationale de recensement des votes. Le président sortant Abdoulaye Wade obtient, lui, 34,20% des voix. Le taux de participation est à 55% des inscrits, toujours selon les mêmes résultats officiels provisoires.
Résultats officiels mardi 27 ou mercredi 28. “Ce soir une ère nouvelle commence pour le Sénégal”, s’est félicité le vainqueur du scrutin, qui lui aussi a salué la maturité des électeurs et de la démocratie sénégalaise. “L’ampleur de cette victoire aux allures de plébiscite exprime l’immensité des attentes de la population, j’en prends toute la mesure. Ensemble, nous allons nous atteler au travail“, a-t-il conclu. “C’est encore une preuve de la maturité du peuple sénégalais et de la classe politique“, a commenté le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), chargée de superviser le scrutin.
Macky Sall prendra ses fonctions le 1er avril 2012.
3 avril 2012 : Le président Macky Sall nomme Abdoul Mbaye Premier ministre. Chef d’entreprise et banquier de formation, 59 ans, Abdoul Mbaye doit former le nouveau gouvernement du Sénégal sans dépasser les 25 personnes. La nomination de M. Mbaye a été précédée du premier discours à la nation de Macky Sall qui a dit vouloir un règlement pacifique du conflit casamançais qui dure depuis près de trente ans.
an 2012 : Sierra Leone - Ernest Bai Koroma, principal opposant, candidat du Congrès de tout le peuple (APC), ex-parti unique écarté du pouvoir depuis quinze ans, succède à Ahmad Tejan Kabbah, battant au second tour son adversaire, Solomon Berewa, vice-président et candidat du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) avec 54,6 % des suffrages. Il est réélu pour un deuxième et dernier mandat le 17 novembre 2012 en remportant 58,7 % des suffrages contre 37,4 % pour son adversaire, le général Julius Maada Bio, brièvement chef de l'État en 1996. Il a maintenu la paix, amélioré le réseau routier et la fourniture en électricité, même si celle-ci reste déficiente. Pour autant, le pays reste un des plus pauvres d'Afrique, malgré ses mines de diamant.
an 2013 : République de Centrafrique - Face au risque de génocide, la France annonce, le 26 novembre 2013, l'envoi d'un millier de soldats pour rétablir la sécurité dans le pays. Le 5 décembre 2013, par la résolution 2127, le conseil de sécurité des Nations unies autorise le « déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) pour une période de 12 mois » officiellement pour mettre fin à la « faillite totale de l'ordre public, l'absence de l'état de droit et les tensions interconfessionnelles ». La MISCA est appuyée par des forces françaises (opération Sangaris), autorisées à prendre « toutes les mesures nécessaires ».
an 2013 : Congo Kinshasa - Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise appuyée par une brigade d'intervention de l'ONU chasse les rebelles du M23 des dernières positions qu'ils occupaient dans les montagnes du Nord-Kivu, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda, les rebelles déposent les armes et dissolvent leur mouvement en décembre 2013 dans un traité de paix signé à Nairobi.
an 2013-2014 : Afrique République de Djibouti - En 2013, les élections législatives aboutissent à une grave crise électorale et une répression du régime contre l'Union pour le salut national (USN), coalition des sept partis djiboutiens d'opposition. Elle aboutit à la signature entre cette dernière et le gouvernement d'un accord-cadre politique le 30 décembre 2014. Les dix députés de l'opposition qui commencent à siéger peu de temps après sont les premiers depuis l’indépendance.
an 2013-2013 : Égypte - Mohamed Morsi est remplacé par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Adli Mansour, qui prête serment comme président par intérim. Le 4 juillet 2013, on apprend que Mohamed Morsi est détenu par l'armée et que des mandats d'arrêt sont émis à l'encontre des dirigeants des Frères musulmans. Le 5 juillet 2013, le Parlement est dissous. Le 26 juillet 2013, l'armée déclare que Mohamed Morsi est en prison dans l'attente de son procès pour collusion avec le mouvement palestinien du Hamas.
Fin 2013, le nouveau pouvoir militaire est à son tour la cible de contestations, notamment à cause de la répression de manifestations et de l'arrestation d'activistes démocrates.
an 2013 : Gambie - Alors qu'elle en est membre depuis 1965, la Gambie, par la voix de son ministre de l'Intérieur, annonce le 2 octobre 2013 son retrait du Commonwealth. Le pays refuse les injonctions du Royaume-Uni au sujet des droits de l'homme alors que le régime du président Yahya Jammeh se fait plus autoritaire et accuse l'organisation d'être néo-coloniale.
an 2013 : Kenya - Pour la première fois des débats présidentiels télévisés sont organisés les 11 et 25 février 2013. Également, pour la première fois, certains bureaux de vote sont équipés pour transmettre électroniquement les résultats vers la commission indépendante IEBC chargée de comptabiliser les résultats des élections générales.
Huit candidats ont posé leur candidature lors de l'élection présidentielle du 4 mars 2013. Pour l'emporter au premier tour, un candidat doit réunir au moins 25 % des votes dans au moins 24 comtés différents et 50 % de l'ensemble des votes plus un (majorité absolue).
Depuis la première élection présidentielle multipartisme de 1992, l'appartenance d'un candidat à tel ou tel groupe tribal a toujours été un élément important dans le choix des électeurs. Uhuru Kenyatta avec son colistier William Ruto sont respectivement kikuyu et kalenjin (premier et quatrième groupe tribal du pays) alors que son adversaire Raila Odinga et son colistier Kalonzo Musyoka sont luo et kamba (troisième et cinquième groupe). Uhuru Kenyatta est déclaré vainqueur dès le premier tour de l'élection du 4 mars 2013 avec 50,07 % des suffrages devant Raila Odinga avec 43,31 %. Ce dernier conteste les élections et, conformément à la possibilité donnée par l'article 140.1 de la Constitution, dépose, en date du 16 mars 2013 une pétition à la Cour suprême pour contester la validité du scrutin présidentiel arguant des bourrages d'urnes, les dysfonctionnements du système électronique de transmission vers l'IEBC et l'inorganisation de cette dernière. La Cour rend son jugement le 30 mars suivant en déclarant que « l'élection générale fut libre et impartiale » et que « Uhuru et son colistier Ruto ont été valablement élus » et en publie la version intégrale le 16 avril.
Présidence de Uhuru Kenyatta
Uhuru Kenyatta est investi en tant que 4e président du Kenya le 9 avril 2013 au centre sportif international Moi de Kasarani (Nairobi).
D'emblée, il s'oppose à la demande des députés d'obtenir une augmentation de 60 % de leur salaire29 et réduit le nombre de ministères et secrétariats d’État, de quarante-deux sous la présidence de son prédécesseur, à dix-huit30. Cinq femmes deviennent ministres31 dont deux à des postes très importants comme Amina Mohamed aux Affaires étrangères et Raychelle Omano à la Défense.
Lors de son discours prononcé lors du Madaraka Day (célébration de l'autonomie du pays au 1er juin 1963) du 1er juin 2013, il réaffirme la teneur de la Constitution à propos de la gouvernance des comtés, rappelle les huit anciens commissaires provinciaux vers d'autres fonctions et met, ainsi, fin aux dissensions entre les gouverneurs et les commissaires.
L'organisation État islamique et les chebabs multiplient les attaques au Kenya dans les années 2010, mettant en échec la politique sécuritaire du gouvernement. À ces attaques, s'ajoute une instabilité politique interne dans les mois qui précèdent les élections générales d'août 2017. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, est finalement réélu et affiche un score électoral de 54,28 % des suffrages exprimés. Son rival Raila Odinga parle de fraudes. Des émeutes éclatent avant un appel au calme par l'opposant Raila Odinga, qui s'en remet à la Cour suprême. Celle-ci, à la surprise générale, lui donne cette fois raison et invalide les élections, qui sont réorganisés en octobre 2017. Cette décision montre une consolidation des contre-pouvoirs au Kenya à la suite de la constitution de 2010. Uhuru Kenyatta fait procéder à des modifications de la loi électorale avant ce nouveau scrutin, ce qui provoque le retrait de Raila Odinga, qui appelle au boycott de l'élection. Finalement, le président sortant Uhuru Kenyatta remporte le nouveau scrutin avec 98,26 % des voix, mais la participation le 26 octobre 2017 n'est que de 38,8 % des électeurs inscrits, à comparer à 79 % le 8 août 2017, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême. Le 13 mai 2021, le projet de réforme constitutionnelle de Uhuru Kenyatta est jugé illégal. Le 20 août 2021, La Cour d'appel du Kenya a confirmé l'illégalité du processus de révision constitutionnelle lancé par le président Uhuru Kenyatta mettant fin définitivement à ce projet de révision constitutionnelle.
an 2013 : Libye - En mai 2013, sous la pression des milices révolutionnaires, le parlement libyen adopte une loi dite de « bannissement politique », excluant de toute fonction officielle les personnes ayant occupé des responsabilités, à un moment ou à un autre, sous le régime de Kadhafi. Le radicalisme de cette loi, qui frappe de fait une grande partie des dirigeants libyens, provoque une crise politique et plusieurs démissions, privant la Libye d'un personnel politique expérimenté. Le président du Congrès général national Mohamed Youssef el-Megaryef, qui avait été ambassadeur sous Kadhafi avant de rejoindre la dissidence, est contraint de quitter ses fonctions. Fin juin, Nouri Bousahmein est élu président du GNC. Le premier ministre Ali Zeidan a quant à lui le plus grand mal à imposer son autorité face aux différents chefs de milices, qui tiennent notamment les champs pétroliers de Cyrénaïque, avec le soutien des tribus : en octobre 2013, il est séquestré quelques heures par un groupe armé, avant d'être relâché. En novembre 2013, des rebelles autonomistes proclament en Cyrénaïque un gouvernement, défiant celui de Tripoli qu'ils disent aux mains des islamistes.
an 2013 - 2018 : Madagascar - L’élection présidentielle malgache de 2013 fait de Hery Rajaonarimampianina le président de la IVe république et son Premier ministre est Roger Kolo. Mais Hery Rajaonarimampianina, qui remporte cette élection considérée par les observateurs comme démocratique, dispose alors du soutien politique d'Andry Rajoelina, avec qui il est conduit à prendre progressivement ses distances. Le nouveau président manque dès lors de soutien politique tout en étant confronté à une ploutocratie aux commandes du pays. La crise politique est doublée d'une crise économique persistante. Le 14 janvier 2015, le général de brigade aérienne Jean Ravelonarivo est nommé Premier ministre en remplacement de Roger Kolo. En mai 2015, le président est destitué par l’Assemblée nationale, mais la décision est ensuite annulée par la justice malgache. Olivier Mahafaly Solonandrasana remplace Jean Ravelonarivo le 10 avril 2016, mais pour calmer le pays en proie aux émeutes, il est contraint à la démission et remplacé par Christian Ntsay le 4 juin 2018. Les élections de décembre 2018 portent au pouvoir pour 5 ans Andry Rajoelina. Celui-ci remporte également les élections législatives de mai 2019 et obtient la majoprité absolue à l'Assemblée nationale.
an 2013 : Mauritanie - Le 18 février 2013, les forces armées mauritaniennes annoncent le début d'exercices militaires dans le sud-est du pays avec la participation de dix-neuf pays européens, africains et arabes.
En 2013, les élections législatives de novembre et décembre confortent la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale.
an 2013-2015 : Nigéria - En 2013, le Nigeria devient aussi la première économie d'Afrique, avec un Produit intérieur brut de 510 milliards de dollars, dépassant l'Afrique du Sud, même si ce dernier pays reste en tête en termes de PIB par habitant.
À la suite de l'élection présidentielle de 2015, Muhammadu Buhari est élu. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine du Nigéria qu'une transition à la tête de l'État se fait de façon démocratique.
an 2013-2019 : Somalie - Le 11 janvier 2013, l'armée française lance une opération militaire afin de libérer l'otage Denis Allex de la DGSE détenu par les Al-Shabbaab à Buulo Mareer depuis 2009 mais celle-ci s'avérera être un échec.
Le groupe terroriste Harakat al-Chabab al-Moudjahidin multiplie les attaques depuis 2008, et notamment en 2019 : en juillet, contre un hôtel de Kismaayo, puis sur la route d’accès à l’aéroport de Mogadiscio et quelques jours plus tard contre la mairie de Mogadiscio, contre un hôtel de hôtel à Mogadiscio le 10 décembre 2019 puis le 28 décembre sur un poste de contrôle à l'entrée de Mogadiscio (cette dernière attaque faisant 81 morts).
Outre le terrorisme, les Somaliens sont victimes de la violence d’État de certains pays de la région. Ainsi, 42 réfugiés sont tués en mars 2017 dans une attaque aérienne saoudienne sur la mer Rouge.
Les Nations unies estiment que 1,7 million de personnes manquent de nourriture à cause de la sécheresse en mai 2019, et que leur nombre va augmenter d'un demi-million d'ici à juillet. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont contraintes d'abandonner leur foyer pour tenter de trouver de la nourriture, venant ainsi s'ajouter aux 2,6 millions de personnes déjà déplacées dans le pays du fait de la sécheresse et de la guerre.
an 2013-2015 : Togo - En 2013, de nouvelles élections législatives sont organisées. Le parti Unir obtient 62 sièges sur 91 soit la majorité absolue. L'ANC devient le premier parti de l'opposition avec 19 sièges. Un regroupement des principaux partis d'opposition (le Combat pour l'alternance politique) dénonce par avance des fraudes massives pour l'élection présidentielle de 2015.
an 2014 : Afrique du Sud - Jacob Zuma est réélu pour un second mandat, l'ANC restant nettement en tête dans l'électorat bien qu'en recul face à l'Alliance démocratique et aux Combattants pour la liberté économique de Julius Malema.
an 2014 : Algérie - Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat en 2014
an 2014 : Burkina Faso - Le 30 octobre 2014, Blaise Compaoré fait face à un soulèvement populaire contre son projet de modification de l'article 37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels, afin de se représenter en 2015. À la suite des émeutes, Blaise Compaoré quitte le pouvoir.
Le chef d'état-major des armées Honoré Traoré annonce le 31 octobre la création d'un « organe de transition », chargé des pouvoirs exécutif et législatif, dont l'objectif est un retour à l'ordre constitutionnel « dans un délai de douze mois ». Le 1er novembre 2014, l'armée publie un communiqué qui affirme son soutien à Isaac Zida comme président de transition. Honoré Traoré en est un des signataires, ce qui implique son renoncement au pouvoir. Le 17 novembre 2014, le diplomate Michel Kafando est nommé président de transition. Il nomme Isaac Zida Premier ministre.
an 2014-2018 : Afrique du Sud - Jacob Zuma est, en 2014, réélu pour un second mandat avec Cyril Ramaphosa comme vice-président. Il ne peut achever son second mandat et est poussé par son parti à la démission en février 2018.
La presse dresse alors un bilan négatif de ses deux mandats marqués par de multiples scandales de corruption, des accusations de prévarication, un échec aux élections municipales sud-africaines de 2016, marquées par un recul de l'ANC dans les métropoles et une popularité en berne affectant son parti.
an 2014-2015 : Algérie - L'attentat du 19 avril 2014 contre l'Armée nationale populaire (ANP) entraîne la mort de 11 militaires, celle du 17 juillet 2015 la mort de 11 à 13 soldats
an 2014 : République de Centrafrique - Le 10 janvier 2014, le président de la transition centrafricaine Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaye annoncent leur démission lors d'un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).
Le 20 janvier 2014, le Conseil national de transition de la République centrafricaine élit Catherine Samba-Panza comme chef de l'État de transition de la République centrafricaine. Au printemps 2014, trois journalistes sont tués, dont la française Camille Lepage, sur fond de sanctions de l'ONU.
Le 23 juillet 2014, les belligérants signent un accord de cessation des hostilités à Brazzaville. En dépit de cet accord, le pays est divisé en régions contrôlées par des milices, « sur lesquelles ni l’État ni la mission de l’ONU n’ont prise ».
an 2014 : République de Djibouti - En mai 2014, le pays est victime d'un attentat suicide dans le restaurant La Chaumière. Selon les informations, deux ou trois kamikazes (dont une femme) se seraient fait exploser en entrant dans le restaurant. Un mort, un ressortissant turc, a été recensé, et plusieurs blessés, dont des coopérants français présents dans le restaurant, ainsi qu'une jeune femme originaire des Pays-Bas. L'un des kamikazes n'a pas pu entrer dans le restaurant. Il s'est jeté sur la terrasse en déclenchant sa ceinture explosive.
2014 - 2030 : Égypte - En mai 2014, Abdel Fattah al-Sissi, déjà considéré comme le dirigeant de fait de l'Égypte, remporte l'élection présidentielle. Il est réélu pour un deuxième mandat en 2018. Par une révision constitutionnelle validée par un référendum en avril 2019, il se donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Il impose une logique autoritaire, réprime toute opposition et toute voix critique , et met sous contrôle les médias et la justice. La répression touche notamment des médias, des blogueurs, des journalistes, dont des personnalités féminines comme Israa Abdel Fattah ou Solafa Magdy.
La population égyptienne dépasse les cent millions d’habitants en février 2020. Elle progresse d’un million supplémentaire tous les six mois. Le taux de fécondité est passé de 5,3 enfants par femme en 1980 à 3 en 2008, puis est remonté à 3,5 en 2014. A titre de comparaison, l’Iran connaît un taux de fécondité de 1,8 enfants par femme et la Tunisie de 2,2. Cette croissance de la population égyptienne intervient de plus sur une bande de terre limitée essentiellement à la vallée du Nil et à son delta, représentant moins de 5% de la superficie d’un pays relativement désertique. La proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté semble un élément déterminant. Les Égyptiens les plus pauvres, ne disposant pas d'aide publique adaptée, veulent s'appuyer sur leur progéniture pour assurer leur besoins quotidiens.
Par ailleurs, l'armée égyptienne semble perdre progressivement le contrôle de la péninsule du Sinaï face à la guérilla jihadiste, une branche locale de l'État islamique.
an 2014 : Gambie - Le 30 décembre 2014, une autre tentative de coup d’État a lieu en Gambie pendant que Jammeh est à Dubaï. Il accuse fortement les puissances occidentales d’avoir aidé des terroristes pour le renverser. La répression et les accusations arbitraires s'accentuent.
an 2014-2015 : Guinée - En 2014 et 2015, le pays est touché par l'épidémie Ebola mais se mobilise pour en contenir les impacts.
an 2014 : Guinée-Bissau - En 2014, José Mário Vaz remporte l'élection présidentielle du 13 avril 2014, marquant le retour progressif à la légalité constitutionnelle. Pour autant, l'instabilité persiste, et les premiers ministres se succèdent.
an 2014 : Leshoto - Le Lesotho demeure l'un des pays les plus pauvres du monde : en 2014, l'indice de développement humain (IDH) le classe au 162e rang sur 187 pays.
an 2014 : Libéria - En 2014, le Liberia, avec ses voisins la Guinée et la Sierra Leone, est touché par une épidémie de maladie à virus Ebola, qui désorganise sérieusement la vie du pays. Cette épidémie fait des milliers de morts.
an 2014 : Libye - Le 20 février 2014, sans passion et au milieu d'épisodes de violences, les Libyens élisent leur assemblée constituante. Le scrutin se déroule dans un contexte d'instabilité politique persistante, alors que le gouvernement d'Ali Zeidan, qui tente de poser les bases d'un État, est de plus en plus discrédité. Le Congrès général national provoque également le mécontentement de la population et de la classe politique en prolongeant son mandat d'un an, jusqu'en décembre 2014, et en laissant à un futur parlement, dont la date n'est toujours pas décidée, la tâche de décider de la nature d'une élection présidentielle. Minoritaires au Congrès, les islamistes gagnent cependant en influence dans l'assemblée et accaparent de plus en plus de pouvoir, laissant peu de marge de manœuvre au gouvernement. Un bras de fer oppose le premier ministre au Congrès général national jusqu'en mars 2014, date à laquelle le Congrès démet par un vote le chef du gouvernement : les islamistes se débarrassent ainsi d'un de leurs principaux adversaires. Abdallah al-Thani assure l'intérim après le départ de Zeidan. La Libye n'a alors toujours pas réussi à former d'armée ou de police réellement professionnels, laissant en grande partie le terrain à diverses factions armées et des ex-chefs rebelles.
Le 30 mars, le Congrès général national décide de laisser la place à une Chambre des représentants, qui devra être élue en juin. Le 4 mai, le Congrès général national élit Ahmed Miitig au poste de premier ministre : la validité de cette élection est aussitôt contestée, les rebelles autonomistes de l'Est annonçant quant à eux qu'ils refusent de reconnaître ce gouvernement. Le général Khalifa Haftar, chef d'état-major de l'Armée nationale libyenne, défie ouvertement le Congrès général national dominé par les islamistes, exigeant sa dissolution et la mise en place d'un « Conseil présidentiel » pour mieux assurer l'autorité de l'État. Les 16 et 18 mai, des forces loyales à Haftar attaquent des milices à Benghazi, puis le siège du CGN à Tripoli, faisant plusieurs dizaines de morts60. En juin, la justice invalide l'élection de Miitig ; Abdallah al-Thani revient alors à la tête du gouvernement. Les élections législatives se déroulent le 25 juin : 12 des 200 sièges du nouveau parlement ne sont pas pourvus, les votes ayant été annulés dans diverses localités en raison des violences. Le Parti de la justice et de la construction, proche des islamistes, est nettement minoritaire.
L'instabilité persiste ensuite en Libye, qui s'avère incapable de construire un véritable pouvoir central et de mettre un terme au désordre et à la violence dans le pays, où les milices continuent de s'arroger un pouvoir de fait. En juillet 2014, la mission de l'ONU évacue son personnel après des affrontements à Tripoli et Benghazi, qui font plusieurs victimes. Toujours en juillet, la milice de Misrata alliée à des groupes islamistes affronte la milice de Zenten alliée à d'anciens soutiens de Khadafi pour le contrôle de l'aéroport de Tripoli, tandis que d'autres groupes combattent en Cyrénaïque pour le contrôle des ressources pétrolières.
Après les élections, la passation de pouvoir entre le Congrès général national et la nouvelle Chambre des représentants est annulée : le nouveau parlement, boycotté par les élus islamistes et présidé par Aguila Salah Issa, tient sa session inaugurale à Tobrouk. Fin août, la coalition « Aube de la Libye » (Fajr Libya) formée par les groupes islamistes, prend le contrôle de Tripoli et reforme le Congrès général national : Nouri Bousahmein est réélu au poste qu'il occupait avant les élections, tandis qu'Omar al-Hassi devient le nouveau premier ministre. L'Égypte et les Émirats arabes unis mènent des bombardements répétés sur la capitale libyenne.
an 2014 : Malawi - En mai 2014, Joyce Banda perd l'élection présidentielle, au profit du frère de Bingu wa Mutharika, Peter Mutharika. Le pays, comme d'autres en Afrique australe, est confronté à des phénomènes climatiques difficiles, alternant sécheresse et inondations, dont les effets sont aggravés par la déforestation, mais connait une croissance de son PIB. Peter Mutharika est réélu pour un deuxième mandat lors de l’élection présidentielle de 2019, dans un scrutin serré. L'opposition dénonce des résultats frauduleux. Le 3 février 2020, la cour constitutionnelle, constatant des irrégularités, annule l'élection.
an 2014 : Mali - Interventions de troupes françaises (opération Serval puis Barkhane)
Cette opération Serval semble être un succès dans un premiers temps : les villes ont été reprises ainsi que le territoire du nord du pays, un dialogue est rétabli avec les différentes composantes Touareg et l’État malien est stabilisé. Mais Al-Qaida au Maghreb islamique change d'approche,et se reconstitue. L'organisation procède désormais par des incursions ponctuelles et par des attentats, et le maintien sur place des troupes françaises et africaines, dans l'organisation initiale de ces forces, se révèle coûteux. Il est décidé de substituer l’opération Barkhane à l'opération Serval, pour sécuriser la bande sahélo-saharienne, avec la mission de lutter contre les groupes djihadistes et d’empêcher la constitution de sanctuaires terroristes dont le quartier-général semble établi à N’Djamena. Le nouveau dispositif est officiellement lancée le 1er août 2014.
an 2014 : Mauritanie - Le 2 février 2014, le Premier ministre Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf, en poste depuis le début du mandat du président Aziz, présente la démission de son gouvernement. Il est reconduit dans ses fonctions dès le lendemain et chargé de former un nouveau gouvernement qui compte onze nouvelles personnalités dont cinq femmes.
Le 21 mai 2014, les ministres de l'Intérieur du groupe des Cinq du Sahel, dont fait partie la Mauritanie, créent une « plateforme de coopération sécuritaire » destinée notamment à « lutter contre le terrorisme » à Nouakchott.
Le 4 juin 2014, des milliers de sympathisants manifestent à Nouakchott contre le mode d'organisation des élections présidentielles à l'appel du Forum national pour la démocratie et l'unité (FNDU, opposition radicale).
Mohamed Ould Abdel Aziz remporte une victoire écrasante et attendue à la présidentielle le 21 juin 2014, et recueille 81,94% des suffrages, avec un taux de participation de 56,55%. Investi le 2 août pour son second mandat, il nomme comme Premier ministre Yahya Ould Hademine, ancien ministre de l'Equipement et des Transports du précédent gouvernement.
Le 3 novembre 2014, le responsable du parti islamiste modéré Tewassoul Elhacen Ould Mohamed est nommé à la tête de l'opposition démocratique.
Le 25 décembre 2014, pour la première fois depuis son indépendance, une condamnation à mort pour apostasie est prononcée en Mauritanie à Nouadhibou (au nord-ouest du pays) à l'encontre d'un citoyen mauritanien musulman, inculpé après avoir publié sur internet un texte considéré comme blasphématoire. Le 21 avril 2015, la peine de mort est confirmée pour le blogueur Mohamed Cheikh ould Mkheitir, qui est détenu depuis janvier 2014 pour un article jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. Le 31 janvier 2017 la Cour suprême renvoie devant une autre cour d'appel le dossier de Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir, le blogueur condamné à mort pour apostasie et emprisonné depuis 3 ans. Il est libéré le 29 juillet 2019 et ne cesse de dénoncer les discriminations ethniques et sociales en Mauritanie.
Esclavage
Le 6 mars 2014, avec l'appui de l'ONU, la Mauritanie adopte un plan pour l'éradication de l'esclavage.
En novembre 2014, les autorités mauritaniennes ferme le siège de l'IRA, une ONG anti-esclavagiste qu'elles accusent de propager la haine entre les populations.
Situation sanitaire et humanitaire
Le 24 octobre 2014, le gouvernement annonce le renforcement des contrôles de sa frontière avec le Mali à la suite de l'annonce du premier cas d'Ebola dans ce pays.
an 2014 : Mozambique - Le 15 octobre 2014, le FRELIMO propose un nouveau candidat à l'élection présidentielle, Filipe Nyusi qui est élu au premier tour, au cours d’un scrutin parsemé de fraudes et contesté par l’opposition, comme chaque fois. Afonso Dhlakama, chef du RENAMO, principale force d'opposition, double cependant son score de 2009, et réunit 37 % des suffrages exprimés. La situation post-électorale est tendue et le RENAMO semble pendant quelques mois reprendre une insurrection militaire, comme pendant les heures noires de la guerre civile qui a duré de 1976 à 1992.
an 2014 : Namibie - En 2014 a lieu l'Élection présidentielle namibienne de 2014, Elle est remportée par le candidat de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO), Hage Geingob, avec 86,73 % des suffrages.
an 2014 : Nigéria - L'année 2014 est marquée par la montée en puissance du groupe, qui kidnappe notamment plus de 200 lycéennes, provoquant des réactions d'indignations mondiales.
an 2014-2015 : Sierra Leone - Le pays est touché par l'épidémie d’Ebola en 2014 et 2015, qui fait 4 000 morts, et, en 2017, par des inondations meurtrières.
an 2014 : Tunisie - L'article 37 de la loi électorale, votée en application de l'article 74 de la Constitution de 2014, permet à tout électeur de confession musulmane, âgé d'au moins 35 ans et jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance de se présenter à l'élection présidentielle ; il doit présenter, s'il est titulaire d'une autre nationalité, un engagement stipulant l'abandon de son autre nationalité en cas d'élection. L'article 38 de la même loi exige que le candidat soit parrainé par dix élus de l'Assemblée des représentants du peuple ou par 10 000 électeurs, tout en stipulant qu'il est interdit au même parrain de parrainer plus d'un candidat. L'article 39 exige enfin le dépôt d'une caution de 10 000 dinars auprès du trésor public, qui est restituée au candidat s'il obtient plus de 3 % des suffrages exprimés.
L'Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de statuer et de fixer la liste des candidatures approuvées dans un délai de quatre jours à compter de la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures ; toute décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.
an 2015 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - la présidence Kaboré (2015-2022). - Des élections sont prévues initialement en octobre 2015, pour passer de cette période de transition à un fonctionnement démocratique stabilisé. Mais une tentative de coup d'état, (qualifié par des burkinabés de « coup d'état le plus bête du monde ») retarde l'échéance prévue pour cette consultation électorale.
Le 16 septembre 2015, en effet, le président de transition, le premier ministre et quelques membres du gouvernement sont pris en otages par des troupes armées, le Régiment de sécurité présidentielle, sous les ordres du général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Comparé. Des manifestations sont réprimées. Finalement, les autorités de transition sont rétablies, et le fameux régiment de sécurité présidentielle est désarmé fin septembre 2015. Les élections ont lieu en novembre 2015.
Le 30 novembre 2015, à la suite des élections présidentielles et législatives, Roch Marc Christian Kaboré (MPP) est élu au premier tour président du Burkina Faso avec 53,49 % des voix devant Zéphirin Diabré (UPC), qui récolte 29,65 % des voix, les douze autres candidats se partageant le reste. Il est le deuxième président civil depuis l'accès à l'indépendance du Burkina Faso après Maurice Yaméogo.
Depuis 2016, le Burkina Faso est touché par un certain nombre d'attaques menées par des groupes armés djihadistes : le 15 janvier 2016 ont lieu les attentats de Ouagadougou, des hommes armés attaquent le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ces lieux sont fréquentés principalement par des occidentaux. L'attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fait 30 morts. En août 2017, une autre attaque djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou. Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste visant l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou fait 8 morts, tous des militaires et plus de 80 blessés (civils et militaires). Cette attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
an 2015 : Burundi - Pierre Nkurunziza décide de briguer un troisième mandat à la présidence de la République et s'impose en avril comme le candidat du pouvoir pour l'élection présidentielle du 26 juin 2015. Cette décision est contraire à la constitution du Burundi, promulguée en mars 2005. Sa candidature est néanmoins validée par une décision controversée de la Cour constitutionnelle.
Le 13 mai 2015, Pierre Nkurunziza, en déplacement, est victime d'une tentative de coup d'État de la part du général Godefroid Niyombare.
Le 15 mai, après de violents combats dans le centre-ville de Bujumbura, les putschistes annoncent leur reddition et le pouvoir indique le retour imminent du président Nkurunziza. Les jours qui suivent voient une répression sanglante de l'opposition de la part du président. Cette répression fait des centaines morts et provoque des départs massifs : des centaines de milliers de burandais se réfugient à l'extérieur du pays . Après plusieurs reports, l'élection présidentielle, jugée illégale et truquée par tous les observateurs de la politique burundaise, se tient finalement le
21 juillet. Le 24 juillet, la commission électorale nationale indépendante proclame Nkurunziza vainqueur avec 69,41 % des suffrages.
.
an 2015-2016 : République de Centrafrique - Une élection présidentielle est organisée en décembre 2015 et janvier 2016. Faustin-Archange Touadéra arrive deuxième du premier tour avec 19 % des voix, derrière son opposant, Anicet-Georges Dologuélé qui arrive en tête avec 23,7 %. Il est finalement élu président de la République à l'issue du deuxième tour, avec 62,7 % des suffrages contre 37,3 % à Anicet-Georges Dologuélé. Ce nouveau président de la République lance un processus de réconciliation nationale afin de rendre justice aux victimes des guerres civiles, la plupart déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pour ce faire, il charge par décret son ministre conseiller, Regina Konzi Mongot, d'élaborer le Programme national de réconciliation nationale et de paix, proposé en décembre 2016, adopté en séance tenante à l'unanimité par les organismes internationaux.
an 2015 : Congo Brazzaville - En 2015, Denis Sassou-Nguesso organise une série de consultations avec des personnalités politiques du pays afin d’examiner une possible modification de la constitution en vigueur dans le pays depuis 2002. La démarche est vivement critiquée par une partie de l’opposition qui y voit une manœuvre afin de pouvoir se présenter une troisième fois à la présidence de la République (la Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels à deux et l’âge pour se présenter à la présidence de la République à 70 ans). La majorité assure de son côté souhaiter renforcer les institutions du pays en passant d’un régime présidentiel à un régime semi-parlementaire.
Le 25 octobre 2015, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Elle entre en vigueur le 6 novembre 2015, après sa promulgation par Denis Sassou-Nguesso.
an 2015-2017 : Congo Kinshasa - En 2015, des tensions apparaissent dans la perspective de l'élection présidentielle de 2016 et d'un éventuel prolongement de mandat de Joseph Kabila. L'article 70 de la Constitution du pays, datée de 2006, dispose que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Prétextant un délai supplémentaire de seize mois et un jour pour finaliser l’enregistrement des 30 millions d’électeurs, la commission électorale a annoncé le 20 août 2016, que l'élection présidentielle ne pouvait pas se dérouler avant juillet 2017. Le 19 septembre 2016, lors d’un rassemblement à Kinshasa contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, au moins dix-sept personnes sont mortes (3 policiers et 14 civils) durant la manifestation. Après la crise de confiance dans les institutions résultant de cette décision, des mouvements insurrectionnels sont signalés dans différentes provinces : milice Kamwina Napsu dans le Kasaï central, Bundu dia Kongo dans le Kongo central, Pygmées contre Bantous dans le Tanganyika, réactivation du M23. L'économie pâtit de la situation, et le phénomène des enfants soldats est en recrudescence.
Le 11 octobre 2017, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Corneille Nangaa, annonce que le scrutin pour remplacer Joseph Kabila ne pourra pas avoir lieu avant 504 jours, en raison du recensement encore en cours dans les régions du Kasaï, jusqu'en décembre 2017, puis de l’audit du fichier électoral par les experts, de l’élaboration de la loi portant répartition des sièges au parlement et de plusieurs autres opérations techniques et logistiques nécessaires avant la tenue des élections, prévue au premier semestre 2019. Ce nouveau report des élections suscite l'indignation de l'opposition, ainsi que nombre d'ONG.
an 2015-2016 : Afrique Côte d'Ivoire - À la suite de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015, le président Ouattara est réélu pour cinq ans. Il souhaite consolider les efforts de réconciliation nationale et rédiger une nouvelle Constitution. Cette nouvelle Constitution, qui entraine la création d'un sénat et d'un poste de vice-président, est approuvée par référendum le 30 octobre 2016. La troisième République Ivoirienne est proclamée le 8 novembre 2016.
an 2015 : Guinée - Le 11 octobre 2015, le président Alpha Condé obtient 58 % des suffrages et est réélu au premier tour de l'élection présidentielle pour un nouveau mandat de 5 ans.
an 2015 : Libye - Le gouvernement de Tobrouk — seul à être reconnu par la communauté internationale — et celui de Tripoli se disputent dès lors le pouvoir, en même temps que le contrôle des puits de pétrole, tandis que le pays entier est en proie à la violence et aux affrontements de groupes armés, tribaux ou djihadistes. La déliquescence de la Libye contribue à faire du pays l'une des principales zones de transit de l'immigration clandestine à destination de l'Europe. Par ailleurs, à la faveur du chaos politique, l'État islamique s'implante en Libye et lance des attaques, notamment à Misrata et à Syrte. L'ONU s'efforce d'amener les belligérants libyens à s'unir pour contrer l'État islamique. Le 10 juillet 2015, le gouvernement de Tobrouk signe finalement avec une partie des groupes armés un accord de paix proposé par l’ONU : celui de Tripoli rejette au contraire le texte et n'envoie pas de délégation à la signature.
an 2015 : Mauritanie - Le 28 janvier 2015 débute une grève de 9 semaines affectant les sites de production et d'exportation de la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM). Les revendications portent sur des augmentations de salaire. Après 9 semaines de grève la reprise du travail se déroule le 3 avril à la suite de l'ouverture de négociations et de la réintégration de grévistes licenciés.
Le 6 aout 2015, un islamiste malien, ancien porte-parole d'Ansar Dine, un groupe lié à Al Qaïda, et visé par un mandat d'arrêt international l'accusant de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, meurtre et actes terroristes est libéré par la Mauritanie, où il était détenu depuis plusieurs mois.
Le 2 septembre 2015, un remaniement ministériel remercie huit ministres, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Equipement.
Le 17 novembre 2015, la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie (SNIM) ouvre un nouveau complexe minier sur le site de Zouerate, dans le nord du pays. Dénommé Guelb II, c'est le plus important projet industriel de l’histoire de la Mauritanie, dans lequel près d’un milliard de dollars ont été investis.
Le 10 février la présidence annonce un nouveau remaniement et le départ de cinq ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de l'Économie.
Le 7 mai 2015 l'opposition appelle a manifester contre le projet de révision constitutionnelle annoncé par le président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui prévoit entre autres choses la suppression du Sénat. Des heurts avec les forces de l'ordre feront plusieurs blessés. Le 29 septembre 2015, après de longues négociations entre pouvoir et opposition, s'ouvre un nouveau dialogue national. L'initiative est le point de départ qui doit amener à une réforme constitutionnelle, portant notamment sur la suppression du Sénat et la création du poste de vice-président. Une partie importante de l'opposition accuse le président Mohamed Ould Abdel Aziz de vouloir modifier le texte fondamental dans le but se présenter pour un troisième mandat. Le 20 octobre 2015 un accord politique marquant la fin du dialogue national est signé entre la majorité et quelques partis d'opposition. Plusieurs révisions constitutionnelles sont retenues, mais pas la suppression de la limitation des mandats présidentiels est rejetée.
Esclavage
Le 1er juillet 2015, six militants anti-esclavage de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) sont arrêtés, marquant le début d'une série d'arrestations dans les rangs de l'IRA. Leur procès débute le 3 août 2015 et dure quinze jours à l'issue desquels la Cour criminelle condamne la plupart des accusés à des peines de prison allant de trois à huit ans. Treize d'entre eux disent avoir été torturés durant leur détention.
Le 13 août 2015, le Parlement adopte une loi durcissant la répression de l'esclavage, considéré désormais comme un « crime contre
l'humanité ».
Situation sanitaire et humanitaire
Le 9 octobre 2015, la Mauritanie alerte l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'épidémie de fièvre qui sévit dans la vallée du rift
an 2015 : Nigéria - Début 2015, Boko Haram rase plusieurs villes et villages du nord-est du pays. Cette série d'attaques pousse les voisins du Nigéria, le Tchad, le Niger et le Cameroun à intervenir contre la secte islamiste. En 2015, Boko Haram fait allégeance à l'État islamique.
an 2015 : Tchad - Depuis 2015, l'armée tchadienne est engagée dans le conflit contre le groupe djihadiste Boko Haram, répandu dans le Nord du Nigeria et du Cameroun. En représailles, ce groupe a commis plusieurs attaques en territoire tchadien.
an 2015-2020 : Togo - Faure Gnassingbé est à nouveau réélu lors de l'élection présidentielle d'avril 2015, avec 58,75 % des suffrages exprimés, contre 34,95 % pour son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Une élection jugée libre et transparente par l'UE et les principaux observateurs internationaux. L'abstention s'élève à 40,01 %, contre 35,32 % à la précédente présidentielle de 2010. Du côté de l'opposition, Tchabouré Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI), a obtenu 3,08 % des suffrages, Komandega Taama, président du Nouvel engagement togolais (NET), 1,06 %, et Mouhamed Tchassona-Traoré, président du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (MCD, opposition), 0,99 %. Il nomme Premier ministre Komi Sélom Klassou le 5 juin 2015 jusque-là premier président de l'Assemblée nationale. Faure Gnassingbé se présente pour un quatrième mandat lors des élections présidentielles de 202022. Il est reconduit et l'élection est contestée une nouvelle fois par l'opposition.
an 2015 : Zambie - Edgar Lungu est élu en 2015 pour le remplacer et terminer son mandat présidentiel. Edgar Lungu est à la tête du Front patriotique (PF) qu'il a créé en 2001 après avoir quitté le Mouvement pour la démocratie multipartite (MMD). Il est vainqueur du scrutin présidentiel, d'une courte tête.
an 2016 : Algérie - Le pays enregistre sa première grande attaque terroriste dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016. Bilan : une trentaine de morts et une centaine de blessés.
an 2016-2018 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Depuis 2016, le Burkina Faso est touché par un certain nombre d'attaques menées par des groupes armés djihadistes : le 15 janvier 2016 ont lieu les attentats de Ouagadougou, des hommes armés attaquent le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ces lieux sont fréquentés principalement par des occidentaux. L'attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) fait 30 morts. En août 2017, une autre attaque djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou. Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste visant l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou fait 8 morts, tous des militaires et plus de 80 blessés (civils et militaires). Cette attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
an 2016 : Cameroun - Depuis novembre 2016, des manifestants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, majoritairement anglophones, font pression pour le maintien de l'usage de la langue anglaise dans les écoles et les tribunaux. Des personnes ont été tuées et des centaines emprisonnées à la suite de ces protestations.
an 2016 : Cap Vert - Jorge Carlos Fonseca, du MPD, est réélu Président en 2016. José Maria Neves, du PAICV, est, dans le même temps, désigné premier ministre, de 2001 à 2016. Le pays bénéficie d'une alternance pacifique des deux partis au pouvoir, et même d'une cohabitation de ces deux partis pendant certaines périodes. Il est considéré comme ayant une bonne gouvernance, avec l'une et l'autre de ces formations, même si l'économie, peu diversifiée, est dépendante à 20 % du tourisme. Cet état ne dispense pas de grandes ressources naturelles. En 2016, le MPD revient au pouvoir à la suite des législatives, et la dirigeante relativement récente du PAICV, Janira Hopffer Almada, reconnaît sa défaite sans drame. L'archipel, qui souffre du réchauffement climatique, d'autant plus que l'eau douce y est rare, a une politique de développement des énergies renouvelables9, ainsi que de l'écotourisme.
an 2016 : Congo Brazzaville - Le 20 mars 2016, après avoir fait modifier la constitution (cf. infra), Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 60,07 % des voix, score validé par la Cour constitutionnelle le 4 avril suivant.
an 2016-2019 : Gabon - Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin à cinq mille voix près. L'opposition dénonce immédiatement ces résultats. Des émeutes encore plus violemment réprimées que celles de 2009 éclatent, avec comme point d'orgue l'attaque du quartier général de l'opposition par la garde présidentielle qui fait de nombreux morts. Le 24 septembre 2016, Ali Bongo est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec 50,66 % des voix, suivi de Jean Ping avec 47,24 % des suffrages.
Le président Bongo prône le concept de « Gabon émergent », politique visant notamment à la diversification de l'économie afin de diminuer sa dépendance aux cours mondiaux du pétrole. En 2018, cela ne s'est pourtant pas concrétisé, notamment du fait de la baisse des cours du pétrole et d'investissements peu judicieux, tandis que le chômage des jeunes reste élevé.
Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin à cinq mille voix près. L'opposition dénonce immédiatement ces résultats. Des émeutes encore plus violemment réprimées que celles de 2009 éclatent, avec comme point d'orgue l'attaque du quartier général de l'opposition par la garde présidentielle qui fait de nombreux morts. Le 24 septembre 2016, Ali Bongo est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec 50,66 % des voix, suivi de Jean Ping avec 47,24 % des suffrages.
Le 2 février 2017, le Parlement européen adopte une résolution déclarant que les résultats de la présidentielle « manquent de transparence » et sont « extrêmement douteux ».
Le 7 janvier 2019, une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence après un accident vasculaire cérébral, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour ; sur cinq mutins, deux sont tués et les autres arrêtés. Le 12 janvier, un nouveau Premier ministre est nommé, Julien Nkoghe Bekalé. Le pouvoir gabonais connaît une guerre des clans au sommet. Les remaniements ministériels se succèdent entre janvier et décembre 2019, alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé d'Ali Bongo. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée première ministre en juillet 2020.
an 2016-2017 : Gambie - En décembre 2016, sept partis d'opposition choisissent un candidat unique, Adama Barrow, pour l'élection présidentielle. Adama Barrow remporte l'élection à l'unique tour de scrutin en recueillant 43,3 % des suffrages, contre le président sortant qui arrive second avec 39,6 % des suffrages. Le 17 janvier 2017, Yahya Jammeh instaure l'état d'urgence et le lendemain, le Parlement prolonge son mandat de trois mois, jusqu'au 19 avril 2017. Le 19 janvier, Adama Barrow prête serment à l'ambassade de Gambie à Dakar. Devant le refus de Yahya Jammeh de lui céder le pouvoir, malgré les injonctions de la CÉDÉAO, l'armée sénégalaise pénètre en territoire gambien dans le courant de l'après-midi. Le soir même, le chef de l'armée gambienne, le général Ousman Badjie, déclare à des ressortissants occidentaux qu'il n'ordonnera pas à ses hommes de résister en cas d’intervention des troupes africaines.
L'élection présidentielle de décembre 2016 voit Adama Barrow, candidat de l'opposition, remporter la victoire sur le président sortant13 dont le mandat court jusqu'au 18 janvier 2017. Le 19 janvier 2017, Adama Barrow prête serment dans l'ambassade gambienne à Dakar au Sénégal, après le refus du président sortant de céder le pouvoir. Le même jour, l'armée sénégalaise entre en Gambie, forte d'une résolution de l'ONU. Le 20 janvier 2017, Jammeh accepte de quitter le pouvoir, et part en exil le lendemain soir pour Conakry, avant de rejoindre la Guinée équatoriale.
an 2016 : Guinée - En juillet 2016, la Guinée est le premier pays à majorité musulmane d'Afrique à renouer ses liens diplomatiques avec Israël.
an 2016-2018 : Guinée-Bissau - Au mois de septembre 2016, le président guinéen Alpha Condé, médiateur de la crise bissau-guinéenne, et son homologue de la Sierra Leone Ernest Baï Koroma obtiennent un compromis politique signé le 10 septembre par toutes les parties : ce sont les accords de Conakry. Successivement, Umaro Sissoco Embaló en novembre 2016, puis Artur Silvafin janvier 2018, puis Aristides Gomes mi-avril 2018 sont nommés premier ministres.
an 2016 : Libye - Devant la gravité de la situation et la progression de l'EI, la communauté internationale pousse à la création d'un gouvernement unitaire. Le 12 mars 2016 Fayez el-Sarraj prend la tête d'un gouvernement « d'union nationale », formé à Tunis, initialement rejeté par les parlements de Tripoli et de Tobrouk. Grâce au soutien occidental, le gouvernement peut s'installer à Tripoli à la fin du mois. Il obtient le 23 avril le soutien de la majorité des parlementaires de Tobrouk, et s'installe progressivement dans ses fonctions.
L’Organisation internationale pour les migrations note le développement de la traite d’êtres humains dans la Libye post-kadhafiste. Selon l'organisation, de nombreux migrants sont vendus sur des « marchés aux esclaves » pour 190 à 280 euros. Ils sont égalent sujets à la malnutrition, aux violences sexuelles, voire aux meurtres.
La ville de Syrte, place forte de l’organisation Etat islamique (EI) en Afrique du Nord, est reconquise début décembre 2016 par les forces du gouvernement libyen d’union nationale de Faïez Sarraj, soutenu par les capitales occidentales et les Nations unies, stoppant les vélléités de l'EI dans ce pays.
an 2016 : Mauritanie - Torture
Le 4 février 2016, après une inspection de dix jours, Juan Ernest Mendez, le rapporteur spécial de l'ONU fait part de ses regrets quant à la non application de la loi sur la prévention et la répression de la torture, promulguée en septembre 2015. La Mauritanie est dénoncée par plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, qui rapportent de nombreux actes de tortures et de mauvais traitement infligés aux détenus lors des interrogatoires.
Le 14 novembre 2016, une plainte visant de hauts responsables mauritaniens est déposée à au tribunal de grande instance de Paris. Ils sont accusés de « tortures et de traitements cruels » à l'encontre de militants anti-esclavage.
Situation sanitaire et humanitaire
En novembre 2016, le Programme alimentaire mondial (PAM) appelle à la mobilisation de 17 millions de dollars pour faire face à la situation des réfugiés maliens qui ont fui les exactions des groupes terroristes, confrontés à une crise alimentaire.
an 2016 : Réunion (Ile de la) - la quasi-totalité des 5 300 ha de terres agricoles irriguées par l'Irrigation du Littoral Ouest est en service.
an 2016-2018 : Sao Tomé et Principe - Chef de l’Etat : M. Evaristo Carvalho, Président de la République (élu le 7 août 2016)
Chef du Gouvernement : M. Jorge Bom Jesus
L’élection présidentielle du 7 août 2016 voit Evaristo Carvalho, candidat de l’ADI (action démocratique indépendante), élu président de la République contre le président sortant Manuel Pinto da Costa. Le Président a un rôle non exécutif, d’arbitre et de représentation.
Malgré deux tentatives de coup d’Etat en 2003 et 2009, la démocratie parlementaire s’affirme et permet à plusieurs reprises une alternance entre les deux grandes forces qui animent la vie politique : l’ADI de Patrice Trovoada (fils de Miguel Trovoada, il est premier ministre de 2010 à 2012 et de 2014 à 2018) et le MLSTP de Jorge Bom Jesus.
Aux élections législatives d’octobre 2018, une coalition menée par le MLSTP l’emporte d’une très courte avance (28 sièges contre 27) et, après une courte période d’incertitude rapidement tranchée par la Cour constitutionnelle et acceptée par toutes les parties, Jorge Bom Jesus est chargé de former un gouvernement, début décembre 2018. Le gouvernement, toujours dirigé par Jorge Bom Jesus, a été remanié en septembre 2020.
an 2016 : Seychelles - À la suite de la défaite de son parti Lepep (issu de l'ancien parti unique) aux élections législatives de septembre 2016, James Michel annonce sa démission de son poste de président de la République en septembre 2016. Le 16 octobre suivant, il est remplacé par son vice-président, Danny Faure. Une période de cohabitation commence entre ce nouveau président et un Parlement contrôlé par l'opposition à l'ex-parti unique (qui était au pouvoir depuis 1977).
an 2016 : Tchad - Depuis 2016, le Tchad est confronté à un mouvement insurrectionnel dans le Nord du pays : plusieurs groupes armés d'exilés tchadiens ayant combattu dans la guerre civile libyenne reviennent en force dans leur pays d'origine.
an 2016 : Zambie - Edgar Lungu est réélu en 2016, dans un scrutin là encore serré, contre Hakainde Hichilema.
an 2019 : Afrique du Sud - Cyril Ramaphosa est réélu chef de l’État le 22 mai 2019, à l’issue d’élections générales lors desquelles l’ANC obtient le plus faible score de son histoire (57,5 %), passant sous la barre des 60 % pour la première fois depuis un quart de siècle et payant ainsi les errements et les scandales de l'ère Zuma, son prédécesseur.
Il doit également faire face à une opposition interne au sein de l'ANC, avec un clan resté fidèle à Jacob Zuma, ayant à sa tête le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, et son adjointe, Jessie Duarte. Une vague de xénophobie vis-à-vis les migrants, les « étrangers », secoue également le pays.
an 2019-2022 : Algérie - Depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika et l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, le pays est dirigé par le président Abdelmadjid Tebboune.
an 2019 : Bénin (anc. Dahomey) - En décembre 2019, l’annonce, par le président ivoirien Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron, de la fin du franc CFA pour les huit pays de la CEDEAO, au profit de l'Eco est diversement qualifiée. Décision historique pour certains, d'autres la qualifient d’« arnaque » et de « poudre aux yeux ». Une parité fixe est maintenue pour la future monnaie avec l’euro
an 2019 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - - Dans la nuit du 3 au 4 février 2019, un groupe terroriste attaque la ville de Kaïn dans le département du même nom, au nord de la province du Yatenga. Le bilan est de 14 morts civils. L'armée réagit rapidement, avec des actions contre les groupes terroristes dans le nord-ouest du pays, déclarant avoir alors « neutralisé » 146 terroristes. À la veille du début de l'année de la présidence par le pays du G5 Sahel, l'attaque terroriste porte à près de 300 le nombre d'habitants assassinés par ces groupes depuis 201541. Le jour inaugural du G5 Sahel, mardi 5 février, un détachement de la gendarmerie est attaqué à Oursi, cinq militaires meurent, contre selon l'armée, 21 assaillants tués lors de l'attaque. L'insécurité croissante a entrainé la multiplication des milices. En 2020, le pays compterait près de 4 500 groupes de koglweogo, mobilisant entre 20 000 et 45 000 membres.
Pour faire face au crime organisé (attaques à main armée dans les lieux de travail et habitations, vols d'animaux et autres formes de violences ciblant notamment les populations rurales et périurbaines), des groupes d'autodéfense se sont constitués au sein de certaines communautés. Dénommés « koglwéogo », ils sont indépendants vis-à-vis de l'État, ne rendent comptes à personne. Ils agissent hors de tout cadre légal. Ils ont localement fait reculer la délinquance, mais des exactions commises par certains de leurs membres créent une nouvelle source d'insécurité et de péril pour les droits humains, et affaiblissent encore le système judiciaire légal (déjà critiqué pour son inefficacité par la population et les médias). Au sein de koglwéogo qui, sous prétexte d'une réponse citoyenne à la crise sécuritaire, « s'arrogent le droit d'arrêter, de juger et de sanctionner, par des amendes, sévices corporels et humiliations, au terme de tribunaux populaires expéditifs », de graves violences (torture notamment) sont observées. « De présumés voleurs sont ligotés au pied d'un arbre, fouettés avec des branches enflammées de tamarinier, le tout en public, et ce jusqu'à ce qu'ils avouent leur crime », bafouant les droits humains via une justice expéditive. Selon Amnesty international, « les Koglwéogo ont commis des exactions, telles que des passages à tabac et des enlèvements, poussant ainsi des organisations de la société civile à reprocher à l’État de ne pas agir suffisamment pour empêcher ces violences et y remédier ; une levée de boucliers qui avait amené l'Etat à condamner en septembre 2016 Koglwéogo à 6 mois d'emprisonnement, et 26 autres à des peines allant de 10 à 12 mois de prison avec sursis. Les 29 et 30 mai 2020, plusieurs attaques djihadistes ont fait une cinquantaine de morts à Kompienga48. Dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, une nouvelle attaque djihadiste tue plus de 160 personnes dont « une vingtaine d'enfants » à Solhan, un village situé au nord-est du pays. C'est l'attaque la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso depuis le début des assauts djihadistes, en 2015. En six ans, les violences ont déjà fait plusieurs milliers de morts, plus particulièrement dans les zones proches des frontières avec le Mali et le Niger
an 2019 : Afrique - Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa, Président d'Afrique du Sud, prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi
an 2019 : Cameroun - En 2019, les combats entre les guérillas séparatistes et les forces gouvernementales se poursuivent.
an 2019 : République de Centrafrique - Le 6 février 2019, l'État centrafricain signe avec les 14 principaux groupes armés du pays un nouvel accord de paix négocié en janvier à Khartoum (Soudan). Malgré cet accord, 80 % du territoire restent contrôlés par des groupes armés et les massacres de populations civiles continuent.
an 2019-2020 : Gabon - Le 7 janvier 2019, une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence après un accident vasculaire cérébral, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour ; sur cinq mutins, deux sont tués et les autres arrêtés. Le 12 janvier, un nouveau Premier ministre est nommé, Julien Nkoghe Bekalé. Le pouvoir gabonais connaît une guerre des clans au sommet. Les remaniements ministériels se succèdent entre janvier et décembre 2019, alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé d'Ali Bongo. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée première ministre en juillet 2020.
an 2019 : Gambie - Le 27 août 2019, Dawda Jawara décède, il avait était premier Premier ministre de Gambie entre 1962 et 1970, puis le premier président de la République de Gambie de 1970 à 1994.
an 2019 : Guinée-Bissau - élection présidentielle de fin 2019 voit la défaite du candidat de l'ex-parti unique, au pouvoir depuis 1974, le PAIGC, et la victoire d'Umaro Sissoco Embaló, ancien général et ancien Premier ministre devenu opposant. La confirmation de ce résultat est compliquée, donnant lieu à des allers et retours entre la Commission électorale et la Cour suprême (saisie par le PAIGC), mais c'est la première transition politique qui s'effectue pacifiquement.
an 2019 : Guinée équatoriale - La population de Guinée équatoriale vit dans des conditions précaires. Bata, seconde ville du pays et capitale économique, a été ainsi privée d'eau courante pendant trois semaines en 2019, sans que les autorités s'expliquent sur les difficultés rencontrées.
an 2019 : Mali - Les djihadistes opèrent une guerre asymétrique : ils procèdent surtout par attaques surprises, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires. Le 23 mars 2019, des miliciens dogons font 157 morts lors du massacre d'Ogossagou, village peul situé près de Bankass, toujours dans le centre du pays. Beaucoup des victimes avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d’autres affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts en 2018 dans le centre du Mali, selon l’ONU. Les troupes françaises sont de plus en plus critiquées localement : poursuivre le combat accroît le risque d’enlisement et de compromission.
an 2019 : Iles Maurice - À la lignée des Ramgoolam succède celle des Jugnauth. Pravind Jugnauth remporte les législatives de 2019.
Le 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution demandant au Royaume-Uni de rétrocéder sous six mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos. Ce délai a pris fin le 22 novembre 2019, sans que le Royaume-Uni se conforme à cette résolution, ni à l'avis consultatif formulé en février par la Cour internationale de justice (CIJ) demandant à Londres de mettre fin « dans les plus brefs délais » à son administration des Chagos.
an 2019 : Mauritanie - Le 28 janvier 2019, un projet de loi est voté autorisant un accord de coopération entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite en matière de lutte contre le trafic d'armes et d'êtres humains. L’opposition mauritanienne crie au scandale, pointant le manque de crédibilité du royaume wahhabite en matière du respect des droits de l’homme.
Le 5 mars 2019, à trois mois de la présidentielle, 76 partis politiques sont dissous par décret rendu public par le ministre mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation. Le 9 mai, six candidatures à la présidentielle du 22 juin 2019 sont validées par le Conseil constitutionnel.
Le 20 mai, une série de nominations faites en conseil des ministres dans les semaines qui précèdent l'élection présidentielle sont dénoncées par plusieurs candidats.
Le 1er juillet 2019, la victoire du général Mohamed Ould Ghazouani dès le premier tour, avec 52 % des voix, est proclamée par le Conseil constitutionnel mauritanien, dans un climat délétère, avec une coupure prolongée d'internet et un déploiement des unités d’élite de l’armée, de la garde et de la police anti-émeute dans toute la capitale, Nouakchott. L'opposition dénonce de multiples irrégularités dans le déroulement du scrutin et qualifie la déclaration de victoire du candidat du pouvoir le soir du premier tour de «nouveau coup d'État».
Le 8 août 2019, le président Ghazouani nomme son premier gouvernement, dirigé par le premier ministre désigné le 3 août, Ismael Ould Bodé Ould Cheikh Sidiya.
Le 19 mars 2019, la police mauritanienne refoule une délégation d'Amnesty International à son arrivée à l'aéroport de Nouakchott
Le 22 mars 2019, les blogueurs Abderrahmane Weddady et Cheikh Ould Jiddou, connus pour dénoncer les atteintes aux droits de l'Homme en Mauritanie sont emprisonnés. Amnesty International explique qu'« Ils ont critiqué la corruption qui régnerait au sein du gouvernement dans des commentaires sur Facebook ». Les deux blogueurs avaient repris sur leurs blogs des articles publiés par des médias arabes faisant état d’un placement présumé de deux milliards de dollars aux Émirats arabes unis par un proche du chef de l’État. Amnesty International qualifie par ailleurs leur détention d’illégale. D'autres ONG comme Reporters Sans Frontières et Human Right Watch dénonceront à leur tour l'arrestation des deux blogueurs.
Le 5 juillet 2019, une vingtaine de journalistes manifestent devant le ministère la Communication et demandent la libération de leur confrère Ahmed Ould Wedia, interpellé chez lui trois jours auparavant.
En mai 2019, la France et la Mauritanie signent un accord de financement d'un montant de 4,4 milliards d'ouguiyas (11 millions d'euros), afin de financer des projets hydrauliques destinés à améliorer les conditions de vie de la population.
Esclavage
Le 28 janvier 2019, un projet de loi est voté autorisant un accord de coopération entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite en matière de lutte contre le trafic d'armes et d'êtres humains. L’opposition mauritanienne crie au scandale, pointant le manque de crédibilité du royaume wahhabite en matière du respect des droits de l’homme.
Les séquelles de l'esclavage touchent particulièrement la population Haratine, qui faute d'accès à l'éducation concentre 85 % des analphabètes du pays
Situation sanitaire et humanitaire
En mai 2019, la France et la Mauritanie signent un accord de financement d'un montant de 4,4 milliards d'ouguiyas (11 millions d'euros), afin de financer des projets hydrauliques destinés à améliorer les conditions de vie de la population.
an 2019 : Mozambique - Le président Filipe Nyusi est réélu en octobre 2019 pour un deuxième mandat de cinq ans avec 73 % des suffrages. Son parti, le FRELIMO, remporte 184 des 250 sièges à l’Assemblée nationale et dirige l’ensemble des dix provinces du pays. Ce scrutin a été manipulé comme les précédents pour en garantir le résultat : redécoupage de la carte électorale pour gonfler l’importance des bastions du pouvoir, mise à disposition constante des moyens de l’Etat pour la campagne du parti au pouvoir, tracasseries pour les opposants, usage de la violence, etc., le FRELIMO montre une volonté d’hégémonie. Ceci pose aussi la question d’un processus de paix jamais arrivé à son terme depuis le premier accord avec l’ancienne rébellion de la Résistance nationale mozambicaine (RENAMO), en 1992. Ossufo Momade a été le candidat de la RENAMO, mouvement affaibli par la mort de son chef historique, Afonso Dhlakama, en 2018.
Le Mozambique peut devenir l'un des grands producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, avec d'importantes réserves, et devient à ce titre un pays courtisé. Les ressources en gaz naturel devraient être exploitées en particulier dans la province de Cabo Delgado d’ici à cinq ans. Total, notamment, a finalisé son entrée fin septembre 2019 dans l’un des deux projets majeurs, Mozambique LNG.
an 2019 : Namibie - En 2019 a lieu L'élection présidentielle namibienne de 2019, en même temps que les élections législatives. Le président sortant Hage Geingob, de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (abrégée en SWAPO) est réélu avec un score, en baisse, de 56 % des suffrages. La SWAPO est au pouvoir depuis 1990. La participation au scrutin présidentiel a été de 60 %. Les autres candidats ont été Panduleni Itula, candidat dissident de la SWAPO qui obtient 30 % des suffrages. Il est en tête dans la capitale du pays. Le chef de l’opposition, McHenry Venaani, ne récolte que 5,4 %. La proximité passée de son parti, le Mouvement démocratique populaire (PDM) (ex-Alliance démocratique de la Turnhalle), avec le régime de l'apartheid en Afrique du Sud de l’apartheid, continue à être un repoussoir pour une grande part de l’électorat. Un nouveau parti d’opposition émerge, le Mouvement des sans-terre (LPM) de Bernadus Swartbooi : Bernadus Swartbooi réunit 2,8 % des suffarges exprimés.
La SWAPO est critiquée pour des scandales de corruption et ses résultats politiques sont affectés aussi par la situation économique et l'importance du chômage. Le secteur minier reste important. Mais la chute des cours des matières premières a réduit les recettes. Par ailleurs, une sécheresse persistante depuis plusieurs saisons a contribué aussi à faire reculer le produit intérieur brut (PIB) deux ans de suite, en 2017 et en 2018. « Les moyens de subsistance d’une majorité de Namibiens sont menacés, notamment ceux qui dépendent des activités de l’agriculture », n'a pu que déplorer la première ministre Saara Kuugongelwa-Amadhila. Le chômage touche un tiers de la population.
an 2019 : Soudan - En 2019, un vaste mouvement de protestation contre le régime se forme dans les villes de l’extrême nord du pays, en particulier autour d'Atbara, agglomération ouvrière et fief du syndicalisme soudanais. Les manifestants réclament initialement de meilleures conditions de vie (plus de vingt millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté), puis, alors que la répression s’accentue, la démission du président.
Le 11 avril 2019, Omar el-Bechir est renversé par l'armée. Le ministre de la Défense Ahmed Awad Ibn Auf annonce la mise en place d'un gouvernement de transition pour deux ans jusqu'à de nouvelles élections libres.
Le 12 avril 2019, au lendemain de la destitution du président, le Conseil militaire de transition déclare que le futur gouvernement sera un gouvernement civil en promettant un dialogue entre l'armée et les politiciens soudanais. L'armée entame alors des discussions avec les autorités civiles d'opposition et les organisations représentant les manifestants. Le 3 juin 2019, alors que les négociations piétinent et que les manifestants campent devant le QG de l'armée depuis près de deux mois, l'armée et la milice des Forces de soutien rapide tirent sur la foule pour tenter de déloger les manifestants causant un massacre. Le 4 juin 2019, le chef du Conseil militaire de transition, Abdel Fatah al-Burhan, annonce la fin des négociations avec les civils et promet la tenue d'élections d'ici 9 mois.
Le 21 août, à la suite d'un accord, le Conseil militaire de transition devient le Conseil de souveraineté. Il maintient les président et vice-président sortants en place mais dispose de membres civils. Abdallah Hamdok est nommé Premier ministre. Il annonce la composition d'un gouvernement de transition début septembre 2019, un gouvernement composé de dix-huit membres dont quatre femmes, notamment Asma Mohamed Abdallah une diplomate expérimentée qui devient ministre des affaires étrangères : « La première priorité du gouvernement de transition est de mettre un terme à la guerre et de construire une paix durable », est-il précisé, faisant référence aux conflits et rébellions qui pèsent sur le Darfour, le Nil Bleu et le Kordofan du Sud.
an 2020 : UNION AFRICAINE - Le 10 février 2020, Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud, prend la présidence de l'Union africaine, succédant à Abdel Fattah al-Sissi.
an 2020 : Burundi - La situation économique continue à se dégrader. Début 2020, le général Évariste Ndayishimiye est désigné comme candidat pour l’élection présidentielle du 20 mai 2020 par le parti au pouvoir, pour succéder à Pierre Nkurunziza. Il remporte l'élection présidentielle du 20 mai 2020, en obtenant 68,72 % des voix et devance très largement le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, président du Conseil national pour la liberté (CNL), qui réunit 24,19 % des voix.
an 2020 : Cameroun - Au cours de l'année 2020, de nombreuses attaques terroristes - dont beaucoup ont été menées sans revendication - et les représailles du gouvernement ont fait couler le sang dans tout le pays. Depuis 2016, plus de 450 000 personnes ont fui leurs foyers. Le conflit a indirectement conduit à une recrudescence des attaques de Boko Haram, l'armée camerounaise s'étant largement retirée du nord pour se concentrer sur la lutte contre les séparatistes ambazoniens. Paul Biya est réélu pour un septième mandat en 2018, dans un scrutin dont la régularité est contestée par l'opposition. Il lance un « grand dialogue national », mais aucune avancée décisive n'en ressort sur le conflit dans les régions anglophones. Paul Biya fait libérer des détenus, mais les leaders du mouvement restent en prison.
Les élections législatives et municipales du 9 février 2020 entraînent un regain de violence dans les régions anglophones du Cameroun, autour de la tentative d'indépendance de l'Ambazonie. Les groupes armés séparatistes promettent des représailles à ceux qui iraient voter, en réaction le gouvernement central du Cameroun augmente ses effectifs militaires dans la zone. Dans les deux semaines précédant les élections, selon Human Rights Watch, les rebelles séparatistes enlèvent plus d'une centaine de personnes dans les deux régions anglophones, tandis que les forces de sécurité commettent de nombreux abus de pouvoir. Le 7 février 2020, c'est depuis sa cellule à la prison centrale de Yaoundé que Sisiku Julius Ayuk Tabe, président du gouvernement intérimaire d’Ambazonie, déclare, qu’ils sont plus que jamais engagés dans une indépendance totale ou une résistance à jamais.
Les violences se poursuivent après les élections. Ainsi, le 16 février 2020, 22 civils dont 14 enfants et 1 femme enceinte sont massacrés à Ntumbaw, un village du Nord-Ouest. l'opposition camerounaise (surtout le Mouvement pour la renaissance du Cameroun) et les ONG locales accusent l'Armée et le gouvernement d'avoir perpétré le massacre, dans un contexte de répression de la tentative de sécession de l'Ambazonie.
Le 21 avril 2020, le régime camerounais admet sa responsabilité, expliquant que l'Armée et un groupe d'autodéfense allié avaient attaqué des indépendantistes, tuant 5 d'entre-eux, puis s'étaient rendus compte que leur assaut avait également tué accidentellement les femmes et les enfants, et avaient alors décidé de déclencher l'incendie pour tenter de masquer leurs faits.
Le 2 juillet 2020, déjà très impliquée lors de la tenue des assises du « grand dialogue national », l'Église catholique a de nouveau joué les facilitateurs lors de la récente prise de contact entre les séparatistes anglophones emprisonnés à Yaoundé et des émissaires du gouvernement. C'est d'ailleurs au centre épiscopal de Mvolyé, dans la capitale camerounaise, que cette rencontre s'est tenue. Pour l'occasion, Julius Ayuk Tabé, le président autoproclamé de l'Ambazonie et quelques-uns de ses partisans avaient été spécialement extraits de leurs cellules pour entamer des discussions avec les autorités du gouvernement. Entre eux, un témoin privilégié : Monseigneur Andrew Nkea Fuanya, archevêque de Bamenda. Cette nouvelle implication de l'Église catholique pour tenter de rapprocher les parties en conflit de la crise dans les régions anglophones a été plutôt bien perçue par nombre d'observateurs, alors que jusqu'ici une sorte de crise de confiance semble installée de part et d'autre entre protagonistes. D'autant que dix mois après la tenue du Grand dialogue national, les résolutions qui en avaient été issues tardent à être mises en application. Notamment le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le 20 août 2020, Le procès en appel du leader séparatiste anglophone Sisiku Ayuk Tabe et de ses neuf co-accusés a été une nouvelle fois reporté. Une partie des magistrats affectés à ce dossier ayant été récemment mutés, la cause a été renvoyée au 17 septembre 2020.
Le 17 septembre 2020, Une Cour d’appel camerounaise a confirmé, la condamnation à la prison à vie prononcée en 2018 contre Sisiku Ayuk Tabe. Sisiku Ayuk Tabe avait été jugé coupable « sécession » et « terrorisme », en lien avec le conflit dans les régions anglophones du Cameroun. Il s’était autoproclamé président de l’Ambazonie, nom donné par les indépendantistes anglophones à l’ancien Cameroun du Sud britannique, non reconnu internationalement. Lors de l’audience la Cour d’appel a estimé que le tribunal militaire qui avait condamné Sisiku Ayuk Tabe et ses coaccusés le 20 août 2019 a bien dit le droit. Elle a donc confirmé la prison à vie pour les accusés, assortie d’une amende de 250 milliards de francs CFA.
Dans les deux régions à majorité anglophones du Cameroun, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, des indépendantistes s’opposent violemment à l’armée depuis 2017 et les deux camps sont régulièrement accusés d’exactions contre des civils par des ONG. Au moins 3 000 personnes ont perdu la vie et plus de 700 000 autres ont dû fuir leur domicile, selon les Nations unies.
an 2020-2021 : République de Centrafrique - En décembre 2020, des mercenaires russes du groupe Wagner s'engagent aux côtés de l'armée centrafricaine, des forces de la MINUSCA et des forces rwandaises contre les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement qui veulent prendre Bangui et empêcher la tenue des élections présidentielle et législatives. Le 31 mars 2021, le Groupe de travail des Nations unies sur les mercenaires a dit sa préoccupations sur des violations répétées des droits de l'Homme par les mercenaires du groupe Wagner. Une enquête de RFI a collecté de nombreux indices, dont des documents confidentiels et des témoignages allant en ce sens. Le gouvernement centrafricain a réagi en mettant en place une commission d'enquête. La Russie a dénoncé « de fausses nouvelles » qui « servent les intérêts des malfaiteurs qui complotent pour renverser le gouvernement ».
an 2020 : Afrique Côte d'Ivoire - En novembre 2020, Alassane Ouattara est réélu pour un troisième mandat avec 94,27 % des voix lors d'un scrutin très critiqué puisque l'opposition avait demandé à le boycotter, contestant la constitutionnalité d'un troisième mandat. Finalement, seuls 53,90 % des électeurs se sont rendus aux urnes pour élire le président sortant.
an 2020-2021 : Éthiopie - les relations entre le gouvernement fédéral et celui de la région du Tigré se dégradent rapidement après les élections. Le 4 novembre 2020, le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) lance une attaque contre des bases des Forces de défense nationale éthiopiennes à Mekele, la capitale du Tigré, et à Dansha, une ville de l’ouest de la région. La guerre du Tigré escalade et se poursuit depuis cette date.
Les Forces de défense tigréennes ont repris la capitale régionale, Mekele, forçant le gouvernement éthiopien à décréter, le lundi 28 juin 2021, un « cessez-le-feu unilatéral »
Le 28 juin 2021, sept mois après avoir dû abandonner Mekele face aux assauts de l’armée gouvernementale éthiopienne, les forces du Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) reprennent le contrôle de la capitale provinciale du Tigré. Dans cette région du nord de l’Éthiopie, en guerre depuis novembre 2020, les derniers jours ont été le théâtre d’un spectaculaire renversement de situation militaire, forçant le gouvernement éthiopien à décréter un cessez-le-feu.
En marge du conflit au Tigré éthiopien, l’armée soudanaise tente de reprendre la main sur le triangle d’Al-Fashaga, un territoire agricole disputé par L’Éthiopie et le Soudan, pays de la Corne de l'Afrique. C’est un bras de fer qui menace de dégénérer, dans le sillage du conflit en cours dans la province éthiopienne du Tigré. En jeu : le triangle d’Al-Fashaga, soit 250 km2 de terres fertiles coincées entre les rivières Tekezé et Atbara, au cœur d’une dispute historique entre le Soudan et l’Éthiopie.
Début novembre 2021, plusieurs États occidentaux ordonnent à leurs nationaux de quitter l'Éthiopie, en prévision d'une éventuelle prise d'Addis-Abeba par le TPLF accompagnée d'exactions tribales. À ce stade le conflit a coûté, outre des milliers de morts, le déplacement forcé de plus de deux millions de personnes et un risque de famine pour cinq millions.
an 2020 : Guinée - En mars 2020, en dépit des manifestations et du désaccord de la grande partie de la population et de l'opposition et ce malgré une loi stipulant qu'aucun président ne peut se présenter pour plus 2 mandats consécutifs, Alpha Condé modifie la Constitution pour pouvoir légalement se représenter. Il est alors officiellement candidat pour un troisième mandat pour les élections s'étant tenues en octobre 2020.
an 2020 : Guinée-Bissau - L'investiture d'Umaro Sissoco Embaló a lieu le 27 février 2020. La passation de pouvoir s'effectue ensuite au palais présidentiel. Nuno Gomes Nabiam est nommé Premier ministre le lendemain, le 28 février 2020. Mais une incertitude subsiste : une partie des députés investissent comme président, le 28 février au soir, le président de l’Assemblée nationale, Cipriano Cassama, par intérim. Pour eux, l'investiture de Umaro Sissoco Embalo n'est pas légale.
an 2020 : Libéria - Le 1er octobre 2020, le Président Weah a procédé à un remaniement de son gouvernement et a formé un gouvernement d’union nationale pour faire face notamment aux défis sociaux, économiques et sanitaires auxquels le pays est confronté.
La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2023.
an 2020 : Mali - En 2020, dans un contexte d'élections législatives contestées et de manifestations massives menées par le M5-RFP, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrêté par des mutins et démissionne sur les ondes de l'ORTM, à minuit le 19 août 2020. Quelques heures plus tard, le Comité national pour le salut du peuple prend le pouvoir. Il est présidé par Assimi Goïta et dispose des services d'Ismaël Wagué comme porte-parole. Ce coup d'État est condamné de manière unanime par la communauté internationale.
Assimi Goïta en tant que président du CNSP la junte militaire qui a renversé Ibrahim Boubacar Keîta le 18 août 2020.
Bah N'Daw après avoir été designé par le CNSP Président de la Transition le 21 septembre 2020 puis renversé par un coup d'État.
an 2020 : Iles Maurice - Le 15 janvier 2020, Pravind Jugnauth premier ministre des île Maurice, était à Londres pour assister à un sommet sur les investissements de la Grande-Bretagne en Afrique. il s'est entretenu avec les chefs des gouvernements de l'Afrique du Sud, du Kenya, de Côte d'Ivoire et du Mozambique. Il a indiqué que : « Port-Louis étudiait la possibilité d’entamer des poursuites contre des responsables britanniques devant la Cour pénale internationale pour crime contre l’humanité ».
an 2020 : Mozambique - Depuis deux ans un groupe d’islamistes armés a déclenché une insurrection dans cette région du nord du pays. Les combats se déroulent à quelques kilomètres des futures installations gazières et le port de Mocimboa da Praia est pris par les insurgés en août 2020.
an 2020 : Namibie - Le 21 mars 2020, la Namibie célèbre son trentième anniversaire d'indépendance.
an 2020 : Nigéria - En octobre 2020, le pays est secoué par d'importantes manifestations protestant contre l'oppression et la brutalité policières – connues nationalement, et mondialement, sous le nom de #EndSARS (abréviation de “End Special Anti-Robbery Squad”). Ce mouvement populaire est violemment réprimé par les autorités.
an 2020 : Somalie - Le pays se mobilise également début 2020 contre une invasion de criquets pèlerins qui touche la Corne d'Afrique et plusieurs régions d'Afrique de l'Est.
an 2020 - 2021 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - John Magufuli acquiert une popularité, notamment grâce à sa lutte contre le gaspillage de l'argent public et contre la corruption, mais fait preuve également de dérives autoritaires, contre ses opposants, contre les libertés individuelles, contre la presse, etc. Il est réélu pour un second mandat en octobre 2020. Il meurt en fonction en mars 2021 et sa vice-présidente Samia Suluhu lui succède.
an 2021 : Bénin (anc. Dahomey) - Le 11 avril 2021, Patrice Talon est réélu Président de la République.
an 2021 : Cap Vert - En octobre 2021, se déroule l'élection présidentielle cap-verdienne de 2021, remportée par José Maria Neves
an 2021 : Congo Brazzaville - Fin décembre 2019, Denis Sassou-Nguesso est à nouveau désigné candidat de son parti (le PCT) à la présidentielle de 2021. Le 23 mars 2021, la commission électorale annonce que Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 88,57 % (résultats provisoires officiels). La participation est estimée à 67,55 % et son principal opposant, Guy Brice Parfait Kolélas, (mort de la Covid-19 le lendemain de l'élection), recueille 7,84 % des voix. Ses opposants annoncent former des recours. Le 6 avril 2021, la Cour constitutionnelle de la République du Congo a entériné la réélection du président Denis Sassou-Nguesso au scrutin du 21 mars, après avoir rejeté les recours de l'opposition.
an 2021 : République de Djibouti - Le 9 avril 2021, Ismaël Omar Guelleh a été réélu, avec 98,58 % des voix, selon les chiffres officiels provisoires.
an 2021 : Gambie - Adama Barrow est réélu président de la République le 5 décembre 2021.
an 2021 : Guinée - Le 5 septembre 2021, un coup d'État des forces spéciales, dirigées par Mamadi Doumbouya, mène à la capture d'Alpha Condé. Une junte prend le pouvoir.
Mamadi Doumbouya devient alors président du Comité national du rassemblement pour le développement et président de la Transition.
an 2021-2022 : Libye - Le 24 décembre 2021 devraient avoir lieu une élection présidentielle et en janvier 2022 des élections législatives.
an 2021 : Mali - Le 24 mai 2021, le président de transition Bah N'Daw et le premier ministre de transition Moctar Ouane sont interpellés et conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta démet N'Daw et Ouane de leurs fonctions. Suite à ce coup d'Etat, la France décide de mettre un terme à l'Opération Barkhane et appuie le développement international de la Task Force Takuba notamment pour sécuriser la région du Liptako
Assimi Goïta (Vice-président) de facto président de la transition après l'arrestation et la démission du Premier Ministre Moctar Ouane et du président de la transition Bah N'Daw par Assimi Goïta le lundi 24 mai 2021 et le mardi 25 mai 2021.
an 2021 : Namibie - En mai 2021 l’Allemagne et la Namibie sont parvenus à se mettre d’accord sur un document qui établit les responsabilités de l'Allemagne ex-puissance coloniale durant le Génocide des Héréro et des Namas.
an 2021-2022 : Somalie - En 2021 et 2022, le pays connait une importante sécheresse, provoquant des problèmes de disette importante pour près de 7,8 millions de personnes soit presque 50 % de la population.
an 2021 : Togo - En 2021, David Ekoué Dosseh, un professeur de médecine à l'origine de Togo Debout, la « plateforme citoyenne » créée le 22 septembre 2017, est sur la liste établie par le collectif Forbidden Stories de 300 Togolais espionnés par le logiciel Pegasus.
an 2021 : Soudan - Une tentative de putsch a lieu le 21 septembre 2021. Les responsables sont arrêtés.
Un coup d'État militaire a lieu en octobre 2021, menant à l'arrestation de civils dont le premier ministre. Le 25 octobre, des membres de l'armée tirent sur des civils refusant le putsch.
an 2021 : Tchad - Le 20 avril 2021, un Conseil militaire de Transition dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, alors général de l'armée tchadienne et fils du président Idriss Déby Itno, prend le pouvoir à la suite du décès de ce dernier, dont on soupçonne que la mort soudaine soit liée à un assassinat non ciblé lié à des affrontements avec le Fact, un groupe armé libyen. Cette prise du pouvoir ne respecte pas la Constitution de la République du Tchad, promulguée le 4 mai 2018, qui est alors suspendue par l'Armée, en même temps que l'Assemblée nationale est dissoute.
Au moment de prendre le pouvoir, l'armée promet que des élections libres et démocratiques seront organisées au Tchad sous dix-huit mois, après une période de transition et d'apaisement.
an 2021 : Togo - En 2021, David Ekoué Dosseh, un professeur de médecine à l'origine de Togo Debout, la « plateforme citoyenne » créée le 22 septembre 2017, est sur la liste établie par le collectif Forbidden Stories de 300 Togolais espionnés par le logiciel Pegasus.
an 2021-2022 : Tunisie - Crise politique de 2021-2022
Le 25 juillet 2021, invoquant l'article 80 de la Constitution, Kaïs Saïed limoge le gouvernement, annonce la suspension de l'Assemblée des représentants du peuple — dont il lève l'immunité des membres —, la formation d'un nouveau gouvernement — qui sera responsable devant lui — et sa décision de gouverner par décrets ; il indique également qu'il présidera le parquet. Ennahdha dénonce aussitôt un « coup d'État ». Cette qualification de coup d'État est partagée par des analystes politiques et juristes, notamment en ce qui concerne la suspension des travaux parlementaires.
Le 22 septembre, il confirme par décret le prolongement des décisions ainsi que la dissolution de l'Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, et décide de suspendre les salaires et les bénéfices accordés au président de l'Assemblée des représentants du peuple et ses membres, et s'octroie le droit de gouverner par décret, récupérant de facto le pouvoir législatif. Le 13 décembre, il annonce la tenue d'un référendum constitutionnel, prévu à l'été 2022.
Le 30 mars 2022, après la réunion virtuelle de 120 députés pour voter la fin des mesures d'exception en vigueur, Kaïs Saïed dissout le Parlement, ce qu'interdit pourtant la Constitution durant la période où l'état d'exception est appliqué, et menace les députés de poursuites judiciaires.
an 2022 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Le 23 janvier 2022 a lieu un coup d'État. Les putschistes, rassemblés sous la bannière du « Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration » et menés par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, annoncent la fermeture des frontières terrestres et aériennes à partir de minuit, la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale ainsi que la « suspension » de la Constitution. Le 24 janvier 2022, certains médias locaux et internationaux relaient une information selon laquelle le président de Faso serait détenu par des soldats mutins. D'autres médias assurent que c'est une information erronée. Le 1er mars 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, signe un plan pour entamer une transition de trois ans vers la démocratie.
an 2022 : République de Centrafrique - En avril 2022, une "opération" militaire menée par l’État centrafricain et des paramilitaires russes cause la mort de dizaines de civils dans les villages de Gordil et Ndah, au Nord-Est de la capitale. Suite à ce massacre, l'ONU indique ouvrir une enquête.
an 2022 : Érythrée - Le 2 mars 2022, l'Érythrée est l'un des cinq pays de l'ONU votant contre la résolution ES-11/1 ayant pour but de sanctionner et condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
an 2022 : Guinée - mars 2022 En Guinée, déchu il y a plus six mois par un coup d’état militaire le 5 septembre 2021, Alpha Condé ne prendra plus la tête du parti qu’il a lui-même créé dans la clandestinité au début des année 1990. En attendant le prochain président du RPG, un intérimaire a été porté à la tête de l’ancien parti au pouvoir. En réunion extraordinaire, ce jeudi 10 mars 2022, les cadres du parti ont désigné l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana comme président par intérim.
mai 2022 Transition prolongée en Guinée : l’opposition dénonce une « décision unilatérale » et une « durée injustifiable ». Le colonel Mamadi Doumbouya, auteur du putsch contre Alpha Condé, prévoit un délai de trente-neuf mois avant d’organiser d’éventuelles élections.
an 2022 : Lesotho - Les élections législatives lésothiennes de 2022 ont lieu en septembre 2022 afin de renouveler les membres de l'assemblée nationale du Lesotho.
Le Lesotho est une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement bicaméral dont la chambre basse, l'assemblée nationale est composée de 120 députés élus pour un mandat de cinq ans au suffrage direct. Son mode de scrutin, mixte, s'apparente au système électoral allemand, bien que les électeurs n'aient qu'un seul vote pour exprimer leur choix. Sur les 120 sièges, 80 sont pourvus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales uninominales. L'ensemble des votes pour chacun des partis est ensuite regroupé au niveau national, nonobstant ceux des indépendants, et les quarante sièges restants répartis entre eux de manière à rapprocher la composition de l'assemblée à celles des résultats en part des voix.
an 2022 : Mali - Les autorités maliennes responsables du coup d'Etat s'engagent auprès de la Communauté internationale à « organiser des élections présidentielles et législatives avant le 27 février 2022 ». Cet engagement non tenu et le partenariat des autorités maliennes avec le groupe paramilitaire russe Wagner conduisent le 17 février 2022 à l'annonce du retrait de la Task Force Takuba.
Le 16 mai 2022, le gouvernement d'Assimi Goïta révèle avoir réussi à déjouer un coup d'Etat mené par des militaires maliens dans la nuit du 11 au 12 mai. Selon les sources officielles du gouvernement, cette tentative de putsch avortée a été « soutenue par un Etat occidental »
an 2022 : Afrique - Élections à venir dans l'année : dans les prochains mois se tiendraient des processus électoraux cruciaux en République démocratique du Congo, en Angola, à Sao-Tomé, en Guinée équatoriale ainsi qu’au Tchad.