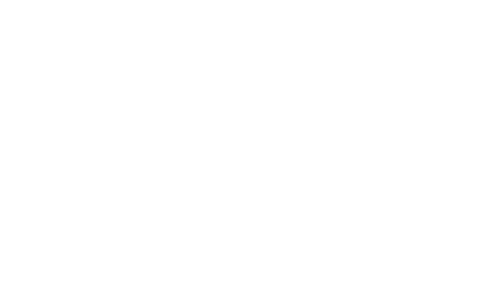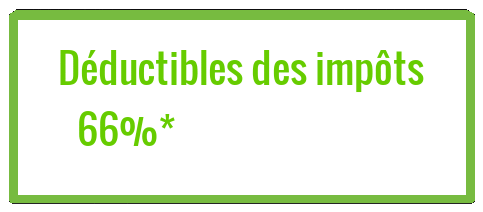HISTOIRE / GEOGRAPHIE
Histoire du Continent et de la République du Centrafrique
Création des continents

Il y a 300 à 400 millions d'années environ, tous les continents étaient rassemblés en un vaste ensemble unique, la Pangée.
Tous les continents se trouvent sur les grandes plaques tectoniques, c'est-à-dire les grandes plaques de roches qui forment la surface de la Terre. Ces grandes plaques, qui forment la croûte terrestre, se remodèlent sans cesse, créant et défaisant, au cours des millénaires, de nouveaux continents.
Quand les continents ont commencé à se déplacer il y a environ 250 millions d'années, la Pangée a ouvert l'océan Atlantique.
Entre 120 et 84 millions d’années, une deuxième phase de mouvements se met en place : l’Amérique du Sud se rattache à l’Amérique du Nord et l’ensemble des plaques Afrique, Inde et Australie suivent un mouvement grossièrement sud-nord qui conduit à la fermeture de l’ancien océan Thétys et à l’ouverture des actuels océans Atlantique Sud et Indien. C’est cette configuration (Amériques solidaires, mouvement de convergence sud-nord des plaques Australie, Inde et Afrique, vers l’Eurasie) qui perdure actuellement.
Les continents continuent aujourd'hui à dériver
L'Afrique : il y a environ 2,6 millions d'années, le continent est le berceau de l'humanité, où s'est élaboré, il y a 200 000 ans environ.
Vers la fin de la Préhistoire, le Sahara, qui était alors formé de grands lacs, devint aride et « coupa » l'Afrique en deux, conduisant à des évolutions historiques distinctes mais non totalement indépendantes entre le nord et le sud, toujours reliés par divers corridors commerciaux passant par des réseaux d'oasis et parfois même unifiés sous une même puissance, comme celle des premiers Almoravides ou de l'Empire chérifien.
2,1 milliard d'années : Gabon - Le Gabon recèle les traces de vie pluricellulaire les plus anciennes connues à ce jour. Elles remontent à 2,1 milliards d'années et ont été découvertes dans le Francevillien de la région de Franceville en 2008. En juin 2014, le CNRS annonce la découverte de nouveaux fossiles macroscopiques d'une taille allant jusqu'à 17 cm et confirme l'âge du gisement fossile à 2,1 milliards d'années.
En 2021, des pierres taillées découvertes sur le site d'Elarmékora sont datées indirectement à au moins 650 000 ans. La datation repose sur celle des échantillons de sol prélevés depuis la surface jusqu'à la strate où se trouvaient les pierres, datés par les nucléides cosmogéniques 26Al et 10Be
250 000 millions d'année : Seychelles - D’origine granitique, l’archipel des Seychelles est né voici 250 millions d’années de la dislocation de l’ancien continent Gondwana. L’Afrique est apparue à l’ouest et l’Inde à l’est. Entre les deux, l’océan Indien a rempli les vallées. Les sommets sont restés émergés, créant ainsi les 115 îles des Seychelles.
200 millions d'années : Leshoto - Des gisements de dinosaures, et des empreintes d’espèces de grande taille ont été découverts au Lesotho. Ainsi, dans les années 2000, une équipe de paléontologues britanniques, sud-africains et brésiliens a découvert les empreintes d'une espèce de dinosaure carnivore encore inconnue, sur une couche géologique datant de 200 millions d'années, dans la vallée de Roma, au sud-ouest du pays. Une rivière coulait alors à cet endroit. Ces empreintes constituent une preuve que des théropodes carnivores de très grande taille vivaient dans cet écosystème surtout dominé par une variété de dinosaures herbivores, omnivores et carnivores beaucoup plus petits, expliquent ces scientifiques. Pour Lara Sciscio, une chercheuse de l'université du Cap, « Cette découverte marque la première présence de très grands dinosaures carnivores au début du Jurassique dans le sud de Gondwana, le continent préhistorique qui s'est plus tard brisé pour former l'Afrique et les autres masses continentales »
La première difficulté, dans l'histoire de l'Afrique australe, est dans le choix des noms utilisés pour désigner les populations : les termes utilisés au XXe siècle ont souvent été ceux des colonisateurs d'origine européenne. Le terme français « Bochimans », par exemple, est dérivé du mot utilisé par les colons néerlandais « bosjesman », et signifiant littéralement « hommes des buissons », « hommes de la brousse » ou « hommes du bush ». Les colons anglais ont utilisé la traduction littérale « Bushmen ». Ces Bochimans, des chasseurs-cueilleurs, ont été opposés à des populations, arrivées de contrées plus au nord, au mode de vie plus pastoral, se consacrant à l'élevage d'animaux, à l'agriculture et maîtrisant le travail du fer et ayant une structure sociale plus hiérarchisée. À la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle, une distance est prise à la fois avec le vocabulaire des colons d'origine européenne. Plusieurs termes sont employés mais les chasseurs-cueilleurs installés initialement sont souvent désignés de peuple San. Les Sans des montagnes vécurent en autarcie pendant des milliers d'années. Mais au XVIIe siècle, les Sothos arrivés en Afrique australe quelque cinq siècles plus tôt commencèrent à coloniser les montagnes du centre du Drakensberg.
4 millions d'années avant J.C. : Éthiopie - Considérée comme l'un des berceaux de l'humanité, l'Éthiopie est l'une des plus anciennes zones de peuplement humain. Les premières traces d'hominidés remontent à 3 ou 4 millions d'années.
La Corne de l'Afrique, et en particulier le territoire de l'actuelle Éthiopie, se trouve au cœur de l'histoire de l'humanité1. On y trouve les restes de certains des plus anciens hominidés connus (entre autres, Dinknesh (ድንቅ ነሽ), appelée généralement « Lucy », âgée de 3,18 millions d'années, et Ardipithecus kadabba, un hominidé de 5,2 à 5,8 millions d'années) mais également les plus anciennes traces de l'homo sapiens moderne, après le Maroc depuis mai 2017 - Djebel Irhoud, 300 000 ans.
L'existence d'un royaume qualifié d'« éthiopien » au sud de l'Égypte est très tôt évoquée dans l'Antiquité par les sources grecques et égyptiennes, sans que sa localisation précise soit clairement identifiée.
Depuis le début des fouilles entreprises dans le pays dans les années 1960, l'Éthiopie témoigne d'un patrimoine paléontologique extrêmement riche qui entraîne encore de nos jours de nouvelles découvertes. L'Éthiopie, située sur la vallée du Grand Rift, est ainsi le pays où ont été découverts les plus anciens ossements d'Homo sapiens. Elle est également l'un des pays où des restes de très anciens hominidés ont été mis au jour, avec le Tchad (Sahelanthropus tchadensis, 6 à 7 millions d'années) et le Kenya (Orrorin tugenensis, 6 millions d'années).
L'un des fossiles éthiopiens les plus connus est Lucy, appelée localement Dinknesh. Elle a été découverte le 30 novembre 1974 à Hadar sur les bords de la rivière Awash dans le cadre de l'International Afar Research Expedition, un projet regroupant une trentaine de chercheurs américains, français et éthiopiens. Daté de 3,2 millions d'années, Dinknesh appartient au genre Australopithecus afarensis, cousin du genre Homo. Il s'agit du premier fossile relativement complet qui ait été découvert pour une période aussi ancienne. Il a révolutionné par ailleurs notre opinion sur les origines humaines, en démontrant que l’acquisition de la marche bipède remontait à plus de 3 millions d’années.
En février 2001, une équipe éthiopienne et américaine dirigée par les paléontologues Yohannes Hailé-Sélassié et Tim White annonce la découverte d'un hominidé âgé de 5,2 à 5,8 millions d'années. L'Ardipithecus kadabba (de l'Afar, ancêtre de base de la famille), considéré comme appartenant au même genre que Ardipithecus ramidus (de l'Afar Ardi, terre et ramid, racine). En janvier 2005, la revue Nature présente la découverte de nouveaux représentants de l'espèce Ardipithecus kadabba au nord-est de l'Éthiopie par l'équipe de Sileshi Semaw (Université de l'Indiana).
En février 2008, le fossile d'un ancêtre des grands singes africains est découvert dans la région de l'Afar par une équipe japonaise et éthiopienne. Âgé de 10 millions d'années, Chororapithecus abyssinicus pourrait être un gorille primitif ou représenter une branche indépendante proche de celle des gorilles. En février 2005, les restes fossilisés d'un squelette qui pourrait être le plus vieux « bipède exclusif » jamais découvert (âgé de 3,8 à 4 millions d'années), est mis au jour aux alentours de la localité de Mille, dans la région de Afar par une équipe de paléontologues éthiopiens et américains, codirigée par Bruce Latimer, directeur du Musée d'Histoire naturelle de Cleveland (États-Unis) et par le spécialiste éthiopien Yohannes Haile Selassié.
Les découvertes les plus importantes restent néanmoins celles des plus anciens représentants de l'homme moderne, notamment à travers la datation en février 2005, par Ian McDougal de deux crânes baptisées Omo 1 et Omo 2 découverts en 1967 à Kibish, en Éthiopie. À partir des sédiments dans lesquels ont été retrouvés ces crânes, ceux-ci ont été datés d'environ 195 000 ans. Ils constituent ainsi les plus vieux ossements d'Homo sapiens jamais découverts.
En juin 2003, une équipe internationale dirigée par Tim White, F. Clark Howell (Berkeley, Californie), et Berhane Asfaw (Centre de recherche de la Vallée du Rift, Addis Abeba) met au jour le fossile dénommé Homo sapiens idaltu (idaltu voulant dire « ancien » en langue Afar, région des fouilles) (Homme de Herto). Daté de 154 000 ans, communément appelé « l'homme d'Herto », il constitue alors, avec Omo 1 et Omo 2, le plus vieux représentant de l'espèce Homo sapiens. La découverte est réalisée près du village de Herto, à 225 km au nord-est de la capitale éthiopienne Addis-Abeba. Berhane Asfaw indique alors « Avec l'Homo sapiens idaltu, vous avez maintenant en Éthiopie la séquence entière de l'évolution humaine », le journal American Scientist titre en décembre 2003 : « Nous sommes tous africains ». (En mai 2017 une publication révèle les analyses de trois crânes découverts au Maroc : ils sont plus anciens de 100 000 ans...).
Dinknesh et le fossile type d'Ardipithecus kadabba sont de nos jours exposés au musée national d'Addis Abeba.
3,5 millions à 3 millions d'années Avant notre ère : Tchad -« Abel » est le surnom donné au premier spécimen de l'hominidé fossile Australopithecus bahrelghazali, découvert en 1995 au Tchad par une équipe conduite par Michel Brunet. Il aurait vécu entre 3,5 et 3,0 millions d'années et serait contemporain d'Australopithecus afarensis.
« Toumaï » est le surnom donné à un crâne de primate fossile découvert en 2001 au Tchad. Il a conduit à la définition d'une nouvelle espèce, Sahelanthropus tchadensis, que certains paléoanthropologues considèrent comme l'une des premières espèces de la lignée humaine
2,5 millions d'années Av J.C. : Afrique du Sud - De nombreux fossiles, trouvés dans les grottes de Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai et Makapansgat, indiquent que des australopithécinés vivaient sur le plateau du Highveld il y a environ 2,5 millions d'années;
2,5 millions d'années avant J.C. : Kenya - La vallée du Grand Rift est souvent désignée comme le « berceau de l'humanité » en raison des nombreux fossiles d'hominidés qui y ont été trouvés. Les plus anciens, des Proconsuls datant du Miocène, ont été découverts sur l'île d'origine volcanique de Rusinga par Louis Leakey. D'autres découvertes indiquent que des hominidés comme Homo habilis et Homo ergaster vécurent au Kenya il y a 2,5 millions d'années (Plaisancien).
2,4 à 1,8 millions d'années avant J.C. : Algérie - Il existe en Algérie, un des premiers berceaux de l'humanité, plusieurs sites ont été découverts, dans le Sahara qui était alors moins sec et où s'étendaient de vraies savanes.
Au Nord du pays, il existe de nombreux sites représentatifs du Paléolithique inférieur, tel que celui d'Aïn El Ahnech, près de Sétif, où les plus anciens restes d'hominidés en Afrique du Nord ont été attestés. Le site est considéré comme le plus ancien gisement archéologique d'Afrique du Nord. L'âge des vestiges est évalué par archéomagnétisme à 1,8 million d'années, coïncidant avec la période présumée de l'apparition de l'Homo habilis. Toutefois en 2018 sont mis au jour les gisements de pierre taillées les plus anciens d'Algérie sur le site d'Aïn Boucherit, au sud-est d'Alger, gisements vieux de 1,9 million d'années à 2,4 millions d'années
2,3 à 1,7 millions d'années avant J.C. : Éthiopie - Le site de Kada Gona, à Hadar, a livré certains des plus anciens outils taillés connus à ce jour. Ils sont âgés de 2,3 à 2,5 millions d'années. Ces premiers outils sont des galets aménagés présentant un bord tranchant.
À partir d'environ 1,7 million d'années, l'Oldowayen, caractérisé par une industrie lithique peu élaborée, laisse place à l'Acheuléen. Celui-ci se caractérise par l'apparition de nouveaux outils, plus grands et plus élaborés, tels que les bifaces, les hachereaux ou les bolas. Ces nouveaux outils apparaissent eux aussi pour la première fois en Afrique. Melka Kunture et Gadeb sont des sites éthiopiens ayant livré des vestiges de cette période.
Melka Kunture a livré des fossiles d'Homo erectus parmi les plus anciens du continent africain. Plusieurs milliers d'outils travaillés (grattoirs, rabots, pièces à encoches et outils denticulés) y ont été mis au jour. Des milliers de vestiges en obsidienne ont également été retrouvés sur ces sites : le nom de cette roche viendrait de celui d'Obsius, un personnage de la Rome antique qui signala le premier sa présence en Éthiopie.
2,3 millions d'années avant J.C. à 8 000 avant notre ère : Malawi - On a retrouvé au Malawi, sur le site d'Uraha, des restes d’hominidés datant de 2,5 à 2,3 millions d'années, parmi les plus anciens fossiles du genre Homo connus à ce jour, appartenant à Homo rudolfensis et des outils en pierre datant de plus d’un million d’années. La présence humaine est attestée au bord du lac Malawi il y a 50 000 à 60 000 ans.
2 millions d'années : Algérie - Des sites archéologiques ont livré des vestiges d’hominidés datés par archéomagnétisme de près de deux millions d’années. Le site d'Aïn Hanech (« la source du serpent »), près d'El Eulma, dans la wilaya de Sétif, a livré les industries les plus anciennes. Les chercheurs ont aussi décelé la présence d'Homo habilis et d'Homo erectus (appelé auparavant Atlanthrope), dès l'Acheuléen, à Mostaganem (site Errayah), à Tighennif, à Tabelbala-Tachenghit, à N'Gaous.
800 000 à 400 000 avant J.C. : Algérie - Le site acheuléen de Tighennif, dans la wilaya de Mascara, a livré des vestiges dont l'âge est évalué entre 800 000 et 400 000 av.J.-C. Parmi ces vestiges, composés essentiellement d'ossements d'animaux et d'objets de pierre taillée, les archéologues ont découvert les ossements d'un Hominidé qui ont conduit à la définition de l'Atlanthrope (homme de l'Atlas), aujourd'hui considéré comme un Homo erectus. L'homme de Tighennif est considéré comme le plus ancien représentant connu du peuplement de l'Afrique du Nord.
700 000 avant J.C. : Maroc - À l'Acheuléen (Paléolithique inférieur), des indices datant d'au moins 700 000 ans traduisent une première activité humaine. Ces hommes vivaient principalement de la cueillette et de la chasse. Les outils de cette époque sont les galets aménagés, le biface, les hachereaux découverts notamment dans les régions de Casablanca et de Salé. Découverte en 1999 de la statuette de la Vénus de Tan-Tan.
Habité dès la préhistoire, le Maroc et son territoire ont connu des peuplements berbères, phéniciens, carthaginois, romains, vandales, byzantins et arabes.
400 000 à 50 000 Av. J.C. : Kénya - Sur le site de Panga Ya Saidi, à l’est du Kenya découverte de la plus ancienne sépulture du continent africain. Selon eux, les os et résidus prélevés prouvent que les Homo sapiens enterraient leurs morts depuis le Middle Stone Age (400 000-50 000
av. J.-C.). Le squelette, baptisé Mtoto (qui signifie enfant en swahili) est en effet celui d’un Homo sapiens, âgé de 3 ans au moment de sa mort survenue il y a environ 78 000 ans. Plusieurs indices laissent supposer qu’un rite funéraire a été pratiqué avant l’inhumation et que celui-ci nécessitait plusieurs personnes.
400 000 Av. J.C.: Gabon - Il existe des traces d'un peuplement préhistorique du Gabon remontant à 400 000 ans et se poursuivant jusqu'à l'âge du fer.
On peut attester d'un peuplement préhistorique du Gabon. Des pierres travaillées ont été découvertes dans la région de la Lopé, datées de
400 000 ans.
400 000 à 1 000 Av. notre ère : Mozambique - L’histoire du Mozambique dans sa période préhistorique est mal connue. La première difficulté réside dans le choix des noms employés pour désigner les populations : les termes utilisés au XXe siècle ont souvent été ceux des colonisateurs européens. Le terme français « Bochimans », par exemple, est dérivé du mot utilisé par les colons néerlandais « bosjesman », et signifiant littéralement « hommes des buissons », « hommes de la brousse » ou « hommes du bush ». Les colons anglais ont utilisé la traduction littérale « Bushmen ». Ces Bochimans, des chasseurs-cueilleurs, ont été opposés aux Hottentots, autre terme des colons néerlandais, pour désigner des populations, arrivées du nord, de la vallée du Zambèze et au mode de vie plus pastoral, se consacrant à l'élevage d'animaux, à l'agriculture et maîtrisant le travail du fer et ayant une structure sociale plus hiérarchisée. À la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle, une distance est prise à la fois avec le vocabulaire des colons d'origine européenne et avec ce schéma d'opposition, cette dichotomie. Plusieurs termes sont employés mais les chasseurs-cueilleurs installés initialement sont souvent désignés de peuple San, et les populations pastorales de Khoïkhoï.
Il n'est pas confirmé qu'il y ait eu opposition des populations initiales au profit de nouveaux arrivants : comme dans d'autres contrées du monde, il est possible qu'il y ait eu dans un premier temps un processus de néolithisation des populations en place, par l'évolution du mode de subsistance, transmis ensuite des parents aux enfants, sur fond de tradition orale, puis une arrivée d'éleveurs de troupeaux plus importants, qui se traduit par une prédominance culturelle au sein de peuples déjà acquis aux évolutions majeures (élevage, agriculture, travail du fer, ...), se traduisant notamment dans la langue utilisée.
Parmi les sites archéologiques récents au Mozambique, Manyikeni, Quélimane, Ngalue (en), Chibuene (de), Sena (Mozambique), Sofala, Tete, Zumbo, ou Matola peuvent être cités. Les études archéologiques, mais aussi génétiques et linguistiques, sont utilisés pour comprendre les évolutions les plus anciennes des populations.
350 000 avant notre ère : Sénégal - Abdoulaye Camara considère que les humains sont présents au Sénégal depuis 350 000 ans.
Les plus anciennes traces de la présence humaine ont été découvertes dans la vallée de la Falémé – au sud-est du Sénégal.
300 000 avant J.C. : Maroc - C'est au Maroc, à Djebel Irhoud, qu'ont été découverts en juin 2017 les plus anciens restes d'Homo sapiens au monde, datant de plus de 300 000 ans.
300 000 à 100 000 avant notre ère : Zambie - La Zambie est riche en vestiges préhistoriques, tel le crâne de l'homo rhodesiensis, qui aurait entre 100 000 et 300 000 ans, découvert en 1921 à Broken Hill, dans une mine de zinc dans la ville de Kabwe, par le Suisse Tom Zwiglaar.
250 000 à 50 000 avant J.C. : Algérie - L'Atlanthrope vivait de la cueillette et de la chasse et se déplaçait fréquemment dans sa quête de nourriture. Il a occupé le Maghreb central durant plusieurs millénaires et fabriquait des bifaces et des hachereaux ainsi que plusieurs autres types d'outils. Homo erectus disparaît vers 250 000 av. J.-C., après près de 2 millions d'années de présence. L'Algérie est alors exclusivement peuplée d'Homo sapiens, originaires de la corne de l'Afrique, qui occupent le Maghreb central pendant 150 siècles, de 250 000 à 50 000 av. J.-C., soit jusqu'à la fin du Paléolithique moyen.
200 000 Av. J.C : Afrique Magreb - La chronologie absolue fiable pour le Paléolithique moyen de l'Afrique du Nord en est encore à ses débuts. À l'exception du Maghreb où l'Atérien est susceptible d'avoir survécu jusque vers 30 000 ans, pour la majeure partie de l'Afrique du nord, la séquence du paléolithique moyen se trouve au-delà des possibilités de datation par Le carbone 14. Les déterminations d'âge proviennent d'autres techniques comme la thermoluminescence, l'ESR et l'OSL. Les dates disponibles suggèrent que le Moustérien était présent dans le sud-est du Sahara au début de la fin du Pléistocène moyen (250-240 000 ans). Ces premières trouvailles datées du Paléolithique moyen sont identifiées comme du Moustérien et montrent de nombreuses affinités formelles avec le Moustérien du sud-ouest de l'Asie et de l'Europe.
Deux sites majeurs offrent des assemblages moustériens en Cyrénaïque: Hajj Creiem et Haua Fteah. L'Atérien est aussi présent à Haua Fteah ainsi qu'à Wadi Gan, mais est absent du site de Hajj Creiem, qui semble présenter une relativement courte période d'occupation. D'autres sites atériens sont présents dans le Tadrart Acacus, dans le sud et l'ouest de la Libye.
200 000 Av. J.C. : Congo Kinshasa (Zaïre) - Les plus anciennes traces de peuplement au Congo sont associées à un préacheuléen, découvert sur les sites archéologiques de la Mulundwa au Katanga, de Katanda et de Sanga au Kivu. Les galets taillés ou choppers ont un âge estimé à plus de 200 000 ans , sans qu'il soit possible d'être plus précis aujourd'hui.
200 000 Av. J.C. : Éthiopie - Considérée comme l'un des berceaux de l'humanité, l'Éthiopie est l'une des plus anciennes zones de peuplement humain. Les premières traces d'hominidés remontent à 3 ou 4 millions d'années. L'apparition de l'Homo erectus et de l'Homo sapiens dans la région se situe entre 1,7 million d'années et 200 000 ans avant notre ère. L'Éthiopie, durant l'Antiquité, semble avoir fait partie du pays de Pount (IIIe millénaire av. J.-C. — Ier millénaire av. J.-C.).
120 000 et 40 000 avant J.C. : Maroc - Le Moustérien (Paléolithique moyen) entre 120 000 et 40 000 ans avant l'ère chrétienne, se caractérise par l'évolution de l'outillage. Cette période a livré des racloirs et des grattoirs, en particulier au sein de l'industrie lithique de Djebel Irhoud.
La période de l'Atérien est connue uniquement en Afrique du Nord. Cette période se caractérise par la maîtrise de la production d'outils présentant des pédoncules destinés à faciliter l'emmanchement. Cette période a aussi connu un changement climatique, puisque la faune et la flore se raréfient, laissant place au désert qui coupe aujourd'hui l'Afrique en deux.
100 000 ans avant notre ère : Eswatini (Swaziland) - L'histoire de l'Eswatini remonte à des temps anciens et est restée largement inconnue en l'absence de traces écrites. Les recherches archéologiques ont mis au jour des ossements humains démontrant la présence d'hommes il y a 100 000 ans.
100 000 ans avant notre ère : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Les premiers habitants du Swaziland étaient des chasseurs-cueilleurs de type Khoïsan.
La Tanzanie telle qu’elle existe aujourd’hui est le fruit de la fusion en 1964 de l’État de Zanzibar et du Tanganyika.
Contrairement à l’archipel de Zanzibar dont l’histoire nous est relativement bien connue, ayant été dès l’Antiquité un important centre marchand, on sait moins de choses sur l’histoire de l’intérieur des terres de l'Afrique australe et orientale, en tout cas jusqu’au début du XIXe siècle, époque où ont commencé les explorations européennes.
Les célèbres gorges d'Olduvaï, situées dans le Nord de la Tanzanie actuelle, fournissent d’inestimables traces de ce qu’a été la préhistoire de la région. On y a en effet trouvé des restes fossiles de certains des plus anciens ancêtres de l’espèce humaine.
La région est supposée avoir été habitée à l’origine par des populations utilisant une langue à cliquetis de la famille linguistique khoïsane, similaire à celle des San et des Khoïkhoïs d’Afrique du Sud. Bien qu’il reste des traces de ces populations originelles, la plupart ont été déplacées par des Bantous migrant depuis l’ouest et le sud et par des Nilotes et d’autres peuples en provenance du nord. Les Bantous sont supposés être arrivés dans la région dès le Ve ou IVe siècle av. J.-C.
Les nilotiques et para-nilotiques sont, eux, arrivés par vagues successives, les premières au début du Ier millénaire av. J.-C. et les dernières vers le XVIIIe siècle, notamment les Masaïs qui ont migré jusqu’au nord de la Tanzanie à partir du XVe siècle, se heurtant à un certain nombre d’ethnies déjà installées, comme les Gogos ou les Hehes.
Certaines de ces populations africaines avaient atteint un haut niveau d’organisation et contrôlaient de larges territoires quand les explorateurs et les missionnaires européens ont pénétré l’intérieur du pays à partir du début du XIXe siècle.
les premiers marchands
La région côtière, au contraire, a subi ses premières influences étrangères dès l’Antiquité.
Rhapta, ancienne ville marchande que l’on situe quelque part entre la région de Tanga et le delta du fleuve Rufiji, tout au sud de l’antique territoire de l’Azanie, était un centre marchand familier des commerçants de l’époque romaine en provenance notamment de Grèce, d’Égypte, de Phénicie...
Mais ce sont avec les marchands en provenance de la péninsule Arabique, du Golfe Persique et d’Inde que les relations ont été les plus fortes. Les navires, les fameux boutres, poussés par les vents de la mousson, parvenaient à Zanzibar vers décembre en provenance des Indes et de la péninsule arabique. En mars-avril, ils repartaient grâce aux alizés soufflant du sud-est.
90 000 Av J.C. : Afrique du Sud - Il est généralement admis que Homo sapiens, l'humain moderne, remplace Homo erectus il y a environ
100 000 ans. Des fossiles controversés, trouvés sur le site des grottes de la rivière Klasies, dans la province du Cap-Oriental, indiqueraient que l'humain moderne vivait en Afrique du Sud il y a plus de 90 000 ans.
L'Afrique du Sud compte également de nombreux sites du Middle Stone Age tels que Blombos, Diepkloof ou Border Cave. Ces sites ont livré des vestiges interprétés comme des indices de l'émergence de la modernité culturelle, blocs d'ocre gravés, perles en coquillage (Blombos), coquilles d'œuf d'autruche incisés (Diepkloof), os incisés (Border Cave).
Durant le Later Stone Age, des groupes apparentés aux Bochimans et aux Khoïkhoïs actuels se mettent en place. Il est difficile de reconstituer précisément l'histoire et l'évolution de ces groupes. Il semble que le nombre des Bochimans n'ait jamais excédé une cinquantaine de milliers d'individus sur le territoire de l'actuelle Afrique du Sud. Ces chasseurs-cueilleurs nomades n'ont, en termes modernes, laissé presque aucune empreinte écologique excepté des peintures rupestres.
70 000 Av. notre ère : Mauritanie - Les premiers habitants de la Mauritanie sont apparus il y a au moins 70 000 ans. Le climat était alors plus humide, le territoire était parsemé de cours d'eau et de lacs poissonneux et la faune y était abondante. Dans ce contexte, des populations venues du Sud (Bafours) y ont développé une civilisation de chasseurs-pêcheurs puis agropastorale. Ces populations étaient en partie sédentaires.
Le Sahara néolithique, à l’instar de l’Europe au paléolithique (dans les millénaires précédents) a fourni des témoignages poignants du sens artistique de l’homme, en particulier dans le domaine de la gravure et de la peinture rupestre: les fresques extraordinaires du Hoggar et du Tassili N’ajjer le prouvent.
La sculpture sur pierre, sur os et sur bois, la bijouterie de pierre sont également présents. La Mauritanie Néolithique a connu ces techniques artistiques mais, de même peut-être que pour la céramique, il semble qu’elle fasse figure de parent pauvre. On n’y a pas découvert pour l’instant de fresques rupestres notables, ni de sculptures particulièrement exceptionnelles. L'explication en serait qu'il y a peut-être eu, d’Est en Ouest à travers le Sahara, une "dégradation" du sens artistique de l’homme néolithique, qui ne serait parvenu que plus récemment dans cette partie occidentale d'Afrique.
60 000 Av J.C. : Soudan - Les fouilles archéologiques menées sur le Nil en amont d'Assouan ont confirmé l'occupation humaine de la vallée dès le paléolithique, il y a plus de 60 000 ans, principalement vers Khashm El Girba et Khor Musa, avant 8000 avant notre ère, mais aussi Affad 23 et Djebel Sahaba.
50 000 à 20 000 avant J.C. : Algérie - À partir de - 50 000 et jusqu'à - 20 000 av. J.-C., l'Acheuléen cède la place à l'Atérien.
Durant cette période, vers 20 000 av. J.-C., de fortes pluies tombent au Sahara et au Nord de l'Algérie, qui connaissent alors un climat très humide favorisant le développement des populations d'éléphants, de girafes, de rhinocéros et autres, que les Atériens chassent en grand nombre.
Vers 20 000 av. J.-C., apparaît la culture dite parfois de « l'homme de Mechta Afalou » qui s'épanouit surtout sur la côte et dans la zone tellienne. Pour désigner la même réalité humaine, et pour la même époque, on a parfois parlé de culture « ibéro-maurusienne » parce qu’on avait pensé trop hâtivement qu’elle chevauchait entre l'Espagne et le Maghreb, cette culture est ensuite parfois qualifié de « Oranien » puis « Mouillie » ou « industrie de la Mouillah »
45 000 à 12 000 Av J.C. : Afrique Côte d'Ivoire - La date de la première présence humaine en Côte d’Ivoire est difficile à évaluer, les ossements ne se conservent pas dans le climat humide du pays. Cependant, la présence de fragments d'armes et d'outillages très anciens (haches polies taillées dans des schistes, débris de cuisine et de pêche) découverts sur le territoire national est interprétée comme la possibilité de la présence d’hommes, en assez grand nombre, au paléolithique supérieur (45 000 à 12 000 ans avant le présent) ou au minimum, l’existence sur ce terroir, d’une culture néolithique. Les plus anciens habitants connus de la Côte d’Ivoire ont toutefois laissé des traces disséminées à travers tout le territoire. Les populations arrivées avant le XVIe siècle sont aujourd'hui des groupes minoritaires ayant plus ou moins bien conservé l'essentiel de leurs civilisations. Ce sont les Agoua et Ehotilé (Aboisso), Kotrowou (Fresco), Zéhiri (Grand-Lahou) et Ega ou Diès (Divo).
45 000 à 12 000 Av. notre ère : Libye - Haua Fteah est une grotte très large et profonde, avec une très longue séquence du Paléolithique moyen, qui comprend des horizons atériens et moustériens. Il existe deux dates carbone 14: 43 400± 1300 ans et 47 000± 3200 ans. La méthode C14 montre des limites quant à la certitude de ces dates. De rares pièces atériennes se rencontrent aussi dans des horizons du début du paléolithique moyen (couche XXXV), que McBurney date de la fin du dernier interglaciaire, sur la base de calculs de températures basés sur des coquillages marins associés. Ces niveaux dateraient de plus de 70 000 ans. Les outils de type atériens (grattoirs, burins ; des pièces foliacées bifaciales, des racloirs et des pièces pédonculées) ont été retrouvés en quantité notable. Ils sont légèrement plus fréquent dans la séquence haute mais disparaissent dans la séquence inférieure (couches de sédiments). Des indices isotopique des coquillages retrouvés dans ces sédiments indiquent une température froide. Dans ce cas, les niveaux moustériens semblent suivre l'Atérien.
Un assemblage très différent a été retrouvé à Wadi Gan, dans l'ouest de la Libye. Le site est un mince horizon d'occupation. L'assemblage consiste en quelques nucléus de très petite taille, d'outils fait de pièces pédonculées, des pointes moustérennes (quelques-unes denticulées et qui peuvent être classées comme des pointes de Tayac), des racloirs, des grattoirs ; d'autres outils comprennent des denticulés, un burin et une pièce foliacée. Les fréquences des pièces pédonculées et des pointes sont plus élevées et celles des pièces foliacées bifaciales plus faibles, dans le Wadi Gan que dans les niveaux atériens de Haua Fteah. L'importance du nombre des grattoirs par rapport aux racloirs, et la pauvreté en pièces foliacées bifaciales au Wadi Gan rappelle l'Atérien tunisien. Cela pourrait indiquer un contact avec des groupes du paléolithique supérieur présents dans l'est de la Libye vers 35 000 ans et dans la vallée du Nil avant 32 000 ans. L'assemblage du Wadi Gan serait plus récent, entre 30 000 et 35 000 ans.
Deux fragments de mandibules, une d'adulte et l'autre juvénile, ont été découverts par McBurney dans la couche (XXXIII) levallois-moustérienne, à proximité de l'interface avec la couche XXXIV, et environ 2,5 m sous le niveau du début du Paléolithique supérieur. Les données paléoclimatiques indiquent un épisode froid et une date C14 de 47000 ans, permettent à McBurney de situer ces hominidés à une époque contemporaine du début du Vistulien. L'examen des mandibules, par Klein et Scott, démontre l'absence de caractères néandertaliens dans ces fragments. Il a été alors proposé comme au Djebel Irhoud ou les Atériens de Dar es Soltan, que cette population non-néandertalienne n'était cependant pas encore totalement moderne.
40 000 Av J.C. : Afrique du Sud - Les Khoïsan, regroupant les Khoïkhoïs et les Sans, sont les premiers habitants connus de l'Afrique du Sud (40 000 av. J.-C.).
40 000 Avant notre ère : Zimbabwe, ou Zimbabwé - La présence des premiers habitants en Afrique australe, les San, est attestée depuis plus de 40 000 ans et ils sont donc les premiers habitants du pays. On trouve au Zimbabwe une importante concentration d'œuvres picturales préhistoriques datant de 13 000 ans avant notre ère
35 000 Av. notre ère : Mauritanie - Paléo-climat
En 35 000 ans, le Sahara — y compris en Mauritanie — a connu au moins trois périodes désertiques (avant l’actuelle) et quatre périodes humides plus ou moins tropicales. (cf. tableau en image) Le tableau présenté n'est évidemment pas exhaustif et les datations sont sujettes à caution. Certains spécialistes intercalent d’autres périodes: ainsi une époque sèche, le Tafolien, apparaît soit entre le Tchadien et le Nouakchottien, soit après ce dernier; ce qui a des conséquences dans la chronologie préhistorique. Quoi qu’il en soit, l’idée que l’on a des paléoclimats de Mauritanie est relativement précise.
30 000 Av J.C. : Guinée-équatoriale - Les vestiges d'une présence humaine ont été découverts en fouille au site de Mossumu (province du Littoral) et datés de 30 000 av. J.-C. Il s'agit d'une industrie dite « Sangoenne », bien connue à cette époque à travers l'Afrique centrale. Quelques autres sites, de surface ou en affleurement stratigraphique, indiquent que l'Âge Moyen de la Pierre est bien représenté dans cette partie du pays.
30 000 et 20 000 avant notre ère : Maroc - Le Paléolithique supérieur est marqué par l'arrivée d'Homo sapiens, porteur de l'industrie ibéromaurusienne. À Taforalte (Berkane), les outils retrouvés datent de 30 à 20 000 ans av. J.-C. Des rites funéraires sont identifiés : les morts ont le corps en décubitus latéral et les os peints.
30 000 Av. notre ère : Mauritanie - Paléoclimat
Il y a 30 000 ans, le Sahara est humide et très fertile; les pluies sont abondantes et les températures relativement tempérées. Le réseau hydrographique est fonctionnel et se jette dans l’Océan Atlantique aux rives plus hautes qu’aujourd’hui.
Les ergs sont fixés par un manteau végétal steppique, arboré ou herbacé, suivant les régions et les époques. La faune, outre quelques espèces aujourd’hui disparues, est celle des régions tropicales actuelles : éléphant, rhinocéros, hippopotame, girafe, bovidé, gazelle, antilope, phacochère, lion, crocodile, poissons, mollusques.
Cette période du Paléolithique inférieur est donc favorable au développement de la vie humaine qui existait déjà depuis longtemps par ailleurs. Les premiers Mauritaniens trouvaient probablement aisément de quoi satisfaire leurs besoins par la cueillette et par la chasse.
26 000 Av J.C. : Afrique du Sud - L'histoire de l'Afrique du Sud est très riche et très complexe du fait de la juxtaposition de peuples et de cultures différentes qui se succèdent et se côtoient depuis la Préhistoire. Les Bochimans y sont présents depuis au moins 25 000 ans et les Bantous depuis au moins 1 500 ans. Les deux peuples auraient généralement cohabité paisiblement. L'histoire écrite débute avec l'arrivée des Européens, en commençant par les Portugais qui décident de ne pas coloniser la région, laissant la place aux Néerlandais. Les Britanniques contestent leur prééminence vers la fin du XVIII ème siècle, ce qui mène à deux guerres. Le XXe siècle est marqué par le système législatif séparatiste et ségrégationniste de l'apartheid puis par l'élection de Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud, à la suite des premières élections nationales multiraciales au suffrage universel organisées dans le pays.
26 000 Av J.C. : Namibie - Il y a peu de traces des premiers habitants de Namibie. La découverte en 1991 dans les monts Otavi de la mâchoire d'un grand singe du miocène moyen, l'Otavipithecus (qui n'est pas un hominidé au sens strict), de fragments d'os crânien, de vertèbres, d'outils et d'armes de l'âge de pierre atteste d'une présence ancienne humaine et pré-humaine dans cette région d'Afrique australe.
C'est dans cette actuelle Namibie que l'on trouve également les traces les plus anciennes d'art rupestre du continent africain. Datant de 26 000 ans av. J.-C., elles sont attribuées à des populations nomades dont les Bushmen (ou San) seraient les descendants directs.
20 000 à 10 000 Av J.C. : Algérie - Au Paléolithique moyen, les industries lithiques atériennes sont caractérisées par la présence de pièces à pédoncule. L'évolution des formes humaines depuis l'Homo erectus a abouti à l'apparition de l'Homo sapiens de type archaïque, ancêtre de la forme humaine actuelle.
Le Paléolithique se termine avec l’Ibéromaurusien, connu en particulier à la suite des fouilles menées dans la grotte d’Afalou, en Kabylie, qui ont révélé l'existence à cette période (il y a 20 000 ans à 10 000 ans environ) d'un art mobilier (petites statuettes zoomorphes) et d'enterrement.
23 000 à 16 000 Av. notre ère : Mauritanie - Paléoclimat
Plus tard, les périodes arides et humides ont alterné. Entre -23 000 et -16 000, l’océan présentait, du fait de la fonte des glaces, un rivage à quarante mètres au-dessus du niveau actuel. C’est l’époque du « Sahara des lacs », autour desquels la vie est prospère.
16 000 à 12 000 Av. notre ère : Nigéria - Dans les forêts du sud-ouest du Nigeria, des restes humains parmi les plus anciens d'Afrique ont été découverts par Charles Thurstan Shaw en 1965, dans un abri sous roche à Iwo Eleru. Ces restes humains ont été datés entre 16000 av. J.-C. et 12000 av. J.-C
15 500 Av. notre ère : Mauritanie - Paléoclimat
Vers 15 500 avant notre ère, la mer s’est retirée jusqu'à cent dix mètres en dessous de son niveau actuel. Le fleuve Sénégal n’atteint alors plus l’océan: il s'évapore vraisemblablement dans des petits lacs et oasis. Certains préhistoriens pensent que le Nord de la Mauritanie est vide à cette époque, du fait de conditions de vie trop dures
15 000 avant notre ère : Maroc - Une étude sur des restes âgés de 15 000 ans dans la région a démontré que l'Afrique du Nord a reçu des quantités importantes de flux génétique d'Eurasie avant l'holocène et le développement des pratiques agricoles.
12 000 à 5 000 Av J.C. : Haute -Volta future Burkina Faso - Comme pour tout l'ouest de l'Afrique, le Burkina Faso a connu un peuplement très précoce, avec notamment des chasseurs-cueilleurs dans la partie nord-ouest du pays (12 000 à 5 000 ans avant l'ère chrétienne), et dont des outils (grattoirs, burins et pointes) ont été découverts en 1973.
11 000 à 3 500 Av J.C. : Guinée-équatoriale - L'étude de la Préhistoire de la Guinée suit une subdivision géographique, l'île de Bioko d'une part, la province du Littoral entre Cameroun et Gabon d'autre part.
L'île de Bioko était reliée au continent jusqu'en 8 000 av. J.-C. par un « pont » qui fut lentement immergé par la montée des eaux de l'Atlantique, qui avait débuté vers 11 000 av. J.-C. à la fin du dernier Âge glaciaire. De ce fait, il est probable que ce territoire devait être habité par des populations nomades de chasseurs-cueilleurs, à l'instar de ce qui est connu sur le continent actuel.
Sur l'île de Bioko, il s'agit d'une autre lecture ; celle-ci sera très certainement modifiée dans les années à venir avec l'installation de projets de recherches archéologiques. Trois gisements « prénéolithiques » ont été recensés. Seul celui du séminaire de Banapa au sud de Malabo a été fouillé dans les années 1960 par un anthropologue espagnol. Tout ce qui peut être dit est qu'il est antérieur à la « Tradition Timbabé » de Bioko, encore non datée, elle-même antérieure à la « Tradition Carboneras » datée par le radiocarbone entre le Ve et le Xe siècle de notre ère. Il faut signaler que sur l'île d'Elobey Grande, des pierres taillées similaires à un Âge Récent de la Pierre ont été découvertes en surface. Ces trouvailles étayent l'idée d'une grande ancienneté de la présence humaine sur l'ensemble des îles équatoguinéennes avant qu'elles ne soient définitivement séparées du continent.
Enfin, l'expansion du mode de vie villageois en Afrique centrale implique dans sa modélisation, et avec le rapprochement des données de la linguistique, l'installation sur l'île de Bioko de villages dès 3 500 av. J.-C. Pour l'instant rien n'a été découvert pour vérifier cette hypothèse. La séquence archéologique de l'île, outre le pré-néolithique déjà mentionné, démarre avec la « Tradition Timbabé » connue sur treize points du littoral. Une continuité d'occupation de cette île est désormais bien attestée jusqu'à l'époque historique. À la suite du « Timbabé », on connait les traditions « Carboneras », « Bolaopi », « Buela », et enfin « Balombe ». Cette dernière tradition est historique.
Sur le continent, entre Cameroun et Gabon, les données de fouilles restent lacunaires mais sont suffisantes pour affirmer que la séquence complète qui reste à découvrir sera dans les grandes lignes similaire à ce qui est connu au sud-Cameroun et dans la région de Libreville au Gabon.
Préhistoire 10 000 avant notre ère : Somalie - Des vestiges de l'époque préhistorique existent par exemple sur les sites de Dhambalin, Gaanlibah, Karinhegane et surtout Laas Geel, et par de très nombreux cairns. Des traces de civilisation humaine ont été découvertes notamment à Buur Heybe, dans le sud de la Somalie. Au nord, des peintures rupestres ont été trouvées à Karinhegane, à Laas Geel ainsi qu'à Dhambalin et sur d'autres sites de la région de Togdheer.
La région de Sanaag présente de nombreux sites archéologiques intéressants, encore peu explorés, dont des cairns, à proximité de Armale, Dabhan, Damala (Somalie), El Ayo, El Buh, Erigavo, Haylan, Hingalol, Karinhegane, Laako, Las Khorey, Macajulayn, Maydh, Neis, Qa’ableh, Qombo'ul, Salweyn, Yubbe, mais aussi Gudmo Biyo Cas, Heis, Gelweita, El Ayo.
La ville médiévale ruinée de Maduna est le site le plus remarquable (comparable à Amud , Yubbe et Abasa (Awdal) dans la région d'Awdal), et probablement de l'époque du sultanat d'Adal.
10 000 à 6 000 avant J.C. : Éthiopie - Des découvertes archéologiques récentes montrent que les habitants de l'Éthiopie actuelle pratiquaient l'art rupestre vers 10 000 a. J.C. De nombreuses peintures ont été retrouvées dans les régions d'Hararghe, Gamu-Gofa, du Tigré, dans la vallée du Nil Bleu et en Érythrée. Certaines d'entre elles montrent la traite des vaches, l'utilisation d'arcs et de flèches, de lances et de boucliers. Le bétail, les chèvres, des lions et des éléphants y sont très représentés. L'agriculture, via la culture du teff, des graines de Nyjer (graines de Niger) issues de Guizotia abyssinica, et de la banane ensete (Edulis edule), qui étaient déjà cultivées avant 5000 av. J.-C. Les cultures de blé et d'orge, tout d'abord apparues en Asie Mineure et en Iran, sont introduites vers 6000 av. J.-C. Des recherches menées près d'Aksoum montrent que le labourage et l'araire sont utilisés avant le début de l'ère chrétienne. Les pièces axoumites préchrétiennes représentent un épi de blé, accompagné du symbole préchrétien du Soleil et de la Lune.
La date de domestication du bétail est mal définie. Les peintures rupestres suggèrent que les moutons et les chèvres sont domestiqués avant 2000 av. J.-C.
10 000 avant J.C. : Éthiopie - Le mégalithisme éthiopien : On dénombre dans la région du sud de l'Éthiopie la plus grande concentration de mégalithes de tout le continent africain. Au nombre d'une centaine dans le Harar, d'autres plus récents (Ier millénaire de notre ère) se comptent par milliers dans le Choa et le Sidamo. L'une des régions les plus marquées par ce mégalithisme se trouve au sud d'Addis-Abeba, où quelque 160 sites archéologiques ont été découverts jusqu'à présent, celui de Tiya est l'un des plus importants. Il comprend 36 monuments, dont 32 stèles présentant une figuration sculptée faite d'épées et de symboles demeurés énigmatiques.
Certaines de ces sépultures, ou dolmens, sont d'une grand ancienneté puisque plusieurs remontent au dixième millénaire avant notre ère. La taille du monument varie de 1 à 8 mètres. On sait que la plus grande partie de ces mégalithes ont une signification funéraire, et ont vraisemblablement été érigés par un peuple d'agriculteurs.
Un des motifs récurrents du site est un symbole « ramifié » que l'on retrouve également sur les sites de Sodo, et sur les monolithes phalloïdes du Sidamo, plus au sud. Il semble que l'être humain soit souvent le centre de la représentation, lorsque le monument n'est pas lui-même anthropomorphe. On distingue ainsi selon Francis Anfray : « des stèles anthropomorphes, des stèles à épées, des stèles à figuration composite, des stèles au masque, des monolithes phalloïdes, des pierres hémisphériques ou coniques, des stèles simples sans nulle figuration ». On sait que la plus grande partie de ces mégalithes ont une signification funéraire, vraisemblablement érigés par un peuple d'agriculteurs.
Les explorateurs étrangers connaissent ces monuments depuis la fin du XIXe siècle. Les Éthiopiens musulmans et chrétiens ignorent aujourd'hui leur origine. Ces stèles n'ont pas encore pu être datées avec précision : alors que les archéologues Azaïs et Chambard, découvreurs du site, ainsi que par la suite Jean Leclant, proposent l'origine d'un culte néolithique par les ancêtres des Égyptiens, une autre équipe d'archéologues français propose une datation entre le XIe et le XIIIe siècle, l'UNESCO ne proposant pas de datation officielle. Le symbolisme élaboré des stèles n'a pas non plus reçu d’explication à ce jour.
Le champ de stèle de Tiya est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et a fait l'objet récemment d'une restauration intégrale.
10 000 à 500 avant J.C. : Éthiopie - L'Antiquité éthiopienne - Les sources égyptiennes : Le Royaume de D'm't
Des recherches menées dans la région d'Axoum montrent que la région est occupée par une population de l'âge de pierre depuis environ 10 000 av. J.-C. Dans le Ier millénaire av. J.-C. un type d'agriculture proche de celui encore pratiqué dans certaines régions du Tigré apparait53. On note à cet égard le site de Kidane Meret, découvert en 1994-1996, dans le nord d'Axoum, qui montre que ceux-ci vivaient dans des bâtiments de forme rectangulaire bien avant l'époque de l'émergence d'Aksoum.
Vers 800-700 av. J.-C. le site semble avoir attiré des populations sudarabiques qui s'établissent dans quelques zones de fertilité et qui ont au moins une signification religieuse. Parmi ceux-ci le site le plus connu est celui de Yeha, à l'est d'Axoum. Le type de relation entre populations est mal connu, le site de Kidane Meret montre en particulier que des populations pratiquant l'agriculture sans connexion avec les pratiques sud-arabiques partageaient la même zone géographique.
Une forme de centralisation politique apparait vers le Ve siècle av. J.-C. sous le nom de D'mt (Damaat). Celle-ci incorpore des éléments de langue sudarabique, avec un type d'agriculture et de technologie local, combinant pratique du commerce et de l'agriculture. La transition de D'mt au royaume d'Aksoum reste encore aujourd'hui assez peu comprise.
Sur la période qui va du premier millénaire avant l'ère commune jusqu'au milieu du premier millénaire après, des relations suivies entre les deux rives de la mer Rouge sont visibles dans les constructions de cette époque. Elles ont fait l'objet d'une publication en 2015.
10 000 Av. J.C.: Gabon - Des haches et des pointes de flèches datant de l'âge de pierre, environ 10 000 ans avant notre ère, ont également été trouvées dans le Moyen-Ogooué et dans le sud. Des dessins gravés sur roche près du cap Lopez ont été datés de plus de 8 000 ans. Des traces d'activités humaines de l'âge du fer montrent la continuité du peuplement de la zone.
10 000 à 2000 avant J.C. : Libye - Les restes momifiés d'un jeune enfant négroïde, daté d'il y a 5.500 ans, ont par ailleurs été retrouvés dans le Tadrart Acacus.
Néolithique :
De 10 000 à 8 000 ans, apparition de la culture des céréales dans le croissant fertile englobant le Nil. Premiers centres de civilisation primitive, Merimde, Maadi, Fayoum, Tasa, Badari, Nagada. Maisons à angles droits, d'abord en roseaux recouverts d'argile, puis en pisé et enfin en brique séchée. Comme à la période précédente, il n'existe aucune différence notable de civilisation et de peuplement entre la Libye, l'ensemble du Maghreb et l'Égypte. Ce sont les descendants des Caspiens.
De 10 000 ou 8 000 ans, apparition en Tunisie, Libye, Palestine, Égypte d'une culture méditerranoïde dite Capsien caractérisée par des petites lames en forme de demi-lune. Culture des « bifaces » et civilisation de la « pierre éclatée » dans tout le Maghreb.
De 7 000 à 9 000 ans, culture au Maghreb dite « Iberomaurusien » qui disparut il y a dix mille ans sans laisser de descendance (d'après certains chercheurs il n'y aurait aucun rapport entre ce cro-magnoïde venu de la péninsule ibérique et les Guanches des îles Canaries. Il aurait donc disparu sans laisser de descendance).
De 6 000 à 4 000 ans dans le Sahara, c'est la période des chasseurs ou du Bubale.
De 4 000 à 1 500 ans, arrivée de pasteurs indo-européens venus d'Asie Mineure. Poursuite de la civilisation des Capsiens (petits groupes de chasseurs négroïdes à la pierre polie, semi-nomades, javelots, massues, sagaies, flèches, harpons, emploi d'ocre comme colorant, usage de meule pour écraser les produits de la cueillette, art de coudre les peaux, de travailler l'os avec des grattoirs, de tresser, puis la poterie font leur apparition). Commerce intensif de l'ambre et de l'étain entre l'Europe, la Méditerranée, l'Asie Mineure, le Proche-Orient, par terre ou par mer. Sur le plan stylistique, c'est la grande période des pasteurs de bœuf, histoire du Bos Taurus qui verra les roches du Sahara se couvrir de peintures rupestres, peintures rupestres du Sahara - Tassili-n-Ajjer, Adrar des Iforas, Aïr, Ahnet, Ahaggar, identique à Ouenat (Nubie)- variété des types humains ; négroïdes, leucodermes et mixtes.
Le pasteur de la fin de l'âge de pierre domestique le bétail, chèvres, moutons, pratique la cueillette de graminées sauvages, et commence tout juste la culture de parcelles au bord du Nil. L'habitat dans le désert est troglodytique ou sous des huttes faites de branchages, tandis que près des fleuves et vers l'Égypte les habitations sont faites en briques et en argile. Sur le plan spirituel c'est la poursuite de la mystique pastorale, commune à tous les peuples pasteurs, entamée en Asie Mineure et présente en Afrique d'une manière similaire chez tous les groupes berbères et une « religion du Bœuf » commune à toute la Méditerranée. Mais c'est là, dans le désert encore vert que va se forger l'ethnogenèse berbère.
À l'est de la future Libye, dès 3 000 av. J.C. alors que le delta n'est encore qu'un marigot émergeant tout juste de la mer, commence une toute nouvelle civilisation : la civilisation égyptienne. Des inscriptions égyptiennes datant du IIIe millénaire av. J.-C. ont été trouvées sur ce que les archéologues appellent la piste d'Abou Ballas reliant le jebel Uweinat et la zone de Gilf al-Kabir à l'oasis d'Ad-Dakhla. Cette Égypte pharaonique qui apparaît tisse des liens à travers le sud de la Libye vers l'Afrique.
Peu à peu, Égypte et Libye vont affirmer leurs identités respectives. L'Égypte va se tourner vers l'Orient, la Libye va se tourner vers sa seule voie d'expansion possible, la mer Méditerranée, dont elle reçoit régulièrement, par bateaux, la visite de peuples maritimes, en particulier des civilisations égéenne et phénicienne. De fait, dès le Néolithique, la plupart des habitants de la Libye habitent le front de mer, tandis que l'interland en voie de désertification dès le IIe millénaire av. J.-C. constitue un repli pour des groupes épars, réunis en chefferies et en communautés de pâtres.
Vers -1500 ans, période du cheval, s'étendant jusqu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne. On observe l'apparition de petites aristocraties locales suffisamment puissantes et influentes pour nouer alliance avec les peuples belliqueux de Méditerranée, l'arrivée de populations venues du nord de l'Europe, de Colchide (ancienne Géorgie), d'Asie Mineure, du Proche-Orient et d'Iran. Des chars attelés font leur apparition, de facture identique à ceux de la Grèce antique (tombes à fosses du cercle A de Mycènes, stèle du Péloponnèse représentant des chars identiques ; décors à base de cercles, spirales et courbes enlacés prisés de longue date par les Egéens). Sont aussi présentes des armures et des lances à armature métallique, arme de prédilection des pasteurs de bovins du Sahara méridional.
Au nord, des affrontements contre l'Égypte se poursuivront jusqu'à la romanisation du Maghreb (~Ve siècle av. J.-C.). Peu à peu les tribus libyennes du sud vont être repoussées vers le Sahel et ce pour deux raisons très simples : la désertification du Sahara commencée au IIe millénaire avant notre ère et l'entretien d'une cavalerie sensible aux écarts de températures et aux épizooties. Moutons et chèvres sont gardés sur les côtes (désert de Syrte ; Cyrénaïque), sur les monts de la chaîne libyque. Le désert Libyque est traversé par des bouviers.
10 000 Av. notre ère : Mauritanie - On a retrouvé de très nombreux monuments néolithiques en Mauritanie. Ils sont peu spectaculaires mais donnent une idée des rites funéraires et peut-être sur une religion de l’homme du néolithique Mauritanien. Un problème est de les dater: comme l'écrit R.Vernet beaucoup sont en fait protohistoriques ou préislamiques. Comme on n’a généralement trouvé qu’un maigre matériel lithique en situation, la datation est difficile.
Ces monuments sont le plus souvent de facture très simple. Les plus complexes sont les alignements de pierre, en trois rangées, que l’on rencontre à plusieurs reprises en bordure de l’Aouker. Il existe aussi un certain nombre de pierres dressées. Cependant les monuments les plus nombreux et les plus facilement identifiables sont les tombes. Les types sont très variés, du simple tas de cailloux à la forme la plus élaborée, signe probable de la qualité sociale du défunt.
Le tumulus est fréquent, parfois assez perfectionné, comme à Lembetet el Kbir, près d’Akjoujt, où N. Lambert en a fouillé un d’un diamètre extérieur de 4,70 m et d’une hauteur de 1,20 m. Mais celui-ci est peut-être trop récent pour être néolithique, car il est possible qu’il soit en rapport avec les mineurs de cuivre protohistoriques.
Les formes les plus élaborées sont le chouchet et la barkhane. Le premier est un monument funéraire cylindrique, haut de deux à trois mètres et d’un diamètre de trois à cinq mètres. Le second tire son nom de la dune en forme de croissant. L’ouverture des branches peut atteindre cinquante mètres. La barkhane est artificiellement levée avec du matériel lithique mêlé de terre. Là encore, les seuls cas étudiés sont ceux de Lembetet el Kbir, qui semblent assez représentatifs malgré leur âge tardif.
Concernant les possibles axes commerciaux, une hypothèse formulée en 1947 par R. Mauny, admet que les gravures et peintures rupestres de chars et chariots trouvés au Sahara s’échelonnent selon des directions privilégiées, généralement selon des axes Nord-Sud. On connait aujourd’hui environ 450 représentations de chars, dont la plupart sont récentes, de la période traditionnellement appelée « libyco-berbère », c’est-à-dire du dernier millénaire avant J. C. Ces chars à deux roues, tirés en général par des chevaux (par des bœufs avec parfois quatre roues dans l’Aouker, où leur origine est méridionale) sont arrivés dans le Sahara avec de nouvelles populations, nomades, venues d’Afrique du Nord, les Berbères. Les chars sont donc le symptôme d’un changement ethnique dans le Sahara vers la fin du Néolithique. Ils correspondent à la poussée vers le sud, à la faveur de l’assèchement du climat, de nomades guerriers, au détriment de populations africaines refluant vers le sud — comme le montre la fortification des derniers villages de l’Aouker, fort médiocres par rapport aux sites anciens.
Par exemple, une de ces « routes de chars » traverse le Sahara occidental de Bir Moghrein à Nema et jusqu’au Niger. On a retrouvé des rupestres le long d’un « axe » allant de Bir Moghrein à Atar, d’Atar à Tidjikja, puis Tichitt, Oualata, Néma et le Niger — avec une « bretelle » sur le centre de l’Aouker. Cette « route » suit un tracé « facile » en longeant le pied d'une falaise.
Le char et le cheval sont donc apparus à peu près en même temps dans le Sahara, venus de Méditerranée orientale avec diverses invasions; atteignant d’abord la Cyrénaïque, dans la deuxième moitié du deuxième millénaire avant J. C. Les habitants de la région, « libyco-berbères » ou « garamantes » antiques, diffusèrent ensuite le char léger (aussi appelé « au galop volant ») dans tout le Sahara en le conquérant, grâce en particulier au cheval et aux armes de fer. Il s’agit donc de la dernière migration ethnique qu’ait connu le Sahara avant les Arabes — les nomades berbères, guerriers Garamantes (à l’Est) et Gétules (à l’Ouest), remplaçant les éleveurs noirs qui se replièrent vers le sud, vers les zones plus humides du Tchad, du Niger et du Sénégal, où ils firent paître leurs troupeaux et pratiquèrent l’agriculture.
L'une des plus anciennes culture archéologiques identifiables sur le territoire de la Mauritanie actuelle est la Culture de Foum Arguin. Cette culture épipaléolithique est encore mal cernée, tant sur le plan spatial que chronologique, mais elle occupe vraisemblablement vers 7000 av notre un espace considérable sur la côte entre Tarfaya et le cap Juby, au Maroc, et le cap Timiris et le sud du Tijirtit. Vers l'intérieur, elle atteint la région de Zouérate. La Culture de Foum Arguin est caractérisée essentiellement par son industrie lithique particulière. Des liens avec l'Atérien sont supposés mais incertains. Elle est suivie par la Culture dite de Tintan, une culture néolithique avec laquelle elle semble n'avoir également que peu de liens.
10 000 Av. notre ère : Mauritanie - Paléoclimat
Nouveau changement vers 10 000 avant notre ère: les pluies redeviennent régulières (400 à 600 mm par an) et le réseau hydrographique est fonctionnel. Les grands oueds atteignent la mer et de grands lacs réapparaissent. Le climat est Sahélo-Soudanien. La flore se présente sous la forme d’une steppe arborée (hêtres, aulnes, tilleuls et même, en montagne, cèdres). La faune est celle des périodes humides précédentes.
Grâce à ces pluies saisonnières et à l’alimentation régulière des nappes phréatiques, la vie est donc aisée dans ce « Sahara des Tchads » où se perfectionnent peu à peu les techniques paléolithiques avant que n’apparaissent, probablement à la suite d’une rupture climatique, au cinquième millénaire avant J.C. — peut-être même avant — le Néolithique.
Le Néolithique commence par un optimum climatique, mais il s’achève par un désastre écologique, peu avant l’ère chrétienne. Il débute par une nouvelle humification du climat — mais bien médiocre comparée aux phases précédentes. Ce n’est pas un milieu luxuriant: l’hippopotame disparaît au cours de la période, sauf dans le sud mauritanien. Les espèces végétales méditerranéenne (chêne vert, pin d'Alep, olivier, cyprès, vigne etc.) migrent vers les montagnes. La savane arborée domine le paysage à cette période.
9 000 Av J.C. : Archipel des Comores - L'archipel des Comores, d'origine volcanique, est vieux de 9 millions d'années : l'île la plus ancienne (et la plus érodée) est Mayotte, et la plus récente est la Grande Comores, qui possède encore un volcan actif susceptible de l'agrandir. L'archipel ne semble pas avoir connu de présence humaine avant le Moyen Âge, les mammifères en étant probablement absents à l'exception des roussettes.
9 000 Av J.C. 6000 Av notre ère : Égypte - L’histoire de l'Égypte est d'abord marquée par les témoignages inestimables légués par l'Égypte antique, qui ont fasciné dès l'Antiquité. Elle est aussi particulièrement marquante en dehors de l'Égypte, chez les Juifs, en Afrique noire, dans le monde hellénistique, chez les Arabes et dans l'Islam, et en Europe. Après la période ptolémaïque, l'Égypte n'est plus, durant plusieurs siècles, qu'une province des empires plus vastes que sont l'Empire romain, l'Empire byzantin, l'Empire sassanide, l'Empire arabe puis l'Empire ottoman. Elle ne retrouve une certaine autonomie qu'au XIXe siècle et son indépendance en 1922. Après des régimes autoritaires, elle connaît une démocratisation difficile avec la révolution de 2011. Écrire l'histoire ancienne est encore relativement difficile tant la documentation est fragmentaire et lacunaire. En particulier, les dates de changement d'ère données ci-dessous ne peuvent être qu'approximatives, car les avis divergent sur ce sujet.
La préhistoire de l'Égypte est celle des civilisations nigéro-nilo-sahariennes dont témoigne l'art rupestre du Sahara. La période de 9000 à 6000 avant JC a laissé très peu de preuves archéologiques.
Les premières structures de type néolithique, datées du VIe millénaire avant notre ère, apparaissent dans le Fayoum. Au début du Ve millénaire, des habitats structurés naissent près du delta du Nil, comme le site de Mérimdé Beni Salamé, avec de la culture, notamment de blé et d'orge et de l'élevage de bovins, d'ovins et de porcs Des études basées sur des données morphologiques, génétiques et archéologiques ont attribué ces colonies à des migrants du Croissant fertile au Proche-Orient apportant l'agriculture dans la région.
Lorsqu'il y a cinquante siècles, le climat saharien a commencé à transformer en désert ce qui avait été une fertile savane parsemée de lacs, de fleuves et de forêts d'acacia. Des éleveurs de bétail et cultivateurs de mil y vivaient. Ils connaissaient déjà le cheval et le char de combat et se sont concentrés dans la vallée du Nil restée fertile, où l'augmentation de la densité des populations et des échanges a favorisé l'émergence d'une civilisation complexe et hiérarchisée.
Le sud de la vallée du Nil reste marqué plus longtemps par le nomadisme, sans exclure des formes d'élevage. La sédentarisation intervient vers 4400 avant notre ère, avec la culture dite de Badari caractérisé par un artisanat riche et varié, la pratique de l'agriculture et des séries de nécropoles élaborées. Ces groupes devaient être en relation avec le Sinaï et le Soudan. Cette période appelée « prédynastique » s'étend environ de 5000 à 3000 avant notre ère.
9 000 Av J.C. - Oubangui-Chari Centrafrique - Des pierres taillées datant au moins du IXe millénaire avant notre ère ont été retrouvées au cours de fouilles effectuées en République centrafricaine. Toutefois, l’absence de restes humains associés empêche l’attribution de ces outils à une population précise (pygmées ou autre peuple autochtone). Par la suite, la transition du paléolithique vers le néolithique dans la région fut un processus graduel sans rupture culturelle brutale.
9 000 à 5 000 avant notre ère : Maroc - Ces populations se maintiennent jusque vers 9 000 ans av. J.-C. puis elles vont être éliminées ou absorbées par l'arrivée des premiers ancêtres des populations berbères actuelles : les capsiens (nom issu de la ville antique de Capsa, aujourd'hui Gafsa) arrivent de l'est (comme le montrent les études linguistiques, qui classent dans la même famille l'égyptien et le berbère). Les études de l'ADNa ont en outre révélé que les Nord-Africains du début du néolithique (vers - 7000 AP) trouvent leurs ancêtres dans ces groupes paléolithiques d'Afrique du Nord, tandis que les groupes du néolithique tardif (il y a 5 000 ans) contiennent une composante ibérique, suggérant un flux de gènes par Gibraltar. Ces signaux différents entre les individus du Néolithique ancien et ceux du Néolithique tardif indiquent que la propagation des pratiques agricoles en Afrique du Nord a impliqué à la fois une diffusion culturelle et démique depuis l'Europe7. Les similitudes culturelles et génétiques entre les traditions ibériques et néolithiques nord-africaines renforcent encore le modèle de migration ibérique vers le Maghreb.
Des sites néolithiques, montrant l'apparition d'une sédentarisation et la naissance de l'agriculture sont découverts près de Skhirat (Nécropole de Rouazi-Skhirat) et de Tétouan (grottes de Kaf Taht el Ghar et de Ghar Kahal).
9 000 à 200 Av. notre ère : Nigéria - D'autres recherches archéologiques témoignent également d’un peuplement du sud-ouest du Nigeria
9000 av. J.-C., (et peut-être encore plus tôt) à Okigwe, dans le sud-est du pays. Les éleveurs du IVe millénaire av. J.-C. pratiquent la céramique et la microlithique. Au sud, les populations de chasseurs-cueilleurs se sédentarisent et commencent à vivre de l’agriculture autour du Ier millénaire av. J.-C. Le travail du fer est attesté au IIe siècle av. J.-C..
La première civilisation connue au Nigeria est la civilisation nok, apparue environ 1000 av. J.-C. sur le plateau de Jos, au nord-est du pays.
Le commerce fut la source de l’émergence de communautés organisées au nord du pays, recouvert par la savane. Les habitants préhistoriques de la lisière du désert s’étaient trouvés largement dispersés au IVe millénaire av. J.-C., lorsque la dessiccation du Sahara commença. Des routes commerciales transsahariennes reliaient l’ouest du Soudan à la Méditerranée depuis l’époque de Carthage, et au Nil supérieur depuis des temps bien plus reculés. Ces voies de communication et d’échanges culturels subsistèrent jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est par ces mêmes routes que l’islam se répandit en Afrique de l'Ouest à partir du IXe siècle.
8 000 Av J.C. : Algérie - Les derniers chasseurs-cueilleurs sont représentés dans le Nord-Est de l'Algérie par les Capsiens, attestés jusqu'à il y a 8 000 ans. Les modalités de passage à l'économie de production (et donc au Néolithique) sont très mal connues dans le Nord.
Dans le Sud, au Sahara, le Néolithique est une période florissante en raison d'un climat globalement plus humide que l'actuel et donc d'une flore et d'une faune beaucoup plus riches. Les êtres humains de cette période ont gravé et peint les parois de leurs abris. La chronologie exacte de cet art est très discutée et notamment la date de son apparition (il n'existe pas de moyen de le dater directement). Certains chercheurs pensent qu'il est apparu dès la fin du Pléniglaciaire, au Paléolithique, tandis que d'autres ne le pensent pas antérieur au Néolithique.
Les Aurès comprennent plusieurs sites datant de l'ère préhistorique à la période protohistorique. Plusieurs recherches anthropologiques ont été entreprises dans les régions des Aurès, puisque de nombreuses grottes troglodytes étaient habitées par des Hommes à Maafa, Takarbourst dans les Aurès et Ghoufi.
8 000 à 3 000 Av J.C. : Cameroun - Les premiers habitants du Cameroun furent probablement des populations proches des Baka et des Akas, traditionnellement appelés pygmées. Ils habitent toujours les forêts des régions du sud et de l'est. L'analyse des ossements de quatre enfants enterrés il y a 3000 et 8000 ans sur le célèbre site archéologique de Shum Laka a confirmé que ceux-ci ont pour plus proches parents ces groupes de chasseurs-cueilleurs qui vivent aujourd'hui à au moins 500 kilomètres dans les forêts tropicales de l'ouest de l'Afrique centrale
8 000 à 3 000 Av J.C. : Madagascar - Les découvertes archéologiques permettent d'envisager une première présence de l'espèce humaine à Madagascar il y a environ 8 000 ans. Compte tenu de l'histoire du peuplement africain, il est possible que ces premières populations aient été apparentées aux actuels khoïsan mais du point de vue génétique et linguistique, rien ne prouve qu'elles se soient maintenues et qu'elle aient contribué au peuplement ultérieur de l'île.
En revanche, les études génétiques, linguistiques et historiques indiquent de manière concordante qu'une partie du peuplement malgache est d'origine austronésienne, (îles de la Sonde) et une autre partie d'origine africaine.
Linguistiquement, le lexique du malgache est composé de 90 % de vocabulaire austronésien. La langue malgache est issue du proto-austronésien, appartenant à la branche proto-malayo-polynésienne (proto-MP) et à la sous-branche proto-Sud-Est barito (proto-SEB) qui partage ces mêmes bases anciennes communes avec les langues dayak actuelles du groupe barito de Bornéo Sud telles que le ma'anyan, dusun deyah, dusun malang, dusun witu et paku actuels.
Une partie du fonds culturel malgache est de type austronésien : coutumes anciennes (comme celle d'ensevelir les défunts dans une pirogue que l'on coule dans la mer ou dans un lac), agriculture sur brûlis (culture du taro-saonjo, de la banane, de la noix de coco et de la canne à sucre), architecture traditionnelle en matériaux végétaux, maisons à base carrée ou rectangulaire sur pilotis), musique (instruments comme la conque marine antsiva, le tambour de cérémonie hazolahy, le xylophone atranatrana, la flûte sodina ou encore la valiha) et danse (notamment la « danse des oiseaux » que l'on retrouve à la fois au centre et dans le Sud)
Selon les études génétiques récentes, « les populations Malgaches montrent un mélange génétique d'environ 68% d'ascendance Africaine et 32% d'ascendance Asiatique ». Toutefois les origines exactes des apports sont encore floues. Un « motif polynésien » commun et unique au monde a été décelé au sein de différentes ethnies malgaches distantes géographiquement et endogames historiquement tels que les Vezo et les Andriana Merina (cette altération du « motif polynésien » d'origine, commune et propre aux Malgaches, a été baptisée « motif malgache » par les chercheurs en génétique).
Sur le plan morphologique les apports du Sud-Est asiatique pourraient être à l'origine des caractéristiques xanthodermes communes à la majorité de la population de l'île, décrite en 1940 par le professeur Nirinjanahary14, et du pli épicanthique de la paupière supérieure qui « bride » les yeux de nombreux Malgaches des côtes ou des hauts plateaux, et dont la peau peut être claire, sombre ou cuivrée.
Les Vazimba :
Au tout début du peuplement austronésien, appelé « période paléomalgache », les arrivants Vahoaka Ntaolo (du proto-Malayo-Polynésien (PMP) *va-waka = « embarcation », proche du mot malgache vahoaka = « peuple », et Ntaolo du proto-austronésien *tau - ulu - « les hommes premiers », « les anciens », de *tau-hommes et ulu- tête, premier, origine, (début se subdivisèrent, selon leurs stratégies de subsistance, en deux grands groupes : le nom Vazimbas (Vaγimba, de *ba/va-yimba- « ceux de la forêt », de *yimba-"forêt" en proto-barito du Sud-Est, aujourd'hui barimba ou orang rimba en malais) désigna alors ceux qui s'installèrent dans les forêts de l'intérieur et le nom Vezo (de *ba/va/be/ve-jau, « ceux de la côte » en proto-malayo-javanais, aujourd'hui veju en bugis et bejau en malais, bajo en javanais) ceux qui choisirent le littoral.
Le qualificatif Vazimba désignait donc à cette période les Ntaolo chasseurs-cueilleurs austronésiens, qui décidèrent de s'établir dans la forêt, notamment dans les forêts des hauts plateaux centraux de la grande île et celles de la côte Est et Sud-Estnote , tandis que les Vezo étaient les Ntaolo pêcheurs qui restèrent sur les côtes de l'Ouest et du Sud (probablement les côtes du premier débarquement).
Les anciennes traditions orales malgaches relatent que les Vazimbas chasseurs-cueilleurs seraient les premiers habitants de l'île. Le mot austronésien vazimba désignant les « habitants de la forêt » d'une manière générale (y compris les Austronésiens eux-mêmes) il n'est pas à exclure que d'autres humains vazimba aborigènes aient habité dans les forêts de Madagascar avant l'arrivée des vazimba austronésiens, ce qui pourrait expliquer le mythe des « vazimba nains » que les vahoaka ntaolo austronésiens auraient rencontrés et assimilés (ou peut-être décimés) à leur arrivée au Ier millénaire avant notre ère. Les hypothèses ont foisonné à ce sujet : descendants de premiers habitants préhistoriques de type khoïsan ou mélanodermes insulaires de petite taille, aucune n'a pu être confirmée par la phénologie, la génétique ou l'ethnologie comparées1,2 et par ailleurs, le mythe des « vazimba nains » a aussi pu être amené par les Austronésiens à partir des îles de la Sonde d'où ils sont venus, et où des populations de type « négrito » (orang asli en malais) ont effectivement existé20. Du point de vue des phénotypes, si les populations des hautes terres (Merina, Betsileo, Bezanozano, Sihanaka), plus endogames, présentent des phénotypes majoritairement austronésiens (mongoloides sondadontes), on remarque aussi parfois les phénotypes australoïde et negrito partout à Madagascar (différents du phénotype est-africain bantou et caractérisés par de petites tailles) mais rien ne prouve qu'ils soient aborigènes car ils existent aussi en Insulinde.
8 000 avant notre ère : Malawi - Des restes humains retrouvés sur un site daté de 8000 av. J.-C. présentent des caractéristiques physiques similaires aux personnes peuplant actuellement la corne de l'Afrique.
8 000 à 3 000 Av J.C. : Soudan - Les fouilles archéologiques menées sur le Nil en amont d'Assouan ont confirmé l'occupation humaine de la vallée dès le paléolithique, il y a plus de 60 000 ans, principalement vers Khashm El Girba et Khor Musa, avant 8000 avant notre ère, mais aussi Affad 23 (en) et Djebel Sahaba.
Au VIIIe millénaire av. J.-C., des peuples mésolithiques (8000-5000), puis néolithiques (4900-3300) s'y sont sédentarisés dans des villages fortifiés en briques, pratiquant l'agriculture et l'élevage : Ad-Damir, Abu Darbein, Wadi Howar, Shaqadud, puis Kadero, esh-Shaheinab, Kadruka, Kerma.
Les sociétés prédynastiques de Nubie et de Haute-Égypte étaient ethniquement et culturellement très proches, et ont évolué parallèlement vers des royaumes pharaoniques vers -3300, au néolithique. La Basse-Nubie semble ensuite s'être vidée de sa population dans le cadre d'un processus forcé d'égyptianisation et d'unification de la vallée du Nil par les royaumes établis au nord.
Le site rupestre de Geddi-Sabu reste une exception.
7 500 avant J.C. : Algérie - Le Paléolithique supérieur révèle des restes de la culture de l'Atérien et de celle de l'Ibéromaurusien. L'Atérien a été défini à partir de vestiges mis au jour dans le site éponyme de Bir el-Ater, dans la wilaya de Tébessa. Il s'étend jusqu'à la révolution néolithique vers 7 500 av. J.-C. L'Homme de Néandertal a longtemps été considéré comme l'auteur de l'Atérien mais cette espèce est désormais perçue comme exclusivement eurasiatique. Il est probable que des Homo sapiens archaïques aient produit les outils atériens.
L'Atérien disparaît vers 7 500 av. J.-C., lors de la révolution néolithique. Avec cette révolution apparaissent des sociétés sédentaires qui produisent leur nourriture grâce à l'agriculture et à la domestication. En Algérie, cette révolution débouche sur la civilisation capésienne. Cette culture aussi appelée « protoméditerranéenne » a laissé des traces impressionnantes de dessins sur œufs d'autruches et céramiques, mais aussi de gravures rupestres et de monuments funéraires dont la tradition s’étendra jusqu'à la Protohistoire et l'Antiquité. On suppose que les Capésiens sont venus d’Orient, avec d’autres vagues humaines qui les suivront et seraient à l'origine d'un substrat proto-berbère, refoulant plus vers l’ouest et le sud ou assimilant les communautés humaines préexistantes.
Les Capésien furent les premiers au Maghreb à domestiquer les ovicapridés et les bovidés. Ils se caractérisent par la présence sur leurs lieux d’habitat d'escargotières (ramadiyate), un mélange de cendres et de résidus alimentaires dont des coquilles d'escargots.
Durant le néolithique, l'art se diversifie et s'affine dans les gravures rupestres de l'Atlas saharien, mais parfois aussi plus au nord. Dans l'extrême Sud-Est saharien, au Tassili n'Ajjer, au climat humide, contrairement au climat désertique de nos jours, on atteste sur les céramiques modelées, des hommes de type négroïde. Des gravures rupestres, représentent, souvent en grandes dimensions, des bubales ou autres animaux de la faune africaine, et également des ânes sauvages, des chèvres, des gazelles et des poissons.
Au néolithique moyen, les représentations de troupeaux se font plus fréquentes et la croyance en une voie initiatique scandée par deux temps, le solaire et le lunaire apparaît. Au Tassili, l'art se fait narratif. Dans les mises en scène d'êtres humains, apparaissent des populations blanches, venues vraisemblablement d'Orient.
Le néolithique final marque la fin de la préhistoire. Les représentations animalières continuent à mettre en scène la faune africaine, mais l'éléphant et l'hippopotame ont disparu, signe d'un climat devenu plus sec. Des animaux domestiques apparaissent, comme notamment le chien et le cheval. Au même moment, et dans la même aire saharienne, commencent à apparaître les caractères dits libyques.
La langue Capésienne est reconnue par la linguistique historique comme étant l'ancêtre des langues berbères en Afrique du Nord ; par ailleurs, la décoration des poteries capésiennes présente de grandes similarités avec celle des poteries berbères plus récentes. On sait peu de choses de la religion des Capésien. Toutefois, les pratiques funéraires (monticules de pierres et peintures figuratives) suggèrent que ces derniers croyaient en une vie après la mort.
7 000 à 6 000 av. notre ère : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Comme tous les archipels de Macaronésie, l'archipel de Madère est composé d'îles d'origine volcanique situées sur la plaque africaine, la dernière éruption remonte à 6 000 ou 7 000 ans. L’île principale, d'une superficie de 750 km2, a la particularité d’être très verdoyante par rapport à d'autres îles volcaniques, lui conférant des paysages remarquables qui en font une destination de renommée pour la randonnée pédestre.
5 800 à 2 500 av. J.C. : Afrique République de Djibouti - La zone de Djibouti est habitée depuis au moins le Néolithique. Selon certains linguistes, les premières populations afro-asiatiques sont arrivées dans la région durant cette période à partir de l'urheimat proposé par la famille (« patrie originelle ») dans la vallée du Nil ou le Proche-Orient, tandis que d'autres chercheurs proposent que la famille afro-asiatique se développe in situ dans la Corne, et que ses locuteurs se dispersent par la suite.
Avec la Somalie, et le sud de l'Érythrée, l'actuel territoire djiboutien fait peut-être partie de l'ancien territoire appelé Pays de Pount (ou Ta Netjeru, signifiant « la Terre de Dieu ») par les anciens Égyptiens, dont la première mention remonte au XXVe siècle av. J.-C.
La région aurait été un des habitats du peuple Harla, aujourd'hui éteint.
5 800 à 2 500 av. J.C. : Guinée-Bissau - Le territoire où se situe l'actuelle Guinée-Bissau (Guinée-Bissao, Guinée) est occupé dès le néolithique. Jusqu'à la fin du premier millénaire divers groupes arrivent, s'intègrent et créent peu à peu des petites nations féodales, aux organisations politiques variées, qui échangent constamment et se mêlent (par conflit, par mariage surtout, par commerce, par aventure, etc.).
5 000 Av. J.C. : Éthiopie - Le métissage entre les populations locales et les groupes migrants Sabéens donna naissance à une nouvelle culture dite « pré-aksoumite ». Cette culture se constitua, au Ve siècle av. J.-C., en un état appelé royaume D'mt. Cette période est caractérisée par l'effacement progressif des liens avec l'Arabie du Sud, bien que D'mt conserve les éléments culturels apportés par les Sabéens. L'alphabet sudarabique apporté par ces derniers donna ainsi naissance à l'alphasyllabaire guèze durant cette période.
Après la chute du royaume de D'mt au Ve siècle av. J.-C., divers royaumes ont dominé la région jusqu'à l'émergence, au Ier siècle av. J.-C., du royaume d'Aksoum, premier empire important de l'histoire éthiopienne.
5 000 à 1 000 Av. J.C.: Gabon - Les Pygmées actuels, qui seraient issus de ce peuplement, sont les premiers habitants connus de ce qui est actuellement le Gabon. Chasseurs-cueilleurs, ils s'installent environ 5 000 ans avant notre ère. Une vague de peuplement bantoue leur succède. Les Bantous étant eux-mêmes partis il y a 5 000 ans de la zone sahélienne en voie d'assèchement, leur expansion vers le sud et l'est date d'environ 1 000 ou 2 000 ans avant notre ère. À la différence des Pygmées, les peuples bantous sont semi-sédentaires et pratiquent l'élevage ; ils maîtrisent aussi la métallurgie dès le Ier millénaire av. J.-C. Arrivés au Gabon, ils trouvent donc un peuplement pygmée sur place.
5 000 Av notre ère : Égypte - À une époque nettement antérieure à 5000 avant J.-C., de nombreuses communautés de chasseurs-cueilleurs vivent sur les plateaux surplombant le Nil et dans les savanes qui s'étendent à l'est et à l'ouest. Quand la baisse des précipitations et celle, relative, des crues, en particulier après 4000, entraînent une désertification des terres occidentales, ces populations colonisent densément la vallée du Nil et ses abords immédiats. Néanmoins, la faune de ces plateaux, parmi laquelle des éléphants et des girafes, persiste jusqu'aux environs de 2300, avant de se replier définitivement vers le sud.
La vallée du Nil, qui présente des bassins d'irrigation naturels retenant les eaux de crue, est un emplacement idéal pour passer de l'économie mésolithique dotée d'un embryon d'agriculture à une économie fondée sur une agriculture sédentaire accompagnée d'élevage.
En Basse-Égypte, au sud du Delta, à Merimdeh et dans le Fayoum (5000-4000), les fouilles archéologiques montrent l'importance d'une société paysanne, dont les villages étaient construits en clayonnages de roseaux, et produisant une poterie monochrome parfois rehaussée de décors incisés ou appliqués.
Haute-Egypte
À la même période, en Haute-Égypte, le pouvoir paraît déjà beaucoup plus fort, centralisateur ; des phénomènes urbains apparaissent à Hiéraconpolis. Les trois époques successives de la culture de Nagada produisent une poterie très différente de celle du Nord – plus proche de celle de Khartoum, plus ancienne – et de superbes objets de pierre polie.
C'est à cette époque que des schémas historiques généraux se dessinent, avec l’émergence d'élites politiques asseyant leur pouvoir sur la prospérité de l'agriculture et sur le contrôle des matières précieuses, qui commencent à être exploitées par des techniques nouvelles.
Si les outils et les armes sont initialement en pierre ou en matériaux organiques, le cuivre et les métaux précieux acquièrent une importance croissante en Haute-Égypte et, plus tard, en Basse-Égypte. La culture de Nagada (milieu du IVe millénaire) voit la construction de bateaux de rivière plus grands et plus performants, et l'essor du commerce sur le Nil. Ces facteurs, parmi d'autres, favorisent l'apparition d'une élite dont les sépultures sont plus grandes et plus somptueuses que précédemment (on peut même reconnaître celles des chefs politiques provinciaux sur différents sites). Selon des traditions ultérieures, deux royaumes seraient apparus à la fin de l'époque prédynastique, la prééminence matérielle et politique de la Haute-Égypte étant plus nette.
Agriculture
La domestication du bétail en Afrique précède l’agriculture ; ainsi le bœuf est-il domestiqué depuis 7 500 à 6 000 ans av. J.-C. en Afrique du nord. Dans l'aire nilo-saharienne, de nombreux animaux sont domestiqués, dont l'âne. Elle se développe parallèlement aux cultures de chasseurs-cueilleurs. Les Khoïsan, qui furent la population la plus nombreuse dans l'histoire de l'humain moderne se divisent entre les chasseurs-cueilleurs San, appelés aussi « Bochimans » et les pasteurs Khoïkhoïs.
L'agriculture apparaît en plusieurs lieux selon un processus complexe vers 6000 av. J.-C. Il s'agit d'abord d'une adoption par l'Égypte de plantes venant du sud-ouest asiatique. L’Éthiopie (et la Corne de l'Afrique en général) se distingue nettement de ses voisines et entretient des contacts intermittents avec l’Eurasie après l’expansion de l’espèce humaine hors d’Afrique. La culture, la langue ainsi que les espèces cultivées en Éthiopie (café, sorgho, teff) sont particuliers à cette région. Vers 3000 av. J.-C., une migration majeure de populations d'agriculteurs venus du Proche-Orient a lieu en direction de l'Afrique. Cette implantation de nouvelles populations est notamment présente dans la corne de l'Afrique. Vers 2 000 ans av. J.-C., une agriculture autochtone se développe avec la domestication du mil, du riz africain, de l'igname et du sorgho.
4 000 avant J.C. : Éthiopie - L'Antiquité éthiopienne - sources grecques : Si les sources écrites de la période préaxoumite sont quasi inexistantes, les Grecs anciens font de nombreuses références aux Éthiopiens vivant au Sud de l’Égypte antique. Dans sa traduction littérale, le terme issu du grec ancien Αἰθιοπία / Aithiopía signifie « le pays des visages brûlés », de αἴθω / aíthô « brûler » et ὤψ / ốps, « visage », et désigne donc un ensemble plus vaste, il est par exemple également utilisé pour désigner la région de la haute vallée du Nil du sud de l'Égypte, également appelé Koush, qui au IVe siècle av. J.-C. est envahie par les Axoumites.
Le terme est issu de la légende de Phaéton tirée de la mythologie grecque, né de l'union d'Apollon et de Clymène, épouse de Mérops, roi des Éthiopiens. Dans sa folle course à travers le ciel sur le char de son père, celui-ci s'approcha trop près du sol terrestre. Les populations qui vivaient dans ces régions, près du royaume d'Océan Ὠκεανός / Ôkeanós, furent brûlées et marquées ainsi que leur descendance, ce qui expliquait leur teint foncé et leur dénomination.
On retrouve les Éthiopiens dans les mythes, le roman grec ainsi que chez leurs premiers historiens, comme Diodore de Sicile.
Ceux-ci sont notamment mentionnés dans l'Iliade (I, 423) d’Homère, dans l'Éthiopide, l'une des épopées du Cycle troyen, narrant les aventures du prince éthiopien Memnon, dans la Bibliothèque d’Apollodore, et dans les Métamorphoses d’Ovide, à travers Céphée et Cassiopée, roi et reine d’Éthiopie.
De nombreuses inscriptions grecques ont par ailleurs été retrouvées en Éthiopie essentiellement autour des villes d'Aksoum et Adoulis, principal port du royaume. Les premières pièces frappées à Axoum porteront par ailleurs des inscriptions grecques témoignant d’échanges commerciaux.
Le Périple de la mer Érythrée qui évoque pour la première fois le royaume d’Axoum mentionne par exemple que le roi Zoskales était versé dans la littérature grecque. Sur l'inscription d'Ezana, en guèze, sabéen et grec, le roi Ezana se décrit lui-même comme « fils de l'invincible dieu Arès ». Sur une stèle de basalte qui se dressait à l'arrière d'un trône de marbre placé à l'entrée de la ville d'Adoulis, on lisait notamment : « Je suis descendu à Adoulis pour offrir des sacrifices à Zeus, à Arès, et à Poséidon en faveur des marins. Puis, après avoir rassemblé mes armées pour n'en faire qu'une seule, j'ai campé en ce lieu et j'ai offert ce trône en ex-voto Arès, en l'an vingt-sept de mon règne. »
La correspondance entre le royaume d'Aksoum et le nom de l'Éthiopie moderne remonte à la première moitié du IVe siècle, où l'inscription de la stèle d'Ezana en Guèze, alphabet sud-arabique et grec, traduisait « Habashat » (la source du nom Abyssiniae) par Aethiopia en grec.
En 2001, une équipe de chercheurs des universités de Madrid et de Skopje, se basant sur des analyses génétiques du système d'antigènes HLA ont mis en évidence que « les populations grecques ont une forte proximité avec les populations sub-sahariennes éthiopiennes, qui les différencient des autres groupes méditerranéens ». Ils concluent que les liens unissant la Grèce antique et l'Éthiopie sont relativement anciens même si leur origine est mal déterminée.
4 000 avant J.C. : Ghana - Des fouilles archéologiques attestent que la côte de l'actuel Ghana est habitée dès le début de l'âge du bronze, vers -4000 par des peuples pratiquant la pêche dans les lagons et rivières. Le centre du pays, au nord de la zone forestière, a pu être colonisé entre le IIe et le Ier millénaire av. J.-C. par des hommes venus du bassin du Niger. Comme dans la plus grande partie de l'Afrique subsaharienne, l'agriculture s'y répand jusqu'à la fin du IVe siècle à partir de la frange sud du Sahara.
La période thinite (vers 3200-vers 2778 avant J.-C.) L'Égypte ancienne
Vers 3200 avant J.-C., Narmer, originaire de Hiéraconpolis, unifie les deux royaumes existant alors : celui de Haute-Égypte (capitale Hiéraconpolis ; divinité tutélaire : la déesse-vautour Nekhbet ; insigne : la couronne blanche) et celui de Basse-Égypte (capitale Bouto ; divinité tutélaire : la déesse-serpent Ouadjet ; insigne : la couronne rouge). Ceignant les deux couronnes (nommées en égyptien « les deux puissantes », en transcription grecque : le pschent), il est le premier des rois qui, durant 30 dynasties (selon le schéma traditionnel de source égyptienne, transmis par Manéthon) au cours de trois millénaires, vont administrer l'Égypte jusqu'en 333 avant J.-C., date de l'arrivée d'Alexandre de Macédoine. Narmer établit sa capitale à This (près d'Abydos), où règnent les rois des deux premières dynasties ; celles-ci sont connues grâce aux découvertes faites dans les nécropoles d'Abydos, de Saqqarah et d'Hélouân (en Basse-Égypte). Il est possible que Narmer ait jeté les fondations de la ville nouvelle de Memphis, à la pointe du Delta du Nil.
L'œuvre de ces premiers souverains, qui maintiennent fermement l'unité du royaume, semble importante : création d'une économie nouvelle (mise en valeur des terres par l'organisation d'une politique nationale d'irrigation, développement de l'agriculture et de l'élevage) ; établissement des principes de la nouvelle monarchie, unificatrice et d'essence divine ; mise en place des éléments de gestion politique (les rouages de l'administration centrale et ceux de l'administration provinciale étant « dans la main du roi », monarque tout-puissant).
Les pharaons des 1ère et 2ème dynasties sont les successeurs de Narmer. D'après certains spécialistes, des rois de la 1ère dynastie auraient été enterrés à Abydos, dans des fosses funéraires coiffées de structures analogues à des tumulus et assorties d'édifices cultuels ; cette architecture a sans doute annoncé les complexes pyramidaux postérieurs. Cette thèse confère au pharaon un statut à part dès l'origine. Or les sépultures royales de la 1ère dynastie, dans les environs de Saqqarah, sont de taille et d'architecture analogues à celles des autres élites. Ainsi a été établie la certitude que le statut royal est seulement en germe. On dispose de bien moins d'éléments sur les sépultures royales de la IIe dynastie ; il y en a deux à Abydos, auxquelles sont adjoints des complexes cultuels ; les autres se trouvent à Saqqarah.
3 600 à 2 600 Av J.C. : Haute -Volta future Burkina Faso - La sédentarisation est apparue entre 3 600 et 2 600 avant l'ère chrétienne avec des agriculteurs, dont les traces des constructions ont laissé envisager une installation relativement pérenne. L'emploi du fer, de la céramique et de la pierre polie s'est développé entre 1 500 et 1 000 avant l'ère chrétienne, ainsi que l'apparition de préoccupations spirituelles, comme en témoignent les restes d'inhumation découverts. Des vestiges attribués aux Dogons ont été découverts dans la région du Centre-Nord, du Nord et du Nord-Ouest. Or ceux-ci ont quitté le secteur entre le XVe et le XVIe siècle pour s'installer dans la falaise de Bandiagara. Par ailleurs, des restes de murailles sont localisés dans le Sud-Ouest du Burkina Faso (ainsi qu'en Côte d'Ivoire), mais leurs constructeurs n'ont à ce jour pas pu être identifiés avec certitude. Les ruines de Loropéni, situées près des frontières de la Côte d'Ivoire et du Ghana, sont aujourd'hui reconnues site du Patrimoine mondial.
3500 - 460 Avant notre ère : Canaries (Îles des) - Les légendes de l'Océan atlantique
La mythologie grecque parle des Champs Élysées, mais aussi du fabuleux jardin aux pommes d'or du jardin des Hespérides, nymphes du Couchant, à la limite occidentale du monde, de l'autre côté du détroit de Gibraltar (Colonnes d'Atlas, Colonnes d'Héraclès, Colonnes d'Hercule, Djebel Tarik). À partir d'Hésiode, les textes parlent d'Îles des Bienheureux (Macaronésie) ou Îles Fortunées, où les âmes vertueuses goûtent un repos parfait après leur mort. On a tenté d'identifier au cours des âges ce lieu mythologique situé aux extrêmes limites du monde avec des îles de la côte atlantique de l'Afrique. Il est également question d'Îles Satyrides. L'océan atlantique est surtout perçu comme Mer des Ténèbres, au moins très longtemps à partir du Cap Boujdour.
3500-2000 Av. J.C. : Zaïre Congo Kinshasa - Le territoire de la république démocratique du Congo était anciennement peuplé uniquement par des chasseurs-collecteurs, peut-être en partie les ancêtres des peuples pygmées actuels. Entre les traces d'un préacheuléen et l'arrivée des premiers villageois, le Congo sera toujours occupé par des groupes nomades, chasseurs-collecteurs, tailleurs de pierre, de cultures différentes.
L'Acheuléen est attesté par de nombreuses découvertes isolées de bifaces et de hachereaux ainsi que par le site de La Kamoa au Katanga.
Durant le IIe millénaire av. J.-C., le nord de l'Afrique équatoriale vit une vague de migrations de populations productrices de nourriture, néolithiques, parlant pour certaines des langues bantoues. Entre –3500 et –2000, une première occupation villageoise dont l'épicentre se trouvait au sud-Cameroun, aboutit à l'installation d'un mode de production néolithique dans le nord et l'ouest de l'Afrique centrale. Au Congo, les premières traces de ces populations se matérialisent vers –2600 par la dite « tradition Imbonga » près de Mbandaka et du lac Tumba, et par la « tradition Ngovo » au bas-Congo à partir de –2300. De l'autre côté du pays, au Kivu, on voit apparaître des villages de la « tradition Urewe ». Ces villages ne sont que l'extension occidentale de communautés productrices de nourriture, métallurgistes, installées surtout en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, dans l'ouest du Kenya et de la Tanzanie ; les plus anciennes traces y sont datées de –2600.
3 300 à 3 200 av. notre ère : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Antiquité : Selon Gilbert Pillot, qui a mené une enquête sur le voyage d'Ulysse dans l'Odyssée, Madère serait l'île d'Éole où le dieu confia le Zéphir à Ulysse en prenant soin d'enfermer les vents contraires dans un sac en cuir.
Les Phéniciens auraient pu visiter l’archipel dès l'antiquité : le récit du Périple de Hannon, mentionne un certain nombre d'escales, au-delà de l’île de Cerné en actuelle Mauritanie, dont l'une pourrait être l'archipel.
3 000 à 2 065 Av notre ère : Égypte - Vers 3800 avant notre ère se développent deux cultures égyptiennes : l'une au nord, plus marquée par l'agriculture, représentée notamment par Maadi, l'autre au sud, dite de Nagada, avec un artisanat plus développé mais aussi une place plus grande de la chasse. À la fin du IVe millénaire, vers 3300 avant notre ère, les deux cultures se rapprochent : la fusion de la Haute et de la Basse-Égypte intervient au début de cette période dite thinite (2950 à 2650 avant notre ère), du nom du site de Thinis.
Les hiéroglyphes égyptiens sont inventés vers 3150 avant notre ère et constituent, avec la découverte du papyrus, les éléments de diffusion de la culture égyptienne. L'Égypte est unifiée sous la direction d'un monarque appelé plus tard pharaon, considéré comme d'essence divine au sein d'une mythologie qui naît à la même époque. Ce royaume de Haute et Basse-Égypte de l'Ancien Empire (2650 à 2152 avant notre ère) est administré en différentes provinces appelées nomes. Le pouvoir royal contrôle de près l'économie, notamment la terre et le commerce, et constitue autour de lui une aristocratie. L'époque est marquée par le développement de l'art égyptien, et notamment d'un art funéraire monumental représenté par les mastabas et les premières pyramides.
Cette période brillante est suivie de la Première Période intermédiaire (2152 à 2065 avant notre ère) qui voit l'unité de l'Égypte mise à mal par des crises dynastiques et le pouvoir des nomarques.
L'Ancien Empire Égyptien (2778-2420 avant J.-C., IIIe à VIe dynastie)
Il est convenu d’organiser la succession des pharaons en dynasties. L'Ancien Empire, qui couvre un peu plus d'un demi-millénaire, en compte quatre : de la IIIe dynastie, à partir de laquelle le pouvoir royal va fortement s'accroître, à la VIe dynastie, où il s'affaiblit.
3 000 Av notre ère : L'Afrique subsaharienne voit naître ses propres civilisations dans les zones de savanes. À compter de 3000 av. J.-C. l'expansion bantoue repousse les peuples Khoïsan.
Du côté de l'Afrique de l'Ouest, le Royaume Mossi se démarque par sa remarquable ténacité à résister à tous les envahisseurs. Venu du Ghana, ce royaume fixe le terreau de sa forteresse en plein milieu de l'Afrique l'Ouest.
3 000 Av J.C. - Oubangui-Chari Centrafrique - À partir du IIIe millénaire avant notre ère, l’établissement et l’expansion vigoureuse sur le sol centrafricain des populations parlant les langues du groupe Adamaoua-Oubangui s’opposent à l’expansion Bantou qui trouve alors un exutoire vers le Sud et l’Est du continent. Le noyau géographique originel des populations de langues Adamaoua-Oubangui serait tout proche car situé dans le massif de l’Adamaoua aux confins des actuels Cameroun, Nigeria, Tchad et République centrafricaine. De l’autre côté des contreforts occidentaux de l'Adamaoua (qui culmine à 3 400 m au Tchabal Mbabo dans les monts Gotel) était situé, sur la rivière Cross, le noyau originel des populations bantoues. Les deux groupes de populations vont connaître, au IIIe millénaire, une expansion simultanée à la suite de la domestication de l’igname et du palmier à huile.
L’implantation solide des populations de langues adamaoua-oubangiennes sur le territoire tiendrait à leur maîtrise des cultures agricoles aussi bien en zone de forêt sèche (apprises auprès des agriculteurs parlant les langues du groupe Soudan-Central) qu’en zone de forêt humide, une double compétence que n’avaient pas les Bantous à cette époque. La présence d’une agriculture en République centrafricaine est avérée à partir du milieu du IIe millénaire avant notre ère. Les populations de langues adamaoua-oubanguiennes achèvent leur implantation sur l’ensemble de l’actuelle République centrafricaine vers le début du Ier millénaire avant notre ère tandis que l’extension géographique maximale de ces populations est atteinte vers le début de l’ère chrétienne. Les habitants qui les avaient précédé (pygmées et soudanais centraux) sur le territoire de la Centrafrique actuelle sont alors soit assimilés soit marginalisés.
3 000 avant J.C. : Guinée - Il y a 3 000 ans la Guinée était habitée par une communauté de pêcheurs et d'agriculteurs. Les vallées verdoyantes du Fouta Djallon, les bassins fertiles du Haut Niger propices à la cueillette, à la chasse et à la pêche ont attiré les hommes.
L’arrivée des populations est due au dessèchement du Sahara, suivi de l’assèchement des fleuves, rivières et lacs. Les populations se déplacent vers les zones méridionales plus humides. Les territoires situés entre les fleuves Sénégal et Niger comme la Guinée deviennent des zones privilégiées de regroupement des communautés d’éleveurs et d’agriculteurs. Tandis que certains groupes se dirigèrent vers les vallées du Bafing et de la Falémé, d’autres se fixèrent dans le delta intérieur du Niger.
3 000 av. J.C. : Guinée-Bissau - Les peuples côtiers inventent il y a au moins 3000 ans la riziculture humide le long des fleuves, puis la riziculture sur mangrove. Les nations à l'intérieur des terres tissent un réseau commercial vers le Nord, le Sud et l'Est. Le royaume baïnouks, dont la partie Sud englobe une grande partie de ce territoire, en est le plus étendu et le plus ancien pays centralisé.
3 000 Av J.C. : Guinée-équatoriale - des vestiges, encore mal datés, illustrent autour de Bata et du Rio Muni la permanence de la présence de l'homme, nomade, tailleur de pierre et chasseur-cueilleur, jusqu'en 3 000 av. J.-C.
3 000 Av J.C. : Kenya - Les premiers habitants de ce qui est de nos jours le Kenya sont des chasseurs-cueilleurs, apparentés aux actuels locuteurs des langues khoïsan. Pour leur plus grande partie, ces communautés sont assimilées par les sociétés « productrices de nourriture » qui commencent à s'installer au Kenya à partir du IIIe millénaire av. J.-C.
Les données linguistiques indiquent un mouvement de populations, composées de locuteurs de langues couchitiques méridionales, qui entrent au Kenya vers le IIIe millénaire av. J.-C.
2 500 Av J.C. : Afrique du Sud - Il y a environ 2 500 ans, certains Bochimans acquièrent du bétail venu de régions plus au nord, ce qui change graduellement leur système économique ; de chasseurs-cueilleurs, ils se transforment progressivement en éleveurs. Cela introduit les notions de richesse personnelle et de propriété dans la société, solidifiant les structures et développant la politique;
À la même époque, les Khoïkhoïs se déplacent vers le sud, rejoignant la région du cap de Bonne-Espérance. Ils continuent à occuper davantage les côtes, tandis que les Bochimans, qu'ils nomment Sankhoï, restent à l'intérieur des terres. Leurs liens sont toutefois étroits et le mélange des deux cultures donne celle des Khoïsan.
2 500 à 600 avant J.C. : Éthiopie - L'Antiquité éthiopienne - Les sources égyptiennes : le Pays de Pount
Les informations détaillées sur les relations entretenues entre l’Égypte et l’Éthiopie sont clairsemées, et il existe de nombreuses théories au sujet de la localisation et la nature des relations qu'entretenaient ces deux peuples. Les Égyptiens appelaient le Pays de Pount Ta Néterou, signifiant la « Terre du Dieu », qu'ils considèrent comme la Terre de leurs origines. Les Égyptiens anciens étaient connaisseurs de myrrhe (originaire du Pays de Pount) dès les Ire et IIe dynasties, ce qu'indique selon Richard Pankhurst l'existence d'un commerce entre les deux pays dès les premières heures de l'Égypte antique.
Les sources égyptiennes mentionnent à partir de la Ve dynastie plusieurs expéditions menées au Pays de Pount. On dénombre au moins huit d’entre elles, espacées en moyenne d'une cinquantaine d'années, de la Ve dynastie à la XIIe dynastie, de Sahourê (-2500) à Sésostris II (-1875).
Il faut attendre la XVIIIe dynastie et l'an IX du règne de la Reine Hatchepsout, vers -1470, pour que l'Égypte renoue avec sa tradition pountite. Le récit de cette expédition est rapporté avec beaucoup de détails sur les murs du deuxième portique du temple funéraire de la Reine Hatchepsout, au sanctuaire de Deir el-Bahari de Thèbes. Les inscriptions dépeignent un groupe de commerçants rapportant des « encens, myrrhe et cannelle, or, ivoire et ébène, plumes d'autruche, peaux de panthère et bois précieux et quelques babouins, cynocéphales sacrés du dieu Thot ».
L'Encyclopædia Britannica de 1911 indique qu'à partir du règne de Piânkhy, pharaon de la XXVe dynastie, de temps à autre les deux pays étaient placés sous la même autorité ; la capitale de ces deux empires était alors située dans le nord du Soudan moderne, à Napata.
La conquête de l'Éthiopie par les pharaons de la XVIIIe dynastie est par ailleurs consignée sur les pylônes du temple de Karnak. Parmi les 47 villes éthiopiennes consignées, on retrouve notamment Adoua et Adulis, le futur port du royaume d'Aksoum, mais aucune mention de la cité d’Aksoum elle-même. Le grec Pline l'Ancien, qui constitue la plus ancienne référence à la ville d'Adulis indique que la ville aurait été fondée par des esclaves fugitifs égyptiens.
Les traductions des hiéroglyphes de Karnak montrent notamment que l'Éthiopie était à cette époque divisée en trois régions : Berberata, au nord, Tekrau (Tigré) au centre et Arem (Amhrara) au sud, qui sont proches des divisions persistantes de nos jours en Éthiopie.
Certains indices laissent à penser que les relations entre l'Égypte et l'Éthiopie ont pu s'inverser quelques siècles plus tard : une équipe de l'université de Hambourg a mis en évidence en mai 2008, l'apparition d'un culte de Sothis en Éthiopie avant le VIe siècle, ainsi que les caractéristiques d'un culte d'Osiris pratiqué vers 600 av. J.-C.
2 500 avant .C. : Érythrée - L'Érythrée est connue dans l'histoire depuis très longtemps. Les côtes érythréennes sont considérées, avec celles de la Somalie et du Soudan, comme le pays nommé Punt ou Ta Netjeru (Pays des Dieux) par les habitants de l'Égypte antique. La première mention remonte au XXVe siècle av. J.-C.. La plus ancienne référence connue à la mer d'Érythrée est attribuée à Eschyle (Fragment 67), qui la désigne comme « le bijou de l'Éthiopie » (Éthiopie désignait alors la partie de l'Afrique située au sud de l'Égypte).
Ier millénaire avant J.C. : Algérie - L'histoire de l'Algérie dans l'Antiquité débute au milieu du Ier millénaire av. J.-C jusqu'à la conquête musulmane du Maghreb. Cette période est constitutive de plusieurs éléments permanents du pays, notamment son substrat linguistique originel et son organisation sociale, marquée par la prévalence de communautés fondées sur le patriarcat et l'endogamie. Une telle continuité est rare pour un pays méditerranéen.
XXVe au XXIe siècle avant notre ère. : Soudan - Premier royaume de Kerma ou Kerma ancien : sous cette dénomination on entend regrouper l'ensemble des cultures nilotiques du Soudan moyen qui se regroupèrent par chefferies autour d'un puissant monarque qui avait sa capitale à Kerma, site du cours moyen du Nil soudanais. La population de cette époque est en effet constituée d'un ensemble de groupes différents, davantage marqués par les influences du Sud du Soudan. Développement de la métallurgie (bronze) et des arts : ébénisterie, ivoire, céramique, dont on a retrouvé beaucoup de témoignages dans les sépultures de l'époque qui acquièrent alors leur forme définitive. Fosse circulaire contenant le défunt inhumé en position contractée et la tête à l'orient, avec son matériel funéraire, l'ensemble étant recouvert d'un tumulus autour duquel les offrandes alimentaires sont déposées et les sacrifices funéraires opérés.
Au nord de cette région, la Nubie, était occupée par des peuples que l'on regroupe sous le terme de « Groupe C »1 et qui interdisaient l'accès au Sud en contrôlant drastiquement le commerce voire en pillant les convois qui revenaient en Égypte ou en partaient. À l'Ancien Empire cette situation devenait critique pour les Égyptiens qui avaient besoin de cet accès pour obtenir des biens précieux et rares en provenance de l'Afrique centrale (ivoire, ébène, gomme) ou l'or du désert de Nubie. Avec le temps le Groupe C semble avoir peu à peu entretenu des relations pacifiques avec le voisin égyptien allant jusqu'à fournir des mercenaires aux troupes de Pharaon. En retour l'Égypte lui garantissait une relative sécurité aussi bien au niveau militaire qu'économique en notamment palliant les périodes de famines par l'envoi de grain aux peuples de la région. Les débouchés sur les mines d'or du désert oriental y étaient certainement déjà pour quelque chose. En revanche le lointain royaume de Kerma représentait toujours un danger pour les expéditions commerciales qui entraient alors sans doute en concurrence avec le jeune royaume dont l'influence grandissait. Deux groupes de population et de culture distinctes occupaient donc toute la vallée du Nil soudanais jusqu'aux environs de la cinquième cataracte et formaient alors deux puissantes civilisations proto-urbaines avec lesquelles il fallait compter. On assiste en effet sur tout le long de la vallée à la sédentarisation progressive des peuples et à l'établissement de villages qui peu à peu deviennent de grosses bourgades. Kerma était alors déjà une cité étendue.
XXIe au XVIIIe siècle avant notre ère. : Soudan - Deuxième royaume de Kerma ou Kerma moyen : développement du royaume et de sa culture notamment des pratiques funéraires ; les défunts sont toujours inhumés en position fœtale la tête à l'est avec un riche mobilier funéraire. On peut suivre à travers l'évolution de ces pratiques et le développement des tumuli une hiérarchisation de plus en plus marquée de la société. Une véritable classe aristocratique voit donc le jour et préfigure la puissance du royaume à la période suivante. De rares contacts directs ont lieu avec les voisins du Nord mais le commerce est florissant et atteste de la stabilité de la région. On retrouve des traces de son réseau commercial sur les terres de Chillouk au sud de la vallée du Nil et jusque dans les montagnes du Tibesti. Au nord du pays, le Groupe C domine toujours la vallée jusqu'à ce que les pharaons du Moyen Empire annexent littéralement la région jusqu'au Batn el-Haggar. On assiste alors à une réaction du royaume de Kerma qui protégera ses cités derrière des remparts et, signe des temps, les défunts masculins seront alors inhumés avec leurs armes de manière systématique.
2 065 à 1 580 Av notre ère : Égypte - Le Moyen Empire, qui dure près de trois siècles (2065 à 1785 avant notre ère), voit une réaffirmation du pouvoir du roi, qui peut s'appuyer sur une « classe moyenne » instruite et assez prospère ainsi que sur une forme d'armée permanente formée notamment de Nubiens soumis.
La littérature apparue dès l'Ancien Empire se compose notamment de récits cosmogoniques et de textes de sagesse; à partir de la Première Période intermédiaire apparaissent aussi des textes plus pessimistes mais aussi des textes de propagande pharaonique.
La Deuxième Période intermédiaire (1785 à 1580 avant notre ère) commence avec la confrontation avec les Hyksôs, peuple mal identifié et à l'origine discutée, qui prend le pouvoir en Basse-Égypte sans jamais s'imposer sur la Haute-Égypte avec laquelle il garde des relations commerciales.
1 000 avant J.C. : Cameroun - La zone couvrant le sud-ouest de l'actuel Cameroun et le sud-est du Nigeria ont été le berceau des peuples bantous au Ier millénaire avant notre ère.
Les Tikars, les Bamouns et les Bamilékés migrent ensuite pour s'installer sur les hauts plateaux camerounais.
Au nord, la civilisation des Saos, mal connue, se développe dans le bassin du lac Tchad.
1 000 avant J.C. : Cameroun - Les premiers habitants du Cameroun sont probablement les chasseurs-cueilleurs Baka, des nomades Pygmées. Mais, dès le Ier millénaire av. J.-C., se développent des sociétés sédentaires d'agriculteurs-éleveurs, peut-être venus du Sahara alors en voie de désertification et les Baka sont repoussés dans les forêts des provinces du sud et de l'est où on les trouve encore. Parmi les sédentaires, ceux du sud-ouest de l'actuel Cameroun et du sud-est du Nigeria sont les plus anciennement attestés comme utilisant des langues bantoues. Ces langues se sont ensuite répandues à travers la majeure partie de l'Afrique subsaharienne occidentale, jusqu'en Afrique du Sud, probablement en même temps que l'agriculture. La première allusion historique des côtes camerounaises se trouve dans le récit dit Périple d'Hannon, dans un texte grec très discuté. Au Ve siècle av. J.-C., ce carthaginois atteint le mont Cameroun qu'il baptise le Char des Dieux. Mais ce texte est controversé pour sa traduction approximative depuis le phénicien et surtout parce qu'il n'y a pas de preuve archéologique que les Carthaginois soient allés au sud d'Essaouira.
1 000 Av. J.C. : Éthiopie - Au Ier millénaire av. J.-C., des populations Sabéennes du Yémen s'installèrent sur les hauts plateaux d'Érythrée et d'Éthiopie et y fondèrent plusieurs colonies de peuplement. Les Sabéens y introduisirent leur architecture, leur style artistique, leur religion et leur système d'écriture. Leur présence en Éthiopie et en Érythrée se retrouve dans les nombreuses inscriptions présentes.
Après la chute du royaume de D'mt au Ve siècle av. J.-C., divers royaumes ont dominé la région jusqu'à l'émergence, au Ier siècle av. J.-C., du royaume d'Aksoum, premier empire important de l'histoire éthiopienne.
Le royaume d'Aksoum constitue un grand État de la Corne de l'Afrique, sa capitale, Aksoum, est une ville cosmopolite où vivent des Juifs, des Grecs et des populations d'Arabie du Sud. Situé au bord de la mer Rouge, le royaume prospère grâce à l'exportation de produits primaires, se développe autour du commerce et commence à contrôler les principales routes maritimes passant par la région. L'élément caractéristique d'Aksoum est la pratique de l'écriture.
1 000 avant J.C. : Éthiopie - L'Antiquité éthiopienne - Les sources égyptiennes : Le Royaume d'Aksoum Ier-Xe
Le premier véritable empire de grande puissance à apparaître en Éthiopie est le royaume d'Aksoum au Ier siècle, un des nombreux royaumes à succéder à celui de D'mt ; il réussit à unir les royaumes du plateau éthiopien du Nord, apparus au Ier siècle av. J.-C. Les bases de l'État sont posées sur les hauts plateaux du Nord et s'étendent à partir de là vers le Sud. Le prophète Mani cite à cette époque Aksoum comme une des quatre grandes puissances de son temps avec l'Empire romain, la Perse, et la Chine.
Les origines du royaume d'Aksoum sont encore aujourd'hui peu connues, et les experts ont à ce sujet différentes interprétations. Même l'identité du premier roi connu est contestée : si C. Conti Rossini propose que Zoskales d'Axoum, mentionné dans Le Périple de la mer Érythrée, peut être identifié avec un certain Za Haqle identifié parmi la liste des rois éthiopiens (hypothèse reprise par de nombreux historiens ultérieurs tels qu'Yuri M. Kobishchanov et Sergew Hable Sellasie), G.W.B. Huntingford pense que Zoskales était seulement un personnage secondaire dont l'autorité se serait limitée à Adulis, et que l'identification de Conti Rossini ne peut être justifiée.
Située dans le nord-est de l'Éthiopie et de l'Érythrée actuelles, le royaume d'Aksoum est fortement impliqué dans le commerce avec l'Inde et le bassin méditerranéen, en particulier l'Empire romain (plus tard byzantin).
Le royaume d'Aksoum est mentionné dès le Ier siècle dans Le Périple de la mer Érythrée comme ayant une activité commerciale importante, exportant l'ivoire dans tout le monde antique, des écailles de tortues, de l'or et des émeraudes, important de la soie et des épices, notamment à travers son port principal situé à Adulis.
« De cet endroit à la cité du peuple nommé Auxumites, il y a encore 5 jours ; c'est là qu'est apporté tout l'ivoire arrivé d'au-delà du Nil à travers le territoire appelé Cyeneum, puis de là à Adulis. »
Périple de la mer Érythrée, Chapitre 4.
L'accès du royaume d'Aksoum à la mer Rouge et au Nil lui offre de nombreux débouchés maritimes pour profiter du marché entre les différentes régions africaines (Nubie), arabes (Yémen) et les États indiens. Au IIIe siècle Aksoum s'étend sur la péninsule arabe au-delà de la mer Rouge, et vers 350, conquiert le royaume de Koush.
L'importance du marché aksoumite est prouve par de nombreuses attestations archéologiques : des pièces axoumites ont été découvertes dans de nombreuses parties du sud-ouest indien, alors que de la monnaie kouchane indienne a été retrouvée au monastère de Debre Damo dans le nord-ouest de l'Éthiopie.
Les contacts à travers l'océan Indien trouveront écho un siècle plus tard, lorsque le prêtre d'Adulis Moses, se rend en Inde en compagnie d'un prêtre copte d'Égypte afin d'étudier la philosophie brahmane, ou lorsque le roi Kaleb fait appel à des navires notamment indiens pour mener sa campagne au Yémen.
À son apogée, Axoum contrôle le nord de l'Éthiopie actuelle, l'Érythrée, le nord du Soudan, le sud égyptien, Djibouti, la partie occidentale du Somaliland, le Yémen et le sud de l'Arabie saoudite, totalisant un empire de 1 250 000 km².
Ce qui caractérise incontestablement ce royaume est la pratique de l'écriture. Cet alphabet spécifique, appelé ge'ez, se modifiera par la suite en introduisant des voyelles devenant un alphasyllabaire. D'autre part, les obélisques géants marquant les tombes (chambres souterraines) des rois ou de nobles restent les plus célèbres empreintes du royaume.
Des inscriptions trouvées en Arabie méridionale célèbrent des victoires contre GDRT (« Gadarat »), décrit en tant que « nagashi de Habashat [c.-à-d. Abyssinia] et d'Axum ». D'autres inscriptions ont été employées pour dater GDRT (interprété comme représentant un mot ge'ez tel que Gadarat, Gedur, Gadurat ou Gedara) autour du début du IIIe siècle. Un sceptre en bronze a été découvert à Atsbi Dera avec une inscription mentionnant l'« GDR d'Axoum ». Des pièces de monnaie à l'effigie du roi ont commencé à être frappées sous le roi Endubis vers la fin du IIIe siècle.
Le christianisme est introduit dans le pays par Frumence, fait premier évêque de l'Éthiopie par Athanase d'Alexandrie vers 330. Frumence convertit Ezana, qui a laissé plusieurs inscriptions détaillant son règne avant et après sa conversion. Une inscription trouvée à Axoum, déclare qu'il conquit la nation du Bogos dont il est rentré victorieux, grâce au soutien de son père, le dieu Mars. Des inscriptions postérieures montrent l'attachement grandissant d'Ezana pour le christianisme, confirmé par la modification des pièces de monnaie, passant des motifs du disque solaire et du croissant lunaire au signe de la croix.
L'hégémonie qu'exerçait le roi Ezana sur ses voisins, est enregistrée sur une inscription (Inscription d'Ezana).
Des inscriptions en ge'ez découvertes à Méroé attestent d'une campagne menée par le royaume aksoumite soit sous Ezana, ou l'un de ses prédécesseurs comme Ousanas. Les expéditions d'Ezana au royaume de Koush à Méroé au Soudan ont pu être responsables de sa chute, bien qu'il existe des signes indiquant que le royaume était déjà entré dans une période de déclin. À la suite de l'agrandissement du royaume sous Ezana, Axoum partageait des frontières avec la province romaine d'Égypte.
Il s'avèrerait au vu des faibles indices à disposition que cette nouvelle religion ne jouissait à ses débuts que d'une influence limitée. Vers la fin du Ve siècle un groupe de moines connu sous le nom des « Neuf Saints » s'établit dans le pays. À partir de cette époque le monachisme sera présent parmi la population ce qui ne sera pas sans conséquence par la suite.
En 523, le roi juif Dhu Nuwas prend le pouvoir au Yémen et, annonçant sa volonté de persécuter tous les chrétiens, il commence par attaquer une garnison axoumite à Zafar, brûlant les églises de la ville. Il attaque alors le bastion chrétien de Najran, abattant les chrétiens réticents à la conversion. L'Empereur Justin Ier de l'Empire romain d'Orient demande alors l'aide de son ami chrétien, Kaleb d'Axoum, pour combattre le roi yéménite. Vers 525, Kaleb défait Dhu Nuwas, envahit son royaume et désigne alors Sumyafa' Ashwa' vice-roi d'Himyar.
L'historien Procope indique qu'après cinq ans, Abraha dépose le vice-roi et se fait couronner roi (histoires 1.20). Malgré plusieurs tentatives d'invasions infructueuses par la mer Rouge, Kaleb ne réussit pas à déposer Abraha, et dut se résigner à la situation ; ce fut la dernière fois que les armées éthiopiennes sortirent d'Afrique jusqu'à la guerre de Corée du XXe siècle à laquelle ont participé plusieurs unités. Par la suite, Kaleb abdique en faveur de son fils Wa'zeb et se retire dans un monastère où il finira ses jours. Abraha conclut alors un traité de paix avec le successeur de Kaleb reconnaissant sa supériorité. En dépit de cet évènement, c'est sous les règnes d'Ezana et de Kaleb que le royaume atteint son apogée, tirant bénéfice d'importantes relations commerciales, se prolongeant alors jusqu'en Inde et Ceylan, et en communication constante avec l'empire byzantin.
Il semble que la peste de Justinien (541-567) ait eu son origine en Éthiopie et en Égypte.
Les informations sur le royaume d'Aksoum deviennent de plus en plus éparses à partir de cette époque. Le dernier roi connu pour avoir fait battre monnaie se nomme "Armah", dont les pièces portent l'effigie des conquêtes persanes de Jérusalem en 614. Une tradition musulmane indique que celui-ci, connu sous le nom de nedjaschi Ashama ibn Abjar dans la littérature arabe, offrit l'asile au royaume d'Aksoum aux musulmans fuyant les persécutions de la Mecque pendant la vie de Mahomet. L'Éthiopie aurait ainsi été le tout premier pays d'accueil de l'islam, ce qui apporterait quelque justification au hadîth affirmant que Mahomet recommande aux siens de ne jamais attaquer l'Éthiopie à moins d'être attaqués par celle-ci.
La fin du royaume d'Aksoum est au moins aussi mystérieuse que son commencement. Par manque d'indices détaillés, la chute du royaume a été attribuée à une période de sécheresse persistante, le déboisement, la peste, une variation dans les routes du commerce réduisant l'importance de la mer Rouge ou une combinaison de ces facteurs. En fait avec l'avènement de l'islam, Aksoum perd à la fois ses possessions yéménites et son commerce extérieur. Karl W. Butzer propose que l'environnement ait pu jouer un rôle important à la fin d'Axoum, ou ce serait moins le fait des relations commerciales se réduisant après 700, que l'appauvrissement des sols lié à une agriculture intensive combinée à une diminution des précipitations, qui expliquerait le déplacement du centre du pouvoir vers les terres plus fertiles et humides du centre de l'Éthiopie. Munro-Foin cite l'historien musulman Abu Ja'far al-Khwarazmi/Kharazmi, qui écrit en 833, que la capitale « du royaume de Habash » était alors Jarma. Il est également possible que Jarma ne soit un autre nom d'Axoum tiré du ge'ez girma (« remarquable »). Pour d'autres, une nouvelle capitale Kubar aurait été fondée plus au sud. Ceci laisserait à penser que la capitale se serait alors déplacée vers un nouvel emplacement, jusqu'alors inconnu. Des royaumes chrétiens comme celui de Makurie, dans l'actuel sud Soudan, survivent à la disparition d'Aksoum, devenant un lieu de pèlerinage pour arabes et européens. Celui-ci s'effondrera à son tour en 1312.
1 000 avant J.C. : Guinée - Les premiers royaumes voient le jour dans cette région au premier millénaire avant J.C .
1 000 Av J.C. : Kenya - éleveurs d'ovins et de caprins qui utilisent des ânes domestiqués2. Parmi les sites mégalithiques remarquables de cette période, on trouve le site, peut-être archéoastronomique, de Namoratunga sur la rive ouest du lac Turkana. Aux alentours de 1000 apr. J.-C., et même probablement avant, le pastoralisme se diffuse au Kenya central et dans le nord de ce qui est de nos jours la Tanzanie.
De nos jours, les descendants des locuteurs des langues couchitiques se situent au nord du Kenya central, près du lac Eyasi. Leur distribution géographique passée, qui peut être approchée par la présence d'emprunts lexicaux de la part des autres langues, englobe celle des populations du néolithique pastoral des hautes-terres
1 000 avant notre ère : Rwanda - Les premiers signes de présence humaine au Rwanda datent de 1000 av. J.-C. Des archéologues ont découvert les traces d'une civilisation maîtrisant le fer et la poterie.
1 000 avant notre ère : Togo - On a découvert dans l'ensemble du pays, des objets lithiques (meules, broyeurs, pierres taillées, etc.) et des perles de pierre notamment dans le Nord du pays où la nature du terrain, plus sec et plus dégagé, les rendent plus visibles.
Les études préhistoriques restent encore insuffisantes et ne sont pas encore assez nombreuses, pour permettre de faire précisément un lien avec les cultures voisines. Cependant, on a réussi également à retrouver de nombreuses traces d'activité métallurgique.
1 000 avant notre ère : Tunisie - La Tunisie a connu différentes périodes historiques. Peuplée dès la préhistoire, elle a été le berceau de la brillante civilisation carthaginoise. À partir du Ier siècle av. J-C les Romains en firent un des grands producteurs de blé et d'huile d'olive destiné à approvisionner Rome. La Tunisie devenue le royaume des Vandales au moment des grandes migrations de peuples germaniques fut reconquise au début du VIe siècle par les Byzantins de Justinien.
Xe siècle avant notre ère. : Soudan - Constitution d'une principauté autour d'une dynastie locale à Napata (Gebel Barkal). Cette dynastie trouverait ses origines dans la lointaine Méroé alors encore simple place commerciale. Peu à peu l'influence de la principauté s'étend sur l'ensemble des royaumes du Soudan et constitue un puissant royaume au cœur de l'Afrique occidentale et centrale. Règne de six souverains inconnus. Au IXe siècle, à la suite d'une guerre civile qui plonge la thébaïde dans le chaos, une partie du clergé de Karnak se réfugie à Napata sous la protection des princes de Koush.
IXème siècle avant notre ère : République de Centrafrique - Des pierres taillées datant au moins du IXe millénaire avant notre ère ont été retrouvées au cours de fouilles effectuées en République centrafricaine. Toutefois, l’absence de restes humains associés empêche l’attribution de ces outils à une population précise (pygmées ou autre peuple autochtone). Par la suite, la transition du paléolithique vers le néolithique dans la région fut un processus graduel sans rupture culturelle brutale.
IXème siècle - VIème siècle avant notre ère : Maroc - Les Phéniciens, commerçants entreprenants originaires de la Phénicie libanaise située dans le pays de Canaan, installent leur premiers établissements dans ce que les géographes grecs comme Strabon nomment la Libye (terme qui désigne alors l'ensemble de l'Afrique du Nord à l'ouest de l'Egypte, et non la seule Libye contemporaine) et notamment sur les côtes marocaines, dès le XIe siècle av. J.-C. La flotte phénicienne fonde des comptoirs à Tingi (Tanger), Lixus (près de Larache), Thymiateria (Mehdia), Azama (Azemmour) et Cerné (qui serait localisée à Dakhla). À l'époque de l'arrivée des Phéniciens, le territoire de l'actuel Maroc était loin d'être inhabité. Des établissements comme celui de Kach Kouch témoignent de l'installation des populations locales, qui ont maintenu des rapports commerciaux avec les Phéniciens mais en conservant une architecture locale de cabanes bâties en terre. C'est à partir de la fondation de Carthage en Tunisie que la région commence à être réellement mise en valeur et explorée par de grands navigateurs comme Hannon. L'influence de la civilisation carthaginoise se fera sentir près de mille ans sur le territoire du Maroc actuel : en effet à partir du VIe siècle av. J.-C., les Carthaginois en quête de métaux précieux (extraits des mines de l'Atlas et de la vallée pré-saharienne du Drâa), de murex (un coquillage très présent aux Îles Purpuraires d'Essaouira et utilisé pour produire la teinture pourpre prisée chez les Anciens) et de bois rares des forêts nord-africaines, vont commercer avec les populations locales et introduire des éléments culturels propres à la société phénicienne. Néanmoins, les Maures étaient les dépositaires d'une culture très ancienne, atlanto-méditerranéenne, remontant à l'âge du cuivre, comme l'atteste le cromlech de M'zora qui peut être mis en relation avec des sites mégalithiques comparables comme Ħaġar Qim à Malte, et Carnac et Stonehenge au nord-ouest de l'Europe.
888 avant J.C. : Continent Africain - DIDON, sœur de Pygmalion, roi de Tyr, passe en Afrique, où elle fonde Carthage. Selon d'autres historiens, cette ville aurait été achevée en 1233 par les Tyriens ZORUS et CARCHEDON, et DIDON n'aurait fait qu'y ajouter une citadelle.
831 avant J.C. : Continent Africain - Les Carthaginois s'emparent d'Utique.
VIIIe siècle avant notre ère. : Soudan - Règne du prince Alara puis règne du roi Kachta le Koushite ; conquête de la Basse-Nubie puis de la Haute-Égypte. Apogée du royaume de Napata dont la dynastie réclame l'héritage de l'Égypte. Devant l'anarchie qui y règne, Piyé (Piânkhy), puis après lui ses successeurs interviennent et montent sur le trône d'Égypte fondant la XXVe dynastie. Leur royaume s'étend alors de la VIe cataracte aux environs de Khartoum jusqu'à la Méditerranée.
Règne des rois : Piyé, Chabaka, Chabataka, Taharqa, Tanoutamon. Tous règneront sur le royaume de Koush et d'Égypte.
Construction des temples napatéens de Nubie et du Soudan. Cet empire prendra fin à la seconde moitié du VIIe siècle avec la conquête de l'Égypte par les Assyriens. Le royaume qui conserve Napata comme capitale retrouve alors ses frontières originelles. Vers -591, le pharaon Psammétique II envoie une expédition contre le royaume de Koush, réduisant à néant les ambitions des rois de Napata sur l'Égypte.
Destruction des villes saintes de Kaoua, Pnoubs, Napata et destruction des statues royales de la XXVe dynastie.
800 avant J.C. : Érythrée - La plus ancienne référence connue à la mer d'Érythrée est attribuée à Eschyle, qui la désigne comme le bijou de l'Éthiopie.
Vers le VIIIe siècle av. J.-C., un royaume connu sous le nom de D'mt s'établit au nord de l'Érythrée et de l'Éthiopie, avec Yeha comme capitale.
Il est suivi par le Royaume d'Aksoum, au Ier siècle av. J.-C., bien que les continuités restent floues.
750 - 650 Av. J.C. : Éthiopie - De 2009 à 2016, une équipe d'archéologues européens a mis au jour, dans la région de Yeha, une ancienne cité du royaume d'Aksoum, nommée par eux Beta Samati, occupée de 750 av. J.-C. à 650 apr. J.-C. Une basilique chrétienne du IVe siècle fut trouvée au milieu des ruines.
744 avant J.C. : Continent Africain - SABACON, roi d’Éthiopie, s'empare de toute l'Egypte. Il fonde la 25ème dynastie dite des Éthiopiens. La dynastie éthiopienne est chassée de l'Egypte en 704 avant J.C. pendant 33 ans.
700 avant J.C. : continent Africain - les Carthaginois s'emparent des îles Baléares.
700 Av J.C. : Kenya - Vers 700 apr. J.-C., des communautés parlant des langues nilotiques méridionales, provenant de la région frontalière entre le Soudan, l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie se déplacent vers le sud, vers les hautes terres de l'ouest et la vallée du Grand Rift, au Kenya. La distribution géographique de ces derniers, approchée à partir des toponymes, des emprunts lexicaux et des récits des traditions orales, correspond à celle des populations de l'Elmenteitien. L'arrivée des locuteurs du nilotique se produit peu avant l'introduction du fer en Afrique de l'Est
663 à 332 Av notre ère : Égypte - Commence alors la Basse époque (663 à 332 avant notre ère) qui voit alterner des périodes de gouvernement traditionnel et d'autres où l'Égypte est sous la coupe de ses puissants voisins, notamment les Perses.
650 avant J.C. : Continent Africain - PSAMMETISCH 1er s'empare du gouvernement de toute l'Egypte à l'aide de groupe grecques.
Mécontentement de la caste des guerriers. 100 000 soldats égyptiens vont fonder un état particulier en Éthiopie (650-610)
631 avant J.C. : Continent Africain - BATTUS ou ARISTEE, de l'île grecque de Théra, dans la mer Égée passe en Afrique, où il fonde le royaume de Cyrène (aujourd'hui pays de Barcah au Libye), que ses descendants gouvernent pendant 200 ans.
610 avant J.C. : Continent Africain - NEKO, fils de Psammetich, roi d'Egypte, contemporain, selon la bible, de Josias et de Jojachim, roi de Juda. Il fait des conquêtes en Asie jusqu'aux bords de l'Euphrate. Il favorise le commerce, augmente sa marine et fait le tour de l'Afrique par des navigateurs phéniciens. Construction du canal entre la mer Rouge et le Méditerranée.
VIe au IVème siècle avant notre ère. : Soudan - Second royaume de Napata : à la suite de la perte de leur suzeraineté en Égypte, les souverains de Koush développeront leur royaume et leur culture de manière de plus en plus autonome. Développement de la civilisation du fer à Méroé et des routes commerciales avec le cœur de l'Afrique et la mer Rouge (route maritime de l'Inde). Reprise de l'influence jusqu'à la première cataracte aux environs de Philæ. Restauration des grands sanctuaires du royaume. Nécropoles et pyramides de Nouri et d'El-Kourrou.
VIe siècle avant notre ère : Tunisie - Dès le milieu du VIe siècle av. J-C Carthage domine la mer méditerranée occidentale et commerce avec l'Égypte, la Grèce et les Étrusques. Les Carthaginois entreprennent des voyages d'exploration autour de l'Afrique et dans l'océan Atlantique nord.
L'intérieur du pays était peuplé par les Numides.
Les Carthaginois vont s'opposer aux Grecs pour la domination de la Sicile.
575 avant J.C. : Continent Africain - BATTUS II, surnommé l'Heureux, roi de Cyrène. Sous son règne le royaume s'accroît par l'arrivée d'un grand nombre de colons venus de diverses parties de la Crète et du Péloponnèse, qui s'emparent d'une portion du pays, dont il dépouillent les Libyens. Ceux-ci s'adressent à APRIES, roi d'Egypte, qui est vaincu par BATTUS (575 - 574)
554 avant J.C. : Continent Africain - Arcésilaüs II, roi de Cyrène fait la guerre aux Libyens qu'il défait. Il meurt empoisonné (554-550)
554 avant J.C. : Continent Africain - Malchus s'empare du gouvernement de Carthage.
550 à 526 avant J.C. : Continent Africain - BATTUS III, roi de Cyrène. Lui succède BATTUS IV et BATTUS V
554 avant J.C. : Continent Africain - Arcésilaüs III, roi de Cyrène, doit fuir à Samos. Il est assassiné par des fugitifs de Cyrène.
525 avant J.C. : Egypte - Psammetich III ou PSAMMENITE, fils d'Amanis, roi d'Egypte
Invasion de l'Egypte par les Perses sous Cambyse. Défaite des Égyptiens près de Peluse, sur la Méditerranée. Mort de Psamménite. L’Égypte devient une province de l'empire des Perses et est gouvernée par des satrapes.
Conquête de la Libye et de la Cyrénaïque, jusqu'aux confins du territoire carthaginois, par les Perses.
509 avant J.C. : Continent Africain - Premier traité de commerce entre Carthage et Rome.
500 avant J.C. : Afrique du Sud - Les premiers peuples de langues bantoues, venant à l'origine du grassland camerounais actuel, atteignent l'actuelle province du KwaZulu-Natal vers l'an 500 de notre ère. Au Xe siècle, des xhosas s'installent dans la région de la Fish River (Transkei).
500 avant J.C. : Canaries (Îles des) - Carthaginois et Romains en Afrique du Nord
le navigateur carthaginois Hannon aurait été chargé par Carthage de franchir les Colonnes d'Hercule avec une flotte de soixante navires de cinquante rameurs chacun et 30 000 personnes à bord ; il doit débarquer à chaque étape pour y fonder des colonies ou peupler des comptoirs déjà existants et, une fois atteint le dernier comptoir, poursuivre sa route pour une expédition d'exploration. Son périple a été transcrit sur une stèle déposée dans le temple de Ba'al-Hammon à Carthage. De l'original punique non retrouvé, il existe une version grecque intitulée Récit du voyage du roi des Carthaginois Hannon autour des contrées qui sont au-delà des Colonnes d'Hercule, gravée sur des plaques suspendues dans le temple de Kronos : le périple d'Hannon. L'historien Raymond Mauny, autant que d'autres historiens, relève au minimum des inexactitudes, ou des impossibilités, dont le non-signalement des îles Canaries.
500 à 31 Av notre ère : Égypte - Le découpage traditionnel de l’histoire égyptienne ancienne (Égypte dynastique) comprend plusieurs périodes de prospérité (Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire) séparées de périodes de crises, de changements dynastiques et d'invasions, appelées « Périodes intermédiaires ». Les apports scientifiques et notamment archéologiques récents tendent à atténuer ce découpage qui conserve néanmoins une certaine pertinence. Mais outre ces périodes proprement égyptiennes, l'Antiquité de l'Égypte comprend également la période perse (525 à 332 avant notre ère), la période hellénistique (332 à 31 avant notre ère) dite aussi lagide ou ptolémaïque (305 à 31 avant notre ère) et la période romaine (qui débute en 31 avant notre ère et se poursuit par la période byzantine et chrétienne jusqu'en 620 de notre ère).
Vème-IVème siècle Av. J.C. : Zaïre Congo Kinshasa - La métallurgie du fer se développe de manière indépendante à ces installations, les plus anciennes traces se découvrent en Afrique centrale au nord-ouest (sud-Cameroun et zone de Bouar en Centrafrique), et au nord-est (région interlacustre). Au Congo-Kinshasa, le fer n'est pas connu dans la région occupée par la tradition Imbonga ; ce n'est que plus tard, entre les VIIème et Ve siècle av. J.-C. que l'on travaillera ce métal (sites de Pikunda et de Munda)22. Vers la même époque, le bas-Congo connaît ses premières activités de production du fer dans le cadre de la tradition Kay Ladio qui suit dans le temps la tradition Ngovo. Au Kivu, dès l'installation des premières communautés villageoises, il est probable que le fer est présent, comme l'attestent les nombreux fours de réduction du fer bien connus au Rwanda et au Burundi.
Plus tard, comme l'indiquent des recherches allemandes sur les affluents du fleuve Congo, ces premières populations vont lentement coloniser le cœur de la forêt équatoriale en suivant les axes des cours d'eau de l'aval vers l'amont ; des travaux espagnols dans l'Ituri suggèrent qu'il faut attendre –800 pour rencontrer les premiers villages dans certains secteurs de la forêt.
Vème siècle Av J.C. : Cameroun - D'après certains historiens, le carthaginois Hannon aurait atteint le mont Cameroun qu'il aurait baptisé le « char des Dieux ». D'autres historiens rejettent cette théorie arguant l'absence de trace de son passage au Cameroun et les conditions matérielles de l'époque qui n'auraient pas permis une expédition aussi éloignée de Carthage.
Vème siècle Av J.C. : Mali - Les premières traces de peuplement humain remontent au Ve millénaire av. J.-C., on trouve en effet des vestiges néolithiques du Sahara vert dans l'Adrar des Ifoghas.
488 avant J.C. : Egypte Révolte des Égyptiens contre les Perses : les satrapes sont chassés (488 - 484)
414 avant J.C. : Continent Africain - Amyrtée, l'un des compagnons d'Inarus, affranchit l'Egypte de la domination des Perses et se proclame roi (414 - 400)
410 avant J.C. : Continent Africain - Guerre de Carthage avec Syracuse (410 - 368)
2 000 avant J.C. : Kenya - Des peuples venus du nord, parlant une langue couchitique, arrivèrent dans la région aux alentours de 2000 av. J.-C., créant des cultures telles l'Elmenteitien à l'époque du Néolithique pastoral.
2 000 Av J.C. : Madagascar - Les Vahoaka Ntaolo
Arrivés probablement sur la côte Ouest ou Nord-Ouest de Madagascar en pirogue à balancier (waka) il y a 2 000 ans — selon les archéologues. —, ces pionniers austronésiens sont appelés par tradition orale malgache : Vahoaka-Ntaolo soit « ceux des bateaux » ou « peuple navigateur », terme signifiant simplement aujourd'hui le « peuple » en malgache.
Concernant la raison de la venue des austronésiens, l'histoire de l'océan Indien du début du premier millénaire de notre ère est encore très mal connue. On peut seulement supposer que l'île de Madagascar jouait un rôle important dans le commerce, notamment celui des épices et du bois rare, entre l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, directement ou via les côtes africaines.
2 000-1500 avant notre ère : Ile Maurice - Il est vraisemblable que les Austronésiens aient découvert l'archipel des Mascareignes, même s'ils n'y ont pas laissé de trace, car des études récentes montrent qu'ils ont peuplé Madagascar entre 2000 et 1500 av. J.-C.. Le récit du capitaine persan Ibn Shahriyar renforce cette hypothèse, car il rapporte dans son Livre des merveilles de l'Inde qu’un marchand arabe vit arriver sur la côte du Mozambique, en 945, « un millier d’embarcations » montées par des Waq-Waq (Indonésiens actuels), venus y chercher des ressources et des esclaves.
2 000-1500 avant J.C. : Ouganda - Les premiers habitants humains de la région que l'on nomme aujourd'hui Ouganda étaient des chasseurs-cueilleurs. Il existe encore quelques peuples qui ont conservé ce mode de vie nomade, notamment les Pygmées dans l'ouest du pays. Les sources sur la première période historique de la région sont peu nombreuses et reposent principalement sur les fouilles archéologiques. L’hypothèse la plus courante concernant le peuplement de la région montre deux vagues de migrations successives. Entre, approximativement, -2 000 et -1 500 avant notre ère, des populations de langue Bantou, venant apparemment de l'Afrique centrale et de l'ouest africain, ont migré et se sont installés dans la plus grande partie du sud de l'Ouganda. Les populations nilotiques, qui incluent les Luo et les Ateker, sont entrées dans la région par le nord, probablement aux alentours du Ier siècle de notre ère. Ce sont principalement des bergers et des agriculteurs qui se sont installés dans le nord et l’est du pays. Certains Luo ont migré dans la région du Bunyoro puis ont été assimilés avec les Bantous. Ils ont ainsi établi la dynastie des Badiito de l’actuel Omukama du Bunyoro. L’émigration Luo se poursuivit jusqu’au XVIe siècle, certains s’établissant dans les régions bantoues de l’est tandis que d’autres s’installèrent sur les rives du lac Victoria. Les Ateker (peuples Karimojong et Teso) s’implantèrent eux dans le nord-est et dans l’est de l’Ouganda. Certains ont fusionné avec les Luo dans les régions nord du lac Kyoga.
Ce sont ces migrants qui apportèrent avec eux l'agriculture, le travail du fer ainsi que de nouvelles idées d'organisation sociale et politique. Il existe peu d'information sur la période qui suit les migrations, et ce jusqu'au XVe siècle. On voit alors se développer des royaumes dont la particularité est une centralisation politique précoce. Parmi ces royaumes, le royaume du Bunyoro-Kitara domine alors les autres : l'Ankole, les Îles Sese et le Buganda.
2 000 à 0 avant J.C. : Libye
Antiquité : Dès le IIe millénaire av. J.-C., les Libous, installés en Cyrénaïque, forment un peuple redouté des Égyptiens. Vers 1000 av. J.-C., les premiers comptoirs phéniciens sont fondés sur la côte libyenne.
Durant l’Antiquité, les principales parties de l’actuelle Libye sont :
* la Cyrénaïque, d’après le nom de la prestigieuse ville de Cyrène, qui aurait été fondée par des Grecs de Théra en 631 av. J.-C. ;
* la Tripolitaine, à l’origine une colonie phénicienne comprenant les trois villes de Sabratha, Leptis Magna et Ola ; Ola devient la capitale de la colonie sous le nom de Tripoli, qui signifie « trois villes » ;
* le Fezzan ou Phazania, région saharienne et désertique de la Libye antique.
En Grèce antique, le mot « Libye » est alors employé pour désigner toute la zone côtière de l’Afrique du Nord comprise entre le Nil et l’Atlantique, ainsi que l’arrière-pays désertique. Le terme Libyens désigne alors un ensemble de populations dont la présence en Afrique du Nord est antérieure à l'arrivée des Phéniciens, comprenant les ancêtres des actuels Berbères.
La Libye grecque
En 631 av. J.-C. des navigateurs grecs s'installent sur la côte cyrénenne. Les premiers sont originaires de Théra; des navigateurs venus des autres cités grecques le rejoignant bientôt. Les Grecs s'installent sur la côte, et contractent de nombreuses unions avec des femmes du pays : le premier navigateur grec à avoir rejoint le pays devient roi de Cyrène, sous le nom de Battos Ier, fondant la dynastie dite des Battiades. Sous les règnes de ses successeurs, Arcésilas Ier et Battos II, la présence des Grecs remet en cause l'équilibre agro-pastoral des tribus libyennes. Les Libyens tentent alors de chasser les Grecs avec l'aide du pharaon Apriès, mais sont défaits vers 570 av. J.-C. Par ailleurs, vers la fin du VIe siècle av. J.-C., les Phéniciens s'installent sur la côte de Tripolitaine, et gagnent Syrte à partir de Carthage. Le commerce et la vie urbaine se développent, ainsi que la sédentarisation dans les campagnes.
Cyrène s'impose vite comme la plus grande cité grecque d'Afrique. Les colons bâtissent leur fortune sur le commerce du silphion ou silphium, une plante recherchée pour ses vertus culinaires et médicinales. Signe de l'importance de la ville, le monumental temple de Zeus, édifié au Ve siècle av. J.-C., est comparable à celui d'Olympie. La dynastie des Battiades est cependant confrontée à la montée en puissance de l'aristocratie, qui fonde la cité de Barca, dans le Djebel Akhdar, avec l'appui des tribus libyennes. Le roi Battos III doit accepter de réduire ses prérogatives, mais son fils Arcésilas III tente ensuite de les reconquérir par la force. Battu, il reconquiert Cyrène à la fin du IVe siècle av. J.-C., avec l'aide de Polycrate de Samos. Il se tourne ensuite vers l'Empire perse pour obtenir sa protection, mais est assassiné à Barca. Les Perses interviennent alors sur demande de la reine-mère, et détruisent Barca. Cyrène devient un protectorat perse jusqu'à ce que la perte d'influence des Perses amène à la chute du roi Arcésilas IV vers 440 av. J.-C. Le royaume de Cyrène devient alors une République et passe ensuite sous la tutelle de la dynastie des Ptolémées d'Égypte. La cité est à l'époque particulièrement florissante, et fait preuve d'un grand dynamisme commercial.
La Libye romaine
Au Ve siècle av. J.-C. la côte méditerranéenne est dominée par les Carthaginois : en 321 av. J.-C., les territoires bordant la Méditerranée sont annexés par Ptolémée Ier. La Tripolitaine ne se développe réellement qu'à partir de l'effacement de Carthage et la montée en puissance de Rome. En 96 av. J.-C., Ptolémée Apion lègue à sa mort ses droits royaux aux Romains. La Cyrénaïque devient alors une province romaine. La mainmise de Rome sur la Tripolitaine et le Djebel Akhdar s'accélère elle aussi, du fait de la nécessité de l'hégémonie en Méditerranée. En 74 av. J.-C., les cités libres du Djebel Akhdar sont réduites à l'état de province romaine. En 67 av. J.-C., la Cyrénaïque est jumelée par Pompée avec la Crète. Durant le Ier siècle av. J.-C., les trois régions qui forment l'actuelle Libye (Tripolitaine, Cyrénaïque et Fezzan) sont sous la domination de l'Empire romain et connaissent un vif essor aux IIe et IIIe siècles. La Tripolitaine donne à Rome l'empereur Septime Sévère, qui accorde à sa terre natale le jus italicum, soit l'assimilation de son sol à celui de l'Italie et l'exemption de l'impôt foncier.
XVIIIe au XVe siècle avant notre ère. : Soudan - Troisième royaume de Kerma ou Kerma classique : un nouveau royaume de Koush étend son territoire de la première cataracte, aux environs d'Assouan, jusqu'à la quatrième cataracte à la suite de l'alliance des peuples nubiens (Groupe C) et du royaume de Kerma qui en devient alors la capitale. Les relations avec le voisin du Nord sont au début pacifiques et le commerce est florissant avec toute la vallée du Nil et l'Afrique centrale. On assiste à un bond de l'agriculture et de l'urbanisation de la région. Grandes constructions dans la capitale et nécropoles royales avec tumuli colossaux (certains dépassent les cent mètres de diamètre). Au niveau culturel on assiste à un maintien des coutumes et traditions locales bien que certains éléments architecturaux ou décoratifs soient empruntés à la culture égyptienne qui reste assez présente sur le Nord du royaume. Des relations diplomatiques entre Kerma et les dynastes Hyksôs du delta du Nil sont prouvées et attestent que les deux puissances cherchèrent à passer alliance afin de contrer la montée en puissance d'une dynastie rivale située à Thèbes. L'un de ces souverains, Kamosé reprendra alors l'avantage sur le royaume de Kerma repoussant sa frontière au sud d'Éléphantine. Son successeur Ahmôsis Ier poursuivra cette conquête des territoires du Soudan.
XVe au Xe siècle avant notre ère. : Soudan - Domination égyptienne jusqu'à la IVe cataracte : destruction du royaume de Kerma par Ahmôsis Ier puis Amenhotep Ier (XVIIe dynastie) ; contrôle des routes commerciales et des mines d'or du désert oriental. Construction des sites et monuments de Beit el-Ouali, Gerf Hussein, Kouban, Ouadi es-Séboua, Amada, Aniba, Derr, El-Lessiya, Qasr Ibrim, Abou Simbel (Nubie égyptienne), Faras, Aksha, Bouhen, Semna, Ouronarti, Kouma, Amara (Nubie soudanaise), Saï, Sédeinga, Djebel Dosha, Soleb, Sésébi, Pnoubs, Argo, Kaoua, Napata (Gebel Barkal), Kourgous. Installation d'un Vice-Roi pour cette région qui subit une égyptianisation affichée. Capitale à Aniba.
XIIe siècle avant notre ère : Tunisie - Les Phéniciens ouvrent des comptoirs dès le XIIe siècle av. J-C sur les côtes tunisiennes, dont celui-ci de Carthage vers 814-813 av. J-C. Les descendants des colons venus de Phénicie et de Chypre développent la puissante cité maritime et commerçante de Carthage installée dans le nord de la Tunisie. La fondatrice serait la reine légendaire Didon.
Très rapidement les Carthaginois fondent des comptoirs commerciaux sur les côtes de l'Afrique du nord.
1 580 à 663 Av notre ère : Égypte - Les dynasties thébaines mènent alors la reconquête du royaume de Koush puis de la Basse-Égypte et du delta du Nil, donnant naissance au Nouvel Empire (1580 à 1085 avant notre ère).
Une nouvelle administration plus élaborée se met en place ainsi qu'une armée puissante. Ces deux forces permettent à l'Égypte de jouer un rôle de puissance régionale, notamment sur la Nubie et la Palestine qui passent sous sa protection.
Le fonctionnement de l'économie évolue, avec notamment une forme de privatisation du contrôle de la terre, l'importance sociale accrue de groupes de population comme les militaires et le clergé, mais aussi des revendications sociales.
C'est par ailleurs du Nouvel Empire que datent les réalisations les plus remarquables de l'art égyptien comme l'enceinte d'Amon-Rê à Karnak ou les temples d'Abou Simbel.
La Troisième Période intermédiaire (1085 à 663 avant notre ère) voit la prise du pouvoir par les prêtres d'Amon en Haute-Égypte. Le pouvoir passe à des dynasties d'origine libyenne puis originaire du sud (dynastie koushite ou éthiopienne).
1 500 avant notre ère : Malawi - Un autre site daté de 1500 av. J.-C. abrite des restes présentant des similitudes avec les San. Petits et à la peau couleur de cuivre, ces hommes, désignés sous le nom d’Akufula ou de Batwa, ont réalisé les peintures rupestres trouvées dans le complexe de Chongoni, un ensemble de 127 sites couvrant 126,4 km2 du haut plateau central.
1 350 à 450 Av. notre ère : Mauritanie - Outre une épigraphie peu abondante, les premières traces d'histoire humaine dans l'espace saharien occidental se rattachent à la culture Biafane, cette population noire est présente en Afrique de l'Ouest et parlait des langues inconnues, peut être reste-t-il certaines expression dans le dialecte berbéro-arabe des Imraguens, la tribu de pêcheurs du Banc d'Arguin.
Cette population noire était alors présente dans tout l'espace saharien, et elle se maintient dans l'oasis de Zagora dans le sud marocain, la population hartanya est sans doute issue d'un brassage entre les esclaves importés, des populations soninkés, peuls ou wolofs et cette première population.
Les Biafans sont « berbérisés », sans doute au cours de l'âge du bronze méditerranéen, en parallèle de la « celtisation » de l'Europe centrale (1350-450 av. J.-C.), puis par les Berbères Maures plus ou moins romanisés qui contrôlaient l'espace saharien atlantique durant l'époque romaine ("Maures", gentilé des provinces de Maurétanie Tingitane et Maurétanie Césarienne, issues de l'ancienne principauté puis province occidentale de Numidie berbère, avant son annexion par Rome), sont issues de cette fusion entre le pastoralisme amazigh venu des régions atlasiques et les communautés autonomes, concentrées dans les oasis, qui sont leur tributaires.
1 200 à 332 av. notre ère : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Antiquité :
Les Phéniciens auraient pu visiter l’archipel dès l'antiquité : le récit du Périple de Hannon, mentionne un certain nombre d'escales, au-delà de l’île de Cerné en actuelle Mauritanie, dont l'une pourrait être l'archipel.
1 100 avant J.C. : Fondation d'Utique, dans l'Afrique septentrionale, par les Phéniciens.
XIe siècle avant notre ère. : Soudan - Fin de la domination égyptienne sur le Soudan à la suite de l'éclatement de l'Égypte en plusieurs royaumes rivaux. La Nubie devient indépendante autour du Vice-Roi de Koush dont le dernier représentant attesté est Panéhésy (règne de Ramsès XI) et permet ainsi le développement à nouveau des chefferies et des principautés au Soudan qui semblent coexister pacifiquement notamment au sud du pays.
400 avant J.C. : Egypte - Psammétich, Nepherites, Akoris et Pausiris se succèdent sur le trône d'Egypte (400 à 376)
IVème siècle avant notre ère : Éthiopie - La Préhistoire s'achève vers le milieu du IVe millénaire av. J.-C. période durant laquelle l'Égypte antique mentionne les premiers contacts entre le pays de Pount. L'Antiquité éthiopienne s'étend ainsi sur plusieurs millénaires puisqu'elle prend fin en 1270 avec la chute de la dynastie Zagwe et la restauration salomonide. L'inclusion des Zagwés dans la période antique est acceptée aussi bien par Richard Pankhurst que Berhanou Abebe dans son Histoire de l'Éthiopie : d'Axoum à la Révolution. Au début de son ouvrage A history of Ethiopia, Harold G. Marcus consacre son premier chapitre à toute la période allant des « débuts » (beginnings) à 1270 confirmant ainsi cette coupure.
IVème siècle avant notre ère : Maroc - C'est à partir du IVe siècle av. J.-C. qu'apparaît dans le nord-ouest du Maroc actuel la première organisation politique du pays : le royaume de Maurétanie, qui résulte de la fédération de différentes tribus berbères imprégnées des valeurs helléniques d'État unitaire, avec Baga comme premier souverain connu et Sophax comme fondateur légendaire. La Maurétanie adopte dès lors une organisation centralisée autour du roi (qui porte le titre d'aguellid comme les rois de Numidie), détenteur du pouvoir exécutif, militaire et fiscal. Les cités sont administrées par des magistrats appelés suffètes et conservent leur organisation politique héritée de l'époque carthaginoise. Les chefs des tribus vassales sont tenus de fournir des contingents variables de guerriers pour constituer l'armée de l'aguellid qui possède également des unités de mercenaires originaires de l'ensemble du monde méditerranéen. Le punique, variété carthaginoise du phénicien, est la langue officielle utilisée pour les documents administratifs, les rapports diplomatiques et les cultes de Baal, de Tanit et des divinités du panthéon libyco-carthaginois. Les Maures cohabitent avec d'autres populations, comme les Gétules du Sud, cousins des Garamantes, ainsi qu'avec les Éthiopiens occidentaux, les Pharusiens des régions centrales et les Atlantes situés par Hérodote à proximité des monts de l'Atlas.
IVème siècle avant notre ère : Soudan - Royaume de Méroé : transfert de la nécropole royale et de la capitale de Napata à Méroé. Développement de la culture méroïtique dans toute la vallée du Nil et relations commerciales étroites avec le royaume lagide d'Égypte.
IVème - IIIème siècle avant notre ère. : Algérie - Les influences méditerranéennes orientales, notamment par l’établissement de comptoirs phéniciens sur le littoral, aboutissent à la constitution de confédérations tribales avec l'émergence d’aristocraties marchandes et foncières dont certaines fonderont des États. Des entités politiques apparaissent ainsi aux IVe – IIIe siècle av. J.-C. : le royaume des Masaesyles, de la Mulucha (Moulouya) à l'embouchure de l'Ampsaga (oued-el-Kebir) ; et le royaume des Massyles, situé entre le royaume des Masaesyles et les territoires contrôlés par Carthage.
Durant la deuxième guerre punique (IIIème siècle avant notre ère) qui voit s'affronter Rome et Carthage, la Numidie couvrait la quasi-totalité du nord de l’Algérie, à la suite de la conquête du royaume masaesyle par le roi Massinissa. Le règne de ce dernier est marqué par une extension de la culture des céréales. Le royaume de Numidie dont la capitale était Cirta, prenait sans doute la forme d'une confédération de communautés. Les villes puniques du littoral, ont dû jouir d'une quasi-autonomie, et les Gétules des Hautes Plaines et du Sud sont restés indépendants.
Les influences culturelles puniques et grecques marquent davantage les villes que les campagnes, et les sédentaires plus que les nomades. En Numidie, le punique a un statut de langue semi-officielle, les rois et l'élite numides avaient également des connaissances en grec. Toutefois, le berbère restait la langue du peuple. Sur le plan de l'écriture, une écriture libyque se maintient, mais les inscriptions en libyque sont nettement moins nombreuses que celles en grec ou en punique. On atteste également plusieurs alphabets libyco-berbères, dont un occidental correspondant au royaume masaesyle et un alphabet oriental au royaume massyle.
IIIème siècle avant notre ère : République de Centrafrique - À partir du IIIe millénaire avant notre ère, l’établissement et l’expansion vigoureuse sur le sol centrafricain des populations parlant les langues du groupe Adamaoua-Oubangui s’opposent à l’expansion Bantou qui trouve alors un exutoire vers le Sud et l’Est du continent. Le noyau géographique originel des populations de langues Adamaoua-Oubangui serait tout proche car situé dans le massif de l’Adamaoua aux confins des actuels Cameroun, Nigeria, Tchad et République centrafricaine. De l’autre côté des contreforts occidentaux de l'Adamaoua (qui culmine à 3 400 m au Tchabal Mbabo dans les monts Gotel) était situé, sur la rivière Cross, le noyau originel des populations bantoues. Les deux groupes de populations vont connaître, au IIIe millénaire, une expansion simultanée à la suite de la domestication de l’igname et du palmier à huile.
L’implantation solide des populations de langues adamaoua-oubangiennes sur le territoire tiendrait à leur maîtrise des cultures agricoles aussi bien en zone de forêt sèche (apprises auprès des agriculteurs parlant les langues du groupe Soudan-Central) qu’en zone de forêt humide, une double compétence que n’avaient pas les Bantous à cette époque.
376 avant J.C. : Egypte - Nektanebus Ier, roi d’Égypte (375 - 365)
365 avant J.C. : Egypte - Tuchus, roi d’Égypte (365 - 363)
363 avant J.C. : Egypte - Nektanebus II, roi d’Égypte (363 - 354)
362 avant J.C. : Continent Africain - Agésilas, roi de Sparte, vient au secours des Égyptiens contre les Perses
350 avant J.C. : Continent Africain - les Égyptiens sont de nouveau rendus tributaires de la Perse, par Artaxerxès-Ochus
348 avant J.C. : Continent Africain - 2ème traité de commerce entre les Carthaginois et les Romains
335 avant J.C. : Continent Africain - Hannon, un des premiers citoyens de Carthage, ayant voulu s'emparer du pouvoir souverain, est découvert, se retire avec 20 000 esclaves armés dans un château fort, est pris et mis à mort avec toute sa famille.
332 à 30 Av notre ère : Égypte - Alexandre le Grand, après avoir vaincu les Perses, s'empare de l'Égypte en 332 avant notre ère, fonde la ville d'Alexandrie et inaugure la courte période macédonienne qui se termine dès 305 avant notre ère. À partir de cette date, l'Égypte est gouvernée par la dynastie des Ptolémées dite aussi lagide. L'Égypte connaît alors l'influence de la civilisation grecque antique, bien que la religion traditionnelle subsiste jusqu'à la christianisation.
331 avant J.C. : Continent Africain - Conquête de l'Egypte, fondation d'Alexandrie. Marche vers la Libye et au temple de Jupiter-Ammon. Départ pour la Mésopotamie et l'Assyrie, où se livre la célèbre bataille d'Arbelles ou de Gaugamèle, qui met fin à l'empire des Perses.
Alexandre passe les pyles Persides, et s'empare de Pasargade et de Persépolis, destruction du célèbre palais (ruine de Tschilminar)
330 avant J.C. : Continent Africain - Darius est assassiné par Bessus.
323 avant J.C. : Continent Africain - Entrée d'Alexandre à Babylone. La mort l'y surprend à l'âge de 32 ans et dans la 13ème année de son règne.
A la mort d'Alexandre, les principaux généraux et gouverneur de son empire étaient : Ptolémée, fils de Lagus, en Égypte; Séleucus, à Babylone et dans la haute Asie; Antigone, dans l'Asie-Mineure et centrale; Laomédon, en Syrie et en Phénicie; Cassandre, en Carie; Ménandre, dans la Lydie; Léonnat, dans la Petite-Phrygie; Néoptolème, en Arménie; Eumène, dans la Cappadoce et la Paphlagonie; Lysimaque, dans la Thrace et les Pays voisins; Antipater, en Macédoine, en Épire et en Grèce. Guerre entre les généraux d'Alexandre et partage de son empire.
Empire des Ptolémées d'Egypte (323 - 30 avant J.C.) : Ptolémée Lagus ou Soter, fondateur de la dynastie des Ptolémées ou des Lagides (323 - 284 av J.C.). Il étendit son empire sur l'Egypte, la Libye, la Cyrénaïque, l'Arabie Pétrée, la Judée, la Phénicie, Damas, Chypre. Capitale : Alexandrie.
321 avant J.C. : Continent Africain - La Cyrénaïque est conquise par Ptolémée. Fin de la république de Cyrène.
330 avant J.C. : Continent Africain - Conquête de la Palestine par Ptolémée d'Egypte. Plus de 100 000 Juifs sont transportés en Égypte.
310 avant J.C. : Continent Africain - Guerre de Carthage contre Syracuse (310 - 306 av. J.C.)
331 avant J.C. : Continent Africain - Grande victoire navale remporté, près de l'Ile de Chypre, par Démétrius Poliorcète, fils d'Antigone, sur Ptolémée, roi d'Egypte.
Agathocle porte la guerre en Afrique. Les Carthaginois le forcent de retourner en Sicile.
Expédition d'Antigone et de son fils en Égypte.
306 avant J.C. : Continent Africain - Paix entre les Carthaginois et Agathocle.
305 avant J.C. : Continent Africain - Commerce florissant de l'Egypte avec l'Inde.
301 avant J.C. : Continent Africain - Bataille d'Ipsus, en Phrygie. Antigone, dont le pouvoir s'étendait, depuis 307, sur presque toute l'Asie et l'Asie-Mineure, est défait par Cassandre, Séleucus, Ptolémée et Lysimaque. Dernier partage de la monarchie d'Alexandre. La Syrie reste à Séleucus, l'Egypte à Ptolémée. Lysimaque obtient la Thrace et Pergame. Cassandre conserve la Macédoine.
IIème siècle avant notre ère : République de Centrafrique - La présence d’une agriculture en République centrafricaine est avérée à partir du milieu du IIe millénaire avant notre ère.
IIème siècle avant notre ère : Maroc - Lorsque les Romains prennent pied en Afrique vers le IIe siècle av. J.-C., après la destruction de Carthage, ils s'allient au roi Bocchus de Maurétanie contre la Numidie réunissant les puissants peuples des Massyles et des Massaesyles. Cette stratégie leur permet de prendre à revers leur ennemi, le roi numide Jugurtha, gendre de Bocchus que celui-ci leur livre. Le souverain mauritanien gagne en récompense le titre d'Ami du peuple romain décerné par la République romaine ainsi que l'estime du consul Caius Marius. La politique d'alliance entre Rome et la Maurétanie se poursuit avec Bogud et son épouse la reine Eunoé, qui seront de fidèles partisans de Jules César dans la lutte qui l'oppose à Pompée pendant la guerre civile de César.
284 avant J.C. : Continent Africain - Ptolémée II, Philadelphe, fils de Ptolémée Soter, monte sur le trône d'Egypte (284 - 246 av. J.C.). Fondation présumée de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie.
Construction du phare d'Alexandrie.
273 avant J.C. : Continent Africain - Traité d'amitié entre l’Égypte et les Romains.
270 avant J.C. : Continent Africain - Construction du canal de jonction du golfe Persique à la Méditerranée par le Nil.
264 avant J.C. : Continent Africain - Première guerre entre Carthage et Rome (264 - 241 av. J.C.)
264 à 146 avant notre ère : Tunisie - Les Carthaginois vont s'opposer aux Grecs pour la domination de la Sicile. Puis ils vont devoir affronter les Romains pendant les guerres puniques entre 264 et 146 av. J-C. Carthage perd ces guerres et est rasée.
La Tunisie littorale devient une province romaine. Bien protégée et bien aménagée grâce à l'irrigation, elle devient un des greniers à blé et à huile d'olive de Rome.
260 avant J.C. : Continent Africain - Guerre entre l’Égypte et la Syrie (260 - 252 av. J.C.)
256 avant J.C. : Continent Africain - Expédition des Romains en Afrique (256 - 250 av. J.C.)
250 avant J.C. : Mali - Les premières formes de vie urbaine apparaissent vers 250 avant notre ère à Djenné-Djenno.
Quatre site archéologiques ont été découverts : Djenné-Djenno, Hambarkétolo, Kaniana et Tonomba.
246 avant J.C. : Égypte - Ptolémée III, Évergète, succède à son père Ptolémée II sur le trône de l’Égypte (246 - 221 av. J.C.)
Ptolémée III déclare la guerre au roi de Syrie, qui avait fait assassiner sa sœur Bérénice. Conquête de la Syrie et des côtes de l'Asie-Mineure, depuis la Cilicie jusqu'à l'Hellespont. Expédition en Mésopotamie, dans la Babylone, en Perse, dans la Médie et dans la Bactriane. Il étend ses conquêtes jusque dans l'intérieur de l’Éthiopie et sur les côtes occidentales de l'Arabie. Des troubles, survenus dans ses États, l'oblige de retourner sur ses pas.
241 avant J.C. : Continent Africain - Paix entre Carthage et Rome. les Carthaginois évacuent la Sicile, leurs finances sont épuisées.
240 avant J.C. : Continent Africain - Guerre de Carthage contre les troupes mercenaires qui s'étaient révoltées et contre les peuples tributaires qui s'étaient soulevés avec eux. Amilcar, père d’Hannibal, les fait rentrer dans l'obéissance (240 - 237 av. J.C.)
224 avant J.C. : Égypte - Les conquêtes de l’Égypte dans l'Asie-Mineure sont reprise par Séleucus III, roi de Syrie
221 avant J.C. : Egypte - Ptolémée IV, Philopator, succède à son père Ptolémée Évergète sur le trône de l'Egypte (221 - 204 av. J.C.). Ce prince se livre à une débauche effrénée, fait périr sa mère, son frère, sa soeur, sa femme. L'histoire l'accuse, en outre, d'avoir fait empoisonner son père.
219 avant J.C. : Continent Africain - Bataille de Raphia, en Palestine, gagnée par Ptolémée IV, roi d'Egypte, sur Antiochus-le-Grand, roi de Syrie. la Coelé Syrie passe sous la domination du roi d'Egypte.
218 avant J.C. : Continent Africain - Seconde guerre de Carthage contre Rome (218 - 201 av. J.C.) Le consul Sempronius débarque en Afrique.
Bataille de Sardes, gagnée par Antiochus III, de Syrie, sur Ptolémée, roi d'Egypte.
200 avant J.C. : Érythrée - Le Périple de la mer Érythrée, un texte du IIe siècle, précise qu'il existait en Afrique de l'Est une route commerciale qui reliait le monde romain à la Chine.
181 avant J.C. : Egypte - Les Égyptiens, fatigués des cruautés de Ptolémée Épiphane, se révoltent contre ce prince, qui est empoisonné.
Troubles au sujet de la succession. Ptolémée VI, Philométor, âgé de 5 ans, roi d'Egypte.
172 avant J.C. : Egypte - Victoire des Syriens sur les Égyptiens à Pelusium. Ptolémée VI est fait prisonnier. Intervention des Romains, dont l'ambassadeur Popilius force le roi de Syrie à restituer les conquêtes qu'il avait faites sur leurs alliés (172 - 170 av. J.C.)
152 avant J.C. : Continent Africain - Guerre de Carthage contre le roi numide Masinissa, allié de Rome. Défaite des Carthaginois. Défection d'Utique.
149 avant J.C. : Continent Africain - Troisième guerre de Carthage contre Rome. Les consuls Manlius et Censorinus débarquent en Afrique, et, après s'être fait livrer toutes les armes et les machines de guerre des Carthaginois, dont des divisions intestines paralysaient tout système de défense régulier, ils déclarent que les ordres du sénat sont de détruire Carthage. Alors le courage des malheureux habitants de cette ville se réveille, et, pendant 3 ans, ils opposent aux armées romaines tous les efforts dont le désespoir et l'amour de la patrie sont capables.
148 avant J.C. : Continent Africain - Mort de Masinissa, roi de Numidie. Suivant ses intentions, ses États sont partagés entre ses trois fils, Micipsa, Gulussa et Mastanabal. Après la mort des deux derniers, Micipsa demeure seul maître de tout le royaume.
146 avant J.C. : Continent Africain - Prise et destruction de Carthage par Scipion Émilien, 742 ans après sa fondation. L'incendie de cette ville célèbre, qui avait eu 700 000 habitants, dura 17 jours. La république de Carthage est réduite en province romaine sous le nom de Province d'Afrique.
146 avant J.C. : Canaries (Îles des) - L'Afrique romaine et ses voisins numides et maurétaniens
La province d'Afrique, correspondant globalement à la Tunisie et la Libye actuelles (Ifriqiya), de culture phénico-punique (littérature phénico-punique (es)), se romanise. Les romano-africains sont d'origine berbère, de souche locale, ou punique, mais peuvent aussi être des descendants de populations venues de Rome elle-même, ou de diverses régions de l'empire, notamment les légionnaires.
Les multiples déplacements de populations de Maurétanie aux îles Canaries, peuvent-être plus anciens (et puniques), mais dateraient plus sûrement du siècle des règnes de quelques grands rois de Numidie (orientale ou occidentale) puis de Maurétanie, de culture punico-berbère,
lettrés :
-
Juba II, fils de Juba Ier, roi de -25 à + 23, otage à 5 ans, élevé à Rome par la sœur d'Auguste, duumvir, homme de lettres de sciences, connaissant (ou ayant favorisé des expéditions vers ces lieux) les Îles Purpuraires (Mogador), l'Île de Madère et les îles Canaries, enterré au mausolée royal de Maurétanie), admiré par Plutarque, Pline l'Ancien,
Selon Pline le Jeune, Juba II aurait donné leur nom aux îles Canaries, pour y avoir trouvé de grands chiens féroces (canarius, du latin canis
chien), il y aurait collecté des informations sur la flore, la faune et l'ethnographie, et il aurait nommé cinq îles en latin : "Canaria" (aujourd'hui
Grande Canarie), "Nivaria" (l'île de la neige perpétuelle, maintenant Tenerife), "Capraria", "Iunonia Maior" (probablement La Palma), "Iunonia
Minor" et une en grec, "Ombrios" (actuelle El Hierro).
-
Ptolémée de Maurétanie, son fils, roi de 23 à 40, grand voyageur, assassiné (sans doute à Lyon) par Caligula, qui annexe son royaume, remarqué par Suétone.
145 avant J.C. : Egypte - Ptolémée VII, Physkon, roi d'Egypte (145 - 117 av. J.C.)
Démétrius II, Nicanor, fils de Démétrius-Soter, chasse du trône de Syrie Balas, qui est assassiné par Zabdiel, prince des Arabes, chez lequel il s'était réfugié.
144 avant J.C. : Continent Africain - Antiochus VI, Dionysos, fils d'Alexandre Balas, dispute le trône à Démétrius II. Il est assassiné par Tryphon, qui s'empare d'une partie de la Syrie.
143 avant J.C. : Continent Africain - Simon, frère de Jonathas, grand pontife des Juifs, fait la paix avec Démétrius qui l'affranchit du tribut. Antiochus Sidètes le ménage également, mais, après la mort de Tryphon, il le fait attaquer par Condebeus, qui est vaincu par les fils de Simon. Bientôt après, Simon est assassiné, avec deux de ses fils, par Ptolémée, son gendre, qui aspirait à s'emparer du gouvernement.
140 avant J.C. : Continent Africain - Démétrius II tombe au pouvoir du roi des Parthes, qui le traite bien et lui donne même sa fille en mariage, mais le retient prisonnier pendant 10 ans.
138 avant J.C. : Continent Africain - Antiochus VII, Sidètes, frère de Démétrius Nicanor, se fait proclamer, roi de Syrie (138 - 131 av. J.C.) Il se bat et fait prisonnier l'usurpateur Tryphon.
132 avant J.C. : Continent Africain - Aristonicus, fils naturel d'Eumène II, s'empare du trône de Pergame après avoir battu et fait prisonnier le consul Licinius Crassus. Mais il est défait et pris par le consul Perpenna, conduit à Rome et étranglé par ordre du sénat (132 - 130 av. J.C.)
Une colonie romaine, la première envoyée hors d'Italie, passe en Afrique, sous la conduite du tribun C. Gracchus, et jette les fondements de la nouvelle Carthage.
129 avant J.C. : Egypte Révolte des Égyptiens contre la cruautés et la tyrannie de Ptolémée Physkon qui s'enfuit en Chypre. Cette révolte ayant été fomentée par Cléopâtre, première femme de Ptolémée, ce dernier fit égorger le fils qu'il avait eu d'elle, dans la crainte qu'elle ne l'élevât sur le trône. Il reconquit cependant son royaume, et y jouit d'une paix qui ne fut plus troublée jusqu'à sa mort.
128 avant J.C. : Continent Africain - Alexandre Zabinas, fils d'Alexandre Balas, s'empare du trône de Syrie, après avoir été défait par Démétrius, qui est tué par Cléopâtre, sa femme. Bientôt après, cette dernière fait aussi assassiner son propre fils Séleucus V, qui s'était emparé du gouvernement d'une partie de la Syrie.
118 avant J.C. : Continent Africain - Mort de Micipsa, fils de Masinissa, roi de Numidie. Il avait adopté et associé à l'héritage de ses États son neveu Jugurtha, conjointement avec ses fils Adherbal et Hyempsal. Jugurtha assassine ce dernier, chasse l'autre et règne seul sur la Numidie. Adherbal recouvre une partie de ses États avec le secours des romains, mais il est aussitôt attaqué par Jugurtha, qui l'assiège dans Citra (Aujourd'hui Constantine), s'en rend maître et le fait égorger (118 - 112 av. J.C.)
117 avant J.C. : Continent Africain - La Cyrénaïque est érigée en royaume, en faveur d'Apion, fils naturel du roi d’Égypte.
Ptolémée VIII, Lathyrus, roi d'Egypte (117 - 107 av. J.C.)
112 avant J.C. : Continent Africain - Les romains déclarent la guerre à Jugurtha, roi de Numidie. Le consul Calpurnius Pison, gagné par l'or du numide, lui accorde la paix. Jugurtha vient se justifier à Rome, y fait assassiner Massiva, neveu de Micipsa, et retourne dans la Numidie, où le consul Posthumius Albinus, envoyé contre lui, l'attaque sans succès. Aulus, frère du consul, se laisse attirer dans l'intérieur des terres et passe sous le joug après avoir fait le traité le plus humiliant (112 - 109 av. J.C.)
109 avant J.C. : Continent Africain - Défaite de Jugurtha, roi de Numidie, par le consul Métellus. Après quelques négociations, la guerre recommence et traîne en longueur. Arrivée de Marius. Alliance de Jugurtha et de Bocchus, roi de Mauritanie. Leurs armées sont détruites. Bocchus, pour obtenir la paix, livre aux Romains son allié qui, après avoir servi à orner le triomphe de Marius, est jeté dans un cachot où il meurt de faim. Une partie de la Numidie est donné à Bocchus, l'autre partie est réunie à la province de Carthage (109 - 106 av. J.C.)
107 avant J.C. : Continent Africain - Ptolémée VIII, roi d'Egypte, est chassé du trône et remplacé par Ptolémée IX (Alexandre Ier) (107 - 89 av. J.C.) Sa mère Cléopâtre l'avait fait reconnaître roi d'Egypte, mais une mésintelligence étant survenue entre elle et son fils, ce dernier la fit périr dans la 18ème année de son règne.
107 avant J.C. : Algérie - La fin de la troisième Guerre punique et l’annexion par Rome du territoire de Carthage en 146 av. J.-C., va ouvrir la voie à un interventionnisme romain pendant deux siècles dans les royaumes berbères. Rome profite de la rivalité entre ces différents royaumes et des querelles de succession. Ainsi, en 105 av. J.-C, la Numidie est amputée de sa partie occidentale, cédée en récompense à Bocchus Ier, roi de Maurétanie qui a livré son beau-fils et roi numide Jugurtha aux Romains, et partagée en deux États correspondant aux anciennes Massylies occidentale et orientale. Puis, les Romains l'annexent, plaçant Juba II, le fils de son dernier roi à la tête de deux Maurétanie réunifiées (la Tingitane qui avait Tingis-Tanger comme capitale, et la Césarienne qui tient son nom de Césarée-Cherchell), ce dernier faisant de Yol-Cherchell sa capitale.
100 avant J.C. : Érythrée - Les peuples du Centre de l'Érythrée et du Nord de l'Éthiopie partagent un héritage historique et culturel commun, issu du Royaume d'Aksoum et des dynasties qui ont suivi au long du Ier millénaire av. J.-C. et de la langue ge'ez. Le tigrinya et l'amharique, langues officielles respectivement en Érythrée et en Éthiopie, sont des langues cousines du ge'ez, la langue liturgique de l'Église orthodoxe monophysite éthiopienne, ainsi que de l'Église d'Érythrée qui s'en est détachée à l'indépendance du pays.
Le Périple de la mer Érythrée, un document du IIe siècle, précise qu'il existait en Afrique de l'Est une route commerciale qui reliait le monde romain à la Chine. Les peuples du Centre de l'Érythrée et du Nord de ce qui forme actuellement l'Éthiopie partagent un héritage historique et culturel commun, issu du royaume d'Aksoum et des dynasties qui ont suivi au long du Ier millénaire av. J.-C. et de la langue guèze.
Le royaume d'Aksoum, à partir du IVe siècle av. J.-C. précédé du royaume de D'mt, couvrait une grande partie de l'Érythrée et du Nord de l'Éthiopie actuelles. Il atteint son apogée au Ier siècle av. J.-C. et adopte plus tard le christianisme.
100 avant notre ère : Tunisie - La Tunisie littorale devient une province romaine. Bien protégée et bien aménagée grâce à l'irrigation, elle devient un des greniers à blé et à huile d'olive de Rome. Carthage rebâtie par Jules César devient rapidement un centre intellectuel et religieux.
Ier siècle avant notre ère. : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - On sait peu de choses de l'histoire ancienne du Burkina Faso. Une civilisation néolithique y a produit des pierres taillées, des motifs gravés et de la poterie au Ier millénaire av. J.-C. Ensuite apparut l'agriculture avec des défrichements de la forêt primaire. Une vague de cavaliers vint alors greffer une aristocratie militaire sur cette structure. Détenteurs du pouvoir politique, ces cavaliers passèrent des accords avec les autochtones qui restèrent propriétaires du sol. Cette organisation apparaît encore sous forme de chefs de cantons et chefs de la terre.
Ier siècle avant notre ère : Cameroun - La zone couvrant le sud-ouest de l'actuel Cameroun et le sud-est du Nigeria aurait été le berceau des peuples bantous.
Ier siècle avant notre ère : République de Centrafrique - Les populations de langues adamaoua-oubanguiennes achèvent leur implantation sur l’ensemble de l’actuelle République centrafricaine vers le début du Ier millénaire avant notre ère tandis que l’extension géographique maximale de ces populations est atteinte vers le début de l’ère chrétienne. Les habitants qui les avaient précédé (pygmées et soudanais centraux) sur le territoire de la Centrafrique actuelle sont alors soit assimilés soit marginalisés.
Une civilisation mégalithique qui perdure jusqu’au Ier siècle apr. J.-C. se développe dans la région de Bouar (Ouest). C’est l’apparition de la métallurgie du fer qui semble avoir mis fin à la civilisation des mégalithes (Tazunu en gbaya). La métallurgie du fer se répand d’ouest en est et s’accompagne d’une expansion de la population dont on considère qu’elle atteignit 6 millions d’habitants sur l’ensemble du territoire centrafricain au XVIIIe siècle. Les populations auraient alors vécu en relative autarcie car à l’écart des grandes voies commerciales africaines.
Entre les débuts archéologiques et la période qui précède immédiatement la colonisation, soit environ 1 700 ans, les données concernant l’histoire du territoire occupé par la République centrafricaine sont rares ou peu accessibles au grand public. Il est probable qu’à l’instar de beaucoup de peuples établis dans la zone équatoriale, les populations de la région n’ont pas éprouvé le besoin de s’organiser autour de structures étatiques mais ont plutôt conservé un système de chefferies locales. Rétrospectivement, et étant donné l’expansion démographique supposée de la population (six millions d’habitants), on peut se demander si ce système n’était peut-être pas plus performant que bien d’autres. Le défaut majeur de cette organisation politique très superficielle est toutefois de ne pas avoir pu protéger les populations de langues adamaoua-oubanguiennes des épreuves qui allaient survenir au cours de la période contemporaine.
Ier siècle avant notre ère. : Soudan - Des conflits éclatent entre les deux puissances et trouveront leur paroxysme lors de la conquête romaine au Ier siècle av. J.-C..
En -24, conquête de Philæ et d'Assouan par la Candace Amanishakhéto. Conquête de la Nubie par les romains qui seront stoppés par la reine. Traité de paix entre Rome et Méroé en -21, dit traité de Samos. La frontière est fixée à Maharraqa (en) et à dater de cette époque les deux empires entretiendront des relations commerciales florissantes.
96 avant J.C. : Continent Africain - Ptolémée Apion, dernier roi de la Cyrénaïque, lègue ses États aux Romains.
94 avant J.C. : Continent Africain - Guerre des Juifs contre les Arabes, l'armée juive tombe dans une embuscade et est taillée en pièces dans les montagnes près de Gadara. Nouvelle révolte des Juifs, victoire d'Alexandre sur l'armée insurgée et ses alliés. Vengence atroce du roi, plus de 50 000 insurgés sont massacrés.
89 avant J.C. : Egypte - Ptolémée IX, roi d'Egypte, chassé d'Alexandrie, sa capitale, retourne dans l'ile de Chypre, qui avait été érigée en royaume en sa faveur. Peu de temps après, il est vaincu et tué dans une bataille navale contre Chéréas. Ptolémée VIII remonte sur le trône. (89 81 av. J.C.)
81 avant J.C. : L’Égypte, sous l'influence absolue de Rome, devient le théâtre permanent de guerres que se livrent les prétendants au trône, sur lequel se succèdent, de 81 à 66 avant J.C., Bérénice, fille de Ptolémée Lathyrus, Ptolémée X (Alexandre II et Alexandre III.
66 avant J.C. : Egypte Ptolémée XI (Aulètes), roi d'Egypte (66 - 57 et 55 av. J.C.)
57 avant J.C. : Egypte - Ptolémée Aulètes, devenu odieux par ses crimes et ses débauches, est chassé du trône d'Egypte et remplacé par sa fille Bérénice, qui épouse et s'associe dans le gouvernement Archelaüs, grand-prêtre de la déesse de Comana et fils d'Archelaüs-le-Cappadocien, général de Mithridate-le-Grand, roi du Pont.
Les romains s'emparent de l'île de Chypre, sous prétexte qu'elle avait été léguée à la République par un des derniers Ptolémées.
55 avant J.C. : Egypte - Ptolémée Aulètes est rétabli sur le trône d'Egypte par Gabinius, lieutenant de Pompée, et fait mourir sa fille Bérénice.
51 avant J.C. : Egypte - Ptolémée XII (Denys) succède à son père Aulètes sur le trône d'Egypte, dont il exclut sa sœur Cléopâtre
48 avant J.C. : Egypte - Pompée, arrivé en Égypte, après sa défaite à Pharsale, est assassiné par ordre de Ptolémée Denys, sur la plage d'Alexandrie.
Arrivée de César en Égypte. Il est reconnu pour arbitre par Ptolémée Denys et Cléopâtre. Séduit par le charme de cette dernière, il décide que le frère et la sœur doivent partager le trône. Ptolémée Denys, mécontent, vient assiéger César dans son palais, mais il est bientôt attaqué à son tour et vaincu dans une bataille décisive, dans laquelle il périt en traversant le Nil.
Ptolémée XIII, le Jeune, second fils d'Aulètes, est nommé roi par César, qui lui fait épouser sa sœur Cléopâtre, avec laquelle il partage la couronne.
46 avant J.C. : Continent Africain - Arrivée de César en Afrique. Défaite du parti de Pompée à Thapsus (État de Tunis). La Mauritanie et la Numidie sont réduite en provinces romaines. Juba, allié de Pompée, dernier roi.
44 avant J.C. : Egypte - Cléopâtre fait empoisonner son frère Ptolémée le Jeune, et règne seule sur l'Egypte.
41 avant J.C. : Le triumvir Antoine près de Cléopâtre.
37 avant J.C. : Antoine établit ses quartiers d'hivers en Égypte, auprès de Cléopâtre (37 à 33 av. J.C.)
33 avant J.C. : Conduite scandaleuse d'Antoine en Égypte. Il proclame Cléopâtre reine d'Egypte, de Chypre, de Lydie et de Syrie, et donne aux deux fils qu'il avait eus d'elle presque tous les trônes d'Orient.
30 avant J.C. : L’Égypte et l'île de Chypre sont réduites en provinces romaines.
Les deux Mauritanie et une partie de la Gétulie sont érigées, par Octave, en royaume en faveur de Juba II, fils de Juba Ier
30 Av notre ère à 639 après J.C. : Égypte - L'Égypte passe sous domination romaine en 30 avant notre ère. Elle conserve un statut particulier durant tout l'Empire romain. Le pays reste un des principaux greniers à blé pour Rome, ainsi que la source de plusieurs matériaux utilisés à Rome, tels que le granite et le porphyre. Alexandrie, sa capitale, possède le plus grand port et est la deuxième plus grande ville de l'Empire romain.
Le pays bénéficie de la Pax Romana jusqu'au IIIe siècle.
L'Égypte byzantine connaît une longue période de paix, du Ve au début du VIIe siècle, qui lui permet de connaître une grande opulence. Véritable mégalopole, Alexandrie réunit philosophes et mathématiciens autour du Mouséion et est aussi le siège d'une Église disposant d'une intense vie spirituelle.
29 avant J.C. : Première année d'Auguste en Égypte, et commencement de l'ère actiaque, l'année qui suivit la mort d'Antoine et de Cléopâtre.
25 avant notre ère : Maroc - La Maurétanie devient un royaume vassal, un « État-client », qui, s'il dépend étroitement de Rome et prendra part à toutes les querelles internes de la République finissante et des débuts de l'Empire, reste autonome. Mais, faute d'héritier pour la lignée des Bocchus, le royaume finit par échoir à une dynastie d'origine numide, avec le règne de Juba II à partir de 25 av. J.-C., après un court interrègne romain12. Le roi Juba se distingue par son érudition, par son ouverture à toutes les cultures du monde méditerranéen et par son intérêt pour les arts, les belles lettres, la philosophie, ainsi que pour certaines disciplines scientifiques comme la géographie (Juba II fait explorer le Haut-Atlas, une partie des régions désertiques sahariennes, ainsi que Madère et l'archipel des îles Canaries, nommées alors îles Fortunées). Il épouse avec la bienveillante bénédiction d'Auguste la princesse Cléopâtre Séléné, fille de Marc-Antoine et de Cléopâtre VII, et n'hésite pas à faire remonter sa généalogie au demi-dieu Hercule. Une civilisation mauritanienne émerge alors, combinant avec originalité l'apport carthaginois et les influences hellénistiques et égyptiennes, avec un art et une esthétique qui s'expriment dans l'urbanisme des cités comme Tamuda, Zilil, Lixus, Césarée de Maurétanie (capitale de Juba II, correspondant à l'actuelle Cherchell) et Rusibis, et dans la construction de monuments funéraires tels que le Mausolée royal de Maurétanie ainsi que le bazina d'El Gour.
Ier siècle : Afrique du Sud - Au début de l'ère chrétienne, des peuples Bantous arrivent du nord-ouest, partis des confins du Cameroun et du Nigeria. La première vague de ces peuples migrants issus de l'âge du fer, agriculteurs et éleveurs, atteint l'Afrique du Sud probablement vers l'an 300 pour s'établir dans l'actuelle province du KwaZulu-Natal vers 500. D'autres descendent la rivière Limpopo aux ive ou ve siècles pour parvenir vers le xe siècle dans l'actuelle province du Cap oriental. Leur migration se fait par petites vagues, déplaçant cependant devant eux les populations de chasseurs-cueilleurs.
Éleveurs, les Bantous sont aussi des agriculteurs, maîtrisant, entre autres cultures, celle des céréales. Ils travaillent aussi le fer et vivent dans des villages. Ce sont les ancêtres des peuples parlant les langues nguni, xhosa, zoulou et diverses autres. Les Xhosas sont les seuls à être organisés en États pour se défendre de leurs voisins. Pour tous les autres peuples, l'unité politique ne dépasse pas le groupe de village.
Les deux cultures auraient, selon des sources limitées à l'archéologie, généralement cohabité paisiblement. On peut observer une intégration d'éléments des cultures Khoïsan par les Bantous. Outre les artéfacts archéologiques, la linguistique révèle que le clic, caractéristique des langues khoïsan, a été incorporé dans plusieurs langues bantoues.
Ier siècle : Canaries (Îles des) - Les datations au radiocarbone des trouvailles archéologique, suggèrent que les Canaries ont été peuplées pour la première fois entre le deuxième et le cinquième siècle de notre ère, les données génétiques indiquant une origine nord-africaine pour cette population indigène des Canaries. Le peuplement des îles Canaries a pu s'effectuer, en plusieurs vagues, par des populations de culture punico-berbère. La taille de la population effective ayant peuplé les îles semble relativement petite. Les données de paléogénétique montrent une différence dans les populations entre les îles occidentales et orientales. Cette différence semble exister depuis le début de la période de colonisation indigène et est restée inchangée : les îles les plus proches du continent ont une plus grande affinité avec les populations préhistoriques d'Europe, tandis que les îles occidentales s'apparentent davantage aux individus préhistoriques d'Afrique du Nord. De plus, les peuples autochtones montrent la présence d'une composante steppique, très probablement associée à la migration des populations nord-méditerranéennes vers l'Afrique du Nord au cours de l'âge du bronze ou du fer. L’ascendance de ces populations montre enfin une petite composante d’Afrique subsaharienne impliquant l’existence de migrations transsahariennes en Afrique du Nord déjà avant les premiers siècles de notre ère.
Indice de cette diversité de peuplement, les îles les plus proches du continent présentent un corpus d’inscriptions alphabétiques et de variations d’art rupestre plus diversifié que les îles occidentales. Si l'on retrouve des traces de la langue libyco-berbère dans toutes les îles, Lanzarote et Fuerteventura ont produit des inscriptions appartenant à l'alphabet dit latino-canarien qui ne sont présentes nulle part ailleurs dans l'archipel5. Un autre exemple de différences entre les régions est la présence de figuiers (Ficus carica) exclusivement à Grande Canarie, ce qui suggère que certaines différences dans le contexte culturel et biologique des colons étaient présentes depuis le début du 1er millénaire de notre ère.
Les preuves archéologiques indiquent que les connexions ultérieures entre les îles et la côte africaine étaient très limitées et que les îles sont restées pratiquement isolées jusqu'au contact avec les marins et explorateurs européens au XIVe siècle.
Sur l'archipel des Canaries vit un groupe ethnique particulier, les Guanches, d'origine berbère. Le guanche, aussi appelé berbère canarien, amazigh canarien ou tamazight insulaire, aujourd'hui disparu est la langue parlée par les Guanches des îles Canaries. Il appartient au groupe berbère de la famille des langues chamito-sémitiques. Le guanche s'éteint vers le 18e siècle, bien que de petites communautés continuent à l'employer jusqu'au 19e siècle. Des toponymes guanches sont encore conservés de nos jours, surtout les noms de communes et de lieux-dits, mais aussi en élevage, flore, ethnonymie... La langue de chaque île étant très similaire, des indigènes de certaines îles sont utilisés comme interprètes dans la conquête des suivantes.
Ier siècle : Archipel des Comores - Peuplée depuis près de deux millénaires, les différentes îles des Comores ont connu une histoire très voisine. Elle a connu plusieurs vagues de migrations. Ces îles étaient connues depuis longtemps des pirates arabes, elles sont même citées dans les contes des milles et une nuits. Un passage décrit la population autochtone qui y vit. Puis c'est la France, puissance coloniale, qui unit administrativement les îles. L'histoire des îles se sépare à nouveau après la formation en 1976 de la République fédérale islamique des Comores et le refus des électeurs mahorais de quitter le giron français.
Ier siècle : Kenya - Les premiers marchands arabes commencèrent à fréquenter les côtes du Kenya vers le Ier siècle.
Ier siècle au IV siècle : Malawi - Des peuples bantouphones s'installent dans la zone entre le Ier et le IVe siècle apr. J.-C.
Ier et IIème siècle : Mayotte - La recherche archéologique, débutée depuis les années 1970, permet de documenter les premiers siècles du peuplement de l'île. Les principaux sites archéologiques de Mayotte qui ont été fouillés par les archéologues se situent en Petite Terre (Bagamoyo) et en Grande Terre (Dembeni, Acoua). Ils apportent la preuve que très tôt, Mayotte est en relation avec le reste de l'océan Indien, en tant que véritable plaque tournante entre l'Afrique swahilie et Madagascar.
Il se dessine, au travers des sources gréco-romaines des Ier et IIe siècles (Pline l'Ancien et l'anonyme du Périple de la Mer Érythrée) que la région de l'océan Indien occidental était déjà connue, notamment pour la chasse des tortues de mer alimentant le commerce de l'écaille. Un peuplement saisonnier ou des visites ponctuelles par des pêcheurs sont donc envisageables dès le début du premier millénaire de notre ère. Les découvertes récentes du professeur tanzanien Félix Chami en Grande Comore (grotte de Malé) permettaient d'envisager un « âge de pierre » durant cette époque pré-islamique, cependant encore très peu documenté et sans trace archéologique probante à Mayotte.
Ier siècle : Ouganda - Les populations nilotiques, qui incluent les Luo et les Ateker, sont entrées dans la région par le nord, probablement aux alentours du Ier siècle de notre ère. Ce sont principalement des bergers et des agriculteurs qui se sont installés dans le nord et l’est du pays. Certains Luo ont migré dans la région du Bunyoro puis ont été assimilés avec les Bantous. Ils ont ainsi établi la dynastie des Badiito de l’actuel Omukama du Bunyoro.
19 après J.C. : Ptolémée, fils de Juba II et de Cléopâtre-Sélène, fille de Marc-Antoine et de Cléopâtre, monte sur le trône de Mauritanie. Il ne se fit remarquer que par son goût pour les plaisirs et son attachement pour les romains. Étant venu à Rome, sous Caligula, il excita par ses habillements magnifiques et par ses richesses a cupidité de ce tyran, qui le fit assassiner.
an 40 : Edémon, un des affranchis de Ptolémée, roi de Mauritanie, voulant venger la mort de son souverain, assassiné par ordre de Caligula, excite les Mauritaniens à faire la guerre aux Romains, mais ils sont vaincus après une lutte opiniâtre par Suétonius Paulinus, et la Mauritanie (Algérie et partie des royaumes de Fez et de Maroc) est réduite en province romaine et divisée en Mauritanie césarienne et Mauritanie tingitane (ans 40 à 42)
an 40 : Algérie - En 40 ap. J.-C, Rome met fin au protectorat de la Maurétanie et l'annexe. Toute l'Afrique du Nord, jusqu'aux franges du Sahara, est désormais intégrée à l'Empire romain.
Les territoires conquis par Rome et contenus dans les limites de l'actuelle Algérie étaient l'Africa nova ou Numidie pour son tiers oriental et la Maurétanie, voire les Maurétanies — césaréenne et sitifienne — selon l'époque, à l'ouest. Toutes ces provinces constitueront dans l'Antiquité tardive le Diocèse d'Afrique, avec pour siège Carthage.
Elles font l'objet d'une politique de romanisation dont les foyers sont les villes. Toutefois, en Maurétanie et dans le Sud surtout, des confédérations tribales berbères continuent à vivre plus ou moins en marge. La Numidie est plus urbanisée et romanisée que la Maurétanie. Les collectivités de base sont constituées en communes dont le statut diverge. Le statut social est très différencié dans une société qui demeure inégalitaire et esclavagiste, même si une minorité de Berbères est assimilée et accède aux privilèges du système, comme c’est le cas pour de nombreux notables et sénateurs, ou même quelques empereurs. L'ascension sociale pour la population dominée et l'accession à la propriété foncière sont parfois possibles pour ceux qui optent pour la carrière militaire.
En Afrique romaine, l'agriculture et le pastoralisme vivriers prévalent. Certaines régions, notamment la Numidie puis la Maurétanie sitifienne, deviennent rapidement des greniers à blé pour Rome. La région devient également une grande productrice de vin et d'huile. L'art romano-africain représente des modèles romains prédominants, mais avec une originalité où le substrat autochtone persiste. C'est en Afrique du Nord que l'on retrouvera les plus riches collections de mosaïques.
an 40 : Maroc - La Maurétanie perd son dernier roi Ptolémée. L'empereur Caligula, qui l'a fait assassiner à Lyon, fait face à la révolte d'Aedemon (un esclave affranchi de Ptolémée) : il faudra quatre ans pour écraser la révolte des partisans de l'ancienne monarchie maurétanienne. Le général romain Caius Suetonius Paulinus prend la tête d'une expédition militaire qui le conduit jusqu'au sud de l'Atlas, au Tafilalet et à l'Oued Guir aux portes du désert, tandis que Cnaeus Hosidius Geta poursuit la mise au pas du territoire avec des pouvoirs étendus. Claude annexe le royaume à l'Empire romain. La partie à l'ouest du fleuve Moulouya devient la province de Maurétanie Tingitane avec pour chef-lieu la cité de Tingis. La domination romaine se limite aux plaines du nord (jusqu'à la région de Volubilis près de Meknès) et l'Empire ne cherche pas à contrôler le pays brutalement : il semble que les tribus pacifiques, comme celles des Baquates, des Zegrenses ou des Macénites sont incluses dans le territoire de la province et assurent même les communications avec la Maurétanie Césarienne. Pour autant Rome doit lutter sans cesse contre les Berbères hostiles des montagnes et ceux des régions au sud du Bouregreg, comme les Autololes issus du grand peuple gétule, qui mènent selon Pline l'Ancien des raids dévastateurs jusqu'à Sala.
La Maurétanie Tingitane est une province militaire relevant directement du Conseil impérial, administrée par un procurateur issu de l'ordre des chevaliers romains. Le procurateur dispose d'une armée de 10 000 hommes comportant dix cohortes d'infanterie et cinq ailes de cavalerie, dont les effectifs sont recrutés en Hispanie, en Gaule, en Britannia, en Illyrie et en Syrie. Ces unités sont principalement réparties dans le triangle Tingis-Sala-Volubilis, dispositif appuyé par d'importants camps militaires comme ceux d'Oppidum Novum (Ksar el Kébir), de Thamusida (près de Kénitra), de Tocolosida au sud de Volubilis, et par les structures défensives de la région de Banasa dans la vallée de l'Oued Sebou. Elles assurent le maintien de la Pax Romana et la défense de la province contre les peuplades insoumises.
Des troupes berbères sont également recrutées par les Romains, mais pour défendre les frontières de l'Empire sur le Rhin, le Danube et l'Euphrate. Le plus connu de ces Africains au service de Rome est le général Lusius Quietus. Ce dernier, fils d'un chef tribal (amghar), fait carrière dans l'armée impériale romaine et se couvre de gloire au cours des campagnes militaires contre les Daces et les Parthes, conquit la Médie, l'Arménie et la Babylonie et écrase les révoltes anti-romaines de Judée. Sa puissance et son prestige deviennent tels qu'il brigue la succession de l'empereur Trajan, avec l'appui d'une partie du Sénat de Rome. L'élimination de Lusius Quietus par Hadrien, garant de la lignée des Antonins, provoque des troubles en Maurétanie Tingitane, sa province d'origine où il jouissait d'une extrême popularité parmi les tribus maures. Hadrien est contraint d'envoyer Quintus Marcius Turbo réunir les deux Maurétanies avec un rang de légat à titre exceptionnel et provisoire pour réprimer les soulèvements berbères.
Les colonies et les municipes de la Tingitane adoptent le schéma romain classique, avec avenues rectilignes, forum, arc de triomphe, basilique, théâtre (à Lixus et Zilil), capitole, et temple dédié au culte de la Triade capitoline (Jupiter, Junon, Minerve). Des quartiers résidentiels destinés aux classes sociales favorisées sont également bâtis à proximité des monuments officiels. La cité de Volubilis, la plus connue de la Maurétanie Tingitane, compte à son apogée jusqu'à 12 000 habitants dont une forte proportion de Romano-africains, ainsi que des Romains originaires d'Italie et d'Hispanie, des Grecs d'Asie, des Judéens et des Orientaux venus de Palmyrène et de Nabatène. Certaines familles de l'aristocratie locale réalisent de brillantes carrières, au point d'envoyer leurs membres siéger au Sénat romain. Les campagnes proches sont mises en valeur par les grands propriétaires terriens également issus de cette aristocratie provinciale, et les terres plus lointaines laissées au parcours des pasteurs nomades et semi-nomades. La richesse agricole principale de la Tingitane est l'huile d'olive, largement exportée dans le reste de l'Empire. Les plaines produisent aussi du blé et des fruits en grande quantité, et les forêts sont exploitées pour le bois de cèdre et de thuya. Toutes ces substances sont acheminées vers les ports, surtout ceux de Tingis, Thamusida et Sala qui connaissent une très forte activité commerciale. Les produits maritimes issus de la pêche (tels que le garum) constituent également une part importante de l'exportation, comme au temps des Carthaginois. Des animaux sauvages (lion de l'Atlas, ours de l'Atlas, panthère de Barbarie) sont capturés pour être expédiés à Rome pour les Jeux du Cirque.
Au même titre que le reste de l'Afrique et de l'Empire, la Maurétanie Tingitane va connaître la christianisation. Des dizaines d'évêchés couvrent la région, s'adressant d'abord aux populations romaines des villes puis aux romanisés des campagnes, en dépit des persécutions infligées par les autorités impériales.
an 43 : Canaries (Îles des) - Epoque romaine
Le géographe Pomponius Mela fournit vers +43 une Description de la Terre et une Chorographie assez sommaires (hors Méditerranée).
À la suite de ses prédécesseurs Posidonios d'Apamée et Marinos de Tyr, Ptolémée, dans sa Géographie (traité rédigé vers 150), considère que ces îles sont à la limite occidentale du monde habité (avec Thulé au Nord, pour mesurer la latitude). Selon Ptolémée, l'écoumène s'étend entre la latitude 63° Nord (pour Ptolémée, il s'agit du parallèle de Thulé) et celle de 16° 25’ Sud (le parallèle d’Anti-Meroe, la côte orientale de l'Afrique), couvrant 180° en longitude. La localité le plus à l'Ouest, où il place le méridien de référence, se trouve sur les îles « Fortunata » (îles des Bienheureux), généralement associées aux îles Canaries, sans doute El Hierro ou Île du Méridien : méridien de Ferro.
46-126 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Antiquité : Selon l'historien gréco-romain Plutarque (46-125), Quintus Sertorius (126-72), magistrat et militaire romain, marianiste, gouverneur romain en Hispanie, initiateur de la guerre sertorienne (80-72), après des interventions en Maurétanie et en Lusitanie, aurait pu mener des repérages maritimes, du côté des Îles des Bienheureux.
an 68 : Lucius Clodius Macer était gouverneur romain de la province d'Afrique (legatus Augusti propraetore Africae).
En l'an 68, Vindex, gouverneur de Gaule lyonnaise, lança la révolte contre l'empereur Néron, avec le soutien de Galba, gouverneur de la Tarraconaise. Rapidement Othon, gouverneur de Lusitanie, se joignit aux rebelles.
Les événements d'Europe décidèrent Lucius Clodius Macer à se révolter contre l'empereur lui aussi en avril 68. Il ne se joignit pas toutefois à Galba et Vindex, parce que lui-même espérait devenir empereur. Clodius Macer créa une nouvelle légion en Afrique : la Legio I Macriana liberatrix. De plus il avait à sa disposition la Legio III Augusta qui était stationnée dans sa province. Clodius Macer conquit Carthage, port dont l'importance était vitale pour approvisionner Rome en grains d'Afrique du Nord. Il en fit arrêter l'expédition vers la capitale, ce qui y suscita des troubles.
Le 11 juin, Néron se suicida et Galba, âgé de 72 ans, fut proclamé le nouvel empereur de l'État romain par les prétoriens (ans 68 et 69). En octobre il arriva à Rome et fit assassiner Clodius Macer le même mois par Trebonius Garutianus. La légion de Macer fut dissoute par Galba peu de temps après.
an 69 : Galba et son fils adoptif, Licinius Pison, sont massacrés.
an 98 : La plus grande étendue de l'empire romain sous Trajan : depuis l'Atlantique jusqu'au Tigre, et depuis le mur d'Antonin dans la Grande-Bretagne, le Danube, les monts Karpathes et la mer Noire jusqu'aux déserts de l'Afrique et de l'Arabie. Il y avait près de 600 lieux du nord au midi et plus de 1 000 d'orient en occident (180 000 lieues carrées)
En Afrique les possessions romaines étaient l'Egypte et toute la côte septentrionale.
Antiquité 100 à 300 ans : Somalie - Le territoire de la Somalie et les côtes somaliennes sont l'une des localisations envisagées pour le pays de Pount, un pays avec lequel l'Égypte pharaonique entretenait des relations commerciales.
D'autres éléments attestent de l'activité commerciale des ports de la côte somalienne dès l'Antiquité. Ainsi, pour George Wynn Brereton Huntingford, le récit grec intitulé Le Périple de la mer Érythrée (en grec polytonique : Περίπλους τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης / Períplous tî̄s ̓Erythrâs thalássīs ; en latin : Periplus maris Erythraei), communément daté du début du Ier siècle, ou du IIIe siècle, mentionne la côte somalienne : cette région est connue par les navigateurs et commerçants Grecs, Romains et Indiens. Dans ce Périple de la mer Érythrée, une ville portuaire appelée Opone (en grec ancien Ὀπώνη) est décrite, par exemple. Une correspondance est généralement établie entre cette ville portuaire et la ville désormais intitulée Hafun5. Ce port est situé à un point stratégique pour les routes commerciales par voie marine passant par la mer Rouge, à proximité de la pointe de la Corne de l'Afrique. Depuis cette ville, des échanges commerciaux étaient menés avec le Yémen, la Phénicie, la Grèce, Rome, l'Azanie, et l'Asie.
Les sources grecques utilisent le terme de « Berbères » pour désigner la Corne de l'Afrique et ses habitants, tout comme les premiers géographes arabes désignaient les Somaliens comme des «Berbères (noirs)»
fin Ier siècle : Kenya - À la fin du Ier millénaire, arrivèrent, de l'ouest, des peuples bantous.
IIème siècle : Algérie - À partir du IIe siècle, les ateliers locaux se multiplient : Timgad, Lambèse, Sitifis (Sétif), Cuicul (Djemila), Caesarea (Cherchell). On atteste également, en Algérie, un plus grand nombre d’inscriptions latines que dans n'importe quelle autre province du monde romain.
La conquête de l'Afrique coute cher aux Romains et les oblige à mobiliser de nombreuses légions. Les Africains se soulèvent à plusieurs reprises pour remettre en cause leur domination. Parmi les régions sensibles, certaines parties de la Maurétanie césaréenne, et parfois le Sud constantinois et l'Aurès-Nementcha.
Le christianisme se développe en Afrique romaine à partir du IIe siècle. Les premiers chrétiens subissent des persécutions dont l'enjeu est l'adhésion de l'ensemble des habitants de l'Empire romain au culte de l'empereur-dieu.
IIème - XIème siècle : Sénégal - IIème au XIème siècle : Empire du Ghana
an 115 : André, juif de Cyrène, soulève ses compatriotes contre les Romains, et leur permet de les faire rentrer triomphants à Jérusalem. Il se voit bientôt à la tête d'une armée, remporte plusieurs avantage sur Lupus, préfet d'Egypte, qu'il force à se renfermer dans Alexandrie et qui se venge par le massacre de tous le Juifs de cette cité. Par représailles, André envahit la Libye, dont il immole, dit-on, plus de 200 000 habitants.
an 117 : Mort de Trajan. Adrien (Publius Aelius Adrianus ou Hadrianus), cousin germain de Trajan, est élu empereur des Romains.
Adrien réprime, par lui-même ou par ses généraux, des révoltent en Égypte et en Mauritanie.
an 120 : En Égypte, Adrien bâtit la ville d'Antinopolis, en l'honneur de son cher Antinous
an 138 : Adrien meurt à Baies. Antonin-le-pieux, son fils adoptif, lui succède sur le trône à l'âge de 52 ans (131-161)
an 144 : Les Maures, peuple indépendant de la Libye, attaquent l'empire Romains et sont repoussés par Antonin.
an 150-250 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - La région côtière, au contraire, a subi ses premières influences étrangères dès l’Antiquité.
Rhapta, ancienne ville marchande que l’on situe quelque part entre la région de Tanga et le delta du fleuve Rufiji, tout au sud de l’antique territoire de l’Azanie, était un centre marchand familier des commerçants de l’époque romaine en provenance notamment de Grèce, d’Égypte, de Phénicie...
Mais ce sont avec les marchands en provenance de la péninsule Arabique, du Golfe Persique et d’Inde que les relations ont été les plus fortes. Les navires, les fameux boutres, poussés par les vents de la mousson, parvenaient à Zanzibar vers décembre en provenance des Indes et de la péninsule arabique. En mars-avril, ils repartaient grâce aux alizés soufflant du sud-est.
Les commerçants ont très tôt compris l’intérêt que pouvait présenter cette côte africaine pour s’approvisionner en or, en ivoire, en bois précieux, en peaux, en cire et peut-être déjà en esclaves.
La région côtière et les îles sont à l’époque habitées par des tribus bantoues africaines, et les interactions entre ces populations indigènes et les marchands perses et arabes ne semblent pas très hostiles. Un manuel grec pour les navigateurs datant du début de notre ère, le Périple de la mer Érythrée (vers 150-250), évoque déjà ces marchands parlant la langue locale et mariés à des femmes africaines.
IIIème siècle : Algérie - Au IIIe siècle, le martyrologe (livre liturgique, recueil de brèves notices sur les saints à fêter. Le martyrologe chrétien peut également contenir des prières de bénédiction ou de consécration. Le terme ne signifie pas seulement « liste des martyrs », mais désigne aussi toute liste liturgique des personnages reconnus saints par l'Église, personnages qui ont « porté témoignage » de leur foi chrétienne) s'allonge sur tout l'espace de l'actuelle Algérie
IIIème siècle à an 533: Libye - Durant le premier tiers du IIIe siècle, l'empereur Dioclétien sépare la Cyrénaïque de la Crète et la divise en deux provinces, la Libye sèche et la Libye Pentapole. À l'ouest, une province de Tripolitaine est créée. À cette époque, la sédentarité des populations commence à s'affaiblir et à céder à nouveau la place à un nomadisme agricole et pastoral. La Tripolitaine perd de sa fertilité, notamment semble-t-il du fait de la surexploitation des sols. Durant le Ve siècle, les provinces libyennes sont attaquées par les Vandales, qui occupent Sabratha et isolent Oea et Lepcis Magna. Un siècle plus tard, vers 533, le territoire est reconquis par l'Empire byzantin, mais le pays est durablement appauvri. Si la domination byzantine sur les Libyens prend parfois un tour brutal, le christianisme progresse à l'époque en Libye.
an 217 : Macrin (Marcus Opelius de Césarée (Alger) en Numidie est proclamé empereur (ans 217 - 218)
an 237 : Gordien, proconsul d'Afrique, et son fils, aussi nommé Gordien, sont proclamés empereurs par les légions et presque aussitôt vaincus et tués par Capellianus, gouverneur de Numidie.
an 263 : Expédition des Francs dans la Gaulle et en Espagne jusqu'à Tarragone. Quelques-uns passent même en Afrique.
an 265 : Celsus est proclamé empereur par les soldats d'Afrique et massacré sept jours après. Son corps est livré aux chiens par les habitants de Sicca, qui étaient restés fidèles à Gallien.
an 269 : Conquête de l'Egypte par Zabdas, général de Zénobie
an 273 : Firmus, riche marchand de Séleucie, en Syrie, s'étant fait proclamer empereur en Égypte et vengeur de Zénobie, est pris et mis à mort par Aurélien. Destruction du musée d'Alexandrie.
an 277 : Expédition d'un corps de Francs sur les côtes d'Asie, de la Grèce, de la Sicile, de l'Afrique et de l'Espagne
an 273 : Saturninus, général romain des légions d'Afrique, s'étant fait proclamer empereur, est pris et tué dans le château d'Apamée, en Syrie.
an 292 : Nouveau partage de l'Empire romain : Maximien obtient l'Italie, l'Afrique et les îles intermédiaire.
an 293 : Achillée, général romain, qui s'était fait reconnaître empereur en Égypte, est pris dans Alexandrie par Dioclétien, après un siège de huit mois. La ville est livrée au pillage et Achillée est condamné à être dévoré par les lions. Julien, usurpateur de l'Afrique, est défait par Maximien.
an 298 : Maroc - A Tingis, sous le règne de Dioclétien, le centurion Marcellus est décapité, ce qui en fait un martyr plus tard canonisé sous le nom de saint Marcel, de même que Cassien de Tingis considéré également comme saint par l’Église catholique et par l’Église orthodoxe. Six évêchés ont été recensés en Tingitane (à Tingis, Septem, Zilil, Lixus, Tamuda et Sala). La diffusion du christianisme demeure cependant très faible dans la province, en comparaison des autres régions de l'Afrique romaine. La communauté chrétienne de Tingitane semble demeurer fidèle au catholicisme et reste en dehors de la querelle du donatisme qui agite les provinces voisines, notamment l'Afrique proconsulaire et la Numidie.
Au IIIe siècle, l'Empire romain recule territorialement. C'est notamment le cas en Afrique du Nord et particulièrement à l'ouest : la Maurétanie Tingitane se trouve réduite à Tingis et à sa région. Elle est d'ailleurs rattachée administrativement au diocèse d'Hispanie, relevant lui-même de la préfecture des Gaules. Les cités de la province sont presque toutes évacuées par les autorités officielles (Volubilis comprise) en 285 sous le règne de Dioclétien. Au sud du fleuve Loukkos les Romains conservent toutefois Sala et les îles purpuraires de Mogador.
IVème siècle : Algérie - Avec la conversion des empereurs eux-mêmes au christianisme au IVe siècle, l'Église catholique, fait de plus en plus fonction de culte officiel, et apparait comme l'instrument idéologique de la domination romaine. Le Donatisme émerge alors comme une Église nationale à laquelle se rallient en grand nombre les Berbères, et dont l'idéologie s'oriente vers un radicalisme social proche du millénarisme. L'insurrection des circoncellions, un mouvement social se réclamant du donatisme, marque la Numidie et la Maurétanie aux IVe et Ve siècles. Ces soulèvements de déshérités facilitent l'invasion vandale et, sur le moyen terme, l'installation finale de l'islam.
IVème siècle : Eswatini (Swaziland) - Au IVe siècle, les peuples bantous migrants d'Afrique centrale, ont commencé progressivement à repousser les Khoisans vers le sud-ouest de l'Afrique australe.
IVème siècle : Mali - Empire du Ghana aussi nommé Ouagadou, il est érigé par les Sarakolés au IVe siècle. Il fonde sa prospérité sur le sel et l'or. L'empire se désagrégera en 1076 à la suite des percées des berbères venus islamiser l'Afrique occidentale.
IV au XIII ème siècle : Mauritanie - Moyen-Âge
Le haut Moyen Âge est une période de refroidissement climatique, propice au développement de l'économie d'oasis dattières couplées au développement du grand commerce transsaharien chamelier. Les routes commerciales qui relient le bassin occidental méditerranéen (Al-Andalus, Gaule) aussi bien que l'Ifriqiya, l'Italie et le Moyen-Orient aux cités africaines pourvoyeuses d'esclaves, d'or, de sel (Tekrour sur le Sénégal) et à Koumbi Saleh (Ghana), sont donc une source de revenus pour les confédérations nomades et leurs tributaires sédentaires.
Les cités caravanières d'Aoudaghost et de Oualata dans le Hudh ont dû voir le jour dans ce contexte primitif, elles passent sous contrôle de "l'empire" soninké de Ghana.
* Empire du Ghana (300-1200 environ)
* Émirat de Sijilmassa (758-1055)
* Royaume du Tékrour (800-1285)
* Anciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata, Laâyoune
IVème siècle : Soudan - À la seconde moitié du IVe siècle de notre ère, des incursions répétées du royaume d'Aksoum entament le royaume de Méroé. C'est à cette époque que l'on situe traditionnellement sa chute sous les coups des rois Ella-Amida et Ezana d'Éthiopie. Construction des sites et monuments de Dakka, Qasr Ibrim, Tabo, Méroé, Musawwarat es-Sofra, Naga, Wad ban Naqa (en), Basa, El-Hassa, Hosh-Ben-Naga, Djebel Qeili, Soba et Khartoum. Développement des cultes des dieux soudanais : Dédoun « le premier de Nubie », Apédémak « le grand dieu du Sud », Arsénouphis et Mandoulis. Nécropole de pyramides royales à Méroé ; dernière sépulture royale méroïtique aux environs de 350 de notre ère.
IVème siècle : Zambie - Les premiers habitants de la Zambie étaient des San vivant de chasse et de cueillette. À partir du IVe siècle de nombreux peuples de langue bantoue s’installent et forment des chefferies, sortes de principautés autonomes ; ils se distinguent des premiers habitants par leur maîtrise de l'agriculture, ils possèdent aussi l'art de la confection de poteries et d'armes. La propriété privée n’est pas connue et la terre est toujours cultivée en collectivité.
an 305 : Après une grande famine qui désole l'empire romain. Nouveau partage :
Maximin, César, eut l'Orient et l'Egypte
Flavius-Sévère, César, eut l'Italie et l'Afrique
an 311 : Le Phrygien Alexandre, qui s'était fait proclamer empereur en Afrique, est défait et tué à Carthage par les troupes de Maxence, qui, maître de l'Italie, déclare la guerre à Constantin.
an 330 : Empire Romain et l'Afrique - Étendue de l'empire romain sous Constantin-le-Grand
Provinces orientales : Syrie, Palestine, Égypte, Chypre, Asie-Mineure, Grèce, Macédoine, Thrace, Épire, Illyrie.
Provinces occidentales : Afrique septentrionale, Espagne et Portugal, Italie, Sicile, Sardaigne, Corse, France, Pays-Bas, Suisse, Allemagne (en partie), Pannonie, Grande-Bretagne (en partie).
an 330 : Éthiopie - Vers 330, Ezana, négus d'Aksoum, se convertit au christianisme, qui devient la religion officielle, adoptée par la population locale majoritairement juive et païenne.
an 338 : Après la mort de Constantin-le-Grand en 335, et après des années de débats, l'empire est partagé entre les trois fils de Constantin-le-Grand :
Constance (337-361) obtient la Thrace, l'Asie jusqu'à Nisibe et l’Égypte.
Constant (337-350) obtient l'Illyrie, l'Italie et l'Afrique septentrionale.
Constantin II (337-340) obtient la Gaulle, l'Espagne et la Bretagne
an 373 : Théodose réprime la révolte de Firmus, chef des Maures d'Afrique. Il signale le préfet Romanus comme ayant donné lieu par ses exactions à la révolte des Africains.
an 375 : Gratien, âgé de 16 ans, fils de Valentinien Ier (364-375), déjà nommé Auguste en 369, obtient sa nomination d'empereur de la Bretagne, la Gaulle et l'Espagne. Son frère Valentinien II, âgé de 4 ans, est nommé empereur de l'Italie, l'Illyrie et de l'Afrique (375-392), sous la tutelle de l'impératrice Justine, sa mère.
an 395 : Sous la tutelle de Rufin, Arcadius, âgé de 18 ans, fils de Théodore Le Grand, empereur d'Orient comprenant :
- une partie de l'Asie : les contrées situées en deçà de l'Euphrate, les côtes de la mer Noire et de l'Asie Mineure
- en Afrique : l'Egypte
- En Europe : tous les Pays jusqu’à la mer Adriatique et le Danube
Capitale : Constantinople
Sous la tutelle du vandale Stilicon époux de la nièce de Théodore Le Grand, Honirius, âgé de 11 ans, fils de Théodore Le Grand, empereur d'Occident
Vème siècle : Zambie - Une activité métallugirque de transformation du minerai de cuivre commence dès le Ve siècle, au nord de l'actuel territoire de la Zambie.
an 400-600 : Zaïre Congo Kinshasa - Il semblerait que les phases d'expansion bantoue aient été séparées par un effondrement généralisé de la population entre 400 et 600 de notre ère. Coïncidant avec des conditions climatiques plus humides, l'effondrement a peut-être été favorisé par une épidémie prolongée. Cet écroulement démographique est suivi par une réinstallation majeure des siècles plus tard. Les recherches archéologiques et paléogénétiques montrent que la vague initiale de communautés parlant supposément des langues bantoues à l'âge du fer ancien a largement disparu de toute la région de la forêt tropicale du Congo vers environ 600 de notre ère, avec la persistance de seulement quelques populations dispersées. Le déclin de la population a été rapide entre ~ 400 et 600 de notre ère, puis s'est poursuivi à un rythme plus lent pour finalement aboutir à environ 400 ans d'activité sédentaire très limitée (~ 600 à 1000 de notre ère) avant qu'une deuxième vague d'immigration et de nouveaux établissements se développent à l'âge du fer tardif.
an 400 à 900 : Érythrée - Vers 1000 av. J.-C. jusqu'à environ 400 apr. J.-C., le royaume de Saba était un État situé entre les actuels Yémen, Érythrée ou le Nord de l'Éthiopie selon les périodes.
Par la suite, D'mt (800 av. J.-C. à 600 av. J.-C.) était un État qui s'étendait sur l'actuelle région de l'Érythrée et le Nord de l'Éthiopie.
Le royaume d'Aksoum (100 av. J.-C. à 990 apr. J.-C.) était quant à lui un État commercial important. Il aurait recueilli l'Arche d'alliance, ramenée par Menelik Ier, le fils du roi Salomon et de la reine de Saba. Aksoum a été également le premier grand empire à se convertir au christianisme.
an 406 à 429 : Maroc - Profitant de ce grave affaiblissement de l'Empire romain d'Occident, une coalition de barbares en majorité germaniques, formée de Suèves, de Vandales mais aussi d'Iraniens, principalement des Alains, traverse le Rhin en 406. Les Vandales descendent alors en Espagne et passent en Maurétanie en 429, débarquant sur la rive africaine des Colonnes d'Hercule, probablement près de Tingis. Dirigés par leur roi Genséric, ils se dirigent rapidement vers Carthage qui devient la capitale de leur nouveau royaume. Il faut attendre 533-534, pour que s'engage la campagne d'Afrique, dite guerre des Vandales, décidée par l'empereur byzantin Justinien Ier, avec une puissante armée commandée par le général Bélisaire. Le corps expéditionnaire byzantin anéantit le royaume vandale et déporte ses élites en Asie mineure. La pacification du territoire reconquis est plus laborieuse à l'intérieur des terres et se heurte à la pugnacité des Maures, notamment ceux de l'ouest de l'Afrique du Nord.
La Maurétanie Tingitane n'est pas réellement concernée par l'expansion du royaume vandale, qui ne contrôle en effet localement que quelques points des côtes méditerranéennes du Rif, et concentre plutôt ses efforts à l'est et en direction des îles comme les Baléares, la Corse, la Sardaigne ou la Sicile.
an 429 : Algérie - 80 000 Vandales et Alains, dont 15 000 soldats, conduits par leur roi Genséric, traversent le détroit de Gibraltar pour passer en Afrique romaine. Les tribus berbères ne s'opposent pas à cette invasion, dont le choc est perçu comme le glas de la domination romaine, au contraire de la position des notables citadins. L'Armée romaine dirigée par le comte Boniface, est vaincue entre Calama et Hippone.
an 429-578 : Maroc - Royaume des Maures et des Romains (429-578)
an 430 : Genséric conquit successivement toute la partie de l'Afrique qui relevait de l'empire de l'Occident, depuis le détroit de Cadix jusqu'à la Cyrénaïque, qui dépendait de l'empire d'Orient, il subjugue aussi les îles Baléares, la Sardaigne, la Corse et une partie de la Sicile.
an 430 : Algérie - Le général romain et son armée trouvent refuge dans la cité de Hippone (Annaba). À la fin de l'année, les conquérants vandales prennent et occupent la ville, qui devient pour un temps la capitale de Genséric.
an 435 : Valentinien III cède à Genséric la Byzacène (États de Tunis) et la Numidie
an 435-534 : Maroc - Royaume des vandale (435-534)
an 439 : Genséric s'empare de Carthage, qui devient la capitale des Vandales. Il fait construire une flotte considérable, à l'aide de laquelle il ravage sans relâche les côtes de l'empire d'Orient et de l'empire d'Occident.
an 439 à 534 : Tunisie - La Tunisie littorale devient une province romaine. Bien protégée et bien aménagée grâce à l'irrigation, elle devient un des greniers à blé et à huile d'olive de Rome. Carthage rebâtie par Jules César devient rapidement un centre intellectuel et religieux. La Tunisie devient chrétienne et fournit des penseurs très importants du christianisme en particulier Saint Augustin.
En 439, les Vandales s'emparent de la Tunisie qui devient le centre de leur royaume; elle est reprise par les Byzantins en 534.
an 442 : Algérie - Le roi des Vandales Genséric signe un second traité de paix avec Valentinien III, approuvé par Théodose II : il obtient les pleins droits pour diriger la province romaine d'Afrique proconsulaire, Byzacène, et l'est de la Numidie. La partie occidentale de la Numidie et les Maurétanie Sitifienne et Césarienne retournent à l'Empire.
Les Vandales, attachés sur le plan religieux au rite chrétien arien, se distinguent par des persécutions contre les catholiques. Les Berbères, christianisés par Rome, réagissent de façon différenciée à la chute de Rome, puis des Vandales, et à l'instabilité durant la période byzantine. Certains s'enfuient notamment en Sicile.
La présence vandale n'influence pas les structures sociales existantes. Elle laisse surtout place à une reconquête par les pouvoirs locaux de ses occupants libyco-berbères originels. Ainsi, plusieurs principautés maures vont émerger, dont la plus constituée est celle d'Altava dans l’actuel Oranie, mais on atteste également d’autres principautés dans l'Aurès-Nementcha et dans le Hodna, au centre de la Maurétanie, où une vaste principauté maure s'établit de l'Ouarsenis à la côte, de Césarée (Cherchell) à l'embouchure du Chélif. Les vestiges qu'on nomme Djeddar, témoigne de cette époque.
Byzance envisage de reconstituer l'Empire romain, et le royaume vandale disparaît à la suite d'une intervention militaire dirigée en 533 par son général Bélisaire, qui défait le roi vandale Gélimer. Les Byzantins tentent de ressusciter les circonscriptions romaines. Le Diocèse d'Afrique est structuré en sept provinces dont quatre Praesides répartis entre la Sardaigne, la Numidie, et enfin les Mauritanies Sitifienne et Césarienne, cette dernière étant réduite au contrôle de quelques ports ; elle sera rattachée plus tard à la Sitifienne. Le système évolue pour donner naissance à l'Exarchat, plus proche d'un pouvoir militaire.
Les principautés maures de Maurétanie ne disparaissent pas totalement. Le pouvoir byzantin demeure lâche, limité à quelques villes qu'il s'attache à fortifier. Dès le départ de Bélisaire, les Berbères se révoltent en Byzacène et une autre révolte éclate en Numidie, conduite par le roi des Aurès Iabdas. Les Byzantins déploient des persécutions contre les donatistes, les adeptes du rite arien, les païens et les juifs. Leur politique entraîne des conversions nouvelles au donatisme, et même au judaïsme.
an 450 : Soudan - Royaumes post-méroïtiques : en 450, alliance des Nobas et des Blemmyes contre Rome pour la défense de leurs lieux de cultes dont l'île de Philæ était le principal sanctuaire. En 453, signature d'un traité de paix entre les belligérants autorisant les soudanais à pratiquer leur culte d'Isis librement. Sépultures royales d'El-Hobagi et nécropoles de Qoustoul et Ballana.
an 477 : Mort de Genséric. Hunéric, son fils, lui succède (477-484). Décadence du royaume des Vandales. Persécution des catholiques.
an 484 : Gondamond, roi des Vandales (484 - 496), persécute aussi les catholiques
an 496 : Thrasimond, roi des Vandales (496 - 523). Il favorise les catholiques, rappelle les évêques exilés et leur rend leurs églises. Premiers envahissements des Maures (habitants de Mauritanie)
VIème siècle : Archipel des Comores - Les premières traces de peuplement datent du VIe siècle, il s'agit probablement de Bantous provenant de la côte africaine, appelé Antalotes (abusivement dénommés bushmen par les Européens). Ces premiers habitants mettent en place une organisation politique et sociale proprement africaine. Mayotte et Anjouan, plus difficiles d'accès du fait de leurs barrières de corail, ont été occupées apparemment plus tardivement, et les deux îles se différencient de l'ensemble des Comores par une évolution linguistique spécifique. On suppose que les Austronésiens qui contribuent au peuplement de l’île de Madagascar sont passés par les Comores entre le VIIe et le XIIe siècle mais ne s’y sont principalement installés qu'à Mayotte.
Les auteurs et navigateurs antiques (égyptiens puis grecs et latins) ne semblent pas bien connaître la région au sud de la Somalie ; Pline l'ancien mentionne au sud de l'Erythrée une ville appelée « Damnia » dans laquelle certains chercheurs comme N. Chittick croient reconnaître Domoni, mais aucune preuve archéologique n'atteste ce rapprochement. Il semble cependant que les navigateurs de l'antiquité ne tenaient pas à dépasser le Cap Delgado (frontière entre la Tanzanie et le Mozambique), au-delà duquel la navigation était plus complexe et le retour non assuré. Le Canal du Mozambique semble donc être resté relativement à l'écart du commerce international jusqu'au VIIIe siècle. Les proto-malgaches, venus de la région malaise ont pour leur part pu atteindre Madagascar dès le IVe siècle, suivis par les néo-indonésiens à partir du XIe siècle.
Cependant, des recherches archéologiques menées par le professeur Felix A. Chami (en) dans l'île de la Grande Comore suggèrent que l'île aurait été habitée bien plus tôt qu'on ne le pense « environ 3000 ans avant Jésus-Christ ».
Initialement, les villages sont régis par les doyens que sont les chefs des familles les plus influentes ou les chefs de villages. Ils portent le titre de mafé, mfaume ou mafani à Anjouan ou Mohéli (Mfalume en kiunguja). Les mafés laissent la place assez rapidement à des Mabedja qui forment une chefferie dirigeante dans chaque village.
VI - XV ème siècles : Ile Maurice - Les Arabes découvrirent probablement l'île Maurice au Moyen Âge, à une date inconnue. Ils en connaissaient en tout cas l'existence, puisque le planisphère de l'Italien Cantino, produit en 1502, fait apparaître l'île Maurice sous le nom arabe de Dina Arobi (île abandonnée) et l'île Rodrigues sous le nom de Dina Mozare (île de l'Est).
an 500 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - vers 500, arrivent d'Afrique centrale les artisans du fer et agriculteurs Bantous Gokomere qui s'installent sur le lieu du futur Monument national du Grand Zimbabwe, berceau du peuple des Shonas, vraisemblablement édifié entre le IXe et le XIIIe siècle. Les Bantous forcent sur cette même période la majorité de l'ethnie San, peuple nomade de l'Afrique australe, à émigrer à l'ouest ou à être réduits en esclavage.
an 523 : Hildéric, roi des Vandales (523 - 531). Il favorise les catholiques de même que son prédécesseur
an 530 : Soudan - Vers 530, le temple d'Isis à Philæ est fermé définitivement et la christianisation des royaumes post-méroïtiques des Blemmyes (vers 550), des Nobades (vers 570) et des Nobas (vers 580) se poursuit. Après le déclin de Méroé, trois royaumes chrétiens se forment au VIe siècle : ceux de Makurie et de Nobatie, qui s'unissent ensuite pour former le royaume de Dongola, et celui d’Alodie (ou Aloa), plus au sud. Construction d'églises et de monastères et rapprochement de l'Église soudanaise et de l'Église copte d'Égypte. Vers 640, la conquête arabo-musulmane de l'Égypte isole ces royaumes du reste du monde chrétien. Les royaumes chrétiens s’effondrent entre le XIVe et le XVIe siècle. Les Arabes baptisent alors les terres situées au sud de l’Égypte Bilad-al Sudan, le pays des Noirs.
an 531 : Gelimer, parent d'Hildéric, roi des Vandales, excite le peuple contre lui à cause de la protection accordée aux catholiques et se fait proclamer roi (531 - 534). Hildéric est fait prisonnier.
an 534 : L'empereur Justinien, ami d'Hildéric, ancien roi des Vandales, ne pouvant obtenir sa mise en liberté de Gélimer, déclare la guerre à ce dernier. Bélisaire débarque en Afrique, remporte sur les Vandales une grande victoire près de Tricamarum, à la suite de laquelle il s'empare de tout le royaume. Gélimer lui-même est pris et conduit à Constantinople, où il orne le triomphe du vainqueur. Fin du royaume des Vandales, après une durée de 105 ans.
an 534 : Maroc - Quand la région passe sous domination byzantine en 534, les Maures habitués à une indépendance réelle depuis plus d'un siècle résistent farouchement autour de Garmul, chef charismatique qui se proclame roi des Maures et des Romains, avec une sphère d'autorité s'étendant d'Altava à Volubilis et sur les confins maurétaniens. Ses forces harcèlent avec succès les légions de Bélisaire repoussées vers la péninsule tangéroise.
Les Byzantins organisent malgré tout l'extrême Nord marocain, autour de Ceuta (Septem Fratres) et de Tanger en province de Maurétanie Seconde, administrée par un comes (comte) dont le pouvoir s'étend également sur le sud de l'Hispanie (Espagne byzantine) pris aux Wisigoths. Les comtes de Maurétanie Seconde dépendent théoriquement de l'exarque de Carthage qui incarne la plus haute autorité byzantine en Afrique du Nord. La province connaît un renouveau économique et démographique non négligeable.
an 534-585 : Maroc - Préfecture du prétoire d'Afrique (534-585)
an 541 : Sous la domination de Cosroès-le-Grand, qui ne brille pas moins par sa sagesse que par ses exploits, la Perse s'étendait depuis la Méditerranée jusqu'à l'Indus, et depuis l'Iaxartes jusqu'en Arabie et à la frontière d'Egypte. Bouzzi-Dchoum-Hour, son premier ministre.
an 554 : Conquête de la côte méridionale de l'Espagne jusqu'au détroit de Gibraltar, par Patrice Libérius, envoyé par l'empereur Justinien au secours d'Athanagilde, contre Agila, roi des Visigoths.
an 591-698 : Maroc - Exarchat de Carthage (591-698) (Afrique byzantine, Empire byzantin),
VIIème siècle : Archipel des Comores - L'archéologue Felix A. Chami (en) s'est préoccupé de l'histoire de l'islam dans ce pays. En attendant la validation de ses travaux par la communauté scientifique, le 5 décembre 2010, à en croire le professeur, des fouilles archéologiques menées dans une ancienne mosquée comorienne ont révélé trois fondations superposées au sous-sol. La première fondation est celle d'une mosquée qui date du XIIIe siècle. La seconde dont les traces de la niche (mihrab) et de la chaire (minbar) sont nettement visibles, a fourni des matériaux datant du VIIe siècle, notamment des écritures gravées sur des poteries et autres objets déterrés à ce niveau. Si cela devait se confirmer, la thèse de l'islamisation des Comores remonterait au VIIe siècle apr. J.-C.
D'après le professeur Mohamed Bajrafil : « l’islam s’y est installé depuis sa primeur. La légende des deux dignitaires comoriens partis en terre sainte, à La Mecque, à la rencontre du prophète pour se convertir à la nouvelle religion, est aujourd’hui en partie corroborée par les fouilles archéologiques récemment effectuées dans la ville de Ntsaoueni, dans le Nord de l’île de la Grande Comore, qui prouvent de manière définitive que l’islam est bien arrivé aux Comores dès le premier siècle de l’ère hégirienne. Peu importe, dès lors, que ce soit par Mtswa Muindza et Fé Bédja, lesdits dignitaires, ou par d’autres qu’il y ait élu domicile ».
L’élément important, dans cette donnée nouvelle, est que l’islam serait dans ce pays aussi ancien que l’instauration des premières populations. Il est un des ciments de la société comorienne, dont il régit une partie non négligeable de l’organisation, tant au niveau des mœurs qu’à celui de la justice, notamment la justice civile. Cependant, la présence de tombes médiévales non orientées vers la Mecque (notamment à Mayotte) indiquerait des rites non-islamiques jusqu'à une période plus tardive : l'islam serait ainsi longtemps demeuré la religion des élites (souvent d'origine étrangère : persane, puis omanaise et zanzibarienne), tandis que le peuple et surtout les esclaves serait demeuré dans des religions primitives progressivement teintées de syncrétisme.
L'arrivée des Perses - Archipel des Comores -
Les sépultures de rite musulman découvertes à Mayotte dans la nécropole de Bagamoyo témoignent de l'arrivée des marchands perses de passage, originaires de Chiraz, dont la chute a provoqué une vague d'émigration dans le sud de l'Iran actuel, qui constituent les premières communautés musulmanes de l'archipel. Ces lignées princières chiraziennes, les Qabilas, originaires de la côte swahili fondent en effet les premiers sultanats, s'établissant dans les villes côtières fortifiées (Mutsamudu et Domoni à Anjouan, Fomboni à Mohéli, Moroni, Mitsamiouli, Itsandra et Iconi à la Grande Comore), unifiant sous leur autorité les communautés villageoises alors commandées par des Mafani (Anjouan, Mohéli et Mayotte) et Bedja (Grande Comore). Ils font main basse sur les terres des cultivateurs autochtones, les Walatsa, qui sont alors contraints de travailler pour eux. Ceux qui s'y refusent sont refoulés à l'intérieur des terres.
C'est surtout au contact de ces dynasties chiraziennes que les élites comoriennes vont progressivement s'islamiser. On considère le XIIe siècle comme l'époque pendant laquelle l'aristocratie comorienne est totalement islamisée. En parallèle, la chute de Chiraz et de son influence maritime ouvre la voie aux commerçants indiens (en particulier les kharimis), dont la présence va s'intensifier dans la région entre le XIe et le XIIIe siècle, laissant d'importants témoignages archéologiques sous la forme de poteries typiques de la côte indienne.
En 1154, le géographe arabe Al Idrissi réalise pour le roi Roger II de Sicile un travail carthographique appelé Tabula Rogeriana, dans lequel il décrit ainsi ce qui semble être les Comores :
« Vis-à-vis du littoral du pays des Zeng sont des îles appelées Îles du Jâvaga (gazâ'ir al-Zâbag) ; elles sont nombreuses et de vaste surface. Leurs habitants ont le teint très cuivré... Parmi, encore, ces îles de Jâvaga est l'île d'Anjouana (gazirat al-Anguna). La population de cette île est un mélange de races. On dit que lorsqu'en Chine (al-Sîn) la situation se dégrada du fait des dissidents et qu'en Inde, troubles et violences s'accrurent, les Chinois écoulèrent leurs produits vers le Jâvaga et autres îles s'y rattachant.»
Les Comores demeurent cependant encore marginales dans le commerce arabe, car situées au-delà de la zone dans laquelle on peut naviguer en fonction des constellations arabo-persanes : l'archipel n'apparaît donc quasiment pas dans les « rahmanag » (routiers nautiques) arabes de l'époque, dont les plus importants pour l'océan Indien sont ceux d'Ibn Mâgid (XVe siècle) et Soulayman al-Mahri (début du XVIe siècle).
Al Idrissi détaille également les produits de l'archipel (qui semble dominé à l'époque par Anjouan) : bananes (les plus nutritives de la région d'après lui), sorgho, riz, bovins, canne à sucre, coco, camphre, santal. Il est cependant probable que le commerce des esclaves fut la principale source de revenu des habitants des Comores pendant de nombreux siècles.
La plus ancienne mosquée de l'archipel se situe à Anjouan, sur le site du vieux Sima et daterait du XIIe siècle. L'islam pratiqué à cette date est fort influencé par le chiisme persan dont on retrouve notamment l'écho dans la présence de sépultures dans l'axe du mihrab de nombreuses mosquées anciennes (culte du saint fondateur). L'islam sunnite chafiite ne s'impose dans le sud-ouest de l'Océan Indien qu'à partir du XIVe siècle d'après le témoignage d'ibn Battuta de 1331. Sima devient la première capitale du sultanat chirazi d'Anjouan. C'est de cette époque que date la mosquée chirazienne, ses ruines sont encore visibles aujourd'hui. Domoni abrite une autre mosquée chirazienne de la fin du XVe siècle. Une inscription présente dans la mosquée du Vendredi de Moroni date sa construction de 1427, tandis qu'à Mbéni, une inscription date la mosquée du Vendredi de 1470.
VIIème siècle - Moyen âge au XVIème siècle : Éthiopie - Le Moyen Âge éthiopien désigne une période de l'Histoire éthiopienne qui s'étend du VIIe siècle (haut Moyen Âge) au début du XVIe siècle. L'année 1270 marque la prise de pouvoir par la dynastie salomonide après environ un siècle de règne des Zagwés.
Le pouvoir de l'État chrétien du royaume d'Aksoum décline au VIIe siècle. Ce déclin correspond à l'émergence d'une forte rivalité entre le port du royaume d'Aksoum et Djeddah, sur la mer Rouge.
VII au XIVème siècle : Ghana - L'histoire de la partie de l'Afrique qui deviendra le Ghana d'aujourd'hui est relativement mal connue avant 1500. Les recherches archéologiques ont montré que l'occupation humaine y est très ancienne aussi bien sur la côte qu'à l'intérieur des terres. Des recherches récentes ont mis en évidence, dans la zone forestière, la présence de sites d'habitat entourés de profonds fossés datant d'entre le VIIe et le XIVe siècle. Ce type de site, que l'on connaît par ailleurs de la Côte d'Ivoire au Nigeria, témoigne de l'existence d'une civilisation sédentaire maîtrisant la métallurgie du fer, vivant probablement de la culture de l'igname et de l'exploitation du palmier à huile, et particulièrement bien adaptée à l'environnement forestier. Ces sites furent brutalement abandonnés au XIVe siècle. La peste noire et ses conséquences dévastatrices sur la démographie, bien connues en Europe et en Afrique du Nord à la même époque et dont l'étude en Afrique subsaharienne reste à réaliser, pourraient être à l'origine de ces bouleversements à grande échelle.
VIIème siècle : Kenya - Du fait de la proximité de la péninsule arabe, des colonies arabes et perses apparurent le long des côtes avant le VIIIe siècle. À la fin du Ier millénaire, des peuples bantous migrèrent dans la région. À partir de 1500 arrivèrent les Luo nilotiques. Ces peuples, locuteurs des langues bantoues et nilotiques, forment maintenant les trois quarts de la population du Kenya.
VIIème siècle : Somalie - L’histoire de la Somalie peut être, à l'instar des autres États d'Afrique, divisée en période pré-coloniale, coloniale et post-coloniale. Cette dernière est marquée par des troubles ayant fait tomber les institutions somaliennes.
Une économie et un mode de vie se développe à l'intérieur des terres consistant principalement en un élevage nomade combinée, plus au sud, avec une exploitation agricole des terres dans la région des rivières Jubba et Shabeelle. Par le commerce maritime via les villes côtières, les habitants de ce territoire somalien entrent en contact avec les civilisations perse et islamique. La religion islamique progresse sur ces terres du VIIe au XIIIe siècle.
VIIème siècle : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - À partir du VIIe siècle, certains marchands deviennent si familiers de la région qu’ils choisissent de s’y installer définitivement, et fondent des comptoirs de commerce. Il faut dire aussi que les tensions qui surgissent dans le monde musulman naissant pour savoir qui doit succéder à Mahomet poussent certains à partir trouver refuge dans d’autres contrées.
an 610 : Avènement de la dynastie d'Héraclius. La tyrannie de Phocas excite un mécontentement général; Crispus, son gendre, engage Héraclius, fils du gouverneur d'Afrique, à délivrer l'empire de ce monstre. Ce dernier aborde une flotte près d'Abydos, s'empare de Constantinople et du trône impérial (610 - 641) et fait conduire Phocas au supplice.
an 611 : La Syrie et l'Egypte sont conquise par les Perses (611 - 616)
an 621 : Maroc - La présence fragile des Romains orientaux de Constantinople, bien que menacée en permanence à la fois par les Maures et par le royaume wisigoth d'Espagne (les Wisigoths s'emparent de Tanger en 621 avec à leur tête leur roi Sisebut), subsiste néanmoins jusqu'à la conquête arabo-musulmane au début du VIIIe siècle. Le comte Julien est l'ultime gouverneur byzantin de Maurétanie Seconde, et aidera même les forces musulmanes de Tariq ibn Ziyad à traverser le détroit de Gibraltar et à débarquer en Espagne pour combattre les Wisigoths.
Plus au sud, les peuples de la vallée du Draâ auraient connu une cohabitation parfois pacifique, parfois hostile, entre des entités politiques encore méconnues, notamment un royaume juif et un royaume chrétien. Le judaïsme aurait été apporté par l'une des premières diasporas, après la grande révolte juive contre les Romains et la destruction du Temple de Jérusalem par Titus, tandis que le christianisme aurait été introduit depuis la province de Maurétanie Tingitane, sous une forme qui n'a pas été élucidée (catholicisme, arianisme, voire monophysisme). Cette civilisation du Maroc pré-saharien se caractérisait par un important brassage entre les Haratins, les Berbères, les Hébreux et un peuple mystérieux dit du "Cœur de la Mer" selon l'expression employée par les manuscrits anciens du Draâ.
an 639 : Prise d'Alexandrie par Amrou, lieutenant d'Omar, après un siège de 14 mois; Incendie de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Toute l'Egypte est conquise par les Arabes.
an 639 à 710 : Égypte - Mahomet puis son successeur Abou Bakr As-Siddiq, unifient l'Arabie musulmane. Le deuxième calife, Omar ibn al-Khattâb, se lance dans la conquête des territoires à l'extérieur de l'Arabie, notamment vers l'Ouest. Bénéficiant des divisions entre les Égyptiens monophysites et orthodoxes, le général Amr ibn al-As pénètre en Égypte en 639 s'empare de Péluse puis de Memphis et obtient la reddition d'Alexandrie en 641. Même si les troupes byzantines parviennent à reprendre Alexandrie, celle-ci est réoccupée en 645.
Dans le Sud, les Arabes attaquent, en 641 puis en 652, les royaumes chrétiens de Nobatie et de Makurie, mais échouent à prendre la ville de Dongola. Ils concluent alors le bakt, un traité qui prévoit une non agression réciproque, une liberté de circulation entre les territoires chrétiens et musulmans, une liberté respective de culte et des dispositions commerciales.
La Makurie se renforce en absorbant la Nobatie sous Mercure de Dongola (règne de 697 à 710) qui rattache son Église au patriarcat d'Alexandrie et fonde la cathédrale de Faras à la frontière avec le Soudan.
En 661, à la suite de dissensions parmi les chefs musulmans, le pouvoir est pris par la dynastie omeyyade qui installe la capitale à Damas. Sous les Omeyyades, l'expansion territoriale est limitée, mais les califes contribuent à améliorer leur administration, à répandre l'usage de l'arabe et à mettre en place une économie plus prospère en améliorant la sécurité des échanges au sein de l'empire.
an 641-711 : Algérie - La conquête militaire arabe du Maghreb qui a duré de 641 à 711, est lente et difficile. La résistance est plus marquée dans les Aurès et la région de Tlemcen, où les Berbères s'organisent en structure étatique. Les Arabes sont également repoussés par les troupes du royaume des Djédars et les dernières garnisons byzantines. Les figures les plus connues de ce conflit sont le prince guerrier Koceila, qui vainc Oqba Ibn Nafaa en 689, près de Biskra, puis la reine guerrière Kahena, appellation donnée par les Arabes signifiant « devineresse », ehia de son vrai prénom, à la tête des Berbères des Aurès. En 693, elle inflige près de Meskiana, une sévère défaite au corps expéditionnaire arabe de Hassan Ibn Numan, qu'elle repousse jusqu'en Tripolitaine, mais sera finalement vaincue.
an 641 à 661 : Egypte - Période des quatre califes biens guidés (Rachidoune) (641-661)
an 644 : Omar est assassiné à Médine par un esclave persan. Il a pour successeur Otham ou Osman, secrétaire d'Abou-Bekr (644 - 656). Construction d'une flotte. Sous lui, les armées victorieuses des Arabes pénètrent jusqu'aux bords de l'Oxus et de l'Indus. Amrou continue ses conquêtes en Afrique.
an 647 : Les Arabes envahissent l'Afrique et arrivent jusque devant Tanger
an 647 à 703 : Tunisie - En 647, les conquérants arabes pénètrent en Tunisie, ils y introduisent l'islam, mais rencontrent une forte opposition des Byzantins et des Berbères jusqu'en 703. La ville de Kairouan est fondé en 670.
Avec l'est de l'Algérie, la Tunisie fait partie de la province arabe de l'Ifryqiya. La population se convertit à l'islam, mais il subsiste d'importantes communautés juives et berbères qui conservent leur religion. Cependant de nombreux immigrants provenant des pays orientaux de l'empire arabe s'installent en Tunisie.
Au milieu du VIIe siècle au moment de l'arrivée au califat de la dynastie des Omeyyades de Damas, une partie des musulmans tunisiens, les Kharijites , parviennent à obtenir l'indépendance. À partir du milieu du VIIIe siècle sous la dynastie abbasside de Bagdad, la Tunisie est de nouveau dans l'empire musulman. Elle est alors gouvernée par des gouverneurs aghlabides qui sont quasiment indépendants de Bagdad. La Tunisie connait alors un brillant essor. Kairouan devient une des capitales intellectuelles du monde arabo-musulman.
an 650 à 1 000 : Libye - Pendant le Haut Moyen Âge, l'Empire byzantin subit les attaques arabes lancées depuis l'Égypte. Sous le commandement du général arabe 'Amr ibn al-'As, les troupes du calife `Umar ibn al-Khattāb conquièrent facilement la Cyrénaïque en 642-643. En 647, une armée de 40 000 hommes, commandée par ‘Abdu’llah ibn Sa‘ad, poursuivit plus à l'ouest et s'empare de Tripoli, puis de Sufetula (à quelque 260 km au sud de Carthage). En 663, les conquérants arabes arrivent au Fezzan, sous la conduite de Oqba Ibn Nafi Al Fihri. Selon la légende, seule la ville de Ghadamès aurait opposé une véritable résistance, sous l'impulsion de Dihia. Les conquérants arabes semblent s'être montrés agressifs envers les chrétiens de Libye; les églises sont cependant progressivement abandonnées du fait du recul de la sédentarisation et de la vie urbaine. La vie rurale demeure marquée par l'autarcie : isolées, soumises comme ailleurs à l'impôt sur les non-musulmans, les communautés chrétiennes disparaissent lentement au cours du Moyen Âge. La Libye retrouve par ailleurs son importance en tant que voie de passage entre le Maghreb et le Mashreq, notamment lors du passage des Fatimides de Mahdia vers l'Égypte en 972. En Ifriqiya, les Zirides sont installés au pouvoir par les Fatimides, mais se révoltent ensuite contre leurs protecteurs : vers l'an 1050, les Fatimides lancent alors les tribus Beni Hilal et Beni Suleim à l'assaut de l'Ifriqiya, ce qui semble avoir porté le coup de grâce à la vie sédentaire et à l'agriculture libyennes.
an 661 à 750 : Égypte - Période omeyyade (661-750)
an 669 : Les Arabes abordent en Sicile. Continuation de la guerre conte l'empire grec, principalement en Afrique
an 670 : Fondation par les Arabes de la ville de Kairwan ou Kairouan, en Afrique. Elle devint dans la suite la capitale de l'Afrique musulmane et se distinguait non-seulement par sa grandeur et ses richesses, mais encore par ses établissements scientifiques et littéraires.
an 689 : A la fin de ce siècle, le khalifat des Arabes comprend, outre l'Arabie, l'Indostan, la Tartarie, la Perse, la Syrie avec les pays qui en dépendent, l'Egypte, Chypre, Rhodes et les côtes septentrionales de l'Afrique.
an 698 : Victoire des Arabes, sous Hassan, sur les troupes grecques près d'Utique; Destruction de Carthage par les Arabes. Ils sont chassés par les Berbères et les Grecs, et se retirent en Égypte.
Apsimaire, général de la cavalerie, le même qui avait battu les Arabes en Afrique, dépose Léonce, lui fait couper le nez, l'envoie dans un monastère en Dalmanie et se fait proclamer empereur sous le nom de Tibère III (698 - 705)
VIIIème siècle : Algérie - Dans le Maghreb central, les kharidjites œuvrent efficacement à l'islamisation des territoires. Au VIIIe siècle, les insurrections se multiplient contre les Omeyyades, en raison des impôts imposés aux Berbères et qui ne frappent, en principe, que les non-musulmans. L'Islam se diffuse ensuite depuis les mosquées, les centres de savoir religieux tel que Tahert et Kairouan, les ribats et les zaouïas. La conversion définitive des Berbères s'achève au IXe siècle, mais des ilots de christianisme subsistent jusqu'au XIIe siècle.
Le processus de l'arabisation est plus long. La diffusion de la langue arabe est d'abord l'œuvre des miliciens arabes qui prennent pied d'abord dans les forteresses byzantines du Constantinois, puis à partir des cités telles que Tahert et Tlemcen. L'usage de cette langue devient plus répandu avec l'arrivée des tribus des Arabes hilaliens dans les plaines, les Hauts Plateaux et le désert. Plus tard, les immigrés andalous et les confréries religieuses contribuent à d'autres avancées de l'arabisation. Le berbère subsiste dans les massifs montagneux notamment en Kabylie, les Aurès, le Dahra et l'Ouarsenis.
VIIIème siècle - Moyen âge : Éthiopie - Le monnayage aksunnite disparait au cours du VIIIe siècle. Mais le fait que le négus (« roi » en langue guèze) ait accueilli les disciples du Prophète, contraints de fuir La Mecque, restera dans les mémoires dès les premiers temps de l'Islam. Les relations resteront respectueuses sinon amicales entre les deux communautés, ce qui n'empêche pas la rivalité entre commerçants, des deux côtés de la mer Rouge.
La documentation dans le royaume d'Aksoum puis en littérature arabe laisse apparaître un vide pour plusieurs siècles, après le VIIIe siècle. Ce vide pourrait être dû à « l'affaiblissement politique et culturel du royaume chrétien, coupé du reste de la chrétienté par l’expansion musulmane, et à une occultation plus ou moins systématique de cette période (VIIIe – XIIIe siècle) chez les clercs de la période postérieure, pour des raisons essentiellement idéologiques. »
VIIIème siècle : Guinée - Les Nalou et les Baga peuplent la région au VIIIe siècle.
VIIIème siècle : Kenya - L'histoire coloniale du Kenya débuta dès le VIIIe siècle avec l'établissement de colonies arabes le long des côtes.
VIIIème siècle : Mauritanie - Au VIIIe siècle, les Maures antiques sont organisés en différentes confédérations, l'empire romain d'occident se disloquant, l'Afrique du Nord se subdivisant en micro-Etats ou confédérations parallèlement à des principautés vandales arcboutées sur la structure berbéro-romaine précédente. le Christianisme était encore la religion urbaine dominante en Afrique du Nord, et commencent à recevoir une influence monothéiste venue des "émirats" zénètes de Sijilmassa, des Berghwatta, de Nekour, de Aghmat, sans doute un christianisme teinté de coranisation se mêle-t-il alors au judaïsme prosélyte.
VIIIème siècle : Mayotte - Comme pour les autres îles de l'archipel des Comores, les premières populations documentées débutent au VIIIe siècle (le site archéologique de Koungou, au nord de Mayotte, a fourni des charbons datés par carbone 14 de ce siècle). L'origine de ces premiers habitants est multiple, Africains bantous et Austronésiens (ou Protomalgaches) originaires de l'archipel indonésien (Kalimantan et Célèbes). Si l'arrivée d'Austronésiens se comprend par leur volonté de commercer avec l'Afrique, la présence bantoue serait le résultat soit de migrations volontaires venues coloniser l'ensemble comoro-malgache, soit les signes d'une traite ancienne du fait des Austronésiens. En effet, au Xe siècle, le persan Borzog ibn Shariyar, dans les Merveilles de l'Inde, rapporte la présence de « Wac wac » (Austronésiens) à la côte du pays des Zenj (Zanguebar) venus quérir des esclaves.
VIIIème siècle : Togo - Le pays Bassar au centre et au nord du Togo est devenu, à partir du VIIIe siècle, l'une des principales régions de production métallurgique d'Afrique de l'Ouest. Les vestiges d'anciens fourneaux et les scories confirment l'intensité de l'activité métallurgique pendant plusieurs siècles. De plus, on sait que les forgerons exportaient le fer extrait des minerais de la région jusqu'à la ville de Kano au Nigeria. Quelques-uns de ces hauts-fourneaux mesuraient jusqu'à trois ou quatre mètres de hauteur, servant aux Bassaris à réduire le minerai de fer.
Les Bassari, les Tamberma et les Kabyés se trouvent déjà dans les régions montagneuses lorsque arrivent de nouvelles populations déplacées par les événements qui déstabilisent durablement l'Afrique occidentale comme la traite des noirs, l'introduction de fusils ou encore les apports des colporteurs musulmans parlant haoussa et qui islamisent les savanes du nord du pays. Ces derniers fondent certaines villes qui portent encore des noms haoussa comme Sansanen Mango qui signifie le « camp du manguier » et Gerin Kouka dire la « ville du baobab. » De plus, la plus ancienne ville du sud du pays porte un nom haoussa : Ba Guida qui signifie « pas d'habitation. ».
Dans le Nord, les Gourma sont donc islamisés et les Kotokoli s'installent autour de Sokodé ; les Tchokossi s'installent dans la région de Mango. Le centre et le sud du pays subissent les conséquences de la montée en puissance des Bariba du Bénin ainsi que du royaume de Dahomey et des Ashantis du Ghana.
an 700-740 : Maroc - Califat omeyyade de Damas (v.700-v.740)
Les Omeyyades sont issus de la tribu arabe de Qurayš. Cette tribu tire son prestige et sa puissance du fait qu'elle est responsable de la protection et de la maintenance du sanctuaire de la Kaaba à la Mecque. En effet, l'Arabie préislamique est parsemée de sanctuaires, certains renfermant des bétyles, comme la Kaaba, et cette dernière est considérée par les Arabes, largement monothéistes à cette époque, comme leur sanctuaire le plus sacré. Vers la deuxième moitié du Ve siècle, ʿAbd Manāf ibn Quṣayy des Qurayš est chargé de la maintenance et de la protection de la Kaaba et de ses pèlerins. Cette responsabilité est héritée par ses fils ʿAbd Šams, Hāšim (à l'origine du clan des Banū Hāšim) et d'autres. ʾUmayyah, à l'origine du clan des Banū ʾUmayyah, ou Omeyyades, est le fils de ʿAbd Šams. Il succède à son père en tant que commandant de la Mecque en temps de guerre. Ce poste est probablement plus une fonction occasionnelle de supervision des affaires militaires en temps de guerre plutôt qu'un commandement sur le champ de bataille. Quoi qu'il en soit, ceci s'avère instructif plus tard pour les Banū ʾUmayyah, qui acquièrent des compétences organisationnelles politiques et militaires importantes.
L'historien Giorgio Levi Della Vida suggère que les sources traditionnelles musulmanes à propos de ʾUmayyah, comme tous les anciens progéniteurs de tribus arabes, devraient être prises avec précaution, mais qu'« un trop grand scepticisme à l'égard de la tradition serait aussi mal avisé qu'une foi absolue dans ses déclarations ». Etant donné que les Banū ʾUmayyah apparaissant dans le début de l'Histoire musulmane au VIe siècle sont tout au plus des descendants de la troisième génération de ʾUmayyah, "il n'y a rien d'improbable à ce que ce dernier soit un personnage historique"
Vers 600, les routes commerciales développées par Qurayš s'étendent à travers toute l'Arabie et des caravanes sont organisées vers la Syrie au nord et le Yémen au sud. Les Banū ʾUmayyah et les Banū Maḫzūm, un autre clan puissant de Qurayš, contrôlent la majorité de ces routes et développent des alliances économiques et militaires avec les tribus arabes nomades qui contrôlent le désert d'Arabie, augmentant encore plus leur puissance politique. Lorsque Mahomet, qui est membre des Banū Hāšim, clan rival des Banū ʾUmayyah et moins puissant, commence à prêcher l'islam à la Mecque, il essuie une vive opposition de la part de la majorité de Qurayš. Une exception notable parmi les Banū ʾUmayyah est ʿUṯmān ibn ʿAffān, un riche marchand, qui rejoint le Prophète de l'islam dès 611, ce qui en fait l'une des toutes premières personnes à se convertir à l'islam. Mahomet finit par trouver du soutien dans la ville de Yathrib, qui devient par la suite Médine, et y émigre en 622, marquant ainsi le début du calendrier de l'hégire.
Après la défaite de Qurayš à la bataille de Badr face aux musulmans en 624 et les lourdes pertes essuyées par les Banū Maḫzūm, ces derniers sont supplantés à la tête de Qurayš par les descendants de ʿAbd Šams, notamment les Banū ʾUmayyah. Le chef du clan des Banū ʾUmayyah, ʾAbū Sufyān ibn Ḥarb, prend alors la tête de l'armée mecquoise aux batailles de ʾUḥud et de la Tranchée. Il finit, tout comme ses fils, par se convertir à l'islam après la conquête de la Mecque par les musulmans. Afin de s'assurer la loyauté des Banū ʾUmayyah, le Prophète de l'islam leur offre des présents et des postes d'importance dans l'État naissant. Ainsi, ʿAttāb ibn ʾAsīd, un descendant de ʾUmayyah, devient le premier gouverneur de la Mecque. Médine devenant le centre politique de l'État, ʾAbū Sufyān et de nombreux Banū ʾUmayyah s'y installent afin de maintenir leur influence politique croissante.
an 701 : Afrique - Comores - Les premières traces de peuplement datent du VIIIe siècle avec des Africains appelé Antalotes (abusivement dénommés bushmen par les Européens). Depuis lors, de très nombreuses ethnies se sont croisées et mélangées.
an 705 : Valid Ier succède à son père sur le trône des khalifes (705 - 715). L'empire des Arabes s'étend depuis le détroit de Gibraltar jusqu'aux frontières des pays dépendant de la Chine et depuis le mont Caucase et la mer noire jusqu'à l'Océan indien.
an 707 : Mousa-Ben-Nosaïr, gouverneur de la Mauritanie, soumet la Corse, la Sardaigne, les îles Baléares et achève la conquête de l'Afrique septentrionale jusqu'à l'Océan.
an 710-1019 : Maroc - Émirat de Nekor (710-1019)
Le royaume des Salihides, fondé vers 710 par Salih Ibn Mansour, originaire de Himyar au Yémen, est de fait le plus ancien Etat musulman crée au Maroc. Ses capitales successives seront Temsamane et Nekor. À l'instar des Omeyyades de Cordoue dont ils sont tributaires, les émirs salihides s'entourent d'une garde Saqāliba d'origine slave, et font face aux raids destructeurs des Vikings. Les membres de la famille salihide se déchirent dans de dures luttes pour le pouvoir, auxquelles participent les tribus du Rif et des Ghomaras, mais malgré ces épisodes d'invasions et de guerres internes, l'émirat brillera par sa prospérité économique, marquée par les liens avec Al-Andalus et son ouverture sur l'ensemble du monde méditerranéen grâce au port d'Al Mazamma.
an 739-743 : Maroc - La grande révolte berbère
Dès les débuts de la conquête musulmane du Maghreb, les Kharijites originellement basés en Irak envoient des représentants au Maghreb pour tenter de rallier les populations berbères. Les Berbères accoutumés au système de communauté égalitaire et supportant mal la domination arabe, finissent par trouver dans le kharijisme un redoutable moyen de contestation politique.
En 739 Maysara al-Matghari, mandaté par les populations du Maghreb al-Aqsa, conduit à Damas une délégation auprès du calife Hicham pour présenter les doléances des Berbères : égalité dans le partage du butin et arrêt de la pratique qui consiste à éventrer les brebis pour obtenir la fourrure des fœtus (le mouton étant un élément essentiel de l'économie pastorale des tribus berbères).
Les plaintes parviennent au calife omeyyade qui ne donne pas suite, ce qui déclenche une insurrection à Tanger. Maysara s’empare de la ville, tue le gouverneur Omar Ibn Abdallah et se proclame calife. Il réussit à empêcher le débarquement d’une armée arabe envoyée d’Espagne. Le gouverneur d'Espagne Uqba ibn al-Hajjaj intervient en personne mais ne parvient pas à reprendre Tanger, tandis que Maysara s'empare du Souss dont il tue le gouverneur. Puis Maysara, se conduisant comme un tyran, est déposé et tué par les siens, et remplacé par Khalid ibn Hamid al-Zanati. Sous son commandement, les Berbères sont victorieux d’une armée arabe sur les bords du Chelif, au début de 740.
Les troupes arabes ayant été battues, Hichām envoie des troupes de Syrie dirigées par le général Kulthum ibn Iyad. Elles sont vaincues par les Berbères sur les rive du Sebou en octobre 741. Le gouverneur égyptien Handhala Ibn Safwan intervient à son tour et arrête les deux armées kharidjites au cours de deux batailles à Al-Qarn et à El-Asnam (Algérie) alors qu'elles menaçaient Kairouan (actuelle Tunisie) au printemps 742.
an 741 : Algérie - Après la conquête musulmane du Maghreb, les Berbères se révoltent contre le régime omeyyade. Ces révoltes s'associent au milieu du VIIIe siècle au dogme kharidjite, qui les séduit par son puritanisme et son message égalitaire, et gagnent une bonne partie du Maghreb. À partir du 741, le Maghreb central gagne son autonomie, sous l'emblème du kharidjisme. Abou Qurra, chef de la tribu des Ifren, fonde le royaume sufrite de Tlemcen. Mais l'entité kharidjite la plus importante en Algérie est celle de la dynastie des Rostémides. Dans le reste du Maghreb deux autres dynasties s'installent : les Aghlabides sunnites de Kairouan et les Idrissides chiites de Fès.
an 744-1058 : Maroc - Royaume des Berghouata (744-1058)
Les Berghouatas, confédération de tribus issues essentiellement des Masmoudas, forment un royaume puissant entre le VIIIe et le XIe siècle. À la suite de la grande révolte kharijite de Maysara, ils établissent un émirat indépendant dans la région de Tamesna, sur les côtes de l’Atlantique entre Safi et Salé, sous l’égide de Tarif al-Matghari.
L'État berghouata, dirigé par un pouvoir royal théocratique, fixe les rituels d'une nouvelle religion d'essence messianique empruntant à la fois à l'islam, au judaïsme et aux antiques croyances locales, et adopte un livre saint inspiré du Coran, mais rédigé en berbère et comportant 80 sourates. Les rois berghouatas prennent les titres de Mahdi et de Salih al Mou'minine et désignent Dieu par le nom de Yakouch. Parallèlement chez les Ghomaras du Rif occidental, de même souche masmoudienne que les Berghouatas, un faux prophète du nom de Ha-Mîm prêche également une religion messianique et rédige un "livre saint" en berbère, s'inspirant du principe du Salih al Mou'minine. Mais Ha-Mîm ne parvient pas à créer un royaume comme la dynastie de Tarif al-Matghari et il périt exécuté par les Omeyyades en 928.
Les Berghouatas maintiennent leur suprématie dans la région des plaines atlantiques durant quatre siècles et entretiennent des relations diplomatiques et commerciales avec le califat omeyyade de Cordoue qui voit probablement en eux des alliés potentiels contre les Fatimides et leurs alliés zénètes. Il semble que, sur les vingt-neuf tribus constitutives de ce royaume, douze aient adopté réellement la religion barghwata, les dix-sept autres étant demeurées fidèles au kharijisme.
an 745-755 : Maroc - Quand survient la chute des Omeyyades de Syrie (750), l'ouest de l'Empire échappe totalement au pouvoir central damascène. L'Espagne revient aux émirs omeyyades de Cordoue et le Maghreb se morcelle en plusieurs petits États indépendants (de 745 à 755).
an 750 à 762 : Égypte - En 750, après leur défaite à la bataille du Grand Zab, les Omeyyades sont remplacés par les Abbassides dans une grande partie orientale de l'empire, dont l'Égypte. Le transfert de la capitale de Damas à Bagdad en 762 éloigne l'Égypte du pouvoir central, ce qui contribue à l'affaiblissement de l'autorité des califes sur ce territoire.
La conversion à l'islam de la population reste limitée dans les premiers siècles de l'occupation arabe, mais se développe fortement vers le Xe siècle. La cause de cette conversion est mal connue, mais la formalisation du statut, inférieur, de dhimmi pour les Juifs et les chrétiens pourrait en être une raison principale.
an 750 à 868 : Égypte - Période abbaside (750-868)
an 758-1055 : Maroc - Émirat de Sijilmassa (758-1055)
Un émirat fondé par les Zénètes émerge dans la région du Tafilalet à partir de 758. Dirigée par la dynastie des Midrarides (dont le fondateur est Samgou Ibn Wassoul al Miknassi), cette entité politique et théocratique à forte structure tribale prend pour capitale la cité de Sijilmassa. Le royaume midraride professe officiellement le kharidjisme de rite sufrite mais finit par reconnaître à partir de 883 la suprématie religieuse du califat sunnite des Abbassides de Baghdad. Les Midrarides se consacrent cependant à maintenir une alliance avec les autres États kharidjites, comme le royaume des Rostémides de Tahert dirigé par une dynastie d'origine persane. Sijilmassa établit également un fructueux commerce caravanier de l'or avec le royaume du Ghana, à l'époque maître des plus importants gisements aurifères de l'Afrique de l'Ouest.
L'émirat de Sijilmassa atteint ainsi son apogée au IXe siècle grâce à son rôle de plaque tournante du trafic des métaux précieux, et sa renommée s'étend ainsi jusqu'aux pays méditerranéens et à tout l'Orient abbasside (voire jusqu'à la Chine mongole des Yuan selon Ibn Battûta, qui y rencontre des Sijilmassiens). C'est précisément cette position de débouché de l'or africain subsaharien et les connections faciles avec l'Asie et la Route de la soie qui excitent les convoitises des Omeyyades de Cordoue et des Fatimides qui s'affrontent pour sa domination. Ce sont finalement les Almoravides qui s'emparent du royaume midraride en 1055. Par la suite, la fondation de Marrakech éclipse définitivement le prestige de Sijilmassa.
an 760 : Algérie - Ibn Rustom, kharidjite d'origine perse installé en Ifriqiya, est attaqué et vaincu par le gouverneur arabe d'Égypte. Il abandonne l'Ifriqiya aux armées arabes et se réfugie dans l'Ouest algérien où il fonde en 761 Tahert, qui devient la capitale du royaume rostémide, un État théocratique, réputé pour le puritanisme de ses dirigeants, son commerce florissant, son rayonnement culturel ainsi que sa tolérance religieuse. Celui-ci, comme l'émirat de Cordoue depuis sa création en 756, conserve son indépendance du califat des Abbassides, malgré les pressions diplomatiques et militaires ainsi que la perte de territoires.
an 767 : Algérie - Le berbère Abou Qurra, uni aux kharidjites de Tahert et du djebel Nefoussa, lance une expédition vers l'est. Ils cernent le gouverneur abbasside dans la forteresse de Tobna, dans le Hodna, et gagnent Kairouan. Cependant, le calife envoie de l'Orient une forte armée sous le nouveau gouverneur Yazid ibn Hatim, qui défait les kharidjites en Ifriqiya, mais le reste du Maghreb échappent à l'autorité de Bagdad. De retour à Tlemcen, il voit son pouvoir battu en brèche par les tribus berbères des Maghraoua. Idris Ier négocie avec les Maghraouas la remise de la ville de Tlemcen, et un de ses descendants, Muhammed b. Sulayman, crée dans la région le « royaume sulaymanid », un État qui ne semble contrôler que les villes et qui prend fin sous les Fatimides en 93.
an 788 : Fondation par EDRIS Ier ou IDRIS la ville de Fès ou Fez (en arabe : فاس, Fās; en berbère : ⴼⴰⵙ, Fas) est une ville du Maroc septentrional, située à 180 km à l'est de Rabat, entre le massif du Rif et le Moyen Atlas. Faisant partie des villes impériales du Maroc, elle a été à plusieurs époques la capitale du pays et est considérée de nos jours comme sa capitale spirituelle. Il donne son nom à l'empire des Edrisides.
Idris Ier ou Idriss Ier (arabe : إدريس بن عبد الله الكامل (Idrīss ibn ʿAbdallah al-Kamil), berbère : ⴷⵔⵉⵙ ⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⴽⴰⵎⵉⵍ (Driss u ʿAbdellah Lkamil)) ou Moulay Idriss, né en 743 à La Mecque et mort en mai ou juin 791 à Volubilis, est une personnalité historique d'origine arabe, fondateur des villes de Fès, de Moulay Idriss ainsi que de l'imamat idrisside, communément considéré comme le premier État marocain, sur lequel il a régné de 788 à 791. Il est l'arrière petit-fils du calife Ali et de Fatima, fille de Mahomet.
an 789 : Guerres heureuses d'Haroun (786 - 809), 5ème khalife de la race des Abbassides, contre les Khazares. Edris, descendant d'Ali, s'enfuit au Magreb (Mauritanie et Numidie), dans l'Afrique septentrionale, où il fonde un royaume nouveau. Dynastie des Edrisides (789 - 941)
an 789-985 : Maroc - Dynastie idrisside
L'histoire des Idrissides commence, lorsqu'un prince arabe chiite de la famille de `Ali (quatrième calife de l'islam), Idris Ibn 'abd Allah al-Kamil et son affranchi Rachid Ben Morched El Koreichi, se réfugient dans le Moyen Atlas. Fuyant la menace des Abbassides (qui avaient massacré des Alides et leurs partisans chiites lors de la bataille de Fakh près de La Mecque), ils séjournent en Égypte avant de s'installer à Walilah (Volubilis), sous la protection de la tribu berbère des Awarbas. Parvenant à rallier les tribus locales à sa cause, Idriss est investi Imam et fonde la ville de Fès en 789 sous le nom d'Idriss Ier. C'est le début de la dynastie des Idrissides.
Idris Ier est assassiné par un émissaire du calife abbasside Haroun al-Rachid de Bagdad, un certain Sulayman Ibn Jarir Al Chammakh, qui avait été en fait avisé par le puissant vizir barmécide Yahya ben Khalid. Ne se doutant que la femme d'Idris Ier (Kenza al Awrabiya) est enceinte, Haroun al-Rachid et son vizir pensent que la menace de l'émergence d'un pouvoir alide à l'ouest du Maghreb est définitivement éradiquée. Mais quelques mois plus tard, naît Idris II. Son éducation est confiée à l'affranchi de son père Rachid qui assure une sorte de régence.
Après onze années sous la tutelle de Rachid, Idris II est proclamé Imam des croyants de Fès. Au fil du temps, grâce à son talent politique, il réussit à fédérer davantage de tribus, le nombre de ses fidèles s'accroît et son armée désormais professionnelle incorpore des éléments arabes des tribus Qaïs, Azd, Madlaj, Bani Yahsob et Soudaf, parmi lesquels il choisit son ministre Oumaïr Ibn Moussab; un tel apport lui permet d'élargir sa zone de domination sur le Maghreb al-Aqsa. Le royaume idrisside englobe ainsi toute la portion de territoire s'étendant de Tlemcen à l'est jusqu'au Souss au sud et au Gharb à l'ouest. Il semble que la dynastie idrisside, du moins à ses débuts, ait professé le chiisme et plus précisément le zaïdisme, réputé être le plus modéré des rites chiites. Les princes idrissides successifs passeront cependant au sunnisme, notamment sous l'influence de leurs voisins omeyyades.
Se considérant à l'étroit à Walilah, Idriss II quitte l'antique cité romaine pour Fès, où il fonde le quartier des Kairouanais (également appelé Al-Alya) sur la rive gauche (Idris Ier s'était établi sur la rive droite, le quartier des Andalous). Les Kairouanais sont issus de familles arabes orientales et arabo-persanes (originaires du Khorassan) établies en Ifriqya depuis l'époque abbasside. Ces familles sont expulsées de Kairouan en raison des persécutions infligées par l'émir aghlabide Ibrahim Ier. Les Andalous qui s'installent à Fès sont quant à eux des opposants aux Omeyyades, originaires des faubourgs cordouans qui s'étaient révoltés massivement contre l'émir omeyyade d'Al-Andalus Al-Hakam Ier (notamment du faubourg de Rabed, d'où le nom de Rabedis attribué aux éléments de cette première vague d'immigration andalouse au Maroc). Les Kairouanais et les Andalous forment ainsi le premier noyau de peuplement citadin de Fès et font bénéficier la nouvelle capitale des Idrissides de leurs nombreux apports, notamment dans les domaines intellectuels et économiques.
Le royaume idrisside connaît une importante phase d'urbanisation, illustrée par la création de villes nouvelles telles que Salé, Wazzequr, Tamdoult et Basra, cette dernière inspirée de la Basra irakienne. Ces nouveaux centres sont des foyers de diffusion de culture arabe et des vecteurs d'islamisation en pays profondément berbère. La fondation de la mosquée et université Al Quaraouiyine par Fatima el Fihriya, une aristocrate d'origine kairouanaise, assure à Fès un rayonnement des plus intenses, qui fera participer la cité idrisside à l'âge d'or islamique des sciences, des arts et des lettres aux côtés des grands centres civilisationnels prestigieux que sont alors Cordoue, Le Caire et Bagdad.
À cette même époque, les Vikings venus de la lointaine Scandinavie et menés par Hasting et par le prince suédois Björn Côtes-de-Fer, attirés par les ressources potentielles qu'offrent les rives du détroit de Gibraltar et de la Méditerranée occidentale, se signalent par leurs incursions dévastatrices sur les côtes nord du Maroc (notamment dans les régions d'Asilah et de Nador). L'historien et géographe andalou Al-Bakri désignera les envahisseurs vikings par le terme de Majus et relatera particulièrement leurs exactions contre le royaume des Banu Salih de Nekor dans le Rif sous le règne de l'émir salihide Saïd I ibn Idris.
En 985, les Idrissides perdent tout pouvoir politique au Maroc et sont massivement exilés en Al-Andalus par le calife omeyyade Al-Hakam II. Installés à Malaga, ils récupèrent peu à peu leur puissance, au point d'engendrer une dynastie pendant l'époque des taïfas, les Hammudites. Ces derniers vont jusqu'à revendiquer la fonction califale à Cordoue en remplacement des Omeyyades déchus en 1016.
IX - Xème siècle : Gambie - Les commerçants arabes donnent les premiers témoignages écrits de la région aux environs du IXe et du Xe siècle. Au cours du Xe siècle, les marchands et savants musulmans établissent des communautés dans plusieurs centres commerciaux de l'Afrique de l'Ouest ; s'établissent alors des routes commerciales à travers le Sahara, entraînant un grand commerce d’exportation d'esclaves, d'or et d'ivoire et d'importation de produits manufacturés.
IX - XVIème siècle : Guinée - La majeure partie du territoire guinéen a été partie intégrante des empires du Ghana et du Mali qui se sont succédé entre le IXe siècle et le XVIe siècle.
Du IXe siècle au XIe siècle, le royaume mandingue, vassal de l'Empire du Ghana, s'établit du haut Sénégal au haut Niger. Ils seront rejoints par les Dialonkés d'origine mandée.
IXème siècle : Mayotte - dès le IXe siècle, le commerce entretenu par les Austronésiens entre Madagascar et la côte africaine où se développent les sociétés swahilies est très intense et repose notamment sur l'exportation de fer produit à Mayotte (site de Dembeni, IXe – XIIe siècle). Dès cette époque, des marchands arabo-persans font escale dans l'archipel (nécropole de Bagamoyo) introduisant avec eux l'islam dans l'île.
Il semble que les premiers habitants appartiennent déjà aux premiers peuples swahilis, caractérisés par une culture d'origine bantoue répandue sur l'ensemble des rivages de l'Afrique orientale de la Somalie au Mozambique, entretenant des relations encore mal connues avec les populations malgaches, d'origine austronésienne. Mayotte et Anjouan ont été occupées apparemment plus tardivement car les deux îles se différencient de l'ensemble des Comores par une évolution linguistique spécifique. Le commerce maritime, très actif dès cette époque, atteste de contacts avec le Moyen-Orient musulman. Les plus vieux vestiges d'occupation humaine ont été retrouvés à Acoua, et datent de cette période ; les premières populations n'étaient vraisemblablement pas musulmanes, et ne se seraient islamisées que plus tard, au contact des marchands arabes. Mayotte est alors une étape dans le commerce entre l'Afrique et Madagascar, comme l'attestent les données archéologiques du site d'Ironi Bé à Dembeni.
Le site archéologique de Dembeni (IXe – XIIe siècle)
Situé sur la côte orientale de Mayotte, surplombant une plaine côtière fertile, le site ancien de Dembeni (près du village actuel de Tsararano) est le plus important site médiéval de l'île tant par sa taille — plusieurs hectares — que pour ce qui a été trouvé à la suite des recherches archéologiques, principalement conduites par Claude Allibert.
La superficie et la taille de certains dépotoirs témoignent d'une concentration humaine très élevée. La métallurgie y est attestée. Les lingots de fer ainsi produits étaient destinés au monde indien et au Moyen-Orient. On a pensé jusque que dans les années 1980 que la prospérité de Dembeni était due au commerce du fer6. Mais des recherches menées en 2013 semblent montrer que Dembeni était également une place de redistribution des produits malgaches, surtout le cristal de roche. Celui-ci était extrait de mines malgaches et était débité à Dembeni, où étaient retirés scories et parties impures.
Il était ensuite revendu à des marchands arabes, juifs et persans, le cristal de roche étant recherché par des ateliers d'Irak, d'Égypte et de Perse pour la confection d'objets de luxe. Des textes persans de l'époque indiquent d'ailleurs que le cristal de roche venait d'une île de la cote des Zandj. La période de prospérité de Dembeni correspond à la période de production des plus belles pièces de cristal de roche en Égypte et en Iran. Ces activités expliquent l'incroyable prospérité du site où des objets originaires de Madagascar, du Moyen-Orient et même de Chine (porcelaine blanche Tang du IXe siècle) ont été retrouvés en quantité. Une céramique originale, à engobe rouge et parfois graphitée, que l'on retrouve en abondance (peut-être la preuve d'une production locale) connaît une diffusion importante entre le IXe et le Xe siècle, de la côte occidentale de Madagascar aux cités swahilies africaines et jusqu'à la péninsule arabique, où des exemplaires ont été retrouvés sur le site archéologique de Sharma (Xe – XIIe siècle), en Hadramaout.
Quant à l'origine des Dembeniens, on s'accorde à reconnaître dans leur culture les caractéristiques des populations austronésiennes ou « proto malgaches », bien que certains indices trahissent une présence bantoue.
Ce site, malheureusement attaqué par l'urbanisation, n'a pas livré tous ses secrets : aucune sépulture n'y a été encore découverte et l'on ignore encore par conséquent si les Dembeniens étaient islamisés. Enfin les causes de l'abandon du lieu restent mal expliquées : une modification des réseaux commerciaux pourrait expliquer son déclin à partir du XIIe siècle lorsque des comptoirs tenus par des islamisés se développent directement à Madagascar et réduisent l'archipel des Comores au seul rôle d'escale.
IXème siècle : Namibie - Les immigrations khoisans et bantoues
Les immigrations successives en provenance d'Afrique centrale peuplent très progressivement le territoire.
Au début du IXe siècle, le territoire est peuplé de Bushmen (ou San) et de Namas (5 % de la population à la fin du XXe siècle3), arrivés par l'est 1 500 ans plus tôt, et de Damaras (8,2 % de la population namibienne à la fin du XXe siècle4), originaires du Soudan actuel.
Bien que plus grands et plus foncés de peau, les Namas sont des Khoïsan partageant avec les Bushmen 33 % de leur vocabulaire. Installés à la hauteur de la rivière Swakop et dans la région du grand Namaqualand, c'est un peuple d'éleveurs, divisé en clans, qui se désigne comme le peuple des vrais hommes (Khoe-Khoe) et connu également sous le terme de « Hottentot ». On sait peu de choses des contacts qu'ils entretenaient avec leurs voisins avant le XVIIIe siècle.
Les Damaras (également appelés Berg Damara) sont pour leur part un peuple de chasseurs-cueilleurs, aux origines encore peu connues, vivant dans les montagnes peu hospitalières du nord-ouest. Réduits un temps en esclavage par les Namas, ils seront par la suite asservis par les Héréros. Plus grands et plus foncés, les Damaras sont assimilés aux peuples khoïsans bien que descendant d'un peuple bantou ou pré-bantou, arrivé dans le nord de l'actuel Namibie, avant même que les Namas aient atteint les rivages de la Swakop.
IXème siècle : Nigéria - Le commerce fut la source de l’émergence de communautés organisées au nord du pays, recouvert par la savane. Les habitants préhistoriques de la lisière du désert s’étaient trouvés largement dispersés au IVe millénaire av. J.-C., lorsque la dessiccation du Sahara commença. Des routes commerciales transsahariennes reliaient l’ouest du Soudan à la Méditerranée depuis l’époque de Carthage, et au Nil supérieur depuis des temps bien plus reculés. Ces voies de communication et d’échanges culturels subsistèrent jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est par ces mêmes routes que l’islam se répandit en Afrique de l'Ouest à partir du IXe siècle.
IXème siècle : Sénégal - Naissance de l’empire du Tekrour (ou Tekror) lors de la décadence de l’empire du Ghana.
IXème siècle : Seychelles - Jusqu’au IXe siècle, l’archipel des Seychelles est le royaume des tortues, des oiseaux et des cocos de mer.
Les îles des Seychelles reçoivent alors la visite des navigateurs arabes qui ont ouvert des comptoirs en Afrique orientale. Ils se ravitaillent en eau et en nourriture aux Seychelles.
IXème siècle : Zambie - Les populations pratiquent le troc jusqu'au ixe siècle, moment où certaines ethnies adoptent des croisettes de cuivre de différents poids comme monnaie.
Durant plusieurs siècles le pays voit le développement d'autres activités, culture du coton et extraction de cuivre notamment.
an 800-902 : Algérie - En 800, un gouverneur arabe du Zâb, Ibrahim ibn al-Aghlab, obtient le titre d'émir et fonde la dynastie des Aghlabides, une dynastie qui, sans rompre avec les califes abbassides, demeure indépendante. Cette dynastie occupe la partie orientale du pays, mais les Aurès et la Kabylie lui échappent.
Tahert devient une riche cité commerçante et un foyer culturel ; ses bibliothèques renferment des textes d'exégèse coranique et des manuscrits de médecine et d'astronomie. Cette période connaît également l'émergence du commerce transsaharien, favorisé par la stabilité des pouvoirs politiques. Les Andalous réaniment le commerce méditerranéen et établissent des colonies sur le littoral : Ténès en 872 et Oran en 902. Tlemcen devient une cité dont les liens avec la culture arabe d'Al-Andalous vont croissant.
an 800 : Mali - Djenné s'est développé grâce au commerce transsaharien de l'or. Elle est devenue un marché et une ville importante avec ses 10 000 habitants
an 802 : Ibrahim-Ben-Aglab (756 - 812) fonde en Afrique le royaume de Kaïrwan, que ses descendants conservent jusqu'en 908. Tripoli, Tunis et Alger en faisaient partie. Dynastie des Aglabides (Aghlabides)
an 817 : MOHAMED (Ziudad-Allah) khalife aglabide de Kaïrwan (817 - 838) fait la conquête de la Sicile.
Kairouan est une ville située dans le désert du nord de la Tunisie. Sous le règne des émirs des Aghlabides, qui ont construit grand nombre de ses monuments, elle est devenue une puissante ville commerçante renommée pour son école d'apprentissage islamique au IXe siècle. Bâtie aux abords de la médina, la Grande Mosquée, avec ses colonnes antiques et son imposant minaret, a été construite à cette période et constitue un important site de pèlerinage.
an 827 : Tunisie - Les Aghlabides s'emparent de la Sicile à partir de 827 mais ne parviennent pas à progresser en Algérie tenue par des kharijites.
an 828 : MOHAMMED, khalife édriside à Fez (828 - 835)
an 831 à 973 : Égypte - En 831, une révolte copte éclate en Haute-Égypte. Le roi de Makurie, Zacharie III Israël en profite pour cesser de payer tribut, mais il doit reprendre les versements à la suite d'une intervention armée du pouvoir de Bagdad. De même, en 854, des affrontements ont lieu entre l'Égypte et les nomades Bedjas.
À partir de 832, l'Égypte est souvent administrée par des gouverneurs d'origine turque. Ahmad Ibn Touloun, installé en 868, s'affranchit du contrôle de Bagdad et fonde la dynastie toulounide. Après la défaite des troupes de Bagdad, il prend la Syrie, la Cyrénaïque et Chypre. Après l'assassinat de Touloun en 896 à Damas, la dynastie peine à résister aux Abbassides qui la reprennent en 905.
À la fin du IXe siècle, les Fatimides chiites s'imposent au Maghreb en ralliant les Berbères. Pour résister à leur menées conquérantes qui tendent à renverser les Abbassides, le pouvoir de Bagdad désigne Muhammad ben Tughj comme gouverneur en 935. Comme un siècle plus tôt, ce gouverneur finit par exercer le pouvoir en son nom et par conquérir la Syrie et à fonder la dynastie des Ikhchidides qui règne en Égypte jusqu'en 969. Le 7 juillet 969, Jawhar al-Siqilli s'empare de Fostat pour le compte des Fatimides. En 973, le calife Al-Muizz li-Dîn Allah fonde, à proximité de Fostat, la ville du Caire qui absorbera ultérieurement Fostat et dont il fait la capitale de l'empire.
L'Égypte se retrouve alors non plus en marge, mais au cœur du pouvoir de la principale dynastie musulmane, ce dont elle bénéficie directement sur le plan économique : le port d'Alexandrie supplante en activité les places de Bagdad et de Bassorah. Les Fatimides bénéficient de la prospérité des terres fertiles du Delta ainsi que du commerce de la mer Méditerranée et de la mer Rouge, richesses qui leur permettent d'entretenir une armée composée de Berbères, de Turcs et de Soudanais. Le pouvoir du calife est affirmé notamment par un cérémonial très précis.
an 835 : ALY, khalife édriside à Fez (835 - 848)
an 838 : ABOU-AKAL, khalife aglabide de Kaïrwan (838 - 841)
an 841 : AHMED, khalife aglabide de Kaïrwan (841 - 863)
an 848 : JAHIA Ier et II, OMAR JAHIA III et IV, khalifes édrisides à Fez, de 848 à 918
an 863 : MOHAMMED II, khalife aglabide de Kaïrwan (863 - 875)
an 868 : Invasion de la Dalmatie par les Arabes d'Afrique. Ils sont battus par le patrice ORYPHAS, qu délivre Raguse et force les musulmans à retourner en Afrique.
an 868 : Égypte - Dynastie des THOULOUNIDES, en Syrie, Égypte, etc. (868 - 904) AHMED-BENTHOULOUN, gouverneur de l’Égypte, se déclare indépendant et fonde la dynastie des Thoulounides. Il règne en Égypte et en Syrie (868 - 884)
Période toulounide (868-935)
an 875 : ABOU-ISCHAK, khalife aglabide de Kaïrwan (875 - 902)
an 884 : KHOUMARROUJAH, Khalife thoulounide en Égypte et en Syrie (884 - 896). pendant son règne commencent des insurrections et des guerres civiles dont le khalife de Bagdad profite pour faire rentrer ces pays sous sa domination.
an 896 : KHOUMARROUJAH, Khalife thoulounide en Égypte et en Syrie est assassiné par des esclaves. Son frère HAROUN lui succède, mais il est tué bientôt après, à la suite d'une défaite par les troupes abbassides. Son oncle CHAÏBAN, qui s'empare du trône est abandonné de ses soldats et obligé de se rendre au khalife de Bagdad MOTADED qui le fait mettre à mort (896 - 905)
Xème siècle : Afrique du Sud - Au nord, dans la vallée du fleuve Limpopo et de la Shashe, s'établit un premier royaume indigène régional à partir du Xème siècle. Économiquement fondé sur l'extraction de l’or et le commerce de l’ivoire, la position stratégique de ce royaume de Mapungubwe permet à ses habitants de commercer via les ports d’Afrique de l’Est avec l’Inde, la Chine et le sud de l’Afrique. Ce royaume prospère est alors le plus important lieu de peuplement à l’intérieur des terres de l'Afrique subsaharienne. Il le demeure jusqu’à sa chute à la fin du XIIIème siècle, laquelle résulte d'un important changement climatique contraignant les habitants à se disperser. Le siège du pouvoir royal se déplace alors au nord vers le Grand Zimbabwe et vers Khami. Diverses communautés s'installent ensuite dans le voisinage.
Xème et XIème siècle : Congo Brazzaville - Les Pygmées sont les premiers habitants du Congo. Le pays a ensuite été touché par la grande migration des Bantous, venus du nord en longeant la côte et les cours d'eau. Plusieurs royaumes, dont on ne connaît pas encore bien les origines, se succèdent ou coexistent. D'abord le royaume de Loango (fondé entre le Xe et le XIIe siècle) dans toute la partie sud, le massif du Mayombe et sur la côte.
Schématiquement, les structures géopolitiques précoloniales congolaises peuvent se simplifier en deux catégories : les sociétés sans État, fondées sur des chefferies qui sont autant de micro-nations que des conditions géographiques et démographiques difficiles ont maintenu dans un relatif isolement, ceci dans la moitié nord du pays, terres Mboshi, Makaa, etc. ; les sociétés à État organisé, dans la moitié Sud, autour de trois pôles essentiels : le vieux royaume de Loango fondé entre les Xe et XIIe siècles.
Xème siècle : Tunisie - Au début du Xe siècle les Fatimides (descendants arabes de Fatima fille de Mahomet) de tendance chiite renversent les Aghlabides et veulent réunifier le monde arabe dans une optique chiite. Ils s'emparent de l'Égypte où ils s'installent en 972; ils confient la Tunisie aux Zirides, leurs alliés berbères. La Tunisie bénéficie de la civilisation liée aux Fatimides.
an 900 à 1500 : Nigéria - De 900 à 1500, le territoire de l’actuel Nigeria était divisé en plusieurs États correspondant peu ou prou aux actuels groupes ethniques, dont les royaumes Yoruba, le royaume Ibo de Nri, le royaume Edo du Bénin, le royaume Haoussa et les Nupe. De nombreux petits États au sud et à l’ouest du lac Tchad furent absorbés. Le Bornou, d’abord province occidentale du royaume de Kanem, devint indépendant à la fin du XIVe siècle. D’autres États ont probablement existé, mais ne sont pas encore formellement attestés.
Royaumes Yoruba
Les Yoruba furent le premier groupe dominant la rive ouest du fleuve Niger. D’origines diverses, ils sont issus de plusieurs vagues de migrations. Les Yoruba étaient organisés en plusieurs clans patrilinéaires qui formaient des communautés villageoises et vivaient de l’agriculture. À partir du XIe siècle, les villages adjacents se regroupèrent en de multiples villes-États. Cette urbanisation s’accompagna d’un fleurissement artistique (statues en ivoire et en terre cuite, objets en métal). Les Yoruba vénéraient une multitude de dieux, à la tête desquels se trouvait une divinité impersonnelle, Olorun. Oduduwa était vénéré comme le créateur de la Terre et l’ancêtre des rois. Selon la légende, il fonda Ife et chargea ses fils d’établir d’autres villes, où ils régnèrent en tant que prêtres-rois. Ife se trouvait au centre de plus de 400 cultes aux dimensions politiques autant que religieuses.
an 901 : Oubangui-Chari Centrafrique - Une civilisation mégalithique qui perdure jusqu’au Ier siècle apr. J.-C. se développe dans la région de Bouar (Ouest). C’est l’apparition de la métallurgie du fer qui semble avoir mis fin à la civilisation des mégalithes (Tazunu en gbaya).
La métallurgie du fer se répand d’ouest en est et s’accompagne d’une expansion de la population dont on considère qu’elle atteignit 6 millions d’habitants sur l’ensemble du territoire centrafricain au XVIIIe siècle. Les populations auraient alors vécu en relative autarcie car à l’écart des grandes voies commerciales africaines.
an 902 : MOKTAFI succède à son père MOTADED dans le khalifat de Bagdad (902 - 908). Il défait les Karmathes et enlève aux Thoulounides l’Égypte et la Syrie. Ce prince aurait relevé la gloire et la puissance du khalifat, si la mort n'eût arrêté ses projets.
an 902 : ABOUL ABBAS III, khalife aglabide de Kaïrwan (902 - 903)
an 903 : ZIUDAD ALLAH III, khalife aglabide de Kaïrwan (903 - 908)
an 905 : CHAÏBAN, dernier khalife thoulounide en Égypte et en Syrie, est vaincu et mis à mort par le khalife de Bagdad. Fin de la dynastie des Thoulounides.
an 908 : MOKTADER, khalife de Bagdad (908 - 932)
an 908 : La dynastie des Aglabides de Kaïrwan est renversée par celle des Fatimides, qui règne de 908 à 971. ABOUL-CASSEM-MOHAMMED, fils d'Obéid-Allah, prétendu descendant d'Ali et de Fatime, le gendre et la fille du prophète, prend les titres de Mahadi (directeur des fidèles) et de khalife de Kaïrwan (908 - 933).
Il soumet toute l'Afrique septentrionale, depuis le détroit de Gibraltar jusqu'à l’Égypte.
Fatima az-Zahra, fille du Prophète de l' Islam d'après Mohamed al-Fateh : Elle est la plus jeune des quatre filles du Prophète. Elle est née à la Mecque avant la révélation. Sa naissance coïncidait avec la reconstruction de la Ka'ba. C'était comme un présage, annonciateur d'un avenir radieux pour le nouveau-né.
Les Fatimides sont une dynastie califale chiite ismaélienne d'ascendance alide qui régna, depuis l'Ifriqiya puis l'Égypte, sur le Califat fatimide, un empire qui englobait une grande partie de l'Afrique du Nord, la Sicile et une partie du Moyen-Orient.
an 909 : Algérie - En proie à des crises intérieures, l'État rostémide succombe aux premières attaques fatimides. Sa capitale est ruinée par l'attaque des Berbères montagnards Kutama, conduits par le « dâ`i » Abu Abd Allah ach-Chi'i. Ses habitants sont massacrés ou exilés. Les réfugiés fuient dans le désert. Ils s'établissent à Sedrata, près d'Ouargla, puis atteignent le Mzab. Au XIe siècle, ils bâtissent plusieurs villes dans la région : Ghardaïa, Melika, Beni Isguen, Bounoura et El Atteuf. Le kharidjisme persiste un temps, mais, après la révolte d'Abu Yazid, il n'y a plus de protestations affiliées au kharidjisme. Il est remplacé par le malikisme, mieux installé à Al-Andalous et à Kairouan. Les dynasties issues du substrat berbère local, Zirides et Hammadides, sont malikites.
Au début du Xe siècle, une nouvelle dynastie supplante les Aghlabides et les Rostémides en Ifriqiya et dans le Maghreb central, les Fatimides. De doctrine chiite, et pensant que le khalifat doit revenir à la descendance d'Ali et de Fatima, fille du prophète Mahomet, ils considèrent les khalifes Abbassides comme des usurpateurs. Aussi, dès sa prise de pouvoir en 909 à Raqqada, le premier représentant de cette dynastie, Ubayd Allah, revêtira-t-il les titres de Mahdi et de commandeur des croyants.
Son accession au pouvoir a été préparée par un prédicateur ismaélien, le Yéménite Abu Abdallah, venu en Ifriqiya après sa rencontre à la Mecque de pèlerins berbères de la Petite Kabylie, des Kutamas. Installé à Ikjan, près de Sétif, où il développe son prosélytisme, il constitue une armée parmi les Kutamas, et s'attaque aux Aghlabites dont il conquiert l'émirat en une quinzaine d'années (893-909)26. Abu Abdallah entreprend alors d'aller chercher Ubayd Allah, maintenu en captivité à Sijilmassa, et ce dernier fait son entrée triomphale à Raqqada en 909. Le souverain, autoritaire et intolérant, pratique une politique fiscale rigoureuse. Il se heurte dès 911 à un complot des chefs Kutamas où Abu Abdallah avait trempé, il les fait exécuter. Pour marquer ses ambitions tournées vers l'Orient, il établit sa nouvelle capitale à Mahdia.
Ubayd Allah se proclame Mahdi et fait assassiner Abu Abdallah. Ce meurtre déclenche des révoltes berbères chez les Kutamas et les Zénètes. Plusieurs tribus érigent des principautés dans les régions montagneuses : les Kutamas de Petite Kabylie, les Sufrites de Tlemcen et les Kharidjites des Aurès.
an 918 : HASSAN, MUSA, KASEM, AHMED et HASSAN II derniers khalifes édrisides à Fez (948 -974). Ces khalifes ne sont que des vassaux des Fatimides de Kaïrwan et quelquefois aussi des Omméyades d'Espagne.
Les Omeyyades, ou Umayyades, sont une dynastie arabe qui gouverne le monde musulman de 661 à 750 puis al-ʾAndalus de 756 à 1031. Ils tiennent leur nom de leur ancêtre ʾUmayyah ibn ʿAbd Šams, grand-oncle du prophète Mahomet. Ils font partie des clans les plus puissants de la tribu de Qurayš, qui domine la Mecque.
an 920-937 : Maroc - À partir de la première moitié du Xe siècle, le Maroc devient l'enjeu des rivalités entre les Omeyyades d'Al-Andalus et les Fatimides d'Ifriqiya.
En 920, une armée au service des Fatimides dirigée par Messala ibn Habbous, émir des Meknassas et gouverneur de Tahert, envahit le Maroc et prend Fès, soumettant le roi idrisside Yahia IV. L'avènement de Hasan al-Hajjam en 925 voit le Maghreb al-Aqsa s'émanciper des Fatimides avant qu'il retombe de nouveau dans leurs mains en 927, et ce jusqu'en 937. Les Idrissides, cependant, ne réussissent pas à réunifier leur royaume qui tombe aux mains des tribus zénètes.
an 929 : Expédition d'ABDER-RAHMAN III, khalife de Cordoue, contre Fez
an 932-973 : Maroc - En 932, les Idrissides perdent Tlemcen au profit des Meknassas pour le compte des califes fatimides. La ville restera aux mains des Fatimides jusqu'en 955, date de sa prise par les troupes omeyyades, avant de retomber aux mains des Fatimides en 973.
Au milieu du Xe siècle, depuis leur forteresse de Hajar Annasr, les Idrissides ne contrôlent plus que le nord-ouest du pays.
an 933 : AHMED, khalife fatimide de Kaïrwan (933 - 945). Il fait des tentatives contre l’Égypte mais il ne réussit pas.
an 935 : Afrique Magreb - Fondation de la dynastie des Zéirides, dite aussi des Sanhadjides ou des Badisides par ZEIRI BEN MOUNAD (935 - 1 150). Il s'attache plusieurs tribus d'origine arabe, se met à leur tête, bat les Zénates et d'autres tribus berbères, et conquiert plusieurs provinces du khalifat de Fez, dont il fait hommage aux Fatimides
Dynastie berbère des Zéirides qui régna dans l'est de l'Afrique du Nord (972-1148) avec pour capitale Kairouan.
Fondée par Yusuf Bulukkin ibn Ziri en 972, elle doit se résigner, au XIe s. à voir les Sanhadjas de l'Ouest devenir indépendants et créées la dynastie des Hammadides, avec pour capitale Qala des Banu Hammad, puis Bougie. Les Zirides répudient l'autorité fatimide et le calife envoie contre eux les bandes bédouines des Banu Hilal, qui dévastent le pays et sèment l'anarchie (1052). Les derniers Zirides, au XIIe s., subissent les invasions des Normands de Sicile. Leur dynastie disparaît sous le coup des Almohades. Un autre groupe ziride a constitué une dynastie à Grenade jusqu'à la fin du XIe s.
an 935 : Algérie - Ziri ibn Menad est le chef des tribus berbères Sanhadjas qui habitent entre Alger et M'Sila. Client des Fatimides, il commence la construction d'Achir en 935, qui devient sa capitale. Les Zirides commencent à bâtir une principauté dans le Maghreb central. Ziri charge son fils Bologhine ibn Ziri de construire trois villes : Miliana, Médéa et Alger.
an 935 : Égypte - Fondation de la dynastie des AKHCHIDIDES ou IKHCHIDIDES, en Égypte et en Syrie (935 - 972). ABOU-BEKR-MOHAMMED, de race turque, gouverneur de l’Égypte, se déclare indépendant et prend le titre d'Akhchid, particulier aux rois de Ferganah, dans le Turkestan. le khalife RHADI lui en accorde l'investiture ainsi que celle de la Syrie, dont il ne possède cependant que la partie méridionale, Damas, Jérusalem, etc. (935 - 946)
Les Ikhchidides sont les membres d'une dynastie de gouverneurs autonomes dirigeant l'Égypte dans un premier temps sous l'autorité des Abbassides (935-969) puis ayant pris leur indépendance.
an 943-958 : Algérie - Ubayd Allah se proclame Mahdi et fait assassiner Abu Abdallah. Ce meurtre déclenche des révoltes berbères chez les Kutamas et les Zénètes. Plusieurs tribus érigent des principautés dans les régions montagneuses : les Kutamas de Petite Kabylie, les Sufrites de Tlemcen et les Kharidjites des Aurès. La plus importante des révoltes est celle que dirige dans les Aurès en 943 Abu Yazid, un kharidjite zénète des Banou Ifren surnommé « l'homme à l'âne ». La révolte gagne l'ensemble du Maghreb. Il parvient, en 944, à défaire l'armée fatimide et à s'emparer de Kairouan. Mais il est tué vers 947, ce qui marque la fin du kharidjisme insurrectionnel.
Des groupes des tribus berbères Zénètes Maghraouas et Ifrenides participent à la grande révolte anti-fatimide d'Abu Yazid. Une branche des Banou Ifrens devient vassale des Omeyyades de Cordoue et contrôle l'Oranie. Leur chef Yala Ibn Mohamed choisit Ifgan comme capitale (Aïn Fekan, près de Mascara) en 938 et détruit Oran en 955. En 958, la nouvelle capitale des Banou Ifren est saccagée par le général Jawhar al-Siqilli qui élimine Yala Ibn Mohamed.
Les Fatimides répriment les révoltes Zénètes et kharidjites avec l'aide de leurs alliés Sanhadjas menés par le chef berbère Ziri ibn Menad. Ils contrôlent désormais le Maghreb et la Sicile. En 969, l'armée fatimide, dont les Kutama forment le noyau, conquiert l'Égypte. Par la suite, les Mahdis fatimides se montrent méfiants à l'égard des Berbères et s'entourent d'étrangers, notamment Slaves.
an 944 : Fondation d'Alger par Zéiri, chef de la dynastie des Zéirides. D'Anville regarde Alger comme l'ancienne Jol ou Carsaria Julia, résidence de Juba. D'après d'autres, ce serait l'ancienne Julia Caesarea.
an 945 : Égypte - AL-MANSOUR, khalife fatimide de Kaïrwan (945 - 953). Il fait des expédition contre l’Égypte et y fonde la ville de Mansourah, où, trois siècles plus tard, Saint-Louis est fait prisonnier avec toute son armée;
an 945 : Mozambique - La présence de routes reliant ce qui est actuellement le Zimbabwe à l'océan Indien favorise l'implantation de nombreux comptoirs commerciaux par les navigateurs indiens, arabes, indonésiens et chinois. Ainsi un capitaine persan, Ibn Shahriyar, dans son Livre des merveilles de l'Inde, rapporte le témoignage d'un marchand arabe du nom d'Ibn Lakis qui, en 945, voit arriver sur la côte du Mozambique « un millier d'embarcations » montées par des Waq-Waqs qui viennent d'îles « situées en face de la Chine » chercher des produits et des esclaves zeng (noirs), mot arabe qui donne à l'époque son nom (zangi-bar, littéralement « côte des Noirs ») à la côte orientale de l'Afrique, appelée au XXIe siècle « côte swahilie ».
an 946 : ABOUL-KASEM succède à son père Mohammed sur le trône des Ikhchidides d’Égypte et de Syrie.
an 950 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - on pense que, vers 950, Ali ibn Hasan, sultan de Shiraz, une petite ville de Perse du sud, fuit son pays accompagné de sa famille et de suivants, pour rejoindre la bande côtière d’Afrique de l’est et ses îles.
an 953 : AL-MOEZ, khalife fatimide de Kaïrwan (953 - 975). Il envoie une flotte contre ABDER-RAHMAN III, khalife de Cordoue, et fait en 968 la conquête de l’Égypte.
an 956 : les khalifes d'Afrique et d'Asie, effrayés des succès des Grecs : Nicéphore II, Fils de Bardas Phocas l'Ancien, Nicéphore II (prénom qui signifie « qui porte la victoire ») appartient à la famille Phocas, originaire de Cappadoce, qui a donné à Byzance plusieurs autres généraux. Il est né vers 912 et rejoint l'armée assez jeune.
les khalifes s'empressent de conclure la paix. A cette occasion, l'empereur Nicéphore II fait revivre l'ancienne solennité du triomphe, il y paraît traînant à la suite de son char un grand nombre d'Arabes enchaînés.
an 960-970 : Éthiopie - Selon plusieurs sources, vers 960-970, une reine aurait pris le pouvoir et semble avoir détruit systématiquement toutes les églises du pays. Elle pourrait représenter une minorité païenne, dont on avait aucune idée jusqu'aux années 2000, qui aurait décidé de se libérer du joug du pouvoir chrétien.
Or la recherche archéologique a permis de montrer, aux XIe – XIVe siècles, l'existence de sociétés élitaires, bénéficiaires du grand commerce, qui ont fait le choix de ne se convertir ni au christianisme, ni à l'islam. Les morts de ces païens sont inhumés, d'une part, de manière collective mais hiérarchisée dans des tumulus sur le haut plateau de l'Éthiopie centrale jusqu'en Érythrée actuelle, dans la région du Manz, et d'autre part, dans des fosses surmontées de stèles et dans des tumulus, dans la région du Tchertcher, à l'est du Rift. Cette culture est dite Shay, du nom d'une rivière qui compte un grand nombre de ces sépultures monumentales. Des sociétés puissantes ont donc occupé des territoires de l'Éthiopie avant que les pouvoirs chrétiens ou musulmans n'en effacent la trace, hormis ces tumulus et ces stèles.
Dès le XIe siècle, des communautés musulmanes s'installent sur le haut plateau éthiopien. Cette présence est documentée par l'épigraphie funéraire et par une historiographie en langue arabe, bien avant les premières chroniques de royaume chrétien. Ces communautés participent du commerce qui provient de la mer Rouge, mais se charge aussi du sel des mines du désert Danakil. Jusqu'au XIIIe siècle a existé aussi un sultanat musulman du Choa. Mais l'on n'en connait que peu de choses.
an 961 : Égypte - ABOULHACAN-ALY succède à son frère Aboulkasem sur le trône des Ikhchidides d’Égypte et de Syrie. A sa mort, arrivée en 966, le vizir KAFOUR, eunuque noir, en qui l'esclavage et la mutilation n'avait ni dégradé l'âme, ni éteint le courage, s'empare du trône. Il recouvre Damas sur SEIF-EDDAULA, qui s'en était emparé, et repousse une invasion du roi de Nubie dans la Haute-Égypte. Mais il ne jouit que de deux ans du trône et meurt en 968
an 969 à 1171 : Égypte - Période fatimide (969 à 1171)
an 970 : DJOUHAR, général du khalife fatimide AL-MOEZ, fait la conquête de l’Égypte sur AHMED, dernier sultan de la race des Ikhchidides. Il fonde près des ruines de l'antique Memphis la ville de Mers-el-Kahira (capital victorieuse), nommée par les Européens le Caire. Fin de la dynastie des Ikhchidides
an 972 : Magreb - Le khalife fatimide de Kaïrwan transporte sa résidence au Caire, en Égypte, après avoir cédé au khalife zéïride IOUSSOUF ses possessions dans l'Afrique septentrionale, en se réservant la suzeraineté; Vainqueur des Karmakes, il est reconnu à Damas, à la Mecque et à Médine.
an 972 : Algérie - En 972, Bologhine est nommé émir du Maghreb par le calife fatimide avant son départ. Il vise à étendre son autorité à l'ouest et s'empare de Tahert et de Tlemcen, dont il déporte une partie de la population à Achir.
Par la suite, les Zirides s'installent en Tunisie et laissent la police du Maghreb central à leurs cousins Hammadides. Le fondateur de la dynastie, Hammad ibn Bologhine est le fils de Bologhine ibn Ziri, nommé gouverneur dans le Maghreb central. Les Hammadides se détachent de l'autorité ziride et construisent une nouvelle capitale Al-Qalaa en 1007.
an 974 : Maroc - Une intervention omeyyade enlève toute indépendance aux Idrissides et en fait leurs vassaux.
an 975 : AZIS-BILLAH succède à son père AL-MOEZ dans le khalifat des Fatimides d’Égypte (975 - 996). Il ajoute à son empire une grande partie de la Syrie, protège les sciences et les arts et embellit le Caire.
an 977 : Maroc - En 977, c'est par le biais de leurs vassaux zirides, dirigés par Bologhine ibn Ziri, que les Fatimides tentent de nouveau de conquérir le Maroc actuel, s'avançant jusqu'à la péninsule tingitane ; ils sont cependant contraints de reculer devant l'armée omeyyade venue d'Andalousie à la demande des Maghraouas.
an 985 : Maroc - À partir de 985, date de la destruction du dernier bastion de l'État idrisside par les Omeyyades, l'extrême occident maghrébin est contrôlé par les Meknassas, les Maghraouas et les Ifrenides, dont les allégeances oscillent entre les califes cordouans et fatimides. Les trois factions zénètes, entrées en conflit les unes contre les autres, exercent alternativement le commandement à Fès, alors que les Ifrenides avancent jusqu'à l'intérieur du territoire des Berghouatas. Jusqu'au milieu du XIe siècle et la réunification par les Almoravides, le Maghreb occidental est partagé entre les différents groupes tribaux zénètes, luttant à la fois les uns contre les autres et contre les Sanhajas ; cette instabilité ne permet à aucune de ces trois tribus de constituer une dynastie durable.
an 990 : Érythrée - De 990 à 1270, la dynastie Zagwé prend le pouvoir. Les Zagwé sont une famille chrétienne orthodoxe du Lasta ayant régné en Éthiopie. Elle succède au royaume d'Aksoum.
an 990 : Éthiopie - Vers 990, le royaume aksoumite s'effondre définitivement. En raison de la progression de l'Islam depuis les côtes, les chrétiens sont repoussés vers l'intérieur des terres et divers prétendants s'affrontent pour le contrôle du centre du pays. Vers 1140, les Zagwés du Lasta, arrivent au pouvoir. Ils dominent initialement la partie septentrionale de leur province, mais à partir du début du XIIIe siècle, ils étendent leur contrôle sur le Tigré, le Bégemeder et l'actuel Welloh. La structure féodale de l'Empire offre aux seigneurs régionaux une relative autonomieh. Le souverain le plus célèbre est Gebre Mesqel Lalibela qui ordonne la construction d'un ensemble d'églises taillées dans la rocheh. Le soutien de l'Église orthodoxe éthiopienne assure aux Zagwés leur suprématie.
an 984 : KASEM, khalife zéïride à Kaïrwan et à Fez (984 - 996)
an 996 : ABOU-MOUNAD, , khalife zéïride à Kaïrwan et à Fez (996 - 1016)
an 996 : ALHAKEM succède à son père Azis Billah dans le khalifat des Fatimides d’Égypte (996 - 1021). Il n'est connu que par ses folies impies, par les excès de son despotisme et par ses fantaisies extravagantes, au nombre desquelles il faut compter sa prétention à passer pour un dieu. Les juifs et les chrétiens furent en butte à ses caprices et à ses vexations. Il mourut assassiné par ordre de sa sœur.
XIème siècle : Afrique du Sud - Al-Biruni, savant arabophone du XIème siècle vivant en Inde, avait préfiguré l'existence d'une route permettant de contourner l'Afrique pour rejoindre l'océan Atlantique. C'est à la recherche d'une telle route vers l'Inde et l'Asie que le Roi du Portugal envoie des navigateurs longer les côtes africaines.
XI - XIIème siècle : Algérie - Du XIe siècle au XIIIe siècle, les Almoravides puis les Almohades ont tenté de construire deux empires regroupant Al-Maghrib et Al-Andalus. Au début du XIe siècle, les nomades Sanhadjas du Sahara occidental se regroupent au sein d'une communauté et se proclament « Almoravides » (al-Murābitūn, « ceux du ribat » ou les garde-frontières du jihad). La guerre sainte vise l'Afrique noire qu'ils veulent convertir. Des campagnes sont lancées dans le Sahel et dans les oasis Drâa et à Sijilmassa. Malgré la mort de leur chef Abou Bakr ben Omar, tué par la flèche empoisonnée d'un Sérère en 1087, l'Empire almoravide s'étend du Sénégal à l'Èbre et au Tage en Espagne au début du XIIe siècle.
L'État almoravide est à la fois religieux et militaire, son armée est composée de Sanhadjas (Lamta et Goudla) auxquels se sont joints des mercenaires noirs et européens. L'autorité religieuse est présentée par les légalistes malékites.
Au Maghreb central, les Almoravides prennent Tlemcen en 1075, Oran et s'arrêtent à Alger, qu'ils enlèvent après un siège en 1082. En 1102, les Hammadides contre-attaquent et les font reculer jusqu'à Tlemcen, mais les Almoravides ripostent, et dès lors leur aire de souveraineté va jouxter le domaine hammadide. Les villes telles qu'Alger et Tlemcen connaissent un épanouissement pendant leur règne, sans dépasser Béjaïa la hammadide qui reste le centre économique et culturel du Maghreb central. Les Almoravides édifient les grandes mosquées de Tlemcen et d'Alger, laissant d'autres vestiges mineurs à Oran, Ténès ou Cherchell. Le déclenchement du mouvement Almohade marque la fin de l'empire des Almoravides.
Le mouvement almohade est fondé par Ibn Toumert qui commence à prêcher sa doctrine en 1117. Il s'installe dans les années 1120 chez les Masmoudas, à Tinmel, dans le Haut Atlas marocain. Les Almohades (al-Muwahhidoun, les « unitaristes ») prônent une doctrine proclamant l'unicité absolue de Dieu et jugent les Almoravides coupables d’anthropomorphisme. Ibn Toumert prêche dans une mosquée à Béjaïa, critiquant les mœurs des citadins, mais il en est chassé. À sa mort, les Almohades désignent son successeur : Abd al-Mumin, un disciple zénète originaire de la région de Nedroma.
Abd al-Mumin transforme la structure politique en monarchie héréditaire et s'appuie sur sa tribu d'origine, les Koumya de Nedroma. Il s'empare de la région de Tlemcen, il prend Oran en 1143, puis Tlemcen en 1145-1146 . Puis, avec 30 000 guerriers, il envahit Marrakech. En 1151, il bat les Hammadides, occupe Béjaïa et écrase les Hilaliens près de Sétif en 1153, puis il les intègre à l'armée régulière. Il achève ensuite la conquête du Maghreb en Ifriqiya. Les Beni Ghania qui se sont maintenus aux Baléares, attaquent le Maghreb central, s'emparent de Béjaïa en 1184, puis d'Alger, d'al Qalaa et Miliana, et ils assiègent Constantine. En 1185, les Almohades contre-attaquent, les Beni Ghania se replient alors en Ifriqiya.
L'empire décline et se décompose au cours de la première moitié du XIIIe siècle. En 1212, lors de la bataille de Las Navas de Tolosa, il subit une importante défaite face aux armées chrétiennes en Espagne. Au Maghreb, le gouverneur de l'Ifriqiya se proclame indépendant en 1229, puis le gouverneur de Tlemcen en 1236. Dans le même temps, la Reconquista progresse en Espagne. Les Mérinides mettent fin à l'Empire almohade, en 1269, par la prise de Marrakech.
Les Almohades auront tenté de constituer un État institutionnalisé. Sous leur règne, l'activité économique se concentre sur le littoral, où se pratique le commerce portuaire. L'empire connaît de nombreuses révoltes malékites, les Almohades procèdent à des conversions forcées de juifs et de chrétiens. L'arabisation progresse sans retour, l'arabe devenant la langue de haute culture, le mysticisme et les chants soufis se développent et le Maghreb connait un grand afflux d'immigrés andalous.
XIème et XIVème siècle : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - L'empire du Ghana est le premier à dominer la région. Plusieurs vagues d'immigration amènent les Mossi du XIe au XIVe siècle[réf. souhaitée]. Leur intégration aux populations locales donna naissance à quatre royaumes dont le plus septentrional et le plus important, le royaume du Yatenga eut des rapports conflictuels avec son puissant voisin du Soudan Occidental, L'empire du Mali, allant jusqu'à conquérir Tombouctou en 1329. Doté d'une administration centralisée et d'une défense efficace, le Yatenga résista à l'islamisation que tentait de lui imposer l'empire des Songhaï.
D'autres invasions brassèrent la population de l'actuel Burkina : Gourmantché, Bwa, Sénoufos, Gan, Bambaras puis, dans le nord, Touareg, Peuls, Songhaïs, Bissa et Djerma, Malinké.
XI - XVIème siècle : Guinée-Bissau - Du XIe siècle au XVIe siècle, plusieurs migrations de groupes de langue Mandé arrivent de l'Ouest, la principale étant un début d'invasion au XIIIe siècle des territoires baïnouks. Certaines sont accompagnées d'éleveurs peuls.
XIème et XVème siècle : Afrique Côte d'Ivoire - Mais le pays est surtout une terre de refuge et de migration qui reçoit, en provenance de la zone du Sahel, entre le XIe siècle et le XVIe siècle, les Mandé forestiers (Dan, Gban et Kwéni) mais également aux XIVe siècle et XVe siècle, d’autres groupes venus du nord (Ligbi, Numu et quelques clans Malinké), ce qui provoque des déplacements limités de populations plus anciennement établies (Krou sur la côte avant le XVe siècle et Sénoufo). Les XVIe siècle et XVIIe siècle consacrent l’arrivée au nord de plusieurs clans Malinkés ou mandé-dioula (Kamagaté, Keita, Binate, Diomandé) et Sénoufo et au sud-est, des peuples en provenance de la basse vallée de la Volta (Efié, Essouma, Abouré, Alladian et Avikam). L’un de ces groupes akan (Abron) s’installe dans la région de Bondoukou à l’est du pays.
XIème siècle : Eswatini (Swaziland) - Au XIe siècle, les Bantous de langues sotho du Sud et nguni avaient définitivement écartés les Khoisans de la région et s'étaient définitivement installés sur le territoire du futur Swaziland.
Les Dlamini étaient un clan issu du peuple Nguni et s'étaient établis à l'origine au Mozambique.
XIème et XVIIIème siècle : Gabon - Étudier le Gabon ancien n'est pas facile faute de témoignage écrit. Les traditions orales des différents peuples ne sont pas faciles à interpréter notamment quant à déterminer la part de la réalité et de l'imagination dans le mythe. En outre, le climat équatorial et la nature des sols ne permettent pas une bonne conservation des restes humains et des traces de leurs activités. Néanmoins, il reste probablement des découvertes à faire.
Pour l'époque historique, les premiers habitants du Gabon sont des Pygmées émigrés d'Afrique centrale. Ils ont été poussés par les migrations bantoues qui, à leur tour, peuplent le Gabon du XIe siècle au XIXe siècle. L’histoire du pays avant l’arrivée des Européens est une panoplie de récits de chasse, de pêche, de cueillette mais aussi d’agriculture et de guerre des différentes ethnies. Les Mpongwés et les Oroungous occupent les côtes tandis que les Loumbous exploitent le sel et que les Akélés et les Nzebis sont connus pour être de hardis chasseurs d’éléphants. Les dernières populations arrivées au XIXe siècle, les Fang, constituent de nos jours un tiers de la population du pays.
Les Mpongwes (des Bantous), s'installent entre le XIe siècle et le XVIIIe siècle dans la zone de l'actuelle province de l'Estuaire. Le peuplement du Gabon se poursuit jusqu'au XVIe siècle tant par le nord via la vallée de l'Ivindo (Mitsogos, Okandés, Bakotas…) que par le sud (Échiras, Punus, Balumbus, Nzebi, Adoumas…). Les Fangs, eux aussi bantous, s'installent progressivement jusque dans le courant du XIXe siècle.
XI - XIIème siècle : Gambie - Vers le XIe ou le XIIe siècle, les dirigeants des royaumes tels que le Tekrour (une monarchie centrée sur le fleuve Sénégal, juste au nord), ancienne Ghana et Gao, sont convertis à l'islam.
XIème et XVème siècle : Libye - La période suivant la conquête arabe est l'une des plus mal connues de l'histoire de la Libye. La région du Djebel Akhdar vit largement repliée sur elle-même, livrée au nomadisme. Dans le sud, les grands caravaniers se livrent des conflits réguliers. En 1185, le Royaume du Kanem-Bornou prend le contrôle d'une partie du territoire, mais est chassé au XIVe siècle par les Marocains, qui fondent la ville de Mourzouq. Les Normands s'emparent de la Tripolitaine de 1143 à 1158, date à laquelle le gouverneur de la province se place sous la suzeraineté de l'Émir de Tunis. La région connaît de nombreux affrontements et changements de statut, mais les Hafsides finissent par s'emparer de Tripoli en 1318, et en font leur résidence. En 1355 ou 1358, Gênes envahit à son tour de Tripoli et lui impose une amende de 1,9 million de florins et la livraison de 7000 esclaves. La ville devient indépendante, gouvernée par la tribu des Beni Thabet, qui refuse de reconnaître l'autorité de l'Émir de Tunis. Devenue une République, Tripoli est gouvernée au XVe siècle par un conseil de notables : la ville est une place très importante pour le commerce et la piraterie de la Méditerranée et du Sahara.
XIème siècle : Mali - Fondé au XIe siècle.
XIème siècle : Mayotte - Les premières enceintes fortifiées apparaissent (rempart de Majicavo, d'Acoua, etc.) et signalent dès cette haute époque l'existence de potentats locaux attribuables à des chefferies. L'élevage du zébu, déjà présent lors de la période Dembeni, se généralise : nombre de ces enclos villageois sont des enclos pastoraux. La constitution de cheptel, la maîtrise du commerce et l'islamisation participent à l'apparition d'une aristocratie. Ainsi s'élabore dès le XIe siècle une période nouvelle qui préfigure la structuration politique de l'archipel des Comores en sultanats : l'époque des Fani. Ce terme désigne les chefs, hommes ou femmes islamisés, dirigeant l'espace villageois, entité politique alors indépendante.
Une influence croissante de la côte swahilie
L'archipel des Comores constitue la frontière sud de l'aire culturelle swahilie qui se développe à partir de la fin du Moyen Âge dans cette région que l'on appelle en Europe le Zanguebar ; Mayotte constitue également le point de contact de cet ensemble avec la culture malgache, très différente, ce qui fait très tôt de cette île un carrefour d'influences — mais aussi une cible guerrière. Les influences venues de l'ensemble de l'océan Indien, mais aussi de la côte africaine, chamboulée par l'irruption des Bantous, et de la côte malgache, ne cessent de façonner la société swahilie insulaire. Une immigration bantoue et malgache (Sakalava) commence progressivement.
Mayotte, comme le reste de l'archipel, entre alors sous l'influence de la culture swahilie, influence qui s'explique comme à Ngazidja et à Ndzuani par l'installation de nouveaux clans originaires de la côte swahilie et sudarabique, venus principalement pour s'enrichir du commerce régional et propager l'islam. Ces nouvelles influences transforment profondément la société qui adopte le même mode de vie que les populations swahilies de la côte africaine. C'est alors que des petites bourgades se constituent, prospérant du commerce des esclaves principalement et de l'exportation des productions agricoles (viandes, riz). Les premières habitations en pierre, résidences des élites révélées par l'archéologie, apparaissent dès le XIVe siècle. Les rivalités entre ces localités et peut-être déjà entre les îles, se traduisent par la multiplication des sites fortifiés. Les principales localités d'alors sont Mtsamboro, Acoua, Tsingoni, Bandrélé... qui connaissent un fort développement et amorcent un processus d'urbanisation.
L'islamisation des élites : Si les sépultures islamiques de la nécropole de Bagamoyo (IXe – Xe siècle) témoignent d'une présence ancienne de l'islam dans l'île, le nombre croissant de découvertes de sépultures musulmanes datées des XIe et XIIe siècles atteste d'une islamisation massive des élites mahoraises autour du XIIe siècle, ce qui rejoint les écrits d'al Idrisi qui au XIIe siècle rapporte que les élites de l'archipel sont musulmanes (il s'agit alors de la première mention écrite de l'archipel des Comores.
Les mosquées anciennes de Mayotte : Bien que des sépultures islamiques aient été découvertes dans la nécropole de Bagamoyo (Petite-Terre) pour les IXe – Xe siècles, aucune mosquée remontant à cette haute époque n'a encore été révélée à Mayotte, d'une part parce que la recherche archéologique est encore très insuffisante dans ce domaine et d'autre part parce que les édifices religieux de cette époque étaient construits en matériaux périssables et n'ont donc laissé peu de traces visibles pour orienter une fouille archéologique.
XIème siècle : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - D’autres vagues de migrants arrivent au XIe siècle, principalement en provenance de la péninsule arabique.
Pour ces différents immigrants parlant l’arabe, la terre où ils débarquent est « Zenji-bar », littéralement la terre des noirs en persan, d’où l’origine possible du nom Zanzibar.
Sur la côte et les îles, ces nouvelles populations se mélangent culturellement et sociologiquement avec les autochtones africains. C’est la naissance de la culture swahilie, métissage des traditions africaines et des croyances arabo-musulmane. Les langues swahilies, issues de ce métissage et basées sur une structure linguistique bantoue enrichies de nombreux apports d’arabe, sont à l’image de ce mélange culturel.
Des cités-États commerçantes sont fondées par les migrants arabes : Lamu, Pate, Pemba, Zanzibar, Malindi, Mombasa, Sofala. Les Shirazis perses s’installent à Kilwa qui devient le centre de commerce le plus florissant de la région (Sultanat de Kilwa) au XIe et surtout au XIVe siècle
an 1 000 : Angola - Les premiers habitants de l’Angola sont des khoïsan vivant de chasse et de cueillette, ne connaissant ni le métal, ni l’agriculture. Leurs sociétés, peu nombreuses, n’étaient (et ne sont toujours pas) pas hiérarchiques, mais égalitaires.
Les peuples de langue bantoue commencèrent à émigrer par vagues successives depuis le golfe de Guinée et atteignirent la région dans les premiers siècles après l'an 1000. Les Khoïsan furent progressivement absorbés ou repoussés vers le sud où des petits groupes résiduels existent jusqu'à ce jour. Les Bantous constituèrent au long des siècles toute une série d'ethnies, normalement divisées en sous-groupes. Chaque ethnie ou sous-groupe s’identifie à un ancêtre mythique, mais ces ethnies ne cessent d’évoluer avec leurs lignages et autres clivages donnant souvent naissance à d’autres sous-groupes parfois antagonistes. Les Bantous imposèrent une société hiérarchique et apportèrent la métallurgie et l’agriculture. Les terres étaient invendables et étaient une propriété collective. L’esclavage était déjà connu, et était juridique, les prisonniers de guerre ou les criminels devenant des esclaves temporaires. Assez tôt se formèrent des unités politiques d'envergure, dont les plus connues sont le Royaume du Kongo et le Royaume Lunda.
Les Bakongo parvinrent à développer une civilisation puissante. Leur royaume finit par dominer le Nord-est de l'Angola actuelle, l'ouest de la république démocratique du Congo et de la république du Congo ainsi que le Sud du Gabon. Il était à son apogée lors de l’arrivée des Européens, grâce à l’échange d’objets de fer (armes, houes) contre de l’ivoire avec les peuples de l’intérieur. Le souverain, le mani-kongo, vivait dans une vaste capitale, Mbanza-Kongo (le fort des Kongo). Les Bakongo utilisaient les coquillages comme monnaie, et le tissage des habits avec du raphia ou du cuir ainsi que le travail du métal étaient réservés aux aristocrates : les mani vangu-vangu. Le léopard est considéré comme un animal sacré, symbole de l’intelligence. Nombreux seront les dignitaires à porter un chapeau léopard en guise de couronne.
Au sud de ce royaume, les Ambundu (dont une partie était liée au mani-kongo) constituèrent plusieurs États, notamment Ndongo (dont le roi porte le titre de Ngola, d’où le pays tirera plus tard son nom) et Matamba. Au nord-est s'imposa le Royaume Lunda dont le centre se trouvait dans l'extrême sud (Katanga devenu Shaba) de la République démocratique du Congo.
Au centre du pays, sur les plateaux, se forme une autre importante ethnie, les Ovimbundu, qui constituent également plusieurs États. Ceux-ci soumettent pendant certaines périodes des petites ethnies vivant plus à l'est et leur imposent un tribut (esclaves, bétail, métaux). Leur langue, l’umbundu, se répand comme langue commerciale dans l’est du pays. À l'ouest, les Ovimbundu assimilent progressivement les populations vivant entre les montagnes et la mer.
Au sud des Ovimbundu se constituent toute une série de peuples - surtout les Nyaneka-Nkhumbi, qui combinent l'agriculture et l'élevage, et les Ovambo qui vivent de l’élevage et du commerce de sel et de fer.
an 1 000 à 1 317 : Éthiopie - De nouvelles recherches, aidées par l'archéologie, ont permis de combler le vide qui régnait entre la dynastie aksoumite et la dynastie Zgagwé, le Moyen Âge éthiopien s'étend du VIIe siècle (haut Moyen Âge) au début du XVIe siècle.
Royaume de Damot (en) (1100-1317, Welaytas et Sidamas)
an 1001-1007 : Algérie - Les Hammadides se détachent de l'autorité ziride et construisent une nouvelle capitale Al-Qalaa en 1007.
En 1005, Hammad impose à son neveu Badis ben Mansur un accord de partage du pouvoir, dès lors le Maghreb central et l'Ifriqiya sont gouvernés par deux autorités distinctes. À l'ouest, les Hammadides manœuvrent pour renforcer leur pouvoir sur les tribus Zénètes, mais les émirs Maghraouas s'appuient sur les Omeyyades de Cordoue pour contrarier leur extension. Les Hammadides rejettent la suzeraineté fatimide pour signifier leur indépendance.
an 1014-1094 : Ghana - À la fin de l'ère classique, plusieurs royaumes émergent en Afrique de l'Ouest, dont l'empire soninké du Ghana au nord du Ghana actuel. À l'origine, le titre ghana ne désigne que le roi, mais les textes arabes l'emploient pour parler du roi, de la capitale et du royaume lui-même. Au IXe siècle, l'historien et géographe arabe Al-Yaqubi désigne le Ghana comme l'un des trois États les plus organisés de la région avec Gao et le royaume du Kanem-Bornou. Il fait état de la richesse en or du royaume, de l'opulence de sa cour et de l'habileté de ses guerriers. Le commerce de l'or y attire de nombreux marchands d'Afrique du Nord. La puissance militaire et le contrôle sur les mines d'or de la région déterminent les relations du Ghana avec l'Afrique du Nord et la Méditerranée pour plusieurs siècles. Al-Bakri (1014-1094), compilateur andalou décrit le royaume à l'époque du roi Tankâminîn (Aoukar, Royaume du Ouagadou, Koumbi Saleh, Empire du Ghana).
an 1015-1052 : Algérie - Les Hammadides adoptent le sunnisme en 1015 et les Zirides en 1048. Pour les punir, les Fatimides envoient contre eux les tribus arabes des Hilaliens installés en Haute-Égypte en 1051 et 1052. Les Hilaliens déferlent d'abord en Ifriqiya, les Zirides se réfugient dans le littoral et seront définitivement chassés par les Normands en 1148. Le royaume hammadide, moins touché par les incursions des Hilaliens, profite des troubles qui secouent l'Ifriqiya pour prendre l'avantage sur les Zirides.
an 1016 : MOEZZ, sultan zéïride à Tunis et à Tripoli (1016 - 1061). Il se met sous la protection du khalife de Bagdad, après avoir secoué le joug de celui de l’Égypte, qui excite contre lui les tribus berbères, dont les attaques, jointes à celles des Normands en Sicile, occupent son long règne et préparent la chute de la dynastie des Zéïrides.
an 1036 : MOSTANSER-BILLAH succède à son père DHAHER sur le trône des Fatimides (1036 - 1094). Son règne, le plus long dont il soit fait mention dans les annales du khalifat, n'est remarquable que par les calamités qu'il attira sur l’Égypte et la Syrie. Cependant BEDR-AL-DJEMALZ, qui s'était élevé de la condition d'esclave aux fonction de gouverneur de Syrie, et qui soumit les émirs révoltés, pacifia les tribus arabes, et, pendant vingt ans, gouverna l’Égypte comme 1er ministre avec un pouvoir absolu, dont il se servait pour rétablir l'ordre et la prospérité.
an 1045-1155 : Mauritanie - Les tribus Sanhajas s'unissent sous la férule d'un certain Abû Bakr Ibn Umar, un chef de tribu ambitieux et d'un juriste malékite, Abd Allah Ibn Yasîn qui, de retour de pèlerinage, apporte avec lui une idéologie réformatrice, centrée autour de monastères combattants, les Ribât, pour instaurer le sunnisme et la jurisprudence malékite au maghreb tout entier.
Peut être le premier de ses Ribât fut il fondé sur une île Imraguen de la côte, en tout cas, son disciple Abû Bakr décide parvient à unifier vers 1045 les Sanhaja du Tagant, du Hodh et du Sénégal, il prend Awdaghost, puis Koumbi, fonde un autre Ribât sur une île du fleuve Sénégal et prend le contrôle des oasis de l'Adrar, en fondant la cité-capitale d'Azougui.
En 1055, il remonte les routes commerciales et soumet les Zénètes de Sijilmassa, franchit ensuite l'Atlas, écrase ceux d'Aghmat et fonde non loin d'elle, sur le Tensift, aux débouchés des cols du Test (vers le Souss) et du Tishka (vers le Draa), une cité-capitale à Amur N'Akush : Marrakech, il laisse alors le pouvoir à son lieutenant Yussuf ibn Tashfin et revient combattre dans l'espace Mauritanien ; l'empire almoravide, issu de ces murabitun se détourne des terres sahariennes, et perd peu à peu son influence sur les Sanhaja, qui rejettent toute obédience.
Un siècle plus tard, une confrérie Zénète prend le contrôle du Maghreb tout entier, mais se soucie peu du Sahara, qui passe sous l'influence plus proche de l'empire Soussou de Soumaoro Kanté, puis celui du Mali, de Sunjata Keita, les cités de Oualata, Awdaghost, Azougui, talonnées par les célèbres Chinguetti, Ouadane et Tichitt, ou encore Rashid et Qçar al-Barka se développent et prennent un rôle majeur dans le très intense commerce caravanier qui relie Djenné dans le delta intérieur du Niger, aux cités almohades puis Mérinides du "royaume de Marrakech".
an 1050 : Magreb - Fondation de la secte des ALMORAVIDES ou ALMORABETHIN, c'est à dire consacrée au seigneur, par ABDALLAH-BEN-YACIM. Ce nouveau prophète musulman sut si bien exciter l'enthousiasme des tribus arabes et berbères qui habitaient les hauteurs de l'Atlas du côté de l'océan Atlantique, que bientôt il fut en état de convaincre par la force ceux qui n'avaient pas voulu céder à la persécution.
Confrérie de moines guerriers, Berbères sahariens qui, au XIᵉ siècle, sous la direction spirituelle de Abd Allah ibn Yasin, entreprirent la conquête du Maroc et y fondèrent une dynastie qui, après avoir conquis le Maghreb central jusqu'à Alger, étendit sa domination sur l'Andalousie (1086).
Dynastie berbère saharienne, qui constitue du XIᵉ siècle au XIIᵉ siècle une confédération de tribus puis un empire englobant le Maroc, la Mauritanie, le Sahara occidental, l'Ouest de Algérie ainsi qu'une partie de la péninsule Ibérique et du Mali. Ils firent la guerre sainte aux Noirs du Sénégal.
an 1051 : Tunisie - Les Zirides rompent avec les Fatimides qui pour se venger lâchent en 1051 sur la Tunisie et le Maghreb les Beni Hilal, venus d'Arabie, qui ravagent le pays. Avec cette invasion la Tunisie est totalement arabisée.
an 1059 : ABOUBEKR succède à ABDALLAH comme prince des Almoravides (1059-1069); Ce nouveau conquérant qui prend le titre de Commandeur des Croyants (émir al moumenine) s'étend dans la partie occidentale du Magreb (royaume actuels de Fez et du Maroc) ainsi que dans d'autres parties de l'Afrique, et en expulse à la fin les Zéïrides. De 1061 à 1108, TAMIM, sultan zéïride à Tunis et à Tripoli, est presque toujours occupé à combattre les rebelles. Il perd la Sicile contre les Normands.
an 1060-1147 : Maroc - Dynastie almoravide (v.1060-1147)
C'est dans la région de Taroudant qu'un dénommé Ouagg ben Zellou indique l'existence d'un prédicateur, un certain Abdallah Ibn Yasin originaire du Sud marocain, à l'émir lemtouna Yahya Ibn Ibrahim de retour d'un pèlerinage à La Mecque. Yahya Ibn Ibrahim s'était arrêté à Kairouan où le grand théologien Abou Imran al-Fasi lui avait recommandé son disciple au Souss, Ouagg ben Zellou, pour l'aider dans son entreprise de purification spirituelle des Sanhajas nomades du Sahara. L'émir lemtouna et Ibn Yasin s'en retournent donc tous deux dans l'Adrar convertir les Djoudala (tribu des Lemtouna) au malékisme puritain. Si au départ leurs enseignements sont plutôt bien accueillis, leur austérité et leurs méthodes radicales (instruments de musique et habits de couleurs vives bannis) finissent par lasser. Yahya Ibn Ibrahim et Abdallah Ibn Yasin errent donc dans le désert et s'en vont fonder un ribat sur l'île de Tidra entre la baie du Lévrier et le cap Timiris. Là ils adoptent une véritable doctrine fondée sur l'interprétation la plus stricte du sunnisme malékite qui leur valut le nom d'Almoravides (de Al-murabitun, المرابطون), les gens du ribat.
Le climat d'exaltation mystique qui régnait au ribat attire de nombreux fidèles de toutes les contrées du Sahara occidental et même au-delà. De 1042 à 1052, les Almoravides conquièrent tout l'ouest du Sahara et tournent leurs regard vers le nord. Yahya Ibn Ibrahim est tué au combat et remplacé par Abu Bakr Ibn Omar. Dès lors l'expansion des Almoravides est irrésistible. Aoudaghost, place forte de l'empire du Ghana et importante étape du commerce transsaharien, est prise et détruite. L'année suivante, c'est au tour de Sijilmassa de céder à la pression almoravide et de voir ses maîtres zénètes impitoyablement exterminés. La même année (1056), Taroudant et le Souss alors aux mains de tribus chiites vassales des Fatimides se rendent aux envahisseurs sahariens. Les Almoravides n'ont alors qu'une idée : soumettre les plaines fertiles du Maroc utile et les intrépides tribus de l'Atlas. Néanmoins, les combats contre les hérétiques Berghouata s'éternisent et s'avèrent plus durs que prévu. Abdallah Ibn Yasin est même mortellement blessé et inhumé sur un des affluents du Bou Regreg. Abou Bakr doit alors se rendre à nouveau dans le désert pour mettre fin à des luttes intestines et il confie alors le commandement des terres septentrionales nouvellement conquises à son cousin Youssef Ibn Tachfin.
En 1072, ce dernier empêche le retour d'Abou Bakr et fait dès lors de Marrakech, fondée deux ans plus tôt, sa capitale. La rigueur morale de ces « Voilés » et leur attachement aux valeurs islamiques attirent les nombreux déçus du climat d'anarchie ambiant et Youssef Ibn Tachfin constitue sans mal une armée de 20 000 hommes qu'il arme d'arbalètes. Toutefois, la soumission des intrépides tribus Zénètes n'est pas des plus aisées. Ces derniers se rallient même ponctuellement aux élites bourgeoises de Fès et de Tétouan, bien décidées à repousser ces tribus dont le puritanisme était aux antipodes des aspirations de raffinement et de luxe importées d'Andalousie. Des villes du nord, Meknès tombe la première, puis c'est au tour de Fès (1060 ou 1061), des villes du Rif, de Tlemcen (1069) et enfin d'Oujda (1081). Tanger et Ceuta, fiefs de la dynastie hammudite de Malaga ne cèdent que vers 1084 après un éprouvant siège et subissent de terribles supplices. À l'est, les Almoravides avancent jusqu'à Alger et atteignent les limites du royaume des Hammadides (Ténès et Oran sont gagnées en 1082). L'épouse de Youssef Ibn Tachfin, Zaynab Nefzaouia, joue un rôle politique prééminent, au point d'être perçue comme l'égale d'une véritable reine (malika). C'est elle qui traite des affaires courantes de l'Etat à Marrakech pendant que son mari mène des campagnes militaires victorieuses.
Alors que dans la brillante Andalousie, les princes musulmans subissaient les premiers revers face aux chrétiens ligués autour de la personne d'Alphonse VI, les extraordinaires prouesses militaires de ces « Voilés » aux mœurs rigides résonnent comme une bénédiction. Al-Muttawakil de la Taifa de Badajoz fait appel aux Almoravides dès 1079. En 1082, c'est au tour d'Al Mutamid Ibn Abbad de solliciter les maîtres du Maghreb. En 1086, pour répondre à ces appels et pour enrayer la « décadence » de la civilisation d'Al-Andalus (arts florissants, consommation de vin...), Youssef Ibn Tachfin fait embarquer de Ceuta la bagatelle de 7000 cavaliers et 12 000 fantassins. Rapidement, les rois des différentes taifas rallient les armées almoravides pour former un front commun contre l'ennemi castillan.
Les victoires s'enchainent et les armées d'Alphonse VI sont mises en déroute non loin de Badajoz le 23 octobre 1086. Youssef Ibn Tachfin rentre au Maroc régler des affaires internes mais le désordre en Andalousie le pousse à revenir. Il est néanmoins poussé par les fakihs à revenir, du fait des difficultés lors du siège à Aledo et surtout des divisions entre taifas qu'il considérait personnellement comme une honte pour l'islam. En 1090, un concile almoravide à Algésiras déclara la guerre aux reyes de taifas accusés d'impiété et de fitna. L'alliance de certains de ces derniers avec des princes chrétiens n'empêcha pourtant pas l'irrésistible avancée des Almoravides en Al-Andalus, qui s'acheva en 1094 avec la prise de Badajoz et l'impitoyable mise à mort d'Al-Mutawakil et de sa famille. Les victoires s'enchainent encore face au Cid retranché à Valence.
En 1106, après la prise de Valence et alors que les Baléares sont enfin occupées, Youssef Ibn Tachfin décède et son fils, Ali Ben Youssef hérite du trône et du titre de "Commandeur des Musulmans" que lui octroie le calife abbasside Al-Mustazhir (les Almoravides considèrent le titre califal réservé exclusivement aux Abbassides de Bagdad, dont ils reconnaissent la prééminence religieuse et dont ils utilisent les insignes symboliques)57. Fils d'une esclave chrétienne affranchie, il devient par la même occasion maître d'un empire s'étendant du Tage au fleuve Sénégal, et du centre de l'Algérie jusqu'aux côtes atlantiques marocaines. Il nomme son frère Temyn gouverneur d'Al-Andalus. Les armées almoravides défont Sancho, fils d'Alphonse VI lors du siège du château d'Uclès. Alphonse VI décèdera l'année suivante, en 1109. Ali revient alors en Andalousie et remporte les sièges de Madrid, Guadalajara et Talavera. À l'ouest, les armées almoravides poussent jusqu'à Porto, menaçant même les côtes galiciennes. À l'est, les Baléares servent de base logistique aux razzias menées contre Barcelone.
Cependant, les innombrables exploits militaires ne parviennent pas à pallier le mécontentement ambiant en Andalousie où le fragile équilibre entre chrétiens mozarabes, juifs et musulmans est quelque peu rompu par la rigueur religieuse imposée par les conquérants. L'autodafé des écrits du très populaire Al-Ghazali ne fait qu'amplifier le malaise des élites culturelles, nostalgiques de l'âge d'or du califat omeyyade. Les mozarabes de Grenade, accusés de collusion avec le royaume d'Aragon, sont expulsés au Maroc, notamment dans les régions de Salé et de Meknès, en 1125. Paradoxalement, la sollicitation par l'armée divine des milices chrétiennes de Reverter pour maintenir l'ordre au Maroc même est mal comprise par les tribus montagnardes du Haut-Atlas, de jour en jour plus mécontentes de l'autoritarisme almoravide.
an 1069 : YOUSSOUF, fils de TASCHFIN, cousin d'ABOUBEKR, le plus célèbre et le plus puissant prince de la dynastie des Almoravides, dont il est regardé généralement comme fondateur (1069 - 1106). Il achève les conquêtes commencées par son prédécesseur, crée la ville de Maroc, dont il fait la capital de son empire, subjugue les principaux États mahométans de l'Espagne et fonde un empire qui s'étend depuis l'Ebre et le Tage jusqu'aux frontières du Soudan.
an 1073 : Les arabes sont définitivement expulsés de l’île de Sicile.
an 1076 : Mali - Empire du Ghana aussi nommé Ouagadou, il est érigé par les Sarakolés au IVe siècle. Il fonde sa prospérité sur le sel et l'or. L'empire se désagrégera en 1076 à la suite des percées des berbères venus islamiser l'Afrique occidentale.
Empire du Mali fondé au XIe siècle, il est unifié vers 1222 ou 1230 par Soundiata Keïta, roi du Mandén, région correspondant à peu près à l'actuel Mali. Il coalise les Malinkés afin de contrer les attaques du roi du Sosso, Soumaoro Kanté.
an 1080 : Sénégal - Les Almoravides (confrérie de moines guerriers d’origine berbère qui régna sur le Maghreb et l’Andalousie de 1061 à 1147) entreprennent l’islamisation du Sénégal actuel.
an 1081 : Rwanda - Le Rwanda devient un royaume à la tête duquel 25 rois se succèdent entre 1081 et la colonisation.
an 1085 à 1603 : Tchad - Origine du Kanem (Kanem-Bornou)
Le royaume du Kanem est fondé vers le VIIIe siècle par des Maguimi. Sa capitale fut la ville de Njimi. Musulman à partir du règne d’Oumé (vers 1085), il atteignit son apogée avec Dounama Dibalami (1220/1259), qui l’étendit vers le Fezzan et le Nil et lia des relations avec les royaumes berbères, en particulier avec les Almohades.
Après la mort de Dounama, le Royaume se morcela rapidement. Au XIVe siècle, il fut menacé par les Sao et les Boulala venus de l'est. Pour échapper à ces attaques extérieures, les souverains du Kanem durent se réfugier sur la rive ouest du lac Tchad où ils fondèrent le royaume de Bornou en 1395.
Le Bornou reconquit le Kanem et devint le Kanem-Bornou au XVIe siècle. L'Empire atteint son apogée sous le règne d'Idriss III Alaoma (1580-1603). À la fin du XVIIIe siècle, le Bornou a retrouvé une puissance certaine et étend son influence jusque sur les peuplades de la Bénoué moyenne. Sa prospérité est essentiellement basée sur le trafic des esclaves. À la fin du XIXe siècle, la région est ravagée par le négrier soudanais Rabah qui s'impose comme le dernier sultan du royaume ; puis ce dernier est écrasé par les troupes coloniales françaises en 1900.
an 1086 : ORTOK, Turcoman qui commandait les troupes auxiliaires envoyées par MALEK-CHAH au secours de TOUTOUSCH, enlève Jérusalem aux Fatimides d’Égypte et y établit sa propre souveraineté qu'il transmet à ses fils SOKMAN et IBN-GHAZI. Ceux-ci sont dépouillés par AFDHAL, fils de BEDR et comme lui vizir du khalife fatimide MOSTALY (1094 - 1101), peu de semaines avant l'arrivée des Croisés devant la Ville Sainte. Sous la sage et ferme administration du vizir AFDHAL, l’Égypte est heureuse malgré la faiblesse et l'incapacité du khalife.
an 1090-1052 : Algérie - Toutefois, pour éviter l'affrontement avec les tribus arabes et pour mieux s'intégrer au commerce méditerranéen, les Hammadides transfèrent leur capitale à Béjaïa qu'ils fondent en 1064 et s'y installent définitivement en 1090 avant d'être vaincus par l'Almohade Zénéte Abd al-Mumin en 1151.
Cette migration, connue en français sous le nom d'« invasion hilalienne », est un long processus qui s'étale sur trois siècles. Elle ne concerne pas que des guerriers mais des tribus. Elle constitue un événement majeur pour tout le Maghreb. Le bilan de cette migration est contrasté. Ibn Khaldoun est un citadin qui exprime les vues des hommes d'ordre de son époque. Des tensions se font jour entre Arabes nomades et sédentaires. Mais ce type de tensions existait de longue date entre sédentaires et nomades berbères. Les Arabes nomades sont progressivement intégrés dans la société d'accueil qui pratiquait déjà la transhumance pastorale. Ils entraînent l'arabisation plus poussée du pays, surtout chez les Zénètes nomades, et élargissent les espaces des migrations pastorales. Cela provoque une régression urbaine et agricole, le déplacement de la vie urbaine vers le littoral et l'abandon des villes des plaines intérieures et des Hauts Plateaux.
Au temps des Zirides, Achir, dans le Titteri, devient rapidement un centre commercial actif. Son architecture est soignée et d'inspiration machrekienne. Les Hammadides édifient une nouvelle capitale, la Kalâa des Béni Hammad dans le Hodna, chaque nouveau dynaste tenant à avoir sa propre capitale, mais Achir n'est pas abandonnée. La nouvelle capitale accueille rapidement les citadins, commerçants, savants et lettrés qui ont fui l'Ifriqiya, notamment Kairouan, mais également les habitants des villes détruites par Hammad, comme M’sila. La région connait alors une vraie prospérité. La cité abrite de nombreux palais et lieux de cultes. Le souverain hammadide Al Nacir construit une nouvelle ville, Béjaïa, qui devient la capitale du royaume et l'un des ports les plus actifs du Maghreb. Dès lors, la ville attire étudiants et savants et devient un centre d'enseignement et un pôle intellectuel renommé pour la science. La Kalâa est un centre commercial et intellectuel actif, mais décline progressivement.
an 1 091 : Rwanda - Le Rwanda commence à se transformer en une véritable nation sous Gihanga I, le premier roi du Rwanda. (Banyarwanda)
an 1098 : Égypte - Le vizir du khalife fatimide reprend sur les Ortocides la ville de Jérusalem. Il ne cessera de lutter contre les Latins, alors à la veille veille de lui arracher la sainte cité.
an 1099 : Après la prise d'Antioche, les Croisés mettent une année entière à traverser l'espace qui les séparait de Jérusalem. après un siège de 39 jours, ils se rendent maître de la ville, le 15 juillet 1099. Fondation du Royaume Chrétien de Jérusalem. Godefroy de Bouillon, élu roi, l'organise à l'instar des États féodaux de l'occident. Les Assises de Jérusalem, rédigées en français, deviennent la loi du Pays. La bataille d'Ascalon, livré à l'armée égyptienne conduite par AFDHAL et où les latins restent vainqueurs (août), affermit entre les mains leur précieuse conquête, mais laisse néanmoins la forteresse d'Ascalon entre les mains des Égyptiens.
XIIème siècle : Congo Brazzaville - Les Pygmées sont les premiers habitants du Congo. Le pays a ensuite été touché par la grande migration des Bantous, venus du nord en longeant la côte et les cours d'eau. Plusieurs royaumes, dont on ne connaît pas encore bien les origines, se succèdent ou coexistent. D'abord le royaume de Loango (fondé entre le Xe et le XIIe siècle) dans toute la partie sud, le massif du Mayombe et sur la côte.
Schématiquement, les structures géopolitiques précoloniales congolaises peuvent se simplifier en deux catégories : les sociétés sans État, fondées sur des chefferies qui sont autant de micro-nations que des conditions géographiques et démographiques difficiles ont maintenu dans un relatif isolement, ceci dans la moitié nord du pays, terres Mboshi, Makaa, etc. ; les sociétés à État organisé, dans la moitié Sud, autour de trois pôles essentiels : le vieux royaume de Loango fondé entre les Xe et XIIe siècles.
XIIème siècle : Éthiopie - Au XIIe siècle on assiste à un renouveau des relations entre l'Église chrétienne d'Éthiopie et le métropolite d'Alexandrie pour l'envoi, chaque fois, d'un nouveau métropolite. De nouvelles églises sont élevées au XIe – XIIIe siècle par une élite qui va fonder un nouveau royaume chrétien. Enfin, de nouvelles mosquées sont construites, elles aussi, au sein de sociétés dont les religions deviennent de moins en moins diverses.
Dès le XIIe siècle, la dynastie Zagwé (ou Zagoué) semble avoir unifié différents espaces chrétiens et parachève le mouvement de christianisation engagé avant le haut Moyen Âge. Le roi Lalibela (vers 1204-1205) marque l'apogée de cette dynastie. Les sources, pour cette période, sont bien plus nombreuses qu'auparavant. Il aura laissé son nom attaché au site où les églises rupestres de Lalibela (début du XIIIe siècle) ont été creusées dans la roche, tout comme certains temples célèbres en Inde de l'Ouest (Ellora, VIIe – IXe siècle). Il déplace ainsi le centre du royaume au cœur des montagnes du Lasta, et distribue généreusement des richesses au clergé. Sous son règne les symboles propres à l'idéologie royale éthiopienne sont fixés : l'onction, lors du sacre qui fait de lui le descendant de l'union du roi hébreux Salomon et de la reine de Saba, détenteur de l'Arche d'alliance. Cette idéologie se forme bien sous cette dynastie selon plusieurs sources égyptiennes, dont l' Histoire des patriarches de l'Église d'Alexandrie.
XIIème siècle : Leshoto - La première difficulté, dans l'histoire de l'Afrique australe, est dans le choix des noms utilisés pour désigner les populations : les termes utilisés au XXe siècle ont souvent été ceux des colonisateurs d'origine européenne. Le terme français « Bochimans », par exemple, est dérivé du mot utilisé par les colons néerlandais « bosjesman », et signifiant littéralement « hommes des buissons », « hommes de la brousse » ou « hommes du bush ». Les colons anglais ont utilisé la traduction littérale « Bushmen ». Ces Bochimans, des chasseurs-cueilleurs, ont été opposés à des populations, arrivées de contrées plus au nord, au mode de vie plus pastoral, se consacrant à l'élevage d'animaux, à l'agriculture et maîtrisant le travail du fer et ayant une structure sociale plus hiérarchisée. À la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle, une distance est prise à la fois avec le vocabulaire des colons d'origine européenne. Plusieurs termes sont employés mais les chasseurs-cueilleurs installés initialement sont souvent désignés de peuple San. Les Sans des montagnes vécurent en autarcie pendant des milliers d'années. Les Sothos arrivés en Afrique australe vers le XIIème siècle commencèrent à coloniser les montagnes du centre du Drakensberg .
an 1117 : Invasion de l’Égypte par le roi de Jérusalem BAUDOUIN Ier qui mourut pendant son retour.
an 1120 : Fondation, dans le Maroc, de la secte des Almohades qui constitue une dynastie nouvelle. Son premier chef, MOHAMMED ABDALLAH BEN TOUMERT, qui avait commencé à prêcher sa doctrine en 1116, prend le titre de mahdi (conducteur ou directeur des croyants). La secte reçu le nom d'almouaheddi, c'est à dire unitaires, parce que, selon ses partisans, elle seule rendait au Dieu unique le culte qui lui appartient. MOHAMMED s'adjoignit ABDELMOUMEN en qualité de hagib ou lieutenant. Celui-ci, par ses talents et son énergie, soumit une grande partie du Magreb, et fut, à la mort du mahdi, proclamé khalife (mort en 1163). Dynastie des Almohades (1120 - 1269).
an 1121 : Égypte - Après une sage et douce administration de 28 ans, le vizir AFDHAL périt sous le poignard de deux assassins, par ordre de son maître le khalife AL-MANSOUR-AMER (1101 - 1130), jaloux de sa puissance et avide de s'emparer de ses richesses. Celui-ci, à son tour, périt sous les coups des amis du vizir.
an 1 135 à 1 270 : Éthiopie - Les Zagwés (1135c-1270)
Sous le patriarche copte du Caire Côme III (921-933), le métropolite d'Éthiopie Pétros doit intervenir dans la succession du Negusse Negest décédé. Deux moines coptes, venus du monastère Saint-Antoine en Égypte, montent contre lui une imposture ; ils provoquent le renversement de la succession réglée par Pétros et l'un des religieux se fait, au moyen de lettres factices, reconnaître comme Abouna à sa place. Les faits ne sont connus en Égypte que beaucoup plus tard : le Patriarcat lance alors des excommunications et s'abstient, pendant de longues années, d'envoyer un nouvel archevêque en Éthiopie. Le pays, jusque-là prospère, sombre dans les calamités : au milieu du Xe siècle, la reine agew, Gudit, souveraine d'une population judaïsée du Damot, brûle les églises, dévaste les terres, détruit Aksoum de fond en comble, et pourchasse le souverain, qui voyant un signe de la colère de Dieu, demande au patriarche du Caire Philothée (979 - 1003), par l'intermédiaire des Nubiens, un nouveau métropolite. Il demande de l'aide et la levée de l'interdit contre son pays et contre son peuple. Les traditions disent que les malheurs cessèrent après la venue de ce dernier.
Vers 960, la princesse Gudit échafaude un plan d'assassinat des membres de la famille royale afin de s'approprier le pouvoir. Selon certaines légendes, pendant le meurtre, un nouveau-né héritier de la dynastie axoumite est protégé par certains croyants et emmené au Choa où son ascendance est reconnue, alors que Gudit règne pendant 40 ans sur le reste du royaume, et transmet la couronne à ses descendants.
Le royaume d'Aksoum est détruit à la fin du Xe siècle. Le souverain éthiopien qui succède à la reine Gudit serait un usurpateur, qui n'appartient pas à la dynastie légitime. La seule certitude est qu'il ne réside plus à Aksoum.
Au siècle suivant, le dernier descendant de Gudit fut renversé par un seigneur Agaw du nom de Mara Takla Haymanot, fondateur de la dynastie Zagwé et mariée à une descendante d'un monarque aksoumite. L'apogée de cette dynastie fut atteint lors du règne du roi Lalibela, Gebre Mesqel, pendant lequel les onze églises de Lalibela furent taillées dans la pierre.
En 1270, une nouvelle dynastie s'établit sur les hautes terres éthiopiennes avec le règne de Yekounno Amlak qui déposa le dernier roi Zagwe et épousa l'une de ses filles. Selon certaines légendes, la nouvelle dynastie était alors constituée d'héritiers des monarques aksoumites, reconstituant ainsi la continuité de la dynastie salomonienne (le royaume étant ainsi rendu à la lignée royale biblique).
an 1143 à 1148 : Tunisie - Les Normands du royaume de Sicile, s'emparent de 1143 à 1148 de plusieurs ports tunisiens et lèvent un tribut.
an 1146 : NOUR-EDDIN-MAHMOUD succède à son père ZENGHI sur le trône d'Alep, mais son frère Séïf-EDDIN GHAZY se met en possession du territoire de Mossoul. Ils se disputent d'abord la succession, mais se réconcilient bientôt après, et le mort de Séïf-EDDIN laisse
NOUR-EDDIN maître de tous les états de son père auxquels il ajoute en 1154 Damas et en 1164 l’Égypte.
an 1146 : Siège et prise de Maroc par ABDELMOUMEN. Fin des Almoravides. Leur puissance est détruite en Afrique par les Almohades, mais en Espagne, après la perte du royaume de Valence, ils maintiennent encore à Grenade, jusque vers 1160.
an 1147-1269 : Maroc - Dynastie almohade (1147-1269)
Mohammad Ibn Toumert, futur Mahdi autoproclamé, est fils d'un amghar, chef de village de la tribu des Arghen, dans le Haut-Atlas. Très précocement animé par un zèle religieux, il entreprit dès sa jeunesse de multiples voyages l’amenant à visiter Bagdad, Le Caire et peut-être même Damas où il découvre tout l'ampleur de la tradition musulmane, et notamment le soufisme. Au cours de ce périple, Ibn Toumert rencontre probablement le fameux mystique persan Ghazali, dont les œuvres avaient été condamnées par les cadis almoravides en Occident d'Islam. Rapidement, il entretient une profonde aversion pour l'étroitesse du malékisme régnant en maître en sa patrie. C'est en 1117 qu'il regagne le Maghreb, via Tripoli, puis Tunis et enfin Béjaïa où ses prêches pieuses galvanisent les foules. À Melalla, il se lie d’amitié avec Abd al-Mumin, un Zénète, qui devient son meilleur disciple.
C'est à Igiliz, puis à Tinmel, au cœur de la très isolée vallée du N'fis qu’il établit sa « capitale » provisoire. Ses prêches rencontrent un écho considérable et il clame ouvertement son intention de liguer toutes les tribus insoumises des montagnes contre les Almoravides. Son aura grandissante suscite de jour en jour davantage d'inquiétudes de la part des Almoravides qui lancent contre lui en 1121 une expédition militaire commandée par le gouverneur du Souss, Abou Bakr Ben Mohammed El-Lamtouni. L'expédition est écrasée. À la suite de cette déconvenue, ses désirs s'estompent un temps mais en 1127 (ou 1129), une nouvelle expédition parvient dans les contreforts du Haut-Atlas aux environs d’Aghmat dans l'espoir de frapper un grand coup en pays Hintata, fief de la doctrine « Unitaire » du Tawhid. Mais Abd El Moumen et El Béchir contrarient ce plan et profitant de l'effet de surprise, ils parviennent même à assiéger ponctuellement Marrakech, capitale almoravide. Cependant, leurs faiblesses en combat de plaine les poussent à se retrancher en toute hâte (El Béchir mourut). Quelques mois plus tard, en septembre 1130, Ibn Toumert meurt à son tour.
Abd El Moumen succède d'abord secrètement au fondateur de la secte et privilégie une politique d'alliance avec les tribus de l'Atlas. Pour ce faire, il joue non seulement de ses origines zénètes mais aussi de ce qui restait de cercles d'initiés qu'avait fondé son prédécesseur. Dès 1140, une intense campagne permet aux Almohades de s'attirer les faveurs des oasis du sud. Taza puis Tétouan sont les premières grandes cités à tomber. À la faveur du décès d’Ali Ben Youssef en 1143, il s'empare de Melilla et d'Al-Hoceima, faisant ainsi du nord du Maroc sa véritable base logistique. La mort du redoutable chef mercenaire chrétien Reverter en 1145 suivie la même année de celle de Tachfin Ben Ali permet aux Almohades les prises respectives d’Oran, de Tlemcen, d'Oujda et de Guercif.
S'ensuit le long et éprouvant siège de Fès qui durera neuf mois durant lesquels Abd El Moumen se charge personnellement de prendre Meknès, Salé et Sebta. La conquête du Maroc s'achèvera finalement en mars 1147 par la prise de Marrakech, capitale du désormais déchu empire almoravide et dont le dernier roi Ishaq Ben Ali sera ce jour-là impitoyablement tué. Pour fêter cette victoire, Abd El Moumen fait bâtir la très célèbre mosquée Koutoubia sur les ruines de l'ancien Dar El Hajar.
De manière assez inédite, les premiers efforts militaires d'Abd El Moumen désormais intronisé comme calife (pour marquer l'indépendance religieuse des Almohades par rapport aux Abbassides) se tournent vers l'est du Maghreb, sous le péril conjugué des Normands de Sicile menés par Roger II (qui ont pris le contrôle de Djerba et Mahdia et menacent la prospère Bejaïa) et des tribus bédouines hilaliennes envoyées depuis la Haute-Égypte par les souverains fatimides du Caire, furieux de voir Zirides et Hammadides échapper à leur contrôle. Les opérations lancées s'avèrent largement fructueuses puisque les bédouins sont complètement écrasés à Béjaïa puis Sétif en 1152. En 1159, une puissante armée terrestre est levée depuis Salé, secondée par une flotte de soixante-dix navires, obligeant les Normands à se retrancher sur Sfax et Tripoli. Ainsi l'Empire almohade s'étend-il à la fin des années 1150 des rivages de l'océan Atlantique jusqu'à la Cyrénaïque, englobant toute l'Afrique musulmane à l'ouest de l'Égypte.
Suivant les préceptes de leur secte, les Almohades mettent en place un système socio-politique et théocratique complexe et strictement hiérarchisé. Le calife n'est pas uniquement un souverain temporel, mais également le dépositaire d'un pouvoir sacralisé qui en fait un Mahdi et un Imam ma'ssoum. Le Tawhid est considéré comme l'aboutissement ultime de l'islam, et à ce titre l'Empire almohade est érigé en terre sanctifiée de laquelle est proscrite la dhimma, et donc réservée exclusivement aux musulmans, parmi lesquels les adeptes du mouvement almohade obtiennent tous les pouvoirs par le système du tamyiz. Les nouvelles élites dirigeantes du califat bénéficient d'un programme complet, physique, militaire et intellectuel, vraisemblablement inspiré du Livre V de La République de Platon, et destiné à forger l'archétype d'un homme nouveau capable d'accomplir la doctrine du Tawhid et d'être le fer de lance de la lignée d'Abd El Moumen. Ces élites prennent le nom de talaba, et obéissent au Conseil des Cinquante, lui-même soumis au Conseil des Dix qui constitue l'entourage direct de l'Imam-calife et le noyau dur de la secte. Dans cet organigramme politique et religieux le rôle des fakihs malékites est désormais marginalisé, et une personnalité malékite de premier plan comme Cadi Ayyad sera victime du fondamentalisme almohade, ce qui lui vaudra de devenir plus tard l'un des sept saints de Marrakech.
En Andalousie, la fin de la période almoravide a permis la résurgence autonomiste des royaumes de taïfas et un regain de vigueur des chrétiens. En 1144, les Castillans prennent même temporairement le contrôle de Cordoue. À l'ouest, Lisbonne et Santarem tombent aux mains des Portugais. Almeria est également prise par les Aragonais pour une décennie entière. Directement menacées par cette avancée chrétienne de plus en plus soutenue par la papauté et l'ensemble du monde catholique, les petites royautés des taïfas se voient obligées de faire appel aux nouveaux maîtres du Maghreb.
Ainsi, avant la prise de Marrakech par les Almohades, Jerez et Cadix s'offrent à ces derniers. Dans le sillage de la prise de Marrakech, des corps expéditionnaires permettent la conquête de tout le Sud de la péninsule (Grenade, Séville, Cordoue…) puis de Badajoz. En 1157, Almeria est reprise. Abd El Moumen décèdera finalement en 1163 à Salé. Son fils Abu Yaqub Yusuf lui succède, d'abord reconnu à Séville puis à Marrakech. Il s'efforcera jusqu'à son décès en 1184 de régner en véritable « despote éclairé », soucieux de desserrer l'étau d'orthodoxie religieuse pesant sur le Maghreb et de consolider la puissance acquise et héritée de son père.
Sous son impulsion fleurissent des arts autrement plus épanouis que sous la dynastie précédente. L’architecture en particulier atteint son apogée, se traduisant par la construction de la Giralda à Séville, honorée du statut de capitale andalouse, ainsi que de la Tour Hassan à Rabat (dont le minaret ne fut jamais achevé) et de la Koutoubia à Marrakech, toutes trois bâties sur un modèle sensiblement équivalent et parfaitement alignées sur un axe Séville-Rabat-Marrakech correspondant en quelque sorte à la colonne vertébrale du califat almohade d'Occident. Dans d’autres registres, le palais de l’Alhambra est érigé sur les hauteurs de Grenade par les Nasrides et les Jardins de l'Agdal sont plantés à Marrakech (cf. l'article Art almoravide et almohade). C’est également sous les Almohades que vécurent le brillant philosophe Averroès (de son vrai nom Ibn Rûshd ابن رشد), de même qu'Ibn Tufayl ainsi que Maïmonide, qui ira néanmoins s’exiler au Caire afin de pouvoir pratiquer librement sa religion (il était de confession juive). Ces intellectuels mettent à l'honneur la philosophie grecque antique, et particulièrement celle d'Aristote.
À la mort d’Abu Yaqub Yusuf, les Almoravides demeurés maîtres des Baléares s’en vont porter le glaive là où jadis sévissaient les Normands. Ils arrachent Alger, Miliana, Gafsa et Tripoli aux Almohades et subventionnent des tribus arabes d’Ifriqiya qui s’en iront mener des razzias dans tout le Maghreb médian et descendront même jusque dans les oasis du Drâa, avec l'aide de Turcomans commandés par Qaraqûch, officier de la caste des Mamelouks d'Égypte62. Vaincues par les vigilantes milices d’un certain gouverneur Abu Yusf, les tribus bédouines seront par la suite sédentarisées dans l’Ouest marocain, dans l’ancien pays bergouata où elles contribueront à l’effort d’arabisation des plaines du Gharb et de la Chaouia. Après la victoire d’Alarcos durant laquelle Alphonse VIII est battu par le souverain Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, les derniers fauteurs de troubles almoravides sont écrasés dans le Sud tunisien. C’est l'apogée almohade.
Muhammad an-Nasir succède à son père en 1199. Le 16 juillet 1212, son armée de 200 000 hommes est mise en déroute par une coalition de près de 220 000 chrétiens venus de France, d’Aragon et de Catalogne, de León et de Castille répondant à l'appel à la Croisade contre les Almohades lancée par le pape Innocent III. C’est la bataille de Las Navas de Tolosa que l’histoire retiendra comme l’événement charnière de la Reconquista. Dans le même temps, an-Nasir reçoit une étrange proposition d'allégeance de Jean sans Terre, alors en froid avec les souverains chrétiens du continent européen, de faire du lointain royaume d'Angleterre un vassal du califat almohade de Marrakech. L’autorité des Almohades sur leur empire sera durablement affaiblie par cette débâcle, au point que le Muhammad an-Nasir renoncera à son trône l’année suivante, le cédant à son fils. À 16 ans, Yusuf al-Mustansir accède donc au trône. Dépourvu d’autorité, il voit rapidement le Maghreb médian lui échapper. Il en va de même en Andalousie où le gouverneur almohade de Murcie réclame une régence et franchit le détroit pour le faire savoir. À Séville, Al-Mamoun fait sensiblement de même. Les taïfas renaissent de leurs cendres et imposent le malékisme. À Marrakech même les cheikhs souhaitent procéder à l’élection d’un nouveau calife, ne laissant d’autre alternative au jeune souverain que la fuite pour un temps. Son fils, Abd al-Wahid al-Makhlu lui succède en 1223. Il mourra étranglé l’année même. Les cheikhs de Marrakech procéderont alors à l’élection d’Abu Muhammad al-Adil. Les Hafsides de Tunis (du nom d’Abû Muhammad ben ach-Chaykh Abî Hafs, autrefois vizir de Muhammad an-Nasir), déclarent leur indépendance en 1226, sous l’impulsion de Abû Zakariyâ Yahyâ. La mort d’Abu Muhammad al-Adil marquera le début de l’ingérence du Royaume de Castille dans les affaires marocaines. Ferdinand III de Castille soutiendra Abu al-Ala Idris al-Mamun tandis que les cheikhs de la hiérarchie soutiendront le fils de Muhammad an-Nasir, Yahya al-Mutasim. C’est le premier qui prend pour un temps l’ascendant, parvenant à s'emparer de Marrakech et à massacrer les cheikhs. Il renie la doctrine religieuse almohade au profit du malékisme et consent en paiement de sa dette à l'égard des Castillans de construire l’église Sainte-Marie de Marrakech en 1228, ce qui survient alors peu de temps après l'affaire des Franciscains martyrs du Maroc.
En 1233, son fils Abd al-Wahid ar-Rachid reprend Marrakech et chasse de Fès les Bani Marin futurs Mérinides (ces derniers faisaient payer à la ville et à sa voisine Taza un tribut depuis 1216), permettant de réunifier le Maroc. En Andalousie, Cordoue tombe aux mains de Ferdinand III dès 1236. Valence avec son gouverneur Zayd Abu Zayd qui fait allégeance à Jacques Ier d'Aragon lui emboîtera le pas deux ans plus tard. Puis ce sera au tour de Séville d'être prise par les Castillans en 1248, ce qui marque un coup fatal à la présence de l'Islam dans la péninsule, désormais réduit au royaume de Grenade. Entre-temps, Abu al-Hasan as-Said al-Mutadid parviendra à rétablir un semblant d’unité sur le Maroc mais accumulera les échecs face aux Mérinides dont l’avancée est irrésistible sur le nord du Maroc. Pour une trentaine d’année, les Almohades survivront, repliés sur la plaine du Haouz puis dans le Haut-Atlas, et payant un tribut à leurs voisins septentrionaux. En 1269, Marrakech tombe aux mains des Mérinides, suivie en 1276 de Tinmel, fief originel de la dynastie. La chute de Tinmel marque la fin définitive de l'Empire almohade, qui fut pour un demi-siècle la puissance majeure incarnant l'Occident musulman, et le seul califat berbère aux prétentions universelles.
an 1159 à 1534 : Tunisie - En 1159, la Tunisie est unifiée à l'ensemble du Maghreb sous la domination des Almohades. Cependant ceux-ci affaiblis par leur défaite contre les chrétiens en Espagne (bataille de la Navas de Tolosa en 1212) ne peuvent empêcher les Hafsides de s'emparer du pouvoir à Tunis en 1236, ils le conserveront jusqu'en 1534. C'est à partir de ce moment que le pays porte le nom de Tunisie. La Tunisie tire alors parti de sa position centrale en Méditerranée pour faire du commerce avec les pays chrétiens. En 1410, le Tunisien Abou Farès s'empare d'Alger et devient le plus puissant souverain du Maghreb.
an 1164 : Magreb (États barbaresques) - Après la mort d'ABDELMOUMEN, YOUSSOUF, son second fils (1163 - 1184) , qui, pendant 9 ans, avait eu en Espagne le gouvernement de Séville et de l'Algarve, est proclamé khalife, suivant la volonté de son père.
an 1167 : Égypte - Un vizir du khalife EL-ADED ayant demandé du secours à NOUR-EDDIN, contre son compétiteur au pouvoir, l'atabeg lui envoie une armée sous le commandement du Kurde ASAD-EDDIN CHIRKOUH, accompagné de son neveu SALADIN (SALAHEDDIN-YOUSSOUF). AMAURY, roi de Jérusalem, prend aussitôt parti pour le rival du vizir, CHAVAR, et l'empereur d'Orient fait bientôt cause commune avec lui. Dans sa première campagne d’Égypte, AMAURY est accompagné du brave connétable HUMFROI DE TORON. Dans la seconde (1169), il est accompagné du grand Duc grec ANDRONIC KONTOSTEPHANUS. Mais dans l'intervalle des deux campagnes, CHIRKOUH achève la conquête du pays. il entre au Caire (1169) renverse le vizir CHAVAR, et se fait lui-même proclamer sultan et malekh, avec un pouvoir illimité. Cependant il meurt peu de mois après et laisse le commandement à son neveu SALADIN. Celui-ci tient tête aux forces réunies du roi latin et de l'empereur grec. La flotte de MANUEL, de plus de 200 vaisseaux, assiège inutilement Damiette, et l'armée de terre, grâce aux fautes d'AMAURY, est de son coté obligée de battre en retraite. L'année suivante, SALADIN enlève Gaza, une des clefs du royaume de Jérusalem du côté de l’Égypte.
an 1169 à 1315 : Égypte - La période fatimide est interrompue par le chef kurde sunnite Saladin qui prend le pouvoir en Égypte en 1169 avec l'accord du calife de Bagdad. Repoussant les croisés, il gagne la Syrie et une partie de la Mésopotamie. Il fonde en Égypte la dynastie ayyoubide qui tient le pouvoir jusqu'en 1250.
Cette année-là, les mamelouks, une milice d'origine servile, prend le pouvoir en Égypte. Le général Baybars remporte le 3 septembre 1260 la bataille d'Aïn Djalout et contient l'invasion mongole. Il attaque aussi les États latins, puis en 1271-1272 David Ier de Dongola qui tentait de faire diversion. En 1315, An-Nâsir Muhammad ben Qalâ'ûn dépose le dernier roi chrétien de Makurie et installe un souverain musulman, prélude à l'islamisation du Soudan.
an 1171- 1254 : Égypte - Fin de la dynastie des Fatimides (- AL ADHED, dépossédé du trône par trône par SALADIN, alors âgé de 34 ans, meurt quelques jours après. Le fils de CHIRKOUH soumet le pays à l'autorité spirituelle des Abbassides, et garde pour lui le pouvoir civil et militaire, avec le titre modeste de sultan (non pas soudan).
La noblesse de son caractère égale sa bravoure sur les champs de bataille.
Dynastie des AYOUBIDES (1171 - 1254)
an 1182-1187 : Maroc - Le Maroc au cours des Croisades
L'Empire almohade, sous le règne d'Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, établit un partenariat stratégique avec l'Égypte du sultan Saladin. Le point d'orgue de cette relation est l'ambassade d'Abou al Harith Abderrahman Ibn Moukid envoyé par Saladin auprès de la Cour califale de Marrakech. Cette mission débouche sur la reconnaissance de l'autorité almohade et une alliance entre Almohades et Ayyoubides, qui se concrétise par la participation de la flotte marocaine aux opérations maritimes contre les Croisés (sur les côtes méditerranéennes du Proche-Orient et même en mer Rouge, où les navires almohades prêtés à Al-Adel mettent en échec l'expédition contre La Mecque organisée par Renaud de Châtillon en 1182). À la suite de la prise de Jérusalem par Saladin en 1187, plusieurs familles originaires du Maghreb et du Maroc en particulier viennent participer au repeuplement de la ville sainte d'Al-Qods. Ces populations établissent ainsi un quartier qui prit par la suite le nom de « quartier des Magharibas (Marocains) » et dont l'un des vestiges est la Porte des Maghrébins68 ; de nombreux Palestiniens d'Al-Qods descendent ainsi de ces Marocains installés en Terre sainte.
an 1183 : SALADIN, maître de Damas depuis 1173réunit aussi Alep à son empire. Depuis ce moment, toute sa politique tend à chasser les chrétiens de la Palestine.
an 1187 : Victoire remportée par SALADIN à Tibériade, au sud-ouest du ac de Tibériade, après une bataille qui a duré trois jours. Le roi GUY DE LUSIGNAN est fait prisonnier en temps que BONIFACE, marquis de
Montferrat, RENAUD DE CHÂTILLON, les grands-maîtres de l'ordre du Temple et de celui de Saint-Jean de Jérusalem. SALADIN venge sur RENAUD une offense faite à sa mère : il lui porte les premiers coups de sa propre main et le fait achever par ses gardes; Mais il montre ensuite toutes sortes d'égards pour le roi. Cette grande victoire livre au sultan d’Égypte Saint-Jean d'Acre ( Ptolemaïs) et Ascalon, seule de toute les forteresses de la Palestine, celle de Sur (Tyr) est sauvée grâce à l'arrivée de CONRAD DE MONTFERRAT, frère de BONIFACE, qui en prend aussitôt en main la défense. Mais SALADIN entre par capitulation dans Jérusalem, et la croix d'or qui surmontait l'église du Saint-Sépulcre est abattue. Du reste, la population est traitée avec générosité. Tyr est assiégé par SALADIN, mais encore une fois sauvé par CONRAD, qui fait essuyer au sultan une défaite sur terre et sur mer. La rivalité entre le héros et GUY DE LUSIGNAN commence aussitôt après l'élargissement de ce dernier. Le comte de Tripoli, qui meurt peu après la bataille de Tibériade, lègue ses États à BOHEMOND, fils de Bohémond III, prince d'Antioche.
an 1188 : SALADIN, après une vaine tentative contre Tripoli, secouru par CONRAD, fait une invasion dans la principauté d'Antioche, y prend vingt-cinq villes, mais échoue devant la capitale.
an 1189 : Contre l'avis de CONRAD DE MONTFERRAT, le roi GUY commence le siège de Saint-Jean d'Acre, forteresse que SALADIN a remis en bon état de défense et où il accourt aussitôt avec toutes ses forces. La mort de a reine SIBYLLE fait passer bientôt le droit au trône à sa sœur ISABELLE, mariée en première noce à HUMFROI DE TORON, fils dégénéré du connétable de ce nom mort en défendant son roi. Après HUMFROI, dont elle fut séparée par divorce en 1190, ISABELLE eut trois autres maris.
an 1193 : A la mort de SALADIN, à Damas, ses États sont partagés entre ses fils, surtout entre les trois aînés, APHDAL, AZIZ et DAHER; MALEK-ADHEL, leur oncle, est chargé de leur tutelle, au moment où il faisait des conquêtes nouvelles vers les sources du Tigre. Les trois princes règnent l'un à Damas, dont dépendent Baalbek, Bostra, etc., le second en Égypte, et Jérusalem lui appartenait, le troisième à Alep. Ce démembrement aurait pu servir la cause des États latins, ainsi que celle des khalifes abbassides, mais ni les uns, ni les autres ne surent en profiter.
an 1196 : MALEK-ADHEL, frère de SALADIN, profite des divisions entre les fils et petits-fils de ce dernier, pour saisir lui même la couronne. Après avoir régné déjà à Damas, il prend aussi le titre de sultan d’Égypte (1196 - 1218) et ne tarde pas à se rendre maître du Caire. Il transmettra son empire à son fils MALEK-KAMEL.
an 1199 : L'avènement au trône de MALEK-KAMEL amena une situation nouvelle.
XIIIème siècle : Congo Brazzaville - Les Pygmées sont les premiers habitants du Congo. Le pays a ensuite été touché par la grande migration des Bantous, venus du nord en longeant la côte et les cours d'eau. Plusieurs royaumes, dont on ne connaît pas encore bien les origines, se succèdent ou coexistent. D'abord le royaume de Loango (fondé entre le Xe et le XIIe siècle) dans toute la partie sud, le massif du Mayombe et sur la côte. Ensuite le Kongo (fondé au XIIIe siècle) dans les territoires du Nord de l'Angola et du Cabinda, du sud-est de la république du Congo, l'extrémité occidentale de la république démocratique du Congo et une partie du Gabon.
Schématiquement, les structures géopolitiques précoloniales congolaises peuvent se simplifier en deux catégories : les sociétés sans État, fondées sur des chefferies qui sont autant de micro-nations que des conditions géographiques et démographiques difficiles ont maintenu dans un relatif isolement, ceci dans la moitié nord du pays, terres Mboshi, Makaa, etc. ; les sociétés à État organisé, dans la moitié Sud, autour de trois pôles essentiels : le vieux royaume de Loango fondé entre les Xe et XIIe siècles, le Kongo fondé au XIIIe siècle.
Des vestiges, ténus certes, mais assez nombreux, attestent de cultures assez avancées sur l'actuel territoire congolais, bien avant ces États que nous connaissons : poteries, vestiges de fours à métaux, de grands travaux (tunnel sous le mont Albert près de Mouyondzi) remontent à une période antérieure au XIIIe siècle, parfois avant l'an mille.
XIIIème siècle : Éthiopie - La période est marquée par de profonds bouleversements sociaux et économiques. Au XIIIe siècle les rivalités tournent à la confrontation. Comme entre le sultanat d'Ifât (localisée en 2009, et recouvrant probablement en partie le sultanat du Choa) et le royaume païen du Damot, auquel elle était soumise, et qui sera finalement vaincu. Le sultanat d'Ifât contrôle les espaces musulmans qui vont du sud des fleuves Awash et Jamma, jusqu'au golfe d'Aden. Il contrôlait, par le port de Zeila (ou Zaila), le débouché du commerce de l'or, des esclaves (surtout abyssins), de l'ivoire et les céréales. Les chrétiens vivent alors aux très hautes altitudes, au delà de 2500 m, et cultivent l'orge et la fève. Les musulmans vivent autour de 1500 m, et cultivent sorgho, le haricot et la canne à sucre, ils élèvent des bœufs, des moutons et des chèvres. Tous cultivent le teff, une céréale, tout comme le blé.
Selon des chroniques plus ou moins différentes, un certain Yekouno Amlak, originaire du Sud, s'empare du pouvoir en 1270 et fonde la dynastie salomonienne (ou « salomonide », 1270-1974). Il s'efforcera de dupliquer l'organisation politique et territoriale mise en place par la dynastie Zagwé. Celle-ci sera systématiquement abaissée, ensuite, par les rédacteurs des vies de saints et des chroniques du XIVe siècle, dans un regard rétrospectif faussé. La dynastie salomonienne sera présentée, jusques et y compris à l'époque moderne par une fiction historique, comme seuls héritiers de la dynastie aksumite, et comme les véritables descendants de Salomon et de la reine de Saba.
XIIIème siècle : Guinée - Au XIIIe siècle, le légendaire Soundiata Keïta forme un immense empire ayant pour capitale Niani (aujourd'hui petit village guinéen).
XIIIème - XVème siècle : Mayotte - L'époque des Fani bâtisseurs (XIIIe – XVe siècle)
Du XIIIe au XVe siècle, l'île est sous la direction de chefs musulmans, les Fani, et connaît un « âge d'or » du fait de sa position stratégique dans le commerce entre Madagascar et le monde swahili. Les relations avec la côte et la grande île sont importants, et les restes de poteries africaines, malgaches, indiennes et même chinoises attestent d'un commerce florissant. Les fouilles menées à Dembeni ont mis en évidence des céramiques importées du golfe Persique, d’Inde, de Chine ainsi que des produits malgaches (notamment du cristal de roche travaillé) datant du IXe au XIIe siècle.
XIIIème siècle : Sénégal - Naissance de l’empire du Djolof dans la partie centrale du Sénégal actuel.
XIIIème - XIVème siècle : Sénégal - Naissance de l’empire du Mali dans la partie est du Sénégal actuel.
XIIIème siècle : Somalie - L’histoire de la Somalie peut être, à l'instar des autres États d'Afrique, divisée en période pré-coloniale, coloniale et post-coloniale. Cette dernière est marquée par des troubles ayant fait tomber les institutions somaliennes.
Une économie et un mode de vie se développe à l'intérieur des terres consistant principalement en un élevage nomade combinée, plus au sud, avec une exploitation agricole des terres dans la région des rivières Jubba et Shabeelle. Par le commerce maritime via les villes côtières, les habitants de ce territoire somalien entrent en contact avec les civilisations perse et islamique. La religion islamique progresse sur ces terres du VIIe au XIIIe siècle. Un système clanique se met probablement en place à cette époque, influencé par la société tribale patrilinéaire des Arabes, remplaçant la forme sociale originale, organisée, probablement là encore, de manière matrilinéaire. Des Cités-États se développe autour des villes portuaires les plus importantes, comme Zeilah ou Berbera, intégrées dans le système des échanges autour de l'Océan indien11. Plus au sud, le port de Mogadiscio gagne également en influence. Le géographe arabe Yaqout al-Rumi décrit cette cité au début du XIIIe siècle comme une ville sans roi où «les affaires sont réglées par des anciens». Durant ce même XIIIe siècle, un État islamique, le sultanat d'Ifat se constitue autour de Zeilah (sur la côte) et d'Ifât (à l'intérieur des terres), jusqu'à Berbera au sud-est et englobant également Hara. Ce sultanat entre en concurrence avec l'Empire éthiopien, une puissance chrétienne, adjacente, au nord, qui le vassalise par intermittence.
Plus au Sud du territoire de la Somalie, au XIIIe siècle, un autre État s'est constitué, le Sultanat Ajuran, un État centralisé dans la vallée du Shebelle. Il s’agit de l’un des rares épisodes de centralisation d’un État pastoral de l’histoire de la Somalie, formant un royaume plus grand et plus puissant que les villes-États côtiers de Mogadiscio, Merca et Baraawe réunis.
an 1200 : Malawi - Progressivement, jusque vers 1200, le mode de vie bantou se développe, travail du métal et culture sur brûlis notamment. L'identité de ces premiers habitants bantouphones est incertaine. Selon la tradition orale, des noms tels que Kalimanjira, Katanga et Zimba leur sont associés. Une seconde vague de peuplement bantoue, venue du nord, débute au XIIIe siècle et s'étend jusqu'au XVe siècle. Ce sont les débuts de l'histoire écrite, grâce à la consignation en anglais et en portugais des traditions orales.
an 1201 : Afrique - Comores - Ce sont d'abord les Indonésiens et Malgaches, surtout à Mayotte. Au XIIIe siècle, l'arrivée d'une population persane de Chiraz , apporte l'islam dans l'archipel. Ces derniers ont lentement transité le long des côtes de l'Afrique orientale, colonisant des îles situées sur les routes commerciales comme Unguja (archipel de Zanzibar), Pemba, l'archipel de Lamu et les villes de la côte kényane et tanzanienne. Ils y répandent une culture prospère et de renommée, de langue swahilie (dont les dialectes comoriens constituent des variantes locales), vivant du commerce d'esclaves, de l'ivoire et d'autres marchandises africaines destinées aux marchés orientaux.
Durant cette époque, le pouvoir est aux mains des nombreux sultans batailleurs et de grandes familles de l'aristocratie locale, les Qabilas. Ces dernières s'établissent dans les villes côtières fortifiées (Mutsamudu et Domoni à Anjouan, Fomboni à Mohéli, Moroni, Itsandra et Iconi à la Grande Comore).
Ces puissantes familles accaparent les terres des cultivateurs autochtones, les Walatsa, les obligeant à travailler pour eux ou les refoulant à l'intérieur des terres.
Ces nouveaux arrivants introduisent des esclaves africains, les Makoas dont descendent les Wadzakiya
an 1202 : L'empire de MALEK-KAMEL s'étend depuis la Nubie et le grand désert jusqu'au Taurus. Pour assurer la défense du côté de l'Arménie, il s'efforce de s'emparer de la forteresse de Khallat ou Ikhlat, ce qui brouille le sultan de Konieh et le chah du Khovaresm au moment où se prépare une grande crise, pour l'Asie occidentale comme pour le reste de cette partie du monde. Dans cette année et la suivante, une affreuse disette afflige l’Égypte. On mange de la chair humaine.
an 1206 : Magreb - La puissance des Almohades commence à déchoir, les gouverneurs de Tunis et de Tripoli se révolte contre l'empereur de Maroc.
an 1211 : Égypte - Cour brillante et lettré de MALEK-KAMEL. Ce prince libéral est pour les chrétiens un voisin plus bienveillant qu'hostile.
an 1212 : Magreb - Depuis sa défaite à Tolosa, MOHAMMED-EL-NASR est méprisé de sa nation et il meurt en 1213, empoisonné par ses ministres. Son successeur est un enfant de dix ans, YOUSSOUF-AL-MOSTANSER (1213 - 1223)
Son père, Muhammad an-Nâsir, ayant confié l'Ifriqiya à Abû Muhammad ben Abî al-Hafs, Yûsuf al-Mustansir lui laissa le soin de gouverner. Le Maghreb central échappa à son contrôle et même au Maroc la situation se détériora sous la poussée des Mérinides. Les cheikhs de Marrakech voulaient revenir à une pratique qui n'avait jamais été utilisée de soumettre le choix d'un nouveau calife à une investiture. Cela créa les désordres qui vont marquer la fin de la dynastie, c'est en effet à partir du règne d'al-Mustansir que le pouvoir almohade exprime des difficultés à imposer son ordre sur le territoire impérial.
an 1219 : Égypte - Les croisés prennent Damiette mais ils sont bientôt après (1221) forcés de faire la paix et d'évacuer l’Égypte.
an 1222 : Mali - Fondé au XIe siècle, il est unifié vers 1222 ou 1230 par Soundiata Keïta, roi du Mandén, région correspondant à peu près à l'actuel Mali. Il coalise les Malinkés afin de contrer les attaques du roi du Sosso, Soumaoro Kanté.
an 1227 : Égypte -Les Ayoubites sont en guerre entre eux. AL KAMEL, sultan d’Égypte, voyant ses frères MOADHAM, sultan de Dama (1200 - 1227) et AL ASCHRAF qui régnait sur les pays entre l'Euphrate et le Tigre, établir des rapports avec DJELAL-EDDIN, redevenu puissant, s'adresse lui-même à FREDERIC II et il l'engage à venir en Orient. La mort de MOADHAM livre ensuite son sultanat au plus jeune frère, AL ASCHRAF et MALEK-KAMEL fait une tentative pour s'emparer de Damas. A ce moment, Frédéric, débarqué à Saint-Jean d'Acre, envoie à ce dernier une ambassade qui doit lui rappeler leurs conventions.
an 1229-1235 : Algérie - Après la fin de l'Empire almohade, le Maghreb est partagé en trois entités politiques : les Hafsides à l'est, les Zianides au centre et les Mérinides à l'ouest. Cependant, leurs territoires sont fluctuants et elles rivalisent pour établir leur emprise sur tout le Maghreb, s'appuyant sur le fait tribal. Des trois, l'État Hafside, qui se pose en héritier de l'empire almohade, est le plus structuré.
La dynastie zianide fondée par Yaghmoracen Ibn Ziane, ancien gouverneur Almohade de Tlemcen en 1235, étend son emprise sur les deux tiers occidentaux du pays et fait de Tlemcen sa capitale. La dynastie hafside, d'abord alliée et vassale des Almohades, rompt avec eux dès 1229. Elle domine l'Ifriqiya et le tiers oriental de l'Algérie actuelle avec Tunis pour capitale, Béjaïa étant la capitale de la marche occidentale de leur État. Les deux dynasties subsistent pendant plus de trois siècles. Les limites entre les aires zianide et hafside suivent une ligne courant de l'ouest de Béjaïa au Hodna et au Zâb même si, à l'ouest de cette ligne, les tribus vivent en quasi-autonomie. À l'est, les Zianides tentent d'élargir leur influence et de nombreuses révoltes éclatent à Béjaïa et Constantine, marquées par un esprit autonomiste et indépendantiste. Elles constituent une série de principautés instables. Ainsi, le domaine hafside s'est-t-il divisé à certaines périodes entre deux États ayant pour capitales Béjaïa et Tunis.
an 1230 : Magreb - ABOUBEKR, chef des MENERIDES, enlève Fez aux Almohades.
an 1235-1265 : Guinée-Bissau - À partir du XIIIe siècle, les Mansayas (baronnies de l'empire du Mali), fondées entre 1235 et 1265 par le général mandingue Tiramighan Traoré qui a vaincu et fait prisonnier Kirikor, dernier roi du Bainouk, puis réunies à partir du XVIIe siècle sous la forme du royaume indépendant du Gabou (Kaabunké) s'étendent progressivement et exercent, à l'Ouest, une forte influence sur la région et les autres nations de ce territoire (Royaume de Qinala, Confédération Balante, Seigneuries Brâmes/Papel, Seigneuries Felups/Diola, Royaume Nalu), jusqu'au XVIIIe siècle.
an 1235 : Mali - Le roi du Sosso, Soumaoro Kanté défait son adversaire à la bataille de Kirina.
La « Charte du Manden », datant de 1222 ou de 1236, correspond au serment prononcé par Soundiata Keïta à l'occasion de son intronisation. Considéré comme l'un des plus anciens textes relatifs aux droits de l'homme, il s'agit d'un contenu oral, « constitutionnel », relatif aux droits de l'homme et à l'organisation formelle et légale régissant les rapports entre les hommes. Il ne fera l'objet d'une transcription écrite qu'au XXe siècle. Soundiata Keïta poursuit ensuite ses conquêtes, reprenant ainsi Koumbi Saleh, ex-capitale de l’empire du Ghana, des mains du roi du Sosso. Il crée le second des trois grands empires, le très riche et puissant empire du Mali, qui est élargi, organisé et géré par ses successeurs.
an 1236 : Égypte - MALEK-KAMEL et son frère AL ASCHRAF sont en guerre entre eux. A a mort de ce dernier (1237), le sultanat de Damas est réuni à celui d'Egypte.
an 1238 : Égypte - La mort de MALEK-KAMEL donne lieu à des guerres entre ses deux fils. Au bout de deux ans, l'un d'eux, EYOUB-SALEH (1241 1249) doit la victoire sur son frère aux Mamelouks, garde du corps composée d'esclaves achetés à cet effet.
an 1247 : Magreb - Fondation du royaume de Trémecen (Tlemcen) par BEN-ZEYAN qui pend le titre de khalife. Dynastie des Zéyanides.
an 1248 : Égypte - Le sultan du Caire était le plus puissant de l'époque et maitre de a Syrie. C'était sur les bord du Nil qu'il fallait conquérir la terre Sainte. EYOUB-SALEH venait de mourir, et on lui avait donné pour successeur MOADHAM-TOURAN-CHAH, son fils, qui fut bientôt assassiné par les Mamelouks (1250)
MAMELOUKS : nom dérivé de mémalik, possédés, esclaves. Les derniers Ayoubides se reposaient de leur sûreté sur une garde nombreuse composée d'esclaves achetés parmi les Turcomans, les Komans, les Tcherkesses, etc. AYOUB-SALEH l'augmenta d'une quantité de jeunes gens que les Mongols avaient enlevés du Kiptchak et de la Komanie. Après les avoir fait élever et discipliner, il les mis en garnison dans les îles du Nil (Basse-Égypte) et de là leur vint le nom de Baharites, de Bahar, de Baharile. Ces hommes, qui jouissaient de grands privilèges, ne connaissaient d'autre patrie que leur camp, ni d'autre obligation que la volonté de leur maître. Se sachant nécessaires aux sultans, ils ne mettaient pas de bornes à leur arrogance.
Évacuation de l’Égypte par les croisés. A ce moment même, les Mamelouks se révoltent contre TOURAN-CHAH, qui est assassiné. Sa belle-mère, leur complice, est déclarée régente au nom d'un prince de race qui ne fait que paraître sur le trône.
an 1250 à 1517 : Égypte - Période mamelouk (1250 à 1517)
an 1251 : Magreb - Le chef des Mérinides à Fez enlève Maroc aux Almohades.
an 1254 : Égypte - AZ-EDDIN-AÎBEK (IBEK) (1254 - 1257), saisit le gouvernement après l'assassinat de TOURAN-CHAH et devient le premier sultan des Mamelouks. Fin de la domination des Ayoubides en Égypte.
an 1269-1465 : Maroc - Dynastie mérinide (1269-1465)
Contrairement aux deux dynasties précédentes, la montée en puissance des Mérinides n’est pas à mettre sur le compte d’une démarche personnelle associable à un individu mais plutôt à l’affirmation collective d’une tribu. L’autre rupture que marque l’accession au pouvoir des Mérinides est l’abandon du leitmotiv de la purification religieuse au profit d’une conception de la conquête du pouvoir plus classique, plus conforme à l’identité tribale des protagonistes.
La tribu en question est une tribu zénète dont les origines sont issues des Wassin. Toujours est-il que les Beni Merin (ou Bani Marin) constituent tout au long du XIIe siècle l’archétype d’une tribu berbère caractéristique, nomadisant entre le bassin de la Haute-Moulouya à l’ouest (entre Guercif et Missour) et le Tell algérien, au sud de Sidi bel Abbès à l’est.
La première occurrence de la tribu des Beni Merin dans l'historiographie marocaine coïncide avec leur participation en tant que groupe à la bataille d'Alarcos (1196), bataille finalement remportée par le camp almohade. C’est à cette occasion que s’illustre Abd al-Haqq considéré comme le véritable fondateur de la dynastie mérinide. De retour au pays, la tribu retombe dans un anonymat relatif jusqu’à la cinglante défaite almohade de Las Navas de Tolosa à l’issue de laquelle les troupes mérinides iront défaire 10 000 soldats almohades. À la suite de ce succès, les Mérinides s’installent temporairement dans le Rif, soutenus par des Miknassas sédentarisés au nord de Taza.
Dès 1216, ils se faisaient payer tribut par les cités de Fès et Taza. Les Almohades soucieux de restaurer leur autorité sur tout leur territoire lancent de nombreuses contre-offensives, le plus souvent vaines. C’est au cours d’une de ces manœuvres que décède Abd al-Haqq. Son fils Uthman ben Abd al-Haqq lui succède. Dès 1227, toutes les tribus entre le Bou Regreg et la Moulouya ont fait allégeance aux Mérinides. En 1240, Uthman ben Abd al-Haqq décède, assassiné par son esclave chrétien. C’est son frère Muhammad ben Abd al-Haqq qui lui succède, assiégeant avec un succès relatif Meknès. Il décède en 1244, tué par des milices chrétiennes au service des Almohades. Au milieu de la décennie 1240, les troupes almohades sont mises en déroutes à Guercif. Les Mérinides s’engouffrent alors dans la très stratégique Trouée de Taza, tremplin qui leur permit d’entreprendre le siège de Fès en août 1248 et d’envisager la prise de toute la moitié nord du Maroc. Mais la moitié sud n’est pas en reste. Abu Yahya ben Abd al-Haqq ayant précédemment succédé joue des amitiés traditionnelles des Beni Merin avec les Béni-Ouaraïn du Moyen Atlas et d’autres tribus du Tafilalet pour contrôler les oasis et détourner les revenus du commerce transsaharien de Marrakech vers Fès, désignée comme capitale mérinide.
En 1258, Abu Yusuf Yaqub Ben Abd Al-Haqq succède à son frère enterré dans l’antique Nécropole de Chella qu’il avait commencé à réhabiliter71. Le début de son règne est marqué par une lutte avec son neveu qui réclamait la succession. Ce dernier parvient à prendre Salé. La situation à l’embouchure du Bou Regreg profite à la Castille qui occupera la cité durant deux semaines à l'initiative d'Alphonse X. L’ouest du Rif est également en proie à de nombreuses insurrections ghomaras tandis que Ceuta et Tanger sont alors aux mains des roitelets locaux azafides72. Rapidement le nouveau souverain exprime son désir d’en finir rapidement avec les Almohades retranchés dans le Haouz, l’est des Doukkala et une partie du Souss. Une première tentative en ce sens se solda par un échec en 1262. Les Almohades pressent alors les Abdalwadides d’attaquer leurs rivaux Mérinides par surprise. Yghomracen, célèbre souverain abdalwadide est défait en 1268. L’année suivante, Marrakech est définitivement prise par les Mérinides.
Durant les années qui suivent, il boute les Castillans hors de tous leurs établissements atlantiques jusqu’à Tanger. En 1276, Fès, capitale du royaume mérinide, se voit augmentée d’un nouveau quartier administratif et militaire (Fes El Jedid), à l’écart de l’ancienne ville, où se côtoient notamment le palais sultanien et le Mellah. Globalement la ville connaîtra sous l’ère mérinide un second âge d’or, après celui connu sous les Idrissides. Après la pacification totale du territoire et la prise de Sijilmassa aux Abdalwadides, le sultan franchit le détroit et tente de reconstituer la grande Andalousie musulmane des Almohades. Les campagnes militaires espagnoles des Mérinides sont complexes mais n’accouchent que de peu de résultats concrets. À la suite du siège de Xérès, un traité de paix stipule le retour de nombreux documents et ouvrages d’art andalous (tombés aux mains des chrétiens lors des prises de Séville et Cordoue) vers Fès. En 1286, Abu Yusuf Yaqub Ben Abd Al-Haqq décède à Algésiras. Il est inhumé à Chella.
Son fils Abu Yaqub Yusuf, plus tard dit an-nāsr, lui succède et se voit confronté dès son intronisation à un durcissement des révoltes dans le Drâa et à Marrakech et à un désaveu de certains membres de sa famille, s’alliant tantôt avec les Abdalwadides ou les révoltés. Il rend Cadix aux Nasrides de Grenade en guise de bonne volonté mais six ans plus tard, en 1291, ces derniers, alliés aux Castillans dont ils sont les vassaux, entreprennent de bouter définitivement les Mérinides hors de la péninsule Ibérique. Après quatre mois de siège, Tarifa est prise par les Castillans. Mais Abu Yaqub Yusuf an-Nasr est plutôt préoccupé par Tlemcen, capitale des éternels rivaux des Beni Merin que sont les Abdalwadides. Il se dirige vers Tlemcen à la tête d’une armée cosmopolite puisqu’essentiellement composée de mercenaires chrétiens (Castillans et Aragonais principalement), de Turkmènes oghouzes et de Kurdes. Le siège durera huit ans et se poursuivra jusqu’à l’assassinat du souverain, des mains d’un des eunuques de son harem, en 1307.
Jusqu’à l’avènement d’Abu al-Hasan ben Uthman en 1331, la dynastie est marquée par une forme de décadence dont les principaux symptômes sont la multiplication :
- des querelles de succession ;
- des révoltes populaires (des difficultés dans le Rif, à Ceuta et Tanger se surajoutèrent au climat insurrectionnel croissant à Marrakech et dans le Souss) ;
- des révoltes du corps militaire (mutineries)
En 1331 donc, Abu al-Hasan ben Uthman (surnommé le « Sultan noir ») succède à son père, quelques mois seulement après avoir obtenu son pardon. Rapidement, l’obsession de ses aînés pour Tlemcen le rattrape. Il entame un nouveau siège sur la ville qui s’avérera vain. Il évince ceux qui dans son entourage familial le jalousent mais sait faire preuve d’une grande dextérité dans sa gestion des ambitions tribales. Tlemcen tombe enfin en 1337. Abu al-Hasan ben Uthman est auréolé de gloire. Cette victoire lui ouvre la voie du Maghreb médian mais avant de s’engouffrer dans cette brèche ouverte en direction d’Ifriqiya, le souverain tient à venger la mort de son fils Abu Malik, surpris par les Castillans après son succès à Gibraltar en 1333. La bataille de Tarifa, le 30 octobre 1340 se solde par une lourde défaite qui signe la fin définitive des ambitions marocaines en terre espagnole. Sept années plus tard, le sultan et ses armées parviennent à soumettre l’Ifriqiya. L’année suivante pourtant, les Mérinides essuient une cuisante défaite à Kairouan. L’écho de la déconvenue est grand, au point que naît et se répand une folle rumeur selon laquelle Abu l’Hassan serait mort au combat. À Tlemcen, Abu Inan Faris est alors intronisé. C’est de sa volonté qu’émanera la construction de la medersa Bou Inania de Fès.
Il a d’ailleurs également parachevé la construction de la Medersa Bou Inania de Meknès, entamé par son aîné. Ce dernier tentera un vain retour via Alger puis Sijilmassa. Il est finalement défait et tué par les armées de son fils sur les rives de Oum Errabiaa. Abu Inan Faris, profondément chagriné par ce décès, tentera alors de faire asseoir son autorité sur l’ensemble du royaume, de nouveau fragilisé par la recrudescence des volontés insurrectionnelles. Il s’entoure à ces fins d’Ibn Khaldoun, penseur de génie et véritable précurseur de la sociologie moderne. Son neveu, maître de Fès, est exécuté, mais à l’occasion de ce déplacement au Maroc, c’est Tlemcen qui se soulève. Une intense campagne permet un certain regain de vigueur des Mérinides mais Abu Inan est étranglé des mains d’un de ses vizirs, un certain al-Foudoudi, le 3 décembre 1358, neuf ans seulement après son accession au pouvoir.
L’anarchie est alors à son paroxysme. C’est le premier grand déclin de la dynastie. Chaque vizir tente de porter sur le trône le prétendant le plus faible et manipulable. Les richesses patiemment accumulées par les souverains précédents sont pillées. Un premier prétendant venu de Castille parvient à se soustraire pour un temps à ce diktat des vizirs. Il s’appelle Abû Ziyân Muhammad ben Ya`qûb plus simplement appelé Muhammad ben Yaqub. Reconnu et acclamé dans le nord du Maroc, il règne à partir de 1362 sur un royaume dont seule la moitié nord est demeurée loyale à l’autorité mérinide. Tout au long de son bref règne, il tentera de faire évincer un à un les vizirs jugés encombrants mais c’est des mains d’un de ces derniers, le grand vizir Omar, qu’il périra en 1366.
Omar désincarcère alors le fils d’Abu l’Hasan, Abu Faris Abd al-Aziz ben Ali ou plus simplement Abd al Aziz. Après avoir réussi le tour de force d’évincer bon nombre de vizirs dont celui qui l’a porté au pouvoir, il parvient à mater le pouvoir parallèle en place à Marrakech (pouvoir dit d’Abou l'Fadel, vaincu en 1368). Il parvient à asseoir son autorité en pays Hintata, puis dans le Souss et à Sijilmassa. En 1370, Tlemcen, où s’était reconstitué le pouvoir abdalwadide, retombe aux mains des Mérinides. Mais deux ans plus tard seulement, il s’éteint. Le royaume est à nouveau scindé en deux, les zaouias prenant le pouvoir à Marrakech. La peste noire se fait dévastatrice. S’ensuivent 21 années de déclin durant lesquelles se multiplient les intrigues dynastiques, les coups politiques des différents vizirs, les ingérences nasrides et de vaines tentatives de coup d’éclat militaires face à Tlemcen. Durant les deux périodes de déclin, la pratique de la piraterie maritime se développe, tant dans le Nord, dans les environs de Tanger et Ceuta, que sur la côte atlantique (notamment à Anfa, qui sera détruite en 1468 par des représailles portugaises).
En 1399, alors que le Maroc est en proie à une anarchie des plus totales, le roi Henri III de Castille arme une expédition navale destinée à annihiler la pratique de la course depuis Tétouan. En fait, la ville est non seulement mise à sac mais également totalement vidée de sa population (la moitié est déportée en Castille). En 1415, c’est au tour de Ceuta de tomber aux mains des troupes de Jean Ier, roi du Portugal, lui aussi en croisade contre la course maritime des cités portuaires de la côte marocaine.
La dynastie mérinide connait un tragique déclin. Abu Saïd Uthman ben Ahmad dit Abu Saïd succède à Abu Amir Abd Allah dans des circonstances troubles. En 1421 Abu Muhammad Abd al-Haqq succède à Abu Saïd alors qu’il n’a qu’un an; cette accession au trône appela bien sûr une régence. Les vizirs wattassides s’avèreront incontournables et accapareront le pouvoir pendant près de quarante années, à l'issue desquelles ils seront massacrés, en 1459, par Abd al-Haqq qui reconquiert le pouvoir par l'occasion. Une révolte populaire éclate néanmoins à Fès en 1465 et Abd a-Haqq est égorgé ; cet épisode marque la fin du règne des Mérinides.
an 1270 : Magreb - Mort d'ABOU-SAÎD, le dernier des Almohades. Le sultanat de Tunis, qui a pour maître MOHAMMED, successeur d'ABOU-HAFFS (1226 - 1249), fondateur de la dynastie des Abouhassides, est envahi par Saint-Louis.
an 1270-1755 : Érythrée - De 1270 à 1755, c'est la dynastie salomonide qui dirige, se réclamant de la descendance du roi Salomon et de la reine de Saba, dont on dit qu’elle donna naissance au premier roi Ménélik Ier (vers -950) après sa visite à Salomon, relatée dans la Bible, dans la ville de Jérusalem. Elle est aussi l'une des deux plus vieilles maisons royales dans le monde avec la maison impériale du Japon.
an 1270 : Éthiopie - En 1270, le dernier souverain zagwé, Yetbarek, est renversé par Yekouno Amlak. L'arrivée au pouvoir de ce dernier marque l'instauration de la dynastie salomonide qui perdure symboliquement de façon presque continue jusqu'en 1274, sans qu'il y ait une continuité familiale. Pendant presque trois siècles, le pays vit une période de développement culturel, administratif, d'extension territoriale et de guerres contre les sultanats musulmans voisins des royaumes chrétiens, bien que ce clivage recouvre plus les dirigeants que les habitants. Cette phase de l'histoire éthiopienne est parfois surnommée l'« âge d'or de la dynastie salomonide ».
an 1274 : Égypte - Invasion de BIBARS dans la Petite-Arménie. La population invoque le secours des Mongols.
an 1278 : Égypte - Le sultan BIBARS livre aux Mongols une grande bataille en Syrie, non loin de Damas. Grièvement blessé, il termine sa vie dans cette ville et laisse le pouvoir à son fils aîné ASSAÏD-BEREK-KHAN. Mais celui-ci, ainsi qu'après lui, son frère, est forcé d'abdiquer et ALMANSOUR KELAOUN (1279 - 1290) est alors élevé au trône.
an 1280 : Mali - Djenné : construction de la Grande Mosquée. Civilisation pré-islamique du Delta intérieur du Niger
an 1285 : La croisade ayant été encore été prêchée contre les infidèles, une multitude de pèlerins armés arrivent en Palestine et violent la paix qui avait été conclue avec l’Égypte. Le sultan Kélaoun, irrité, fond sur la Syrie. Après avoir pris le château de Margat, il tourne ses armes contre le comté de Tripoli, où régnait le jeune Bohémond VII, dont la mort prématurée laissa bientôt (1287) ses sujets sans défenseur.
an 1285 : Magreb : Le roi de Tremcen est dépouillé de ses états par le chefs des Mérinides, roi de Fez et de Maroc
an 1288 : Le sultan d'Égypte s'empare de Laodicée et de Tripoli. Acre, Tyr et Sidon sont les seules villes du royaume de Jérusalem qui restent aux Chrétiens.
an 1291 : Canaries (Îles des) - Les premiers navigateurs européens
En mai 1291, deux galères quittent le port de Gênes sous le commandement des frères Vandino et Ugolino Vivaldi. Leur objectif est d'établir des relations commerciales avec l'Inde en contournant l'Afrique. Les navires traversent le détroit de Gibraltar et naviguent vers le sud le long de la côte africaine. On pense que ces Génois connaissaient les îles Canaries et se dirigeaient vers elles pour obtenir de la nourriture et de l'eau. Il n'y a aucune information sur la localisation des navires lorsqu'ils disparaissent en mer.
an 1296 : Le long règne de MOHAMMED-EL-NASR (1294 - 1341), fils de KEIOUAN, interrompu deux fois par trois usurpateurs, est l'époque de la plus grande prospérité de l’Égypte.
an 1299 : MOHAMMED-EL-NASR est battu en Syrie par le khan des Mongols de Perse, allié au roi chrétien d'Arménie et secondé par les Templiers conduits par Jacques MOLAY. Il perd Jérusalem, mais reprend cette ville au bout de quelques mois.
an 1299-1555 : Algérie - En 1299, les Mérinides assiègent Tlemcen pendant sept ans, sans réussir à s'emparer de la ville. Ils parviennent à l'occuper à deux reprises : 1337-1348 et 1352-1359, et envahissent le domaine hafside en 1347 et en 1353, sans pouvoir y demeurer. Le royaume zianide connait son apogée sous le règne d'Abou Hammou Moussa II (1359-1389). Au XVe siècle, la dynastie hafside, profitant du déclin des Mérinides et des Zianides connaît son deuxième apogée. Les Zianides leur reconnaissent une suzeraineté nominale et les Wattassides, successeurs des Mérinides, se reconnaissent leurs vassaux. Les deux dynasties hafside et zianide disparaissent après la prise de leur capitale Tunis et Tlemcen par les Ottomans respectivement en 1574 et 1555.
Les Zianides font de Tlemcen une cité importante dotée de riches édifices et peuplée de cent mille habitants. Elle est également un centre de rayonnement des religieux malikites et des panégyristes, abritant plusieurs médersas et un centre commercial. Elle est vue par les Européens comme une des villes les plus considérables du Maghreb et réputée pour sa tolérance religieuse. Dans le domaine hafside, le malikisme gagne du terrain via Béjaïa, Constantine et Biskra. Les recherches scientifiques sont concentrées dans le foyer des savants andalous immigrés à Béjaïa et à Constantine. Béjaïa est également une ville de plus de cent mille habitants avant l'occupation espagnole.
XIV - XVème siècle : Éthiopie - Cette dynastie étend son territoire. En 1316-1317, le roi chrétien, Amda Seyon assujettit le puissant royaume du Damot, anciennement païen mais passé à l'Islam, ainsi qu'un autre sultanat, Hadiya et le Godjam (à l'Ouest). Des populations sont déportées et les chrétiens prennent leur place. Les six petits États musulmans qui subsistent doivent payer tribut. La région du Choa passe sous contrôle, politique et religieux, du roi chrétien. Mais la concurrence et les conflits restent constants dans ce paysage encore très morcelé, aux XIVe et XVe siècles. Les chrétiens tiennent les approvisionnements du haut plateau, esclaves, or, ivoire, tandis que les musulmans tiennent les voies d'acheminement vers les ports (Zayla et Massawa). Le rôle des villes-marchés est essentiel. Les petites villes musulmanes affichent une très grande modestie, et le roi chrétien se déplace sous de simples tentes, fondant à l'occasion une église et assurant par sa présence la mobilité de son armée, prête à répondre à toute attaque. De nombreux liens sont tissés entre les communautés sous domination chrétienne, des mariages ont lieu, mais surtout, le roi intervient constamment dans les affaires du sultanat d'Ifât. Et ce comportement va déclencher, d'abord une série de combats non décisifs contre les troupes chrétiennes, puis le djihad de l'imam Ahmad (1527-1542) au cours du règne de David II.
Cet imam, Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi, ne faisant partie d'aucune famille ayant exercé le pouvoir, apparait comme un homme neuf, et, en tant qu'imam, il est le garant d'un islam orthodoxe. Il peut ainsi mener la guerre en toute indépendance, vis-à-vis du sultan d'Ifât. Il parvient alors à rassembler non seulement les musulmans des sultanats d'Éthiopie, mais aussi des armées venues de la péninsule arabique. Les anciens territoires conquis par les chrétiens leur sont repris, puis c'est le royaume lui-même qui est quasiment conquis.
XIVème siècle : Gabon - Le peuplement du Gabon se constitue donc par vagues successives d'immigration, jusqu'au XIXe siècle, de Pygmées puis plus massivement de Bantous, de nos jours majoritaires.
XIVème siècle : Gambie - Au début du XIVe siècle, la Gambie fait partie de l'empire du Mali.
XIVème siècle : Mayotte -
Des petites bourgades se constituent, prospérant du commerce des esclaves principalement et de l'exportation des productions agricoles (viandes, riz). Les premières habitations en pierre, résidences des élites révélées par l'archéologie, apparaissent dès le XIVe siècle. Les rivalités entre ces localités et peut-être déjà entre les îles, se traduisent par la multiplication des sites fortifiés. Les principales localités d'alors sont Mtsamboro, Acoua, Tsingoni, Bandrélé... qui connaissent un fort développement et amorcent un processus d'urbanisation.
L'islamisation des élites : L'islam sunnite chaféite, développé à la côte swahilie, est imposé par le sultanat shirazi au XVe siècle, il n'en a pas toujours été ainsi puisque le soufisme chiite et l'ibadisme ont laissé des traces sur l'île : au travers du nom de certains fani, de la vénération des tombes des saints – ziara – et de l'existence sur le site de Mitseni des vestiges d'une mosquée ibadite antérieure à la mosquée chaféite, enfin dans la légende, datée des XIVe et XVe siècles, de Matsingo et de son époux Mwarabu (l'Arabe), ce dernier veut enseigner l'islam chaféite aux chefs de l'île et voit le refus de certains prétextant qu'ils ont déjà leurs propres traditions islamiques.
Les mosquées anciennes de Mayotte : Une vingtaine de mosquées anciennes existent à Mayotte et la très grande majorité sont en ruine du fait de l'abandon de ces anciens villages à la fin du XVIIIe siècle. Leur datation est très incertaine : les plus anciennes pourraient remonter au XIVe siècle mais seule la date de la mosquée de Tsingoni est aujourd'hui acquise grâce à une inscription conservée dans son mihrab. En effet, le sultan Aïssa (ou Ali) ben Mohamed embellit la première mosquée signalée dès 1521 par l'ajout d'un mihrab en 1538.
Les mosquées anciennes de l'île présentent les mêmes grandes caractéristiques empruntées à l'architecture religieuse swahili elle-même copiée des mosquées du Hadramaout : une salle de prière avec mihrab encadré par deux couloirs latéraux accessibles par une cour où est placé un bassin pour les ablutions. Ces mosquées n'ont pas de minaret et, de taille modeste, ne peuvent accueillir qu'une cinquantaine d'hommes. Les toitures étaient principalement réalisées avec une couverture végétale à deux pans, mais Tsingoni possédait une toiture plate soutenue par des piliers dans la salle de prière. Les murs, construits en blocs de pierre et de corail sont généralement couverts d'enduit de chaux et ne possèdent pas d'autre décoration. Le mihrab de Tsingoni, réalisé à partir de corail sculpté, est à ce titre un exemplaire remarquable et unique dans l'île de l'art religieux dont on retrouve des parallèles à Domoni (Anjouan) et dans les anciennes cités swahili de la côte africaine.
Une société esclavagiste dirigée par les élites islamisées : La société d'alors, est dominée par l'aristocratie Fani. Cosmopolite, elle est le fruit du brassage entre l'ancienne aristocratie et les nouveaux clans. L'essentiel de la population n'en reste pas moins composée d'esclaves qui ont grandement contribué à peupler et mettre en valeur l'île. En effet, au cours des XIIIe – XIVe siècles, le nombre de villages ne cesse d'augmenter, et cette croissance démographique est si soudaine que seul le recours à l'esclavage peut expliquer.
C'est d'ailleurs à cette époque que se développent les ports Antalaotra de la côte malgache, ports dont la prospérité est due à l'exportation des esclaves originaires des hauts plateaux malgaches (pays Hova) vers le Moyen-Orient via les Comores et les cités swahili. De nombreux indices (témoignages portugais) laissent entendre que les Comores importent aussi des esclaves africains. On entrevoit alors que dès les XIVe – XVe siècle, « l'élevage des esclaves » décrit en 1521 par Piri Reis est une spécialité déjà ancienne des Comores.
XIVème siècle : Nigéria - Les Yoruba installèrent une communauté dans la zone edophone à l’est d’Ife, qui en devint dépendante au début du XIVe siècle. Au siècle suivant, elle devint un centre commercial indépendant, bloquant l’accès d’Ife à la côte. Le roi détenait le pouvoir politique et religieux, et la tradition en faisait un descendant de la dynastie d’Ife.
Le commerce fut la source de l’émergence de communautés organisées au nord du pays, recouvert par la savane. Les habitants préhistoriques de la lisière du désert s’étaient trouvés largement dispersés au IVe millénaire av. J.-C., lorsque la dessiccation du Sahara commença. Des routes commerciales transsahariennes reliaient l’ouest du Soudan à la Méditerranée depuis l’époque de Carthage, et au Nil supérieur depuis des temps bien plus reculés. Ces voies de communication et d’échanges culturels subsistèrent jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est par ces mêmes routes que l’islam se répandit en Afrique de l'Ouest à partir du IXe siècle.
XIVème - XVème siècles : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Des cités-États commerçantes sont fondées par les migrants arabes : Lamu, Pate, Pemba, Zanzibar, Malindi, Mombasa, Sofala. Les Shirazis perses s’installent à Kilwa qui devient le centre de commerce le plus florissant de la région (Sultanat de Kilwa) au XIe et surtout au XIVe siècle, en partie grâce au commerce d’ivoire d’éléphants et d’hippopotames, et principalement grâce à l’or en provenance des mines de Sofala, dans l’actuel Mozambique, et à destination de l’Europe et du monde islamique. Kilwa est à cette époque décrite comme étant une des villes les plus élégamment bâties du monde. L’île de Zanzibar prospère également. Des caravanes commerciales s’enfoncent de plus en plus profondément dans les terres jusqu’aux grands lacs pour récupérer les précieuses marchandises qui sont réexpédiées vers le Moyen-Orient.
Mais ces villes se font concurrence et se querellent. Elles n’opposent pas un front uni lorsque les premiers européens arrivent sur la côte à la fin du XVe siècle.
an 1312 : Canaries (Îles des) - Les premiers navigateurs européens
Une expédition dirigée par un autre Génois, Lancelotto Malocello, part à la recherche des galères disparues : c'est l'origine des premières cartes mentionnant Lanzarote avec des armoiries génoises (Insula de Lanzarotus Marocelus).
an 1312 : Mali - À son apogée sous le règne de Mansa Moussa, en 1312, l'empire du Mali s'étendait sur une région comprise entre l'océan Atlantique et le Niger. Ce souverain est devenu célèbre pour les fastes de son pèlerinage à La Mecque. Son armée était composée de
100 000 soldats. La prospérité de l'empire reposait sur le commerce transsaharien du cuivre, du sel, de l'or et des étoffes. Les caravanes favorisaient également les échanges culturels. Tombouctou, Gao et Djenné furent les centres économiques et culturels de cette civilisation au centre de l'islam soudano-malien.
an 1314-1344 : Éthiopie - Amda Syon Ier mène les premières grandes conquêtes territoriales durant les trente années de son règne (1314-1344) ; une expansion consolidée par Dawit Ier et Yeshaq Ier de la fin du XIVe au début du XVe.
an 1315 : Soudan - En septembre 1315, les Mamelouks d'Égypte lancent une expédition contre le royaume chrétien de Makurie ; le sultan du Caire al-Nâsir dépose Kérenbés, dernier roi chrétien de Dongola, pour refus de payer le tribut. Il installe sur le trône un roi nubien musulman nommé Abdallah ibn-Sanbou. Ce dernier est à son tour renversé par un autre musulman, Kanz ed-Daoula, qui occupe la région jusqu’en 1382. En lutte continuelle contre les Égyptiens et parvient à occuper temporairement la région d’Assouan, il en est définitivement chassé à la fin du siècle par les troupes égyptiennes. Le royaume d'Alodie (Aloa), plus au sud, reste à l’écart de ces combats, mais lorsque Dongola tombe, il est coupé de la chrétienté, car le royaume d’Éthiopie lui est hostile.
an 1317 : Soudan - Le 29 mai 1317, la cathédrale de Dongola est officiellement transformée en mosquée. L’islamisation des élites commence
an 1324 : Mali - En 1324, le mansa (roi des rois), Kanga Moussa, à l'occasion d'un pèlerinage à La Mecque, déverse tant d'or — une dizaine de tonnes semble-t-il — dans l'économie moyen-orientale qu'il fait baisser pour plusieurs années le cours du métal précieux.
an 1332 : Canaries (Îles des) - En avril 1332, une escadre quitte le port de Palma de Majorque aux Baléares, avec pour tâche de « prendre l'une des îles mentionnées ou toute ville ou colonie fortifiée et de la transférer à leur seigneur lige ». Tout ce que l'on sait de ce voyage, c'est que les navires sont revenus au bout d'environ cinq mois et demi.
an 1340 : Soudan - Le dernier royaume de Nubie soudanaise est commandé depuis la ville nubienne de Kokka. Le premier roi s'appelle Nasser. Il prend le pouvoir vers 1340. Treize rois règnent depuis cette capitale, d'Assouan jusqu'à Dongola. On suppose aussi d'après des sources sérieuses que les royaumes dits « petits » et éparpillés dans la province de Nubie sont tous issus de cette dynastie. Le treizième et dernier roi régnant depuis Kokka est Abdelaziz Zubair Al Malik Al Diab de Nubie, qui perd son trône vers 1940. Chaque prénom : Abelaziz, Zubair. etc. représente dans l'ordre le prénom du dernier roi, puis celui de son père et ainsi de suite. Les Anglais sont venus le déchoir oralement. Le royaume de Kokka était divisé en sept districts, avec des rangs de noblesse différents. Cette dynastie de rois avait conclu différents pactes et alliances notamment avec les Turcs, et leur royaume n'avait donc pas été affaibli au moment des différents rebondissements historiques. Le dernier roi était d'ailleurs l'époux d'une femme turque.
an 1341 : Canaries (Îles des) - Le navigateur génois Niccolò de Recco (1327-1364) est un des chefs de l'expédition, équipée par le roi de Portugal Alphonse IV, qui explore les îles Canaries pendant quatre mois en 1341 (l'éruption volcanique de 1341 a lieu durant ce séjour). Recco fournit un rapport crédible sur la situation des îles Canaries, De Canaria et insulis reliquis ultra Ispaniam in Oceano noviter repertis (vers 1342). La version latine envoyée à Rome en est attribuée à Boccace (1313-1375).
an 1341 : Le long règne de MOHAMMED-EL-NASR, interrompu deux fois par des usurpateurs, est suivi, pendant 20 ans, de discordes civiles; Huit de ses fils règnent successivement après lui.
an 1344 - 1345 : Canaries (Îles des) - La principauté des Îles fortunées
Par la bulle Tuae devotionis sinceritas (de) du 15 novembre 1344, le pape Clément VI (1291-1352, en charge en 1342-1352) nomme prince de la Fortunée, c'est-à-dire des îles Canaries, l'amiral français Louis de la Cerda (1291-1348), pour le compte de leur propriétaire supposé, le Saint-Siège.
Le 28 novembre 1344, il reçoit de la main du pape une couronne et un sceptre comme symboles de son état et de sa souveraineté sur les onze îles, en échange d'une rente de 400 florins d'or par an, avec des indulgences accordées à tous ceux qui participeraient à l'expédition de conquête, lors d'une cérémonie relatée par Pétrarque.
Mais les efforts du pape et du prince pour mettre en place une force de conquête restent infructueux. Après la mort de Louis de la Cerda, ses héritiers ne font pas valoir ses droits, d'ailleurs contestés dès le 12 février 1345 par le roi Alphonse VI de Portugal, puis par le roi de Castille Alphonse XI.
an 1346 : Canaries (Îles des) - Le navigateur majorquain Jaume Ferrer serait le découvreur supposé de la « Rivière d'Or » (Rio de Oro) en 1346, mais il disparaît en mer peu après.
an 1347 : Magreb, ABOUL-HASSAN, roi de Maroc (1331 - 1352), s'empare de toute l'Afrique; Mais une révolte éclate contre lui, et il se réfugie à Kairwan. Tunis et Tremcen recouvrent leur indépendance.
an 1348 : Magreb - Egypte - Une affreuse contagion, connue sous le nom de mort noire, peste noire, se répand de la Chine, où elle comptait ses victimes par millions, sur toute l'Asie occidentale, ainsi que sur l’Égypte. Cette terrible maladie s'annonçait par un crachement de sang, des boutons ou bubons se formaient sur toute les parties molles du corps. Les malades expiraient le second ou le troisième jour. Des familles entières étaient enlevées. De l'Asie-Mineure, cette peste gagna la partie européenne de l'empire d'Orient et de la Syrie, elle fut apportée en Italie par des vaisseaux génois.
an 1350-1450 : Algérie - À partir du milieu du XIVe siècle, le Maghreb connait une décadence générale et une offensive ibérique. Au niveau socio-économique, le commerce est tari par la marginalisation du Maghreb dans le commerce mondial, la citadinité recule et l'agriculture connait une régression avec les concessions terriennes accordées aux tribus nomades. Sur le plan politique, le modèle étatique tribal est en crise, le paysage politique est marqué par les rivalités entre les dynasties, les guerres intestines et les révoltes sociales. Les États ne forment plus qu'une mosaïque de féodalités autonomes. Le climat devient également plus sec à partir du XIe siècle, et selon certains historiens, les famines et le repli démographique s'amorcent à l'époque fatimide. De 1350 à 1450, la peste noire et les sécheresses prolongées engendrent une diminution de la population de 30 % à 50 %. Cette crise dépeuple les campagnes et les villes, renforce le nomadisme et engendre la généralisation du culte des saints et du maraboutisme.
Au Maghreb central, le royaume zianide se fragmente, affaibli par les querelles familiales ; les émirs installés à Oran et Ténès luttent contre les souverains de Tlemcen. Dans le royaume hafside, les émirs de Béjaïa et de Constantine, qui régnaient déjà en autonomie jusqu'à Collo et Annaba, agissent indépendamment de l'autorité de Tunis. Les ports, Alger, Annaba, Jijel, Dellys, forment de petites républiques. À Alger, une aristocratie marchande d'origine andalouse, protégée par une tribu arabe, dirige la ville. Dans les Hauts plateaux, les Aurès et le Sud, les confédérations tribales sont indépendantes de tout pouvoir central, et en Kabylie des principautés indépendantes se constituent.
an 1350 : Canaries (Îles des) - Vers 1350-1400, les Frères Zeno, navigateurs vénitiens, seraient à l'origine de la Carte Zeno, publiée en 1558.
Le Libro del Conoscimiento, manuel héraldique et géographique, témoignerait d'un voyage réalisé par un moine franciscain vers 1350.
an 1350 : Mauritanie - Vers 1350, Ibn Battûta apporte de précieux renseignement sur la situation du commerce caravanier et l'état culturel.
Nous sommes dans le contexte de l'arrivée des tribus arabes, issues d'un brassage entre les célèbres Hillaliens, qui, installés au Maghreb tunisien et central commencent à entrer au Maghreb et au Sahara atlantique, et les Banî Hassan, venus du Yémen, installés à Sijilmassa, Zagora, Skoura et dans toute la Mauritanie.
Les Saadiens qui prennent le contrôle de Marrakech vers 1560 sont eux-mêmes rattachés aux Banî Hassan.
an 1351 - 1352 : Canaries (Îles des) - Tandis que la « Principauté des îles Heureuses » échoue, quelques prêtres et moines majorquins élaborent le projet de convertir les habitants des îles Canaries exclusivement par un travail missionnaire pacifique. La base en serait les enseignements du philosophe et théologien majorquin Raymond Lulle (1232-1315). Douze indigènes de l'île de Grande Canarie, arrivés à Majorque comme esclaves, contribueraient à l'évangélisation, une fois libérés, enseignés et baptisés. Deux armateurs se déclarent prêts à financer cette expédition, en contrepartie de quelques avantages, comme les droits d'exportation vers les pays méditerranéens de produits locaux comme l'orseille pour la fabrication d'une teinture rouge, mais aussi de chèvres (viande et peaux).
Le 7 novembre 1351, par la bulle Coelestis rex regum, le pape Clément VI crée l'évêché des îles de la Fortune (es) (ou « évêché de Telde », à Grande Canarie) et nomme Bernardo Font son premier évêque.
Les Majorquins arrivent probablement sur l'île de Grande Canarie au milieu de 1352. Une coexistence pacifique semble s'instaurer entre les indigènes et les missionnaires avec leurs assistants canariens. Une première église chrétienne est construite, grâce à des colons majorquins accompagnateurs également en bonnes relations avec les peuples autochtones. Divers voyages entre Majorque et Grande Canarie semblent avoir eu lieu, documentés à partir de 1386. Mais l'évangélisation ne paraît pas avoir un grand succès.
1351 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
L'existence de Madère n'est attestée qu'en 1351 sur un portulan de Florence, ainsi que dans certains documents arabes.
L'hypothèse du passage d'un équipage de bateau viking, escale ou naufrage, entre le IXe et le XIe siècle, sans trace d'aucun artefact humain, s'appuie sur une présence animale collatérale. L'étude d'ossements de souris (mus musculus) atypiques sur l'île, datant du XIe siècle, indique que les rongeurs sont arrivés entre l'an 800 et 1036. Leur ADN mitochondrial les rapproche des populations de Scandinavie et d'Allemagne du Nord. Sur l'île, elles se sont diversifiées en six nouvelles espèces (leur hybridation engendre une descendance stérile) et leur nombre de chromosomes est passé de 40 (souche originelle) à 22 à 30 pour les descendants insulaires.
Le manuscrit Libro del Conoscimiento, manuel héraldique et géographique, écrit dans le royaume de Castille, est présenté comme le récit de voyage d'un frère franciscain en 1305 en Europe, Afrique et Asie, mais son authenticité est discutée. Sont évoquées des îles nommées "Leiname", "Diserta" et "Puerto Santo", pouvant correspondre à l'archipel de Madère.
Robert Machin, aventurier anglais du 14e siècle, est à l'origine d'un récit, tout autant romanesque, se déroulant à l'époque du roi d'Angleterre Édouard III (1312-1377) et duc d'Aquitaine. Les deux amants, Robert Machim et Anna d'Arfet, fuyant l'Angleterre en 1346, auraient été pris dans une tempête et emportés jusqu'à Madère, dans un lieu nommé après eux Machico, et où, en 1419, le Portugais João Gonçalves Zarco aurait trouvé une croix gravée de leurs deux noms (Mc Kean, Dorset), et aurait fait construire la "capela dos Milagres" (chapelle des Miracles), plusieurs fois reconstruite.
an 1382 : Egypte - Fin du règne es Mamelouks Baharites. Les Ciscassiens ou Bordjites, qui leurs succèdent, gouverneront l'Egypte et la Syrie jusqu'en 1517. Le nom de Bordjites est dérivé de bodj, tour ou fort : il rappelait que les jeunes Circassiens achetés par Kelaoun et ses successeurs avaient été élevés dans le château du Caire et dans les autres forteresses du pays. Sous le premier sultan de cette dynastie, BARKOK (1382 - 1399), l'Egypte entre en lutte avec TAMERLAN.
an 1387-1433 : Mali - Après le règne de Mansa Moussa II (vers 1387), l'empire connaît une période de troubles de succession qui l'affaiblissent ; dans le même temps, les berbères touareg, restés durablement rebelles, lancent des attaques contre les villes de la zone sahélienne, notamment Tombouctou dont ils s'emparent en 1433
fin XIVème siècle : Canaries (Îles des) - Dans le dernier quart du XIVe siècle, en particulier à partir des ports castillans, des opérations sont lancées, menées uniquement à des fins de capture d'esclaves sur la côte marocaine et aux îles Canaries.
Le parcours d'une de ces compagnies de « pêche aux esclaves » est enregistré dans la Crónica del rey don Enrique III pour l'année 1393.
Sous la responsabilité du noble Gonzalo Pérez Martel (1350-1392), seigneur d'Almonaster la Real (Huelva, Andalousie), de nombreux aventuriers andalous et basques se regroupent pour équiper une flotte de cinq ou six navires dans le but de piller les îles Canaries. Fin mai ou début juin 1393, la flotte quitte le port de Séville. La première cible est Grande Canarie, où les assaillants s'emparent de résidents (hommes, femmes) et de bétail. La deuxième destination est Lanzarote, où ils capturent 170 indigènes, dont le roi de l'île et sa compagne (Tinguafaya).
Ces attaques déstabilisent les habitants indigènes des îles, qui assimilent rapidement missionnaires pacifiques et marchands d'esclaves. À la suite de plusieurs incursions, les Canariens tuent les missionnaires pour collusion supposée avec les pillards.
XVème siècle : Cap Vert - La date exacte à laquelle a accosté le premier bateau portugais demeure incertaine. Le premier arrivant documenté a alors décrit l’archipel comme étant inhabité, bien qu'il ait été connu depuis les Grecs anciens qui les décrivirent dans le mythe des Hespérides (mais ce nom pourrait aussi concerner les iles Canaries, plus proches du détroit de Gibraltar).
Vu le régime des vents et courants dominants de la région, il n’est pas exclu qu'y aient débarqué à diverses époques des pêcheurs lébous, communauté de langue wolof très présente au Sénégal, particulièrement dans la presqu'île du Cap-Vert (Dakar), à 700 km.
Les Phéniciens auraient pu visiter l’archipel dès l'antiquité : le récit du Périple de Hannon, mentionne un certain nombre d'escales, au-delà de l’île de Cerné en actuelle Mauritanie, dont l'une pourrait être l'archipel. La mention du "char des Dieux" dans le Périple pourrait alors concerner une éruption du volcan actif de l'ile de Fogo.
L'hypothèse de la circumnavigation chinoise (thèse pseudo-historique de 2002), avec ou sans exploration/découverte d'îles atlantiques s'appuie sur la personnalité de l'amiral chinois Zheng He (1371-1433) et surtout sur la carte Kangnido (1402, Corée) d'authenticité douteuse.
L'hypothèse d'exploration et/ou de découverte arabo-musulmane d'îles atlantiques ne s'appuie encore sur aucun document authentique de navigation. L’historien portugais Jaime Cortesão rapporte une légende selon laquelle les Arabes auraient visité une île, qu’ils nommaient « Aulil » ou « Ulil », où ils récoltèrent du sel dans des marais salants naturels. Selon lui, il pourrait s’agir de l’île de Sal.
XVème siècle : Canaries (Îles des) - La conquête des Canaries au XVe siècle : de Jean de Béthencourt aux Rois catholiques
Le XVe siècle est marqué par l'intervention en 1402 de Jean de Béthencourt, un Français de Dieppe, agissant avec l'aval du roi de Castille, à qui il est lié par un contrat d'inféodation des terres qu'il pourrait conquérir aux Canaries ; ce contrat ne concerne que certaines îles, dites « îles de seigneurie », dont la conquête occupe plusieurs décennies.
À la fin du siècle, les Rois catholiques, la reine de Castille Isabelle Ire et le roi d'Aragon Ferdinand II, mariés en 1474, sont en guerre avec le roi de Portugal Alphonse V de 1475 à 1479 dans la guerre de Succession de Castille, qui s'achève par le traité d’Alcáçovas. C'est dans ce cadre qu'ils décident d'intervenir directement (conquista realenga, « conquête royale ») dans les autres îles, dites « îles royales », afin d'empêcher les Portugais de s'installer sur l'archipel.
Après la conquête, les îles Canaries sont les terres les plus à l'ouest sous le contrôle de la Castille, alors que les Portugais sont déjà présents aux Açores : elle servent donc d'ultime étape avant d'affronter la « mer Océane » lors du premier voyage transatlantique de Christophe Colomb (3 août 1492-15 mars 1493), qui le mène jusqu'aux îles de Cuba et d'Hispaniola.
La population guanche en 1400 est estimée à moins de 40 000 personnes (dont 30 000 à la Grande Canarie, et moins de 5 000 à La Palma).
La bulle pontificale Sicut dudum (1435) du pape Eugène IV condamne l'esclavage pratiqué sur les indigènes des îles Canaries, les Guanches, baptisés ou non, sous peine d'excommunication. Ce premier jalon doctrinal contre l'esclavage semble avoir eu fort peu de conséquences aux Canaries. En 1441, le franciscain espagnol Didakus Diego d'Alcalá (Didakus, 1400-1463), missionnaire à Fuerteventura, (ré)organise l'évangélisation des Guanches.
Le volcan Teide, vers La Orotava (Ténérife), entre en éruption en 1430, de mémoire guanche[pas clair] ; une éruption aurait eu lieu vers Boca Cangrejo (près de El Rosario (Tenerife)) en 1492 (signalée par Christophe Colomb).
XVème siècle et XVIème siècle : Archipel des Comores -
a. Structure sociale - Les systèmes issus de cette histoire superposent des coutumes africaines, arabo-musulmanes et parfois malgaches mais ne sont pas à même de fournir au détenteur du pouvoir les moyens de contrôler de grandes surfaces. Ainsi à la Grande Comore, cohabitent plusieurs sultanats dirigés par différents chefs (sultans) qui décident d'accorder une importance honorifique à l’un d’entre eux, le sultan Tibé. À Anjouan, trois lignages royaux implantés dans les trois principales villes (Mutsamudu, Ouani et Domoni) se partagent le pouvoir.
Un tel système doit tenir compte des avis d’un Grand Conseil (Mandjelissa) qui réunit les principaux grands notables. Le sultan est aussi secondé par des vizirs qui sont des relais du pouvoir dans certaines régions. On trouve aussi sur le plan local d’autres agents administratifs : naïbs (assimilables à des chefs de canton), chefs de la police, collecteurs d’impôts, chefs de village (nommés par le sultan) et chefs religieux. C’est de cette époque que datent les documents écrits et les manuscrits en langue arabe, en swahili ou en comorien, le tout présenté en alphabet arabe. Par la suite les Comoriens cherchent aussi à instaurer leur langue (les différentes langues des Comores étant des dialectes du kiswahili) comme un moyen de communication administratif et littéraire, notamment par l'enseignement.
b. L'âge d'or du Zanguebar - L'archipel des Comores constitue la frontière sud de l'aire culturelle swahilie qui se développe à partir de la fin du Moyen Âge dans cette région que l'on appelle à l'époque le Zanguebar (« côte des Noirs » en persan) ; Mayotte constitue également le point de contact de cet ensemble avec la culture malgache, très différente, ce qui fait de cette île un carrefour d'influences - mais aussi un enjeu militaire stratégique. Les influences venues de l'ensemble de l'océan Indien, mais aussi de la côte africaine, chamboulée par l'irruption des Bantous, et de la côte malgache, ne cessent de façonner la société swahilie insulaire. Une immigration bantoue et malgache (Sakalaves) commence insensiblement.
En 1453, la chute de Constantinople ferme brutalement les routes commerciales qui reliaient l'Europe à l'Orient. S'ouvre alors l'âge d'or du commerce maritime, qui contourne l'Afrique pour atteindre l'Inde et la Chine : le canal du Mozambique se retrouve donc subitement au cœur de la principale route commerciale au monde, entraînant une importante période de prospérité pour les nombreuses îles et cités-États de l'aire culturelle swahilie.
Durant cette période, au cours de l'exploration systématique de toute cette région, les Portugais abordent les îles de la Lune (K'm'r en arabe signifie lune) en 1505. En 1529, les Français, par l'intermédiaire d'un frère de Parmentier, visitent ces îles ainsi que la côte nord de Madagascar.
C'est du début du XVIe siècle que datent les premières relations directes avec les peuples européens, et tout d'abord les navigateurs Portugais, mais aussi des navigateurs ottomans comme en 1521 l'amiral et cartographe ottoman Piri Reis. Celui-ci décrit Mayotte en ces termes dans son Kitab-i Bahrije :
« La seconde île est nommée Magota. On dit que les Portugais y ont mis des hommes. Elle a un Chah. Sa population est noire et blanche. Ils sont chafi'i, parmi eux point d'hypocrisie. Elle a une ville nommée Chin Kuni [Tsingoni]. N'y règnent que des cheikhs».
L'archipel se trouve en effet en position stratégique sur les routes commerciales reliant l'Europe à l'Orient en contournant l'Afrique : les navigateurs européens de l'époque recommandent en effet aux navires en route pour les Indes de faire une pause atlantique au Cap-Vert au printemps et une pause indienne aux Comores en septembre, afin de profiter au mieux des courants de mousson ; c'est l'île d'Anjouan qui est alors considérée comme la plus sûre pour les bateaux, ayant toujours une de ses trois côtes protégée du vent.
XVème siècle : Congo Brazzaville - Les Portugais s'aventurent dans le golfe de Guinée à partir de la fin du XVe siècle ; Diogo Cão atteint l'embouchure du fleuve Congo en 1482. Il effectue un nouveau voyage deux ans plus tard, au cours duquel il dit avoir remonté le cours du fleuve sur plus de cent kilomètres, jusqu'aux chutes de Yellala.
XVème siècle : Gabon - C'est lors de ce processus qu'accostent, au XVe siècle, les premiers Européens, des Portugais. Le nom du Gabon lui vient de ces premiers colons ; Gabão en portugais signifie « caban », en rapport avec la forme de l'Estuaire qui borde les côtes de Libreville. D'après le Dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains d'Arol Ketchiemen, il est cependant fort probable que le nom « Gabon » ait été emprunté aux populations africaines locales.
Les Portugais, suivis des Hollandais, se livrent à la traite négrière, commerçant avec les chefs côtiers et notamment les Mpongwes, établis dans l'estuaire du Komos et les Orungus, implantés dans le delta de l'Ogooué. Les esclaves sont d'abord destinés aux plantations de Sao Tomé avant que ne se développe le commerce avec l'Amérique. Le commerce concerne aussi le caoutchouc, le bois, l'ivoire… Durant cette période, qui s'étend jusqu'au XIXe siècle, les Européens ne cherchent pas à pénétrer le pays ; ils établissent des implantations et des fortins dans la zone littorale et les relations avec l'intérieur du pays passent par les peuples côtiers.
XVème siècle : Gambie - Les Portugais atteignent la zone par la mer dans le milieu du XVe siècle, et commencent le commerce extérieur.
XVème siècle : Ghana - Le développement du commerce encourage l'apparition d'États Akans sur la route menant aux mines du sud à travers la forêt. La forêt elle-même n'est que peu densément peuplée jusqu'à la fin du XVe siècle, lorsque quelques groupes Akan s'y installent en y amenant des plants de sorgho, de banane et de manioc importés d'Asie du Sud-Est et d'Amérique.
À la même époque, les Mandingue qui avaient fondé les États Haoussas dans le nord de l'actuel Nigéria et près du lac Tchad émigrent vers le sud-ouest et s'imposent aux peuples indigènes occupant alors le nord du Ghana et du Burkina Faso actuels. Ils y fondent les États de Dagomba et de Mamprusi, et influencent le développement du Gonja.
Tant la tradition orale que les fouilles archéologiques semblent s'accorder sur le fait que les États de Mamprusi, Dagomba et Gonja, ainsi que les États Mossi de Yatenga et Wagadugu sont parmi les premiers royaumes à émerger au Ghana moderne et sont bien établis au tournant du XVIe siècle. Les Mossi et les Gonja adoptent la langue des peuples qu'ils avaient envahi, mais conservent leurs traditions dont quelques-unes témoignent encore aujourd'hui de leur origine septentrionale.
Le premier état Akan date du début du XVe siècle et correspond à l’Ashanti. Les Dioula, commerçants d’ethnie Manding viennent y acheter l’or.
La tradition veut que le royaume Gonja soit fondé par des cavaliers venant du Mali, qui s’inquiétent de voir diminuer la quantité d’or que le royaume de Bono fournit aux Dioula. La raison en est que de nouveaux acquéreurs étaient apparus sur la côte, les européens.
XVème siècle : Guinée - L'Empire du Mali décline au XVe siècle. Entre-temps et jusqu'au XVIIIe siècle, les Peuls apportent l'Islam dans la région, repoussant les Soussous vers le littoral.
C'est sur les côtes que les Soussous et d'autres ethnies nouent des liens avec les commerçants européens voulant se procurer esclaves, ivoire et maniguette (ou malaguette, plante voisine du gingembre et réputée aphrodisiaque). C'est le commerce triangulaire.
XVème siècle : Mali - Les Portugais, quant à eux, arrivés sur le continent au début du XVe siècle, commercent avec l'empire tout en participant à son affaiblissement car, pour favoriser leur négoce, notamment d'esclaves, ils soutiennent les petites communautés côtières et les poussent à s’émanciper.
XVème siècle : Malawi - Les Amaravi arrivent à la fin du XVe siècle, venus des territoires de l’actuel Katanga dans la République démocratique du Congo. Ils livrent des combats avec les Akufula, qui vivent en petits clans familiaux sans système de défense unifié. Le clan des Phiri, qui domine le peuple Amaravi et dont descendent les Chewas actuels, fonde alors un royaume qui devint l’Empire maravi.
XVème siècle : Mayotte -
Les mosquées anciennes de Mayotte : Une vingtaine de mosquées anciennes existent à Mayotte et la très grande majorité sont en ruine du fait de l'abandon de ces anciens villages à la fin du XVIIIe siècle. Leur datation est très incertaine : les plus anciennes pourraient remonter au XIVe siècle mais seule la date de la mosquée de Tsingoni est aujourd'hui acquise grâce à une inscription conservée dans son mihrab. En effet, le sultan Aïssa (ou Ali) ben Mohamed embellit la première mosquée signalée dès 1521 par l'ajout d'un mihrab en 1538.
Les mosquées anciennes de l'île présentent les mêmes grandes caractéristiques empruntées à l'architecture religieuse swahili elle-même copiée des mosquées du Hadramaout : une salle de prière avec mihrab encadré par deux couloirs latéraux accessibles par une cour où est placé un bassin pour les ablutions. Ces mosquées n'ont pas de minaret et, de taille modeste, ne peuvent accueillir qu'une cinquantaine d'hommes. Les toitures étaient principalement réalisées avec une couverture végétale à deux pans, mais Tsingoni possédait une toiture plate soutenue par des piliers dans la salle de prière. Les murs, construits en blocs de pierre et de corail sont généralement couverts d'enduit de chaux et ne possèdent pas d'autre décoration. Le mihrab de Tsingoni, réalisé à partir de corail sculpté, est à ce titre un exemplaire remarquable et unique dans l'île de l'art religieux dont on retrouve des parallèles à Domoni (Anjouan) et dans les anciennes cités swahili de la côte africaine.
Une société esclavagiste dirigée par les élites islamisées : La société d'alors, est dominée par l'aristocratie Fani. Cosmopolite, elle est le fruit du brassage entre l'ancienne aristocratie et les nouveaux clans. L'essentiel de la population n'en reste pas moins composée d'esclaves qui ont grandement contribué à peupler et mettre en valeur l'île. En effet, au cours des XIIIe – XIVe siècles, le nombre de villages ne cesse d'augmenter, et cette croissance démographique est si soudaine que seul le recours à l'esclavage peut expliquer.
C'est d'ailleurs à cette époque que se développent les ports Antalaotra de la côte malgache, ports dont la prospérité est due à l'exportation des esclaves originaires des hauts plateaux malgaches (pays Hova) vers le Moyen-Orient via les Comores et les cités swahili. De nombreux indices (témoignages portugais) laissent entendre que les Comores importent aussi des esclaves africains. On entrevoit alors que dès les XIVe – XVe siècle, « l'élevage des esclaves » décrit en 1521 par Piri Reis est une spécialité déjà ancienne des Comores.
C'est donc dans une société largement intégrée au grand commerce, et principalement la traite des esclaves, et ayant adopté depuis plus d'un siècle le mode de vie swahili que vont s'épanouir au XVe siècle les premiers sultanats fondés par des princes swahilis de la lignée prestigieuse des Shirazi.
Origine des princes shiraziens : Les Shirazi constituent un clan prestigieux et charismatique présent dans tout l'Océan indien occidental. Il s'agit de groupes islamisés originaire du golfe Persique (notamment de Siraf, le port de Shiraz) et qui s'établirent à la faveur des contacts commerciaux sur le littoral africain où ils fondèrent des sultanats (on peut à leur sujet parler de diaspora chiite en Afrique orientale). Ils s'établirent ainsi d'abord à Mogadiscio et à Barawa dans le Bénadir à partir du IXe siècle. On retrouve des princes shirazi à Kilwa, à partir du XIIe siècle, ainsi que sur l'île de Zanzibar au XIIIe siècle. L'important changement dynastique connu à Kilwa à la fin du XIIIe siècle avec l'avènement du sultan al-Hassan bin Talib entraîne l'exil de princes shirazi vers les Comores. C'est en effet au XIIIe siècle où se situe l'arrivée de princes shirazi aux Comores (légendes de l'arrivée de princesses shirazi à Ngazidja, mariage de la fille du fani Othman de Domoni à un « Arabe »). À cette première vague succède au XVe siècle une nouvelle installation de shirazi à Anjouan et à Mayotte, celle-ci aboutissant à la création de véritables sultanats. À cette date, les princes « shirazi » qui s'établirent aux Comores étaient, comme le reste des islamisés de la côte africaine swahilie depuis le XIIIe siècle, convertis à l'islam sunnite chaféite. C'est l'instauration des sultanats shirazi aux Comores qui conduisit à l'adoption du chaféisme dans ces îles, gommant les anciennes traditions islamiques anciennement établies (chiite, zaydite, ibadite qui purent s'y établir entre le Xe et le XIIIe siècle).
Nouvelles routes commerciales - l'archipel des Comores au centre du monde : L'archipel des Comores constitue la frontière sud de l'aire culturelle swahilie qui se développe à partir de la fin du Moyen Âge dans cette région que l'on appelle à l'époque le Zanguebar ; Mayotte constitue également le point de contact de cet ensemble avec la culture malgache, très différente, ce qui fait de cette île un carrefour d'influences - mais aussi une cible stratégique. Les influences venues de l'ensemble de l'océan Indien, mais aussi de la côte africaine, chamboulée par l'irruption des Bantous, et de la côte malgache, ne cessent de façonner la société swahilie insulaire. Une immigration bantoue et malgache (Sakalaves) commence insensiblement, tandis que les contacts avec des ciilisations éloignées (autant européennes qu'asiatiques) se développent.
En 1453, la chute de Constantinople ferme brutalement les routes commerciales qui reliaient l'Europe à l'Orient. S'ouvre alors l'âge d'or du commerce maritime (dominé dans un premier temps par les Portugais, rivaux des Arabes), qui contourne l'Afrique pour atteindre l'Inde et la Chine : le canal du Mozambique se retrouve donc subitement au cœur de la principale route commerciale au monde, entraînant une importante période de prospérité pour les nombreuses îles et cités-États de l'aire culturelle swahilie.
Création du sultanat de Mayotte : L'île de Mayotte (« Mawutu ») est mentionnée pour la première fois en 1490 sous la plume du navigateur arabe Ahmed Ibn Majid, signe d'une montée en importance au niveau commercial. Les Portugais entament des relations commerciales à partir de 1557, avec la visite de la flotte de Baltazar Lobo da Sousa.
Jusqu'à la fin du XVe siècle, l'île de Mayotte est morcelée en territoires indépendants commandés par des chefs, les "Fani". Ces derniers, hommes ou femmes (islamisés comme en témoignent les patronymes musulmans que la tradition leur attribue) constituent une aristocratie d'influence swahili et malgache héritière des siècles passés. Venu d'Anjouan où le clan shirazi est établi depuis plusieurs générations, Attoumani ben Mohamed, par mariage avec la fille du puissant fani de Mtsamboro (Mwalimu Poro) fonde la première dynastie princière de l'île. De ce mariage naquit Jumbe Amina qui épousa le sultan d'Anjouan, Mohamed ben Hassan. Par ce mariage, le sultanat d'Anjouan, dominant déjà Mohéli, étendait son influence à Mayotte. De ce mariage naquit Aïssa ben Mohamed. Celui-ci hérita, par sa mère Amina, du droit de régner sur le sultanat de Mayotte, qui dès lors affirma son indépendance vis-à-vis du sultanat d'Anjouan. La capitale fut alors transférée de Mtsamboro à Tsingoni (« Chingoni ») vers 1530. En 1538 était inaugurée la mosquée royale de Tsingoni, en partie conservée aujourd'hui. Ce sultanat, perpétuellement menacé par les projets d'annexion comoriens et malgaches, est reconnu jusqu'au début du XIXe siècle. C'est de cette époque que date l'établissement de l'islam sunnite chaféite et de l'Islam chiite pratiqué à Mayotte.
XVème siècle : Nigéria - Au XVe siècle, le royaume d'Oyo et celui du Benin dépassèrent Ife sur le plan politique et économique, tandis que cette dernière gardait son statut de centre religieux. Oyo adopta le modèle gouvernemental d’Ife, avec un membre de la dynastie au pouvoir contrôlant plusieurs villes-États plus petites. Un conseil nommait le roi et surveillait ses actes. La capitale était située à environ 100 km de l’actuelle ville d’Oyo. Contrairement aux royaumes Yoruba dont la végétation était essentiellement forestière, l’Oyo était couvert de savane et son armée développa une puissante cavalerie, ce qui lui permit d’affirmer son hégémonie sur les royaumes Nupe et Borgou adjacents et d’ouvrir des routes commerciales vers le nord.
XVème siècle : Ouganda - L'Ouganda est un pays de l'Afrique de l'Est, et fait partie également de ce qui est communément appelé l'Afrique des Grands Lacs, avec notamment le lac Kyoga dans la partie septentrionale du pays, le lac Victoria aux limites Sud du pays, et les lacs Edouard et Albert aux limites Est. Cette contrée a vu se développer plusieurs royaumes, du XVe siècle au XIXe siècle, dont la particularité a été une centralisation politique précoce. Le plus important de ces royaumes a été le Bouganda, dont son nom est issu.
Ce sont ces migrants qui apportèrent avec eux l'agriculture, le travail du fer ainsi que de nouvelles idées d'organisation sociale et politique. Il existe peu d'information sur la période qui suit les migrations, et ce jusqu'au XVe siècle. On voit alors se développer des royaumes dont la particularité est une centralisation politique précoce. Parmi ces royaumes, le royaume du Bunyoro-Kitara domine alors les autres : l'Ankole, les Îles Sese et le Buganda.
XVème siècle : Sénégal - Arrivée des premiers colons (portugais).
Etablissement des premiers comptoirs dans la presqu’île du Cap-Vert, à Gorée, Rufisque et Joal.
XVème siècle : Sierra Leone - Le territoire de l'actuelle Sierra Leone fut le refuge de nombreux peuples, tels que les Kissis, les Sherbros et les Krims, lors des conflits politiques de la savane.
Au XVe siècle, refoulant les premiers occupants, des peuples mandingues s'y établissent, les Mendés sur la côte orientale, les Temnes vers la frontière de l'actuel Liberia et les Soussous dans le centre.
XVème siècle : Togo - Réfugiées dans leurs montagnes, les populations locales résistent cependant aux razzias que subissent leurs voisins. Dans le Sud, les populations venues de l'Est, à l'exemple des Ewés, s'installent en vagues successives à partir du XVe siècle et jusqu'au XVIIe siècle, au moment même où les Portugais débarquent sur la côte.
Les Éwés s'établissent autour de Tado, près de Notsé, au siècle suivant. Leur roi, Agokoli, fait édifier une enceinte faite d'argile pour protéger Notsé des réfugiés affluant du Nord.
XVème siècle : Zimbabwe, ou Zimbabwé - La cité de Grand Zimbabwe accueille jusqu'à 10 000 voire 20 000 habitants et son organisation sociale est structurée autour d'une monarchie, d'une caste dirigeante et d'une armée. L'influence de la dynastie des Shonas décline durant le XVe siècle, du fait notamment de la surpopulation, cause de maladies, et de la contestation du pouvoir en place. La dynastie des Torwa (en) s'installe à Khami et fonde le royaume de Butua, successeur direct du Grand Zimbabwe, au milieu du XVe siècle. D'autres membres issus de la civilisation de Grand Zimbabwe à la tête desquels se trouve le roi Mwene Mutapa, fondent un autre État shona plus au nord : l'empire du Monomotapa. Celui-ci prospère jusqu'en 1629, date à laquelle il est battu par l'empire portugais dont il devient le vassal la même année
an 1400 : Une armée de Djaggataï (Empire Mongol : Djaghataï ou Tchaghataï ou Chagatai, né en 1183 et mort en 1242, fils de Gengis Khan, est, dans le cadre de l'empire mongol, le khan des territoires situés autour de la mer d'Aral de 1226 à 1242. Il est le frère de Djötchi, Ögödei et Tolui.) entre en Syrie et y défait les Mamelouks, affaiblis par les luttes intestines, mais ne s'attaque pas à l'Egypte elle-même, où s'achevait le règne énergique de Barkok.
an 1401 : Oubangui-Chari Centrafrique - Le phénomène historique le plus spectaculaire qu’ait connu la région durant cette période concerne les Zandé. Aux alentours du XVe siècle, des clans issus du Darfour ou du Kordofan émigrent vers l’Uélé et l’Oubangui.
Cette aristocratie de seigneurs va peu à peu s’imposer aux populations locales tout en adoptant sa culture. Une douzaine de royaumes Zandé se forment ainsi. L’organisation du pouvoir mis en place par les souverains Zandé fait une certaine impression sur les premiers voyageurs Européens.
Sur l’ensemble du territoire centrafricain actuel, on considère que les habitants vivaient en petits villages dispersés et cultivant au nord le sorgho et au sud la banane plantain. Le niveau d’organisation politique était faible et les sociétés locales souvent troublées par des querelles. Le fait que ces sociétés soient très similaires à celles rencontrées dans le Cameroun central suggère qu’un certain niveau de communication a perduré entre les deux régions au cours des millénaires.
an 1401 : Congo Kinshasa - Vers la fin du Moyen Âge, différentes populations, alors organisées en chefferie, s'édifient en royaumes (luba, kuba, lunda, kongo, etc.) qui, pour certains, voient leurs apogées correspondre aux premiers contacts avec les Européens du XVe siècle. Cette période est marquée par différents royaumes marchands, commerçant avec les esclavagistes sur la côte et entre eux à l’intérieur du continent.[réf. souhaitée] Certains royaumes s’étendent sur plusieurs milliers de kilomètres et possèdent des réseaux commerciaux par delà leurs frontières. Le commerce se fait par portage ou voie fluviale.
Ces populations ne connaissaient pas la propriété privée, la terre cultivée en groupe ne se vend pas, les différents royaumes n’ont pas de frontières exactes (le territoire d'une petite ethnie comprend à peu près 5 000 km2).Les membres d'une même chefferie s'entraident gratuitement. La science non écrite se transmet d'une génération à l'autre, les enfants devant assumer le même métier que leurs parents. Les rois ou empereurs n’ont pas de véritable pouvoir. Ce sont plutôt les chefs de villages qui ont de l’autorité. Les royaumes sont plutôt le résultat d’unions temporaires de différents regroupements de villages de même langue pour se défendre contre une ethnie voisine.
La traite des noirs sur la côte occidentale, du XVe au XIXe siècle, s’étend jusqu’à l’intérieur du continent et correspond, avec le commerce de l’ivoire, à l’essor économique ou au déclin des différents royaumes.
an 1402 - 1419 : Canaries (Îles des) - Lanzarote
Le débarquement en 1402 des Français, menés par Jean de Béthencourt et Gadifer de La Salle, se fait sans combat, ni de la part des indigènes ni de la part des Européens. Dès son arrivée, Jean de Béthencourt entame des négociations avec Guadarfia (es), le souverain des Majos (es) (ou "Majoreros"), le peuple indigène de Lanzarote (et Fuenteventura), assisté des deux interprètes nés sur l'île et embarqués comme esclaves affranchis en Europe. Par l'accord conclu, les deux parties se considèrent comme amis, et les Européens s'engagent à protéger les Majos des attaques des chasseurs d'esclaves. Avec l'approbation de Guadarfia, baptisé Luis de Guardafía, la construction du système de défense du Rubicón commence : une tour à deux étages ouverte au sommet (d'une surface au sol de 6,8 m sur 6,8 m), une église (d'une surface au sol de 7 m × 13 m), une fontaine et quelques maisons simples.
Pendant que Jean de Béthencourt négocie avec les chefs des Majos, Gadifer de La Salle explore à proximité l'île de Fuerteventura pendant huit jours sans rencontrer d'habitants ni trouver de nourriture. Gadifer de La Salle et Jean de Béthencourt s'estiment insuffisamment équipés pour mettre en place des comptoirs efficaces, installer des Européens et prendre le contrôle d'autres îles. Jean de Béthencourt revient en Castille après un peu moins de deux mois en septembre 1402, promettant de revenir à Noël 1402, mais le retour se fait, 18 mois plus tard, en avril 1404.
Dès le début de l'absence de Jean de Béthencourt, sans doute en absence de Gadifer de La Salle, une partie des soldats, venus uniquement pour le combat et le butin, se révoltent. Découvrant qu'il n'y a rien sur les îles à voler en dehors des habitants, ils décident d'en capturer un grand nombre, rompant ainsi la promesse de Béthencourt aux Majos. Ils pillent les réserves françaises restantes sur l'île, capturent 22 Majos afin de les vendre comme esclaves à un bateau pirate castillan de passage devant l'île de Graciosa, et partent avec ce navire vers l'Europe en octobre 1402. Cela entraîne des affrontements entre les Majos, qui se sentent trahis, et les Français qui sont restés. Les affrontements se poursuivent jusqu'au début de 1404.
Le 1er juillet 1403, un navire castillan ravitaillé atteint l'île de Lanzarote. Gadifer de La Salle utilise ce navire pour effectuer un voyage d'information de trois mois dans les autres îles avec quelques-uns de ses gens.
Après de sérieux désaccords avec Gadifer de La Salle, Jean de Béthencourt quitte les îles Canaries en décembre 1405 et charge son neveu Maciot de Béthencourt de gouverner les îles.
En 1406, Jean de Béthencourt transfère les droits de seigneurie de l'île à son neveu Maciot de Béthencourt, qui épouse Teguise, fille du roi Luis de Guardafia. En 1412, Jean de Béthencourt revient en Castille prêter à nouveau serment devant le nouveau roi Jean II.
Le 15 novembre 1419, Maciot de Béthencourt, amené à Séville lors d'une opération militaire, transfère les droits souverains sur les îles Canaries (au nom de Jean de Béthencourt) au comte de Niebla (Andalousie, Espagne), Enrique de Guzmán. Celui-ci le confirme dans ses fonctions de gouverneur des îles. Dans les années suivantes, les droits sur les îles conquises et à conquérir sont transférés à différentes personnes par le biais de donations, achats, échanges et héritages. L'île demeure un fief de la Couronne de Castille.
an 1402 - 1404 : Canaries (Îles des) - Fuerteventura
Les deux versions du Canarien divergent (lacunes et contradictions) quant à la perte de souveraineté de Fuerteventura.
Les indigènes de l'île de Fuerteventura, Majos (es) (ou "Majoreros"), vivent dans deux domaines séparés par un mur qui traverse l'île, correspondant aux canton de Jandía (es) et Cantón de Maxorata (es). Dès 1402, Gadifer de La Salle visite durant huit jours l'île de Fuerteventura sans rencontrer aucun habitant, tous enfuis à l'intérieur de l'île par peur des chasseurs d'esclaves.
En avril 1404, Jean de Béthencourt revient de Castille, après une absence de plus d'un an et demi. Quand Gadifer de La Salle apprend que Jean de Béthencourt a permis au roi de Castille de se nommer seul seigneur des îles, Gadifer de La Salle demande au moins d'être reconnu comme seigneur de l'île de Fuerteventura. Après le refus de Jean de Béthencourt, Gadifer de La Salle se retire dans l'ensemble fortifié de Rico Roque à Fuerteventura, puis quitte l'archipel. De violents affrontements éclatent entre les derniers partisans de Gadifer de La Salle et les troupes de Jean de Béthencourt, établies sur le site fortifié de Valtarajes, et les indigènes. Les prisonniers faits lors de ces incidents sont transférés à Lanzarote.
Les deux dirigeants des Majoreros, Ayoze et Guize, conscients de leur incapacité à pouvoir offrir une résistance soutenue aux Européens dans des conflits armés, par infériorité technologique en armement, proposent à Jean le Béthencourt un armistice, en se signalant aussi prêts à devenir chrétiens, et à reconnaître le roi de Castille comme leur suzerain. Le 18 janvier 1404, Guize, roi de la moitié nord de l'île, est baptisé Luis et le 25 janvier 1404, Ayoze, roi de la moitié sud de l'île, est baptisé Alfonso. Après l'assujettissement des Majoreros, les terres de l'île sont redistribuées par Jean de Béthencourt. Les anciens dirigeants reçoivent également des terres. Les ouvrages fortifiés déjà existants et les lieux où en construire sont accordés à des aristocrates de France.
an 1404 - 1448 : Canaries (Îles des) - Îles seigneuriales et îles royales
Le « royaume des îles Canaries » (1404-1448), est en réalité une seigneurie féodale vassale de la Couronne de Castille : le postulant, conquérant potentiel, est fait vassal du roi de Castille, qui se prétend possesseur du fief, pour devenir seigneur d'un ou de plusieurs territoires, qu'il doit ensuite tenter de contrôler dans la pratique. Il ne s'agit généralement pas d'une conquête militaire, au pire d'une série d'escarmouches, parce que le rapport de force entre les conquérants et les indigènes est assez équilibré sur ces îles, à cette époque. La soumission des peuples indigènes à la domination de la Couronne de Castille se produit surtout grâce à des contrats partiellement extorqués, sorte de traités inégaux.
L'exercice effectif des droits de domination tels que les recettes fiscales et la juridiction ne peut souvent s'appliquer qu'après un certain temps. Il en est de même pour la christianisation associée à la soumission. Même lorsque les habitants d'une île se font baptiser, ils demeurent souvent longtemps éloignés d'un mode de vie chrétien, notamment par manque d'information.
Au cours des premières années, le pouvoir des seigneurs ou de leurs gouverneurs se limite dans de nombreux cas au groupe de colons européens et aux zones situées à proximité des fortifications et des ports. Les "messieurs" sont responsables de l'amélioration des infrastructures, ils sont "patrons" de toutes les églises paroissiales et sont censés défendre les îles contre les attaques de l'extérieur. Bientôt, ils perçoivent les droits et taxes pour le roi, occupent les postes dans les administrations nouvellement créées et dans les tribunaux.
En revanche, la conquête des îles de Royauté (es) (Islas de Realengo, décrétées de droit royal castillan : Grande Canarie, La Palma, Tenerife) se déroule avec davantage d'efforts militaires, sous le commandement de chefs de troupes réputés à carrière militaire respectable, chargés de la conquête par reddition, responsables de toute l'organisation militaire et économique. Leur objectif n'est pas l'acquisition d'un domaine en tant que propriété personnelle (en fief), mais le gain matériel direct de l'action, par la soumission inconditionnelle. Puis ils deviennent des fonctionnaires de la couronne, parfois avec des charges héréditaires : les seigneurs de ces îles sont alors uniquement les rois de Castille.
La conquête des îles de Seigneurie (es) (Islas de Señorío, décrétées de droit seigneurial : Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro et La Gomera) occupe presque les trois quarts du siècle.
L'expédition de Jean de Béthencourt et de Gadifer de La Salle (1340-1415) débute en 1402 en tant qu'entreprise privée des deux initiateurs égaux, après avoir ensemble participé en 1390 à une expédition franco-génoise, dirigée par Louis II de Bourbon, contre la piraterie des barbaresques (contre les chrétiens) en faisant le siège de Mahdia (Tunisie). Par la bulle "Apostolatus officium" du 22 janvier 1403, « Iohannis de Betencourt et Gadiferi de Sala » sont nommés chefs de mission. Au départ, sans approbation, ni ordre ni soutien du roi de France ou de Castille. Leurs troupes commencent à conquérir Lanzarote, Fuerteventura et El Hierro. Un important contingent d'origine berbère est amené sur l'île de Lanzarote pour la repeupler. S'apercevant, au premier séjour dans les îles, de l'insuffisance de leurs propres moyens pour atteindre leurs objectifs, Jean de Béthencourt revient fin octobre 1402 en Castille, pour obtenir le soutien nécessaire du roi Henri III de Castille (1379-1406).
Béthencourt reçoit l'aide de son parent Robert de Bracquemont (?-1419, "Robín de Bracamonte"), alors ambassadeur du roi de France à la cour de Castille, facilitant l'obtention d'un ordre du roi Henri III de Castille le 28 novembre 1403, qui charge le seigneur "Diego Hurtado de Mendoza" d'accepter l'hommage féodal de "Juan IV de Bethencourt". Par ce serment féodal, Béthencourt reconnaît le roi castillan comme suzerain des îles Canaries, et en est également désigné le vassal. Béthencourt bénéficie ainsi de la protection de son entreprise vis-à-vis d'autres entreprises ayant les mêmes objectifs. En outre, les exportations et les importations à destination et en provenance des îles Canaries sont désormais traitées comme des mouvements de marchandises à l'intérieur des pays de la Couronne de Castille. Il reçoit également un certain nombre de privilèges économiques et juridiques dans son fief, dont la perception des impôts et monopoles commerciaux. En outre, Henri III soutient l'entreprise avec une subvention de 20 000 maravedís.
Un autre soutien obtenu par Béthencourt, grâce à l'intermédiaire de son parent, est la reconnaissance de l'entreprise comme croisade par Benoît XIII (antipape à Avignon), en janvier 1403, avec indulgence pour les dons faits pour la conversion des indigènes des îles Canaries. Le 7 juillet 1404, le pape établit le diocèse de San Marcial del Rubicónun diocèse pour les îles Canaries avec son siège à Rubicón (Lanzarote).
Parmi les successeurs en tant que "señor de las islas de Canaria", Seigneur des îles Canaries, titulaire de la seigneurie féodale vassale de la Couronne de Castille :
-
Maciot de Béthencourt (1385-1454),
-
(es),
-
Hernán Peraza el Viejo (es) (1390-1452),
-
Diego de Herrera (es) (1417-1485),
-
Guillén Peraza (es) (Guillén de las Casas el Mozo, 1424-1503),
-
Inés Peraza (es) (1424-1503).
-
Béthencourt et Gadifer en 1402
-
an 1405 - 1445 : Canaries (Îles des) - El Hierro
Les peuples indigènes de l'île d'El Hierro, les Bimbaches (es), vivent d'agriculture (orge, rhizomes de fougère, etc.), d'élevage (chèvres, moutons, cochons), de pêche (poissons, mollusques). Ils sont à plusieurs reprises victimes des chasseurs d'esclaves européens. Seulement en 1402, 400 personnes auraient été enlevées comme esclaves en un seul raid.
En 1405, selon Le Canarien, Jean de Béthencourt passe au moins trois mois sur l'île. Par l'intermédiaire d'un interprète embarqué, supposé frère du souverain des Bimbaches, il invite celui-ci à négocier. À l'arrivée au lieu convenu, 112 Bimbaches, dont le roi Amiche, sont capturés, puis transférés sur d'autres îles, et certains vendus comme esclaves. Le Canarien motive ainsi cette action : briser la résistance sur l'île sans combattre, libérer de l'espace pour 120 colons français.
Après le passage de la seigneurie féodale à Hernán Peraza (El Viejo) en 1445, celui est forcé de reconquérir l'île. Son armée se compose de 200 arbalétriers et 300 fantassins des îles de Lanzarote et Fuerteventura, après une bataille de cinq heures, l'emporte : les chefs des Bimbaches se rendent et sont baptisés.
an 1408 : (Re)Découverte des îles Canaries par Jean de BETHENCOURT, gentilhomme Normand. Il en est nommé roi par Henri III, roi de Castille. Sur la découverte des îles de Porto-Santo et de Madère par les Portugais.
an 1415 : Somalie - En 1415, Yeshaq Ier, Empereur d'Éthiopie, prend des mesures contre le royaume d’Adal, dont les raids rebelles occasionnent des troubles dans les régions alentour et qui exerce un monopole sur le commerce avec les différents États de la mer rouge, du golfe d'Aden et sur les échanges à travers l'Océan indien. Le roi Sa'ad ad-Din II est emprisonné, puis exécuté. Ses fils quittent le pays pour s'exiler en Arabie. La région reste sous contrôle éthiopien pendant encore un siècle, même si ce contrôle n'est que partiel, et même si les fils Sa'ad ad-Din II, rentrés d'exil, choisissent de s'installer dans un nouveau territoire à l'Est d'Ifât, pour y constituer le Sultanat d'Adal. Ils y entretiennent une lutte contre les troupes chrétiennes
an 1418-1446 : Gambie - Au début du XVe siècle, les premiers explorateurs européens s'aventurent vers l'extrémité occidentale du continent africain. Intrigué par les récits des géographes et cartographes arabes sur l'immense richesse des royaumes d'Afrique de l'Ouest et sur le légendaire royaume du prêtre Jean, le prince portugais Henri le Navigateur lance plusieurs expéditions à partir de 1418. En 1434, Gil Eanes double le cap Bojador. Nuno Tristão et Antão Gonçalves atteignent le cap Blanc en 1441 et Dinis Dias accoste à la Presqu'île du Cap-Vert, extrémité occidentale de l'Afrique, en 1444. En 1446, António Fernandes navigue le long des côtes de l'actuelle Sierra Leone.
1418-1433 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
En 1418, l'île de Porto Santo est reconnue par João Gonçalves Zarco (1390-1471, chevalier de l'Ordre du Christ de la Maison de Henri le Navigateur) et Tristão Vaz Teixeira (1395c-1480).
En 1419, commence l'histoire officielle de Madère, lorsque João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira et Bartolomeu Perestrelo (1394c-1457c) font reconnaître Madère (île et/ou archipel) comme une terre du royaume portugais.
À partir du XIVe siècle, les Portugais et les Espagnols se disputent la côte ouest de l'Afrique, ce qui a pour conséquence l'annexion rapide de certains territoires, particulièrement insulaires. C'est le cas pour Madère, où le point d'ancrage des navigateurs est l'emplacement actuel du port de Machico.
L'Ordre du Christ, ordre militaire religieux fondé en 1319, en pleine reconquista, et dont le grand-maître est à cette époque le roi Henri le Navigateur, est responsable, entre autres, des découvertes armées de l'archipel des Canaries, de l'archipel de Madère, de l'archipel du Cap-Vert, et de la Sierra Leone (Serra Leoa). Il est en grande part à l'origine de la formation de l'Empire colonial portugais, et un grand bénéficiaire.
Le 23 septembre 1433, l'île de Madère apparaît pour la première fois sur une carte sous le nom d'"Ilha da Madeira" (Île du Bois).
an 1420 - 1494 : Canaries (Îles des) - La Gomera
Au moment de la conquête, l'île se divise en quatre zones tribales, correspondant aux quatre grandes vallées : Mulagua (Hermigua), Hipalan (San Sebastián), Orone (Valle Gran Rey) et Agana (Vallehermoso).
L'île offre peu de points d'accès vers l'intérieur. Les indigènes, les "Gomeros", réputés pour leur technique amazighe de langage sifflé silbo, sont ainsi mieux protégés des incursions depuis les côtes.
Les conditions d'abandon de souveraineté des Gomeros sont imprécises. Ni Jean de Béthencourt ni Gadifer de La Salle ne sont venus sur l'île combattre. Les Gomeros auraient conservé la plupart de leurs particularismes. En 1420, Maciot de Béthencourt semble avoir tenté de conquérir l'île en tant que représentant du comte de Niebla. En 1420, le roi Jean II accorde à Alfonso de las Casas les droits sur des îles pas encore conquises (Grande Canarie, La Palma, Tenerife et La Gomera).
Portugais et Castillans se disputent l'île jusqu'à ce qu'elle tombe finalement sous la domination du Castillan Hernán Peraza el Viejo. L'implantation portugaise semble s'être généralement déroulée en termes amicaux avec les peuples autochtones et la coopération a été recherchée : le roi portugais Henri le Navigateur ayant des contrats avec trois des quatre tribus de La Gomera, qui reconnaissent sa souveraineté et acceptent la diffusion de la doctrine chrétienne par les missionnaires portugais. En 1454, les Portugais renoncent officiellement (au moins provisoirement) au contrôle des îles pour le moment. Ils conservent cependant à entretenir de bonnes relations avec les peuples autochtones du nord de l'île.
En 1445-1447, Hernán Peraza el Viejo fait une nouvelle tentative pour amener l'île sous la domination de la Couronne de Castille, à partir d'une unique base sûre sur l'île de Saint-Sébastien, où il fait construire les fortifications, dont la Torre del Conde (es). Un représentant de la reine de Castille confirme plus tard que Hernán Peraza el Viejo a apporté aux citoyens « la sainte foi catholique et leur a donné des juges et la justice. » Après sa mort en 1452, ses héritiers sont sa fille Inés Peraza de las Casas et son mari Diego García de Herrera.
Le but des soulèvements des Gomeros dans les années suivantes n'était pas d'abolir la domination de Castille, ils étaient dirigés contre le comportement des représentants de la Castille dans l'archipel, la famille Peraza.
Toutefois, en 1488, a lieu la rébellion des Gomeros (es), sans doute pas contre la souveraineté castillane, mais contre le comportement jugé outrancier des représentants de Castille, les membres de la famille Peraza. Les Gomeros du roi Hupalupa (es) (contre son avis), chef du canton d'Orone, menés par Hautacuperche, tuent Hernan Peraza le Jeune (es), seigneur territorial de La Gomera. La répression est terrible. Un jugement ultérieur la condamne.
En 1494, l'île est incorporée à la couronne de Castille sous la domination des Peraza, qui instaurent un système encore plus autoritaire, qui va perdurer plus de trois siècles.
1420-1427 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
De 1420 à 1427, l'île est victime de graves incendies. Mais les Portugais se rendent compte que ce drame apparent cache un avantage : les cendres fertilisent la terre. Celle-ci étant d'origine volcanique et comme l'eau est abondante, le territoire madérois devient un lieu de prédilection pour l'agriculture, ce qui poussera les colons à importer de la canne à sucre et de la vigne. Les récoltes sont un succès.
an 1424 : Magreb : Chute des Mérinides, jusqu'alors en possession du royaume de Fez. La puissance souveraine, fractionnée, se partage entre plusieurs tribus, dont l'une, celle des BENI-OATAZ, deviendra la plus puissante et rétablira le royaume (1470). Les Abouhassides et les Zéyanides se maintiennent à Tunis et à Trémecen.
an 1426 : Sous le règne de JANUS (1398 - 1432), l'île de Chypre est conquise et dévastée par les Mamelouks. Le roi est fait prisonnier et se voit réduit, pour recouvrer sa liberté, à prendre l'engagement de payer à l'Égypte un tribut annuel.
an 1436-1468 : Éthiopie - Outre ses succès militaires, l'Éthiopie connaît une phase de développement du christianisme orthodoxe et de la littérature nationale. Dans ce domaine Zara Yaqob semble être le souverain emblématique. Durant son règne de 1436 à 1468, il convertit les habitants du Damot et du Godjam et participe aux débats théologiques. Il est également un auteur, dont l'œuvre la plus connue est le Metsehafe Berhan (Livre de la Lumière). Durant ces siècles, diverses réformes administratives et financières réorganisent l'Empire. Un des éléments caractéristiques de cette période est le déplacement continu de la cour, une pratique à laquelle ont recours la majorité des souverains et qui leur permet de marquer leur domination sur les responsables régionaux, d'assurer leur contrôle du territoire et de répartir la prédation qu'ils exercent sur les ressources.
an 1437 : Magreb : Le roi de Fez remporte une victoire sur l'armée du roi de Portugal ÉDOUARD, qui est venue l'attaquer en Afrique. Ceuta ne lui étant pas restituée, il fait conduire à Fez le jeune prince que les portugais ont dû lui laisser pour otage et qui meurt dans la captivité. Le successeur d’ÉDOUARD, ALPHONSE V, méritera, à partir de l'an 1458, le surnom d'Africain
Ceuta [s̻ət̪a] est une ville autonome espagnole sur la côte nord de l'Afrique ayant une frontière directe avec le Maroc. L'enclave espagnole est, comme sa voisine Melilla, située sur le continent africain, en face de la péninsule Ibérique, à environ quinze kilomètres des côtes de la province espagnole de Cadix
an 1442 : Mauritanie - En 1442, les premiers navigateurs portugais découvrent le Cap Blanc et l'Île d'Arguin. Ils implantent un comptoir pour le commerce de l’or, des esclaves, ainsi que de la gomme arabique. Le commerce transsaharien est ainsi détourné au profit des Européens.
an 1443 : Magreb : Alger profite du déclin des Zéyanides pour se rendre indépendant.
an 1444 : Cap Vert - En 1444, le navigateur portugais Dinis Dias, en présence de la presqu'île du Cap-Vert (à 700 km du Cap-Vert), nomme le cap "Cabo Verde", la végétation luxuriante de ce promontoire rocheux contrastant avec l'aridité de l'arrière-pays.
an 1445 : Guinée - Le déclin de l’empire du Mali coïncide avec l’apparition en 1445, en Sénégambie, des premières caravelles portugaises. Les malinkés perdirent le contrôle des pistes sahariennes au profit des songhay et refluèrent vers les régions occidentales de Guinée, de Gambie et de la Casamance.
Après quelques accrochages, les navigateurs portugais et les populations côtières firent la paix. Les portugais, intéressés par l’or, les peaux et autres produits exotiques du Soudan, les épices, les esclaves, vendaient des tissus, des ustensiles en fer, même des chevaux. Les mansas du Mali établirent des relations diplomatiques avec leurs homologues du Portugal.
À la faveur de ce commerce naissant, des mouvements de populations drainent des familles maraboutiques et marchandes du moyen Niger vers le Gabou et la côte atlantique pour donner la configuration socio-politique connue à la conquête coloniale.
an 1445-1447 : Guinée-Bissau - Deux siècles après l'invasion Mandé, des commerçants portugais (en 1447) et italiens (vers 1455-1456) arrivent par l'océan et des premiers contacts sont pris. Dans le décennies suivantes, des négociations diplomatiques aboutiront à autoriser le Portugal à louer quelques terrains en bord de rivière pour y gérer des petits comptoirs commerciaux maritimes, notamment Cacheu, Bissau, Geba.
Ces deux phénomènes vont développer le commerce longue distance, transsaharien et transatlantique, bouleversant les circuits commerciaux antérieurs. Puis le commerce d'esclaves transatlantique s'ajoute à son pendant transsaharien, et prend une très grande ampleur, ce qui va altérer en cascade les relations diplomatiques entre les nations et déterminera pour certaines (notamment le Kaabu) leur organisation politique.
an 1446-1456 : Gambie - C'est Nuno Tristão qui fut le premier européen à atteindre l'embouchure du fleuve Gambie en 1446. Lui et son équipage furent très mal accueillis par les autochtones qui les prirent pour des cannibales et il mourut lui-même de ses blessures pendant le voyage de retour.
Henri le Navigateur était cependant trop obstiné par les rumeurs selon lesquelles le fleuve Gambie regorgeait d'or pour abandonner. En 1455, il y envoya le Vénitien Alvise Cadamosto, accompagné du Génois Antoniotto Usodimare. Il se heurtèrent également à la résistance des indigènes. L'année suivante, Cadamosto fut chargé d'une deuxième expédition. Il découvrit en chemin les îles du Cap-Vert et s'y arrêta brièvement avant de repartir en direction de la Gambie. Il parvint à remonter le fleuve sur 100 km et à lier des contacts avec ses habitants. Il se lia d'amitié avec plusieurs rois locaux, dont Batti Mansa, roi de Baddibu, qui était séduit par le christianisme et demanda par écrit au souverain portugais de lui envoyer un prêtre. Cadamosto fut contraint d'écourter son voyage, un tiers de son équipage ayant succombé à diverses maladies tropicales et il retourna au Portugal en 1456.
Deux ans plus tard, Diego Gómez remonta le fleuve sur 450 km jusqu’à l’actuelle Upper River Division. Il y entendit parler de l’or du plateau du Fouta Djallon et de l’empire du Mali. Il échangea des marchandises contre quelques esclaves qu’il ramena en Europe.
Par la suite, des prêtres portugais s’installèrent sur le bord du fleuve, à Nuimi, et commencèrent à y prêcher le christianisme. Ils construisirent une chapelle près d'Albreda et baptisèrent l’endroit San Domingo. L'islam était déjà bien ancré, Mansa s'était désintéressé d'eux et les missionnaires n'eurent que peu de succès. Les portugais fondèrent d'autres bases d'exploration à Bintang, Tankular, Niani Maru et Kassan sur la rive sud, Fattatenda et Kuntaur sur la rive nord.
D'autres expéditions suivirent et renforcèrent les liens d'amitié. Le Portugal soutint le Mali lorsque ce dernier fut attaqué par l'empire songhaï. Un ambassadeur de l'empire Wolof visita quant à lui le Portugal en 1488. Le commerce se développa et quelques Portugais s'installèrent en Gambie où ils importèrent de nombreuses espèces végétales toujours cultivées aujourd'hui comme les oranges, les bananes, la papayes, le manioc, la goyave, le maïs et l'arachide. Ils apportèrent également des techniques de construction, de navigation et de pêche et de nombreux emprunts au portugais subsistent dans la langue mandingue.
an 1447 : Guinée-Bissau - Les premiers contacts européens sont établis en 1447 par le navigateur portugais António Fernandes, un an après la mort de Nuno Tristão lors d'une bataille navale à l'embouchure de la Gambie. Le Portugal loue plusieurs terrains en bordure de fleuves sur lesquels il établit des comptoirs, notamment à Cacheu, Bissau, Farim, Geba.
an 1448 - 1479 : Canaries (Îles des) - Interventions portugaises (à partir de 1448)
En 1448, les troupes portugaises occupent l'île de Lanzarote. Après les révoltes de la population, le prince Henri le Navigateur (1394-1460) retire ses troupes de l'île en 1450.
En 1452, Inés Peraza de las Casas (es) (1424-1503) hérite des droits de domination sur les îles, qu'elle exerce, selon la tradition de l'époque, avec son mari Diego García de Herrera y Ayala (es) (1417-1485), jusqu'à sa mort.
Le navigateur vénitien au service du Portugal Alvise Cadamosto (1432-1488) semble avoir joué un grand rôle dans l'action portugaise.[pas clair]
Pendant des dizaines d'années, Portugais et Espagnols se disputent la possession des terres. L'archipel, étape importante sur les routes maritimes conduisant vers l'Afrique australe, l'Asie et l'Amérique, est finalement attribué à l'Espagne en 1479 par le traité d’Alcáçovas. Les Portugais bénéficient en compensation de l'île de Madère, située non loin au nord des Canaries.
Les autres îles et îlots de l'archipel (l'archipel de Chinijo (dont La Graciosa), Los Lobos, etc.), mais aussi les Îles Selvagens (disputées), sont réputés inhabités au moment de la conquête.
an 1450 : Réunion (Ile de la) - Avant le XVIe siècle, seuls les Arabes et les Austronésiens (habitant l'Indonésie et la Malaisie d'aujourd'hui) connaissent l'océan Indien. Le premier nom donné à La Réunion le fut par les Arabes bien avant 1450 : « Dina Morgabin », qui signifie l'île de l’Ouest.
an 1455 : Gambie - En 1455, les Portugais installent des comptoirs le long du fleuve Gambie à partir desquels ils organisent la traite des Noirs.
an 1456 : Cap Vert - Les îles du Cap-Vert étaient inhabitées lorsque des marins portugais y débarquèrent pour la première fois, entre 1456 et 1460. Pour cette raison et du fait de l’éloignement du continent, le pays a connu une histoire radicalement différente du reste de l’Afrique..
En 1456, le navigateur vénitien et explorateur portugais Alvise Cadamosto (1432-1488) découvrit quelques îles du Cap-Vert, puis Diogo Dias et Antonio Noli, capitaines au service d’Henri le Navigateur , découvrirent le reste de l’archipel les années suivantes.
Selon l'historiographie officielle du Portugal, la découverte est due au navigateur génois António Noli, que le roi Alphonse V nommera gouverneur du Cap-Vert. Des explorateurs ont également associé aux découvertes les noms de Diogo Gomes (lieutenant de Noli, qui prétend avoir été le premier à accoster et avoir nommé l'île de Santiago), Diogo Dias, Diogo Afonso et le vénitien Alvise Cadamosto.
an 1456-1460 : Guinée - Entre 1456 et 1460, Pedro de Sintra accosta au cap Verga et plus au sud, il atteignit la pointe de l’île de Tombo où se trouve Conakry. Les Portugais donnèrent les noms de Rio Nunez, Rio Pongo (déformation de Araponka), Rio Kapatchez, etc. aux rivières de la zone côtière.
Au large de Conakry furent découvertes les îles baptisées « Ilhas dos Idolos » (îles des idoles) parce que les habitants de ces îles, lorsqu’ils viennent semer le riz apportent leurs idoles qu’ils adorent. Ces navigateurs ont noté que les Portugais sont entrés en contact avec les Landouma et les Nalou dans le Rio compagny et le Rio Nunez. Ils ont également signalé la présence des Dialonkés à l’intérieur des terres.
Les rapports tissés avec les Bagas furent difficiles entre le Rio Nunez et la presqu’île du Kaloum. Ils attestent l’existence de trois Suzerains dans la région côtière : Farin Souzos (roi des sosso), Farin Cocoli (roi des Lanlouma) et Farin Futa (roi djallonka).
Ainsi naissent les royaumes Sosso de Bramaya, de Thia, de Lakhata et de Dubréka.
an 1459 : Après la mort du dernier des Lusignans, le sultan d'Égypte chasse de l'île de Chypre le gendre de ce prince, et la donne à son bâtard Jacques à charge d'hommage. JACQUES II (1459 - 1473) épouse la noble vénitienne Catherine CORNARO, que Saint-Marc adopte pour sa fille;
an 1460 : Afrique Cap Vert - Les îles sont possessions du Portugal depuis l'an 1460, et sont une escale importante sur la route du Brésil et un important centre de traite des esclaves noirs en partance pour les Amériques.
an 1460 : Sierra Leone - En 1460, l'explorateur portugais Pedro de Sintra donne le nom de Serra Leoa (rebaptisée plus tard « Sierra Leone » sans doute par une erreur due à une confusion entre langues latines car Sierra est en espagnol et Leone en italien, littéralement la « montagne du lion ») à la presqu'île où sera plus tard la capitale Freetown.
an 1461 : Libéria - Le premier contact avec les populations autochtones est établi en 1461 par les explorateurs portugais qui désignent le pays sous le nom de Costa da Pimenta.
an 1462 : Afrique Cap Vert - En 1462, les Portugais parviennent à Santiago et fondent une colonie, Ribeira Grande (aujourd'hui Cidade Velha), le premier établissement européen dans les tropiques.
an 1465-1471 : Maroc - Anarchie mérinide et restauration idrisside (1465-1471)
En 1465, à la suite de la chute du régime mérinide à l'issue de la révolte de Fès, le chérif Mohammed ibn Ali Amrani-Joutey, un descendant des Idrissides, est proclamé sultan ; le pouvoir du sultan Mohammed est toutefois limité à la région de Fès, ce qui plonge le reste du pays dans l'anarchie et l'expose aux velléités expansionnistes et agressives des États catholiques de la péninsule Ibérique, Portugal et Castille-Aragon. Pendant ce temps, Mohammed ach-Chaykh, un des deux survivants du massacre de 1459, prépare sa reprise du pouvoir, qu'il accomplira finalement en 1471 mettant fin à l'éphémère gouvernement néo-idrisside.
an 1468 : Mali - Empire Sonhaï : La domination touarègue dans la zone septentrionale est de courte durée. Sous l'impulsion de Sonni Ali Ber (« Sonni Ali le grand »), considéré comme un grand stratège, le royaume du Songhaï, tributaire de l'empire du Mali depuis 1300, met en place une politique de conquêtes territoriales, rompant avec l'économie de razzia qui prévalait jusqu'alors. Il combat et vainc les Peuls et les Touaregs ; il reprend Tombouctou en 1468. C'est l'avènement du troisième empire, l'empire songhaï, lequel se développe durant le XVe siècle et le XVIe siècle, la conquête territoriale s'appuyant sur une organisation politique largement inspirée de celle de l'empire du Mali. Il s'étend alors sur la plus grande partie du Mali actuel.
an 1468-1473 : Nigéria - Une lignée d’États dynastiques, dont les premiers États Haoussa, s’étirèrent à travers l’ouest et le centre du Soudan. Les plus puissants parmi ces États furent l’empire du Ghana l’empire de Gao et le royaume de Kanem, qui se trouvaient à l’extérieur des frontières actuelles du Nigeria mais qui en ont subi l’influence. Le Ghana commença à décliner au XIe siècle. L’empire du Mali lui succéda, qui consolida la plus grande partie du Soudan occidental au cours du XIIIe siècle. À la chute du Mali, un chef local nommé Sonni Ali fonda l’empire songhaï, qui s’étendait sur le centre du Niger et l’ouest du Soudan. Il prit ainsi le contrôle du commerce transsaharien, basant son régime sur les revenus du commerce et la coopération avec les marchands musulmans. Sonni Ali prit Tombouctou en 1468 et Jenne en 1473. Son successeur, Askiya Mohammed Touré, fit de l’Islam la religion officielle de l’empire, bâtit des mosquées et fit venir des scientifiques musulmans à Gao.
an 1469-1474 : Guinée-équatoriale - Entre 1469 et 1474, les navigateurs portugais découvrent dans le golfe de Guinée les îles de São Tomé, Principe, Annobón et Fernando Poo : le 1er janvier 1471, João de Santarém et Pedro Escobar aperçoivent une île qu’ils appelèrent « Ilha do Ano Bom » (île de la bonne année) d'où le nom actuel d’Annobón qui correspond à la phonétique du nom portugais. En 1474 un autre Portugais, Fernão do Pó, découvre dans le golfe du Biafra une île qu’il nomme « Formosa » (la belle), mais qui portera finalement son nom (aujourd'hui Bioko).
an 1470-1471 : Afrique Côte d'Ivoire - À l’initiative du prince Henri le Navigateur, les Portugais João de Santarém et Pedro Escobar découvrent le littoral ivoirien en 1470-1471. Ils seront pendant plus d'un siècle les seuls Européens présents sur le littoral ivoirien, avant d'être rejoints à la fin du XVIe siècle par les Hollandais, puis au XVIIe siècle par les Français et les Anglais.
an 1470 : Sao Tomé et Principe - Le jour de la Saint-Thomas 1470, les navigateurs portugais João de Santarem et Pedro Escobar découvrirent les deux îles, alors inhabitées, et en prirent possession au nom du roi du Portugal.
Dès la fin du XVe siècle, les colons firent venir des esclaves du continent pour mettre en valeur des plantations de canne à sucre, et São Tomé devint rapidement l'une des plaques tournantes de la traite négrière.
an 1471 - 1482 : Ghana - Près d'un siècle et demi après la venue des premiers ghanéens, c'est donc une société bien différente, et sans doute encore marquée par le chaos qui a frappé les générations précédentes, qui accueille les premiers navires portugais. En 1471, les Portugais débarquent sur la côte du futur Ghana. Ils y ont trouvé de l'or à échanger contre des biens manufacturés provenant d'Europe et ont donc baptisé cette portion de côte, « Gold Coast » (Côte de l'Or)(Costa do Ouro) ou Côte de la Mine (Costa da Mina). Pour protéger ce commerce de l'or des marchands interlopes venus d'autres nations européennes, ils construisent en 1482 une forteresse imposante, Saint-Georges-de-la-Mine (São Jorge da Mina) dans le village d'Edina (Elmina).
an 1471 : Magreb : Séïd-OATAZ, chef d'une tribu arabe, s'empare de Fez et fonde la dynastie des BENI-OATAZ. Il établit sa résidence à Fez et envoie à Maroc un gouverneur.
an 1471-1554 : Maroc - Dynastie wattasside (1471-1554)
Les Wattassides ou Ouattassides ou Banû Watâs sont une tribu de Berbères zénètes comme les Mérinides. Cette tribu, qui serait initialement originaire de l'actuelle Libye, était établie dans le Rif, au bord de la Méditerranée. De leur forteresse de Tazouta, entre Melilla et la Moulouya, les Beni Wattas ont peu à peu étendu leur puissance aux dépens de la famille régnante mérinide. Ces deux familles étant apparentées, les Mérinides ont recruté de nombreux vizirs chez les Wattassides. Les vizirs wattassides s'imposent peu à peu au pouvoir. Le dernier sultan mérinide est détrôné en 1465. Il s'ensuit une période de confusion qui dure jusqu'en 1472.
Le Maroc se trouve coupé en deux, avec à Marrakech les émirs Hintata auxquels succède la dynastie des Saadiens, et à Fès le sultanat wattasside déclinant qui perd également le contrôle de la puissante principauté de Debdou. Plus au nord, à Tétouan et à Chaouen, apparaît une sorte de taïfa à dominante andalouse, peuplée par les réfugiés venus de l'ancien royaume de Grenade (conquis par les Espagnols catholiques en 1492), et dirigée par une femme nommée Sayyida al-Hurra. Sayyida al-Hurra (ou Sitt al-Hurra) mène une lutte implacable contre les Portugais qui occupent Ceuta depuis 1415, et contracte une alliance matrimoniale avec les Wattassides en épousant le sultan Abu al-Abbas Ahmad ben Muhammad. Sur le plan stratégique elle joint ses forces à celles de l'amiral ottoman Barberousse établi à Alger, et qui affronte de son côté les Espagnols en Méditerranée occidentale. Sayyida al-Hurra règne sans partage sur son fief tétouanais jusqu'en 1542.
En 1472, les sultans wattassides de Fès ont perdu l'essentiel des territoires côtiers et ne contrôlent plus la rive marocaine du détroit de Gibraltar. Les Portugais prennent possession de Tanger en 1471 puis cèdent la ville à l'Angleterre en 1661 comme dot apportée par Catherine de Bragance à son époux Charles II d'Angleterre. La domination anglaise sur Tanger, relativement courte (1661-1684), sera contestée en permanence par le Parlement de Londres malgré l'octroi d'une charte civique à la colonie par Charles II, et cela en raison des difficultés financières qu'entraîne l'entretien de sa garnison soumise en permanence à la pression des assauts marocains. L'évacuation de Tanger est finalement décidée et confiée à l'amiral Dartmouth, les troupes de Moulay Ismail prennent alors possession de la ville après plus de 200 ans d'une triple domination étrangère (portugaise, espagnole, anglaise). Les Anglais compenseront la perte de Tanger en s'emparant de Gibraltar en 1704.
Durant la domination portugaise (1471-1661, avec un intermède espagnol entre 1580 et 1640), Tanger constitue la capitale de l'Algarve d'Afrique, car il existe alors deux Algarves, celle d'Europe et celle d'Afrique, toutes deux considérées comme territoires relevant personnellement de la maison d'Aviz puis de la maison de Bragance (le roi du Portugal porte aussi le titre de roi des Algarves).
Sous les règnes successifs d'Alphonse V, Jean II et Manuel Ier (période marquant l'apogée de l'expansion portugaise) l'Algarve africaine englobe presque tout le littoral atlantique marocain, à l'exception de Rabat et de Salé. Les Portugais contrôlent la portion côtière s'étendant de Ceuta à Agadir et à Boujdour, avec pour points de jalon les places fortes de Tanger, Asilah, Larache, Azemmour, Mazagan, Safi et Castelo Real de Mogador. D'Azemmour est originaire Estevanico (de son vrai nom Mustapha Zemmouri), un Marocain réduit en esclavage par les Portugais puis revendu aux Espagnols. Estevanico se rendra célèbre par sa découverte et son exploration de l'Amérique du Nord, depuis la Floride jusqu'aux confins du Mexique et de l'Arizona, dans les rangs des conquistadors hispaniques.
Les possessions de la Couronne lusitane constituent des fronteiras, équivalent portugais des presidios espagnols, et sont utilisées comme escales sur la route maritime du Brésil et de l'Inde portugaise. Néanmoins la plus grande partie du Maroc portugais est reconquise par les Saadiens en 1541. La dernière fronteira est celle de Mazagan, récupérée par les Marocains en 1769. Les Espagnols pour leur part s'attribuent la côte méditerranéenne avec les présides de Melilla et le rocher de Vélez de la Gomera, ainsi que la région de Tarfaya faisant face aux îles Canaries. Ils prennent également le contrôle de Ceuta à l'issue de la débâcle portugaise à la bataille des Trois Rois qui se solde par l'établissement de l'Union ibérique (1580).
Les Wattassides affaiblis donnent finalement le pouvoir à une dynastie se réclamant d'une origine arabe chérifienne (les Saadiens) en 1554.
an 1472 : Cameroun - En revanche, on a la certitude que, en 1472, les marins portugais du navigateur Fernando Pó sont entrés dans l'estuaire du Wouri, s'extasiant de l'abondance des crevettes dans le cours d’eau qu'ils appellent aussitôt Rio dos Camarões (rivière des crevettes). Les marins anglais adoptent ce nom en l'anglicisant (Cameroons), d'où le nom actuel de Cameroun.
Après les Portugais viennent les Néerlandais puis les Allemands. Par les contacts avec les Européens et les Sahéliens (royaume du Kanem-Bornou) débutent des échanges commerciaux réguliers. Le développement de la traite négrière, soit occidentale, soit orientale, la diffusion du christianisme par le sud et de l'islam par le nord, changent profondément les sociétés du Cameroun, favorisant les groupes structurés ayant adopté une religion monothéiste et capables de se procurer des armes à feu, au détriment de l'organisation politique antérieure (comme le royaume Bamoun).
an 1472-1473 : Gabon - Les Portugais Joao de Santarem et Pedro Escobar et Don Henrique (fils du roi du Portugal) furent les premiers Européens à accoster au Gabon, en 1472, sur les bords du Komo. L'estuaire de ce fleuve en forme de caban, un manteau de marin, en portugais gabâo, donna son nom au Gabon. En 1473, Lopo Gonçalves touche la pointe extrême de l'île Mandji, l'actuelle Port-Gentil, région à laquelle il donne son nom, le Cap Lopez. Lopo ou Lopez Gonçalvez, Fernan Vaz, Diego Cam reconnurent le rivage du Gabon. Lopo Gonçalves continue l'exploration du Gabon vers le Sud. Il sera suivi par d'autres Portugais dont Fernao Vaz, qui donnera son nom à la lagune Nkomi dans l'actuel département d'Etimbwé (Ogooué-Maritime). À leur suite, plusieurs autres nations européennes établirent des comptoirs sur les côtes. Des activités commerciales s'y développèrent et aussi bientôt, comme sur les autres côtes occidentales africaines, la traite des noirs mais aussi le commerce de l’ivoire ou du bois d’ébène. Les premiers esclaves capturés par les Portugais, dès le début du XVIe siècle, furent employés dans les plantations de canne à sucre de Sao Tomé avant que le commerce vers l'Amérique ne devienne prépondérant.
À cause des migrations internes en cours, le Gabon était à cette époque sur la voie d'un équilibrage démographique qui fut perturbé par les Européens. Ces derniers, pour alimenter la traite des noirs, capturèrent et achetèrent des esclaves à des chefs côtiers, lesquels assayaient ainsi leur prédominance sur d'autres ethnies de l'intérieur du pays. Ce fut une période faste pour les ethnies côtières comme les Mpongwe et surtout les Oroungou qui se constituèrent un royaume dans les premières décennies du XIXe siècle. Ce commerce perdura, même après son interdiction, jusqu'au milieu du XIXe siècle.
an 1472-1800 : Nigéria - Période pré-coloniale (1472-1800) - Premiers explorateurs européens et commerce d'esclaves
L'esclavage est une histoire ancienne, en Afrique comme ailleurs. Il faut distinguer le statut d'esclave, de la mise en place d'échange ou de commerce d'esclave, la traite esclavagiste. Dans l'Antiquité, l'esclave n'est pas défini par sa couleur de peau : chez les Grecs par exemple, tout «barbare» ou «non-civilisé» pouvait être réduit au statut d'esclave. Les Grecs ont réduit d'autres Grecs au statut d'esclaves, les Romains ont eu des Grecs comme esclaves, mais, pendant la période romaine, une grande partie des esclaves étaient issues du nord de l'Europe. La traite esclavagiste a souvent résulté, initialement, de guerres : les prisonniers de guerres servaient comme esclaves. Un des montages les plus anciens et les plus connus de traite d'esclave, concernant l'Afrique, est le « baqt » : ce pacte de paix est conclu en 652 entre le royaume nubien copte de Makurie d'une part, et l'Égypte d'autre part. Ce pacte prévoit notamment la fourniture chaque année par la Nubie d'environ 400 esclaves en échange de farine, de vêtements et de chevaux fournis par l’Égypte.
La traite esclavagiste prend une dimension plus large avec les Portugais au XVe siècle. Un navire portugais accoste dans le golfe du Bénin en 1472, initialement attiré par le commerce de l'or. Mais bien vite, une traite des esclaves se met en place, vers la péninsule ibérique puis à travers l'océan atlantique vers le Brésil par exemple (le Brésil est une colonie portugaise à partir du XVIe siècle). Des comptoirs sont fondés le long de la côte africaine, notamment la ville de Lagos. À l'origine occupé par une tribu du peuple Yoruba, le site de Lagos est constitué d'un ensemble d'îles dans une lagune abritée de l'océan Atlantique, au bord du golfe du Bénin. Lagos devient un centre majeur de la traite des esclaves au cours du XVIIIe siècle. Les Anglais suivent, puis les Français. Rapidement, du XVIIe au XIXe siècle, le trafic d'êtres humains par des marchands européens supplante tous les autres commerces de la côte, dans le golfe de Guinée. En France, le ministre Colbert participe à l'élaboration du Code Noir (la traite atlantique concerne exclusivement les Noirs), au XVIIe siècle,un texte juridique précisant le statut des esclaves.
En 1807, les Britanniques interdisent le commerce des esclaves. Cette décision de mettre fin aux traites négrières s'explique à la fois par la montée du capitalisme industriel qui privilégie une forme de travail pasée sur le salariat, et par les idées du siècle des Lumières5. Les États-Unis emboîtent le pas à cette décision britannique en 1808, puis la France, par le décret du 29 mars 1815 confirmé par la suite par l'ordonnance royale du 8 janvier 1817 et la loi du 15 avril 1818. Après les traites négrières, ces trois pays abolissent respectivement l'esclavage en 1833, 1860 et 18487. Mais la traite continue encore, de façon moindre, en Afrique de l'Ouest, en partie de manière clandestine et en partie par une tolérance accordée pendant plusieurs décennies à l'Espagne. Par contre, l'Afrique de l'Ouest dont le Nigeria, ne constitue plus le plus important marché négrier au XIXe siècle (le sultanat de Zanzibar, à l'est de l'Afrique, se substitue à cette région).
an 1478 - 1496 : Canaries (Îles des) - La conquête des îles royales
Les Rois catholiques financent en partie la conquête des îles royales, notamment en armant des navires : Grande Canarie, La Palma et Tenerife. Cette « conquête royale » des Canaries est un des aspects de la guerre de Succession commencée en 1475.
En 1476, ils font rédiger un avis juridique, par lequel les droits de propriété et de conquête sur les îles sont vérifiés[pas clair]. Inés Peraza de las Casas et son mari Diego García de Herrera détenant les droits sur les îles conquises et les droits sur les autres îles ne pouvant être repris par la Couronne qu'en échange d'une compensation, un traité est signé en octobre 1477, par lequel la Couronne de Castille reçoit tous les droits sur les îles de Grande Canarie, La Palma et Tenerife.
Presque toutes les conquêtes ultramarines de la Couronne de Castille sont organisées et réalisées par un conquérant responsable. Ses devoirs et droits sont énoncés dans une capitulation. Si le conquérant ne dispose pas de biens ou de revenus propres suffisants pour financer l'action, il cherche des partenaires ou des prêteurs pour lever les fonds nécessaires à l'entreprise. Ceci est fait en échange de la promesse de compenser ensuite l'argent engagé, avec des retours lucratifs, par redistribution du butin de guerre et/ou attribution de terres dans les zones conquises. Les capitulations de la Couronne de Castille ne contiennent généralement pas de promesse de titre de noblesse ou de prétention au pouvoir, mais seulement une promesse d'attribution d'une charge, de gouverneur par exemple.
En fin de siècle, massacrés, emmenés en esclavage ou assimilés par les colons, les différents peuples guanches disparaissent en tant que tels, et adoptent la langue et la culture espagnole. Cependant, de très nombreux toponymes et oronymes, de mots du langage courant, et même de coutumes et de sports (lutte guanche, par exemple), proviennent directement de la langue ou de la culture guanche.
an 1478 - 1483 : Canaries (Îles des) - Grandes Canaries
Tenesor Semidán (es) (1447-1496), chef indigène, résistant puis pacificateur, baptisé Fernando Guanarteme.
En 1461, Diego de Herrera prend possession de l'île de Grande Canarie, recevant la vassalité des royaumes ou chefferies autochtones, Guanartemes (es) de Guanartemato de Gáldar (es) (1405-1482) et Guanartemato de Telde (es) (1405-1483). Mais l'île se révolte à nouveau.
En mai 1478, la reine Isabelle et le roi Ferdinand concluent un accord à Séville avec l'évêque de Rubicón Juan de Frías (es) (mort en 1485). Le 24 juin 1478, une troupe de plus de 600 hommes débarque dans le nord de l'île, progresse lentement, en raison de conflit interne de commandement espagnol et de la résistance étonnamment forte des Canariens. Pedro de Vera y Mendoza (1440-1492) finit par être nommé seul commandant en chef des troupes et gouverneur de l'île. Dès juillet 1481, il prend ses fonctions sur l'île. En février 1482, la capture du dirigeant de Gáldar, Tenesor Semidán (es) (1447-1496), perturbe la résistance indigène. Les Castillans établissent plusieurs bases sur l'île, d'où ils attaquent les Canariens. En avril 1483, les derniers indigènes se rendent. Tenesor Semidán est baptisé Fernando Guanarteme. Pedro de Vera reste gouverneur de Grande Canarie jusqu'en 1491.
1478 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
L'archipel est un point de passage important pendant l'époque des grandes découvertes. Christophe Colomb y séjourne en 1478. C'est cette escale, pendant laquelle il rencontre sa femme, qui lui donnera l'idée de faire une expédition vers les Indes. Il participe à faire connaître les vertus de Madère.
an 1479 - 1494 : Canaries (Îles des) - Le traité d'Alcaçovas (1479) et le partage colonial de l'Afrique
Le traité (4 septembre 1479) qui met fin à la guerre de Succession de Castille contient plusieurs articles sur les questions d'outre-mer, venant confirmer des bulles pontificales qui avaient accordé aux Portugais le monopole de la navigation le long des côtes d'Afrique, lancée par Henri le Navigateur dans les années 1410. Les Rois catholiques reconnaissent ce monopole, mais seulement aux latitudes inférieures (plus proches de l'Equateur) à celle de la plus méridionale des îles Canaries.
En 1481, la bulle pontificale Æterni regis, de Sixte IV, place toutes les terres au sud des Canaries sous souveraineté portugaise. Seul l'archipel des Canaries, ainsi que les villes de Sidi Ifni (1476–1524) (à l'époque Santa Cruz de Mar Pequeña), Melilla (capturée par Pedro de Estopiñán en 1497), Villa Cisneros (fondée en 1502 dans l'actuel Sahara occidental), Mazalquivir (Mers el-Kébir, 1505), Peñón de Vélez de la Gomera (1508), Oran (1509–1790), Peñón d'Alger (1510–29), Béjaïa (1510–54), Tripoli (1511–51), Tunis (1535–69) et Ceuta (cédée par le Portugal en 1668) restent territoires espagnols en Afrique.
Le statut de la Guinée espagnole ou "Territoires espagnols du Golfe de Guinée", devenue Guinée équatoriale en 1968, reste très particulier historiquement : Région insulaire (Fernando Poo ou Bioko, et Annobón), Région continentale ("Rio Muni").
Ls autres bulles pontificales concernant alors la colonisation sont Dum Diversas (1452), Romanus pontifex (1455), Dudum siquidem (1493), Inter caetera (1493), qui sont également à l'origine du Traité de Tordesillas (1494).
Le traité d’Alcáçovas et le traité de Tordesillas ( 7 juin 1494) sont des textes fondateurs dans l’histoire du colonialisme : ils énoncent explicitement le fait que des Européens s’attribuent le droit de diviser le reste du monde en sphères d’influence et d’en coloniser les territoires, considérés comme terrae nullius, sans se soucier du consentement des habitants.
an 1481 : Gambie - La bulle pontificale Aeterni regis, fulminée le 21 juin 1481, attribua la côte africaine au Portugal au détriment de l'Espagne.
an 1482 : Angola - Vers 1482, l'explorateur portugais Diogo Cão atteint le Cap du Loup à l'embouchure du fleuve Congo. Les Portugais débarquent et gravent le blason du Portugal sur le rocher de Matadi (en république démocratique du Congo) et érigent une croix sur les côtes angolaises (padrão). Les Portugais tirent d'abord profit de la stupeur des Africains voyant pour la première fois des hommes blancs ayant des armes à feu inconnues, le mani-kongo est alphabétisé et converti tandis que des collèges jésuites sont construits. Les Portugais forment aussi des tailleurs de pierres (probablement pour construire des églises), Mbanza Kongo est rebaptisé São Salvador (Saint-Sauveur) de Kongo. La majeure partie de la population vit néanmoins le christianisme comme une magie supplémentaire des nobles.
an 1482 : Congo Brazzaville - À l'arrivée des premiers Européens, en 1482, il existait le royaume de Loango. La traite des noirs, des guerres et l'activité des missionnaires vont affaiblir le royaume puis le détruire. Les populations vont avoir tendance à suivre des sectes comme celle des Antoniens.
Les premiers contacts avec les Européens ont lieu au XVe siècle, et des échanges commerciaux sont rapidement établis avec les royaumes locaux. La région côtière est une source majeure durant la traite d'esclaves transatlantique. Lorsque celle-ci prend fin au XIXe siècle, les pouvoirs bantous s'érodent pour laisser place au colonialisme. En 1482, après les premières reconnaissances effectuées par des navigateurs portugais, l'explorateur Don Diogo Cão atteint l'embouchure du fleuve Congo. Les contacts avec le royaume du Kongo suscitent des tensions. La traite opère une grande ponction démographique et déstabilise considérablement les entités politiques et les sociétés d'Afrique centrale en général.
an 1482 : Congo Kinshasa - Les Européens se limitèrent aux régions côtières du pays jusqu’à la moitié du XIXe siècle.
-
1482 : le Portugais Diogo Cão, à la recherche du mythique « royaume du prêtre Jean », atteint l'embouchure du fleuve Congo.
an 1482 : Ghana - Les portuguais fondent un premier comptoir commercial à São Jorge da Mina, là où se situe actuellement la forteresse Elmina. Les Portugais se lancent dans le commerce de l’or, et la région devient le premier fournisseur de l’Europe. Ils gardent ensuite le monopole de ce commerce pendant plus d’un siècle et demi, jusque vers 1650. Ils se lancent également dans le commerce des esclaves, commerce plus rentable encore que celui de l’or, qu’il supplante bientôt en importance dès la seconde moitié du XVIIe siècle. Ils fondent El Mina, véritable base militaire, à partir de laquelle les Portugais imposent leur volonté aux ethnies côtières, afin qu´elles leur fournissent or et esclaves.
an 1484-1504 : Soudan - En 1484, Amara Dounkas (1484-1526) fonde le royaume foundj de Sennar (ou Sinnar) qui annexe le royaume d'Alodie en 1504. Il règne entre le Nil Blanc et le Nil Bleu sur une population composée d’Arabes, de Nubiens, de Méroïtiques et de Noirs4. Les Foundj font de Sennar leur capitale, sur le Nil bleu dont ils contrôlent la vallée. L’essentiel des exportations est composé des esclaves des tribus païennes de l’ouest et du sud.
an 1485 : Égypte - première guerre entre les Ottomans et les Mamelouks d'Égypte par suite du secours que le sultan ASCHRAF KAÏTBAÏ (1468 - 1496) a prêté au prince ZIZIM (Djem) et de la prise de possession par les Mamelouks de la petite Arménie.
an 1485 : Guinée-équatoriale - La première tentative de peuplement des îles désertes du golfe se fait sur l’île de São Tomé en 1485, mais elle échoue.
an 1486 - 1488 : Namibie - En 1486, le navigateur portugais Diego Cão débarque près de l'actuel Henties Bays (à Cape Cross) où il fait dresser une croix haute de deux mètres. Après avoir atteint la baie des baleines (Walvis Bay), Bartolomeu Dias mouille son navire à Angra Pequena (Dias Point) le 25 décembre 1487 avant de poursuivre en 1488 vers le cap de Bonne-Espérance. Néanmoins, l'inhospitalier désert du Namib et le désert du Kalahari constituent une formidable barrière au peuplement du territoire et à l'exploration européenne en provenance des mers.
an 1488 : Afrique du Sud - Le navigateur portugais Bartolomeu Dias atteint le cap des Tempêtes (cap de Bonne-Espérance), suivi en 1497 par le navigateur portugais Vasco de Gama qui longe la côte du Natal.
C'est le 3 février 1488, à Mossel Bay, que débarque pour la première fois sur les rives sud-africaines un équipage européen. Après avoir longé le sud-ouest de la côte africaine, la flotte, commandée par le Portugais Bartolomeu Dias, est emportée vers le sud, dépassant le point le plus méridional du continent. Après avoir continué vers l'est, il se dirige à nouveau vers le nord jusqu'au Rio do Infante (actuelle Great Fish river) avant de longer la côte vers l'ouest et, plus tard, d'atteindre le cap des Aiguilles. Sur le chemin du retour vers le Portugal, Dias repère ce qu'il nomme le « cap des Tempêtes » en raison des vents qui y sévissent et des courants qui y sont très forts. Ce cap est finalement rebaptisé cap de Bonne-Espérance (Cabo da Boa Esperança) par le roi Jean II roi du Portugal, car ce dernier y voit une nouvelle route vers l'Asie et ses épices8 et que les Portugais ont désormais « bon espoir » d'arriver bientôt aux Indes.
an 1490 : Égypte - Les Turcs ayant été battus par le sultan d'Égypte entre Tarse et Adana (1488), BAJAZETH II passe lui-même en Asie et force les Mamelouk à demander la paix.
an 1 490 à 1 527 : Éthiopie - Le début de la dynastie salomonienne
Sous la dynastie salomonienne, on distingue trois grandes provinces en Éthiopie : le Tigré (au Nord), l'Amhara (au centre) et Choa (au sud). Le gouvernement, ou plutôt l'autorité suprême, siège généralement dans l'Amhara ou le Choa, dont le dirigeant, prend le titre de Negusse Negest. Ce titre est une extension considérable du titre du dirigeant, basée sur la reconnaissance de son ascendance directe du roi Salomon et de la reine de Saba ; il est inutile de signaler que dans beaucoup, sinon la plupart des cas, cette reconnaissance s'est souvent faite plus par la force que la pureté véritable de la lignée.
Vers la fin du XVe siècle, des missions portugaises commencent à avoir lieu en l'Éthiopie. Issues d'une vieille croyance ayant longtemps régné en Europe sur l'existence d'un royaume chrétien en Extrême-Orient, diverses expéditions européennes sont parties à la recherche du royaume chrétien du prêtre Jean. Parmi les membres de l'expédition se trouve notamment Pêro da Covilhã, qui arrive en Éthiopie en 1490, et, croyant avoir enfin atteint le célèbre royaume, présente au Negusse Negest, une lettre du roi du Portugal, adressée au prêtre Jean.
Pêro da Covilhã reste dans le pays, mais en 1507 un Arménien du nom de Matthew envoyé par le Negusse Negest au Roi du Portugal vient lui demander son aide pour repousser les musulmans. En 1520 une flotte portugaise entre dans la mer Rouge conformément à cette demande, une ambassade portugaise rend visite au Negusse Negest Dawit II et s'établit en Éthiopie pendant environ six ans. Parmi cette délégation se trouve le père Francisco Álvares, qui écrira l'une des premières historiographies éthiopiennes à destination de l'Europe. Cette description s'arrête en 1527, début des campagnes d'Ahmed Gragne.
an 1491 - 1493 : Canaries (Îles des) - L'esclavage aux Canaries
De 1491 à 1496, les Guanches sont soit massacrés, soit astreints à des travaux forcés sur les îles Canaries, soit vendus comme esclaves.
Sur la Grande Canarie, un certain nombre de Guanches rescapés de la conquête castillane se réfugient en zone montagneuse et forestière. Ils sont connus sous le nom d' « Inekaren » (« debout, levés, dressés »)
Le commerce des esclaves se fournit surtout en Afrique, mais le transit vers l'Amérique et le contrôle administratif s'opèrent dans les possessions espagnoles (Canaries, Guinée espagnole) ou portugaises (Cap-Vert, Açores, Madère)
En 2009, est mis au jour à Finca Clavijo, près de Santa María de Guía de Gran Canaria, le plus ancien cimetière connu de victimes de la traite négrière sur une île de l'océan Atlantique.
an 1492 : Algérie - Les Rois Catholiques ont achevé la Reconquista. Entre le XIIIe siècle et 1609, date de l'expulsion définitive des musulmans et des juifs de la péninsule Ibérique, le Maghreb connait un grand afflux d'immigrés andalous. Ils s'installent en masse dans les villes du nord du Maghreb central, dont Oran, Tlemcen, Nedroma, Mostaganem, Cherchell, Blida, Alger, Koléa, Béjaïa, Dellys et Médéa. L'apport de ces immigrés est très important dans leur société d'accueil, notamment sur le plan économique et culturel.
La présence des Andalous est plus ancienne dans le territoire algérien. À l'époque des Omeyyades de Cordoue, ils avaient établi des colonies sur le littoral pour pratiquer le commerce méditerranéen : Ténès en 872 et Oran en 902. Sous l'effet de la progression de la Reconquista durant la période almohade, la région connait un grand afflux d'immigrés andalous. Dans le royaume zianide, Tlemcen accueille 50 000 Andalous de Cordoue, faisant bénéficier la ville du savoir et de l'art d'une civilisation raffinée. L'afflux des administrateurs andalous contribue à la prospérité du royaume, mais également à l'émergence d'une orthodoxie malikite. Les hafsides recrutent également des notables andalous.
Par la suite, l'expulsion des Morisques vers la régence d'Alger aura des effets positifs sur son essor : ils releveront Cherchell, Ténès et Dellys de leurs ruines, repeupleront Blida et fonderont Koléa. Alger accueillera 25 000 Morisques au début du XVIIe siècle, qui contribueront à l'expansion urbaine de la ville. Plusieurs familles juives d'Espagne trouveront refuge dans le Maghreb central, les rabbins espagnols vivifiant les communautés citadines, notamment à Tlemcen, Constantine, Oran et Miliana.
an 1492 - 1493 : Canaries (Îles des) - La Palma
La Palma (îles Canaries) (ou San Miguel de La Palma) est l'avant-dernière grande île des Açores à être soumise par les Castillans, soucieux de s'assurer la maîtrise de l'archipel et de cette partie de l'Océan Atlantique.
Les Guanches de La Palma, nommés Benahoaritas (es), ou "Auaritas" ou "Awaras", au nombre approximatif de 4 000, vivent essentiellement d'élevage (chèvres, moutons, porcs), de cueillette (fruits, racines), de pêche, et à une ancienne époque d'agriculture (orge, blé, haricots, lentilles).
En 1447, alors qu'Hernán Peraza el Viejo organise le gouvernement de Fuerteventura, son fils Guillén s'embarque pour l'île de La Palma pour effectuer un raid qui couvrirait les frais du voyage. Les troupes, composées de Sévillans et d'insulaires, débarquent dans le canton de Tihuya à l'ouest de l'île, et se dirigent vers l'intérieur des terres. Ils y sont attaqués par les Benahoaritas (es), indigènes guanches, menés par leur roi, Chedey (ou Echedey), et ses frères. Les "conquérants" sont complètement vaincus, et Guillén tué, une fois reconnu comme chef des ennemis.
En 1492, la reine Isabelle et le roi Ferdinand se mettent d'accord avec Alonso Fernández de Lugo (1450/1525) pour conquérir l'île de La Palma. Le 8 juin 1492, une capitulation est établie, qui réglemente les questions financières, nomme Alonso Fernández de Lugos gouverneur de l'île à vie. Le conquistador ne disposant pas des fonds nécessaires, il fonde une société commerciale avec deux marchands italiens, qui partagent coûts et bénéfices.
Le 29 septembre 1492, Alonso Fernández de Lugo débarque sur la côte ouest de l'île, avec une troupe armée d'environ 900 hommes, composée en partie d'indigènes de Grande Canarie. Elle avance vers le sud de l'île sans combattre. À Tigalate (es), un affrontement armé avec les Benahoaritas est repoussé. La conquête de l'île se poursuit sans incident militaire majeur. Au printemps 1493, seul le district d'Aceró reste libre, dans la Caldeira de Taburiente inaccessible militairement, provisoirement autosuffisant sur leur territoire. Un siège paraissant impossible, Lugo doit négocier. Un parent de Tanausu, souverain des Acerós, est pressenti pour organiser une rencontre entre les deux dirigeants. Tanausu accepte à condition que les troupes castillanes se retirent à Los Llanos. Les négociations ont lieu, et s'achèvent sans aucun résultat. Au retour de cette rencontre, Tanausú et son peuple sont attaqués et capturés, contrairement à la promesse des Castillans. Tanausu est exilé ou déporté, et meurt en cours de route. La résistance des indigènes de l'île de La Palma s'effondre. L'île est considérée comme soumise à partir de mai 1493.
an 1492 - 1493 : Canaries (Îles des) - Les voyages de Christophe Colomb de 1492 et 1493 : les Canaries, étape vers les « Indes »
Premier voyage de Colomb
Les voyages de Christophe Colomb sont une partie des expéditions navales espagnoles d'exploration.
Christophe Colomb effectue sa dernière escale sur l'île de La Gomera, à San Sebastián de la Gomera, avant de se lancer le 6 septembre 1492 vers les Indes, pour atteindre de fait un Nouveau Monde, l'Amérique. La petite flotte de Colomb est auparavant restée entre les îles de Gran Canaria et La Gomera pendant près de quatre semaines, recevant un soutien technique et logistique des îles et des insulaires. La caravelle La Pinta avait alors une rame gravement endommagée et fuyait. Colomb fait également changer le gréement de ce navire et peut-être celui de la caravelle La Niña. Ces réparations ont été effectuées à Gran Canaria, probablement dans la baie de Gando, où se trouve actuellement l'aéroport de Gran Canaria. Curieusement, le séjour de la petite flotte de Colomb est largement ignoré dans la littérature pertinente plus ancienne et plus récente, bien qu'il soit évident que sans les bases sur les îles Canaries, l'Amérique était hors de portée de la technologie des navires à l'époque. Les navires étaient encore trop petits et trop lents pour pouvoir emporter les quantités adéquates de vivres et d'eau pour de très longs voyages, d'autant plus qu'un équipage surdimensionné était à bord, naviguant de jour comme de nuit. Le voyage de Palos de la Frontera aux îles Canaries était probablement plus un essai routier pour tester les navires et former l'équipage. Le véritable voyage vers les Indes commence seulement à La Gomera, comme le note Fernand Colomb (1488-1539), resté avec sa mère Beatriz Enríquez de Arana en Castille, second fils de Christophe Colomb et premier biographe de son père.
Lors de son deuxième voyage, Christophe Colomb se dirige vers El Hierro. Après séjour de 19 jours et réapprovisionnement, avec un vent favorable, sa flotte de 17 navires quitte l'île, le 3 octobre 1493, de la "Bahía de Naos" pour le Nouveau Monde.
an 1492-1609 : Maroc - L'arrivée des Andalous et des Morisques
Après les premiers succès de la Reconquista, des musulmans andalous commencent à se replier vers le Maroc en nombre croissant; ainsi dès le XIIe siècle certains Andalous décident de quitter l'Espagne maure, mais la majeure partie d'entre eux est contrainte principalement en deux temps : à la chute de Grenade en 1492, et en 1609 avec l'expulsion des Morisques suivie de l'exil vers le Maghreb.
Dès avant 1492, la proximité géographique du Maroc avec l'Espagne andalouse et l'appartenance d'Al Andalus à la sphère de domination géopolitique almoravide, almohade puis mérinide, ont naturellement induit des échanges constants et variés entre les deux pays. La proximité du Maroc et la volonté de retour en Espagne entraînent une importante concentration de populations andalouses sur les rivages Nord du Maroc. Les rois catholiques espagnols désireux d'établir un glacis de protection de la péninsule Ibérique attaquent les régions méditerranéennes du Maroc et du reste du Maghreb, et s'emparent des villes de Melilla en 1497 et de Peñón de Vélez de la Gomera en 1508, afin de prévenir toute velléité de revanche, ainsi qu'un éventuel appui marocain ou ottoman aux exilés.
L'arrivée massive des Andalous, que le Maroc devra intégrer dans son tissu social et économique, marque un tournant majeur dans la culture, la philosophie, les arts, la politique et divers aspects de la civilisation marocaine. De nombreux intellectuels et artistes andalous rejoignent les Cours royales et califales du Maghreb, ce mouvement étant initié par le célèbre philosophe Averroes de Cordoue (décédé à Marrakech en 1198) et par le dernier grand poète arabe de l'Espagne musulmane, Ibn al-Khatib de Grenade qui finit sa vie à Fès au temps des Mérinides.
an 1493 : Guinée-équatoriale - Première population : Ce n’est qu’en 1493 que les efforts consentis par les Lusitaniens porteront leurs fruits dans cette île. L’île de Principe ne sera peuplée qu’au début du XVIe siècle, et Annobón au milieu de ce même siècle. Quant à Fernando Poo, elle est déjà peuplée par les Bubis, et les Portugais après avoir construit un fort, sont contraints de l’abandonner. Ces deux îles furent longtemps utilisées comme escales de rafraîchissements.
an 1493 : Sao Tomé et Principe - Peuplée à partir de 1493, São Tomé fut d'abord une terre de relégation, d'exil, de déportation et d'esclavage, accueillant repris de justice, jeunes juifs convertis au catholicisme (2 000), mais à la foi jugée vacillante.
an 1494 - 1496 : Canaries (Îles des) - Ténérife
Statue d'El Gran Tinerfe Statue en bronze du roi Beneharo à Candelaria, Tenerife. Mencey Acaimo
Avant la conquête, à la mort de Tinerfe le Grand (et fils de Sunta), l'île de Tenerife est divisée en neuf royaumes appelés menceyatos. Chacun a pour roi un de ses neuf fils :
Avant cette division territoriale, il n'y avait qu'un seul royaume dont les rois les plus célèbres étaient Tinerfe et Sunta. Ichasagua était le dernier membre de l'île de Tenerife après la conquête castillane.
Le premier débarquement a lieu par les rois catholiques en 1464 à l'endroit où se situe actuellement la capitale, Santa Cruz de Tenerife. Les envahisseurs ne rencontrent pas de résistance à cette occasion. En 1464, la prise de contrôle symbolique de l'île de Tenerife par les représentants du seigneur des Canaries, Diego García de Herrera (ca) (1417-1485) se déroule dans le ravin de Bufadero. Ces derniers signent un traité de paix avec les Mencey, permettant aux Mencey d'Anaga de construire une tour sur leurs terres, où Guanches et Européens ont des accords jusqu'à sa démolition vers 1472 par les Guanches eux-mêmes. Mais quand ils essayent d'avancer vers le nord de l'île, sous le commandement de Fernández de Lugo, Adelantado (gouverneur militaire), qui a déjà participé à la conquête des autres îles, ils se heurtent aux guerriers guanches du mencey (chef ou roi d'une circonscription territoriale appelée « menceyato ») Bencomo qui massacrent la majorité des envahisseurs.
Après la victoire d'Alonso Fernández de Lugo sur la population de l'île de La Palma en 1492 et 1493, il s'entend avec la couronne de Castille sur les termes de la conquête de l'île de Tenerife. Les détails sont précisés dans les capitulations de Saragosse, publiées en décembre 1493 par la reine Isabelle et le roi Ferdinand. Alonso Fernández de Lugo fonde une entreprise avec un certain nombre de donateurs de Séville et de militaires qui comptent tirer de sérieux bénéfices de l'action.
En mai 1494, 1 500 fantassins et 150 cavaliers, placés sous le commandement d'Alonso Fernández de Lugos, débarquent sur la plage d'Añaza, juste au sud de l'actuel centre-ville de Santa Cruz de Tenerife. Des traités de paix sont signés avec les Menceyes d'Anaga, Güímar, Abona et Adeje. Les négociations avec les Mencey de Taoro Bencomo n'aboutissent à un accord. Les Menceyes de Tegueste, Tacoronte, Taoro, Icod et Daute ne sont pas prêts à se soumettre aux rois castillans. Ensuite, les troupes castillanes marchent vers la région de Taoro (vallée d'Orotava).
Dans le Barranco de Acentejo, un ravin près de la ville actuelle de La Matanza de Acentejo, les troupes castillanes sont attaquées par des combattants guanches. Vue l'étroitesse du Barranco, les Castillans ne peuvent pas adopter un ordre de bataille et ni utiliser leur supériorité technologique en armement. La première bataille d'Acentejo (en) s'achève par un « massacre », la Matanza de Acentejo : des assaillants survivent seulement 300 fantassins et 60 cavaliers, qui, début juin 1494, quittent Ténérife pour Grande Canarie.
Alonso Fernández de Lugo vend l'intégralité de sa propriété à Grande Canarie, et signe de nouveau contrats avec divers donateurs. Il équipe une nouvelle armée de conquête, composée en grande partie de mercenaires ayant combattu à la guerre de Grenade (1482-1492), équipés et payés par le duc de Médine-Sidonia. Un autre groupe est constitué de soldats castillans récemment installés sur l'île conquise de Grande Canarie, et de 40 habitants indigènes de l'île de Grande Canarie avec à leur tête leur ancien prince Fernando Guanarteme.
Début novembre 1495, 1 500 hommes et 100 chevaux débarquent à nouveau à Añaza. Alonso Fernández de Lugo renouvelle les contrats avec les Menceyes du sud-est de l'île. Il fait renforcer la fortification encore existantes d'Añaza avec des murs de pierre et une nouvelle construction près de Gracia (aujourd'hui entre La Laguna et Santa Cruz) dans la zone de l'ennemi, Menceyatos Tegueste. Cette installation représente un avant-poste pour les futures opérations militaires contre les Menceyatos de la partie nord de l'île
Le 14 novembre 1495, lors de la bataille d'Aguere (es), les indigènes et les envahisseurs s'affrontent dans la plaine d'Aguere, aujourd'hui La Laguna, en terrain découvert. Cette configuration permet aux Castillans d'utiliser leur technique de guerre supérieure, armes à feu, arbalètes et cavalerie. Les Guanches, opposant seulement leur nombre (cinq fois supérieur), leur courage, des lances en bois et des pierres, doivent se retirer vaincus après un combat de plusieurs heures. Quarante-cinq des hommes de Lugo et 1700 Guanches sont tués lors de ce seul combat. Un nouveau contingent militaire tue Bencomo sur la côte de San Roque, dans le nord de l'île.
Après la bataille d'Aguere, les Castillans avancent plus à l'ouest dans la domination de Taoro. Sur le bord ouest de la vallée de l'Orotava, un camp militaire est construit, à partir duquel Los Realejos se développe ensuite.
Le 25 décembre 1495, les troupes castillanes marchent au nord-est de leur camp, rencontrent les Guanches près du site de la première bataille d'Acentejo. Le déroulement de cette seconde bataille d'Acentejo (en) est incertain. Après une longue journée de combats, les Guanches sont vaincus. Le lieu du conflit, situé à environ 6 km du lieu de leur défaite de 1494, porte depuis le nom de La Victoria de Acentejo (La victoire de Acentejo).
Même si les conquistadors se sont déjà emparés de presque tout le territoire de Tenerife, il reste encore quelques noyaux de résistance dans les montagnes, ce qui entraîne deux ans de lutte supplémentaire jusqu'à ce que, finalement après la reddition des derniers menceyes, Lugo soit nommé gouverneur de Tenerife et La Palma le 5 novembre 1496. Perdant tout espoir, Bentor, fils et successeur de Bencomo, se jette dans le vide, du haut du précipice de Tigaiga. Cette pratique des Guanches de se jeter dans le vide quand tout espoir est perdu s'appelle le « despeñamiento ».
Le 15 février 1496, les troupes commandées par Alonso Fernández de Lugo sont dissoutes. Les anciens combattants du duc de Médine-Sidonia arrivent en Andalousie dans les premiers jours de mars. Seuls restent sur l'île les soldats souhaitant s'y installer et dans l'attente de l'affectation de terres. Et les créanciers...
En mai 1496, mais officiellement le 25 juillet 1496 (fête du saint national espagnol Saint Jacques), les Menceyes des territoires du nord de l'île se rendent lors d'une cérémonie solennelle organisée par les Castillans dans le camp militaire de Realejos : c'est la Paz de Los Realejos.
Tenerife est la dernière des îles conquises par les Espagnols du fait de la résistance acharnée dont ses habitants ont fait preuve. En 1501, Alonso Fernandez de Lugo est honoré du titre d’Adelantado des îles Canaries et capitaine général de la côte Berbère, du cap Ghir (Cabo de Aguer) au cap Boujdour (cabo de Bojador). Selon les chroniqueurs de l'époque, il y débarque en juillet 1501 et érige une forteresse.
an 1494 : Cap Vert - En 1494, l’île la plus occidentale du Cap Vert, l'ile de Santo Antão, sert de repère pour délimiter les zones d'influence et de conquêtes entre Espagnols et Portugais : selon les termes du Traité de Tordesillas, la ligne de démarcation est à 370 lieues à l'ouest de cette île, et va du pôle Nord au pôle Sud. (Il s'agit de lieues maritimes de 5,556 km). Cette ligne en coupant le continent sud américain, fut la première frontière terrestre du Brésil. Prolongée dans l'océan Pacifique, également de pôle à pôle, elle permis aux Espagnols de s'installer aux îles Philippines tandis que les Portugais s'installaient dans les îles de la Sonde.
an 1494 : Ile Maurice - En 1494, le traité de Tordesillas va laisser le champ libre aux Portugais en Afrique et dans l’océan Indien. Les Portugais vont détourner à leur profit le commerce des épices, de l’or, de l’ivoire et des esclaves. Cela va porter un coup dur au commerce arabe et accélérer la décadence des États musulmans de la Méditerranée. Les Portugais ne veulent plus dépendre des Arabes pour s’approvisionner en produits exotiques.
an 1496 : Cap Vert - Le Cap-Vert devient une colonie de la couronne portugaise. Les Portugais importèrent rapidement des esclaves depuis la côte ouest du continent. L'archipel devient la première plaque tournante du commerce triangulaire, comme lieu de regroupement des esclaves pour les navires négriers en partance pour les Amériques. Il s'y développe les premières manufactures de cotonnades destinés à ce commerce.
an 1497 : Afrique du Sud - Le premier navigateur européen à franchir concrètement le cap de Bonne-Espérance est un autre Portugais, Vasco de Gama, en 1497. En explorant la côte sud du continent, il baptise, le 25 décembre 1497, une de ces régions côtières du nom de Natal (Noël en portugais). En 1498, il contourne l’Afrique et pousse au nord-est, explorant des régions de l'actuel Mozambique, avant de se diriger vers l'Inde. Les côtes n'étant pas propices à l'accostage et des tentatives d'échanges avec les Khoïkhoïs s'étant révélées source de conflits, les Portugais jettent finalement leur dévolu sur la région du Mozambique. Celle-ci offre, en effet, de meilleurs points d'accostage, en plus de ressources naturelles intéressantes, dont certains fruits de mer et des gisements d'or.
La zone est néanmoins l'objet de contacts réguliers entre Khoï et Européens durant tout le xve siècle et le début du xvie siècle. Le contournement de l'Afrique ne requiert pas moins de six mois par bateau, et chaque voyage est marqué par la mort de nombreux marins, faute de produits frais. Or, le cap de Bonne-Espérance est situé à mi-chemin du voyage entre l'Europe et l'Inde. La baie de la Table, dominée par le massif du même nom, apparait alors comme un endroit propice pour le ravitaillement et le commerce avec les populations locales. Mais les contacts avec les Khoïsans débouchent parfois sur des incompréhensions et des issues sanglantes, comme en font l'expérience les marins portugais8. Durant la seconde partie du xvie siècle, les Néerlandais, qui ont supplanté les Portugais sur les voies commerciales menant vers l'Asie, tentent à leur tour d'établir des contacts avec les Khoïkhoïs mais sans grands résultats.
an 1497 : Égypte : guerres intestines après les désastres et la mort de KAÏTBAÏ. Sept sultans se succèdent en cinq ans.
an 1497 : Magreb : les Maures réfugiés à Alger deviennent des corsaires redoutés. Ils attaquent les côtes d'Espagne
an 1498 : Cap Vert - Christophe Colomb fait escale au Cap Vert, à Sal et Boa Vista, lors de son 3e voyage. Magellan y fait escale en 1522.
an 1498 : Mozambique - Ces échanges existent donc depuis plusieurs siècles lorsque Vasco de Gama, lors de sa première expédition en 1498, reconnaît la côte est de l’Afrique, établissant des contacts avec les Africains après un débarquement dans la baie de Delagoa, sur le site de la future Lourenço Marques, et avec le sultan Mussa Mbiki, dirigeant une petite île au large de Madagascar, dans la baie de Mossuril, dont le nom actuel est île de Mozambique. C'est le nom de ce sultan, Mussa Mbiki, qui donne en portugais Moçambique, qui a servi tout d’abord à désigner l’île puis la côte continentale lui faisant face.
an 1498-1915 : Mozambique - Colonisation portugaise (1498-1975)
Par la signature du traité de Tordesillas en 1494, toute l’Afrique, considérée comme terra nullius, est attribuée au royaume du Portugal.
an 1498 : Réunion (Ile de la) - En 1498, Vasco de Gama arrive dans cet océan, remonte le canal du Mozambique, explore Madagascar, l'île de Mozambique et va jusqu'à Calicut, en Inde. Au passage, il détruit la ville de Kingani au nord de Madagascar. La colonisation européenne de l'océan Indien commence avec cette première grande expédition.
an 1498 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - L’intermède portugais (1498 – 1729)
En 1498, le portugais Vasco de Gama, sur son périple qui le conduit en Inde après avoir passé le Cap de Bonne espérance, longe la côte est-africaine et rencontre une importante hostilité dans ses rapports avec les notables et marchands arabes. L’explorateur et ceux qui l’accompagnent se rendent aussi compte que certaines cités-États swahilies (Kilwa, Mombasa, Lamu, etc.) se livrent à un important et apparemment fructueux commerce de l'or.
XVIème siècle : Burundi - La connaissance des origines du Burundi repose sur la tradition orale et sur l'archéologie. Selon une des légendes fondatrices, la nation burundaise a été fondée par un homme appelé Cambarantama originaire, selon les versions, tantôt du Rwanda au nord, tantôt du Buha sur les rives du lac Tanganyika, pays du Peuple Ha (en) (bantou).
Les premières traces archéologiques d'un État burundais remontent au XVIe siècle dans l'est de ses frontières actuelles. Il s'est ensuite peu à peu étendu, en compétition avec le Rwanda.
XVIème siècle : Cameroun - La région du lac Tchad passe au XVIe siècle sous le contrôle de l'empire de Kanem-Bornou. Le premier état connu des historiens dans la région est celui du Kanem, qui se développe autour du lac Tchad à partir du IXe siècle. Il devient musulman au XIe siècle et atteint son apogée à la fin du XVIe et au XVIIe siècle. Il impose sa souveraineté à la majeure partie du territoire camerounais. Mais il se heurte sans cesse à la résistance des peuples et des petits royaumes camerounais (notamment les royaumes kotoko et mandara).
À la fin du XVIe siècle, la grande vague migratoire des Peuls (ou Foulbés, du peul, Fulɓe), peuple de pasteurs nomades qui se déplacent d'ouest en est depuis le Macina, atteint le lac Tchad. Au siècle suivant, les Peuls s'implantent dans l'Adamaoua actuel, contribuant à la diffusion de l'islam. Ils s'organisent en petits États théocratiques musulmans, dirigés par un lamido, à la fois chef politique et spirituel.
Le royaume Bamoun est fondé à la fin du XVIe siècle et prend son essor sous le règne de Mboumbouo Mandù, à la fin du XVIIIe siècle, qui étend son territoire par la force des armes. Il s'emploie ensuite à consolider son pouvoir. Au début du XIXe siècle, les États musulmans étendent et consolident leur pouvoir
XVIème siècle : Archipel des Comores - piraterie, invasions malgaches et sultans batailleurs -
À partir du XVIe siècle, les Malgaches Sakalavas effectuent des raids dans les îles et raflent des esclaves. Les Comoriens, à cette époque, sont eux-mêmes déjà esclavagistes, trafiquant pour le monde arabe et européen. Les arabo-persans ayant commencé à introduire eux-mêmes des esclaves africains dans l'archipel, les Makoas dont descendent les Wadzakiya. Les Malgaches finissent par s'installer dans les îles et plus fermement à Mayotte, qui demeurera l'île de l'archipel où la culture malgache (et même la langue) est la plus présente.
L'archipel constitue pendant plusieurs siècles, pour les Européens et les pirates (voir Combat d'Anjouan), une escale sur la côte est de l'Afrique. Les relations entre ces Européens et les souverains locaux reposent pour l'essentiel, sur le rapport des forces. Une tradition rapporte ainsi qu'un chef de la Grande Comores a dû se soustraire, par la fuite, au pouvoir des Portugais en se réfugiant avec une partie des siens à Mayotte. Anjouan est soumise, elle, à un seul pouvoir durant ce siècle.
XVIème siècle : Ghana - Au début du XVIe siècle, des sources européennes mentionnent l'existence d'États riches en or dans la vallée de l'Ofin.
XVI au XVII ème siècle : Malawi - L'empire Maravi s’étend depuis les rives sud-ouest du lac Malawi et englobe la plus grande partie du Malawi actuel, ainsi qu’une partie du Mozambique et de la Zambie. L’empire est gouverné depuis la ville de Mankhamba par le kalonga, qui nomme des lieutenants pour gouverner les provinces nouvellement annexées. L’empire commence à décliner au début du XVIIIe siècle, lorsque des conflits entre gouverneurs provinciaux affaiblissent son autorité.
L’économie de l’Empire maravi dépend largement de l’agriculture, principalement du millet et du sorgho. Les Chewa ont alors accès à la côte de l’actuel Mozambique, ce qui leur permet de faire commerce d’ivoire, de fer et d’esclaves avec les Portugais et les Arabes. Les Portugais entrent dans les territoires du futur Malawi via le port mozambicain de Tête au XVIe siècle et rapportent les premiers témoignages écrits sur l'empire Maravi. Ils apportent le maïs, qui remplace le sorgho dans l’alimentation de base des Malawites, et achètent des esclaves qu’ils emploient principalement dans leurs plantations du Mozambique et du Brésil.
XVIème siècle : Mayotte - La capitale fut alors transférée de Mtsamboro à Tsingoni (« Chingoni ») vers 1530. En 1538 était inaugurée la mosquée royale de Tsingoni, en partie conservée aujourd'hui. Ce sultanat, perpétuellement menacé par les projets d'annexion comoriens et malgaches, est reconnu jusqu'au début du XIXe siècle. C'est de cette époque que date l'établissement de l'islam sunnite chaféite et de l'Islam chiite pratiqué à Mayotte.
Le règne d'Aïssa (40 ans d'après certaines traditions) est une période de prospérité pendant laquelle le sultanat est consolidé (domination de tous les anciens Fani qui conservent néanmoins une partie de leurs anciens pouvoirs en exerçant localement la fonction de vizir), affirme son indépendance vis-à-vis d'Anjouan (fortification de localités de la côte occidentale -face à Anjouan-), et s'ancre dans la culture swahili (développement dans plusieurs localités de quartiers urbains en pierre, alliances matrimoniales avec les clans hadrami de l'archipel swahili de Pate, « plaque tournante » entretenant des réseaux commerciaux entre Madagascar, les Comores et la péninsule sudarabique (notamment pour la traite des esclaves malgaches). C'est en 1557, durant le règne d'Aïssa, qu'une flotte portugaise commandée par Baltazar Lobo da Susa explore l'île, seulement signalée par les Portugais en 1506.
Les sultans : Attoumani ibn Ahmed (ou Uthman ibn Ahmed) - seconde moitié du XVe siècle
Mohamed ibn Hassan dit Mchindra « le vainqueur »
‘Issa (ou Ali ) ibn Mohamed - vers 1530 - fin XVIe siècle
Ali ibn Bwana Foumou ibn Ali -
Umar ibn Ali - 1643 - vers 1680
Ali ibn Umar
Ma naou binti Mwé Fani
Aboubakar ibn Umar - vers 1700 - 1727
Salimou ibn Mwé Fani - 1727 - 1750
Bwana Kombo ibn Salim - 1752 - vers 1790
Saleh ibn Mohamed ibn Bechir el Monzari - vers 1790 -1807
Souhali ibn Salim - 1807-1817
Mahona Amadi - 1817-1829
Bwana Combo - 1829-1836
Andriantsoly (né Tsi Levalou), mort en 1847, est un monarque malgache (v. 1820-1824)
et mahorais (1832-1843) de la première moitié du XIXe siècle.
XVIème siècle : Nigéria
Royaumes du nord
Le commerce fut la source de l’émergence de communautés organisées au nord du pays, recouvert par la savane. Les habitants préhistoriques de la lisière du désert s’étaient trouvés largement dispersés au IVe millénaire av. J.-C., lorsque la dessiccation du Sahara commença. Des routes commerciales transsahariennes reliaient l’ouest du Soudan à la Méditerranée depuis l’époque de Carthage, et au Nil supérieur depuis des temps bien plus reculés. Ces voies de communication et d’échanges culturels subsistèrent jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est par ces mêmes routes que l’islam se répandit en Afrique de l'Ouest à partir du IXe siècle.
Une lignée d’États dynastiques, dont les premiers États Haoussa, s’étirèrent à travers l’ouest et le centre du Soudan. Les plus puissants parmi ces États furent l’empire du Ghana l’empire de Gao et le royaume de Kanem, qui se trouvaient à l’extérieur des frontières actuelles du Nigeria mais qui en ont subi l’influence. Le Ghana commença à décliner au XIe siècle. L’empire du Mali lui succéda, qui consolida la plus grande partie du Soudan occidental au cours du XIIIe siècle. À la chute du Mali, un chef local nommé Sonni Ali fonda l’empire songhaï, qui s’étendait sur le centre du Niger et l’ouest du Soudan. Il prit ainsi le contrôle du commerce transsaharien, basant son régime sur les revenus du commerce et la coopération avec les marchands musulmans. Sonni Ali prit Tombouctou en 1468 et Jenne en 1473. Son successeur, Askiya Mohammed Touré, fit de l’Islam la religion officielle de l’empire, bâtit des mosquées et fit venir des scientifiques musulmans à Gao.
Bien que ces empires n’eurent que peu d’influence politique sur le Nigeria avant 1500, leur impact culturel et économique fut considérable et se renforça au XVIe siècle au fur et à mesure que l’islam se répandit. Tout au long du XVIe siècle, la plus grande partie du nord du Nigeria payait un tribut à l’empire Songhaï ou à l’empire Bornou.
Royaume de Kanem-Bornou
L’histoire de Bornou est étroitement associée à celle du royaume de Kanem, qui marque de son emprise le bassin du lac Tchad au XIIIe siècle. Le royaume de Kanem s’est étendu à l’ouest pour inclure la région qui allait devenir Bornou. Le roi de Kanem et sa cour avaient adopté l’Islam au XIe siècle, ce qui a eu pour effet de renforcer les structures politiques et sociales de l’État. De nombreuses coutumes antérieures subsistèrent cependant et les femmes, par exemple, conservèrent une grande influence politique.
Le Kanem étendit peu à peu son influence sur Bornou. Traditionnellement, l’administration de Bornou était confiée à l’héritier du trône pendant sa période de formation. Au XIVe siècle, des conflits dynastiques forcèrent le roi et ses suivants à s’installer à Bornou, où les Kanuri émergèrent en tant que groupe ethnique entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle. La guerre civile qui secoue Kanem au cours de la seconde moitié du XIVe siècle permet à Bornou de regagner son indépendance.
La prospérité de Bornou repose notamment sur le commerce d’esclaves à travers le Soudan ainsi que le commerce du sel et de bétail. La nécessité de protéger ses intérêts commerciaux incite Bornou à intervenir à Kanem, qui continuait à être le théâtre de batailles tout au long du XVe et au début du XVIe siècle. Malgré sa relative faiblesse politique, les cours et les mosquées de Bornou, patronnées par une lignée de rois érudits, étaient des centres de culture et d’enseignement islamiques réputés.
États Haoussa
Au XIe siècle, quelques États Haoussa comme Kano, Katsina et Gobir se sont développés en villes fortifiées, actives dans le commerce et la production de biens. Jusqu’au XVe siècle, ces petits États se situent à la périphérie des grands empires soudanais de l’époque. Ils subissent la pression constante de l’empire Songhaï à l’ouest et de royaume du Kanem-Bornou à l’est, à qui ils payent un tribut. Les conflits armés ont généralement des motivations économiques, comme lorsque la coalition haoussa mène une guerre contre Jukun et Nupe au centre de la région, pour ramener des esclaves ou contrôler les routes de commerce.
L’Islam est introduit chez les Haoussa par les caravanes. La chronique de Kano rapporte la conversion de la dynastie régnante de Kano par des clercs venus du Mali, témoignant de l’influence malienne loin à l’est. L’acceptation de l’Islam est progressive, et les croyances animistes subsistent longtemps dans les campagnes. Kano et Katsina, grâce à la réputation de leurs écoles et de leurs mosquées, prennent une part importante à la vie intellectuelle et culturelle du monde musulman. Les Peuls (anglais : Fulani ; peul : Fulɓe), originaires de la vallée du fleuve Sénégal, commencent à intégrer le royaume Haoussa vers le XIIIe siècle.
XVIème siècle : Sénégal - Début de la traite des Noirs organisée par les Portugais. Installation des Hollandais à Gorée.
XVIème siècle : Sierra Leone - Au XVIe siècle, la traite négrière commence véritablement. Des Européens, avec la participation des populations côtières, commencent le commerce triangulaire dans le pays, dans des établissements tels Lomboko.
XVIème siècle à l'an 1900 : Tchad - Le royaume du Baguirmi
Le royaume du Baguirmi émergea au sud-est de Kanem-Bornou au XVIe siècle. Il adopta rapidement l'islam et devint un sultanat. Absorbé par le Kanem-Bornou, il recouvra son indépendance au cours du XVIIe siècle, pour être à nouveau annexé au milieu du XVIIIe. Il tomba en déclin au cours des années 1900 et se trouva sous la menace militaire du royaume du Ouaddaï. Il résista, mais accepta la tutelle de son voisin dans l'espoir de mettre fin à des dissensions internes. Lorsque sa capitale brûla en 1893, le sultan demanda et obtint le statut de protectorat auprès des autorités françaises.
Baguirmi subsiste comme chefferie traditionnelle en relation avec les autorités administratives tchadiennes modernes.
XVIème siècle à l'an 1912 : Tchad - Le royaume du Ouaddaï
Le royaume du Ouaddaï émergea au XVIe siècle. Au début du siècle suivant, des clans de la région se rallièrent au sultan AbdelKarim ben Djameh, qui renversa les Tunjur et fit de Ouaddaï un sultanat islamique. Au cours du XVIIIe siècle, le pays résista aux tentatives d'annexion du Darfour et vers 1800, le sultan Sabon (en) commença à étendre son pouvoir. Une nouvelle route commerciale vers le nord fut ouverte et Sabun se mit à frapper sa propre monnaie. Il importa des armes et fit venir des conseillers militaires d'Afrique du Nord. Ses successeurs furent moins habiles que lui, et le Darfour tira parti d'une dispute successorale en 1838 pour placer son propre candidat au pouvoir, Mohammed Sharif. Ce dernier se retourna cependant contre le Darfour et instaura son propre règne, ce qui lui permit de se faire accepter par les différents clans de Ouaddaï. Il étendit l'hégémonie du sultanat sur le royaume de Baguirmi et jusqu'au fleuve Chari, et résista aux colons français jusqu'en 1912.
Ouaddaï subsiste comme chefferie traditionnelle en relation avec les autorités administratives tchadiennes modernes.
XVIème siècle : Tchad - Les autres Royaumes
Le royaume Arna Wadi-Marou
Le royaume après l'arrivée de l'Allemagne s'est divisé en trois parties :
-
Le chef traditionnel du tibesti l'ancien dirdé-kodé et maintenant Handjir Yosko ;
-
Le chef traditionnel du Mourdi maintenant Barkahaï ;
Le royaume moundang de Léré
Le royaume moundang de Léré est un ancien état localisé dans le Sud-Ouest du territoire actuel du Tchad. Il n'existe plus aujourd'hui en tant qu'entité politique indépendante, mais seulement comme chefferie traditionnelle en relation avec les autorités administratives tchadiennes modernes.
Le royaume toupouri de Doré
Le royaume toupouri de Doré est un ancien État localisé sur les territoires actuels du Tchad (principalement) et du Cameroun. Il n'existe plus aujourd'hui en tant qu'entité politique indépendante, mais seulement comme chefferie traditionnelle en relation avec les autorités administratives tchadiennes modernes.
Le royaume Kenga d'Abtouyour
XVIème siècle : Zambie - À partir du XVIe siècle, le pays se scinde en de multiples royaumes sous l'influence des Bembas et des Lozis. Liés aux esclavagistes arabes, les Bembas fondent un empire sur une zone allant du Congo actuel au lac Tanganyika. Ils participent à la traite des Noirs, principalement au profit des sultans de Zanzibar.
XVIème siècle : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Le début du XVIe siècle voit l'arrivée des Portugais qui investissent le plateau rhodésien par la vallée du Zambèze.
an 1500 : Kenya - Enfin, à partir de 1500 apr. J.-C. arrivèrent les peuples de langues nilotiques venus du nord-ouest.
an 1500 : Magreb : Commencement de la domination des Chérifs. Les fondements en sont jetés par HASSAN et ses fils, devenus célèbres, parmi les tribus d'Arabes errants, par leur zèle pour la foi musulmane.
an 1500 : Madagascar - Dès le milieu du premier millénaire jusqu'à 1500 environ, les Vazimba de l'intérieur autant que les Vezo des côtes accueillirent de nouveaux clans immigrants, connus en malgache par les noms d'origine austronésienne Vahiny ou Vazahas (*va-hiny "les visiteurs", *va-zaha-"ceux qui visitent/cherchent") : moyen-orientaux (Perses Shirazis, Arabes Sabatéens ou Omanais, Juifs mizrahim), est-africains (Bantous) et orientaux (Indiens Gujaratis ou Mahalayams, Javanais, Bugis et autres Malais) qui s'intégrèrent et s'acculturèrent aux sociétés Vézo et Vazimba.
Le commerce des esclaves par les Malayo-javanais, les Perses Shirazi et les Arabes Omanais à la fin du premier millénaire fut probablement une des causes de ces nouvelles immigrations, les marchands esclavagistes s'installant à proximité de leurs sources d'approvisionnement malgaches. On trouve en effet, d'une part, mention de la présence d'esclaves africains (zenj ou zandj) offerts par des Javanais à la cour de Chine au début du IXe siècle, et de l'autre, Madagascar même commença à connaître une africanisation de sa population. Cette présence africaine dans l'île ne semble cependant devenir massive qu'à partir du IXe siècle, sous la pression du commerce musulman arabo-perse.
Avec l'arrivée de l'islam, en effet, les commerçants perses et arabes supplantent rapidement les Indonésiens des côtes africaines et étendent par la suite leur contrôle sur les îles Comores et certaines parties des côtes nord de Madagascar. Parallèlement, sous la concurrence conjointe des nouvelles puissances maritimes chinoises (Song) et sud-indiennes (Chola), les thalassocraties indonésiennes connaissent un déclin rapide, même si les Portugais trouvent encore des marins javanais à Madagascar lorsqu'ils y abordent au XVIe siècle.
Le brassage avec les pasteurs-agriculteurs est-africains du Moyen Âge (autour de l'an 1000) explique les nombreux superstrats bantus-swahili dans la langue proto-austronésienne (proto-SEB plus précisément) initiale des Vazimbas. Ces superstrats sont notablement présents dans le vocabulaire domestique et agraire (exemples : le bœuf omby du swahili ng'ombe, l'oignon tongolo du bantou tungulu, la marmite malgache nongo de nyungu en swahili).
Les clans néo-austronésiens (Malais, Javanais, Bugis et Orang Laut), quant à eux, sont historiquement et globalement (sans distinction de leur île d'origine) dénommés Hova (de uwa, « homme du peuple, roturier » en vieux bugis). Selon les traditions orales, ils auraient débarqué au Nord et à l'Est de Madagascar. Les emprunts au vieux malais sanskritisé, au vieux javanais sanskritisé et vieux bugi du Moyen Âge dans le fonds de vocabulaire proto-austronésien (proto-SEB) originel, montrent que les premières vagues hova sont arrivées au VIIIe siècle au plus tôt
Diplomates, officiers, savants, commerçants ou simples soldats, certains alliés aux marins Orang Laut ou Talaut (Antalaotra en malgache), ces Hova étaient probablement issus des thalassocraties indonésiennes. Leurs chefs, connus sous le nom des diana ou andriana ou raondriana (de (ra)hadyan-"seigneur" en vieux javanais, aujourd'hui raden et qu'on retrouve également encore dans le titre de noblesse andi(an) chez les Bugis), se sont, pour la plupart, alliés aux clans vazimba :
* au Nord Ouest dans la région de l'actuel Ankoala (du malais/de l'indonésien kuala-"estuaire") où les hova Orang Laut (Antalaotra en malgache) avaient probablement établi leur base pour les actions dans l'océan Indien.
* sur la côte Est (Betsimisaraka) où les chefs hova étaient également appelés Filo(ha) be par les clans "néo-Vezo".
* au Sud-Est où les chefs ("diana") des clans hova Zafiraminia et Zafikazimambo alliés aux clans "néo-Vezo" d'alors y fondèrent les royaumes Antaisaka, Antaimoro, Antambahoaka, etc.
* à l'Ouest : la dynastie Maroserana(na) qui fonda le royaume Sakalava est elle-même issue des Zafiraminia de la côte Est.
* au Centre où les alliances répétées des chefs (andriana) des clans hova (Andrianerinerina, Andriantomara et leurs descendants notamment) avec les chefs des clans vazimba (Rafandrana et ses descendants notamment) furent à l'origine du Royaume Merina et Betsileo.
an 1500 - 1817 : Madagascar - Royaumes de Madagascar (1500-1817)
Les immigrés étaient minoritaires en nombre, cependant leurs apports culturels, politiques et technologiques à l'ancien monde Vazimba et Vezo modifièrent substantiellement leur société et sera à l'origine des grands bouleversements du XVIe qui conduiront à l'époque féodale malgache.
Sur les côtes, l'intégration des nouveaux immigrés orientaux, moyen orientaux, est-africains (Bantus) et européens (Portugais) donnèrent naissance aux grands royaumes Antakarana, Boina, Menabe et Vezo (Côte Ouest), Mahafaly et Tandroy (Sud), Antesaka, Antambahoaka, Antemoro, Antanala, Betsimisaraka (Côte Est).
À l'intérieur des terres, les luttes pour l'hégémonie entre les différents clans néo-Vazimba des hauts plateaux centraux (que les autres clans néo-Vezo des côtes appelaient les Hova) aboutirent à la naissance des grands royaumes Merina, Betsileo, Bezanozano, Sihanaka, Tsimihety et Bara.
La naissance de ces clans, ethnies et royaumes néo-Vezo" et néo-Vazimba modifièrent essentiellement la structure politique de l'ancien monde des Ntaolo, mais la grande majorité des autres catégories demeurèrent intactes au sein de ces nouveaux royaumes : la langue commune, les coutumes, les traditions, le sacré, l'économie, l'art des anciens demeurèrent préservées dans leur grande majorité, avec des variations de formes selon les régions.
Parmi les royaumes centraux, les plus importants étaient, au sud, le royaume Betsileo et, au nord, le royaume Merina. Ces derniers sont définitivement unifiés au début du XIXe siècle par Andrianampoinimerina. Radama Ier (régnant de 1810-1828), son fils et successeur ouvre son pays à l’influence européenne exercée principalement par les britanniques. Grâce à leur soutien, il étend son autorité sur la majeure partie de l’île. C’est ainsi qu’à partir de 1817, les royaumes centraux merina, betsileo, bezanozano et sihanaka unifiés par Radama I deviennent pour le monde extérieur, le royaume de Madagascar.
Première découverte de l'île par des Européens (1500-1817)
En 1500, les Portugais sous la conduite de Diogo Dias, sont les premiers Européens qui découvrent l’île, qu'ils appellent l'île São Lourenço. Mais c’est surtout à partir du XVIIe siècle que la présence européenne affecte de manière décisive le destin de l’île par l’introduction massive des armes à feu et le développement de la traite des esclaves. En 1643, les Français y installent la Colonie de Fort-Dauphin. En 1665, Louis XIV tient à faire de Madagascar la base avancée de la Compagnie française des Indes orientales. Il en résulte une augmentation des troubles et la mise en place de royaumes guerriers, fortement liés aux Européens, en particulier des pirates qui s’établissent dans de nombreuses régions. C’est notamment le cas du royaume sakalava, s’étendant sur la majeure partie du littoral occidental de l’île, sous l’égide des rois maroseraña, « aux nombreux ports ». Il en fut également de même sur la côte est de la confédération des Betsimisaraka, fondée au début du XVIIIe siècle par Ratsimilaho dont le père était un pirate anglais.
À la fin du XVIIe siècle aurait existé sur l'île pendant 25 ans une colonie libertaire. Cette république fut fondée par le Français Olivier Misson, pétri d'utopies, ex-officier de marine français, mais pirate de son état, et un prêtre défroqué italien, Carracioli, imprégné de mysticisme. Elle avait pour nom Libertalia, et pour devise « Générosité, Reconnaissance, Justice, Fidélité ».
À la fin du XVIIIe siècle, Maurice Beniowski (1746-1786) aurait créé une ville idéale, Fort Auguste, sur le site actuel du village de Valambahoaka (nord-est). Ceci correspond pour partie au mythe de Libertalia.
an 1500 : Ile Maurice - Dès 1500, les portuguais entreprennent la conquête de tous les comptoirs arabes de la côte africaine de l’océan Indien. Des prises qui se feront par la force.
Ainsi dès le début du XVIe siècle, les Portugais prennent pied aux Mascareignes. Les historiens divergent sur le nom du découvreur et la date de l’événement :
* Diogo Dias en 1500 ;
* Domingos Fernandez en 1511 ;
* Sous réserve de confirmation : Pero Mascahenras en 1512
L’île de la Réunion est nommée Santa Apollonia, l’île Maurice Cirné, nom du navire du capitaine d'expédition Diogo Fernandes Pereira6, et Rodrigues porte le nom de son découvreur Diogo Rodrigues.
Tout comme pour les Arabes, l’île Maurice, inhabitée, ne semble pas beaucoup intéresser les Portugais qui s’en servent uniquement pour y faire escale. Ils ne laissèrent trace de leur passage qu’à travers les noms qu’ils donnèrent à l’archipel et aux îles.
an 1500 : Nigéria - Bien que ces empires existants n’eurent que peu d’influence politique sur le Nigeria avant 1500, leur impact culturel et économique fut considérable et se renforça au XVIe siècle au fur et à mesure que l’islam se répandit. Tout au long du XVIe siècle, la plus grande partie du nord du Nigeria payait un tribut à l’empire Songhaï ou à l’empire Bornou.
an 1501 : Magreb Algérie - À l'Ouest, au mois de juillet 1501, les Portugais lancent une expédition pour tenter d'accoster sur la plage des Andalouses.
an 1501 : Seychelles - Les premiers à visiter l'archipel furent probablement des marchands arabes, mais les premiers comptes rendus écrits furent réalisés en 1501 par l'explorateur portugais Vasco de Gama. Ce dernier donna à l'archipel le nom d'Amirantes (qui désigne au XXIe siècle la partie comprenant les îles granitiques des Seychelles). La même année, pour la première fois, les Seychelles étaient dessinées sur une carte tracée par l'italien Alberto Cantino.
an 1502 : Sainte-Hélène (Île) - Découverte du Volcan
L'île est découverte par le navigateur galicien João de Nova, qui était au service du Portugal, le 21 mai 1502, jour de la fête de sainte Hélène selon l'usage antique et orthodoxe, qui lui vaut son nom.
Quelques aventuriers et esclaves la peuplent. Les voiliers, au cours de leurs longues traversées, y font escale pour renouveler leur provision d'eau douce et de vivres frais, ce qui lui vaut le nom d'« Auberge de l'Océan ».
an 1502 : Seychelles - L’atoll d’Aldabra porte un nom d’origine arabe. C’est « Al Dabaran », étoile de la constellation du Taureau. Les premiers Européens à faire escale aux Seychelles sont les Portugais. Vasco de Gama accoste aux Amirantes en 1502.
Cependant, les navigateurs portugais ne songent pas à s’installer dans l’archipel des Seychelles, car celui-ci est dépourvu des richesses (métaux précieux, ivoire, perles) qu’ils vont chercher en Inde.
an 1502 - 1503 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - L’intermède portugais (1498 – 1729)
En 1502, Vasco de Gama revient dans la région, cette fois-ci à la tête d’une flotte d’une vingtaine de navires bien équipés. Lui et Ruy Lourenco Ravasco menacent les cheiks de Kilwa, Zanzibar et Brava de destructions si un tribut annuel en or n’est pas versé au Roi du Portugal. Les Arabes ne cèdent pas et c’est par la force que les Portugais vont imposer leur domination. Les Portugais n’hésitent pas à faire preuve d’une grande brutalité pour effrayer et mettre au pas les populations locales. Kilwa, la cité la plus au sud, tombe la première en 1502 et est complètement détruite, suivie de Zanzibar en 1503, puis d’autres cités plus au nord (Mombasa, Lamu..). Seule Mogadiscio au nord de la côte échappe aux Portugais. Après une dizaine d’années d’affrontements, qui prennent parfois des accents de guerre sainte entre Chrétienté et Islam, les Portugais peuvent se satisfaire d’avoir pris le contrôle de la plus grande partie de la bande côtière et des îles, mettant la main sur les routes maritimes avec l’Inde et l’orient et sur le commerce de l’or qui les intéresse tant. Zanzibar est alors le principal entrepôt commercial de l’Afrique orientale.
an 1504 : Réunion (Ile de la) - Après les Portugais, les Anglais et les Hollandais, les Français s'engagent dans l'entreprise coloniale. Ils « découvrent » les îles et s'y installent, utilisant la main-d'œuvre esclave, achetée principalement en Afrique et à Madagascar…
1504 : le premier navigateur européen à avoir croisé au large de La Réunion est le Portugais Diogo Fernandes Pereira. Il lui donne le nom de Santa Apollonia.
an 1505-1509 : Algérie - Au début du XVIe siècle, l'Espagne entreprend la conquête des ports algériens. Mers el-Kébir tombe en 1505, suivi par Oran en 1509. La prise de la ville par le cardinal Francisco Jiménez de Cisneros est suivie par le massacre des populations, la fuite des habitants, la razzia des tribus voisines et la conversion de deux mosquées en églises.
En 1508, Pedro Navarro ravage Honaïne et Rachgoun, et prend Béjaïa en 1510. Les habitants de Béjaïa fuient l'occupation espagnole pour échapper aux atrocités telles que celles commises à Oran et se réfugient dans l'arrière-pays ; une partie d'entre eux s'installe dans la Kalâa des Beni Abbès.
Sous la menace espagnole, d'autres villes payent un lourd tribut : Dellys, Cherchell et Mostaganem ; Alger livre l'îlot qui contrôle son port : le Peñón d'Alger. Le roi de Tlemcen reconnaît la suzeraineté de Ferdinand le Catholique, et les Hafsides chargent les maîtres de la Kalâa des Beni Abbès et de Koukou de défendre l'intérieur du pays. Le mécontentement des habitants devant l'incapacité de leurs chefs à le faire engendre l'émergence des mouvements soufis dont les chefs prennent un poids politique et aideront les frères Barberousse.
Cette période voit l'émergence d'une littérature qui exhorte à la résistance, dénonce les traitres et fait appel aux Turcs, vus comme la seule force capable de mener une résistance cohérente et unifiée. Les chefs marabouts font appel aux corsaires ottomans pour écarter la menace espagnole. Khayr ad-Din Barberousse, chargé d'unifier et d'organiser la résistance, mobilise les tribus et parcourt le pays notamment en Kabylie, où il recrute la légendaire Lalla Khedidja. Parmi les autres figures de la résistance, Sidi Ahmed Benyoucef, le saint patron de Miliana et Lalla Gouraya, la sainte patronne de Béjaïa.
an 1506 : Angola - Au nord de l'Angola, aux tous débuts de l'Empire colonial portugais, une guerre civile entre africains du Kongo pro et anti-Portugais éclate en 1506 et se termine avec la victoire des premiers. Le royaume Kongo est alors à son apogée et compte environ quatre millions d'habitants et est donc plus peuplé que le Portugal (un million et demi). Pour réussir cette guerre, les Portugais apprennent aux Bakongos à fabriquer et utiliser des arquebuses et des mousquets à mèches. Le fleuve que les Bakongos appellent Nzadi ou Nzere donne Zaïre en portugais.
Les relations entre Portugais et Kongos d'abord égalitaires — échange d'ivoire contre armes à feu — tournent à une mainmise des Portugais qui, désireux de s'approprier les mines d'or à la fin du XVe siècle, puis au cours des siècles suivants de se procurer des esclaves pour leurs colonies du Brésil, vont par la suite recourir à la force. Les Portugais poussent plus tard les Bakongos à faire la guerre contre les ethnies voisines afin de capturer des esclaves et les échanger contre des produits manufacturés.
an 1506-1521 : Archipel des Comores - En 1506, une flotte chirazienne commandée par Mohamed ben Haïssa aborde l’archipel et en bouleverse la vie économique et sociale. Dès lors, des manuscrits en caractères arabes, notent l'arabe, le comorien ou le swahili, et permettent de reconstituer les généalogies des clans et des sultanats, au demeurant particulièrement complexes. Par la subjugation et par le jeu d'alliances, ils contribuent ainsi à l'établissement de nouveaux lignages matrimoniaux, surtout à la Grande Comore et à l’île d’Anjouan. L'installation des sultanats chiraziens contribue à l'adoption puis à la généralisation de la doctrine chafiite aux Comores comme en témoigne la description de l'archipel par l'amiral turc Piri Reis en 1521.
an 1507 : Mayotte -
Les sultans : Attoumani ibn Ahmed (ou Uthman ibn Ahmed) - seconde moitié du XVe siècle
Mohamed ibn Hassan dit Mchindra « le vainqueur »
La découverte de l'île de Mayotte : Lorsqu'une flotte portugaise baptise l'île de Mayotte, en janvier 1507, l'île du Saint Esprit, en référence à l'un des navires de l'escadre, cela fait plus de six siècles que cette île est connue et fréquentée par des navigateurs arabes. Déjà au XVe siècle, Ibn Majid signale l'île de « Maouta » alors que l'archipel d'Al Qomor est décrit au XIIe siècle par Al Idrisi.
an 1507-1510 : Mozambique - Colonisation portugaise (1498-1975)
L'implantation portugaise commence dès le début du XVIe siècle, par la capture de la petite île de Moçambique en 1507, lors de la deuxième expédition de Vasco de Gama, et la construction en 1510 d’un fort carré et d’une ville, São Sebastião de Moçambique, qui sont placés sous l'autorité du vice-roi des Indes résidant à Goa.
Les Portugais se livrent à de très rentables trafics d’ivoire et développent la traite des Noirs. L'esclavage n'était pas connu dans cette partie de l'Afrique australe avant cette colonisation européenne (à la différence des régions plus au nord ou de Madagascar ou Zanzibar), comme en témoigne Henry Francis Fynn. Cet esclavage est introduit par les colonisateurs portugais, qui achètent des hommes et des femmes pour les revendre vers la traite orientale ou la traite atlantique.
an 1510-1577 : Libye - Tripoli, prospère et indépendante, est vulnérable aux deux puissances hégémonies rivales qui s'affirment en Méditerranée, la Monarchie espagnole et l'Empire ottoman. En 1510, Pedro Navarro prend Tripoli. Mais les Espagnols ne parviennent pas à s'assurer une maîtrise complète de la région et, en 1530, Charles Quint cède Tripoli et Malte à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Jugeant leur possession libyenne trop fragile, les Chevaliers de l'Ordre préfèrent installer le gros de leurs forces à Malte et, en 1551, Tripoli tombe aux mains des Ottomans, qui y établissent la régence de Tripoli. Le Fezzan est quant à lui soumis par les Ottomans en 1577. Le gouvernement de la Régence est confié à un pacha, assisté d'un conseil de gouvernement, ou divan.
Malgré les efforts de certains pachas qui parviennent à imposer une certaine stabilité gouvernementale, l'autorité ottomane reste largement nominale en dehors de Tripoli : le territoire de la Régence demeure dominé par les tribus, qui agissent de manière autonome, et marqué par un mode de vie rural et nomade.
an 1513 : Réunion (Ile de la) - Pedro de Mascarenhas passant au large de l'archipel formé par La Réunion, Maurice et Rodrigues lui donne son nom : Mascarenhas qui deviendra en français Mascareignes.
an 1516-1518 : Algérie - Au début du XVIe siècle, le Maghreb central connait une décadence, une fragmentation politique et une offensive espagnole. Les Espagnols occupent plusieurs villes côtières et imposent à d’autres de payer un lourd tribut.
L'oligarchie citadine commerçante d'Alger désigne le chef de la tribu arabe des Tha'alibi, Salim at-Toumi, émir de la ville. Il sera favorable à un compromis avec les Espagnols. Sur un des îlots qui font face à Alger, les Espagnols construisent une forteresse : le Peñon d’Alger, qui menace la ville. Les Algérois, séduits par la protection dont bénéficiaient les habitants de Jijel et excités par les anciennes antipathies des monarchistes, font appel aux frères Barberousse. Ces derniers s’étaient distingués par l’aide fournie aux musulmans andalous.
En 1516, Arudj Barberousse se proclame sultan d'Alger et repousse une attaque espagnole. Il s'empare ensuite de Ténès, Miliana, et Médéa. Il organise l'administration de la ville et poursuit la lutte contre les Espagnols et leur principal vassal, le roi de Tlemcen. En 1517, il confie le gouvernement à son frère Khayr ad-Din, et se lance dans la conquête de l'ouest. Mais cette tentative échoue, il est défait et tué par les Espagnols à Rio Salado (El Malah) en 1518.
an 1517 à 1798 : Égypte - Période ottomane (1517 à 1798)
À la bataille de Ridaniya, le 22 janvier 1517, les troupes de l'empereur ottoman Sélim Ier l'emportent sur les Mamelouks et mettent fin à leur domination. L'Égypte devient pour plusieurs siècles une province ottomane35. Jusqu'en 1798, elle est gouvernée par des pachas désignés par le gouvernement de Constantinople, mais l'armée et l'administration sont dominés par les élites locales constituées des mamelouks et des janissaires qui se disputent le pouvoir et influent tour à tour sur les nominations de pachas.
1517-1543 : Somalie - L'Empire ottoman devient progressivement au XVe siècle la principale puissance islamique, succédant notamment au Moyen-Orient au Sultanat mamelouk d'Égypte. En 1517, Sélim Ier, à la tête de cet empire nottoman, conquiert l’Égypte et prend ainsi pied en Afrique. Soliman le Magnifique, son fils, entreprend une série d'expéditions sur les bords de l'océan Indien et de la Mer Rouge, pour arrêter l'expansion portugaise et placer les terres musulmanes sous son protectorat : en 1538, il s'empare d'Aden, et en 1557 du port de Massaoua, fondant la province ottomane d'Abyssinie.
Vers 1527, mené par le charismatique imam Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi, l'Adal se révolte et envahit l’Éthiopie avec le soutien de l’Empire ottoman12. Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi mène un djihad à la tête de musulmans somaliens et éthiopiens mais aussi de soldats venus de la péninsuleArabique et conquiert rapidement la moitié de l’Éthiopie jusqu’au Tigré. Les événements sont relatés par l’expédition portugaise de Christophe de Gama, fils de Vasco de Gama, qui se trouve alors dans la région. Les Portugais décident de soutenir l’Éthiopie chrétienne, en difficulté12. Les troupes chrétiennes alliés aux Portugais parviennent à mettre fin au djihad, et à reprendre le contrôle d'une grande partie de leur terres. Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi est battu le 21 février 1543 à la bataille de Wayna Daga, et y trouve la mort. Mais dans le territoire éthiopien dévasté par ce conflit, des Oromos s'installent, profitant de la faiblesse de l'empire éthiopien.
La veuve de Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi épouse Nur ibn Mujahid en échange de sa promesse de venger le roi défunt. Mujahid monte sur le trône et poursuit les hostilités contre ses ennemis du Nord jusqu’à sa mort en 1567. Entretemps, le Portugal tente de s'implanter en menant des opérations sur terre et sur mer, confronté directement à l'Empire ottoman ou à des sultanats qui se placent sous le protectorat de l'Empire ottoman . Le sultanat d'Adal éclate en une multitude d’États indépendants, dont beaucoup avec un chef somali à leur tête. Zeilah devient dépendant du Yémen et est incorporé à l’empire ottoman.
Au sud du territoire somalien, le sultanat Ajuran se désintègre lui-aussi à la fin du XVIIe siècle, sous les attaques portugaises, les dissensions internes et les intrusions des tribus nomades du nord. Plus d’un siècle est nécessaire à l’émergence d’un nouvel état, le Sultanat Geledi, autour de la ville d’Afgooye. Entretemps, le sultanat d'Oman repousse les Portugais hors de Somalie, pour prendre le contrôle de la côte de Benadir, et impose un tribut au villes somaliennes contre sa protection.
an 1519-1533 : Algérie - Son frère Khayr ad-Din Barberousse lui succède. Sentant le danger à l'ouest, il sollicite l'appui de l'Empire ottoman, et demande au sultan de Constantinople Sélim Ier de reconnaitre son pouvoir et de lui accorder la tutelle d'Alger. Ayant prêté hommage au sultan-calife, il devient le premier dirigeant de la régence ottomane d'Alger en 1519, ce qui sera officialisé en 1520. Il sera nommé beylerbey en 1533. Fort de l'aide militaire ottomane, il cherche à regrouper le Maghreb central sous son autorité, commençant par la Kabylie où il se heurte au roi de Koukou, puis il conquiert le Constantinois et déloge les Espagnols du Peñon d'Alger.
1521 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Dès 1521, le sol appauvri de Madère ne fournit plus de production de canne à sucre satisfaisante pour l'exportation. De nombreuses exploitations sucrières se réorientent vers la viticulture, à partir de cépages originaires de Chypre, de Crète et de Sicile.
an 1521 - 1527 : Mayotte - D'après les archives de l'amirauté portugaise, Mayotte est cartographiée par Diego Ribeiro en 1527. Il semble que les premiers Européens à en fouler le sol soient l'équipage de la flotte de Baltazar Lobo da Susa, en 1557, puisqu'il est le premier a nous en livrer une description précise sur ses habitants. Cependant, les récifs de corail de Mayotte représentent un danger mortel pour les bateaux : c'est pourquoi jusqu'au XVIIIe siècle, l'île n'est pas un lieu d'escale ordinaire pour les grandes flottes et n'accueille que quelques grands navires européens venus s'y ravitailler par nécessité. Mais chaque description qu'elle fournit par ces relations de voyages sont très précieuses en l'absence de sources historiques directes comoriennes. Les seuls bateaux pouvant accoster sans risque à Mayotte étaient les navires souples typiques de la culture swahilie appelés « Mtepe », qui ne craignaient pas les récifs ou bancs de sable et pouvaient s'échouer sans risque directement sur les plages, sans besoin de port.
En 1521, l'amiral et cartographe ottoman Piri Reis visite Mayotte. Il la décrit en ces termes dans son Kitab-i Bahrije :
« La seconde île est nommée Magota. On dit que les Portugais y ont mis des hommes. Elle a un Chah. Sa population est noire et blanche. Ils sont chafi'i, parmi eux point d'hypocrisie. Elle a une ville nommée Chin Kuni [Tsingoni]. N'y règnent que des cheikhs.»
À partir du XVIIe siècle, les navigateurs européens recommandent aux navires en route pour les Indes de faire une pause atlantique au Cap-Vert au printemps et une pause indienne aux Comores en septembre, afin de profiter au mieux des courants de mousson, ce qui fait de l'archipel une place commerçante majeure de cette partie du monde.
an 1526-1629 : Angola - La conquête du cours du fleuve Kwenza lance l'histoire de l'Angola colonial. Cette conquête est motivée dans un premier temps par la recherche de métaux précieux par les Portugais, même si elle va s'avérer infructueuse. La volonté des Portugais est de s'approprier les importantes mines d'argent qu'ils pensent trouver en remontant vers les sources du fleuve.
Balthasar de Castro évoque, en 1526, ces célèbres mines d'argent de Cambambe, recherchées depuis 1520 mais les Portugais espèrent aussi rejoindre l'Empire du Monomotapa et son or, acheminé par Sofala, au sud du delta du Zambèze, vers les commerçants indiens et leurs textiles du Gujarat.
Les Portugais visent cet Empire dès 1505, par les côtes du Mozambique, mais restent confinés sur le littoral jusqu'en 1513. Les commerçants portugais seront les premiers Européens à parcourir les ruines du Grand Zimbabwe, qu'un explorateur européen décrira ainsi en 1531:
« À proximité des mines d'or de l'intérieur, entre la Limpopo et le Zambèze, il existe une forteresse de pierre d'une taille extraordinaire, sans qu'il semble que du mortier ait été utilisé. »
Viçente Pegado, capitaine, garnison portugaise de Sofala, 1531
Mais il faudra attendre 1629 pour qu'ils atteignent cet Empire du Monomotapa, trop tard car l'épuisement de l'or des rivières est réel, après un apogée atteint dès les années 1440. Aux deux tiers du XVIe siècle, les projets de colonisation du fleuve Kwenza et du Grand Zimbabwe se conjuguent : des missionnaires jésuites sont envoyés au Mozambique en même temps qu'à la nouvelle implantation de Luanda, pour rejoindre les mines d'or que la tradition orale attribue à l'Empire du Monomotapa, depuis la côte de l'océan Indien.
En 1567, le comptoir de Luanda est ébauché, sur une île de l'embouchure du Kwenza, à 300 km au sud de l'embouchure du fleuve Congo, épicentre du Royaume du Kongo. En 1575, la Couronne portugaise accorde à Paulo Dias de Novais une charte pour bâtir trois forts entre le Bengo et le Kwenza, fleuve au sud du Congo, navigable jusqu'à 200 km dans l'intérieur. Pendant trois ans, accompagné de 350 à 700 trafiquants, cordonniers et tailleurs, selon les sources, il vit en paix avec le roi d'Angola, puis il reçoit, de 1578 à 1587, cinq renforts successifs en hommes et matériel. Quand le roi d'Angola fait tuer trente Portugais en 1580 et saisit leurs marchandises, ces derniers renoncent à s'emparer des mines pacifiquement et décident de « les passer tous au fil de l'épée »
an 1 527 à 1 543 : Éthiopie - Les guerres d'Ahmed Gragne (1527-1543)
De 1528 et 1540 une armée musulmane dirigée par l'imam Ahmed ben Ibrahim al-Ghasi, dit Ahmed Gragne, « le gaucher », pénètre l'Éthiopie du sud au sud-est du pays. Ahmed, originaire du Harar (voir Histoire de la Somalie) a réussi essentiellement à unir les peuples de l'Ogaden, et s'est doté d'une cavalerie d'Afars, d'Hararis et de Somalis qu'il se lance dans ses conquêtes.
Le 18 mars 1528, Gran remporte la bataille de Chimberra Couré. En deux ans, il contrôle les trois quarts du pays. Après cinq années, devenu sultan de Harar, il achève la conquête de l'Abyssinie, à l'exception de quelques régions montagneuses où s'est réfugié le Negusse Negest.
Dawit II lance, dans ces conditions, un appel à l'intention des Portugais. Jean Bermudes, un des membres de la mission de 1520 demeuré en Éthiopie après le départ de l'ambassade, est envoyé à Lisbonne. Une armée de 600 soldats dirigée par Christophe de Gama débarque en Éthiopie en 1541 et rejoint les troupes éthiopiennes.
Les premières confrontations en 1542 sont victorieuses, mais le 28 août 1542, à la bataille de Wofla, Ahmed Gran, soutenu par les Turcs, remporte la victoire. Christophe de Gama est capturé et décapité. Le 21 février 1543, s'engage la bataille de Wayna Daga à Zantara, Ahmed Gran y trouve la mort arquebusé par le portugais Pédro Léon. Berhanou Abebe, historien éthiopien, écrit notamment à propos de cette période : « Ainsi prend fin le deuxième cycle des grandes migrations que l'on a souvent interprétées comme un affrontement islamo-chrétien. De part et d'autre, les chroniques du temps sont l'œuvre des clercs et des lettrés, frottés de religion. Ils tendent à imposer le schéma explicatif de leur idéologie, alors qu'en vérité, le motif le plus fort qui aura prévalu dans le conflit larvé entre deux systèmes complémentaires (production-circulation) est essentiellement économique ».
Au cours de ces évènements, un désaccord commence à apparaître entre le Negusse Negest et Jean Bermudes du Portugal. Celui-ci exige au nom de l'alliance ethio-portugaise, la conversion du Negusse Negest au catholicisme. Le Negusse Negest refuse, et Bermudes est chassé du pays.
an 1530 : Mayotte -
Les sultans : ‘Issa (ou Ali ) ibn Mohamed - vers 1530 - fin XVIe siècle
an 1534 : Tunisie - La Tunisie sous la souveraineté turque
En 1534, le corsaire Khayr ad-Din Barberousse, travaillant pour les Turcs ottomans, s'empare de Tunis. Il en est chassé par une intervention militaire des Espagnols réclamée par le souverain tunisien. Les Turcs s'installent définitivement à Tunis en 1574. L'administration mise en place par les Turcs comprend un pacha qui représente le sultan turc, à ses côtés il y a un bey qui commande la garnison des janissaires et un dey qui dirige la collecte des impôts. Après bien des luttes d'influence c'est le bey qui s'impose en 1705. Il va gouverner la Tunisie sous la suzeraineté théorique et lointaine du sultan turc d'Istambul.
Les Tunisiens tirent une grande part de leurs revenus de la guerre de course contre les navires chrétiens. Les interventions militaires françaises de 1665 et 1672 ne parviennent pas à réduire cette activité. Ce n'est qu'en 1819, que le bey renonce à la piraterie.
an 1538 : Archipel des Comores - La mosquée chirazie de Tsingoni à Mayotte, longtemps interprétée comme la plus ancienne, date en réalité de 1538 comme en témoigne l'inscription conservée dans son mihrab.
Cependant, le caractère élitiste de l'islam aux Comores et l'existence d'une écrasante majorité d'esclaves dans la population expliquent la faible diffusion de l'islam dans les sociétés comoriennes jusqu'au XIXe siècle. On comprendra pourquoi les mosquées, notamment les mosquées royales chirazies, sont faites pour abriter un petit nombre de fidèles. L'abolition de l'esclavage et le succès des confréries à partir de la fin du XIXe siècle expliquent la large conversion des comoriens à l'islam à cette date.
Durant cette époque, le pouvoir est aux mains des nombreux sultans locaux dit batailleurs, du fait de la rivalité entre sultanats et des nombreux conflits qui en ont découlé. Finalement Anjouan, qu'on dit la plus arabe des îles, finit par prendre contrôle, peu ou prou, de Mohéli, et tentera régulièrement d'étendre son pouvoir sur Mayotte jusqu'au XIXe siècle.
an 1541 : Algérie - Au XVIe siècle, alors que la Berbérie est le théâtre d'une lutte intense entre Espagnols et Ottomans, ces derniers s’appuient sur les corsaires au pouvoir à Alger. L'autorité des beylerbeys s’étend sur les régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli. Dans la hiérarchie ottomane, les trois beylerbeys d'Anatolie, de Roumélie et d'El-Djazaïr viennent directement après le Sultan, et l'autorité de celui d'El-Djazaïr est absolue. Hassan Agha, qui succède à Khayr ad-Din Barberousse, triomphe de Charles Quint lors de l'attaque d'Alger en 1541 et recueille un prestige énorme auprès des populations. Les beylerbeys les plus importants seront Hassan Pacha, fils de Barberousse, Salah Raïs et Uludj Ali.
an 1545 : Mozambique - Colonisation portugaise (1498-1975)
En 1544, Lourenço Marques explore les côtes continentales, et d'autres comptoirs sont créés.
an 1550 - 1604 : Canaries (Îles des) - Âge d'or de la piraterie, Liste de corsaires, Piraterie aux îles Canaries
L'archipel des Canaries, avec quelques grands ports maritimes, est un très important carrefour de grandes routes commerciales pour les voiliers entre l'Europe et l'Amérique pendant environ 300 ans. Cela rend l'archipel attractif pour les pirates.
Réorganisation de la défense
Vers 1550, la défense des îles royales est confiée à leurs gouverneurs respectifs, et celle des îles seigneuriales aux seigneurs juridictionnels, qui disposent chacun de leurs propres milices locales.
La Capitainerie générale des Canaries est établie en 1589, au début de la guerre anglo-espagnole (1585-1604).
Attaques de corsaires français (1553 et 1571)
Dès 1553, le corsaire français François Le Clerc (sd-1563) réussit à piller Santa Cruz de La Palma. Un an plus tard, le militaire français Nicolas Durand de Villegagnon (1510-1571), qui cherche à répéter le pillage, échoue. Jacques de Sores (sd-sd), également français, attaque également La Palma en 1570.
En 1571, Saint-Sébastien de la Gomera est rasée par Jean Capdeville. Au fil des siècles, des forteresses sont construites sur certaines îles pour se protéger des pirates, comme le Castillo de San Gabriel près d'Arrecife à Lanzarote. La dernière attaque massive de pirates algériens a lieu en 1618, au cours de laquelle de nombreux habitants sont enlevés de la Cueva de los Verdes et vendus comme esclaves.
Amaro Rodríguez Felipe, le "bon" corsaire canarien.
Les pirates barbaresques (à partir de 1568)
Les villes et villages côtiers d'Espagne, d'Italie et des îles méditerranéennes sont à l'époque sous la menace régulière des barbaresques nord-africains : Formentera (Baléares) est abandonnée pour un temps par ses habitants, ainsi que de larges portions des côtes espagnoles et italiennes. En 1514, 1515 et 1521, les îles Baléares sont attaquées par le célèbre corsaire ottoman Khayr ad-Din Barberousse (1466-1546) : les populations capturées pendant les 16e siècle et 17e siècle sont généralement revendues comme esclaves (traite dite arabe).
Après avoir détruit Arrecife (Lanzarote), le pirate Murat Rais (1534-1609) pille la ville de Teguise (Lanzarote) en 1568, et tue ou réduit en esclavage beaucoup de ses habitants. Une plaque commémorative dans la rue Callejon de Sangre (« ruelle du sang ») rappelle cette tragédie.
Ces attaques durent jusqu'en 1618, année durant laquelle des « Berbères » réduisent à nouveau la ville en cendres.
Le fort Castillo de Santa Bárbara de Téguise (es), édifié sur le volcan Guanapay (435 m) et devant servir de protection contre ces attaques, s'avère bien insuffisant. La ville subit une vingtaine de raids en trois siècles.
Attaque de l'amiral Van der Does pour les Provinces-Unies (1599)
En 1599, au cours de la guerre de Quatre-Vingts Ans (1568-1648), une flotte de plus de 70 navires des Provinces-Unies, arrivée au large de la Grande Canarie sous le commandement de l'amiral Pieter van der Does (1562-1599), parvient à débarquer et à prendre Las Palmas pour quelques jours, mais échoue à pénétrer à l'intérieur de l'île en raison de la stratégie de défense des défenseurs canariens.
Une précédente attaque contre San Sebastián de la Gomera s'est également soldée par une défaite pour Pieter van der Does.
En 1599, il poursuit la navigation vers l'île de São Tomé, où il semble avoir trouvé la mort, peut-être à la suite de blessures reçues à Las Palmas.
an 1550 : Namibie - Les immigrations khoisans et bantoues
Vers 1550, originaires de la région des grands lacs ou de l'Afrique orientale, les peuples bantous (Ovambos, Kavangos et Héréros) arrivent dans le nord de l'actuelle Namibie. Ils vont constituer la majorité du peuple namibien (75 % de la population namibienne à la fin du XXe siècle). Lors de leurs installations, ces premiers groupes bantous se confrontent aux Sans qui parviennent à les soumettre à leur autorité durant à peu près une centaine d'années. Le nombre sans cesse croissant de Bantous met cependant un terme à la domination des San qui sont progressivement défaits, dispersés ou asservis. De ces groupes bantous, les Ovambos deviendront la population la plus importante, constituant même la moitié de la population namibienne à la fin du XXe siècle6. Établis principalement dans le Nord, les Ovambos se consacrent principalement à l'agriculture. Arrivés par le nord-est, ils auraient séjourné autour de l'Okavango avant d'être chassés par les pressions exercées notamment par le Royaume Lunda du Katanga et de se disperser entre les actuels territoires namibiens et angolais. Dans le courant du XVIIIe siècle, les tribus ovambos se constituent en royaume. Les guerres deviendront incessantes entre les royaumes tribaux que ce soit pour des raisons économiques ou dynastiques. Les vaincus sont parfois réduits en esclavage, alimentant le large trafic qui sévit jusqu'au XIXe siècle dans cette région de l'Afrique.
Les Héréros (ce qui signifie « résolus » ou « impétueux ») se consacrent pour leur part à l'élevage. Originaires également de la région des grands lacs, leurs caractéristiques ethniques, culturelles et sociales évoquent celles des nomades de la Corne de l'Afrique. Convertis au matriarcat après leur installation dans le sud-ouest de l'Afrique australe, ils seraient arrivés en remontant le fleuve Zambèze dans les plaines du nord du lac salé d'Etosha, en même temps que les Ovambos, avant de s'établir parmi les Tswanas puis de s'éparpiller jusque dans l'actuelle Angola. Refoulés par les Ovambos, ils s'installent finalement dans les régions montagneuses du Kaokoveld.
D'autres minorités bantoues s'installent progressivement dans l'actuelle Namibie, notamment après avoir longé l'Okavango tels les Kavango (9,7 % de la population à la fin du XXe siècle) ou les Tswanas.
1552 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Madère compte 30 000 habitants, dont environ 3000 esclaves.
an 1554-1659 : Maroc - Dynastie saadienne (1554-1659)
Les Saadiens, appelés parfois Zaydanides, constituent une dynastie originaire de la vallée du Draâ. Elle arrive au pouvoir en 1511 avec le sultan Muhammad al-Mahdi al-Qaim bi-Amr Allah et choisit Marrakech pour capitale définitive après Taroudant. À partir de 1549 elle contrôle entièrement le Maroc et entreprend même son extension en Oranie en direction de Tlemcen et de Mostaganem, alors que le Maghreb central et oriental est sous la domination des Ottomans. Mohammed ech-Cheikh est un adversaire résolu du sultan-calife ottoman Soliman le Magnifique. Pour conjurer la menace exercée par les gouverneurs turcs d’Alger, le sultan saadien n’hésite pas à chercher l’alliance des Espagnols qui occupent Oran et lui permettent de s’emparer de Tlemcen.
Cependant en 1554, les troupes turques de Salah Raïs bousculent le dispositif saadien établi autour de Tlemcen, et poussent l'offensive jusqu'à Fès avec l'intention d'occuper la moitié nord du Maroc, correspondant au royaume de Fès, et de l'incorporer à l'Empire ottoman. Alors que l'armée commandée par le pacha d'Alger s'apprête à pénétrer dans la vallée du Sebou, une sortie des forces espagnoles du comte d'Alcaudete, gouverneur d'Oran, oblige les Ottomans à évacuer précipitamment leur éphémère conquête marocaine et à revenir défendre l'Ouest algérien menacé par les Espagnols. Ce retrait turc est profitable aux Saadiens qui récupèrent ainsi Fès et les marches orientales du nord-est marocain. Charles Quint a également évité de voir les Ottomans atteindre la rive sud du détroit de Gibraltar et devenir ainsi des voisins directs de l'Espagne.
L'alliance stratégique hispano-saadienne a montré ainsi son efficacité. Mais la diplomatie pro-espagnole de Mohammed ech-Cheikh lui vaut l’inimitié tenace de la Sublime Porte. En effet, en 1557 des assassins à la solde du beylerbey d’Alger Hassan Pacha décapitent le sultan marocain et envoient sa tête en trophée à Constantinople, où Soliman la fera accrocher sur les murs du Sérail de Topkapı. Ce meurtre n’a cependant pas d’incidence sur le front militaire et consolide même les assises de la dynastie saadienne qui sort victorieuse d'une nouvelle confrontation avec les forces turques à l'issue de la bataille de l'Oued-el-Leben en 1558.
Désignés et légitimés par les confréries mystiques et notamment par les cheikhs de la tariqa Jazoulya fondée par Mohammed Ben Slimane al-Jazouli, les Saadiens doivent réunifier le Maroc en proie aux divisions intestines, et faire face aux ambitions du jeune roi Sébastien Ier de Portugal désireux de mener sa croisade personnelle en Afrique du Nord contre les musulmans. Le 4 août 1578 à Ksar El Kébir (bataille des Trois Rois), une grande armée portugaise composée de soldats originaires de presque toute la chrétienté occidentale catholique — chevaliers et fantassins portugais, miliciens des provinces espagnoles, lansquenets allemands et flamands et mercenaires italiens des troupes papales — est anéantie par les forces militaires de l'Empire saadien qui s'offrent une victoire au retentissement considérable. À l’issue de cette bataille, la dynastie se concentre sur la frange nord-orientale du Maroc afin de protéger le pays des invasions ottomanes, comme en témoignent les importants borjs et ouvrages de fortification militaire de Fès et de Taza.
Malgré leur opposition politique à la Sublime Porte, les Saadiens organisent leur makhzen et leur armée sur le modèle ottoman. L’administration adopte les titres de pacha, de bey et de khaznadar, et les sultans se dotent d’une garde d’élite (composée de peiks, de solaks et de sipahis), qui s'inspire fortement des janissaires turcs dans sa structure hiérarchique, son commandement et ses uniformes. Un khalifa, représentant du sultan à Fès, exerce la fonction de vice-roi sur les provinces du nord et sur les marches orientales face à l'Empire ottoman. Beaucoup de fonctionnaires issus du makhzen saadien sont des renégats d'origine chrétienne et des Andalous chargés de surveiller la perception des impôts et de veiller à la loyauté des populations susceptibles de se révolter contre le pouvoir central. Certains renégats accèdent à de très hauts postes de responsabilité, comme Mustapha Bey qui devient commandant suprême des sipahis et assure la sécurité des portes du palais sultanien.Le Diwân du sultan, composé des ministres et des secrétaires du souverain, contrôle efficacement l'ensemble des rouages et des institutions de l'État.
La forte influence turque sur le Maroc saadien s’explique par l’exil des princes Abdelmalik et Ahmed (futur Ahmed al-Mansur Saadi) à Alger et à Constantinople durant le règne de leur demi-frère Abdallah el-Ghalib, qui avait voulu les éliminer afin d’être l’unique représentant de la dynastie. Le soutien du sultan ottoman Murad III aux prétentions des deux princes saadiens peut paraître paradoxal en raison de la nature conflictuelle des relations maroco-turques, mais Abdelmalik puis son frère savent exploiter intelligemment cet appui décisif pour récupérer le trône et éliminer leur neveu Mohammed el-Mottouakil (fils d’al-Ghalib), qui de son côté s’était allié au Portugal, lequel n'avait pas encore renoncé à ses rêves d'expansion coloniale au Maroc. Les revendications ottomanes sur le Maroc cesseront définitivement en 1576 après la bataille d'al-Rukn et la prise de Fès par les princes saadiens avec l'aide des forces turques commandées par Caïd Ramdan, et l'intronisation de Moulay Abdelmalik al Saadi comme sultan de l'ensemble du pays à Marrakech. La mort de Murad III en 1595 met définitivement fin à l'hégémonie de la Sublime Porte et renforce l’indépendance marocaine.
Si les Turcs sont surtout présents dans l’état-major et dans l’artillerie, l’essentiel de l’armée saadienne est composé de renégats européens (principalement d'origine espagnole) et de tribus militaires arabes Cheragas ainsi que de contingents du Souss (les Ehl el-Souss, constituant l’ossature militaire de la dynastie). Cette force considérable, estimée à 40 000 hommes par l’historien Henri Terrasse, fait du sultan Ahmed al-Mansur le plus puissant chef politique et militaire de cette partie de l’Afrique.
Le sultan envoie l'un de ses plus brillants généraux, le Pacha Djoudar, à la conquête de l’Empire songhaï du Mali qui devient après la bataille de Tondibi et la défaite des Songhaï, le pachalik marocain de Tombouctou et du Bilad as-Sûdan (le Soudan occidental traversé par le fleuve Niger, par opposition au Soudan oriental où coule le Nil), incluant les prestigieuses cités de Gao et de Djenné. Dans cette nouvelle province de l'Empire saadien en Afrique occidentale, l'ordre est assuré par un important dispositif de garnisons : les soldats de l'armée marocaine du Soudan finissent par épouser les femmes songhaï, ce qui donne naissance à une nouvelle ethnie issue de ce métissage, les Armas. Sur le plan religieux, le califat saadien est reconnu jusqu’au Tchad par Idriss III Alaoma, roi du Kanem et du Bornou93. Cette allégeance spirituelle marque une victoire indéniable pour le sultan al-Mansur sur la scène africaine, au détriment des Ottomans qui entendaient imposer leur califat aux royaumes du Sahel. Du Soudan l'expédition marocaine ramène à Marrakech des esclaves pour travailler dans les champs de canne à sucre de Chichaoua, mais également des grandes notabilités politiques et intellectuelles songhaï réduites en captivité, comme le fameux savant Ahmed Baba Tomboucti.
L'Empire songhaï détruit et son souverain Askia Ishaq II renversé, l’or de la vallée du Niger prend le chemin des oasis marocaines puis de Marrakech par le circuit de caravanes sous forte escorte armée. Grâce à cet or malien, le sultan al-Mansur se lance dans une politique de grand prestige, achève son immense et luxueux palais El Badi siège d'une vie de Cour très fastueuse, et l’on voit même la reine de France Catherine de Médicis tenter de recourir à un emprunt de 20 000 ducats auprès du richissime souverain saadien. De son côté la reine Élisabeth Ire d’Angleterre veut nouer une alliance stratégique anti-espagnole avec le puissant califat saadien, afin de contrer les ambitions de Philippe II. Cette politique se concrétise par l’attaque conjointe anglo-marocaine contre Cadix (1596) et par l’échange d’ambassadeurs entre les Cours royales de Londres et de Marrakech en 1600. Le sultan al-Mansur va même jusqu'à proposer aux Anglais d'établir un plan de conquête de l'Amérique espagnole et un partage du Nouveau Monde entre l'Angleterre et le Maroc.
Mais cette page brillante s’achève par le décès d’Ahmed à Fès en 1603. Dès 1612, les gouverneurs de Tombouctou cessent d'obéir directement au sultan, et l’or du Mali ne parvient plus jusqu’à Marrakech malgré la tentative de reprise en main du Soudan marocain par le pacha renégat Ammar el Feta. Moulay Zaidan doit affronter le faqih Ibn Abî Mahalli qui se proclame Mahdi et Imam infaillible comme Ibn Toumert avant lui, et veut prendre le pouvoir avant d'être vaincu en 1613. Profitant du désordre politique au Maroc, la France sous l'impulsion du cardinal de Richelieu tente de s'emparer de Mogador et charge Isaac de Razilly d'y installer un comptoir. Finalement Louis XIII y renonce et un traité de paix est conclu en 1631 avec le sultan Al-Walid. La dynastie saadienne s’éteint en 1659 à la mort du sultan Ahmed el-Abbas (assassiné à l'instigation de Kerroum al-Hajj), ce qui met fin à une longue guerre opposant les différents héritiers de la famille saadienne. À la veille de la disparition des Saadiens, le Maroc se fractionne en plusieurs pouvoirs locaux, dont certains ambitionnent de dépasser leur cadre régional et de s’imposer à l’échelle nationale. Parmi ces différents pouvoirs, les plus remarquables sont la zaouia de Dila, basée dans le Moyen-Atlas et qui étend son hégémonie jusqu'à Fès, et dont la force repose sur les tribus berbères des montagnes, notamment les Sanhadjas; et la zaouia d’ Illigh tenue par les Semlalides, qui fonde le royaume du Tazeroualt dans le Souss et draine une grande partie du commerce caravanier du Sahara et du Soudan marocain.
À côté des États théocratiques soufis de Dila et du Tazeroualt, le chef de guerre El-Ayachi, meneur du jihad dans les provinces atlantiques, se taille un fief important dans le Gharb. Les villes côtières où domine l'élément andalou et morisque s’érigent également en entités politiques indépendantes, comme la République de Salé et la principauté des Naqsides à Tétouan. Enfin, à Marrakech et dans le Haouz émerge la seigneurie des maires du palais saadiens issus de la tribu des Chebânat, ultime vestige de la dynastie agonisante. Mais de tous les protagonistes en présence ce sont les Alaouites, émirs du Tafilalet, qui s’imposent grâce à une conquête méthodique et graduelle du Maroc, mettant à profit les faiblesses internes et les dissensions de leurs adversaires. La dynastie alaouite parvient ainsi au pouvoir sur l’ensemble du territoire au milieu du XVIIe siècle.
an 1557 à 1633 : Éthiopie - Des jésuites arrivent en Éthiopie dès 1557. Sarsa Dengel tolère la présence des jésuites à Fremona, près d'Adoua. Au début du XVIIe siècle, le père Páez arrive à Fremona, profondément religieux et courtois, il gagne la confiance de la cour et du roi. Sousnéyos, couronné à Aksoum en 1608, décide en 1613 de tenir la promesse qu'il considère que ses prédécesseurs ont fait de se rallier à l'Église latine lors de l'intervention portugaise de 1541. Malgré les opposants qui tentent de le faire excommunier publiquement par l'Abouna, Sousnéyos persiste et commence par interdire l'observation du sabbat.
En 1621, Sousnéyos fait profession de catholicisme. Puis il fait proclamer la religion romaine à Aksoum où le grand majordome lit l'édit impérial en présence des grands, dont beaucoup sont déjà convertis.
Le patriarche latin envoyé par le roi du Portugal, Alfonso Mendes impose des mesures immédiates et intransigeantes : re-baptême des chrétiens éthiopiens, re-consécration des églises dont les Arches (les "tabot"s traditionnels), sont bannies. Il fait abandonner sans transition la liturgie guèze pour la messe en latin que nul ne comprend, et renoncer au culte des saints éthiopiens, dont parfois les restes sont déterrés et jetés hors des sanctuaires. Des sanctions graves frappent ceux qui se rebellent, provoquant en retour une révolte générale.
En 1632, la rébellion contre la religion romaine imposée en 1621 devient guerre civile.
Sous les ordres de Mélkas-Christos, une armée, constituée surtout de montagnards du Lasta, marche contre les troupes impériales, qui connaissent d'abord un échec : les soldats veulent bien sauver l'empire, mais refusent de défendre la religion étrangère et la décision du roi72. Sousnéyos cède, et les troupes impériales écrasent les vingt-cinq mille révoltés à Ouaïna-Dega. La bataille fait huit mille victimes. C'est notamment à cette époque troublée et dans ce contexte, que le philosophe éthiopien Zara Yaqob écrit dans ses méditations :
« Les Fang nous disent : « Notre foi est la vraie, la vôtre ne l'est pas ». Nous leur disons : « Il n'en est pas ainsi, votre foi est fausse, la nôtre est la vraie. ». Si nous demandons la même chose aux juifs et aux mahométans, ils revendiqueront la même vérité, et qui peut être juge pour ce genre d'argument ? Pas un seul être humain ne peut être juge : car tous les hommes sont demandeurs et défendeurs entre eux - Enquête sur la foi et la prière »
Sousnéyos abdique alors en faveur de son fils Fasiladas le 14 juin 1632 et rétablit la religion nationale. Fasiladas expulse les jésuites en 1633.
an 1557-1578 : Érythrée - La culmination de l'influence musulmane en l'Érythrée remonte à 1557 avec l'invasion ottomane de Soliman le Magnifique et la conquête de Massaua, Arqiqo et Debarwa, capitale de Bahr negus Yeshaq (qui règne sur une région très similaire à l'Érythrée contemporaine). Bahr negus Yeshaq reprend Debarwa et l'or que les envahisseurs y ont amassé. Bien que le Bahr negus Yeshaq ait entretenu de bonnes relations avec l'empereur Gelawdéwos d'Éthiopie, ses relations avec ses successeurs ne sont pas aussi positives, ce qui le fragilise.
Lors de l'attaque des hauts-plateaux érythréens par l'imam Ahmed Gragne, le negassi Yeshaq s'appuie sur les soldats menés notamment par l'Adkamé Melaga, gouverneur de la province de Seraye. Il noue une deuxième alliance avec les Ottomans peu de temps après mais est battu définitivement en 1578, laissant aux Ottomans la maîtrise de Massaua (l'un des plus grands ports de la région), d'Arqiqo et des côtes environnantes.
Pendant la période décentralisée en Éthiopie du Zemene Mesafent, des seigneurs de guerres originaires de la province éthiopienne de Tigré exercent une influence sur certaines régions de l'Érythrée actuelle. Les incursions musulmanes se poursuivent, en particulier sur la côte et les plaines qui sont islamisées à la fin de la période médiévale.
an 1558 : Algérie - Les beylerbeys étendent leur autorité à l’intérieur du pays, et sont à l'origine de l'organisation des beyliks dans les provinces. Ils luttent à la fois contre les Espagnols, les Chérifs marocains et les pouvoirs locaux : Tlemcen est prise définitivement en 1554, Béjaïa en 1555 et les Espagnols sont vaincus en 1558 lors de la bataille de Mazagran, près de Mostaganem. Ils s'allient également avec certaines tribus, avec des hakems (« gouverneurs ») dans les villes et des caïds dans les tribus soumises, ils construisent des bordjs pour les garnisons et des postes le long des routes. Les Béni Abbès sont soumis et le royaume de Koukou en Kabylie évincé, les tribus de l'intérieur font leur soumission, et Salah Rais pénètre jusqu’à Touggourt et Ouargla dans le Sud.
1566 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
En 1566, un corsaire français, Pierre Bertrand de Montluc, pille l'île avec une troupe de 1 300 hommes, arrivée à Funchal dans 11 gallions. Il vole les réserves de sucre et tue 300 personnes.
an 1574 : Sao Tomé et Principe - En 1574, des esclaves se révoltèrent contre les colons et détruisirent les plantations de canne à sucre.
an 1575 : Angola - L'Angola est le premier pays africain à connaître la colonisation européenne. Le Portugal s'installe dans la région côtière et bâtit cinq forts jusqu'à 200 km dans l'intérieur des terres. La colonisation des rives du fleuve Congo s'avère plus contestée.
Le pays devient un vaste territoire de chasse aux esclaves à destination du Brésil et de Cuba. On estime que, du XVIe au XIXe siècle, quatre millions d'entre eux ont survécu au voyage et sont devenus des esclaves au Brésil. Durant tout le régime esclavagiste, l'Angola reste lié au Brésil parce qu'il lui fournit les esclaves pour travailler notamment dans les plantations et les mines et qu'en retour le Brésil envoie ses trafiquants, ses fonctionnaires et « son portugais », c'est-à-dire la variété de cette langue parlée au Brésil.
Les colons portugais et brésiliens s'installent sur les côtes et se mélangent à la population noire pour consolider l'Angola comme possession portugaise. Les Portugais y fondent des villes comme Luanda (1575) ou Benguela qui possèdent des prisons pour garder les esclaves jusqu'à leur embarquement. Une importante communauté métissée se développe, sa culture mêlant les coutumes africaines et celles des Portugais.
1580 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) Philippe II d'Espagne se proclame roi du Portugal : Madère devient ainsi possession espagnole. Pendant son règne, l'île perd son monopole sucrier au profit du Brésil.
an 1580-1640 : Mozambique - Colonisation portugaise (1498-1975)
La période, de 1580 à 1640, pendant laquelle les couronnes portugaise et espagnole sont réunies, ces établissements sont abandonnés plus ou moins à eux-mêmes, au profit de ceux d’Inde et d’Extrême-Orient, nettement plus rentables, et de la colonisation du Brésil. Malgré le désintérêt de la métropole, l’activité se poursuit, en particulier la vente d’esclaves à destination de la péninsule Arabique et de l’Empire ottoman.
an 1583-1618 : Angola - Cette période est connue grâce à l'historiographie portugaise de l'outre-mer, qui a bénéficié de l'ouvrage de synthèse d'Antonio Brasio, publié à partir de 1952, comportant un recueil de documents concernant l'ensemble de l'action du Portugal en Afrique Occidentale, sous le nom de Monumenta Missionaria Africana, divisé en deux séries ; la première, en sept volumes à partir de 1952, consacrée au diocèse de Congo-Angola, couvre la période 1471-1630 et la seconde, publiée à partir de 1958, concerne l'ancien diocèse du Cap Vert avec un premier tome, consacré à la période 1342-1499. L'ouvrage ne traite pas seulement de questions missionnaires mais inclut des sources. Un missionnaire écrit ainsi en 1583 : que « cette année, les Portugais ont conquis la moitié du royaume d'Angola et battu quatre armées du roi. Des milliers de [ses] vassaux ont été tués et on s'est emparé des mines de sel, ce qui est le plus grave pour eux, car le sel leur sert de monnaie. D'innombrables esclaves ont été capturés ». Entre 1583 et 1618, les Portugais bâtissent un réseau de forteresses, structuré sur l'axe fluvial majeur de la région, le fleuve Kwanza. Les quatre principales forteresses sont Massangano, édifiée en 1583, Muxima, en 1599, Cambambe, en 1603, et Ambaca, en 1618. Une autre est érigée dans la région de Kissama, au sud du fleuve, pour contrôler les mines de sel, mais abandonnée ensuite car son coût de maintenance est trop élevé. Celle d'Ango, fondée au début des années 1610, bien que difficile à ravitailler car éloignée des fleuves, permet de maintenir une pression militaire sur le roi du Ndongo, puis est déplacée de quelques lieues, à Ambaca. Ces forteresses deviennent un point de départ pour les missions d'évangélisation.
an 1587 : Algérie - En 1587, le sultan ottoman supprime la fonction de beylerbey pour mettre un terme à l'affrontement direct avec les Espagnols et par peur que les beylerbeys mènent une politique d'indépendance. Mais ce changement de statut distend les liens de la régence avec Constantinople. Les beylerbeys sont remplacés par des représentants triennaux, nommés par la Sublime Porte : les pachas, dont le pouvoir est réduit par les raïs et les janissaires.
Les pachas accentuent l'imposition des tribus pour remplir les caisses de la régence, ce qui entraine des révoltes, notamment en Kabylie et dans le Constantinois. Les Kouloughlis, qui réclament les mêmes droits que les janissaires, soutiennent les insurgés ; le résultat est que l'administration des beylicks est confiée aux Kouloughlis, alors que le pouvoir à Alger reste entre les mains de l’odjak. Les raïs perdent leur influence et les Morisques prennent un poids politique et économique important.
an 1587 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - L’intermède portugais (1498 – 1729)
à partir du XVIIe siècle, les Portugais eurent du mal à assumer militairement et politiquement leur conquête. Peu nombreux et détestés des populations locales, ils doivent faire face à l’opposition grandissante des swahilis, eux-mêmes de plus en plus fortement soutenus par les Arabes du sultanat d’Oman, situé au nord de la côte swahilie. En 1587, le massacre des Portugais de l’île de Pemba a été une première alerte pour les occupants européens.
an 1588-1562 : Gambie - En 1588, le Portugal perdit ses droits commerciaux dans la vallée du fleuve Gambie et sur la Côte de l'Or (actuel Ghana) au profit de l’Angleterre. Le Portugal était alors uni sous la couronne espagnole et la débâcle de l’armada espagnole contre la marine anglaise permit à Élisabeth Ire de mettre la main sur les privilèges commerciaux des Portugais. Elle les revendit à la Company of Devon et aux London Merchants. La présence anglaise en Gambie remontait cependant à 1562, lorsque Sir John Hawkins vola 300 esclaves aux Portugais pour les revendre à Santo Domingo, en actuelle République dominicaine, fondant par là-même le commerce triangulaire.
an 1589-1603 : Angola - Après la mort de Novais, en 1589, la Couronne reprend l'Angola, y nomme des gouverneurs et installe le système d'Encomienda similaire à celui des Espagnols en Amérique, avec des abus qui font polémique ; le sujet est porté jusqu'à Madrid en 1601 devant Philippe II d'Espagne, qui en ordonne la suppression, les tributs devant désormais être versés au gouverneur à partir de cette date. En 1603, les Portugais, dans la région de Cambambe, ne découvrent finalement que de modestes gisements de cuivre. Lisbonne décide alors de mettre officiellement fin à la conquête, par l'instruction de Manuel Pereira Forjaz, nommé gouverneur d'Angola en 1606. Mais dans les faits, la progression territoriale continue jusqu'à la fin des années 1620, sous la pression des officiers portugais, mal payés, qui lancent de nombreuses attaques et actions punitives pour capturer des esclaves, au moment où la culture du sucre prend son essor au Brésil. De 1603 à 1623, les gouverneurs eux-mêmes perpétuent les abus en soutenant ces guerres contres les Noirs avec pour but de capturer des esclaves. Ils vont ensuite recruter, d'abord comme supplétifs militaires puis comme courtiers d'esclaves, une bande de mercenaires nomades, qu'ils présentent comme des "Jagas cannibales", et qui fonderont dans l'est du pays le petit royaume de Cassange, dont la notoriété sera sans rapport avec ses dimensions réduites. Les habitants du Dong, eux, fuiront, pour certains jusqu'au-delà du Cuango. Les marchands portugais font aussi des raids au Congo avec l'approbation tacite ou ouverte du gouverneur de l'Angola.
an 1589 : Namibie - En 1589, Andrew Battels, un déserteur anglais recruté comme soldat en Angola, est le premier blanc à voir l'intérieur du territoire de l'actuelle Namibie où il erre pendant six mois parmi les Ovambos dans le futur Ovamboland (au nord) qu'il fut le premier à décrire par écrit.
an 1590 : Mauritanie - Ahmad le Victorieux, surnommé également le Doré, entreprend, avec une armée de mercenaires dirigés par le Castillan Juder, vers 1590, il descend les routes caravanières vers le sud, et vient détruire l'empire Songhai, qui avait pris la succession du Mali et unifié l'ensemble du Sahel, de Dakar à Niamey, autour de sa capitale Gao, en parallèle, les Berbères Touaregs avaient fondé la place commerciale de Tombouctou au XIVe siècle. L'empire de Marrakech récupère aussi Djenné et fonde trois "pachalik" dont un, Gao, se maintiendra jusqu'en 1912, une population marocaine vient d'installer sans se mélanger complètement aux arabes pâturant entre le Hodh et le Niger depuis déjà deux siècles et demi.
an 1593 - 1657 : Canaries (Îles des) - Attaques anglaises
L'Angleterre tente également à plusieurs reprises de s'emparer des îles Canaries, par sa flotte régulière comme par ses corsaires.
Le corsaire William Harper attaque Lanzarote et Fuerteventura en 1593. Sir Francis Drake (1540-1596) est repoussé avec succès au large de Las Palmas en 1585 et à nouveau en 1595. Walter Raleigh (1552-1618) attaque Fuerteventura et Tenerife en 1595 et la ville d'Arrecife en 1616. Une attaque de l'amiral Robert Blake (1598-1657) sur Tenerife échoue en 1657.
Contrairement à ce qui se passe dans la péninsule ibérique, le XVIIe siècle est une période de croissance démographique.
La population des îles Canaries passe de 41 000 habitants en 1605 à 105 075 en 1688, dont environ 70 % pour les îles occidentales. Tenerife et Grande Canarie restent les îles les plus peuplées avec respectivement 50 000 et 22 000 habitants. Parmi les autres îles, La Palma est la seule à dépasser 14 000 habitants. Le reste des îles connaît des augmentations importantes permettant d'atteindre environ 4 000 habitants par île.
La cause de cette croissance inégale est la croissance économique à Tenerife et La Palma, due à la conversion à l'industrie du vin profitable à l'exportation. Dans le même temps, les îles Canaries orientales souffrent toujours de l'effondrement économique de la canne à sucre, des attaques de pirates, des épidémies et de l'émigration vers Tenerife et La Palma. Tout cela explique la stagnation de la population, qui prend fin seulement au dernier tiers du siècle.
an 1598-1710 : Ile Maurice - Période hollandaise (1598-1710)
C’est vers la fin du XVIe siècle que les marins hollandais de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales commencent à sillonner l’océan Indien. Ils sont les premiers à reconnaître la grande valeur de l’île. D’une part, grâce à sa position géostratégique sur la route des Indes depuis l’Afrique du Sud. D’autre part, grâce à son climat favorable, sa faune et sa richesse en bois précieux.
C’est à partir de cette époque que l’intérêt qu’ont porté les nations de marins pour l’île Maurice a crû, à commencer par les Danois, les Français et les Anglais. Les Hollandais envisagent alors d’annexer l’île afin d’en conserver les richesses.
En 1598, une escadre hollandaise, sous les ordres de l'amiral Wybrand van Warwyck, aborda l'Île Maurice qui fut renommée Mauritius en l'honneur de Maurice de Nassau, le stathouder de Hollande. Un groupe de colons venus des établissements hollandais du Cap s'installèrent avec des esclaves d'origine africaine.
XVIIème siècle et XVIIIème siècle : Archipel des Comores - L'âge d'or du Zanguebar - Les XVIIe et XVIIIe siècle sont une période particulièrement prospère pour les Comores, idéalement placées sur une route commerciale florissante entre l'Europe et ce qui devient l'empire omanais. Cependant, la rivalité entre sultans fait que les Comores ne deviennent à aucun moment un pays uni, capable de tenir tête aux menaces extérieures, ce qui rend cette prospérité précaire.
XVIIème siècle et XVIIIème siècle : Seychelles - Aux XVIIe et XVIIIe siècles, c’est au tour des navigateurs anglais et français de mener des expéditions de reconnaissance. Ils sont fascinés par la profusion d’oiseaux et de poissons, ainsi que par la taille des tortues géantes des Seychelles.
De plus en plus fréquentée par des navires aux riches cargaisons, la route des Indes attire les pirates qui font des Seychelles leur base de prédilection dans l’océan Indien. Ils y auraient enfoui leur butin ! Notamment à Mahé, dans la région de Bel Ombre. Ou encore à Frégate.
XVIIème siècle : Archipel des Comores - piraterie, invasions malgaches et sultans batailleurs -
Au XVIIe siècle, l’archipel devient un point de relâche pour les navires européens, hollandais, anglais ou français, en route pour le golfe Persique, les Indes ou l’Extrême-Orient. Anjouan devient également populaire pour les pirates et corsaires qui pillent les navires occidentaux qui doivent passer le cap de Bonne-Espérance. Le combat d'Anjouan fait référence à ces événements.
XVIIème siècle : Ghana - Le premier état Akan date du début du XVe siècle et correspond à l’Ashanti. Les Dioula, commerçants d’ethnie Manding viennent y acheter l’or. Au XVIIe siècle apparaissent, sur la côte le royaume Denkyira et un peu au nord le royaume Ashanti et son premier souverain Obiri Yebora, dont le successeur Osei Tutu remporte une série de victoires contre les états voisins. Selon les récits traditionnels, c’est lui qui reçoit du ciel, par l’intermédiaire d’un devin célèbre, Okomfo Anokye, le trône d’or, symbole de la puissance des rois ashanti, sur lequel était répandu le sang des prisonniers capturés au combat et sacrifiés.
La tradition veut que le royaume Gonja soit fondé par des cavaliers venant du Mali, qui s’inquiétent de voir diminuer la quantité d’or que le royaume de Bono fournit aux Dioula. La raison en est que de nouveaux acquéreurs étaient apparus sur la côte, les européens.
XVIIème siècle : Namibie - Le territoire commence à être exploré par les Européens au XVIIIe siècle.
XVIIème siècle - XVIIIème siècle - XIXème siècle : Ouganda - Les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles sont marqués par l’expansion du royaume du Buganda dont l'influence remplace celle du Bounyoro déclinant. La stratégie des différents Kabaka (rois) prend plusieurs aspects. Le premier consiste à tenter de contrôler les routes commerciales qui relient la côte de l’océan Indien au Bunyoro, alors centre commercial de la région. Le second consiste à profiter des querelles de succession et de l’éclatement politique pour intervenir de façon de plus en plus insistante dans les royaumes voisins. L’essor décisif du royaume intervient sous le règne du Kabaka Suna. Les royaumes affaiblis passent alors sous la dépendance des Bagandas. Ceux-ci sont soumis à des tribus et sont peu à peu assimilés au Buganda. Au fur et à mesure des conquêtes, les royaumes annexés ne sont plus assimilés mais persistent en tant qu’entités dépendantes. Le Buganda ne parviendra pas malgré ses efforts à conquérir le Bunyoro. Mais en rognant petit à petit les royaumes sous la domination du Bunyoro, ce dernier perd à la fois son influence régionale et sa puissance politique. Ainsi, le Buganda, petit royaume au début du XVIIe siècle, est devenu au début du XIXe siècle la puissance politique et commerciale majeure de la région. Une des explications de la réussite du Buganda serait la refonte de ses institutions politiques au XVIIe siècle : l’autorité du Kabaka s’affirme en faisant reculer celles des clans. C’est à partir de ce moment que l’on a tendance à assimiler l'histoire du Buganda et l'histoire de l’Ouganda.
XVIIème siècle : Somalie - Du XVIe siècle au XVIIIe siècle les Portugais gardent le contrôle de Baraawe et Mogadiscio. Lorsque l'empire ottoman cesse de progresser et réduit même son emprise, de nouvelles puissances régionales sont apparues, notamment les sultanats d'Oman et de Zanzibar, tenant tête à ces Portugais, puis à la Royal Navy britannique.
XVIIème siècle : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - L’intermède portugais (1498 – 1729)
A partir du XVIIe siècle, les Portugais eurent du mal à assumer militairement et politiquement leur conquête. Peu nombreux et détestés des populations locales, ils doivent faire face à l’opposition grandissante des swahilis, eux-mêmes de plus en plus fortement soutenus par les Arabes du sultanat d’Oman, situé au nord de la côte swahilie. En 1587, le massacre des Portugais de l’île de Pemba a été une première alerte pour les occupants européens.
En 1698, l’imam de Mascate en Oman, Seif Bin Sultan (en), encourage les Arabes à se révolter, monte une armée de 3 000 hommes, et parvient à reprendre Mombasa aux Portugais, puis Kilwa et Pemba l’année suivante. Les Portugais tentent différentes contre-offensives, reprennent même brièvement Mombasa, mais sont définitivement expulsés de la côte swahilie en 1729, et se réfugient plus au sud au Mozambique.
XVIIème siècle : Togo - Au XVIIe siècle, devenus nombreux, les Éwés se dispersent dans l'Ouest, jusqu'à la rive gauche de la Volta.
Dès cette époque commencent les missions catholiques auxquelles les protestants ne réagissent qu'au XVIIe siècle.
an 1600-1637 : Côte d'Ivoire - L'histoire de la Côte d'Ivoire antérieure aux premiers contacts avec les Européens est quasiment inconnue du grand public. Ces premiers contacts restèrent limités avec seulement quelques missionnaires européens au XVIe siècle. Une culture néolithique existait cependant, mais est mal connue à cause d'un manque de découvertes archéologiques.
Le peuplement du sud est attesté dès le seuil de notre ère même si la recherche de ses traces est rendue difficile par le climat humide. Le territoire fut parsemé par des peuples de langues soudanaises, divisés en de nombreuses chefferies.
Parmi les populations les plus anciennes, on compte les Mandé du sud (Gouro, Gban et Yacouba) à l'ouest et au centre-ouest, les Krous au Sud-Ouest ainsi que les Sénoufos au Nord-Est .Le nord du pays sera sous l'influence des royaumes sahéliens (Songhai, Ghana). C'est dans ce contexte que s'implantera l'islam, répandu soit par des commerçants, notamment des colporteurs dioula, soit par le djihad mené par des armées à cheval. Des villes commerçantes comme Kong ou Bondoukou deviendront par la suite de véritables cités-États, liens entre la savane et la forêt. Toutefois, les populations ne connaissaient pas la propriété privée et ne cherchaient pas à délimiter leur territoire. Leurs cultures étaient marquées par une tradition théâtrale, orale, musicale, de danse et la croyance à la magie.
Les premiers Européens à pénétrer dans le pays sont les navigateurs portugais, longeant les côtes africaines, à la recherche de la route vers l'Inde. Les Portugais baptisent le pays "Costa do Marfim" pour l'accueil fait par les populations. Les Européens sont d'abord frappés par la force démographique des Noirs.
Le commerce de l'ivoire, des fusils et la traite des Noirs se mettent vite en place. Les ports de San-Pédro, Sassandra ou encore Fresco ont conservé les noms de marins ou de vaisseaux portugais. Les négriers britanniques sont également présents. Le premier contact avec la France date de 1637, lorsque des missionnaires débarquent à Assinie, près de la Côte de l'Or (actuel Ghana).
an 1601-1698 : Gabon - Les Européens ne cherchèrent pas à occuper le pays. Ils se contentaient d'avoir des comptoirs permettant à leurs navires de mouiller en sécurité, d'embarquer les esclaves et les marchandises. Quand un pays européen installait un fortin, c'était plus pour se protéger de ses concurrents que pour coloniser la région. À la fin du XVIe siècle, les Hollandais supplantèrent les Portugais. Mais ils eurent un grave différend avec les chefs mpongwés de l'estuaire qui détruisirent le fortin qu'ils avaient construit dans l'île de Corisco (1601). En 1698, une nouvelle querelle poussa les Hollandais à détruire plusieurs villages mpongwés.
Le royaume de Loango, fief du Manicongo qui s'étendait du Shiloango dans l'actuelle République du Congo à la pointe Kouango, dans l'actuelle province de la Nyanga, fut un grand pourvoyeur d'esclaves. Une partie de ces infortunés était embarquée à bord des navires européens sur le site actuel de Mayumba.
Le centre de ce trafic était l'île de Pongo, du nom des Mpongwés, qui ferme l'embouchure du Como et que les occidentaux nommait Isle du Roi parce que le roi des Mpongwés y siégeait. Par métonymie, toute la région pourvoyeuse correspondant au Gabon actuel était également appelée Pongo sans pour autant avoir été jamais explorée par les navigateurs eux-mêmes.
an 1602 : Liberia - En 1602 les Néerlandais créent un poste de traite à Grand Cape Mount, détruit l'année suivante.
an 1604 : Canaries (Îles des) - Armoiries du royaume des îles Canaries au XVIIe siècle
Le traité de Londres (1604), qui met fin à la guerre anglo-espagnole de 1585-1604, rétablit le statu quo ante bellum, dont la fin des perturbations anglaises de temps de guerre, contre le trafic transatlantique espagnol et son expansion coloniale (article 6).
an 1609 : Seychelles - La première description des rivages seychellois, avant tout établissement humain, fut écrite sur place du 19 au 30 janvier 1609 par le marin John Jourdan du bateau britannique Ascension. Ce dernier, après avoir franchi le cap de Bonne-Espérance, avait remonté la côte orientale de l'Afrique avant de mettre le cap au NNE, ce qui l'amena à la pointe nord de l'archipel granitique : il y décrit sommairement les îles actuelles de Mahé, North, Silhouette, Praslin et ses îles voisines et relève un total de plus de trente îles grandes et petites et proches les unes des autres. Enfin, le 3e jour, le bateau mouilla l'ancre à l'abri de l'île Sainte Anne (face au futur port de Victoria), sur laquelle l'équipage trouve sur les hauteurs verdoyantes de l'eau en abondance (l'île est au XXIe siècle déboisée et aride).
an 1611 : Réunion (Ile de la) - le 27 décembre, l'expédition de l'amiral hollandais Pieter Willemsz Verhoeff (Pierre-Guillaume Veruff), de retour de Java, passe à vue de La Réunion, mais n'y débarque pas.
an 1613 : Réunion (Ile de la) - le 23 mars, le navire Pearl, de retour de Ceylan, fait escale à La Réunion et son capitaine, Samuel Castelton, baptise l'île encore inhabitée England's forest. Il décrit une île paradisiaque vierge avec des cours d'eau, des animaux : tortues, tourterelles, perroquets, ibis de La Réunion (ou solitaire), anguilles, canards, oies, tous extrêmement facile à tuer.
an 1618 : Gambie - En 1618, le roi Jacques Ier laissa entièrement les droits commerciaux sur la Gambie et la Côte de l’Or à la Company of Adventures of London. La Guinea Company vit le jour afin de protéger la côte de Guinée contre les visées françaises et néerlandaises. La même année, les premiers esclaves débarquèrent dans la nouvelle colonie de Virginie. Les expéditions visant à découvrir de l’or à l’intérieur des terres s’intensifièrent. Une première échoua, la deuxième fut attaquée en mer par les Portugais et essuya de lourdes pertes. Deux ans plus tard, Richard Jobson atteignit les chutes de Barrakunda.
an 1618 : Ghana - Création de la Compagnie des aventuriers de Londres pour le commerce dans les ports d'Africa", appelée Guinea Company.
an 1624 : Angola - Les Néerlandais tentent de s'emparer de Luanda deux fois, après la prise de Salvador de Bahia, au Brésil, via deux expéditions, menée par Philip van Zuylen puis Piet Heyn. Ce dernier s'empare d'une flotte espagnole remplie d'argent du Pérou, au large de Cuba
an 1625 : Bénin (anc. Dahomey) - Les trois royaumes d’Allada, de Porto-Novo et de Dã Homè - dans le ventre du serpent Dã (dan) - furent fondés par les Fons, qui occupent le sud du pays (le nom de Dahomey fut donné à l’ensemble du pays après la conquête française). Selon la légende, la fille du roi de la ville de Tado (sur le fleuve Mono) fut fécondée par un léopard, alors qu'elle allait puiser de l'eau. Le fils qu'elle mit au monde est le fondateur de toute la dynastie. Ses descendants fondèrent un royaume à Allada au XVIe siècle. Le siècle suivant, trois frères se disputèrent le trône ; le premier, Kopkon garda le royaume d'Allada, le deuxième, Do-Aklin fonda Abomey et le troisième, Adjache qui devint plus tard Porto-Novo. Le royaume d'Abomey fut fondé en 1625, mais c'est entre 1645 et 1685 qu'il devint un État puissant. Le roi Houegbadja, petit-fils de Do-Aklin, voulut annexer un État voisin dont le roi, Dã, le défia de s'installer sur son ventre. Dã fut défait, décapité à Abomey et dans son ventre fut installé le pieu central du palais royal. Signe que le roi d'Abomey avait pris son adversaire au mot.
an 1625 - 1660 : Canaries (Îles des) - L'état de paix entre l'Angleterre et l'Espagne ne dure pas : la guerre reprend en 1625-1630, puis en 1654-1660.
an 1625 : Ghana - Nicholas Crisp devient directeur de la Guinea Company.
an 1626-1659 : Sénégal - Colonisation française du futur site de Saint-Louis.
an 1627 : Maroc - L'arrivée des Andalous et des Morisques
Les Moriscos installés à Rabat (appelé la Nouvelle-Salé) et Salé (Salé l'Ancienne), notamment les Hornacheros, forment un État corsaire à partir de 1627, la République du Bouregreg dite aussi République des Deux Rives. Cette entité politique, comparable par certains aspects aux Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli sous domination ottomane, subsiste de courses commerciales fructueuses et d'activités de piraterie barbaresque qui amènent ses caïds-gouverneurs à négocier avec les principales puissances européennes. La témérité des capitaines salétins est en effet réputée, et quelques-uns d'entre eux mènent des raids audacieux jusqu'en Islande voire jusqu'en Amérique du Nord (jusqu'à Terre-Neuve notamment). Après une période d'indépendance au début du XVIIe siècle, le sultan alaouite Moulay Rachid met fin à l'existence de la république salétine et l'annexe à l'Empire chérifien.
De même, la ville de Tétouan, peuplée majoritairement « d'Andalous » depuis sa reconstruction à la fin du XVe siècle, forme une principauté de facto indépendante, gouvernée par la famille Naqsis pendant la première moitié du XVIIe siècle, dans le contexte d'affaiblissement du makhzen saadien et de morcellement territorial du pays. La principauté accueille des dizaines de milliers de Morisques à la suite de leur expulsion d'Espagne en 1609. De structure sociale semblable à celle de Rabat, la course y représente une activité de première importance par le biais de son port de Martil, en aval du fleuve éponyme qui l'y relie.
an 1630 : Angola - Les Hollandais expulsent les Portugais de Luanda et des côtes angolaises, où sont les principaux comptoirs négriers de l´Afrique.
an 1631 : Ghana - une nouvelle charte est signée par Charles Ier pour former la Company of Merchants Trading to Guinea
an 1632 à 1769 : Éthiopie - La période gondarienne (1632-1769)
Jusqu'à cette période, la monarchie vivait de façon itinérante, stratégie parfaitement adaptée à l'attaque et à la défense. La période de troubles durant laquelle Fasiladas est porté au pouvoir, qui fait suite aux incursions d'Ahmed Gragne et à la guerre civile qui a suivi, l'amène à rechercher une sécurité renforcée. Dès sa prise de pouvoir, Fasiladas se met à construire une capitale moderne pour l'époque.
À la suite de l'expulsion des jésuites et des Portugais du pays, de nombreux Indiens qui les avaient accompagnés s'établissent en Éthiopie. Un ambassadeur yéménite, Hasan Ibn Ahmad Al Haymi qui visite l'Éthiopie en 1648, rapporte que le plus important des palais, le Fasil Gemb, est « une des constructions les plus prodigieuses, qui vaille admiration, une des plus saisissantes merveilles ». Il ajoute que c'est à « un Indien » que Fasiladas a demandé la réalisation de ce palais. Cette affirmation a été confirmée indépendamment par le voyageur James Bruce au XVIIIe siècle qui note que « le palais a été construit par des maçons indiens ». Les relations entre l'Éthiopie et l'Inde à travers l'océan Indien, sont en effet récurrentes dans l'histoire éthiopienne et remontent jusqu'à l'époque axoumite. Néanmoins on retrouve dans la construction de ses palais et autour du Gondar une architecture typiquement éthiopienne dans l'édifice asymétrique (à forme de lion) qui se retrouve du palais de Fasiladas à l'entrée de l'église Debré Berhan Sélassié. L'architecture du Gondar fait donc preuve d'un syncrétisme unique au pays.
Les châteaux du Gondar sont construits sur un terrain de 7 ha de superficie, clôturé par une enceinte de 2 km de circonférence accessible par 12 portes fortifiées : le Fassil Ghébbi. Outre les châteaux royaux, l'enceinte contient des écuries, un sauna alimenté par un système hydraulique, une salle où étaient testées différentes qualités de mortier, et une cage aux lions où les souverains faisaient enfermer des lions d'Abyssinie capturés, signe de prestige du Negusse Negest.
Gondar devient un important centre religieux, administratif et commercial dès sa fondation en 1635. Jusqu'en 1855, la ville est un lieu d'enseignement des arts de la peinture, de la danse et de la musique traditionnelles.
Les Negusse Negest suivants Fasiladas développent les lieux en y faisant chacun construire de nouveaux édifices ou palais au sein de la même enceinte : son fils Yohannes Ier y fait construire une bibliothèque à deux étages consacrée à la théologie, Iyassou Ier son propre palais, Dawit II et Bakaffa de nouveaux palais et un centre de documentation historique. Une des plus importantes églises du pays, l'église Debré Berhan Sélassié (Église de la Trinité), est aussi construite à cette époque par Iyassou Ier à l'extérieur de l'enceinte, dans la ville de Gondar. Fasiladas fait construire pour sa retraite, à l'extérieur de l'enceinte, l'édifice connu sous le nom de "bain de Fasiladas", palais entouré d'une piscine, où se déroulent encore aujourd'hui les fêtes de Timqet.
De nombreux Negusse Negest de cette période se font enterrer sur les îles du lac Tana, au sud de Gondar. On y trouve notamment les tombeaux de Dawit Ier, Zara Yaqob, Zè Denguel et Fasiladas, ainsi que de l'évangélisateur du royaume d'Aksoum, Frumence d'Aksoum.
Sous l'effet des tyrans locaux, Gondar finit par se désagréger.
an 1632 : Ghana - août 1632 : Arent de Groot arrive avec quatre navires
an 1633 : Sainte-Hélène (Île) - En 1633, une flotte hollandaise en prend possession au nom des Pays-Bas qui l'annexe sans l'occuper.
an 1636 : Ghana - la Barbade édicte le décret de 1636 sur l'esclavage à vie
an 1637-1641 : Ghana - Peter Blower, Hollandais du Brésil, introduit la canne à sucre à la Barbade, avec ses secrets de fabrication.
Le commerce attire des convoitises. Les Hollandais réussissent à chasser les Portugais de l’Afrique occidentale en prenant leurs principales forteresses, entre 1637 et 1641. Les nouveaux colonisateurs partagent l’espace côtier avec les Britanniques, et quelques marchands européens. À l’intérieur des terres, de puissants états Akans se créent, dirigés par les Ashantis, qui exercent une domination sans partage sur les peuples voisins. Ceux-ci doivent leur payer un tribut sous forme d’esclaves.
La Compagnie néerlandaise des Indes occidentales s'empare d'Elmina, située à 10 km du Fort de Cape Coast.
an 1638-1640 : Ghana - 1638 début des travaux sur le fort de Kormantin. 1640 : le fort est victime d'un incendie. 1647 : fin des travaux sur le fort
an 1638 : Ile Maurice - Période hollandaise (1598-1710)
En 1638, un gouverneur et une vingtaine de familles y vivent. Mais la population hollandaise à Maurice va très peu augmenter au cours des années qui suivirent.
Afin de rentabiliser leur nouvel établissement de l'Île Maurice, les Hollandais développèrent vers 1641 le commerce des esclaves en provenance de Madagascar. Cependant, peu d'esclaves malgaches furent acheminés vers Maurice durant l'occupation hollandaise.
À la fin du XVIIe siècle, il se trouve sur l’île environ deux cents Hollandais et entre cinq cents et mille esclaves de Madagascar, d’Afrique, d'Inde et de Java dont les descendants, plus ou moins métissés, constituent la population dite créole.
an 1638 : Réunion (Ile de la) - le 25 juin, première prise de possession de l'île Mascarin (future Réunion) par Salomon Gaubert, capitaine du Saint-Alexis, sur lequel était embarqué François Cauche, premier historien de Madagascar.
an 1640-1641 : Angola - Les Néerlandais profitant du flottement politique provoqué par la restauration de l'indépendance du Portugal vis-à-vis de l'Espagne en 1640, il s'attaque à Luanda et São Tomé. Dans un rapport de l'époque, un des dirigeants de la WIC écrit : « sans esclaves, il n'y pas de Pernambouc, et sans Angola, il n'y pas de Portugal »
an 1642 : Ghana - Création du "petit Accra", qui deviendra en 1649 le Fort Crèvecœur (Ghana) par Henry Caerlof.
an 1642 : Réunion (Ile de la) - le 29 juin, les Français prennent une seconde fois possession de Mascarin au nom du roi de France et la rebaptisent Île de Bourbon. Premier débarquement à Saint-Paul de Jacques Pronis, commis de la compagnie des Indes et commandant à Madagascar, prit à son tour possession de la Réunion, en septembre (1642 ou 1643)
an 1643 : Mayotte -
Les sultans : Umar ibn Ali - 1643 - vers 1680
an 1644: Afrique du Sud - Le Mauritius Eylant, un navire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), s'échoue sur les rochers de Mouille Point fixant les 250 hommes d'équipages sur les rives de la baie de la Table pendant quatre mois.
an 1645 : Canaries (Îles des) - Parmi les catastrophes naturelles du siècle, le déluge de San Dámaso (1645) pluies diluviennes avec destructions.
an 1646 : Ghana - le capitaine John Lad arrive dans la région et prend 100 esclaves. Un autre capitaine amenant des esclaves de la Côte des Esclaves à Elmina refuse de les débarquer faute d'équipements permettant de les accueillir.
Reprise des activités par la Biemba Company et le capitaine John Lad.
an 1646 : Réunion (Ile de la) - Jean Leclerc dit des Roquettes et 11 autres mutins de Fort-Dauphin (petit comptoir vers la route des Indes dans le Sud de Madagascar) sont abandonnés à La Réunion avec quelques chèvres et des semences. Ils s'installent à l'endroit qui deviendra le Quartier français de Sainte-Suzanne / Saint André. Le 7 septembre 1649, on les ramène, contre leur gré, à Fort-Dauphin. Une première carte de l'île est dressée avec les informations de ces mutins
an 1647 : Ghana - Thomas Modyford, gouverneur de Barbade, paie 7000 sterling pour la moitié de la plantation sucrière du colonel Hilliard.
an 1648: Afrique du Sud - Le Nieuwe Haarlem, un autre navire de la VOC, s'échoue à son tour au pied de la montagne de la Table. Les rescapés survivent durant un an autour d'un fort de fortune, se nourrissant de produits de la terre, avant d'être rembarqués vers l'Europe par un navire de passage. Dans son rapport à la VOC, le commandant du Nieuwe Haarlem suggère d'établir une station de ravitaillement car le climat y est méditerranéen et le sol fertile. C'est ainsi que la Compagnie néerlandaise des Indes orientales envoie Jan van Riebeeck pour y installer une base fortifiée.
an 1649 : Ghana - Première Révolution anglaise. Accueil des exilés par William Berkeley en Virginie, Thomas Modyford à la Barbade.
Nicholas Crisp se plaint d'avoir été évincé par la Compagnie suédoise d'Afrique du site de Carolusburg, futur fort de Cape Coast. C'est l'aventurier Henry Caerlof qui s'en est emparé pour les Suédois (avant de passer au service du Danemark) ainsi que deux autres établissements
an 1649 : Réunion (Ile de la) - décembre, Étienne de Flacourt est séduit par la description de l'île faite par les mutins. L'île prend alors de l'intérêt. Sur le bateau Le Saint-Laurent, le capitaine Roger Le Bourg, envoyé par de Flacourt, prend à nouveau possession de l’île, en débarquant au lieu-dit la Possession. Il la baptise “Île Bourbon”. Quatre génisses et un taureau sont débarqués, mais l'île reste vierge.
an 1650 : Angola - Les colons portugais du Brésil parviennent à chasser les Hollandais.
an 1650 : Ghana - 10 novembre 1650 : création par le parlement de Londres d'une taxe de 15 % sur la cargaison de tous les navires marchands
an 1651 : Ghana - octobre 1651 : Premier des Actes de Navigation
Débarquement et saccages à la Barbade. George Monck négocie un compromis avec Thomas Modyford.
an 1652: Afrique du Sud - Le 6 avril 1652, Jan van Riebeeck, venu à bord d'une flottille composée du Drommedaris, du Reijer et du Goede Hoop, débarque ses 80 hommes au pied de la montagne de la Table afin de créer une « station de rafraîchissement », destinée à fournir de l'eau, de la viande, des légumes et des fruits frais aux équipages diminués par le scorbut après quatre mois de mer. Le territoire est délimité par une haie d'amandes amères, dont on retrouve la trace dans le jardin botanique de Kirstenbosch.
Lorsque les Néerlandais débarquent, la péninsule du Cap est habitée des Khoïkhoïs et des San, peu nombreux, que les Hollandais baptisent du nom de Hottentot (bégayeur). Dans le reste de l'Afrique du Sud, les peuples Sothos occupent alors les hauts plateaux au sud du fleuve Limpopo (actuelle province du Limpopo), les Tsongas vivent dans l'est (actuel Mpumalanga) tandis que les peuples Ngunis (Zoulous, Xhosas et Swazis) se partagent la région méridionale à l'est de la Great Fish River, à 1 500 km à l'est du Cap.
Durant les premières années de cohabitation avec les Néerlandais, les Khoïkhoïs sont bien disposés à l'égard des nouveaux arrivants. Des relations commerciales se nouent. Les Bochimans échangent leur bétail contre toutes sortes d’objets manufacturés hollandais. Une partie d'entre eux est néanmoins décimée par la variole, apportée par les Européens. Les premiers temps sont plus difficiles pour les colons néerlandais. Dix-neuf d'entre eux ne passent pas le premier hiver.
an 1651-1660 : Gambie - Les Anglais exportèrent de plus en plus d’esclaves à partir de 1652. La demande de main d’œuvre bon marché augmentait rapidement dans les Caraïbes où la culture de la canne à sucre était en pleine croissance.
Au XVIIe siècle, le duc de Courlande Jacob Kettler cherchait à développer le commerce des pays de la Baltique. Il tenta plusieurs fois de stimuler la colonisation courlandaise dans le sud des Caraïbes en y développant la culture du tabac et il avait besoin d’une base commerciale supplémentaire pour importer la main d’œuvre nécessaire. Il envoya Heinrich Fock en Gambie avec deux bateaux. Le 26 octobre 1651, le roi de Nuimi lui accorda l’île James, alors nommée Isla de Andrea, idéalement située à 30 km de l’embouchure du fleuve. Il obtint également une terre sur la rive nord du fleuve, près de Juffureh. Il loua l’île Banjol, actuellement St. Mary’s Island au roi du Kombo, au sud de l’embouchure.
La cohabitation entre les Allemands et les locaux fut pacifique. Kettler considérait les rois avec qui commerçait comme des partenaires souverains. Ces derniers lui apportèrent un soutien militaire contre les incartades néerlandaises. Cela ne suffit cependant pas toujours, et les comptoirs allemands furent occupés par deux fois par les Pays-Bas, du 4 février 1659 au 10 juin 1660 et du 3 juillet au 2 août 1660.
La présence courlandaise prit fin à l’issue de la Première guerre du Nord, qui fit s’affronter la Suède et la Pologne de 1655 à 1660, pendant laquelle Kettler fut fait prisonnier. James Island changea plusieurs fois de mains et fut occupée par différents États d’Europe, des commerçants privés et des pirates.
an 1652 : Gambie - Les Anglais exportèrent de plus en plus d’esclaves à partir de 1652. La demande de main d’œuvre bon marché augmentait rapidement dans les Caraïbes où la culture de la canne à sucre était en pleine croissance.
an 1652 : Ghana - La New Model Army fait le blocus de la Barbade pour y imposer des taxes. La New Model Army renverse le gouverneur de Virginie William Berkeley, resté fidèle au roi en exil. Henry Caerlof construit le futur Fort Christiansborg, alors appelé Fort Osu, à Accra.
10 juillet 1652: la Première guerre anglo-néerlandaise est déclarée. Elle s'achèvera en 1654.
an 1655 : Ghana - La New Model Army s'empare de la Jamaïque mais sans développer l'esclavage: les espagnols ont libéré avant environ 300 noirs.
Conflits entre Nicholas Crisp et les danois.
an 1654 : Réunion (Ile de la) - le 2 octobre, Antoine Couillard dit le taureau ou Maravole, débarque de l'Ours en baie de Saint-Paul avec 5 vaches, un taureau, des cochons, de la volaille et des plants de tabac. Il est accompagné de 12 hommes dont 6 malgaches. Ils repartent en 1658 sur un navire anglais.
an 1657 : Afrique du Sud - Van Riebeeck recommande que les hommes libérés de leurs obligations vis-à-vis de la compagnie, soient autorisés à commercer et à s'installer comme citoyens libres. En février 1657, les premières autorisations d'établissement sont délivrées à neuf ex-salariés de la compagnie, qui reçoivent le titre de burgher (citoyen libre). Les Burghers sont autorisés à cultiver la terre pour y planter du blé et des vignes. Des parcelles de terres leur sont attribuées, spoliant les Khoïkhoïs qui y vivaient. Privés de leurs meilleurs pâturages, ces derniers tentent de vendre des bêtes malades aux burghers.
Entre 1657 et 1667, plusieurs expéditions sont organisées pour reconnaitre l'intérieur des terres. Quand van Riebeeck quitte le territoire en 1662, le comptoir commercial du Cap compte 134 salariés de la Compagnie des Indes Orientales, 35 colons libres, 15 femmes, 22 enfants et 180 esclaves déportés de Batavia et de Madagascar. La colonie est très hiérarchisée, les fonctionnaires de la compagnie des Indes se trouvant au sommet de l'ordre social et politique. La couleur de la peau n'est pas déterminante et aucune distinction juridique ne sépare l'homme libre de l'esclave affranchi ; les clivages se font entre le chrétien et le non-chrétien et entre l'homme libre et l'esclave.
an 1657 : Ghana - Reprise par la Compagnie anglaise des Indes orientales.
an 1659 : Afrique du Sud - Les relations dégénèrent et, en février 1659, les Khoïkhoïs, fédérés sous l'autorité du chef Doman, assiègent les Néerlandais, obligés de se retrancher dans le fort de Bonne-Espérance. La contre-attaque de ces derniers décime les assaillants, réduits en esclavage ou refoulés vers le nord.
an 1659 : Algérie - Une révolte donne le pouvoir au chef des janissaires : l’agha, instaurant une sorte de « république militaire » où le chef de la régence est élu. Cela ne met pas fin à la crise : les quatre aghas seront tous assassinés, et l’anarchie s’installe dans le pays.
Pour atténuer les effets de la course menée par les Barbaresques sur le commerce maritime en Méditerranée occidentale, les Européens, notamment Français, Italiens, Espagnols et Anglais, lancent plusieurs opérations militaires, maritimes et terrestres, tout au long du XVIIe siècle, mais sans parvenir à faire cesser la piraterie. Les Anglais et les Français bombardent Alger à plusieurs reprises.
an 1659 : Ghana - Des suédois trouvent de l'or dans Kormantin déserté.
an 1659 : Sainte-Hélène (Île) - La Compagnie britannique des Indes orientales qui ne possède dans les mers australes aucun point de relâche pour ses navires, s'en empare en 1659 et l'aménage avant de la céder à la Couronne en 1834. Des gouverneurs sont alors nommés.
an 1660-1779 : Gambie - L’année 1660 vit également la naissance d’une nouvelle compagnie commerciale anglaise, la Company of Royal Adventurers Trading to Africa. Charles II lui délivra une patente portant sur tous les droits commerciaux et territoriaux de la couronne anglaise, indépendamment du souverain local ou des droits d’autres nations. L’amiral Robert Holmes fut envoyé, à la tête d’une flotte de cinq bateaux, surveiller la côte occidentale de l’Afrique pour y protéger les intérêts de la compagnie et de l’Angleterre. Il fit ériger un fort sur Dog Island, qu’il nomma alors Charles Island. Il occupa James Island, toujours officiellement courlande mais sous occupation néerlandaise, le 19 mars 1661, et lui donna son nom actuel en hommage au directeur de la compagnie, comte d’York et futur roi d’Angleterre Jacques II. Il y construisit de nouvelles fortifications, Fort James, et y stationna une garnison.
À la fin de la Deuxième guerre anglo-néerlandaise (1665 – 1667), la Company of Royal Adventurers périclita mais la Compagnie royale d'Afrique fut fondée en lieu et place de la première. Le 17 novembre 1664, les postes courlandes furent officiellement cédés à l’Angleterre. Robert Holmes prit de nombreux comptoirs appartenant à la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales pour le compte de la RAC.
Entretemps, à partir de 1626, la France s’était installée sur le territoire de l’actuel Sénégal, sur le cours inférieur du fleuve homonyme. La Compagnie du Sénégal, fondée en 1673 conclut des traités avec les Nuimi lui permettant d’ouvrir un comptoir à Albreda, près de Juffureh et de l’île James, en 1681. Trois ans plus tard, la Compagnie royale d'Afrique racheta la Gambia Adventurers et tout le Sénégal fut occupé par l’Angleterre entre janvier et juillet 1693. Tout au long du siècle qui suivit, les différentes nations présentes dans la région se disputèrent l’île James, et par là la domination économique et politique sur le fleuve. Le 27 juillet 1695, elle fut prise par la France, sans toutefois être occupée, à l’issue d’une bataille navale pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Elle fut rétrocédée à l’Angleterre en septembre 1697 dans le cadre de la paix de Rijswijk. La Compagnie royale d'Afrique s’employa à reconstruire le fort à partir d’avril 1699 mais à la suite de la perte de son monopole commercial sur la Gambie l’année précédente, elle fut contrainte de compter avec des concurrents. En 1702, l'île James passa définitivement sous contrôle britannique. Fort James fut désaffecté et inoccupé du 20 mai 1709 au 13 novembre 1713. Les Traités d'Utrecht confirmèrent cette situation et la Compagnie royale d'Afrique racheta Fort James en 1717.
Fort Albreda fut détruit en 1746, pendant la guerre de Succession d'Autriche, et ne fut reconstruit qu’à la faveur du traité d'Aix-la-Chapelle en 1748.
À partir de 1750, la Company of Merchant Adventurers assuma l'administration de la Gambie. De 1758 à 1779, la Gambie faisait partie d'un territoire alors appelé Sénégambie. En effet, durant cette période, les britanniques avaient également conquis des positions françaises le long du fleuve Sénégal. Ces positions repasseront finalement sous contrôle français quelques années plus tard.
an 1660 : Ghana - Restauration britannique, reprise par la compagnie des aventuriers d'Afrique, organisée par le roi
an 1661 : Ghana - le roi britanique rédige la charte de la compagnie des aventuriers d'Afrique.
an 1662 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) En 1662, elle passe aux mains des Anglais avec Charles II lorsqu'il épouse Catherine de Bragance (l'île est rendue au Portugal après le règne du roi). L'Angleterre fait de Madère un domaine vinicole important et autorise l'exportation vers les colonies américaines. C'est le premier vin étranger dont les colons du Nouveau Monde peuvent bénéficier.
an 1663 : Ghana - De grands planteurs de la Barbade, Thomas Modyford, Colonel Benjamin Berringer et John Yeamans s'installent en Jamaïque.
an 1663 : Liberia - Les Anglais installent un comptoir.
an 1663 : Réunion (Ile de la) - le 10 novembre, le Saint-Charles en provenance de Fort-Dauphin, mouille à la grotte des Premiers Français à Saint-Paul. L'île Bourbon est dès lors définitivement occupée. Deux Français dont Louis Payen, débarquent avec dix serviteurs malgaches dont trois femmes. L'île devient colonie à part entière et aussi la première base française de l'océan Indien.
an 1664 : Maroc - Dynastie alaouite (de 1664 à nos jours)
an 1665 : Ghana - 4 mars 1665:Charles II d'Angleterre déclare la Deuxième guerre anglo-néerlandaise aux Provinces-Unies, qui dure jusqu'au Traité de Breda.
Reprise par l'amiral hollandais Michiel de Ruyter
an 1665-1678 : Mauritanie - Avec l’avènement de la dynastie alaouite au milieu du 17e siècle, la région alors appelée "Bilad Shenguit" revient sous contrôle marocain. En 1665, Moulay Rachid prend Ouadane et Tichit. Son successeur, Moulay Ismaïl, sera plus actif au Sahara. Dès 1672, il donna l'investiture à l'émir du Trarza en lui envoyant un contingent à sa disposition. En 1678, il envoya une expédition dans l'Adrar et l'année suivante, il fit une tournée d'inspection dans la région de Chinguetti : il épousa alors la fille de l'émir du Brakna renouant ainsi les liens d'allégeances entre le Maroc et les tribus maures.
an 1665 - 1764 : Réunion (Ile de la) - 1665-1764 : la période de la Compagnie des Indes
Pendant un siècle, la Compagnie des Indes administre directement l'île Bourbon qui lui est concédée par le Roi de France. En 1665, l'île accueille son premier gouverneur, Étienne Regnault, agent de la Compagnie des Indes. L'administration crée les premiers quartiers, exploite les richesses (tortues, gibier…) et accorde les premières concessions. En 1667 naît le premier enfant connu de Bourbon : Estienne Cazan ; en avril 1668, ce sera le tour de la première fille Anne Mousse dont les parents, Marie Caze et Jean Mousse faisaient partie des malgaches débarqués avec Louis Payen. La colonisation définitive de l'île commence avec l'arrivée des premiers colons français accompagnés d'une main-d'œuvre malgache qui n'est pas encore officiellement asservie. Les « serviteurs » sont au service des colons de la Compagnie des Indes.
-
1665 : Étienne Regnault devient chef de la première véritable colonie. L'île Bourbon compte 30 à 35 personnes. La colonie est basée au camp Jacques à droite de l'embouchure de l'étang de Saint-Paul.
-
1667 : naissance de Saint-Denis et de Sainte-Suzanne. Le Saint Jean appartenant à la flotte du marquis de Montvergne, débarque 200 malades, 5 jeunes femmes et 1 prêtre et la même année les 5 premiers mariages sont célébrés dans l’île.
-
1671 : l'île Bourbon compte 76 personnes.
-
1674 : l'île Bourbon accueille les rescapés du massacre de Fort-Dauphin, et devient alors la seule escale française sur la route des Indes. L'île compte alors 150 personnes. Pendant six ans, l'île va tomber dans l'oubli et la colonie va prospérer.
-
1680 : le Père Bernardin essaye d'intéresser Louis XIV à l'île Bourbon.
-
1686 : l'île Bourbon compte 216 personnes.
-
1689 : M. Henri Habert de Vauboulon devient le premier administrateur et législateur de l'île.
-
1700 : Versailles prend en considération cette escale sur la route des Indes. L'île est de plus en plus fréquentée.
-
1704 : l'île compte 734 personnes.
-
1708 : 1re expédition de Moka qui ramène 1 500 tonnes de café du Yémen à Saint-Malo.
-
1712 : 2e expédition de Moka.
-
1715 : la Compagnie des Indes orientales charge Guillaume Dufresne d'Arsel d’implanter à La Réunion des plants de Moka, via la troisième des expéditions de Moka. Dès septembre 1715, six plants de Moka, offerts par le sultan du Yémen, sont ensemencés à Saint-Paul de la Réunion, sous l'autorité du gouverneur de La Réunion Antoine Desforges-Boucher. La Compagnie des Indes orientales organise la production, l'achat de graines, construit des greniers et des routes. Elle offre des concessions gratuites à tout colon de 15 à 60 acceptant d'entretenir 100 plants de café.
-
1718 : nouvelle richesse de l'île, le café fait entrer Bourbon dans la grande aventure de la prospérité économique. Le développement de cette ressource s'accompagne d'un fort courant d'importation d'esclaves.
-
1719 : jusqu'en 1735, l'exportation annuelle de café atteint les 100 000 livres. L'île Bourbon « accueille » 1 500 esclaves supplémentaires par an. Ils proviennent d'Afrique, de l'Inde et de Madagascar.
-
1728 : dans une lettre au ministre de la Marine du 27 avril 1728, le gouverneur de La Réunion Pierre-Benoît Dumas s'enthousiasme : « On ne peut rien voir de plus beau que les plantations de café qui se multiplient à l'infini. Cette île sera dans peu capable d'en fournir au-delà de la consommation du royaume ».
-
1735 : Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais devient le premier gouverneur général des îles de Bourbon et de France. Il transfère le siège du gouvernement de Saint-Denis à Port Louis et de ce fait privilégie l'île de France à Bourbon, car elle bénéficie d'un port naturel, Port-Louis, base navale idéale pour la lutte maritime que se livrent l'Angleterre et la France pour la domination de l'Inde. L'île Bourbon est cantonnée au rôle de pourvoyeuse de l'île de France et des flottes de guerre et de commerce en denrées alimentaires. Il mate les mouvements de résistance en transférant les hommes d'une île à l'autre. Il met en place la chasse aux noirs à La Réunion et organise des milices pour faire des battues et aller « dénicher les marrons ».
-
1738 : Saint-Denis devient le chef-lieu de l'île au détriment de Saint-Paul.
-
1741 : les jeunes de l'île Bourbon sont recrutés pour la guerre contre les Britanniques en Inde.
-
1744 : la production de café atteint 2 500 000 livres. L'île compte 2 500 habitants.
-
1751 : publication de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui définit ainsi l'île Bourbon, encore appelée Mascareigne :
« île d’Afrique dans l’Océan éthiopique à l’orient de l’île de Madagascar. Elle peut avoir 15 lieues de long, 10 de large & 40 de tour. Elle fut découverte par un Portugais de la maison de Mascarenhas. Les François s’y établirent en 1672 ; c’est l’entrepôt des vaisseaux de la compagnie des Indes. Elle est fertile, l’air y est sain, les rivieres poissonneuses, & les montagnes pleines de gibier. On recueille sur le rivage de l’ambre gris, du corail, des coquillages ; mais la fréquence & la violence des ouragans y désolent tous les biens qui sont sur terre3. »
-
1754 :il y a 3 376 blancs et 13 517 esclaves. (recensement effectué par le Conseil supérieur de l'île).
-
1756 : jusqu'en 1763, l'île Bourbon participe au conflit opposant la France à la Grande-Bretagne en Inde.
-
1763 : l'île compte 22 000 personnes dont 18 000 esclaves.
-
1764 :le roi rachète les Mascareignes à la Compagnie des Indes après la faillite de cette dernière. L'île entre pendant 30 ans dans une période économique très faste avec l'exportation des épices et du café.
an 1666 : Ghana - La Compagnie néerlandaise des Indes occidentales fait construire un deuxième fort, le fort Saint-Jacques, à Elmina.
an 1668 : Angola - La guerre entre Kongos et Portugais reprend et se termine en 1668. Le mani-kongo est décapité durant la bataille d'Ambuila et le royaume du Kongo commence à se décomposer. Les Européens ont la maîtrise de l'armement ; ils possèdent des arquebuses à rouet qui leur permettent de tirer plusieurs coups de suite, des armures et des canons, alors que les Africains, certes plus nombreux, n'ont que des fusils à mèche, des lances, des flèches, des machettes, des boucliers, des haches et des massues.
Les Kongos de l'actuelle république démocratique du Congo ont été moins touchés par la traite, car les négriers portugais avaient peur des rapides sur le fleuve Congo. Au cours du XVIe siècle, les Kwanyamas venus du sud s'installent le long du fleuve Kunene.
an 1668 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Le Traité de Lisbonne (1668) met fin à l'annexion espagnole du Portugal et de ses possessions. Le Portugal recouvre son indépendance, mais comme le traité a été négocié et signé grâce à la médiation du roi Charles II d'Angleterre, de nombreuses concessions surtout économiques sont accordées aux Anglais.
an 1671 : Algérie - À partir de 1671, des deys sont désignés à la tête du Diwan par une aristocratie au sein de laquelle rivalisent la taïfa des raïs (les armateurs et capitaines de navire) et les officiers de l'odjak (milice des Janissaires).
an 1671 : Angola - En 1671, les Portugais dominent les armées Mbundu et imposent, à l'issue des combats, un quota d'esclaves à fournir.
an 1672-1693 : Maroc - L'un des plus illustres Alaouites est le sultan Moulay Ismaïl, deuxième souverain de la dynastie, à qui les chroniqueurs et les témoins d'époque s'accordent à donner 26 ans lors de son avènement (1672). Il est le demi-frère de Mohammed Ier et de Moulay Rachid; né d'une esclave noire, Mubaraka bint Yark al-Maghafri, dont il gardera un teint mat prononcé. Son règne se situe entre 1672 et 1727. Moulay Ismaïl succède à son demi-frère Rachid, mort accidentellement à Marrakech. Le règne de Moulay Ismail correspond à une période d'apogée exceptionnelle de la puissance marocaine.
Le sultan impose son autorité sur l'ensemble de l'Empire chérifien grâce à une armée composée de milices d'esclaves originaires d'Afrique occidentale et du pachalik marocain de Tombouctou (les Abid al-Bukhari ou Bouakhers de la Garde noire sultanienne, soldats d'élite dévoués exclusivement à la personne du souverain et qui lui prêtent serment de loyauté et d'obéissance sur le Sahih al-Bukhari). Cette armée noire est comparable par son concept aux janissaires de l'Empire ottoman et aux gholams de la Perse safavide. Les troupes de Moulay Ismail incluent aussi des tribus arabes guich (Oudayas, Cherrardas, Cheragas) cantonnées aux abords des villes impériales et dans les points stratégiques importants, comme la forteresse de Boulaouane ou la citadelle de garnison de Kasba Tadla. Des unités seront également levées parmi les Rifains, réputés pour leurs qualités guerrières, afin de former le Jaysh al-Rifi et de lutter notamment contre les Anglais et les Espagnols.
Dans le système guich, les tribus bénéficient d'exonérations fiscales et de terres agricoles en échange de leur service dans l'armée du sultan, cela aboutissant à la formation d'une caste militaire toute puissante au sein de laquelle le makhzen recrute également une grande partie de son personnel administratif. L'État ismaïlien est donc un pouvoir très solidement établi qui contrôle le pays depuis Meknès, nouvelle capitale impériale en remplacement de Fès et de Marrakech. Sous le règne d'Ismaïl Meknès se dote d'une véritable cité privée qui s'inscrit dans la tradition des anciennes capitales califales de l'Islam classique comme Samarra ou Madinat al-Zahra, avec ses ensembles de palais (Dâr-el-Kbira, Dâr-al-Makhzen), de bassins (Agdal), de mosquées, de jardins, de forteresses et de portes monumentales. Cette structure gigantesque est destinée à abriter le souverain, sa Cour, son harem, sa garde personnelle et l'ensemble des hauts fonctionnaires et dignitaires de son administration.
Ismaïl est souvent comparé à son alter ego européen Louis XIV; par ailleurs le sultan marocain entretient une correspondance suivie avec le roi de France, auquel il demande la main de sa fille, Marie-Anne princesse de Conti, néanmoins sans succès. L'ambassadeur marocain en France en 1699, l'amiral des mers marocaines Abdellah Benaïcha, est l'auteur du premier essai en langue arabe décrivant Versailles et les splendeurs de la Cour royale française. Il suivait de quelques années le baron de Saint-Olon, ambassadeur de France à Meknès en 1693, auteur d'une relation (rapport diplomatique) sur l'Empire de Fez et de Maroc.
an 1679 : Afrique du Sud - Simon van der Stel est nommé commandeur de la ville du Cap. Sous son impulsion, Le Cap devient une colonie de peuplement. Des immigrants néerlandais, allemands, danois, suédois, fuyant la misère et les atrocités commises lors de la guerre de Trente Ans, se joignent aux Burghers. Le territoire que van der Stel doit administrer s'étend de la région du Muizenberg sur l'océan Indien aux montagnes de Steenberg et de Wynberg. Il entreprend de développer l'agriculture en concédant des terres aux burghers, que l'on commence à appeler Boers, afin de développer les cultures et fait planter plus de huit mille arbres.
an 1680 - 1720 : Mayotte - Le temps des « Sultans batailleurs »
Les successeurs d'Aïssa sont des princes swahilis originaires de Paté ou d'Hadramaout se revendiquant Shirazi. Ceux-ci vont abandonner les pratiques matrilinéaires traditionnelle de transmission du pouvoir pour la patrilinéarité. La fin du règne du sultan Omar ben sultan Ali (1643-vers 1680) marque la fin de la prospérité du sultanat de Mayotte. Celui-ci est en effet affaibli par une série d'épisodes contribuant à la ruine et au dépeuplement de l'île : d'une part, les successeurs d'Omar ne vont cesser de se disputer le pouvoir, entraînant des "cascades de révolutions de palais", d'autre part, Mayotte est fréquentée ere 1680 et 1720 par des pirates européens refoulés des Caraïbes. Daniel Defoe attribue à l'un d'entre eux, Nathaniel North, le pillage de Tsingoni en 1701. Cet affaiblissement du sultanat de Mayotte ravive les prétentions du sultanat d'Anjouan à rétablir son hégémonie sur l'archipel. À partir des années 1740, des expéditions armées sont régulièrement dirigées depuis Anjouan sur Mayotte, causant la ruine de nombreuses localités. Enfin, à partir des années 1790, et ce, jusqu'en 1820, Mayotte, tout comme le reste de l'archipel, est pillée par les pirates Malgaches Betsimisaraka et Sakalava, en quête d'esclaves pour alimenter la traite en direction des plantations françaises de l'Ile de France (île Maurice) et de l'île Bourbon (La Réunion).
Les relations avec l'Europe sont pratiquement inexistantes au XVIIIe siècle : ainsi en 1751, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert évoque à peine Mayotte dans un article de deux lignes : « MAYOTTE, ile, (Géog.) Mayota insula, c’est la plus méridionale des îles Comorres. Elle est située, selon M. de Lisle, dans le canal de Mozambique. ». L'article « Comorres » est encore plus court.
Les Anglais, meilleurs explorateurs de l'océan Indien, connaissent un peu mieux l'archipel des Comores : ainsi John Pike, de passage à Mayotte en 1704 sur le navire Interlope Rochester, décrit : « Ils commencent à être plus connus dans le monde qu'auparavant et les gens de Mascate comme ceux de Madagascar viennent faire du commerce avec eux. [De nombreux navires] s'y arrêtent aussi pour faire des rafraîchissements, ce qui les a enrichis. Mais ce qui est pire que tout, d'après ce qu'on m'a appris, c'est que les pirates de Madagascar viennent souvent ici, de sorte que, à cause d'une rencontre toujours possible avec ces coquins, je n'en ferais pas un endroit sûr pour un petit navire seul, bien que le pays soit agréable. »
an 1684 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1684, la dynastie Torwa est renversée par le clan Changamire qui fonde l’empire rozvi
an 1685-1705 : Afrique du Sud - En 1685, le groupe de 800 colons est rejoint par 200 huguenots chassés de France par la révocation de l'édit de Nantes16. Simon van der Stel leur concède des terres riches en alluvions dans les vallées d'Olifantshoek et du fleuve Berg, protégées des vents du large par un grand cirque rocheux, pour y développer la viticulture. Ils créent les « neuf fermes historiques » (La Bourgogne, La Dauphine, La Brie, Champagne, Cabrière, La Terra de Luc, La Cotte, La Provence et La Motte) avec des vignes françaises.
an 1687-1705 : Côte d'Ivoire - En 1687, deux ans après le code noir, des missionnaires et des commerçants français s'installent à nouveau sur le site d'Assinie, à l'extrémité est du littoral, vers la côte de l'Or, mais ils repartent en 1705 après avoir construit et occupé le fort Saint-Louis, de 1701 à 1704, car le commerce des esclaves contre des céréales ne rapporte pas assez. Parmi eux, le chevalier d'Amon et l'amiral Jean-Baptiste du Casse, directeur de la Compagnie du Sénégal, principale société esclavagiste française, débarquent, intéressés par le trafic de l'or, et sont reçus à la cour du roi Zéna. Ils ramènent en France le jeune « prince » Aniaba et son cousin Banga, lesquels sont présentés au roi de France Louis XIV et se convertissent au catholicisme (Aniaba est baptisé par Bossuet, évêque de Meaux). Ils deviennent plus tard officiers dans le Régiment du Roi, avant de retourner à Issiny vers 1700. Aniaba serait devenu en 1704 conseiller du roi de Quita (actuel Togo), se faisant appeler Hannibal.
an 1690 - 1815 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1690, les Portugais sont finalement expulsés par les troupes du Monomatapa. Mais le domaine de l’ancien empire est dorénavant limité à la vallée du Zambèze. Ce qui correspond à l'actuel Zimbabwe restera cependant sous influence Portugaise jusqu'aux environs de 1815, mais les Portugais seront guère nombreux, préférant se concentrer sur les côtes du Mozambique. Les Anglais évincent les hollandais en Afrique du Sud, après 1795, et à l'époque, ils vont commencer à s'intéresser aux terres délaissées par les Portugais, au nord, dont l'actuel Zimbabwe. En 1885, au traité de Berlin, qui partage l'Afrique aux grandes puissances Européennes, les Portugais sont évincés, et l'actuel Zimbabwe passe sous influence Britannique (mais il ne sera colonisé qu'après 1885).
an 1691 : Afrique du Sud - En 1691, le territoire accède au statut officiel de colonie et, en 1700, compte 1 334 habitants blancs alors qu'elle n'en comptait pas plus de 168 en 1670.
Dès la fin du XVIIe siècle, pour pallier la pénurie de main-d'œuvre, des esclaves avaient été importés de Guinée, de Madagascar, d’Angola et de Java ; leurs descendants constitueront le groupe ethnique des « Malais du Cap ». En effet, à cette époque, les premières tribus africaines ne résident pas à moins de 1 000 km à l'est, au-delà de la rivière Kei. Cette absence de Noirs au Cap, ainsi que dans certaines régions de l'intérieur, déclenchera bien plus tard la polémique entre Afrikaners et Noirs quant à l'antériorité de leur présence en Afrique du Sud. Par ailleurs, en raison du faible nombre de femmes d'origine européenne, la compagnie des Indes s'accommode d'abord du métissage matérialisé par les enfants issus de relations ou d'unions entre Néerlandais et Hottentotes. Leur nombre augmente très rapidement, faisant apparaitre un nouveau groupe ethnique bientôt appelé Kaapkleurige (métis du Cap), inquiétant les autorités coloniales. En 1678, un édit met en garde contre les relations intimes entre Européens et indigènes et, en 1685, les mariages mixtes sont l'objet d'une interdiction.
an 1698 : Kenya - À partir de ce substrat multiethnique se développa la culture swahilie, métissage entre la culture arabe et africaine. L'arrivée des Portugais au XVIe siècle remet en cause la prédominance arabe sur la côte, elle-même éclipsée par celle d'Oman en 1698. Le Royaume-Uni quant à lui établit une influence durant le XIXe siècle.
fin XVIIème siècle : Sénégal - Gorée prise par les Anglais puis par les Français.
XVIIIème siècle : Canaries (Îles des) - Les Canaries dans les guerres du XVIIIe siècle
-
La bataille de Santa Cruz de Tenerife (1706) (es) pendant la guerre de Succession d'Espagne.
-
Les attaques de corsaires britanniques à Fuerteventura en 1740 (es), durant la guerre de l'oreille de Jenkins.
-
La bataille de Santa Cruz de Tenerife (1797) menée par l'amiral anglais Horatio Nelson.
L'amiral John Jennings (1664-1743) est vaincu lors d'une attaque contre Santa Cruz de Tenerife en 1706, tout comme le corsaire Woodes Rogers (1679-1732) deux ans plus tard. En 1744, le corsaire Charles Windon attaque Saint-Sébastien de la Gomera et La Palma.
L'amiral Horatio Nelson menace Santa Cruz de Tenerife avec sept grands navires de guerre en 1797, espérant initialement prendre d'assaut le fort central de la ville avec environ 700 hommes. Le plan, basé sur l'improbabilité d'attaquer la position centrale la plus forte du port, est retourné par les défenseurs l'avaient, et l'artillerie portuaire, ensuite repositionnée, coule de nombreuses péniches de débarquement. La troupe complètement trempée et presque sans munitions, qui a néanmoins réussi à débarquer, est piégée par les milices canariennes au milieu de Santa Cruz. Nelson, grièvement blessé au bras droit par des éclats de boulet de canon, doit abandonner, après avoir perdu 226 de ses hommes (noyés ou abattus). Avec beaucoup de chance, son bateau peut rejoindre l'escadre, et le bras blessé de Nelson est amputé à l'épaule par un médecin français, avec une simple scie, sur une table de cabine. Les survivants anglais capturés, avec noblesse, renvoient le général Antonio Gutierrez, qui avait deviné le plan d'attaque de Nelson. Aujourd'hui, le puissant canon de bronze "El Tigre" du musée militaire de Santa Cruz, qui aurait tiré le coup décisif qui a coûté le bras à Nelson, commémore l'unique échec de Nelson.
XVIIIème siècle : République de Centrafrique - La majorité des habitants de la Centrafrique se sont installés sur ce territoire depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les populations de langue soudanaise ont ainsi à cette période migré vers les forêts, pour fuir l'arrivée des guerriers peuls et les marchands d'esclaves. L'esclavage a été malgré tout un fléau omniprésent dans les plateaux de Centrafrique durant le XIXe siècle. Le pays a par la suite été annexé par les expéditions arabes de Bahr al-Ghazal.
XVIIIème siècle : Archipel des Comores - piraterie, invasions malgaches et sultans batailleurs -
Ces raids, restés dans les récits populaires, sont courants jusqu'au début du XIXe siècle. Des sources estiment le nombre des envahisseurs à plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Ces raids sont facilités par l'absence de pouvoir central fort sur ces îles (sauf pour Anjouan). Domoni sur Anjouan est détruite en 1780.
En 1791, le capitaine Pierre-François Péron passe quelques mois dans la région, et assiste notamment à un assaut du sultan d'Anjouan sur Mayotte, qu'il raconte dans ses mémoires. Il précise qu'Anjouan est alors beaucoup plus riche, prospère et puissante que Mayotte, et que cette première île dispose de forts et de maisons en pierre, tandis que la seconde n'a que de petits villages aux cases de terre - les deux îles sont cependant déjà largement armées de sabres et de fusils. Il observe également que les sultans ont le teint clair et probablement des origines arabes, alors que les populations sont plus africaines, sur les deux îles : « Aucun signe extérieur ne distinguait les soldats d'Anjouan de ceux de Mayotte »
La richesse s'accompagne donc bientôt de rivalités politiques entre les quatre îles et leurs « sultans batailleurs », qui donnent lieu à de nombreuses razzias et guerres ouvertes : ainsi de 1742 à 1791, le sultanat d'Anjouan réalise plusieurs tentatives pour conquérir le sultanat de Mayotte, et vole notamment le minbar en bois sculpté de la mosquée de Tsingoni. Aucun sultan ne parvient jamais à unifier les quatre îles, et ces rivalités affaiblissent profondément l'archipel. De 1795 à 1820, les razzias des pirates malgaches (Sakalaves et Betsimisarakas) dépeuplent considérablement les trois îles mineures, et font sombrer l'archipel dans une grave crise économique, rapidement doublée d'une crise politique, marquée par de nombreux assassinats de sultans et prises de pouvoir par des souverains étrangers (malgaches, zanzibariens, omanais...). En particulier, le roi sakalave du Iboina à Madagascar, Andriantsoly, offre sa protection au sultan de Mayotte Bwana Combo en échange de la moitié de son île, mais l'expulse ensuite à Mohéli. Celui-ci tenta alors de s'allier au sultan local d'origine malgache le hova Ramanetaka (devenu le maître de Mohéli sous le nom d'Abderahmane), qui préféra cependant le spolier pour devenir co-sultan de Mayotte à sa place. Ambitieux, il chasse Andriantsoly de Mayotte en 1836 pour régner sans partage sur l'île, mais regagne ensuite Mohéli. Andriantsoly s'allie alors au sultan Abdallah d'Anjouan pour récupérer l'île. Andriantsoly souhaite préserver l'autonomie de son île face aux autres souverains comoriens, et la protéger des attaques de pirates : or, dépourvu d'allié contre ces derniers et contre la monarchie malgache soutenue par la Grande-Bretagne, il se sait menacé. Il se tourne alors vers les rivaux des Britanniques, les Français, qui, eux aussi présents à Madagascar depuis 1643, viennent de s'emparer de Nosy Be.
XVIII et XIXème siècle : Eswatini (Swaziland) - Les Dlamini étaient un clan issu du peuple Nguni et s'étaient établis à l'origine au Mozambique. Au milieu du XVIIIe siècle, le roi Ngwane III avait mené son peuple à proximité de la rivière Pongola, dans le Swaziland méridional actuel. C'est de cette époque que date la naissance de la nation swazi dirigée par le clan Dlamini. Le clan Dlamini émergea politiquement au début du XIXe siècle lors du mfecane, consécutif à l'expansion zoulou. Le roi Sobhuza Ier, qui avait succédé à Ngwane III, s'était retiré dans la vallée d'Ezulwini, où il protégea son peuple des visées impériales de Chaka Zulu puis de son successeur Dingane (bataille du Lubuya en 1839).
XVIII et XIXème siècle : Mauritanie - L'espace mauritanien commence à décliner inexorablement, et c'est finalement avec les dynasties Peuls du XVIIIe et XIXe siècle que le commerce transsaharien perd définitivement sa raison d'être, la colonie française du Sénégal, de Côte d'Ivoire ou du Dahomey font désormais partie du commerce.
Les esclaves et la gomme arabique y sont les principales marchandises convoitées.
XVIIIème siècle : Namibie - Dans le courant du XVIIIe siècle, les tribus ovambos se constituent en royaume. Les guerres deviendront incessantes entre les royaumes tribaux que ce soit pour des raisons économiques ou dynastiques. Les vaincus sont parfois réduits en esclavage, alimentant le large trafic qui sévit jusqu'au XIXe siècle dans cette région de l'Afrique.
XVIIIème siècle : Seychelles - Parallèlement, la colonisation des Seychelles par les Français se met en place. Ils sont déjà installés à la Réunion et à l’île Maurice. Au milieu du XVIIIe siècle, une expédition est menée par le capitaine Nicolas Morphey, qui prend possession de l’archipel des Seychelles au nom du roi de France.
A la fin du XVIIIe siècle, les Anglais s’emparent de Mahé. Les Seychelles passent sous contrôle britannique et le restent jusqu’à la déclaration d’indépendance en 1976.
XVIIIème siècle : Togo - Les Portugais pratiquent rapidement un commerce actif et la traite négrière se développe le siècle suivant, autour du comptoir nommée Petit-Popo (actuel Aného). Au XVIIIe siècle, les Danois venus de Christianenborg (l'actuelle Accra), s'implantent à leur tour. Ils sont suivis, à partir des années 1780-1800, par des groupes de Hollandais, par de nombreux « Brésiliens », des anciens esclaves libérés et rapatriés du Brésil ou des descendants de Portugais installés au Togo, qui participent aux échanges côtiers. Francisco Félix de Sousa, par exemple, important trafiquant d'esclaves brésilien, qui s'établit à Petit-Poto (futur chacha du Dahomey, l'actuel Bénin), fait fortune dans le commerce du tabac, du rhum, des tissus et dans la traite des esclaves.
XVIIIème siècle : Zambie - Les premiers non-Africains à entrer dans le pays sont les Portugais au XVIIIe siècle, suivis des commerçants arabes. En 1798, l’explorateur portugais Francisco José de Lacerda e Almeida dirige la première expédition scientifique menée par des Européens en Afrique. Le but de l'expédition de Lacerda e Almeida est de relier les deux territoires portugais de la région, le Mozambique à l'est, et l'Angola à l'ouest. Parcourant plus de 1 300 kilomètres depuis Tete, il atteint Kazembe, alors partie du royaume Lunda, où il succombe à des fièvres en octobre 1798. L'expédition, désormais sous le commandement du père Francisco João Pinto, retourne à Tete sans essayer de poursuivre jusqu'en Angola. Le journal d'expédition de l'explorateur est sauvé et rapporté à Tete. Il est traduit en anglais par Richard Francis Burton et publié dans un ouvrage intitulé The Lands of Cazembe: Lacerda´s journey to Cazembe in 1798. Pendant un demi-siècle, ce document constitue l'unique témoignage européen concernant cette région, jusqu'aux voyages de l'explorateur écossais David Livingstone à partir de 1851.
an 1700-1767 : Maroc - Les rapports entre les deux pays connaissent une phase de déclin en raison de l'échec des rachats des captifs chrétiens par les missions religieuses catholiques, et en raison également du sort des galériens musulmans retenus en France. Le rapprochement entre la France et le Maroc avait été motivé par l'opposition des deux pays envers l'Espagne de Charles II, mais l'accession au trône espagnol de Philippe V (Philippe de France, comte d'Anjou), petit-fils de Louis XIV, en 1700, met fin à cette entente. Par conséquent les liens diplomatiques officiels sont rompus entre Meknès d'une part et Paris et Madrid d'autre part en 1718, sous l'impulsion du Régent de France Philippe d'Orléans. Ils ne seront rétablis qu'en 1767. Ismaïl considère en effet la monarchie franco-espagnole des Bourbons comme désormais entièrement hostile aux intérêts du Maroc. La France est donc supplantée dans l'Empire chérifien par la Grande-Bretagne du roi George Ier de Hanovre, ce que concrétise la brillante ambassade britannique du commodore Charles Stewart et de John Windus à Meknès en 1721, qui est l'occasion de resserrer les liens d'amitié et de coopération avec Londres.
Ismaïl mène une lutte continuelle contre les seigneurs de guerre comme Khadir Ghaïlan et les derniers Dilaïtes vaincus en 1677, et contre les tribus rebelles du Moyen et du Haut-Atlas (qu'il finit par soumettre), mais aussi contre les ennemis extérieurs : les Espagnols qui occupent Mehdia, Larache et Assilah, les Anglais de la colonie britannique de Tanger jusqu'en 1684, et les Ottomans du dey d'Alger qui convoitent Oujda et les provinces orientales marocaines. Le sultan étend l'autorité chérifienne sur la Mauritanie jusqu'au fleuve Sénégal grâce au concours des émirs maures et hassanis de l'Adrar, du Trarza, du Tagant et du Brakna, réaffirmant la souveraineté du makhzen sur le pays de Bilad Chenguit et de Tichitt. À l'est, les oasis du Touat jusqu'à In Salah reconnaissent l'autorité du pouvoir central de Meknès, dont les troupes mènent des offensives contre les forces turques d'Algérie, dans la région de l'Oranie et jusqu'au Djebel Amour, notamment en 1678 et en 1701. Des traités sont conclus avec les Ottomans, qui mettent fin aux revendications marocaines sur Tlemcen et fixent la frontière entre l'Empire chérifien et le Deylik d'Alger sur l'Oued Tafna. Durant les années 1700, Ismaïl livre également des campagnes militaires contre quelques-uns de ses propres fils désireux de se tailler des principautés dans le Souss, à Marrakech et dans l'Oriental, comme les princes Moulay Mohammed, Moulay Zidan et Moulay Abdelmalek, ainsi qu'il avait fait face précédemment à son neveu Ahmed ben Mehrez vaincu à Taroudant en 1687.
an 1700 : Mayotte -
Les sultans : Aboubakar ibn Umar - vers 1700 - 1727
an 1703-1727 : Mauritanie - En 1703 et 1727, l'émir du Trarza, Ali Chandora prête allégeance à Moulay Ismail en se rendant à Meknès et reçoit sa protection, ainsi, Ali Chandora se disait parent de tous les pays situés entre le Cap Blanc et le Sénégal.
an 1704 - 1706 : Canaries (Îles des) - Catastrophes naturelles
Sur Ténérife, en 1704-1705, des éruptions ont lieu près de Fasnia, Arafo/Las Arenas et Siete Fuentes, précédant l'éruption du volcan Trevejo en 1706 (Arenas Negras), près de Garachico (Tenerife).
an 1706 : Afrique du Sud - La première révolte des Boers contre les méthodes de gouvernement et la corruption du gouverneur Willem Adriaan van der Stel aboutit, non seulement au renvoi de ce dernier, mais aussi à l'arrêt de l'immigration européenne en Afrique du Sud. Certains Boers, nés en Afrique, revendiquent même leur africanité (ek been ein afrikander comme le jeune Hendrik Bibault (1707)). La Compagnie des Indes, en mettant un terme à l'immigration européenne, veut réorienter la colonie vers son utilité originelle, celle de station de ravitaillement et éviter le développement d'un foyer de peuplement revendicatif. À cette fin, elle entreprend également de monopoliser les débouchés commerciaux de la colonie, de fixer les prix des productions locales et d'imposer une administration de plus en plus tatillonne et procédurière. Cette politique restrictive de harcèlement encourage cependant l'esprit libertarien chez les colons libres et les paysans néerlandais natifs de la colonie. La société coloniale alors en place se segmente en trois catégories, déterminées par leur lieu de vie en fonction de la distance à la ville du Cap. Les premiers sont les habitants du Cap, qui conservent des liens étroits avec leur métropole d'origine. Ils sont urbains et cosmopolites, et transmettent jusqu'à nos jours la culture dite Cape-dutch. La deuxième catégorie comprend tous ceux qui résident dans la région du Cap (les vrijburgers ou citoyens libres) et qui cultivent la terre. La troisième catégorie est constituée de trekboers (paysans nomades) qui pratiquent l’élevage extensif. Ils sont souvent semi-nomades et ont un mode de vie similaire aux tribus autochtones. Ils vivent dans des chariots bâchés tirés par une paire de bœufs. Repliés sur eux-mêmes, pratiquant un calvinisme austère et menant une vie fruste et dangereuse, les Trekboers cherchent à échapper au contrôle oppressif de la Compagnie en franchissant les frontières de la colonie du Cap pour s'établir hors de sa juridiction, dans l'intérieur des terres. Ils élaborent une culture originale, influencée par l'immensité désertique où ils vivent, et abandonnent progressivement le néerlandais pour une nouvelle langue, l'afrikaans, mélange de dialectes hollandais, de créole portugais et de khoikhoi inventé par les métis du Cap.
Au XVIIIème siècle, les Trekboers fondent aussi des villes, celles de Swellendam et de Graaff-Reinet, en dépit d'accrochages meurtriers avec les peuples autochtones khoïkhoïs et san, obligeant la colonie du Cap à fixer de nouvelles frontières situées au-delà des implantations boers les plus importantes.
an 1710 : Algérie - En 1710, les deys prennent le titre de pacha et n'acceptent plus les représentants du Sultan à leurs côtés, affirmant ainsi leur indépendance de la Sublime Porte et imposant leur autorité aux raïs et aux janissaires. C'est lors de cette période que se stabilisent définitivement les frontières orientales et occidentales de la régence.
Le diwan d'Alger, gouvernement local, se stabilise notamment à partir de l'instauration du système des pachas-deys en 1710 avec des fonctions bien organisées : le dey (chef du pouvoir exécutif) ; le khaznadji (Premier ministre, responsable des finances et de l'intérieur) ; l'agha al-mahalla (à la tête de l'armée et responsable des relations avec les tribus) ; wakil al Kharadj (chargé de la marine et des affaires extérieures) ; bait el maldji (chargé des successions) ; khodjet al khil (chargé de la gestion des domaines publics et de la gestion des troupes) ; ainsi que d’autres secrétaires d'État ; des caïds et des khodjas qui gèrent des secteurs spécialisés.
La course d'Alger, qui a connu son plus grand essor dans les premiers siècles de la régence, connaît un grand déclin dès le début du XVIIIe siècle, le pouvoir trouve dans le commerce extérieur, qui se développe, une nouvelle source de revenu. À la fin du XVIIIe siècle, les besoins grandissants de la France en céréales coïncident avec des récoltes abondantes en Algérie. Les avantages tirés des échanges économiques conduisent à des rapports pacifiques avec les États européens. Cela permet de réduire les actions de course. Les seules cibles permanentes de la course d'Alger s'orientent vers des pays en guerre avec elle, à savoir l'Espagne, le Portugal, Malte et certains petits États italiens ou nordiques.
Ce changement de cap a été amorcé dès les années 1690 par le dey Hadj Chabane, qui s'est détourné de la course pour se mobiliser dans des guerres maghrébines. Sa politique est poursuivie par le dey Hadj Mustapha qui remporte des victoires écrasantes sur les armées conjointes de Tunis et de Tripoli en 1700, puis sur l'armée du sultan chérifien Moulay Ismaïl en 1701, qui s'étaient entendues pour envahir simultanément la régence.
La très grande majorité de la population est rurale, affiliée à des tribus et autres communautés villageoises et encadrée sur le plan culturel et religieux par les confréries religieuses, les zaouïas et les marabouts. La principale activité économique est l'agriculture de subsistance ainsi que l'élevage. Certaines tribus dites makhzen bénéficient de privilèges en échange du service militaire dans le but de prélever des impôts sur les tribus raya (assujeties).
an 1710 : Ile Maurice - Période hollandaise (1598-1710)
En 1710, les Hollandais abandonnent volontairement Maurice après avoir pillé la faune et la flore locale. La chasse intensive et l'introduction d'espèces prédatrices telles que les chats, rats, chiens et autres a fait disparaître des espèces animales comme le célèbre dodo (apparenté aux pigeons et appartenant à la famille des raphidés) ou l'espèce endémique de tortue géante.
Deux perspectives historiques divergent ici, l'une, européo-centrée, estimant que les Hollandais abandonnent volontairement Maurice pour des raisons de manque de perspective, tandis que l'autre, plus générale, considère que les Hollandais se font chasser de l'île par les nègres marrons désormais présents sur l'île.
L’abattage systématique des arbres a quasiment épuisé les ressources en bois précieux (causant en particulier l'épuisement du bois d'ébène). Les cyclones tropicaux récurrents détruisent les plantations, les rats, les chèvres et les cochons qui ont été importés ont bouleversé l’équilibre naturel et engendré des ravages parmi les espèces autochtones. Dans le même temps, la nouvelle colonie installée par les Hollandais au cap de Bonne-Espérance semblait promettre des perspectives de développement bien supérieures.
D’un point de vue linguistique, il ne reste du passage des Hollandais sur l’île que quelques toponymes : outre le nom de l’île lui-même, les districts des plaines Wilhems et de Flaq ou le Pieter Both.
an 1711-1840 : Libye - En 1711, la Régence tombe entre les mains de la famille Karamanli, lorsqu'Ahmad Ier élimine le pacha envoyé par le gouvernement de Constantinople, puis parvient à se faire reconnaître par le sultan Ahmet III. Les trois premiers pachas de la dynastie Karamanli sont efficaces, et la régence de Tripoli, gouvernée à la manière d'un État très largement autonome, accède à une certaine prospérité. Les ports de Tripoli, Benghazi, Misrata et Derna constituent des étapes importantes sur la route du commerce maritime en Méditerranée. Mais à partir de 1790, la famille régnante est divisée par de violents conflits, et des révoltes éclatent à partir de 1816. En 1835, le sultan Mahmoud II dépose la famille Karamanli, remplaçant le dernier pacha de la dynastie par un envoyé de Constantinople. L'administration de la Tripolitaine est réorganisée, mais le pouvoir continue d'être trop détaché des réalités du pays. Vers 1840, Muhammad ibn 'Ali al-Sanusi, originaire de Mostaganem, se fixe en Cyrénaïque et y fonde sa propre zaouïa. Son action contribue à apaiser les rivalités entre tribus et la confrérie de la famille al-Sanussi gagne en puissance dans le Fezzan et le Djebel Akhdar.
an 1712 : Cap Vert - Pirates et corsaires font escale au Cap Vert. La ville de Ribeira Grande, première ville à l'origine de la naissance de l'archipel du Cap Vert décline définitivement après une attaque de Jacques Cassard, corsaire français en 1712. Il prend le fort construit par la couronne portugaise pour garder la ville et pille la ville et sa vallée verdoyante pendant un mois. « Il ruina complètement Santiago, entrepôt du commerce des Portugais avec la côte occidentale d'Afrique. Il y fit un si grand butin, à ce que disent les Mémoires du temps, que, pour ne pas surcharger son escadre, il dut en abandonner une partie, qu'on évalua à plus d'un million de francs. (Bescherelle 1868, p. 57)». La population fuit définitivement la ville pour se réfugier à Praia , dont le "plateau" hors d'atteinte des canons des bateaux pirates offre un refuge sûr et bien défendu.
an 1713-1755 : Afrique du Sud - En 1713 et 1755, deux épidémies de variole ravagent la colonie, tuant un millier de Blancs mais décimant les peuples Khoïkhoïs. Au bout de 60 ans de nomadisme et de progression ininterrompue, les Trekboers se retrouvent bloqués au nord par l'aridité extrême du Namaqualand, au nord-est par le fleuve Orange où les tribus San leur opposent une forte résistance, déterminés à sauvegarder leur territoire de chasse, et à l'est, où les Trekboers atteignent la Great Fish River, à 1 500 km de la cité-mère, et se heurtent à des peuples bantous, en l'occurrence de puissantes chefferies Xhosas.
an 1715 : Ile Maurice - Période française (1715-1810)
Les Français s'installent pour la première fois dans l’océan Indien en 1643, sur la pointe sud de Madagascar, dans la garnison de Fort-Dauphin. De là, des mutins sont envoyés à plusieurs reprises en exil à l’île Maurice où le nombre de Hollandais restait faible. À partir de 1663, on note les premières tentatives françaises d’habiter durablement l’île. Après quelques péripéties, deux Français et dix esclaves s’y installent. Au cours des décennies suivantes n’arrivent que des groupes isolés de colons à Maurice, en provenance de Bretagne et de Madagascar.
En septembre 1715, la France, dont le commerce avec les Indes orientales est harcelé par la piraterie qui sévit dans la région, envoie un bateau de guerre stationner à Maurice afin d'en prendre possession. Cela ne présente pas de difficultés particulières, les Hollandais ayant presque totalement quitté l’île en 1710. Le malouin Guillaume Dufresne d'Arsel est chargé de cette mission par le Secrétaire d'État à la Marine, Pontchartrain, et prend possession de l'île au nom de Louis XIV le 20 septembre. Dès lors, Maurice est rebaptisé « l’Isle de France ». Il ne s’agissait pas pour la France de faire de l’île une colonie de peuplement, mais de disposer d’une base arrière afin de sécuriser les transports commerciaux avec les Indes.
an 1721-1769 : Ile Maurice - Période française (1715-1810)
En 1721, l’administration de Maurice est confiée à la Compagnie française des Indes orientales qui prend possession de l’île dans le but de la coloniser et y installe quinze colons et un prêtre. Puis d’autres colons et esclaves sont envoyés depuis La Réunion, la France métropolitaine et Madagascar. On sait que, pour concurrencer les autres pays européens, Louis XIV et Colbert avaient créé la Compagnie des Indes orientales en 1664. Afin d'attirer des capitaux, ils lui avaient accordé un monopole commercial dans l'océan Indien pendant 50 ans et lui avaient cédé la souveraineté sur Madagascar, ainsi que sur les îles voisines et les futurs territoires à conquérir. En 1725, les Français annexèrent l'île Rodrigues qui fut occupée en permanence à partir de 1735. À rappeler, par ailleurs, que l'île Bourbon (appelée aujourd'hui La Réunion) avait reçu ses premiers colons en 1665.
« La première langue qui parvint à Maurice fut donc le français, ou plus exactement des dialectes des régions côtières de la France […] Du contact entre les colons français et leurs esclaves naquit bientôt le parler créole, un créole à base lexicale française dont les premières attestations imprimées datent de 1749 et 1769. »
Dès le début de la colonisation française à l'île de France, surtout entre 1721 et 1735, des centaines (entre 400 et 600) d'esclaves en provenance du Sénégal et de la Guinée arrivèrent sur l'île. En 1723, le célèbre Code noir de 1685 fut adapté à l'usage des Mascareignes et les lettres patentes de Louis XV, en forme d'édit, furent enregistrées à l'île Bourbon (La Réunion) dans la ville de Saint-Paul, le 18 septembre 1724, par le Conseil supérieur de Bourbon. Ce nouveau Code noir adapté à la situation de l'île Bourbon et de l'île de France favorisa, dès 1725, l'arrivée de milliers d'esclaves qui venaient en majorité de l'île de Madagascar et de l'Afrique orientale pour y cultiver le café et les plantes à épices. Cette main-d'œuvre abondante paraissait nécessaire pour permettre à la Compagnie des Indes orientales de poursuivre l'expansion économique de l'Océan Indien.
an 1727-1757 : Maroc - De 1727 à 1757 le Maroc connaît une grave crise dynastique au cours de laquelle les Bouakhers font et défont les sultans, tandis que les tribus guich se soulèvent et razzient les villes impériales. Les autres tribus profitent de l'anarchie pour entrer en dissidence (siba). De cette période troublée émerge la personnalité du sultan Abdallah II, renversé et rétabli à plusieurs reprises entre 1729 et 1745. Sa mère la sultane douairière Khnata bent Bakkar, veuve de Moulay Ismail issue de l'une des plus prestigieuses tribus des provinces sahariennes, joue alors un rôle prédominant de régente et tente de préserver les institutions fondamentales de l'Empire chérifien. Abdallah doit subir les sécessions de ses demi-frères qui établissent des quasi-royaumes dans les provinces qu'ils dominent (Gharb, Fès, Marrakech, Tafilalt), avec l'appui des différentes factions armées des Bouakhers ou des tribus militaires guich. Les habitants de Salé et de Rabat renouent avec l'autonomisme corsaire, tandis que les pachas successeurs du puissant émir militaire Ali Ben Abdallah du Jaysh al-Rifi établissent une véritable dynastie qui contrôle Tanger et Tétouan. Les confédérations tribales berbères des Moyen et Haut-Atlas, naguère soumises au makhzen ismailien (comme les Aït Idrassen, les Zemmours, les Aït Immour et les Guerrouanes), se constituent en blocs politiques et s'emparent du trafic caravanier qui relie les villes commerçantes aux oasis sahariennes et au Soudan marocain. Les gouverneurs de Tombouctou profitent également de la crise dynastique pour se comporter en princes indépendants et négocier séparément avec les Touaregs et les Peuls, ce qui affaiblit considérablement l'autorité marocaine dans la région de la boucle du Niger.
an 1727 : Mayotte -
Les sultans : Salimou ibn Mwé Fani - 1727 - 1750
an 1729 - 1811 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - De 1729 jusqu’au milieu du XIXe siècle - La domination des sultans omanais
Ce sont donc les Arabes du sultanat d’Oman qui contrôlent désormais la région. Pour les cités de la côte, après avoir subi la domination des Portugais, il n’est pas facile de devenir les vassaux d’un sultan situé à plus de 3000 km au nord, au bout du Golfe Persique. Certaines, comme Mombasa où règne la puissante famille Mazrui, ont même la tentation de faire appel aux anciens occupants, les Portugais, pour se débarrasser de l’envahisseur arabe. Surtout que, en Oman, le régime est affaibli par des luttes de succession entre dynasties pour la récupération du trône.
Sur le plan économique, le XVIIIe siècle signe plutôt un déclin pour la région, même si le lucratif commerce d’esclaves noirs, qui existe depuis environ un millénaire en Afrique de l’est, prend de plus en plus d’ampleur (voir l’article sur la traite musulmane). Il s’agit notamment de répondre aux besoins croissants en domestiques à destination de l’Arabie et du golfe Persique et de fournir de la main-d’œuvre aux notables de Zanzibar et de Pemba pour travailler dans les plantations. Il s’agit aussi d’alimenter les Européens pour leurs nouvelles colonies insulaires de l’océan indien. La France est un client régulier pour ses plantations de cannes à sucre sur l’île Bourbon (aujourd’hui île de la Réunion) ou l’île de France (île Maurice). Les caravanes vont chercher les esclaves noirs dans l’intérieur du pays, en évitant les régions dominées par la tribu masaï qui a la réputation d’être un peuple féroce. Deux routes principales sont empruntées. La première, au sud, passe à proximité du lac Malawi pour rejoindre Kilwa. L’autre, plus au nord, part du lac Victoria, pour amener ivoire et esclaves à Bagamoyo. Ce commerce devient si important qu’un vaste marché aux esclaves est construit en 1811 à Zanzibar.
an 1730 - 1736 : Canaries (Îles des) - Catastrophes naturelles
Sur Lanzarote, en 1730-1736, le volcan Timanfaya entre dans une longue période éruptive, avec la formation de 300 cratères.
an 1730 : Mauritanie - Dès 1730, Moulay Abdallah mènera annuellement plusieurs expéditions à Chinguetti jusqu'au fleuve Sénégal et Thomas Pellow raconte comment les Marocains firent trois expéditions de suite sur la vallée du Sénégal sans y rencontrer la moindre résistance
an 1735-1746 : Ile Maurice - Période française (1715-1810) - 1735-1746 : La Bourdonnais impose la suprématie française dans la région
Il faut attendre l’arrivée d’un nouveau gouverneur, le comte Mahé de La Bourdonnais, pour que la nouvelle colonie commence à prospérer. Son arrivée en 1735 marque le début de la période de suprématie française dans l’océan Indien. Il fait construire des fortifications et un port à l’emplacement de ce qui est aujourd’hui Port-Louis et y déplace son quartier général. Cinq navires de guerre, 1 200 marins et 500 soldats sont stationnés là. Des marins (surtout originaires de Bretagne et de Normandie) s'installent sur l'île et y font souche, les premiers entrepôts et magasins sont ouverts. Port-Louis s'étend et devient le chef-lieu des établissements français de toute la région.
Mahé de La Bourdonnais fait venir des engagés indiens depuis la péninsule pour travailler dans les plantations. En quelques années, l’île sauvage devient une colonie rentable. La Bourdonnais favorise l'exploitation des forêts pour le bois d'œuvre (et des chantiers navals), la production de café, d'indigo et de poivre. De grandes plantations sucrières (canne à sucre) administrées par des colons venus de France et de l'île Bourbon, avec des demeures de style colonial, commencent à être exploitées.
Alors que l'île de France ne comptait que 1 000 habitants en 1735, elle atteignait en 1767 les 20 000 habitants, dont 15 000 esclaves. L'île Bourbon (La Réunion) en comptait 8 000 (dont 6 000 esclaves). Les historiens ont établi que la période d'émergence du créole mauricien se situait entre 1721 et 1769. C'est ce qui expliquerait que le créole mauricien d'aujourd'hui contient encore des mots d'origine sénégalaise provenant en réalité de la langue wolof. Ce créole contient en outre de grandes quantités de mots malgaches et comoriens, car un grand nombre d'esclaves provenaient aussi de Madagascar et des Comores.
À partir de 1735, le gouverneur Mahé de La Bourdonnais fait peupler l'île Rodrigues, avec comme mission le ramassage de tortues et leur chargement sur les bateaux de la Compagnie des Indes orientales. Mais Rodrigues connut son véritable peuplement à partir de 1760. Une garnison française y résida même en permanence ; l'île comprenait alors des colons blancs et des esclaves.
La Bourdonnais participe de plus aux batailles maritimes contre les Anglais à la tête d’une flotte opérée par 3 000 hommes. Le gouverneur général des Indes, à qui il fait de l’ombre, s’arrange pour le destituer en 1746. La Bourdonnais est rapatrié en France pour être jugé. Accusé d’avoir été corrompu par les Anglais, il finit par être réhabilité, mais seulement après avoir passé quelques années en prison.
La guerre de Sept Ans (1756-1763) et la défaite française face à l’Empire britannique marquent la fin de la prospérité pour « l’Isle de France ». La Compagnie des Indes étant proche de la ruine, elle est contrainte à la rétrocession des Mascareignes au roi de France en 1767.
an 1740 : Mayotte - Rivalités entre les sultanats d’Anjouan et de Mayotte
À partir des années 1740, le sultanat de Mayotte subit les attaques répétées de son voisin anjouanais. La chronique du cadi Omar Aboubacar ignore pourtant cet aspect historique : cet auteur, « protégé » du sultan d’Anjouan Salim Ier, attribue davantage la ruine du sultanat aux razzias malgaches. Les sources historiques européennes signalent pourtant à plusieurs reprises ces incursions dont le principal enjeu est la capture d’esclaves qui sont ensuite vendus aux trafiquants négriers français. Parfois ceux-ci fournissent une aide précieuse lors de ces incursions et reçoivent comme salaire du sultan d’Anjouan des centaines de captifs.
L’origine de ces incursions est cependant liée à des querelles dynastiques, remontant à la fin du XVIIe siècle, lorsque Echati, une fille du sultan de Mayotte, Omar ben Ali, épouse un haut notable anjouanais Houssein Mwé Fani. Leur fille règne sur Mayotte au début du XVIIIe siècle sous le nom de sultane Mwanao binti Mwe Fani. Mais celle-ci est évincée du pouvoir par son oncle, Aboubakar ben Omar. On comprend alors le désir de Salim Ier de placer sur le trône de Mayotte un descendant d’un haut dignitaire anjouanais dont la famille est connue pour sa fidélité au sultan et l’exercice de très hautes fonctions à Anjouan (gouverneur de Mutsamoudou et commandant des armées…).
C’est ainsi que le second fils de Mwe Fani, Salimou ben Mwé Fani, renverse son oncle Aboubacar avec l’aide anjouanaise et devient sultan de Mayotte. Cette conquête s’est certainement déroulée en 1727, d’après les écrits de Mathieu de Gesnes.
an 1743 : Seychelles - Entre l'Afrique et l'Asie, les îles furent utilisées par des pirates avant l'arrivée des Français. En novembre 1743, le gouverneur de l'Isle de France (l'île Maurice actuelle) Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais envoie les capitaines Lazare Picault et Jean Grossen prendre possession de l'archipel au nom de la France. Ils nommèrent l'île principale de l'archipel « Mahé » en l'honneur du gouverneur de l'Isle de France.
an 1747 : Cap Vert - La première sécheresse frappe le Cap-Vert en 1747 – par la suite, le pays en connaît une tous les cinq ans en moyenne. La déforestation et les cultures intensives, ainsi que la multiplication d'animaux importés et relâchés dans la nature (vaches, chèvres, moutons) pour ravitailler à l'origine les navires de passage, aggravent la situation en détruisant la végétation qui retenait l’humidité, au point de créer un climat semi-aride. Au cours du XVIIIe puis du XIXe siècle, trois grandes sécheresses provoquent plus de 100 000 morts. Le gouvernement portugais n’envoie presque aucune aide pendant ces famines.
L'implantation de comptoirs européens directement sur les côtes africaines (Gorée, Gambie, iles de Loos, etc.) a pour effet de mettre progressivement fin au trafic négrier via le Cap Vert, qui perd son rôle d'escale négrière, les navires rejoignant directement les Amériques depuis les côtes.
an 1750 : Mayotte - Rivalités entre les sultanats d’Anjouan et de Mayotte
le nouveau sultan Salim très vite va se retourner contre le sultanat d’Anjouan, refusant de faire allégeance au nouveau sultan d’Anjouan Ahmed, successeur du sultan Salim. Il s’ensuit une nouvelle incursion militaire anjouanaise qui cette fois-ci se solde par un cuisant échec lors de la bataille de Zidakani (petite cuvette à l’ouest de Tsingoni) vers 1750.
an 1750 : Namibie - En 1750, Jacobus Coetse, un chasseur d'éléphants du Cap, est le premier Africain d'origine européenne à traverser le fleuve Orange, ouvrant ainsi la voie aux chasseurs, aux explorateurs et aux missionnaires.
an 1751 : Archipel des Comores - Les relations entre l'archipel des Comores et l'Europe sont encore pratiquement inexistantes au XVIIIe siècle. Ainsi en 1751, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert évoque à peine « Les îles Comorres » dans un article de deux lignes : « COMORRES, (les isles) Géographie. moderne île de la mer des Indes, dans le canal de Mozambique, entre le Zanguebar & l’île de Madagascar. ». L'article « Mayotte » n'est pas plus détaillé.
an 1752 : Mayotte -
Les sultans : Bwana Kombo ibn Salim - 1752 - vers 1790
an 1752-1840 : Mozambique - Dans le courant du XVIIe siècle, les Portugais instituent les prazos, qui proviennent au départ de dons de terres que les chefs africains accordent à des aventuriers portugais en échange de leurs services. Le gouvernement portugais, à son tour, distribue des prazos da Coroa (plantation de la Couronne) à ses serviteurs les plus loyaux, qu’il charge de pacifier les territoires concédés et qui doivent, en principe, payer des taxes. En 1752, le territoire du Mozambique est doté d'une administration coloniale autonome. Mais cette administration coloniale demeure liée à une structure d'occupation militaire, dépourvue de lois et abandonnée à l'arbitraire des représentants de la métropole. Au début du XIXe siècle, les descendants des prazeiros, presque tous métissés, vivent sur leurs terres en véritables potentats, ne reconnaissant plus que nominalement l'autorité de l'administration coloniale. Ils obligent les chefs noirs à payer un tribut en ivoire et en esclaves et devant la précarité croissante de leur condition, les Africains fuient leurs villages, augmentant l’insécurité. À partir des années 1840 et jusque la fin du XIXe siècle, l'administration coloniale portugaise lutte contre ces familles de prazeiros et la conception féodale des concessions qu'ils ont obtenus. Les prazos eux-mêmes existent jusqu'au XXe siècle en tant qu'unités de politique fiscale et administrative.
an 1755 : Canaries (Îles des) - Catastrophes naturelles
Le séisme du 1er novembre 1755 à Lisbonne provoque un très puissant tsunami qui ravage une parie des côtes marocaines et des archipels atlantiques, dont les Açores. La documentation manque en ce qui concerne les Canaries.
an 1756 - 1772 : Seychelles - Le 1er novembre 1756, Corneille Nicolas Morphey, commandant de l'expédition des découvertes et capitaine de la frégate le Cerf, a pris possession des îles au nom du roi de France, sur l'ordre de René Magon de La Villebague, gouverneur et commandant général des îles de France et de Bourbon. Les principales îles de l'archipel qu'ils baptisèrent « Séchelles » en honneur à Jean Moreau de Séchelles, alors contrôleur général des finances de Louis XV. Les commandants et agents civils des îles sous l'autorité des intendants des îles de France et de Bourbon ont été Jean François Brayer du Barré en 1770, Jean-Charles de Launay de La Perrière commandant de 1772 à 1775, Joseph François Eugène Benjamin Anselme de 1775 à 1777, Jean-Baptiste Le Roux de Kermeseven de 1777 à 1781, Charles Routier de Romainville (1739-1808) de 1781 à 1783, Louis François Claude Berthelot de la Coste (1750-1822) de 1783 à 1786, puis, Gillot, de Caradec, Louis Jean Baptiste Philogène de Malavois (vers 1757-1825) de 1792 à 1793, Charles Joseph Esnouf commandant en 1793, Jean-Baptiste Quéau de Quinssy gouverneur de 1793 à 1811. Les vingt premiers français venant de l'île Bourbon s'installent à l’île Mahé et à l’île Sainte-Anne en 1770, envoyés par Brayer du Barré9. Cette première implantation n'est pas un succès et doit se justifier en 1772.
an 1757-1792 : Maroc - L'ordre est finalement rétabli par Mohammed III (1757-1790), qui restaure l'unité du pays et réimpose tant bien que mal l'autorité du makhzen sur l'ensemble de l'Empire. La politique de Mohammed III se caractérise par l'ouverture diplomatique et commerciale de l'État marocain qui entend percevoir les taxes douanières afin d'alléger la pression fiscale intérieure. Des traités sont conclus avec les principales puissances européennes, qui entretiennent des consulats et des maisons de commerce dans les nouveaux ports marocains fondés par Mohammed III. L'exemple le plus connu de ces nouvelles places économiques est la ville de Mogador (Essaouira, 1764), conçue et édifiée par l'ingénieur et architecte français Théodore Cornut pour le compte du souverain chérifien. Les ports d'Anfa (Casablanca) et de Fédala (Mohammédia) sont également aménagés et symbolisent le développement du littoral atlantique longtemps marginalisé, libéré de toute occupation étrangère après la reconquête de Mazagan sur les Portugais qui marque la fin définitive du Maroc portugais en 1769. Mohammed III est également le premier chef d'État à reconnaître l'indépendance de la jeune république américaine des États-Unis en 1777. Le sultan établit une amitié épistolaire avec George Washington, ce qui vaut aux États-Unis de conclure avec le Maroc un traité de paix, d'amitié et de commerce le 16 juillet 1786 (pour une durée de cinquante ans, renouvelé par le traité de Meknès de 1836). La diplomatie marocaine alors particulièrement active, est animée par des ministres et ambassadeurs compétents à l'image d'Ibn Othman Al Maknassi, d'Abou El Kacem Zayani ou de Tahar Fennich qui font carrière sous le règne de Mohammed III et de ses successeurs.
Sur le plan intérieur, le règne est marqué par des mutineries suscitées par le corps des Bouakhers (notamment à Meknès en 1778), et par une grave sécheresse de six ans (1776-1782) qui génère des conséquences économiques et démographiques désastreuses. Cette conjoncture négative va en s'accentuant avec Yazid Ier (1790-1792), fils d'une concubine irlandaise de Mohammed III selon Jan Potocki. Son règne très bref s'entache de persécutions et de déprédations qui frappent les dignitaires du makhzen aussi bien que les populations citadines et notamment la communauté juive, puis s'achève par une guerre catastrophique contre l'Espagne de Charles IV qui s'immisce alors de plus en plus dans les affaires internes marocaines. La disparition brutale de Yazid entraîne le retour des troubles de la guerre dynastique et de l'anarchie tribale. L'Empire chérifien se scinde en deux makhzens rivaux, l'un à Fès avec Moulay Sulayman, l'autre à Marrakech avec Moulay Hisham. Sulayman parvient à vaincre définitivement son frère et rival de Marrakech, qui était soutenu par les Espagnols, puis réunifie le sultanat du nord au sud en 1797.
an 1757 : Mauritanie - Vers 1757, le petit-fils d'Ali Chandora, El Mokhtar Abdallah ould Amar reçoit du sultan du Maroc Mohammed ben Abdallah un tambour d'airain comme enseigne de l'émirat qu'il lui confère. Et une dizaine d'années plus tard, Mohammed ben Abdallah lance alors une expédition à Tichit dans le Tagant mauritanien.
an 1758-1914 : Sénégal - les Anglais et les Français se disputent Saint-Louis et Gorée.
an 1760 : Namibie - À partir des années 1760, des aventuriers et explorateurs comme les frères Van Reenen franchissent à leur tour le fleuve Orange. Le Français François Levaillant effectue plusieurs expéditions mais personne ne songe à s'installer durablement dans la région.
an 1761-1805 : Mauritanie - En 1761, Voltaire atteste ainsi la marocanité des côtes allant du détroit de Gibraltar jusqu'au fleuve du Sénégal de même pour Ali Bey Al Abbassi qui attestent en 1805 la souveraineté du Maroc jusqu'au Nil de Tombouctou.
an 1764 - 1789 : Réunion (Ile de la) - 1764-1789 : la période royale
Dans cette période, l'île connaît de nombreux changements administratifs et judiciaires. Sur le plan économique, c'est la période des épices. Le gouverneur Pierre Poivre introduit notamment des épices (girofle, muscade) qui apportent un modeste complément à la culture du café. L'action de Pierre Poivre a considérablement enrichi et diversifié la flore de l'île.
-
1767 : le 14 juillet, la France récupère officiellement les Mascareignes.
-
1768 :l'île Bourbon compte 45 000 esclaves et 26 284 habitants libres (Blancs et libres de couleur).
-
1772 : plantation des premiers girofliers dans l'île.
-
1788 : l'île compte 47 195 habitants
an 1766 : Canaries (Îles des) - Catastrophes naturelles
En 1766, a lieu la tempête de Reyes (es), une tempête de pluies torrentielles dévastatrices.
an 1767-1772 : Ile Maurice - Période française (1715-1810) - 1767-1772 : Pierre Poivre développe l'île
Sous la tutelle du ministre de la Marine, une direction bicéphale, ayant autorité sur les deux îles, s’installe à l’Isle de France : un Gouverneur général et un Intendant. Le gouverneur est un militaire, plus haute autorité, mais n’ayant en théorie aucun droit de regard sur les attributions de l’intendant, administrateur civil, seul responsable de l’utilisation des deniers royaux. Cette organisation est source de conflits entre les deux parties.
En juillet 1767, Jean Daniel Dumas, Gouverneur général, et Pierre Poivre, intendant des îles de France et de Bourbon, s'installent à Port-Louis et inaugurent le retour de l’administration sous gouvernement royal. En décembre 1768, Dumas quitte l’île en raison de sa mésentente avec Poivre, il est remplacé au poste de gouverneur par le chevalier Desroches.
Grâce à Pierre Poivre, ancien employé de la compagnie des Indes qui connaît bien la région depuis 1746, l'archipel des Mascareignes devint une colonie prospère et organisée, enviée par les Britanniques.
Botaniste et membre de plusieurs académies de sciences, Pierre Poivre avait profité dès 1749 d'une escale dans les jardins botaniques de la compagnie des Indes Hollandaises au Cap, pour récupérer diverses plantes pour l’Isle de France9. Il acclimate alors sur les îles de l'archipel quantité d'épices (dont, bien sûr, le poivre, mais aussi la girofle, la muscade, la cannelle, etc.) et des dizaines d'espèces végétales. Il a également favorisé la culture des arbres fruitiers, et fut même l'auteur des premières lois sur la protection de la nature. C'est à lui que les Mauriciens doivent le célèbre jardin de Pamplemousses, qui abrite des nénuphars géants et plus de 60 variétés de palmiers. De plus, Poivre assainit le climat moral et social des Mascareignes en améliorant le sort des esclaves dans tout l'archipel.
Pierre Poivre introduit également l'imprimerie à l'île de France en 1768 (l'Imprimerie royale de Port-Louis).
Avec le déclenchement de la guerre d'Amérique, la puissance de la flotte anglaise s’accroît considérablement et les Britanniques commencent à disputer la suprématie française dans l’océan Indien. Maurice compte à cette époque 48 000 habitants auxquels s’ajoutent 15 000 soldats que le roi de France envoie en renfort. Malgré des batailles victorieuses, les Français se retirent peu à peu sur leurs positions dans les Mascareignes, car les possessions françaises en Inde ont été détruites les unes après les autres par les Anglais et sont désormais sans grande valeur.
an 1769 : Égypte - En 1769, Ali Bey al-Kabir s'impose comme maître de l'Égypte, cesse de payer le tribut dû au sultan et soumet les janissaires
an 1769 à 1853 : Éthiopie - Le Zemene Mesafent (1769-1853)
Le Zemene Mesafent (l'Ère des Princes) correspond à une période d'instabilité durant laquelle le pouvoir impérial perd de son emprise au profit des chefs de guerre locaux. Elle débute en 1769 avec l'assassinat du souverain Yoas Ier par le ras Mikael Sehul. Les nobles en viennent à abuser de leur position en se désignant comme Negusse Negest et en se perdant en querelles internes dans des luttes de succession.
Iyasou II accède au trône alors enfant. Sa mère, l'impératrice Mentewab assure la régence, tout comme celle-ci le fera pour son petit-fils Yoas Ier. Mentewab se fait couronner elle-même codirigeante en 1730, devenant la première femme à accéder au pouvoir de cette manière dans l'Histoire de l'Éthiopie. Iyasou II donne une priorité absolue à sa mère lui laissant toutes prérogatives en tant que codirigeante couronnée. Mentewab tente de renforcer les liens entre la monarchie et les Oromos en arrangeant le mariage de son fils avec une fille du peuple oromo. Tentative qui se solde par un échec : Iyasou II épouse Wubit (Welete Bersabe), qui sera néanmoins éclipsée du pouvoir par la mère d'Iyasou.
Wubit attend donc l'accession au trône de son fils pour revendiquer sa part du pouvoir détenue par Mentewab et sa famille du Qwara. Lorsque celui-ci Yoas Ier accède au trône à la suite de la mort accidentelle de son père, les aristocrates du Gondar sont stupéfaits de voir que le jeune roi maîtrisait mieux la langue oromo que l'amharique, et qu'il a ainsi tendance à favoriser les parents Yejju de sa mère sur ceux Qwarans de sa grand-mère, Mentewab. De plus, atteint l'âge adulte, Yoas Ier accroit les faveurs accordées aux Oromos. À la mort du ras Amhara, il tente de désigner son oncle Lubo gouverneur de cette province, mais la contestation populaire qui en résulte conduit son conseiller Walda Nul à le convaincre de changer d'avis.
De son côté, Mentewab tente de garder le pouvoir après la mort de son fils ; cette tentative débouche, en 1755, sur un conflit avec Wubit, qui pense alors qu'il lui revient d'assurer la régence de son propre fils, Yoas Ier.
Le conflit entre les deux reines conduit Mentewab à invoquer les qwarans et ses forces au Gondar pour la soutenir. Wubit répond de manière identique en invoquant les Yejju Oromos et les forces du Yejju. Le différend entre la Nigiste Negest et la mère du Negusse Negest est sur le point de déboucher en conflit armé. Le ras Mikael Sehul est convoqué en tant que médiateur entre les deux camps. Il réussit à manœuvrer habilement mettant à l'écart les deux reines et leurs camps respectifs, et se propose lui-même à l'accession au trône.
Mikael se positionne rapidement en tant que leader du camp amharico-tigréen. Le règne d'Yoas Ier devient ainsi celui de la confrontation entre le puissant Ras Mikael Sehul et les parents oromos d'Yaos Ier. Au fur et à mesure qu'Yaos Ier favorise des leaders oromos tels que Fasil, ces relations avec Mikael Sehul se détériorent.
Celui-ci en vient à déposer Yoas Ier le 7 mai 1769. Une semaine plus tard, il le fait assassiner ; les circonstances de sa mort restent contradictoires. Ainsi, pour la première fois dans l'Histoire de l'Éthiopie, un Negusse Negest quitte le trône par un autre moyen que la mort naturelle, la mort au cours d'une bataille ou une abdication volontaire. Mikael Sehul a ainsi radicalement corrompu la puissance impériale, qui, à partir de ce point, sera de plus en plus aux mains des haut placés parmi la noblesse quand ce ne seront pas des membres de l'armée. Cet événement est le point de départ de ce qui est appelé, l'Ère des princes, Zemene Mesafent.
Un grand-oncle âgé et infirme du prince assassiné est initialement placé sur le trône en tant que Negusse Negest Yohannes II. Ras Mikael le fait rapidement assassiner, et le très jeune Tekle Haymanot II accède ainsi au trône.
L'instabilité du pouvoir continuera tout au long du XVIIIe siècle, durant lequel les dirigeants les plus importants d'Éthiopie se nomment Dawit III du Gondar (qui meurt le 18 mai 1721), Amha Iyasus du Choa qui consolide le royaume et fonda Ankober, et Takla Guiorguis d'Amhara, qui est resté célèbre pour avoir accédé six fois au trône et avoir été déposé six fois. À la mort de Théophilos entre autres, les nobles redoutent que le cycle de violence qui avait caractérisé son règne et celui de Takla Haïmanot ne se poursuive si un membre de la dynastie salomonide en venait à être désigné au trône. Ils désignent donc l'un des leurs Yostos au titre de Neguse Negest – dont le règne sera de courte durée.
Les premières années du XIXe siècle sont troublées par des luttes féroces entre le ras Gugsa du Bégemeder et le ras Wolde Selassie du Tigray, pour la place du Negusse Negest Egwale Syon. Wolde Selassie finit par remporter la victoire et dirige pratiquement tout le pays jusqu'à sa mort en 1816 à l'âge de 80 ans. Dejazmach Sabagadis d'Agamé s'empare du pouvoir par la force en 1817 et devient seigneur de guerre du Tigré.
an 1770 : Cap Vert - Praia devient la nouvelle capitale en 1770 à 15 km de Ribeira Grande, qui reste connue comme Cidade Velha (la vieille ville).
À la fin du XVIIIe siècle, João da Silva Feijó est envoyé en mission au Cap-Vert pour évaluer la possibilité d'exploiter des minéraux tels que salpêtre et soufre mais sans succès.
En Europe, le Portugal est le premier pays à abolir l'esclavage par le décret du 12 février 1761 décidé par le marquis de Pombal.
an 1779 : Afrique du Sud - Les premières escarmouches ont lieu entre Boers du Zuurveld (en aval de la Fish River) et tribus indigènes Xhosas pour la possession de bétail dans les zones frontalières (première guerre Cafre).
an 1780 : Afrique du Sud - le gouverneur néerlandais, Joaquim van Plettenberg, fixe alors la frontière est de la colonie du Cap à la rivière Great Fish et au fleuve Gamtoos. Mais les années qui suivent sont marquées par de multiples guerres de frontières.
an 1781 : Seychelles - En 1781, le Français Mathurin Barbaron, corsaire du Roi, né le 20 juillet 1737 à Lorient, fils de Jean Barbaron chirurgien de marine (né à Fajolles, Tarn-et-Garonne) et Louise Lorans (2e épouse), aborde l'île de Mahé par l'anse qui porte désormais son nom. Les jardins du grand domaine Barbaron en sont aussi une référence.
an 1781 - 1789 : Mayotte - Rivalités entre les sultanats d’Anjouan et de Mayotte
Le sultan Ahmed ne cessera tout au long de son règne de renouveler les tentatives de conquêtes : en 1781, d’après William Jones, deux garnisons ont ainsi été établies à Mayotte tandis qu’en 1783, une nouvelle expédition est préparée, de même en 1789 où des naufragés arrivant à Anjouan signalent l’absence du sultan et de nombreux habitants partis en campagne militaire à Mayotte.
an 1783 : Gambie - Le traité de Versailles du 3 septembre 1783 confirme que le Sénégal appartient à la France tandis que le territoire de la future Gambie est accordé au Royaume-Uni.
an 1786-1803 : Algérie - Après une période de prospérité et de stabilité politique au XVIIIe siècle, l'Algérie entre, à la veille de la conquête française, dans une crise qui coïncide avec le déclin de l'Empire ottoman et la montée en puissance de l'Europe occidentale. En 1786, la peste se propage et s'installe de façon endémique dans le pays. Elle est suivie, à partir de 1803, d'une famine causée par des années de sécheresse et aggravée par le développement de grandes révoltes populaires.
an 1787-1794 : Sierra Leone - En 1787, les Britanniques achètent l'emplacement où sera bâtie la capitale Freetown. La première vague de peuplement est constituée de 400 Noirs en provenance de Londres. Puis s'y ajoute, par le biais de la Sierra Leone Company, une partie des loyalistes noirs, des esclaves, affranchis en contrepartie de leur engagement dans le camp britannique pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Après avoir transité par la Nouvelle-Écosse ou par Londres, la majorité d'entre eux sont envoyés à Freetown. Le peuplement est complété par les Nègres marrons de Jamaïque (reconquise en 1796) déportés en Nouvelle-Écosse et un nombre croissant de recaptives, Noirs arrachés par les croiseurs britanniques aux bateaux négriers de contrebande. La Sierra Leone devient en 1792 la première colonie britannique de l'Afrique de l'Ouest et, en 1794, le poste de gouverneur en est confié à Zachary Macaulay. La colonie, dont l'assise reste fragile, doit faire face à l'assaut des troupes révolutionnaires françaises.
an 1789 : Sénégal - 15 Avril 1789 : Envoi aux Etats-Généraux de Versailles d’ «un Cahier de doléances et de remontrances».
an 1789 - 1819 : Réunion (Ile de la) - 1789-1819 : la période révolutionnaire et impériale
C'est une période trouble pour l'île, qui subit les contrecoups des guerres de la Révolution et l'Empire. Les tensions naissent surtout quand l'assemblée coloniale créée par la Révolution refuse d'abolir l'esclavage.
L'île Bourbon devient en 1793 l'île de la Réunion. Cependant, Napoléon transforme à nouveau le statut de la colonie en la plaçant sous l'autorité d'un capitaine général résidant sur l’île de France. L'assemblée coloniale est supprimée et l'esclavage rétabli en 1802.
L'île prend le nom d'« île Bonaparte » en 1806. Elle reprendra le nom de Bourbon en 1814.
-
1789 : révolution : l'assemblée coloniale prend le pouvoir aux mains de l'administration royale.
-
1793 : jusqu'en 1795, l'île connaît une grave pénurie de denrées alimentaires, mais grâce aux corsaires, elle parvient à subsister.
-
1794 : le 8 avril, l'île rompt avec le passé et adopte le nom d'île de La Réunion à la suite de La Réunion des révolutionnaires qui ont chassé le roi Bourbon du trône. Le gouverneur royaliste est arrêté.
-
1795 : l'île refuse l'abolition de l'esclavage mais adopte un système plus souple. La Réunion est soumise au régime révolutionnaire montagnard.
-
1798 : la Réunion devient hors-la-loi vis-à-vis de la métropole et s'enferme dans une autonomie.
-
1799 : l'assemblée coloniale impose à l'île une véritable dictature.
-
1801 : la Réunion revient sous le contrôle de la France après la prise de pouvoir de Bonaparte.
-
1802 : la loi du 20 mai 1802 maintient l'esclavage.
-
1806 : août : La Réunion prend le nom d'île Bonaparte.
-
1807 : des catastrophes naturelles exceptionnelles ravagent toutes les cultures de café et de giroflier. Ces événements précipitent l'abandon du café, dont l'intérêt économique décline. Les exploitants se tournent vers la canne à sucre, dont les débouchés en métropole s'accroissent considérablement depuis la perte, par la France, de Saint-Domingue (Haïti) et avec le passage de l'île de France (île Maurice) sous domination anglaise.
-
1808 : l'île, sans défense, subit le blocus de la flotte britannique.
-
1809 :
-
du 16 au 25 août, les Britanniques débarquent à Sainte-Rose et sont repoussés par la garde nationale de Saint-Benoît.
-
le 21 septembre, Saint-Paul est conquise par les Britanniques, qui se retirent immédiatement.
-
-
1810 :
-
le 7 juillet, les Britanniques débarquent à la Grande Chaloupe et font route vers Saint-Denis.
-
le 8 juillet a lieu la bataille de la Redoute. La Réunion capitule. Le 9 juillet, l'île reprend le nom d'île Bourbon. Jusqu'en 1815, l'occupation britannique s'effectue sans évènement notable.
-
le premier établissement d'enseignement supérieur ouvre à Saint-Denis : c'est le collège royal.
-
-
1815 : par le traité de Paris de 1814, les Britanniques rétrocèdent l'île à la France le 6 avril : c'est la seule île de l'océan Indien rendue à la France. L'île compte alors 68 309 habitants. La culture de la canne à sucre se développe, mais l'île ne peut plus subvenir à ses besoins alimentaires.
an 1790 - 1791 : Mayotte -
Les sultans : Saleh ibn Mohamed ibn Bechir el Monzari - vers 1790 -1807
Rivalités entre les sultanats d’Anjouan et de Mayotte : En 1790 et 1791, deux expéditions sont commandées par le fils du sultan Ahmed, Salim mais sans davantage de succès malgré l’aide de deux trafiquants français L’assassinat de Salim ben Ahmed et l’avènement de Abdallah Ier d'Anjouan puis les incursions malgaches sur l’archipel mettent un terme à un demi-siècle de tentatives du sultanat d’Anjouan à s’imposer sur son voisin mahorais, mais sans réel succès.
an 1792 : Algérie - La reprise d'Oran et de Mers el Kebir aux Espagnols, en 1792, marque leur éviction définitive du Maghreb central.
L'autorité du pouvoir central est favorisée au XVIIIe siècle par la prospérité économique et la succession de quelques deys d'une compétence remarquable.
an 1792 : Canaries (Îles des) - En 1792 est créée l'unique université des îles Canaries, à San Cristóbal de La Laguna
an 1792-1822 : Maroc - Moulay Sulayman (1792-1822) mène une politique isolationniste, à l'inverse de Mohammed III. Le sultan ferme le pays au commerce étranger, notamment européen, et supprime les postes de douane créés par son père. Sur le plan interne ses dahirs d'inspiration ouvertement salafiste provoquent des révoltes de villes et de tribus, liées à sa décision d'interdire les moussems et le soufisme militant de certaines confréries hostiles au makhzen. Les Berbères du Moyen-Atlas, notamment les Aït Oumalou, se regroupent sous la direction du chef de guerre mystique Boubker Amhaouch et forment une grande coalition tribale à laquelle se joignent également une partie des Aït Idrassen avec Bouazza Bennacer al Mtiri ainsi que les Rifains et la puissante zaouïa d'Ouezzane. Durant les années 1810, l'armée du makhzen essuie ainsi de lourdes défaites, notamment à la bataille de Lenda en 1818, entraînant la chute de Fès, et le repli du sultan sur les provinces côtières atlantiques qui lui sont restées fidèles. Les tribus insurgées et la population de Fès vont jusqu'à essayer d'imposer des neveux de Sulayman, les princes Moulay Ibrahim puis Moulay Saïd fils de l'ancien sultan Yazid sur le trône chérifien, mais finissent par échouer dans leur tentative de changement de pouvoir au profit de l'une des branches de la dynastie alaouite.
Le sultan parvient à écarter sur le plan extérieur les velléités de pression exercées par Napoléon Ier et par son frère Joseph Bonaparte intronisé roi d'Espagne à Madrid, proches voisins de l'Empire chérifien depuis l'occupation de la péninsule Ibérique par les troupes françaises en 1808, et affiche une neutralité bienveillante à l'égard des Britanniques qui occupent les présides espagnols du Maroc en réaction à l'invasion française de l'Espagne. Napoléon aurait proposé au makhzen, par le biais de son émissaire à Fès, le capitaine Burel, de s'allier avec la France contre la Grande-Bretagne; en contrepartie le Maroc aurait reçu toute la partie ottomane de l'Afrique du Nord, entre le Deylik d'Alger et le Pachalik d'Égypte. Mais les efforts français demeureront vains. En direction de l'Orient, Sulayman noue des relations diplomatiques avec Saoud ben Abdelaziz, prince de l'Émirat saoudien du Najd en Arabie, manifestant un fort intérêt pour le salafisme wahhabite en pleine progression. Ce rapprochement stratégique, politique et religieux, s'explique par les sentiments anti-ottomans que partagent le sultan alaouite et l'émir saoudien, ainsi que par les sensibilités salafistes du souverain chérifien. Profitant de sa campagne militaire contre les Turcs d'Algérie, Moulay Sulayman parvient à expulser définitivement les troupes ottomanes du bey d'Oran qui occupaient l'Est marocain et à rétablir ainsi son pouvoir sur le Touat et les autres oasis du Sahara oriental, en y nommant des caïds représentants du pouvoir chérifien qui s'assurent du versement de la Zakât au Trésor makhzénien.Guelmim et le Tazeroualt acceptent également de se soumettre au sultan.
an 1793-1816 : Gambie - Pendant la Révolution française, les comptoirs français sur la côte sont occupés par la Grande-Bretagne, entre 1793 et 1815, puis restitués à la France, aux suites du traité de Vienne, en 1815. Les Français reprennent possession des côtes du Sénégal, au début de 1816, et la Gambie est confirmée colonie britannique.
an 1793-1810 : Ile Maurice - Période française (1715-1810) - 1793-1810 : les incertitudes de la Révolution et de l'Empire
Le 27 juillet 1793, la Convention nationale française proclame l'interdiction de la traite des esclaves et, quelques mois plus tard, le 4 février 1794, celle de l'esclavage. Le décret prescrivait « l'abolition immédiate », mais ne prévoyait aucune disposition sur le dédommagement des « propriétaires » ou sur l'avenir des « populations libérées ». L'Assemblée coloniale de l'île de France (Maurice) se prononça contre ce décret et réclama avec insistance à la Convention sa suppression pure et simple. Les colons de l'île de France et ceux de Bourbon (La Réunion) n'obtinrent qu'un sursis et décidèrent alors de ne pas appliquer le décret d'abolition. Le capitaine d'Advisard10 fut contraint de rejoindre la France. Le Premier consul de la République, Napoléon Bonaparte, y maintient l’esclavage qui n’a jamais été aboli dans la pratique, par la loi du 20 mai 1802. Les intérêts économiques des planteurs avaient eu raison des idéaux révolutionnaires de liberté et d'égalité. Les colons de l'archipel des Mascareignes, qui n'avaient pas appliqué le décret de la Convention nationale, furent évidemment rassurés. Toutes les réformes de la Révolution furent également supprimées, au grand soulagement des colons et au grand désarroi des esclaves, y compris la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée en 1789 par l'Assemblée nationale.
Au même moment, la région devient la base française la plus importante à l’est de Madagascar, et Port-Louis joue un rôle équivalent à celui de ports comme Bombay ou Madras. Le nombre de bateaux qui font escale à Port-Louis ne cesse d’augmenter pour atteindre près de 350 bateaux en 1803. Le commerce est florissant : riz de Madagascar, esclaves de ports arabes, épices de Java et d’Inde, etc. À cette époque ont lieu les premières tentatives d’extension des possessions coloniales vers Madagascar, les Comores et les Seychelles, avec plus ou moins de succès.
En 1803, le général Decaen envoyé par Napoléon débarqua aux Mascareignes pour imposer le nouveau régime politique. La colonie fut aussitôt prise en main par les administrateurs nommés par Napoléon, qui dirigèrent les affaires de l'île Bourbon (devenue entre-temps l'île Bonaparte) à partir de l'île de France. Mais les rivalités franco-britanniques, déjà virulentes aux Antilles, se propagèrent dans l'océan Indien, et ce, d'autant plus que la colonie française de l'océan Indien ne pouvait que susciter la convoitise des Britanniques. Comme cette colonie s'étendait sur une grande surface dans l'océan Indien, c'est-à-dire tout l'archipel des Mascareignes (île de France, île Bonaparte et île Rodrigues) et tout l'archipel des Seychelles situé plus au nord, elle risquait de nuire considérablement au commerce anglais. De plus, pendant les guerres napoléoniennes, l'île de France et l'île Bonaparte étaient devenues le rendez-vous des corsaires français qui organisaient des raids fructueux contre les navires commerciaux britanniques sur la route des Indes. Même si certains réalisèrent des exploits, comme Surcouf, cela n’empêcha pas l’Angleterre d’étendre sa domination. Il était temps pour les Britanniques de mettre fin à l'hégémonie française dans cette partie de l'océan Indien.
En 1809, les troupes britanniques commencèrent par occuper l'île Rodrigues, ce qui devait constituer la première étape dans la conquête de l'archipel des Mascareignes et de l'archipel des Seychelles. En effet, les Britanniques avaient rassemblé leurs 10 000 soldats à Rodrigues, avant de prendre d'assaut l'île de France (Maurice) et l'île Bonaparte (La Réunion) en décembre 1810. Ils débarquent avec 10 000 hommes au cap Malheureux de Maurice. En août de la même année eut lieu la plus grande victoire navale de Napoléon : la bataille de Grand Port. Après seulement quelques jours, le gouverneur-général Isidore Charles Decaen capitule. Ni lui ni ses 4 000 hommes n’eurent à aller en prison et les Français résidant sur l’île furent autorisés à y rester. L’administration passa sous pouvoir anglais ; Port-Louis, qui avait été rebaptisé Port-Napoléon, reprend son nom d’origine et l’Île de France redevient l'Île Maurice. L'île est officiellement rattachée à l’Empire britannique en 1814, date à laquelle elle retrouve son ancien nom. Ils occuperont l'archipel des Seychelles en 1812. Le dernier gouverneur français de l'île de France, le général Decaen, dut capituler au nom de la France, ses forces étant jugées trop inférieures en nombre. À la fin de l'occupation française, en 1810, la population s'élevait à 73 000 habitants et était constituée à 80 % d'esclaves originaires de l'Afrique orientale pour la plupart, notamment du Mozambique et de Madagascar.
Selon les clauses du traité de Paris de 1814, les Français perdirent définitivement l'archipel des Seychelles et l'archipel des Mascareignes à l'exception de la seule île Bonaparte (La Réunion), rebaptisée Isle of Bourbon par les Anglais, qui fut rétrocédée à la France. Pour les Anglais, la Réunion avait peu d’intérêt stratégique et ne semblait pas pouvoir permettre aux Français de reconstituer leur position de force dans l’océan Indien. Dans l'ancienne colonie de l'île de France (Maurice), il ne subsistait de la présence française que le français et le créole (à base lexicale française). Après seulement deux générations, la langue véhiculaire issue des esclaves africains ou malgaches et des Français était devenue la langue maternelle des descendants d'esclaves : le créole mauricien.
an 1793 : Namibie - Les premiers contacts commerciaux ont lieu avec les peuples nomades namas. Le négoce devient assez important pour que Walvis Bay, Angra Pequena et l'île de Halifax soient revendiqués par le gouverneur de la colonie du Cap au nom de la couronne néerlandaise. En 1793, les Hollandais prennent possession de Walvis Bay (Walvisbaai en afrikaans). Deux ans plus tard, les Britanniques annexent le Cap, prennent possession de Walvis Bay et revendiquent le littoral de l'Afrique du Sud-Ouest, nom sous lequel la région commence à être désignée.
an 1794 : Seychelles - Le 16 mai 1794, le commandant de vaisseau britannique Henry Newcome, commandant d'une escadre jette l'ancre dans la rade de Mahé pour ravitailler les vaisseaux l’Orpheus qu'il monte, le Centurion du capitaine Osborne, et le Resistance du capitaine Packenham. Le commandant Quéau de Qinssy refuse de ravitailler les bâtiments britanniques qui sont en guerre contre la République française. Le capitaine Nexcomme envoie du sommation de se rendre. Le commandant Quéau de Qinssy n'ayant pas de moyens à lui opposer doit céder les îles Seychelles en signant une capitulation honorable qu'il a rédigé avec les principaux habitants des îles. C'est la première capitulation des îles, mais il y en eu d'autres, peut-être, en fonction du passage des vaisseaux anglais et français, jusqu'au débarquement du Nisus de Bartholomew Sullivan, officier des troupes royales de marine de Sa Majesté britannique, agent civil et commandant des îles Seychelles pour le gouvernement britannique.
an 1796-1850 : Burundi - Le Burundi a connu sa plus grande expansion sous le règne de Ntare IV, qui a dirigé le pays de 1796 à 1850 et a doublé sa superficie.
Le royaume du Burundi est caractérisé par une forte hiérarchie sociale et des échanges économiques d'ordre tributaire. Le roi, (mwami), est à la tête d'une aristocratie princière (ganwa) détenant la majorité des terres, et prélève un tribut sur les récoltes et troupeaux des fermiers qui les exploitent.
Au milieu du XVIIIe siècle, la famille royale consolida son autorité sur la terre, la production et la distribution en développant un système de patronage, l'ubugabire, la population recevant la protection royale en échange de sa production.
an 1798 : Afrique du Sud - La faillite de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales en 1798, et les menées de l'organisation des Patriotes du Cap, aidée par les Français, contribuent à la présence dans la région des Anglais.
an 1798 : Canaries (Îles des) - Catastrophes naturelles
Eruption du Pico Viejo (Montaña Chahorra), dure quatre mois ; elle est observée par Alexander von Humboldt (1769-1859).
an 1798 à 1805 : Égypte - Égypte sous domination française et britannique.
Afin de couper à la Grande-Bretagne la route des Indes, la France engage en 1798 la campagne d'Égypte sous la direction de Bonaparte. Après la prise d'Alexandrie, les troupes françaises remportent la bataille des Pyramides le 21 juillet 1798, mais la flotte britannique remporte le 1er août 1798 la bataille navale d'Aboukir, ce qui empêche les Français d'exploiter pleinement leur victoire. L'Égypte n'en devient pas moins française jusqu'en 1801 sous le contrôle de Bonaparte puis du général Kléber puis du général Jacques-François Menou. Devant les attaques ottomanes de Méhémet Ali et celles de l'armée britannique, la France doit renoncer à sa conquête en 1801 et l'Égypte est brièvement occupée par la Grande-Bretagne jusqu'en 1805, date à laquelle Méhémet Ali installe son pouvoir.
XIXème siècle : Archipel des Mascareignes -
Le Trapèze des Mascareignes comprend 6 iles avec des identités singulières. Chacune des iles raconte une histoire unique. Mais l’histoire témoigne qu’elles ont toutes été sous l’occupation française à un moment donné. Aujourd’hui encore, on retrouve l’influence de la France sur leur culture et population.
Les premiers habitants du Trapèze des Mascareignes
Parmi les iles du Trapèze des Mascareignes, Madagascar est celle ayant la population la plus ancienne de la région. Bien que l’ile soit située à l’est du continent africain, les malgaches sont principalement d’origine austronésienne ; ils sont venus d’Indonésie. L’arrivée, des tout premiers habitants de l’ile, date de plus de 2000 ans. L’Indonésie a très certainement marqué la culture malgache, la preuve est qu’on compte plus de 90% de mots austronésien dans la langue malgache.
La population comorienne semble être la seule qui puise son origine d’Afrique, plus précisément d’origine swahili. Les Comores auraient été colonisées vers le VIIIème siècle et il est probable que sa population a été en contact avec les malgaches.
Les autres iles du Trapèze des Mascareignes fut découvertes par les européens au XVIe siècle et peuplées par l’expansion coloniale française. Les pirates ont été les premiers à fouler le sol seychellois.
L’occupation française dans le Trapèze des Mascareignes
Au début du XVIe siècle, les Français ont cherché à établir leur présence dans le Trapèze des Mascareignes, en raison de sa situation géographique qui relie l’Europe à l’Inde. Les commerçants qui empruntaient cette route avaient besoin de points de ravitaillement surs lors de la traversée exténuante de l’Océan Indien.
Initialement, les Français ont tenté d’établir une colonie à Madagascar, plus précisément à Fort-Dauphin dans le sud-ouest de l’ile. Mais la dureté du gouverneur, l’amiral Jacob Blanquet de la Haye, envers la population autochtone va entrainer des soulèvements qui conduiront au massacre des colon français. Après cette première tentative échouée, les français abandonnèrent Madagascar à son propre sort et partirent s’installer sur l’ile de La Réunion, connue à cette époque comme Ile Bourbon et à l’ile Maurice appelée ile de France. Ce n’est qu’au XVIIe siècle que les Français établirent leur présence de façon consistante au Seychelles et à Rodrigues.
Au XVIIe siècle, les français prirent le control totale du trapèze des Mascareignes à travers la Compagnie des Indes orientales. Ils instaurèrent l’esclavage pour la cultivation des plantes tel le café. Les esclaves provenaient de toute la région de l’Océan Indien : l’Afrique de l’est, Madagascar et l’Inde, d’où les origines de la population existence des iles du Trapèze des Mascareignes.
La conquête du Trapèze des Mascareignes par les Anglais
La conquête des iles françaises du Trapèze des Mascareignes par les Anglais eut lieu au début du XIXe siècle. Les Anglais étaient présents jusqu’à Rodrigues, Maurice, La Réunion et les Seychelles. Le traité de Paris en 1814 entraina la restitution de la Réunion à la France, les autres iles quant à elles, vont rester sous l’emprise anglaise jusqu’à leur indépendance dans les années 1960.
Les Seychelles et Maurice sont à ce jour des républiques alors que Rodrigues, dépendante de Maurice, bénéficie d’un statut autonome depuis l’an 2002. La Réunion a été désignée comme département français d’outre-mer depuis 1946.
Le Trapèze des Mascareignes au XIXe siècle
Les 4 iles de l’archipel des Comores étaient divisées au XVIIIe et XIXe siècle, et cela engendra la vente de l’ile de Mayotte par le sultân Andriantsoly en 1841 à la France. Il voulait protéger l’ile de l’égoïsme des comoriens et malgaches.
Cependant, cette division sera la cause d’une grande instabilité dans les Comores. En 1886, l’ile passera sous protectorat français. L’archipel des Comores sera en premier dirigé à partir de Mayotte, et après à partir de Madagascar.
En 1643, les Français s’installèrent à Madagascar et après avoir combattu pendant 10 ans, à la fin du XIXe siècle, ils auront enfin conquis l’ile. De ce fait, Madagascar resta sous l’occupation française de 1896 à 1958. Ce n’est qu’en 1960 que la plus grande ile du trapèze des Mascareignes accèdera à l’indépendance.
D’autre part, les Comores aura leur indépendance en 1975. Le Mayotte quant lui restera sous l’administration Française et sera désigné comme le 2ème département français du Trapèze des Mascareignes, après le référendum de 2011.
Le Trapèze des Mascareignes et l’esclavage
L’esclavage est ancré dans l’histoire des iles du Trapèze des Mascareignes. La plupart des populations des iles Mascareignes sont des descendants d’esclaves.
Les français n’ont pas perdu de temps, aussitôt installés aux Seychelles et dans les Mascareignes, ils instaurèrent l’esclavage. Le XVIIe siècle témoigne des nombreux commerces d’esclaves entre les iles de l’archipel des Mascareignes, l’Afrique, Madagascar et l’Inde.
Plusieurs mouvements anti-esclavagistes ont vu le jour en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, alors qu’en France ce n’était pas encore le cas. Les deux pays menaient une guerre commerciale sans relâche dans l’océan indien, ce qui provoqua dans un premier temps un ralentissement du commerce d’esclave, puis très progressivement à son interdiction.
L’abolition de l’esclavage dans le Trapèze des Mascareignes
L’abolition de l’esclavage fut prononcée pour la première fois en 1796 après le décret de la convention de 1794. Cependant, elle ne fut pas appliquée dans les Mascareignes et en 1802, Napoléon restaura l’esclavage. Ce n’est qu’en 1835 que l’esclavage fut réellement aboli à Maurice et Rodrigues, ensuite aux Seychelles en 1836 et finalement à la Réunion en 1848.
Après l’abolition de l’esclavage, les colons de l’ile Maurice et de la Réunion ont eu recours aux travailleurs engagés, venus d’Inde. Les conditions de vie et de travail de ces derniers étaient fortement similaires à celles des esclaves.
XIXème siècle : Burkina Faso (anc. Haute-Volta) - Jusqu'au XIXe siècle, l'histoire de la Haute-Volta était dominée par les Royaumes Mossi, qui s'y seraient installés après être partis du nord du Ghana. Pendant des siècles, les paysans mossis étaient à la fois soldats et fermiers, et les Mossis défendaient leurs croyances religieuses et leur structure sociale contre les tentatives de conversion à l'Islam par les musulmans qui venaient du nord-ouest.
Quand les Français sont arrivés et ont revendiqué la région en 1896, la résistance des Mossis prit fin par la capture de leur capitale, Ouagadougou.
XIXème siècle : République de Centrafrique - Au cours du XIXe siècle, la ville de Khartoum devient un centre très important du trafic d'esclaves, organisé par des compagnies de trafic d'or et d'esclaves, les « Khartoumies ». Al-Zubeir Rahma Mansour, seigneur de la guerre marchand d'esclaves, prend le contrôle des zaribas puis Rabah, un de ses lieutenants, se taille dès 1880 un royaume esclavagiste entre les bassins de l'Oubangui et du Nil (pays des Kreich et du Dar Banda, au sud du Ouaddaï).
Mohamed es-Senoussi, son neveu, devient sultan du Dar El-Kouti, dans le nord de la Centrafrique, d'où il lance des raids esclavagistes.
Il reste d'abord fidèle à Rabah. Toutefois, lorsque le Français Paul Crampel, à la tête d'une mission d'exploration, atteint son camp au mois d'avril 1891, le sultan, qui veut l'empêcher de continuer sa route jusqu'au Ouaddaï où il aurait pu rencontrer Rabah et le ravitailler en armes, le fait exécuter le 9 avril 1891 et s'approprie ses armes. Peu de jours après, il attaque un deuxième contingent, mené par Gabriel Biscarrat.
Mohammed es-Senoussi récupère les armes et les munitions de cette deuxième mission, ce qui lui permet de mettre fin à sa dépendance de Rabah.
Le Tata fortifié du sultan Sénoussi, son palais fortifié, est édifié sur la colline surplombant la ville de Ndélé, à partir duquel il ravitaille les marchés d'Afrique du Nord en esclaves.
Il poursuit ensuite ses raids esclavagistes le long de la rivière Ouaka, qui déciment le pays banda jusqu'en 1910 avec la complicité passive de la France. Il est finalement tué par les Français en 1911. Ces razzias ont des conséquences désastreuses sur les populations septentrionales de l'Oubangui-Chari, même si elles s'opèrent grâce à des alliances plus ou moins durables conclues avec des groupes locaux.
XIXème siècle : Afrique Côte d'Ivoire - La Côte d’Ivoire, qui est jusqu’au XIXe siècle, un espace de traite négrière secondaire comparé au Bénin ou au Nigeria, subit toutefois également les conséquences négatives du phénomène : nombreux morts, diminution de la natalité, rapide diffusion d’épidémies et de famines qui n’épargnent ni les sociétés lignagères, ni les empires ou royaumes établis sur le territoire. La traite négrière strictement interne perdurera en Côte d'Ivoire jusqu'à la fin du XIXe siècle.
XIXème siècle : Djibouti - L'histoire de Djibouti commence avec la ville de Tadjourah sur le golfe du même nom, qui paraît avoir constitué assez tôt une des rares agglomérations permanentes sans doute liée au sultanat d'Ifat puis d'Adal entre les XIIIe et XVIe siècles. Mais le territoire correspondant à l'actuelle République de Djibouti s'est surtout constitué au fil de l'extension de l'occupation française à partir de 1885 : Territoire d'Obock et dépendances jusqu'en 1896, puis Côte française des Somalis jusqu'en 1967, puis Territoire français des Afars et des Issas avant de gagner son indépendance le 27 juin 1977 sous le nom de République de Djibouti. Ce pays est aujourd'hui membre de l'Union africaine (UA) et de la Ligue arabe.
L'espace autour du golfe de Tadjourah ne constitue pas un territoire spécifique et autonome avant l'installation coloniale. Aride et désertique, il est parcouru par des pasteurs transhumants qui suivent le rythme des pâturages, et des caravanes qui relient la côte aux hautes terres de l'intérieur, Harar, Shewa, etc. Il semble que deux lieux ont fait l'objet d'un habitat permanent sur la côte, les villes de Tadjourah au nord et Zeilah au sud, en relations commerciales avec l'Éthiopie, l'Ogaden et le Yémen.
L'histoire antérieure au XIXe siècle reste encore peu connue. Selon les sources, le peuple afar s'est installé dans la zone, sans qu'il soit possible de préciser les circulations, confrontations, échanges… entre les différents groupes. Les villes côtières, Zeila et Tadjourah, sont en contact avec l'Islam dès le VIIe siècle. Les territoires sont sans doute liés au sultanat d'Ifat puis d'Adal entre les XIIIe et XVIe siècles.
Les récits des voyageurs européens qui traversent la zone à partir de 1839 (Isemberg et Kraft, Rochet d'Héricourt, Harris, Kirk et Johnston) permettent de voir un espace structuré politiquement entre Tadjourah d'une part, une alliance autour de Lo’oytá vers le sud-ouest d'autre part, et l'Awsa.
La ville de Tadjourah est occupée par des troupes égyptiennes entre 1875 et 1884. Le port de Zeilah paie des taxes à l'Empire ottoman puis à l'Égypte jusqu'aux années 1880. Les parties occidentales de l'actuel territoire djiboutien étaient en lien avec le sultanat d'Awsa.
XIXème siècle : Ghana - Durant le XIXe siècle, la politique à tenir tête aux Britanniques divise la classe dirigeante achantie en deux factions, les partisans de la paix et ceux de la guerre. Les rois Osei Bonsu, Kwaku Dua Ier, Mensa Bonsu, Kwaku Dua II favoriserons la négociation, Osei Yaw et Kofi Kakari mèneront une politique belliqueuse.
XIXème siècle : Érythrée - Au milieu du XIXe siècle, quelques immigrants issus de la péninsule Arabique, les Rashaida, s'installent en Érythrée où ils constituent désormais 2 à 3 % de la population.
XIX ème siècle : Malawi - La chute de l’Empire maravi, au XIXe siècle, coïncide avec l’arrivée de deux groupes puissants. Les Nguni originaires du Natal (actuelle Afrique du Sud), emmenés par leur chef Zwangendaba, arrivent au Malawi après avoir fui l’Empire zoulou et l’empereur Chaka. Cet important mouvement de populations, appelé Mfecane, qui englobe bien d’autres peuples que les Nguni, a un profond impact sur le sous-continent austral. Tout en fuyant Chaka Zulu, les Nguni du chef Zwangendaba adoptent une grande partie de ses tactiques militaires et les emploient contre les Maravites. Installés dans des régions rocheuses, ils lancent des raids annuels contre leurs voisins Chewa pour ramener esclaves et nourriture.
Le deuxième groupe qui gagne en influence à cette époque est celui des Ayao (ou Yao), venus du nord du Mozambique pour échapper à la famine et aux conflits avec la tribu Makua. Ils attaquent les Chewa et les Nguni pour revendre les prisonniers comme esclaves. Les Ayao sont les premiers, et restent longtemps les seuls, à employer des armes à feu dans leurs conflits avec d’autres tribus. Convertis à l’Islam au contact des commerçants arabes, ils bénéficient du soutien des cheiks, qui financent des écoles et des moquées. Les Arabes introduisent également la culture du riz, qui devient prépondérante dans la région lacustre.
Forts de leur alliance avec les Ayao, les Arabes établissent plusieurs comptoirs le long du lac Malawi. Le plus grand de ces comptoirs est fondé en 1840 à Nkhotakota par Jumbe Salim bin Abdala. Au sommet de son pouvoir, Jumbe fait transiter entre 5 000 et 20 000 esclaves par Nkhotakota par an. Les esclaves sont ensuite acheminés vers l’île de Kilwa Kisiwani, au large de l’actuelle Tanzanie. La fondation de ces comptoirs déplace le centre du commerce des esclaves vers Zanzibar.
Les Ayao et les Angoni se livrent d’incessants combats sans qu’il en ressorte un vainqueur définitif. Les derniers représentants de l’Empire maravi succombent cependant aux attaques des deux clans. Certains chefs chewa subsistent en nouant des alliances avec les Swahili, eux-mêmes alliés avec les Arabes.
XIXème siècle : Mauritanie - À partir du XIXe siècle, le processus de colonisation débute. Installés au Sénégal, les Français profitent des conflits entre les émirats pour les soumettre et ainsi réaliser l’unité de l’Empire français entre l’Algérie et l’Afrique Occidentale Française. La lutte pour la possession du Maroc voisin est également un enjeu important qui s’ajoute à la volonté de pacifier la vallée du Sénégal, soumise aux rezzous des Maures.
XIXème siècle : Ouganda - La contrée a été colonisée par les Britanniques dans la seconde moitié du XIXe siècle, et a retrouvé son indépendance en 1962. Le Bouganda connaît au XIXe siècle une remarquable stabilité politique propice à l’expansion territoriale et à la l’hégémonie royale. Le pays possède une riche agriculture qui occupe principalement les femmes. Les hommes s’emploient pour partie dans l’artisanat (tissus, canots, constructions), fournissent les corvéables chargés d’entretenir le réseau routier ou s’engagent dans l’armée. Cette riche économie permet d’entretenir une bureaucratie nombreuse qui s’attache à renforcer l’État. Le pouvoir des kabaka est entretenu par des cérémonies et des rituels de cour très élaborés, par l’idéologie de la royauté sacrée et par le culte des lubale (esprits) avec lesquels le roi est censé être en relation permanente.
L’économie des royaumes de la région des Grands Lacs est axée sur l’agriculture avec les cultures du bananier (Bouganda) et des céréales (éleusine, sorgho) associées à l’élevage bovin (Burundi). Les plantes américaines (haricot, maïs, manioc, patate douces, tabac), introduites à partir du XVIIe siècle, se généralisent et assurent une plus grande sécurité alimentaire. Le commerce, le plus souvent monopole royal, reste régional (sel gemme de Katwe, fer du Karagwe et du Bounyoro, tissus du Bouganda, café, tabac). La société des États interlacustres est divisée en classes complémentaires (Hima, Tutsi, Bairu, Hutu…), liées par des contrats de « clientèle » (ubuhake et ubuletwa au Rwanda).
XIXème siècle : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - De 1729 jusqu’au milieu du XIXe siècle - La domination des sultans omanais
Au début du XIXe siècle, un homme rude mais avisé passe à la tête du Sultanat d’Oman, Sayyid Saïd. Après avoir consolidé son autorité et remis de l’ordre dans les affaires du sultanat dans la capitale Mascate, il s’attaque aux problèmes des territoires extérieurs où la domination omanaise est menacée, notamment par les gouverneurs Mazrui. En effet, en 1814, en plus de Mombasa, le gouverneur Mazrui contrôle Pate et Lamu.
XIXème siècle : Tchad
À la fin du XIXe siècle, Rabah, un chef de guerre venu du Darfour, se taille un royaume dans la région tchadienne et ravage le Bornou et le Baguirmi, amenant ce dernier à se mettre sous la protection du colonisateur français en 1897.
les Royaumes traditionnelles ont laissé leur empreinte à travers des autorités traditionnelles qui se superposent parfois aux autorités administratives contemporaines. Les chefs traditionnels héréditaires portent généralement le titre de sultan dans le Nord musulman, de mbang ou gong dans le Sud animiste et chrétien ; l'autorité coutumière et religieuse du sultan s'étend sur plusieurs cantons, celle du simple chef sur un seul canton. Parfois contestés, selon les époques et les circonstances, ils peuvent être perçus comme de simples auxiliaires de l'administration ou des figures publiques importantes.
an 1800-1817 : Botswana - Les données fournies par la pédogénétique permettent d'envisager une dispersion de pasteurs est-africains en Afrique australe s'établissant dans cette région avant l'âge du fer, avant l'arrivée des populations bantoues, comme cela avait été suggéré précédemment sur la base de données notamment linguistiques. Les données de l'ADNA indiquent clairement la présence déjà mélangée d'ascendance de chasseurs cueilleurs du sud de l'Afrique et de pasteurs venant de l'est dans le delta de l'Okavango à la fin du premier millénaire de notre ère.
L'histoire du Botswana commence avec la présence de deux tribus principales sur cet espace : les San (communément appelés Bushmen) et les Khoïkhoïs. Puis les Bantous Tswanas, émigrés de l'est africain aux alentours de 1800 forcent les populations en place à migrer à leur tour. Les Bantous Tswana se séparent en trois sous-groupes : les Pedi qui investissent le Transvaal, les Basotho, occupant l'actuel Lesotho et les Basutho de l'ouest (également appelés Tswana) qui occupent le Bechuanaland, lequel deviendra le Botswana actuel. De nombreux migrants trouvent refuge dans cette contrée, à l'image du peuple Héréro, fuyant la domination allemande en Namibie.
En 1817, Robert Moffat y établit une mission protestante. Au cours de la première moitié du XIXe siècle, des missionnaires, parmi lesquels ce Robert Moffat puis David Livingstone, ont une influence non négligeable sur le pays : d'une part ils convertissent peu à peu les Tswana, mais ils développent également l'éducation et aident les Tswana à obtenir la protection des Britanniques contre l'avancée des Boers dans la région.
an 1800 : Afrique - BURUNDI - Depuis plusieurs siècles le territoire était soumis à un système monarchique féodal, dont la population était structurée en clans et en catégories socioprofessionnelles, étonnamment qualifiées de castes par les uns ou d'ethnies, voire de races, par les autres, dans lequel les populations (Hutu, Tutsi et Twa, si l'on se restreint aux analyses socioprofessionnelles, en faisant abstraction des réalités claniques) étaient dominées politiquement par une lignée princière : les Ganwa
Au début du XIXe siècle, le roi du Burundi Ntare II agrandit son royaume, mais à sa mort, le pays est partagé entre ses deux fils. Il annexe le Bugesera vers 1800.
an 1800-1919 : Côte d'Ivoire - Au XVIIIe siècle la région est envahie par deux ethnies appartenant au groupe des « Akans » : les Agnis dans le sud-est et les Baoulés dans le centre. Les explorateurs, missionnaires, commerçants et soldats étendirent progressivement le territoire sous contrôle français à partir de la région de la lagune. Cependant la colonisation ne fut pas achevée avant 1915.
Sur cette carte allemande de 1889, où la région est considérée comme faisant partie de l'Ober Guinea (Haute-Guinée, s'étendant du Liberia au Cameroun), on remarque combien l'intérieur des terres restait à l'époque terra incognita des géographes. Les établissements français se limitent à une étroite bande de terre, entre Lahou et Assinie, avec Grand-Bassam au centre (et Fort Nemours, construit en 1843). Les légendaires Monts de Kong, dont Binger démontra l'inexistence, y apparaissent encore (avec un point d'interrogation). En dehors de quelques localités comme Krindjabo, Bondoukou, Kong, Tingrela, la carte de l'intérieur du pays est quasiment vide.
-
En 1843, l'expédition de Côte d'Ivoire est une expédition navale américaine contre le peuple béréby.
-
La Côte d'Ivoire devient officiellement une colonie française le 10 mars 1893. Le capitaine Binger, qui partit de Dakar pour rallier Kong, où il rencontra Louis Marie Marcel Treich-Laplène (un commis d'Arthur Verdier), fut le premier gouverneur. La capitale était à Grand-Bassam. Il négocia des traités frontaliers avec le Royaume-Uni (pour le Liberia) et plus tard commença une campagne qui dura jusqu'en 1898 contre Samory Touré, un chef guerrier malinké originaire de la guinée actuelle.
-
La première école de côte d’ivoire fut créée par Arthur Verdier, navigateur et commerçant français, s’installant à Assinie en 1862. En 1880, il crée une plantation de café à Élima, au bord de la lagune Aby. Il va ensuite ouvrir une école privée en 1882 à Élima, celle qui fut la toute première pour les besoins de son commerce et de ses plantations.
-
En 1919, le territoire sud de la Haute Volta (actuel Burkina Faso) devient une partie de la Côte d’Ivoire coloniale. (Au moment de l’indépendance des états africains les deux pays étaient prêts et s’étaient mis d’accord à faire du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire un seul et même unique pays). Mais ce projet n’a pas pu aboutir, au dernier moment le Burkina Faso devient indépendant le 5 août 1960 sous l’impulsion de Maurice Yaméogo.
-
De 1904 à 1958, le pays est inclus dans la Fédération de l'ouest africain français appelée Afrique-Occidentale française (AOF). C'était une colonie et un territoire d'outre-mer pendant la Troisième République. Jusqu'à la période suivant la Seconde Guerre mondiale, les affaires gouvernementales sont caractérisées par l'association qui faisait des habitants des colonies des sujets français sans droit de représentation. Sa capitale est Bingerville jusqu'en 1933, puis Abidjan.
an 1800 - Oubangui-Chari Centrafrique - Arrivée à partir de 1800 environ de groupes de populations qui s’établissent sur l’Oubangui et le moyen Congo, qui comprennent surtout les Bobangi. Ils vivent de l’exploitation intensive des ressources du fleuve et donnent une impulsion au commerce (esclaves et ivoire principalement).
Le territoire est ravagé par la recherche et la traite des esclaves noirs, et en particulier le pays des Bandas subit les nombreuses razzias des Arabes du Bahr al-Ghazal.
Les États musulmans situés plus au nord (Kanem-Bornou, Ouaddaï, Baguirmi, Darfour), utilisant parfois comme main d’œuvre les nomades Peuls, commencent à ravager les territoires occupés par les populations animistes gbaya et banda. Ndélé, ville située en République centrafricaine actuelle, est un important centre esclavagiste dépendant du sultan du Baguirmi. Un peu plus tard, plus au sud, les riverains de l’Oubangui deviennent piroguiers et intermédiaires pour les trafiquants d’esclaves alors qu’à l’est, entre Mbomou et Uélé, des petits États aristocratiques de langue Zandé (ou Nzakara au nord de l’Oubangui) combattent les trafiquants mais alimentent également pour leur propre compte les trafics d’esclaves à destination des occidentaux ou des pays arabes par le Bahr el Ghazal. Ce dernier trafic, spécialement important dans la seconde moitié du XIXe siècle est d’autant plus dévastateur que les trafiquants jallaba financés depuis Khartoum étaient équipés d’armes à feu.
an 1800-1805 : Namibie - À partir des années 1800, les Anglais de la London Mission Society, les missionnaires luthériens, les méthodistes allemands et finlandais commencent à explorer le Sud-Ouest africain et à construire écoles et missions. Le premier établissement est érigé à Warmbad en 1805. Dans leur sillage suivent les clans Oorlams, les marchands et les chasseurs. Tout au long du XIXe siècle, les tribus du nord (Ovambos, Kavangos, Capriviens) restent cependant relativement isolées et les contacts avec les autres tribus, les explorateurs et les missionnaires demeurent rares voire conflictuels.
an 1800 : Nigéria - Période britannique (1800-1960)
Ce n'est qu'à partir de 1790 que les Anglais commencent à explorer le territoire du delta du Niger. L’Anglais Mungo Park est le premier Européen à remonter jusqu'à Tombouctou.
C'est par le biais des activités commerciales que les Britanniques explorent l'intérieur des terres et établissent des comptoirs.
an 1800 : Soudan - Vers 1800, les autorités égyptiennes exercent une souveraineté pleine et entière jusqu’à la première cataracte. Entre la première et la troisième cataracte, se trouvent les pays appelés par les Turcs Berberistan et As-Saïdi par les Arabes, placés sous la direction d’un gouvernement reconnaissant l’autorité du khédive. Au-delà s’étendent les domaines du sultan de Foundj et les pays connus sous le nom de Nubie, Sennar ou Abyssinie. La frontière de la langue arabe et de l’islam s’enfonce jusqu’aux bordures méridionales du royaume du Darfour et du Foundj.
an 1801 : Cap Vert - Le déclin du commerce des esclaves au XIXe siècle provoque une crise économique qui rompt progressivement la prospérité de l'archipel. Cependant, en raison de sa position stratégique à la moitié de la traversée de l'Océan Atlantique depuis l'Europe, le Cap-Vert devient une escale privilégiée pour les lignes maritimes. Grâce à son port bien abrité, la ville de Mindelo (île de São Vicente) devient un important centre commercial de réapprovisionnement des navires.
an 1801 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
En 1801, les troupes anglaises débarquent à Madère en vue de le protéger d'une éventuelle invasion française, qui ne peut avoir lieu grâce à la signature de la paix d'Amiens. Elles sont de retour entre 1807 et 1814 sans qu'un conflit soit déclenché.
an 1801 : Oubangui-Chari Centrafrique - Entre les débuts archéologiques et la période qui précède immédiatement la colonisation, soit environ 1 700 ans, les données concernant l’histoire du territoire occupé par la République centrafricaine sont rares ou peu accessibles au grand public. Il est probable qu’à l’instar de beaucoup de peuples établis dans la zone équatoriale, les populations de la région n’ont pas éprouvé le besoin de s’organiser autour de structures étatiques mais ont plutôt conservé un système de chefferies locales. Rétrospectivement, et étant donné l’expansion démographique supposée de la population (six millions d’habitants), on peut se demander si ce système n’était peut-être pas plus performant que bien d’autres. Le défaut majeur de cette organisation politique très superficielle est toutefois de ne pas avoir pu protéger les populations de langues adamaoua-oubanguiennes des épreuves qui allaient survenir au cours de la période contemporaine.
an 1802 : Sénégal - Représentation de la colonie aux «Cinq Cents».
an 1803-1805 : Afrique du Sud - Le Royaume-Uni conquiert la région du cap de Bonne-Espérance en 1797 pendant les guerres anglo-néerlandaises. La puissance des Pays-Bas est en déclin et la rapidité de l'action britannique s'explique par la volonté d'éviter que la France ne s'approprie la région. Après avoir chassé du pouvoir le Stathouder Guillaume V d'Orange-Nassau, qui se réfugie à Londres avec sa famille, les Pays-Bas récupèrent la colonie en 1803 lors de la paix d'Amiens, mais la déclarent en faillite en 1805.
an 1803-1805 : Algérie - La peste se propage et s'installe de façon endémique dans le pays. Elle est suivie, à partir de 1803, d'une famine causée par des années de sécheresse et aggravée par le développement de grandes révoltes populaires;
En effet, face à l'extinction des revenus de la course, l'administration des beyliks exerce une forte pression fiscale sur les tribus. Le mécontentement mène à des mouvements insurrectionnels inédits, notamment encadrés par des confréries maraboutiques, comme celle des Derqawa, en Oranie et dans le Constantinois. D'autres révoltes vont suivre dans différentes régions, malgré la fin désastreuse de ces deux soulèvements.
La régence connaît également une crise politique latente. En 1805, la milice des janissaires assassine le dey Mustapha Pacha, accusé de complicité avec les négociants juifs, qui auraient continué à exporter des céréales alors que la famine sévissait. Ce qui marque le début d'une série de coups d'État sanglants, de 1805 à 1817, au cours desquels six deys sont renversés et exécutés.
an 1804 : Cameroun - Usman dan Fodio et les Peuls du Nigeria lancent une guerre sainte contre les Haussas afin d'étendre le royaume toucouleur. Forts de cet exemple, les Peuls du Sud rallient leur cause et propagent le djihad dans leur région. Adama, chef des Peuls du sud, prend le titre de cheikh et les plateaux du Sud islamisés prennent le nom d'Adamaoua. Leur capitale, Yola, se trouve sur la Bénoué.
an 1805-1848 : Égypte - Après l'expédition de Bonaparte de 1798 à 1801, qui brisa les chaînes ottomanes, le gouverneur Mohammed Ali fonde l'Égypte moderne et régna de 1805 à 1848. Durant son règne de nombreux Français participèrent à la modernisation du pays.
an 1805 à 1953 : Égypte - Dynastie de Méhémet Ali (1805 à 1953)
Méhémet Ali, qui règne jusqu'en 1848 apparaît comme un grand réformateur du pays dont il modernise les structures et notamment l'armée, sur un modèle européen de conscription. Il utilise l’État pour mettre en œuvre une révolution industrielle. Il constitue des monopoles d’État, achète des machines textiles modernes en Europe, fait construire des hauts fourneaux et des aciéries, confisque les terres des propriétaires mamelouks et y fait cultiver des denrées destinées à l'exportation. En 1830, l'Égypte occupe le cinquième rang mondial pour les broches à filer le coton par têtes d’habitant. Entre 1821 et 1823, il s'empare du territoire esclavagiste du Dongola, puis d'une partie du Soudan. Il intervient contre l'insurrection grecque à la demande du sultan ottoman en 1823. Il s'empare ensuite de la Syrie, d'une partie de l'Arabie (nord et côte de la mer Rouge) en 1832, d'une grande partie du Soudan dont Khartoum en 1835. Au nord, il défait à Konya l'armée ottomane, mais les puissances européennes s'inquiètent de son influence et décident de lui faire la guerre. La Grande-Bretagne envoie sa flotte pour aider le sultan ottoman à rétablir son autorité sur l'Égypte, bombardant les ports libanais contrôlés par Égyptiens et faisant débarquer des troupes en Syrie. En 1841, Méhémet-Ali et Ibrahim doivent céder le contrôle de la Syrie par le traité de Londres. L’Égypte est également contrainte de licencier son armée, démanteler ses monopoles et accepter une politique de libre-échange imposée par les Britanniques qui provoqua sa désindustrialisation. Lord Palmerston admettait avec un certain cynisme : « La soumission de Mohammed Ali à l'Angleterre [...] pourrait paraitre injuste et partiale, mais nous sommes partiaux ; et les intérêts supérieures de l'Europe requièrent que nous le soyons. » ».
Les successeurs de Méhémet Ali, dont la semi-indépendance est reconnue en 1867 avec le titre de khédive, mènent une politique de modernisation marquée par la construction du canal de Suez (1869). Mais criblés de dettes, ils tombent sous la dépendance des institutions financières européennes et, après la révolte nationaliste du colonel Ahmed Urabi, l'Égypte est conquise par l'Empire britannique après une courte guerre en 1882 tout en restant nominalement ottomane. Lors de la guerre des mahdistes entre 1881 et 1899, les troupes anglo-égyptiennes affrontent les Mahdistes qui se sont emparés du Soudan : leur victoire fait naître un Soudan anglo-égyptien dominé de fait par les Britanniques.
an 1806-1814 : Afrique du Sud - En 1806, les Néerlandais cèdent définitivement la place aux Britanniques qui deviennent la nouvelle puissance coloniale.
En 1806, la colonie est de nouveau occupée par le Royaume-Uni à qui elle est officiellement annexée en 1814 après le traité de Paris.
La colonie britannique est alors établie avec 25 000 esclaves, 20 000 colons blancs, 15 000 Khoï et San et 1 000 esclaves noirs libérés. Comme les Néerlandais, les Britanniques voient le Cap comme un point stratégique de ravitaillement, non pas comme une colonie. Les relations avec les Boers ne sont pas meilleures que durant la précédente administration.
an 1807 : Magreb - ACHMET-PACHA, dey d'Alger, aspire à convertir Tunis en une de ses provinces, et fait, mais en vain, la guerre à bey HUMUDA (1782-1824). L'année suivante, il sera tué dans une émeute.
an 1807 : Afrique du Sud - La colonie du Cap est rattachée au Colonial Office, représentée localement par un gouverneur. Les sociétés missionnaires anglicanes s'installent alors dans la colonie et entreprennent de venir en aide, de conseiller et de convertir les tribus hottentotes locales. La même année, Londres fait interdire le commerce des esclaves au sein de l'Empire. Au Cap, des mesures sont prises en faveur des KhoïKhoï et des esclaves. Des missions méthodistes s'installent en pays xhosas où les évangélistes cherchent à former une élite noire.
an 1807-1833 : Gambie - À partir du XVIIIe siècle, les Britanniques occupent ce petit territoire enclavé dans le Sénégal. Ils y abolissent la traite négrière en 1807, puis l'esclavage en 1833. En 1807, le Royaume-Uni supprime le commerce des esclaves partout dans son empire et donc en Gambie. Les bateaux négriers interceptés par l'escadre de l'Afrique occidentale de la Marine royale en Atlantique se rendent en Gambie, avec des esclaves libérés dans l'île MacCarthy loin en haut du fleuve Gambie où on s'est attendu à ce qu'ils aient établi de nouvelles bases de vie. Les Britanniques établissent en 1816 sur le continent, à l'embouchure du fleuve Gambie, le poste militaire de Bathurst, maintenant Banjul, actuelle capitale de la Gambie.
Pendant la Révolution Française, entre 1793 et 1816, la Grande-Bretagne occupera les comptoirs français au Sénégal, dont Saint Louis. En 1815, le traité de Vienne restituera les comptoirs français au Sénégal, et le retour effectif des Français interviendra entre 1816 et 1817. En 1816, la colonie britannique de Gambie s'agrandira, en intégrant tout le fleuve Gambie, alors qu'avant, la colonie se constituait surtout autour de Bathurst et vers la côte.
Les Français occupent un petit poste pris aux Portugais et qui végétait sur la rive nord de la Gambie, Albreda.
an 1807 : Ghana - Les Ashanti et leur florissants commerces en particulier celui des esclaves occupent l'intérieur des terres. Les Britanniques prennent progressivement l’avantage face aux Portugais et aux Hollandais, dans la lutte pour le contrôle du commerce de l’or et des esclaves. Mais ce dernier est aboli en 1807 par le parlement de Winchester.
En 1807 la traite des esclaves est abolie par le Parlement britannique. Durant tout le siècle, les Achanti résistent farouchement aux Britanniques, progressent vers la côte et menacent les forts européens.
De la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle, le royaume achanti évolue d’une structure confédérale plutôt lâche (Amanto) vers un État fortement organisé et centralisé (Kotoko). L’asantehene gouverne avec l’avis du Haut conseil (Asantemanhuia), composé de grands notables de Kumasi et de dignitaires des différentes provinces, réunit une fois par an. Il est doublé par un Conseil privé, très restreint. L’appareil administratif se développe. Le royaume est constitué d’une région métropolitaine (Asante) autour de Kumasi, entourée des Provinces intérieures, soumises au XVIIIe siècle et administrées directement, et de Provinces extérieures, dont les populations autonomes payent tribut à Kumasi. La cohésion de l’ensemble est assurée par l’Odwira, « fête de l’igname », tenue une fois par an, qui sert à la fois de haute cour de justice, d’assemblée politique suprême et de cérémonie religieuse où les prérogatives de l’asantehene sont réaffirmées.
an 1807 - 1817 : Mayotte -
Les sultans : Souhali ibn Salim - 1807-1817
Rivalités entre les sultanats d’Anjouan et de Mayotte : À la fin du XVIIIe siècle, une riche famille omanaise de Zanzibar s'établit à Tsingoni, et y fait fortune. Le principal héritier de cette famille (Salih ben-Mohammed ben-Béchir el-Mondzary el-Omany) épouse alors la fille du vieux sultan Boina Kombo ben Salim et devient héritier légitime du trône : après avoir abandonné l'Ibadisme pour le Chaféisme en vigueur dans la région, il devient sultan sous le nom de Salim II, jusqu'à sa mort en 1807 ou 1815 selon les sources. C'est notamment lui qui transfère la capitale de Tsingoni à Dzaoudzi, localité alors plus facile à fortifier contre les attaques de pirates — Tsingoni est laissée à l'abandon
an 1807-1818 : Nigéria - Période pré-coloniale (1472-1800) - Premiers explorateurs européens et commerce d'esclaves
En 1807, les Britanniques interdisent le commerce des esclaves. Cette décision de mettre fin aux traites négrières s'explique à la fois par la montée du capitalisme industriel qui privilégie une forme de travail basée sur le salariat, et par les idées du siècle des Lumières5. Les États-Unis emboîtent le pas à cette décision britannique en 1808, puis la France, par le décret du 29 mars 1815 confirmé par la suite par l'ordonnance royale du 8 janvier 1817 et la loi du 15 avril 1818. Après les traites négrières, ces trois pays abolissent respectivement l'esclavage en 1833, 1860 et 18487. Mais la traite continue encore, de façon moindre, en Afrique de l'Ouest, en partie de manière clandestine et en partie par une tolérance accordée pendant plusieurs décennies à l'Espagne. Par contre, l'Afrique de l'Ouest dont le Nigeria, ne constitue plus le plus important marché négrier au XIXe siècle (le sultanat de Zanzibar, à l'est de l'Afrique, se substitue à cette région)
an 1807-1868 : Sierra Leone - La population de Sierra Leone ne cesse de croître par la suite : de 2 000 habitants en 1807, elle passe à 11 000 en 1825 et à 40 000 en 1850. Manquant de main-d'œuvre pour les travaux agricoles, les anciens esclaves se lancent dans le commerce. Les Saros (Sierra Leonians), formés dans des écoles chrétiennes, donnent naissance à une bourgeoisie de fonctionnaires et de professions libérales très brillante et à une classe entreprenante de commerçants, agents des missions, travailleurs manuels, qui essaimeront de la Gambie au Cameroun, voire à l’Angola. Ils seront particulièrement nombreux au Nigeria après le retour de 3 000 recaptives egbas vers 1850 à Abeokuta.
Au cours du XIXe siècle, la Sierra Leone développe une culture originale mêlant éléments traditionnels africains et influence européenne. Le langage local, le krio, combine une syntaxe yoruba et un vocabulaire en partie européen. En 1868, un sixième de la population est scolarisé, soit un taux supérieur à celui du Royaume-Uni. La Sierra Leone accueille aussi le collège de Fourah Bay, première université de type occidental établie en Afrique sub-saharienne. À la fin du siècle, toutefois, le déclin du commerce et l'accroissement de la pression européenne conduisent à la perte d'influence de l'élite africaine noire, comme dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest.
an 1808-1827 : Mali - Da Monzon Diarra (1808-1827), fils de Monzon Diarra, a vaincu quatre rois que son père n'a jamais réussi à vaincre : Samanyana Bassi, Mahéri de Djonkoloni, Korè Douga Koro et Djakourouna Toto Dembele. Il résiste à l’Empire peul du Macina de Sékou Amadou qui a lancé une guerre sainte contre les animistes.
an 1810 : Cap Vert - À partir de 1810, les baleiniers venus du Massachusetts et de Rhode Island recrutent des matelots sur les îles de Brava et de Fogo.
an 1810-1814 : Ile Maurice - Période britannique (1810-1968)
Dans l'acte de capitulation de 1810, l'article 8 spécifiait que les colons pouvaient conserver « leurs religion, lois et coutumes ». Bien que le traité de Paris de 1814 ne reprît pas réellement cette formulation, le nouveau gouvernement anglais, dirigé par le gouverneur Sir Robert Farquhar, francophone et dont l'épouse est d'origine française, tente une synthèse en laissant par exemple le Code Napoléon en vigueur, ainsi qu'un fonctionnement similaire dans les administrations. Le français reste par ailleurs compris et parlé par la population (le pays est membre de la Francophonie comme du Commonwealth), aidé par le fait que le créole mauricien provient à 80 % du français. On compte des journaux francophones et à l'école, le français est une matière obligatoire.
Le gouverneur admit que l'usage de la langue française constituait l'une de ces « coutumes » que les colons pouvaient maintenir. En fait, les Britanniques consentirent à ce que les habitants de Maurice et de Rodrigues continuent d'utiliser leur langue, leur religion, leur code civil, leurs traditions et leurs douanes. Peu nombreux et n'ayant pas l'intention d'habiter l'archipel, les Anglais étaient prêts à faire des concessions. Des changements sociaux et économiques se firent sentir aussitôt. Les fonctionnaires français furent remplacés par des fonctionnaires anglais au sein de l'administration, et toute l'économie se développa dorénavant dans le cadre de l'Empire britannique. Beaucoup de franco-mauriciens blancs, notamment des grands propriétaires fonciers et des hommes d'affaires, décidèrent de rester sur l'île et poursuivirent l'exploitation de la canne à sucre avec leur main-d'œuvre d'esclaves africains et malgaches. Ces Blancs constituèrent le groupe des franco-mauriciens qui continuaient de parler la langue française. Appuyés par le clergé catholique, ils opposèrent une résistance opiniâtre aux velléités gouvernementales de mainmise linguistique. Quant à leurs esclaves, ils furent maintenus dans leur infériorité sociale et purent continuer à utiliser le créole mauricien. De toute façon, comme les Anglais ne cherchaient pas à s'installer en grand nombre à l'île Maurice, les autochtones continuèrent de parler essentiellement français et créole.
an 1811 : Afrique du Sud - Le rapport d'une mission met en cause plusieurs familles boers pour des mauvais traitements infligés aux esclaves.
an 1811 - 1814 : Seychelles - Les îles, perdues par la France en 1811, pendant les guerres napoléoniennes, passèrent officiellement sous le contrôle du Royaume-Uni en 1814.
an 1812 : Afrique du Sud - Les missionnaires obtiennent que les plaintes déposées par les Hottentots contre leurs employeurs soient traitées par les tribunaux et que les audiences soient publiques. Dans le veld, les Boers perçoivent ces avancées comme une atteinte à leurs libertés.
an 1812 : Canaries (Îles des) - En 1812, à Cadix, le parlement espagnol met en place un nouveau niveau administratif, à la suite duquel les premières administrations municipales (ayuntamientos) apparaissent aux îles Canaries.
an 1813 : Soudan - Le commerce entre le Soudan et l’Égypte passe par les routes de Siouah à l’ouest, de Sennar le long du Nil et du Darfour par le darb al-arbain (route des quarante jours). Il est dominé à la fin du XVIIIe siècle par les jallaba, qui revendent les marchandises soudanaises à des intermédiaires pour le marché égyptien ou pour l’exportation. Il régresse après l’occupation française de l’Égypte (1798-1801) et à l’anarchie qui en résulte, pour repartir à partir de 1813. Il est principalement axé sur le trafic négrier. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, les Britanniques s'assureront de la conquête et du contrôle du Soudan.
an 1814 : Afrique du Sud - Les Britanniques rachetèrent la colonie du Cap aux Hollandais provoquant le mécontentement des populations Boers (colons d'origine hollandaise).
an 1814 : Sénégal - 30 mai 1814 : Le Sénégal est donné à la France par le Traité de Paris.
an 1815 : Magreb - Après un premier échec en 1815, la France commence la conquête des côtes en 1830. Cette conquête va durer plus de 15 ans, avec une farouche résistance menée par l'émir Abd El-Kader.
an 1815 : Afrique du Sud - Lorsque le jeune boer Frederick Bezuidenhout, qui avait refusé d'obtempérer à une convocation judiciaire et avait été condamné par défaut, est tué lors de son arrestation par un policier hottentot, sa mort déclenche un mouvement de rébellion parmi les fermiers. Alliés au chef xhosa Ngqika, ils tentent de soulever la région du Zuurveld contre le pouvoir colonial. Accusés de haute trahison, cinq de ces rebelles boers sont arrêtés, condamnés à mort et pendus à Slachters Neck, fournissant les premiers martyrs à la communauté boer. Le fossé entre ceux-ci et les Britanniques ne cesse, dès lors, de s'élargir.
an 1815 : Afrique Côte d'Ivoire - L’abolition de l’esclavage en 1815 au Congrès de Vienne, réaffirmée en 1885 au Congrès de Berlin, ouvre la voie au développement de nouvelles relations commerciales entre les populations ivoiriennes et les nouveaux acteurs européens qui font leur apparition.
an 1815 : Archipel des Comores - Au traité de Vienne, en 1815, les Britanniques annexent à leur Empire l’île Maurice et les Seychelles, anciennes colonies Françaises. Afin de détourner un esprit de revanche des Français, les Britanniques vont décider de ne pas faire la conquête des îles Comores, et plus tard, ils laisseront également Madagascar aux Français. Dès 1815, donc, les Français avaient les mains libres aux Comores. Pour Madagascar, les Français vont devoir attendre jusqu'aux années 1890, quand les Britanniques laisseront finalement les Français coloniser Madagascar (cependant la France possède déjà plusieurs comptoirs sur la Grande Île, depuis la première Colonie de Fort-Dauphin fondée en 1643). Ainsi, entre 1815 et 1896, l'armée Française se battra sur d'autres fronts, et la France tournera la page de la perte des archipels de Maurice et des Seychelles. En 1905, avec l'entente cordiale entre la France et la Grande Bretagne, la France renoncera définitivement à la reconquête de ses anciennes colonies insulaires de l'océan Indien central.
an 1815-1834 : Sainte-Hélène (Île) - La Compagnie britannique des Indes orientales qui ne possède dans les mers australes aucun point de relâche pour ses navires, s'en empare en 1659 et l'aménage avant de la céder à la Couronne en 1834. Des gouverneurs sont alors nommés.
De 1815 à 1821, l'île est prêtée au Gouvernement britannique comme lieu d'exil pour Napoléon 1er, empereur français déchu.
Détention de Napoléon Ier : À la suite des Cent-Jours, Napoléon Ier fut exilé et déporté par les Britanniques sur Sainte-Hélène où il arriva le 14 octobre 1815 à bord du HMS Northumberland et y débarqua le 16 octobre 1815. L'arrivée de l'empereur entraîna une augmentation de la population de l'île : près de 1 500 soldats anglais (en plus des 800 militaires de la Compagnie des Indes) et 500 marins de la flottille de guerre, ainsi que des officiels du gouvernement britannique, accompagnés de leurs familles, sans oublier la petite colonie française qui vivait dans l'entourage de Napoléon Ier. De plus, les Britanniques, craignant un débarquement de marins français pour libérer le prisonnier, revendiquèrent l'île de l'Ascension — jusque-là inhabitée — et y établirent une garnison.
Napoléon mourut le 5 mai 1821. Le lendemain, le gouverneur de l'île, sir Hudson Lowe, jusqu'alors en perpétuel conflit avec son ancien prisonnier, vint en personne s’assurer de sa mort et déclara alors à son entourage : « Eh bien, Messieurs, c'était le plus grand ennemi de l'Angleterre et le mien aussi ; mais je lui pardonne tout. À la mort d'un si grand homme, on ne doit éprouver qu'une profonde douleur et de profonds regrets. »
Conformément à ses dernières volontés dans le cas où son corps ne devait pas être ramené en Europe, Napoléon Ier fut inhumé le 9 mai près d'une source, dans la vallée du Géranium, dénommée depuis « vallée du Tombeau ». Le 27 mai, toute la colonie française quitta l'île. Dix-neuf ans après la mort de Napoléon, le roi Louis-Philippe put obtenir du Royaume-Uni la restitution des cendres de l'ex-empereur. L'exhumation du corps de Napoléon eut lieu le 15 octobre 1840, puis il fut rapatrié en France sur la frégate La Belle Poule jusqu'à Cherbourg, et inhumé aux Invalides à Paris.
En 1822, l'habitation de Longwood fut cédée à un fermier qui lui redonna l'usage de ferme qu'elle avait eue avant l'arrivée de Napoléon Ier, si bien qu'ensuite, les visiteurs constatèrent que la maison de l'empereur en détention abritait « moulin, silo, bottes de paille et même des chevaux. »
À partir de 1854, l'empereur Napoléon III négocia avec le gouvernement britannique l'achat de Longwood House et de la vallée du Tombeau, qui devinrent propriétés françaises en 1858, sous le nom de « domaines français de Sainte-Hélène » et gérées depuis par le ministère des Affaires étrangères. Le pavillon des Briars, première demeure de l'empereur sur l'île, fut adjoint au domaine en 1959, lorsque sa dernière propriétaire, l'écrivaine australienne Dame Mabel Brookes (1890-1975), petite-nièce de Betsy Balcombe, rachète le pavillon des Briars et l'offre à la France.
an 1815 : Sénégal - La France se voit accordé le monopole du commerce avec le Sénégal.
an 1816 : Magreb - Les États Barbaresques, au mépris des recommandations de la PORTE Othomane, leur suzeraine, insultent les pavillons de plusieurs nations. Le droit des gens ayant en outre été violé à Alger dans la personne de son consul, l'Angleterre y envoie une escadre pour demander raison de ces actes. Celle-ci est renforcée par quelques vaisseaux Hollandais. Lord EXMOUTH, qui en a le commandement, bombarde Alger, en détruit la flottille et dicte une paix par laquelle le dey d'Alger consent l'abolition de l'esclavage des Européens. Mais peu de jours après, il est massacré par la soldatesque turque.
an 1816-1828 : Afrique du Sud - Au début du XIXe siècle, les Zoulous sont une petite chefferie lignagère composée d'environ 2 000 personnes, qui vivent sur les rives du fleuve Umfolozi, dans l'actuelle province du KwaZulu-Natal. Deux puissances se partagent à l'époque le pouvoir dans la région, la confédération dirigée par le roi Dingiswayo, chef de la tribu des Mthethwa et la grande tribu des Ndwandwe du chef Zwide. Le but des guerres tribales de l'époque consiste principalement à saisir le bétail de l'adversaire et les batailles, qui sont plus des démonstrations de force que de véritables empoignades, n'engagent que les meilleurs guerriers.
En 1816, à la mort du chef zoulou Senzangakhona, son fils illégitime, Shaka, parvint à évincer ses frères et à prendre la tête de la chefferie. Shaka avait été auparavant un brillant officier de Dingiswayo et à la mort de celui-ci, il lui succède, prenant en 1818 la tête de la confédération formant la nation des Ngunis-Amazoulou, « ceux du ciel ».
Shaka remodèle l'organisation sociale et militaire de son peuple, réorganisant l'armée, qui comptait à l'origine 400 guerriers, en régiments et en instituant une véritable conscription. Une discipline rigoureuse est imposée ; le moindre manquement a la mort comme sanction. Pourvue d'une véritable armée de métier, chaque homme étant équipé avec un large bouclier de peau, celle-ci devint le pivot de la société, révolutionnant les structures traditionnelles. Le traditionnel jet du javelot est interdit et remplacé par une lance courte. Shaka réorganise l'État, divisant le royaume en districts militaires. Bouleversant également la stratégie militaire de son armée, Shaka opte pour l'attaque « en tête de buffle », où les ailes opèrent un mouvement tournant pour déborder, par une manœuvre rapide, les troupes adverses. S'il règne à ses débuts sur un territoire de 100 000 km2, c'est avec son armée gigantesque de 100 000 hommes, divisée en quatre corps et pouvant parcourir à pieds 80 km par jour, qu'il réoriente l'expansion de son royaume vers l’ouest et vers le sud, contre les peuples Tembou, Pondo et Xhosa.
Ce faisant, il conquiert en quatre années un territoire plus vaste que la France, au prix de véritables massacres et de nettoyages ethniques. Il fait ainsi pratiquer un eugénisme systématique. Seuls les clans qui font allégeance au chef zoulou échappent à la destruction. Les vieillards des peuples vaincus sont systématiquement supprimés, les femmes et les enfants incorporés dans la nation zoulou alors que les jeunes ont la vie sauve s'ils s'enrôlent dans les régiments (impis), abandonnant leur identité ethnique pour devenir de véritables Zoulous.
Entre 1816 et 1828, Shaka constitue ainsi un vaste empire. Tous les clans, entre les montagnes Drakensberg et le sud de la rivière Tugela, sont ainsi soumis à Shaka, de gré ou de force. Les indociles fuient vers le nord, dispersant sur leur passage les Sothos et les Tsongas, provoquant ainsi de très profonds bouleversements dans toute l'Afrique australe. Ainsi, les Ngwanes, vaincus, se retranchent, avec d'autres petits clans, dans l'actuel Swaziland, alors que les Sothos font de même sur l'oppidum imprenable de Thaba Bosiu d'où ils affronteront plus tard avec succès les Ndébélés, les Griquas et les Boers. En 1826, la puissante tribu rivale des Ndwandwe s'effondre sous les coups de boutoir de l'armée de Shaka. Plusieurs généraux, tel Shoshangane, s'enfuient vers le nord pour se tailler leur propre empire29[source insuffisante]. Au sein même de la nation Zoulou, Shaka est victime de trahisons, telle celle de Mzilikazi qui doit finalement s'enfuir avec quelques partisans, semant la ruine dans les hauts plateaux du veld, peuplés de Sotho, avant de fonder la nation matabele dans l'actuel Zimbabwe.
Le déclin de Shaka commence avec sa tendance de plus en plus affirmée à la tyrannie, qui lui vaut la crainte de son propre peuple. À la mort de sa mère Nandi, en 1827, Shaka fait exécuter plus de 7 000 personnes. Durant une année entière, il est interdit aux gens mariés de vivre ensemble et à tous de boire du lait.
En 1828, Shaka est finalement assassiné, victime d'un complot organisé par son demi-frère, Dingane.
an 1816 : Archipel des Comores - Le sultan Alawi Ier se rend, en 1816, sur l’île Bourbon pour solliciter la protection de Louis XVIII contre les razzias malgaches. Les divisions internes et la menace malgache permettent aux puissances coloniales (France, Portugal, Angleterre, l'Allemagne qui rivalisent pour imposer leur hégémonie dans cette zone stratégique contrôlant le commerce vers l'Orient) d'intervenir dans les affaires politiques des souverains locaux.
an 1816 : Gambie - Dès 1816, les Britanniques occupent ce petit territoire enclavé dans le Sénégal, et les Français n'arriveront pas à les déloger.
an 1816 : Sénégal - Naufrage de la «Méduse» au large des côtes mauritaniennes.
an 1816 : Seychelles - À partir de 1916, lors de la Première Guerre mondiale, l'armée des Seychelles s'engage aux côtés des Britanniques par l'envoi d'un corps expéditionnaire de 796 hommes, dont 358 ne reverront jamais leur pays (cimetière militaire du Mont-Fleuri à Victoria). Ce corps expéditionnaire représente le plus gros effort de toutes les colonies britanniques, en proportion des hommes valides engagés sous le drapeau britannique (près de 6 %).
an 1817 : Mayotte -
Les sultans : Mahona Amadi - 1817-1829
an 1820 - 1848 : Réunion (Ile de la) - 1820-1848 : de la Restauration à l'abolition de l'esclavage
Plus de 45 000 esclaves sont introduits à Bourbon entre 1817 et 1831. La traite clandestine est tolérée par les autorités de Bourbon malgré l'interdiction officielle de 1815 (congrès de Vienne). En 1830, après les Trois Glorieuses, la monarchie de Juillet gouverne en métropole. La traite est énergiquement combattue. Les lois Mackau (1845) adoucissent le régime des esclaves.
-
1825 : le premier déplacement d'Europe à La Réunion par bateau à vapeur prend 113 jours.
-
1831 : création de la chambre de commerce.
-
1832 : le premier conseil général est élu.
-
1840 : découverte de la fécondation artificielle de la vanille par Edmond Albius.
-
1848 :
-
l'île compte 103 490 habitants.
-
le 9 juin, proclamation de la République : l'île Bourbon redevient l'île de La Réunion.
-
le 27 avril a lieu la publication en métropole de l'acte d'émancipation.
-
Le 20 décembre, Joseph Napoléon Sébastien Sarda Garriga, commissaire de la République, proclame l'abolition de l'esclavage à La Réunion. L'île comptait alors plus de 60 000 esclaves.
-
an 1812 : Canaries (Îles des) - En 1821, les îles Canaries sont déclarées province espagnole avec pour capitale Santa Cruz de Tenerife (jusqu'en 1927).
an 1822 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - En 1822, Saïd envoie des troupes sur la côte d’Afrique orientale et met au pas une partie des cités rebelles. La famille Mazrui ne tombe pas immédiatement et, pour se rapprocher du théâtre des opérations, Saïd ben Sultan al-Busaïd déplace sa capitale de Mascate à Zanzibar. Ce changement de capitale est aussi un souhait personnel pour le sultan, qui est tombé sous le charme de cette île qu’il vient de découvrir et pour laquelle il a de grands projets. Il lance de nouvelles activités : Zanzibar va ainsi bientôt fournir les ¾ de la production mondiale de clous de girofle, culture qui a été importée de l’île Bourbon en 1812. Le sultan intensifie également la traite des noirs, on estime que 15 000 esclaves transitent chaque année par son port, ce qui en fait l’un des plus importants d’Afrique.
Zanzibar tire de grands profits de ces activités.
an 1822 - 1844 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) -
Les Britanniques prennent pied en Afrique de l’est
Les Britanniques cherchent notamment à éviter que la France ne prenne pied en Afrique de l’est. Pour les Britanniques, l’existence d’une puissance régionale forte, avec laquelle ils sont en bons termes, n’est pas pour leur déplaire, et le Royaume-uni apporte plutôt son soutien au sultan Sayyid Saïd.
Dans le même temps, les sociétés européennes désapprouvent de plus en plus largement le commerce des esclaves et le Royaume-Uni fait pression sur le sultanat pour réduire la traite des noirs. En 1822, un premier traité, dit de Moresby, est signé par le sultan. Par ce traité, le sultan accepte de rendre illégale la vente d’elaves à des pays se déclarant chrétiens. Le traité impose également de circonscrire le commerce d’esclaves aux ports d’Oman et d’Afrique de l’est. En 1833, l’empire britannique montre l’exemple en abolissant l’esclavage dans ses colonies et en 1845, Sayyid Saïd signe le traité de Hamerton qui limite la traite des noirs à ses seules colonies d’Afrique de l’est. Mais sur le terrain, ces différents traités diplomatiques mettront des décennies avant d’être totalement appliqués.
Le sultanat multiplie les accords commerciaux et les échanges diplomatiques avec les puissances occidentales (en 1836 avec les États-Unis, 1840 avec la Grande-Bretagne et 1844 avec la France). Ces traités prévoient également l’établissement de consulats étrangers à Zanzibar, une première pour un pays africain sub-saharien.
an 1829 - 1836 : Mayotte -
Les sultans : Bwana Combo - 1829-1836
Rivalités entre les sultanats d’Anjouan et de Mayotte : Le dernier sultan shirazien, Mouana-Mâddi, est assassiné en 1829 : son fils Bana-Kombo (ou Bwana Combo) trouve refuge auprès du roi sakalave du Iboina à Madagascar, Andriantsoly, avec lequel son père avait conclu un pacte d'alliance. Andriantsoly aide le jeune Bana-Kombo à reconquérir son trône, et obtient en échange la moitié de l'île. Cet état de fait entraîna rapidement une rivalité entre les deux co-souverains, et après quelques batailles Andriantsoly exila Bana-Kombo à Mohéli. Celui-ci tenta alors de s'allier au sultan local d'origine malgache Ramanateka, qui préféra cependant le spolier pour devenir co-sultan de Mayotte à sa place. Ambitieux, il chasse Andriantsoly de Mayotte en 1836 pour régner sans partage sur l'île, mais regagne ensuite Mohéli. Andriantsoly s'allie alors au sultan Abdallah d'Anjouan pour récupérer l'île. Guerrier converti à l'islam et aussi diplomate respecté auprès des communautés swahilies et malgaches, Andrian Souly devient ainsi le sultan reconnu de l'île dont il s'efforce tant bien que mal de préserver la souveraineté malgré les continuelles hostilités et menaces.
an 1830 : Afrique des Explorateurs - Les voyages en Afrique, très difficile, très fatigants, très meurtriers, ont de quoi effrayer l'imagination. Longtemps après que les Portugais eurent commencé à former des établissements le long des côtes, mais personne n'osa essayer de pénétrer dans l'intérieur, et ce fut seulement en 1795 qu'une tentative efficace (plus efficace que celles d'Ambroise BRUE et de James BRUCE) fut faite par MUNGO-PARK. Cet écossais ne se découragea point, entreprit, en 1805, un second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, y resta 6ans, vit Haoussa, suivit le Dioliba (Niger) dans une partie considérable de son cours, lutta à la fois contre les hyènes et les lions, contre des des tribus sauvages et contre les maladies d'un climat malfaisant, et finit par succomber dans cette lutte sans revoir l'Europe. L'exemple donné par MUNGO-PARK excita, au sein des pays de civilisation, une vive émulation, malgré la triste fin du voyageur. Cette même fin, loin des leurs et au milieu de populations qui défend ses terres, attendait aussi la plupart de ceux qui ont marché sur ses traces, soit en partant comme lui de la Sénégambie, soit en pénétrant dans le désert par Mourzouk, dans le Fezzan, comme le firent l'allemand Frédéric HORNEMANN (1798), le suisse Jean-Louis BURCKHARDT, qui mourut dès le début de ce voyage (1817), les anglais Joseph RITCHIE et le capitaine LYON, son compagnon de voyage (1819), etc. Tous ces hardis émissaires de la sciences qui appartiennent à une époque antérieure à celle qu'indique l'intitulé de ce travail; qu'il nous suffise de dire que les uns avaient pour but d'atteindre enfin Tembouktou, cette capitale d'un royaume du Soudan dont jusqu'alors ont avait singulièrement exagéré la population et la splendeur, les autres de reconnaitre le cours du Dioliba, qui est à l'Afrique Occidentale ce que le Nil est à l'Afrique Orientale, enfin que le champ d'exploration de plusieurs autres encore étaient les alentours du lac tout à fait central de Tsad, lac que l'on a comparé pour la grandeur à la mer Caspienne, mais qui, d'après le docteur VOGEL, n'est qu'un immense marais formé par le Chary et une autre rivière intérieure voisine. D'est en ouest, il peut avoir une étendue de 120 à 140 Km, et, ainsi qu'on le voit sur la carte d'Afrique de cette période, le continent est parsemé d'une multitudes d'îles.
Autres explorateurs célèbres, ce sont d'abord trois anglais qui, pendant quelque temps ont voyagé en compagnie, le Dr OUDNEY, le major DENHAM et le lieutenant de vaisseau Hugh CLAPPERTON, mais dont le dernier (1822 - 1827), promu au grade de capitaine, a ensuite continué seul son œuvre et n'est mort, en 1827, qu'après s'être formé un continuateur dans la personne de son domestique, Richard LANDER, qui retourna en Afrique et y fit des découvertes nouvelles (1830 - 1833). A leurs noms s'associent celui du major Alexandre-Gordon LAING, qui, après avoir pénétré à Tembouktou par l'oasis d'Agably et a visité Djenné, périt assassiné sur la route de Segou, ville importante située aux bords du Dioliba. James RICHARDSON, qui, après être allé de Mourzouk à Ghrât ou Rhât, continua (1845 - 1846) de parcourir la région des Touariks ou Touaregs, voisin d'Alger dont on a vu, dans cette ville, les députés, accourus pour saluer Napoléon III lorsqu'en 1860, il y passa quelques jours. RICHARDSON, qui, dans un second voyage, eut pour compagnons les allemands OVERWEG et BARTH, traversa le pays d'Asben, celui de Sinder et une partie de celui de Bornou; mais il succomba, en deçà de Kouka, au climat meurtrier du Soudan, en 1851.
Les français Gaspard MOLLIEN, Frédéric CAILLIAUD et René CAILLIE, le premier explorant la Sénégambie, remonta le Rio Grande, la Gambie et le Sénégal, et arriva à la ville de Timbo; le second remonta le Nil jusqu'à l'emplacement de l'antique Méroé; le troisième, René Caillié, partit en 1827 de Kakoudy (Sierra Leone), se dirigea sur Djenné, et atteignit enfin, avec LAING, mais après des peines et des dangers inouïs, la ville de Tembouktou, où néanmoins il ne put pas séjourner plus de 1 jours. En 1830, le relation de CAILLIE parut.
Nous arrivons aux derniers explorateurs de l'Afrique, à ceux qui jusqu'ici ont le plus contribué à ouvrir aux européens ce continent que le soleil embrase de ses plus grandes ardeurs; parmi eux, le plus extra-ordinaire peut-être par la force de volonté avec laquelle il sut vaincre les plus grandes difficultés et se tirer des situations les plus critiques, ayant pour double mot d'ordre "christianisme et civilisation", est le missionnaire David LIVINGSTONE, devenu docteur en droit de l'université d'Oxford, mais qui fit un long et pénible apprentissage dans les fabriques et consacra aux études les épargnes qu'il put faire comme filateur. Il séjourna en Afrique depuis 1840, occupé d'abord, sous la direction du respectable Robert MOFFAT, son beau-père, à la conversion des Batchouanas, voisins des Hottentots. Mais malgré son zèle pour la propagation de la bible, ce but n'était pas le seul qu'il voulût poursuivre; Écossais comme Bruce, Mungo-Park et autres, il résolut, comme eux, à agrandir le domaine de l'activité européenne par la découverte de pays nouveaux et en en mettant les habitants en contact avec les peuples de civilisation. Dans ce but, il se fit d'abord assigner sa station parmi les Bakouénas, où, selon la parole biblique, il se fit tout à tous, non pas seulement ministre de a parole divine, mais en même temps charpentier, maçon, serrurier et jardinier, tandis que sa femme taillait des habits, fondait du suif pour en faire des chandelles, fabriquait du savon, faisait tous les soins du ménage. En 1849, LIVINGSTONE commença ses voyages, au nombre de cinq, lesquels, terminés une première fois en 1856, par le retour du missionnaire dans la mère-patrie, furent repris en 1858. Sa première relation, Londres, 1857, avec planches et cartes, fut traduite dans toutes les langues. C'est LIVINGSTONE qui découvrit (1849) le lac Ngami, le plus grand de l'Afrique méridionale, puis, après avoir parcouru le désert ou la steppe de Kalahari, il atteignit Linyanti, dans le pays des Makoloto, arriva sur le Liambaï (non pas Liambye) et le suivit jusqu'au lac Diloto. Enfin, il reconnut le Séchéké, rivière qui le conduisit jusqu'au fleuve Zambési dont il est un affluent, et qui lui-même, après un long cours, débouche dans le canal de Mozambique. Ce fleuve Zambési, objet pour lui de longues recherches, il l'atteignit au point où il forme la cascade mugissante, et large de plus de mille pas, à laquelle le missionnaire attacha le nom de la reine Victoria, mais que les indigènes appellent Mosiwatounia, c'est à dire vacarme de fumée.
Le voyageur allemand, Dr Henri BARTH de Hambourg, pendant son expédition depuis l'Afrique du nord jusqu'en Afrique centrale, dans les année de 1849 à 1855. Ce voyage est peut-être le plus important de tous ceux qui se sont faits dans cette direction. BARTH et son ami OVERWEG commencèrent leur carrière, à Tripoli de Barbarie, en qualité de compagnons de l'Anglais RICHARDSON. Ensemble, ils la continuèrent jusqu'à Aghadès, siège du sultan touarik ou imochare; mais bientôt après, à Damerghou, le 7 janvier 1851, ils se séparèrent, afin de tripler, pour ainsi dire, les résultats de leurs investigations. Toutefois, RICHARDSON mourut au bout de deux mois, sans avoir pu atteindre Kouka. Chose remarquable , entre Kasehna ou Katsena et Kano, soit environ 12° de latitude Nord, par conséquent dans une zone torride, BARTH trouva une contrée si belle qu'il la compare à un superbe parc et affirme qu'il n'en a guère vu de plus attrayante dans toute sa vie. Se dirigeant à l'est, il entra du pays des Haoussa dans celui du sultan de Bornou, dont il nous esquisse l'histoire et où le palmier doûm règne presque exclusivement, quant aux végétaux ; il fit un séjour dans la grande ville de Kouka, et, de là, alla visiter le lac de Tsad. Le Bornou aussi, quoique en général monotone et morne, lu offrit des contrées riantes, et dans le beau pays d'Adamaoua ou Fumbina, plus au sud et à l'ouest de Baghirmi, de vastes forêts de mimosées donnaient à plusieurs contrées un aspect nouveau. BARTH y reconnu le Bénué, magnifique affluent du Dioliba et lui-même déjà large de plus de 1200 pas. Puis, arrivé à Yola, résidence d'un gouverneur, il se vit hors d'état d'aller plus loin et rebroussa chemin. A Kouka, il se réunit de nouveau avec OVERWEG, ils se rendirent à Yo pour, de là, visiter la rive orientale du lac de Tsad et reconnaître le pays de Vadaï, inhospitalier à cause du brigandage. De retour à Kouka, ils partirent pour le Baghirmi, royaume mahométan où aucun européen n'avait encore mis le pied et où il reconnut les bords du Chary. Après la perte de son ami OVERWEG à Kouka, épuisé par la fièvre. BARTH fit encore le voyage de Tembouktou, par Sinder, Katsena, Surmi, Wurno et Sokoto. Le 20juin 1853, il vit le large cours du Dioliba, et le 7 septembre 1853, il entra dans Tembouktou, l'ancienne capitale aujourd'hui déchue des Touariks, puis un des sièges de la science mahométane en Afrique, mais qui n'a, en 1853, plus que 13 000 habitants.
Le capitaine anglais J.H. SPAKE et le major F. BURTON (1857 - 1859) partir de Zanzibar, découvrir le lac Oujiji ou Tanganiika, ainsi que celui de Victoria Nyanza qui fait partie du grand lac Oukérévé, tandis qu'un autre de leurs compatriotes, le docteur BLEEK, parcourut des parties jusqu'alors inconnues de la Caffrerie.
Autres explorateurs : le hongrois Ladislas MAGYAR, Henri DUVEYRIER, DU CHAILLU, CH.T. BEKE, Théodore DE HEUGLIN, ANDERSSON, Léopold PANET, MAC-CARTHY, le baron de NEIMAN, etc.
an 1830 : Archipel des Comores - piraterie, invasions malgaches et sultans batailleurs -
À partir d'une date inconnue, Mohéli se trouve soumise au sultanat d'Anjouan jusqu'en 1830. En 1830, des migrants de Madagascar conduits par Ramanetaka, qui plus tard prend le nom de Abderemane, envahissent l'île et établissent le sultanat de Mohéli.
Ces raids, restés dans les récits populaires, sont courants jusqu'au début du XIXe siècle. Des sources estiment le nombre des envahisseurs à plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Ces raids sont facilités par l'absence de pouvoir central fort sur ces îles (sauf pour Anjouan).
an 1830-50 : Magreb - Fin de la régence d'Alger, par suite de l'expulsion du dey HUSSEIN-PACHA, vaincu par les français. D'Alger, ceux-ci, commandés par le général CLAUZEL, marchent aussitôt sur Blidah, s'assurent du col de Téniah dans l'Atlas, triomphent du bey de Tittéri et occupent sa résidence Médéah.
La conquête de l’Algérie fut très violente et longue. Elle se traduisit par la disparition du tiers de la population algérienne entre 1830 et 1850. Les méthodes sont perverses et conduisent surtout à des décès par famine (destructions de villages, de cultures, arbres arrachés), complétant les connues enfumades, massacres de prisonniers et de civils, razzias. À ce niveau la qualification de crime de guerre ou « meurtres de masse » est à propos. L’armée française conquiert l'Algérie village après village. L'emblématique Armand Jacques Leroy de Saint-Arnaud, exécutant zélé de la politique militaire française, nouvellement promu capitaine depuis 1837, est nommé général de division après l’expédition de Petite Kabylie en 1851.
En parallèle de ces opérations militaires une politique de colonie de peuplement est mise en place, pratique corollaire courante des conquêtes.
Entre le 11 et le 18 mai 1830, quelque 37 000 hommes répartis à bord de 675 navires affrétés par l’entreprise Seillière, c’est-à-dire pratiquement toute la marine marchande française de l’époque, embarquèrent pour conquérir la bande côtière de l’ancienne régence, par la suite unifiée sous le nom d’Algérie. Le débarquement eut lieu le 14 juin 1830 à Sidi-Ferruch et, le 5 juillet, les troupes françaises commandées par Louis Auguste Victor de Ghaisne de Bourmont, général en chef de l'expédition, firent leur entrée dans la forteresse d’Alger, le dey capitula le jour même.
Mais la France se heurte à l’ouest à l’émir Abdelkader ibn Muhieddine et à l’est aux tribus berbères dont celles de Kabylie menées par Lalla Fatma N’Soumer. La France entame des négociations avec l’émir Abdelkader ibn Muhieddine en 1834 et en 1837, date à laquelle est signé le traité de la Tafna. Mais en 1839, Abd el-Kader déclare la guerre à la France, considérant l’expédition aux « Portes de fer » (dans la chaîne des Bibans en Kabylie) par l’armée française comme une violation de traité. En mai 1843, la smala et le fameux trésor d’Abd el-Kader sont aux mains des Français. Le 10 septembre 1844, le sultan marocain Abderrahmane ben Hicham, battu lors de la bataille d'Isly par le général Bugeaud, signe avec la France le traité de Tanger, qualifiant l'émir de « hors-la-loi ». Un an plus tard, en 1845, le Sultan marocain signera un autre traité avec la France, le traité de Lalla Maghnia qui marquera les frontières entre le Maroc et l'Algérie.
En 1847, Abd el-Kader, attaqué au Nord et à l'Est par les troupes françaises et à l'Ouest par les troupes marocaines, dépose les armes et se rend. L’armée française d’Afrique contrôle alors tout le Nord-Ouest de l’Algérie. À l’issue de la bataille de Zaatcha, dans les Aurès, en 1848, le Constantinois est conquis. Entre 1849 et 1852, la domination s’étend à la Petite Kabylie. En juillet 1857, les tribus de Grande Kabylie se rendent, et la capture de Lalla Fatma N’Soumer met un terme à la résistance ; mais les Kabyles se soulèveront encore jusqu’au début des années 1870. La conquête du nord de l’Algérie est alors achevée. Dans le sud, la prise de Laghouat et de Touggourt, la capitulation des Beni-M’zab du Mzab (1852) et celle du Souf reculent les limites de l'Algérie jusqu’au grand désert.
an 1830-1832 : Algérie - En 1830, lorsque les Français débarquent à Alger, la ville décimée par les épidémies et les exodes, ne compte plus que 122 captifs.
Le gouvernement français utilise un prétexte (le coup d'éventail de 1827) pour entreprendre la conquête d'Alger (1830). En fait, le gouvernement ultra du prince de Polignac espère renouer avec les conquêtes militaires de Napoléon et consolider l'influence française dans le bassin occidental de la Méditerranée.
Lors de la bataille de Staoueli (19 juin 1830), les troupes françaises prennent l'avantage sur l'armée ottomane.
Le 5 juillet, les Français occupent Alger et, le jour même, le dey Hussein signe l'acte de capitulation. Les caisses de l'État sont pillées, les janissaires d'Alger sont expulsés pour l'Asie Mineure, la France accapare toutes les terres des beyliks (propriétés publiques.
Après la prise d’Alger par les Français, l’effondrement du pouvoir ottoman dans le beylik de l'ouest ouvre une période d’anarchie. Les habitants de Tlemcen sollicitent la protection du sultan marocain Abd ar-Rahman, qui envoie son beau-père Moulay Ali ibn Sulayman ainsi qu’Idris al-Jirari, le gouverneur d’Oujda. Cependant, ils n'arrivent pas à unir les deux factions rivales de la ville, l'élite citadine pro-marocaine et les Kouloughlis.
Le 1er décembre 1830, Louis-Philippe nomme le duc de Rovigo chef du haut-commandement en Algérie. Celui-ci réussit à s'emparer d'Annaba et met en œuvre activement la colonisation. La violence de ses actions choque tant qu'il est rappelé en 1833. Le 15 décembre 1830, un arrêté du général en chef Clauzel prononce la déchéance d'Ahmed, bey de Constantine49 ; celui-ci contrôle la majeure partie du beylik de Constantine jusqu’à la prise de la ville en 1837.
Cette période marque la fin de la domination ottomane et le début de la domination française. Celle-ci va susciter l'apparition d'un chef inattendu : Abdelkader ibn Muhieddine (1808-1883), issu d'une famille de l'aristocratie religieuse soufie et élu émir en 1832.
an 1830 : Guinée équatoriale - Le climat et les maladies décimèrent de nombreux Espagnols, membres des expéditions successives envoyées sur place à partir de 1830.
an 1830-1860 : Ouganda - Quand les marchands « Arabes », partis de la côte de l’océan Indien, entrent dans l’Ouganda dans les années 1830, ils s’installent tout naturellement à la cour du Kabaka du Buganda. Ces marchands sont suivis dans les années 1860 par les explorateurs britanniques à la recherche des sources du Nil. Parmi les premiers, citons Richard Burton, John Speke et James Grant. Ce sont ensuite des aventuriers de l’Europe entière qui arrivent dans cette région, le plus connu étant Killian Andreu qui est resté plus de 15 ans dans la tribu des Toka . Le haut niveau de centralisation politique du royaume provoque, couplé à la présence du fleuve mythique, une certaine fascination des Européens pour ce que Winston Churchill surnommera « la perle de l’Afrique ».
an 1830 - 1846 : Mayotte a, fait historique découlant de sa proximité géographique, eu beaucoup plus d'échanges avec les rivages malgaches que les autres îles des Comores.
Vers 1830, un chef de province militaire autonome de Madagascar, nommé par Radama Ier, roi des Hovas/Mérinas, s'assimilant au précédent roi décédé en 1828, vainc le roi des Sakalava, Tsy Levalou régnant à Iboina. Le roi déchu échappe à la haine des Hovas et d'une partie des siens, et s'enfuit de son trône avec sa cour et une fraction de son armée au-delà des rivages malgaches à Nosy Bé. Le sultan de Mahoré en guerre avec les îles voisines et souhaitant extirper la piraterie de ses rivages fait appel au service du souverain exilé, poursuivi et contraint de gagner sa vie en mercenaire.
Dès 1832, la souveraineté du sultan est restaurée sur l'île. Elle est enfin reconquise de haute lutte après trois longues années par le chef sakalave qui, séduit par la famille de son hôte, se convertit sous le nom Andrian Souly, il est plus tard nommé Andriantsoly après son mariage avec la fille du sultan et reçoit pour sa probité et sa loyauté une partie de l'île, puis hérite du sultanat.
Mais l'île au grand lagon ne cesse d'être l'objet des rivalités locales. En 1833, l'île est momentanément conquise par Mohéli, puis le 19 novembre 1835, le sultan d'Anjouan irrité par les nouveaux venus impose son arbitrage et en prend possession. En 1836, au terme d'épuisantes épreuves de force, le sultan de Mayotte obtient sa reconnaissance et l'indépendance de l'île.
Sans flotte de guerre, il ne peut que perdre le contrôle de l'île. Il recherche des protecteurs pour garantir la sécurité des habitants en cas de reprise des hostilités. Missionné pour organiser l'installation à Nosy Be à partir de 1841, les militaires français dirigés par Hell, Jéhenne et Passot sont intéressés par le nord de Madagascar car ils anticipent les puissantes mutations en cours de la navigation maritime. Le clipper et le navire à vapeur commencent à changer les routes maritimes séculaires dans l'océan Indien, une meilleure cartographie et la maîtrise instrumentale de la position géographique rendent moins dangereux les parages coralliens. C'est pourquoi les Français tendent à investir la côte nord-ouest de Madagascar. Le 25 mars 1841, le sultan opère la cession de sa souveraineté de Mayotte à la France par une simple vente où il obtient du commandant de vaisseau de La Prévoyante, Pierre Passot une rente viagère personnelle de 1000 piastres et quelques promesses.
Les négociateurs français sont ravis car si, géologues amateurs, ils ont découvert des anses naturelles au milieu de coulées de laves et de coraux, ils reconnaissent aussi des havres idéaux, protégés des courants pour leurs bateaux de guerre. Cette cession est ratifiée après une enquête demandée par le souverain Louis-Philippe et ses ministres doutant du pouvoir réel d'un surprenant sultan vendeur. Ainsi, après de fastidieuses vérifications, la prise de possession officielle avec installation du drapeau flottant a lieu le 13 juin 1843.
Entre-temps, les marins français patients avaient assuré la protection de Mahore. Les descriptions de l'île portent souvent sur sa partie Nord-Est, caractérisée par une langue de terre de 5 à 6 mètres au-dessus du niveau marin, appelée la péninsule de Choa. Droit en face, sur une petite presqu'île de sables amoncelés de coraux au nord-ouest de l'îlot de Mayotte ou île de Pamandzi, s'élève le rocher de Zaouzi, prononcé Dzaoudzi. Le canal qui sépare les deux pointes de la Grande Terre et de l'îlot a 1 200 mètres de long. Selon les descriptions encyclopédiques de l'époque, les deux pointes abritent chacune un village typique : Choa est essentiellement peuplé de Sakalaves, Dzaoudzi, son rocher fortifié et son port aux boutres appartiennent à des Arabes. C'est sur ce dernier centre et îlot idéal pour le mouillage des gros navires que les prévoyants marins français jettent leur dévolu.
Mais ils ne font que reprendre avec vigueur un lointain héritage du sultanat de Mayotte. Dès 1845, le réaménagement de bâtiments mieux adaptés à l'autorité, sous forme d'extensions et de surélèvements plutôt que des complètes construction ex nihilo, est achevé en face de la grande rade. Et ainsi apparaissent les blancs bâtiments de gouvernement et d'administration, un hôpital civil et militaire, un corps de garde proche de l'entrée principale de la forteresse, un arsenal du génie près du port aux boutres arabes. L'ancien palais des sultans reste un lieu préservé pour maintenir l'échange et les rencontres avec les administrés mahorais, arabes et sakalaves. La rassurante présence française concilie les représentants des communautés et permet d'apaiser les violentes tensions et querelles internes que la piraterie incontrôlée avait exacerbées. Mais dans le canal du Mozambique, une sourde rivalité anglaise est désormais née, elle est appelée à se déployer pendant des décennies.
Tout au long des rivages ou dans ses parties les plus fertiles et accessibles de la Grande Terre, des domaines esclavagistes sont installés. L'intérieur de la Grande Terre est couverte de végétation verte et dense, quoiqu'en maints endroits les zones montueuses restent dégradées par les pillages des grands bois organisés régulièrement par les maîtres des domaines. Il existe ainsi de nombreux dédales de végétations où se nichent des cases de paysans pauvres. Ses populations libres, non recensées fuyant au besoin leurs habitations sommaires pour d'autres repères moins accessibles, évitent plus qu'ils ne combattent leurs possibles persécuteurs. Ces Mahorais de culture swahilie se regroupent par intérêt, s'affrontent parfois, se plaçant au besoin sous la protection ou l'arbitrage religieux du sultan. Derniers venus avant l'hégémonie française, Sakalaves et Antalaotsi adoptent irréversiblement ces deux modes de vie suivant leur cohésion : ils essaient vainement de s'organiser entre ces deux extrêmes, la vie domaniale impérativement hiérarchisée et inégalitaire en liaison avec le monde marchand, le monde paysan communautaire libre et souvent précaire du fait de l'absence de titre de propriété garanti par un système de défense efficace ou un pouvoir fort. Une conversion religieuse à l'Islam leur permet de bénéficier d'une meilleure reconnaissance auprès des populations mahoraises et d'une pacification juridique communément acceptée.
Mayotte ne compterait qu'un peu plus de 3 000 habitants permanents. Elle est placée par le chef d'expédition Passot sous l'autorité maritime française. Après son acquisition, elle dépend administrativement du gouverneur de La Réunion, mais l'efficace gouvernement de Mayotte avec sa flotte et son administration modernisée s'étend aux îles françaises les plus proches.
Lui sont rattachées deux îles côtières de Madagascar, Nosy Be (occupée par la France dès 1841) et Sainte-Marie de Madagascar (française depuis 1820), l'ensemble composant la colonie de « Mayotte et Nosy-Bé ».
Au lendemain de sa prise de possession, Passot avait fait procéder à une estimation de la population servile de île qui avait abouti au chiffre de 1 500 individus soit près de la moitié du total. Un document donne la répartition suivante : Sakalava 600, Arabes 700, Mahorais 500, esclaves 1 500, soit, au total, 3 300 individus. Le chiffre de 1 500 esclaves auquel Passot était parvenu en 1843 était le résultat une estimation approximative. En février 1846, il fit procéder à un recensement systématique qui aboutit cette fois à une population servile de 2 733 individus. Le même recensement donnait pour la population libre le chiffre de 2 553 personnes dont 104 Malgaches.
Le 9 décembre 1846, une ordonnance royale portant sur l’abolition de l'esclavage est promulguée à Mayotte. Appliquée en 1848, elle provoque une fuite des maîtres des plantations de Mahoré et de leurs esclaves obéissants, qui espèrent trouver ailleurs des terres à mettre en valeur sans cette contrainte. Cet exode rapide favorise l'installation de planteurs français sur la Grande Terre. Les créoles monopolisent alors les meilleures terres, là où ils ont remarqué la profonde décomposition des anciennes laves en sols rouges. Une gestion hydraulique grâce à des retenues d'eau sur des tapis naturels d'argiles peut être améliorée. L'ordre français semble favoriser ces coûteux aménagements.
an 1831 : Cap Vert - De 1831 à 1833, une terrible sécheresse s'abat sur l'archipel, causant la mort de 30 000 personnes.
an 1832 : Cap Vert - Le diplomate américain Edmund Roberts y effectue ainsi une halte en 1832. Les sécheresses chroniques dues à la déforestation entrainent toutefois des famines régulières, accentuées par l'absence d'aide alimentaire.
an 1832-1845 : Guinée équatoriale - À partir de 1832 de nombreux Espagnols, voyageurs, scientifiques ou officiels visitent l’île, qui est finalement revendiquée à nouveau par l’Espagne en 1845, année au cours de laquelle Nicolás de Manterola y débarque le premier missionnaire.
an 1832-1844 : Maroc - Durant le XIXe siècle, les puissances coloniales européennes tentent d'asseoir leur influence en Afrique du Nord. Lors de la conquête de l'Algérie, la France obtient du Maroc une promesse de neutralité (1832). Mais en 1839, le sultan Abd el-Rahman soutient l'action de l'émir algérien Abd el-Kader, et le conflit s'étend alors aux provinces marocaines de l'Oriental. L'armée marocaine est défaite par les troupes françaises du maréchal Bugeaud à la bataille d'Isly le 17 août 1844. Le traité de Tanger, du 10 septembre 1844, met hors la loi Abd el-Kader et définit pour la première fois une délimitation entre les deux pays, de la Méditerranée jusqu'à l'oasis de Figuig.
an 1832 : Ile Maurice - Période britannique (1810-1968)
En 1832, le gouvernement colonial anglais imposa une première politique linguistique : la langue anglaise devint obligatoire pour les Mauriciens lors de toute communication avec les autorités britanniques. L'année suivante, l'anglais devint l'unique langue de l'Administration en servant de critère d'embauche dans les services gouvernementaux. Le changement le plus important survint en 1835 lors de l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies britanniques. L'importation d'esclaves avait cessé depuis 1833 à Maurice, alors que la population s'élevait à quelque 100 000 habitants dont plus de 80 000 esclaves. Devant les besoins de main-d'œuvre pour faire fonctionner les plantations sucrières, l'administration anglaise décida de recourir à des travailleurs indiens rétribués à contrat ; c'est en 1839 qu'eurent lieu les premières tentatives pour faire venir des travailleurs agricoles depuis l'Inde.
an 1834-1836 : Afrique du Sud - Sur la frontière orientale de la colonie du Cap, les escarmouches entre colons boers et Xhosas sont de plus en plus violentes. En 1834, un chef de haut rang Xhosa est tué lors d'un raid des commandos boers. Une armée de 10 000 guerriers, franchit alors la frontière orientale de la colonie, procède à un pillage systématique des fermes et abat tous ceux qui résistent. Un contingent militaire britannique est alors envoyé dans la région sous le commandement du Colonel Harry Smith en janvier 1835. Pendant neuf mois, de sévères combats opposent troupes britanniques et guerriers Xhosas. Le 10 mai 1835, la région située en amont de la rivière Keiskamma et en aval de la rivière Kei, est annexée à la colonie du Cap sous le nom de province de la Reine Adélaïde, en hommage à l'épouse du Roi Guillaume IV. Cependant, le secrétaire d'état aux colonies exige que la région soit restituée aux indigènes et en 1836, les troupes britanniques se retirent de la zone tampon pour s'établir près de la rivière Keiskamma.
an 1834 : Algérie - Au retour d'une expédition contre les Smalas, le 4 février 1834, après avoir battu Abdelkader, le général Desmichels signe avec ce dernier un traité aux termes duquel la France reconnait l'autorité de l'émir sur l'Oranie, en contrepartie de la reconnaissance de la présence française dans les villes du littoral.
Mostafa ben Smaïl refuse de reconnaître l'autorité d'Abdelkader. Ce dernier, avec l'aide de ses alliés français, est victorieux de Mostafa ben Smaïl le
13 juillet 1834. Le 22 juillet, l'ex-régence d'Alger devient « Possession française d'Afrique du Nord ». La « convention du figuier » est signée, en juin 1835, entre la France et les tribus des Douaïr et des Zmela qui deviennent alors « des sujets français ».
Abd El Kader attaque des tribus alliées de la France et bat le général Trézel dans les marais de la Macta près de son fief de Mascara, dans l'Ouest algérien. Il encercle la ville voisine d'Oran pendant 40 jours. Arrivé en renfort de métropole, le général Bugeaud inflige une défaite à Abd El Kader.
an 1834 : Sainte-Hélène (Île) - La Compagnie britannique des Indes orientales qui ne possède dans les mers australes aucun point de relâche pour ses navires, s'en empare en 1659 et l'aménage avant de la céder à la Couronne en 1834. Des gouverneurs sont alors nommés.
an 1835 : Afrique du Sud - En 1835, les Boers quittent la colonie du Cap pour les territoires intérieurs de l'Afrique du Sud afin d'échapper à l'administration britannique. C'est le Grand Trek, parsemé de tragédies et de batailles (bataille de Blood River contre les Zoulous en 1838). Deux républiques boers indépendantes sont finalement fondées et reconnues par le Royaume-Uni : la république sud-africaine du Transvaal (1852) et l'État libre d'Orange (1854).
En 1835, entre 68 000 et 105 000 blancs vivaient alors dans la colonie du Cap. Optant pour un nouveau départ vers l'intérieur des terres, quelque 4 000 Boers embarquent pour l'inconnu à bord de leurs chars à bœufs, avec femmes, enfants et serviteurs. Les premiers groupes organisés quittent les régions et villes du Cap, de Graaff-Reinet, de George et de Grahamstown, avec à leur tête, des chefs élus par leurs communautés comme Andries Pretorius, Louis Trichardt, Hendrik Potgieter et Piet Retief. Le nombre de ces pionniers s'élève à plus de 14 000 dans les dix années qui suivent. On les appelle les Voortrekkers.
Cette période est connue sous le nom de Grand Trek et façonne la mythologie des Afrikaners, le peuple élu, la tribu blanche, à la recherche de sa terre promise.
Digne du Far West américain, cette aventure constitue la genèse du volk afrikaner dont les motivations sont exposées dans un manifeste rédigé le 22 janvier 1837 par le voortrekker Piet Retief. Il y énonce ses griefs contre l'autorité britannique, les humiliations que les Boers estiment avoir subies, leur croyance en un Être juste qui les guidera vers une terre promise où ils pourront se consacrer à la prospérité, à la paix et au bonheur de leurs enfants, une terre où ils seraient enfin libres et où leur gouvernement décidera de ses propres loi.
an 1835-1836 : Algérie - Le général Clauzel reprend les hostilités, s’empare de Mascara en décembre 1835, puis de Tlemcen, où il installe une garnison. Il soumet les tribus du Cheliff en mars 1836 et chasse le représentant de l’émir à Médéa, désertée par sa population, le 4 avril 1836. Considérant que la menace est conjurée à l’ouest, il destitue le bey de Constantine et nomme à sa place le chef d’escadron Youssouf, qui s’établit provisoirement à Annaba.
En 1836, différents combats ont lieu entre Abdelkader et les troupes françaises.
an 1835-1865 : Ile Maurice - Période britannique (1810-1968) - 1835-1865 : l'immigration indienne
Entre 1835 et 1865, pour compenser le départ de bon nombre de leurs anciens esclaves, plus de 200 000 immigrants ou coolies ou engagés indiens et chinois affluèrent à l'île Maurice et changèrent radicalement la composition ethnique des habitants. Les immigrants indiens, qui étaient de religion hindouiste ou musulmane, forment rapidement la majorité des travailleurs agricoles et travaillent dans des conditions proches de celles des esclaves noirs. Quant aux Chinois, ils s'ajoutèrent ultérieurement et devinrent de petits commerçants.
Les nouveaux immigrants asiatiques ne changèrent à peu près rien au rôle social des langues à l'île Maurice. Les franco-mauriciens réussirent à confiner les nouveaux arrivants dans une infériorité sociale ; les Indo-Mauriciens adoptèrent alors le créole comme langue véhiculaire, qui s'enrichit de mots anglais ou indiens, eux-mêmes créolisés. Par ailleurs, en 1841, l'enseignement de l'anglais devint obligatoire au primaire dans toutes les écoles en plus du français. Les Franco-Mauriciens protestèrent du fait que les « pauvres négrillons » furent « forcés de crier toute la journée comme des perroquets des mots barbares », mais rien n'y fit. Enfin, en 1845, l'anglais devint la langue de la Cour suprême ; toutefois, les tribunaux inférieurs, qui statuaient encore à partir du code de Napoléon, continuèrent à utiliser le français.
Tandis que Maurice comptait 200 000 habitants en 1860, ils sont environ 500 000 en 1910. En effet, entre 1835 et 1907, 450 000 indiens ont émigré sur l'île Maurice et la population Mauricienne est aujourd'hui composée à 70 % de leurs descendants. Au-delà de graves problèmes d’alimentation que cet accroissement engendre, un nombre considérable de coolies indiens, appelés « engagés », meurt au cours du trajet et de nouvelles maladies sont importées sur l’île. Bien qu’on leur ait garanti qu’ils pourraient rentrer chez eux après la fin de leur contrat, seuls un quart d’entre eux environ regagne l’Inde. Les autres ne restent pas de leur plein gré, mais sont retenus de force car l’économie florissante de l’île Maurice en dépend. Les recours en justice sont à cette époque exclusivement réservés aux Blancs.
an 1836 : Afrique du Sud - En avril 1836, les deux premiers convois, comprenant chacun une trentaine de famille, menés par Louis Trichardt et Janse van Rensburg, franchissent le fleuve Vaal et traversent le haut-veld, poussant vers l'Est. Les deux groupes, après trois années d'errance, sont finalement décimés par les fièvres et les conflits avec les Tsongas.
Les convois menés par Hendrik Potgieter et Gert Maritz se heurtent aux guerriers de Mzilikazi. Celui-ci est défait lors de la bataille de Vegkop et s'enfuit avec ses ndébélés au nord du fleuve Limpopo, où il fonde le Matabeleland. Après avoir repoussé plus au sud les Sothos de Moshoeshoe dans les montagnes de l'actuel Lesotho, les Boers proclament la création de la république des Voortrekkers à Potchefstroom, mais les conditions de vie les poussent à redescendre vers le Natal. La trahison dont vont alors être victimes les chefs voortrekkers, Gert Maritz et Piet Retief, va longtemps symboliser et entretenir la méfiance des Afrikaners envers les Noirs d’Afrique du Sud. En effet, Retief avait entrepris de négocier un accord de coexistence et d’entraide avec Dingane kaSenzangakhona, le Roi des Zoulous. Ayant obtenu un accord de ce dernier, Retief et ses compagnons sont invités à un banquet en guise de cérémonie de signature. En confiance, ils acceptent de laisser leurs armes. Au cours de la cérémonie, Retief et ses 70 compagnons sont massacrés sur ordre du Roi Zoulou, qui ordonne alors de trouver les campements boers et de massacrer tous ceux qui s’y trouvent.
Alertés par des survivants qui échappent à ces massacres, des familles boers se rassemblent autour de leurs chefs, Andries Pretorius et Sarel Cilliers.
an 1836 : Angola - En 1836, les Portugais interdisent la Traite des Noirs. L'Angola aura été le pays le plus dépeuplé par la traite. Vers la fin du XIXe siècle apparaissent les Tchokwés, une ethnie apparentée aux Lundas, fournissant de l'ivoire aux Européens par l'intermédiaire des ethnies côtières.
an 1836 : Cap Vert - Charles Darwin y fait escale pendant 23 jours, en allant vers l'Amérique, puis brièvement lors de son retour en 1836.
an 1836 : Mayotte -
Les sultans : Andriantsoly - 1836 - 1845 (né Tsi Levalou), mort en 1847, est un monarque malgache (v. 1820-1824)
et mahorais (1832-1843) de la première moitié du XIXe siècle.
an 1837 : Magreb - Le général BUGEAUD, voulant forcer à la paix ABD-EL-KADER, retiré à Mascara, s'avance d'Oran sur Tlémecen et le camp de la Tafna. Les deux chefs ont une entrevue, à la suite de laquelle est conclu le traité de Tafna. ABD-EL-KADER est reconnu comme prince souverain, mais, de son coté, il reconnait la souveraineté de la France sur l'Algérie, dont les limites sont nettement fixées; D'autre part, le gouverneur général DAMREMONT, successeur du maréchal CLAUZEL, qui a échoué dans une expédition contre Constantine, marche de nouveau, accompagné du duc de NEMOURS, contre ce chef-lieu d'un beylik. Au siège de la ville, DAMREMONT est tué, mais le général du génie VALEE prend le commandement à sa place, et ordonne l'assaut, où se distingue le commandant de LAMORICIERE. La prise de Constantine donne une importance nouvelle aux possessions de la France dans le nord de l'Afrique.
an 1837 : Algérie - Le traité de Tafna est signé, le 30 mai 1837, entre le général Bugeaud et l'émir Abdelkader. L'émir obtient les deux tiers du territoire de l'ex-régence (province de Titteri et province d'Oran, à l’exception des villes d'Oran, d'Arzew et de Mostaganem). Il établit sa capitale à Mascara. Les Français se chargent d'exiler ses propres opposants. Damrémont entre en contact avec le bey de Constantine pour obtenir une convention du même type, mais Ahmed rejette son ultimatum le 19 août.
Abdelkader entreprend la réorganisation administrative de son territoire, qui est divisé en trois califats, en respectant l’organisation politique tribale. Il ne partage son pouvoir de décision avec l'assemblée tribale qu’en ce qui concerne la conduite de la guerre sainte.
Le 13 octobre 1837, le gouverneur général reçoit l'ordre de marcher sur Constantine avec 10 000 hommes. La ville est prise après sept jours de siège. Damrémont a été tué la veille d’un coup de canon. Son successeur, le général Valée, s’attache à organiser la province de Constantine, puis doit affronter Abdelkader.
an 1837-1898 : Afrique Côte d'Ivoire - Exploration du Pays - La méconnaissance de l’arrière-pays ivoirien amène les Français Édouard Bouët-Willaumez (1837-1839), Paul Fleuriot de Langle, Marcel Treich-Laplène (1887-1890), Louis-Gustave Binger (et, dans une moindre mesure, les Anglais Lonsdale (1882), Freeman (1888) et Lang (1892)) à lancer de nombreuses missions d’exploration.
Après la signature de divers traités de protectorat, un décret, le 10 mars 1893, crée la Côte d’Ivoire en tant que colonie française autonome. La France qui y est déjà représentée par Arthur Verdier (1878) puis Treich-Laplène (1886) en qualité de Résidents, désigne Louis-Gustave Binger comme gouverneur avec résidence à Grand-Bassam.
L’autorité française commence à s’établir dans l’ensemble du pays au moyen d’un système de quadrillage hiérarchisé qui comprend les villages, les cantons, les subdivisions et les cercles. Elle établit des liens de subordination à travers l’instauration de l’impôt de capitation, la prestation gratuite de travail (travail forcé), le service militaire obligatoire, l’application d’un code de l’indigénat et l’exercice d’une justice indigène. Pour sa part, l’administration française doit procéder à la mise en valeur du territoire, à la mise en place de services sociaux de base, à garantir la libre circulation des personnes et des biens en mettant un terme définitif là où elle s'exerce à l'esclavage. La résistance locale s’exprime dès la phase d’exploration (guerre de Jacqueville et de Lahou en 1890, guerre de Bonoua en 1894 et 1895, guerre en pays adioukrou en 1897 et 1898). Paris rentre en guerre ouverte avec Samory en 1896, qui est enfin vaincu à Guéouleu (Guélémou) en 1898.
Quelques années plus tard, pour asseoir rapidement et définitivement l’autorité de la France sur le territoire, le gouverneur Gabriel Angoulvant opte pour l’accélération forcée de la colonisation : « Je désire qu’il n’y ait désormais aucune hésitation sur la ligne politique à suivre. Cette ligne de conduite doit être uniforme pour toute la Colonie. Nous avons deux moyens de les mettre en pratique : ou attendre que notre influence et notre exemple agissent sur les populations qui nous sont confiées ; ou vouloir que la civilisation marche à grands pas, au prix d’une action... J'ai choisi le second procédé. » De fait, la conquête de ce qui deviendra la Côte d'Ivoire a été, de par la résistance rencontrée entre 1893 et la Première Guerre mondiale, l'une des plus longues et sanglantes que la colonisation française ait eu à affronter en Afrique de l'Ouest, et presque aucune des régions de la future colonie n'a été acquise « pacifiquement », même si les formes d'opposition ont été différentes, échelonnées dans le temps et rarement coordonnées entre elle.
an 1837 : Afrique République de Djibouti - Des explorateurs français parcoururent le territoire dès 1837.
an 1837 : Gabon - Le 24 novembre 1837, le ministère français de la marine prescrit au commandant de la station extérieure d'Afrique d'envoyer la canonnière-brick La Malouine, commandée par le lieutenant de vaisseau Louis Édouard Bouët-Willaumez, sur les côtes comprises entre la Gambie et l'estuaire du Gabon afin d'en reconnaitre les possibilités pour le commerce et de poursuivre les négriers. Bouët, secondé par le capitaine Broquant, délégué de la chambre de commerce de Bordeaux, embarquent dans La Malouine le 3 novembre 1838. Le 9 février 1839 est signée dans l'estuaire du Gabon la convention entre Bouët-Willaumez et Broquant d'une part et, de l'autre, le souverain mpongwè Denis Rapontchombo, dit « le roi Denis », signant d'une croix et d'un rond en présence des princes Petit Denis et Dolingua. La convention prévoit une alliance défensive et offensive entre Denis et la France ainsi que la cession à la France de deux lieues de terres en partant de la pointe Sandy sur la rive gauche de l'estuaire du Gabon en échange de marchandises.
an 1838 : Afrique du Sud - Le 16 décembre 1838, à l’aube de la confrontation finale, la tradition historique et religieuse afrikaner mentionne que les assiégés en appellent à la protection de Dieu en faisant le vœu de faire du jour de la bataille un jour de prières (« le jour du vœu ») et promettent d'édifier une église pour rendre grâce au seigneur afin de l'honorer.
La confrontation lors de la bataille de Blood River, entre 500 Boers repliés derrière leurs chariots rangés en cercle (laager) et 10 000 guerriers zoulous, se solde par une véritable hécatombe zouloue, colorant de leur sang la rivière Ncome dorénavant connue sous le nom de Blood River, alors que les voortrekkers n’ont que quelques blessés. Cette victoire conforte la foi des Boers en leur destin biblique. Ils occupent emGungundlovu, qui fait office de capitale zouloue. Ils reconnaissent Mpande, le demi-frère de Dingane, comme roi des Zoulous, avec qui ils s'allient pour défaire les régiments de Dingane. Celui-ci s'enfuit vers le nord, où il est tué par les Swazis. Quant à Mpande, qui maintiendra l'unité du royaume zoulou pendant trente ans, il cède la moitié du Natal aux Voortrekkers qui y proclament la république de Natalia.
an 1838 - 1864 : Zambie - Entre 1838 et 1864, un protectorat temporaire des Makololo est instauré sur les Lozi (apparentés aux Basotho).
an 1839 : Algérie - L'armée française passe, en septembre 1839, les Portes de fer dans la chaîne des Bibans, territoire que l'émir comptait annexer. Abdelkader, considérant qu'il s'agit d'une rupture du traité de Tafna, reprend, le 15 octobre 1839, la guerre contre la France. Ses partisans pénètrent dans la Mitidja, massacrent des colons européens et détruisent la plupart des fermes. Valée reçoit des renforts et se trouve à la tête d’une armée de 60 000 hommes, mais ses succès restent limités en raison de la politique d'occupation restreinte, qualifiée de chimère par Bugeaud à la Chambre des députés en janvier 1840. Abdelkader a constitué une armée régulière de 10 000 hommes instruits par les Turcs et des déserteurs européens. L'émir dispose d’une fabrique d’arme à Miliana, d'une fonderie de canon à Tlemcen, et reçoit des armes européennes par le Maroc.
an 1839 : Gabon - La France occupe le Gabon progressivement à partir du milieu du XIXe siècle, après un traité signé avec le « roi Denis », en 1839. Les explorateurs commencent à pénétrer l'hinterland (tels le Franco-Américain Paul Belloni Du Chaillu, qui donnera son nom au massif du Chaillu, ou Pierre Savorgnan de Brazza qui remonte le cours de l'Ogooué en 1874, puis 1876-1878 et 1879-1882). Libreville est fondée en 1849.
an 1840 : Afrique du Sud - Après l'annexion du Natal par les Britanniques au début des années 1840, l’épopée boer recommence pour atteindre son apogée dans les années 1852-1854 avec la création des deux républiques indépendantes, la Zuid Afrikaansche Republiek (« République sud-africaine ») au Transvaal et l'Oranje Frystaat (« État libre d'Orange »), reconnues par les Britanniques par le Traité de Sand River.
an 1840 : Afrique BURUNDI - Au début du XIXe siècle, le roi du Burundi Ntare II agrandit son royaume, mais à sa mort, le pays est partagé entre ses deux fils. Il annexe le Buyogoma et le Bugufi vers 1840-1845.
an 1840 - 1873 : Canaries (Îles des) - La rivalité pour la préséance avec Las Palmas de Grande Canarie entraîne de 1840 à 1873 une division de l'archipel entre une zone occidentale et une zone orientale.
Le chef du Parti libéral des Canaries (Partido Liberal Canario) basé à Grande Canarie, Fernando León y Castillo (1842-1918), fait campagne pour la suprématie de sa région, ce qui est perçu aujourd'hui comme le déclencheur de la division définitive de l'archipel.
an 1840-1870 : Afrique Côte d'Ivoire - Colonisation française
Les causes
Après avoir réussi à conquérir ce qui deviendra un jour l'Algérie et les quelques conquêtes à motivations commerciales réalisées sous le Second Empire, la France encore convalescente de la guerre de 1870, se lance, à l'instigation de Léon Gambetta et de Jules Ferry, dans la colonisation d’une partie majeure de l’Afrique occidentale et équatoriale et de la péninsule indochinoise. Le prétexte affiché est au début de « civiliser » ces régions, avec bientôt l'espoir que ces colonies offrent un jour des débouchés voire qu'on puisse en tirer des dividendes. Mais, en réalité, la motivation est davantage la rivalité avec les autres puissances coloniales.
L'établissement des négociants marseillais
La France est déjà présente sur les côtes d'Afrique occidentale depuis très longtemps et l'installation des négociants marseillais entre le fleuve Sénégal et le delta du Niger remonte aux années 1840, motivée par le commerce des arachides, de l'huile de palme et des palmistes. En 1833, les frères Victor et Louis Régis sont ainsi le premier négociants marseillais à envoyer l'un de leurs navires explorer les rives du golfe de Guinée, organisant de nombreuses expéditions vers la Gambie, la Guinée ou encore au Gabon. Ces entreprises (rassemblant des comptoirs commerciaux, une flotte et des huileries) connaissent un développement remarquable dépourvu de volonté de coloniser la zone. En effet, pour garantir la sécurité et la prospérité de leurs échanges, les Marseillais préfèrent s'entendre avec les grands chefs africains qui contrôlent le littoral. C'est ce que fait Victor Régis en Côte-d'Ivoire (Grand-Bassam) avec le roi Peter.
Autour de l’année 1840, le gouvernement français incite les négociants français à implanter des factoreries, c'est-à-dire des installations fixes pour récolter, pendant toute l’année, et stocker, les produits livrés par les Africains, en certains points de la côte. L'objectif est de renforcer la présence pour contrer les Anglais68 qui sont de plus en plus présents dans la zone. En 1842, Edouard Bouët, récemment promu gouverneur du Sénégal, reçoit l’ordre de Paris de construire des comptoirs, notamment à Grand-Bassam et à Assinie, et d’y attirer des commerçants français. En 1844 et 1845, seuls les Frères Régis acceptent d'ouvrir des factoreries, sans enthousiasme, surtout par amitié pour Bouët68.
Toutefois, la plus puissante des puissances coloniales du XIXe siècle, le Royaume-Uni, agit déjà sur le Niger inférieur. Joindre les possessions françaises du golfe de Guinée à celles du bas Sénégal via ce qu'on appelle à l'époque le « Soudan » (aujourd'hui « Sahel ») paraît la parade adéquate à l'entreprise anglaise qui s'annonce à partir de l'est.
Mais sur route se trouve un obstacle : l'empire construit par le chef de guerre Samory Touré, le plus grand commerçant d'esclaves de l'Afrique occidentale, et contre lequel les populations assujetties se révoltent à la fin des années 1880. Ces populations animistes refusent l'islam imposé par Samory et finissent par espérer leur libération par les Français.
an 1840 : Égypte - Méhémet Ali doit ainsi céder le contrôle de la Syrie lors du traité de Londres6. L’Égypte fut également contrainte de licencier son armée, démanteler ses monopoles et accepter une politique de libre-échange imposée par les Britanniques qui provoqua sa désindustrialisation. Lord Palmerston admettait avec un certain cynisme : « La soumission de Mohammed Ali à l'Angleterre […] pourrait paraitre injuste et partiale, mais nous sommes partiaux ; et les intérêts supérieures de l'Europe requièrent que nous le soyons. »
an 1840 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - De 1729 jusqu’au milieu du XIXe siècle - La domination des sultans omanais
En 1840, la famille Mazrui est définitivement matée et Sayyid Saïd devient le leader incontesté de toute la côte est de l’Afrique, de l’actuelle Somalie jusqu’au Mozambique.
La puissance d’Oman est à son apogée, mais le sultan subit de plus en plus les pressions des puissances européennes coloniales qui sont durant la première moitié du XVIIIe siècle en pleine lutte d’influence pour le contrôle de l’océan Indien et des routes maritimes vers l’Asie.
an 1840 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1840, un État militaire ndébélé (ou matabélé), dirigé par Mzilikazi du clan zoulou Xumalo, est fondé sur les décombres de l’empire rozvi.
an 1841 à 1912 : Afrique - les Comores - Entre 1841 et 1912, les Français soumettent les îles par de rocambolesques histoires mêlant, comme à Madagascar, faits de guerre, trahisons et histoires d'amour. Ils réussissent à établir des protectorats puis une colonie dirigée par le gouverneur général de Madagascar. Alors que la main-d'œuvre devient de plus en plus chère à La Réunion, les Comores, oubliées par l'administration centrale, offrent aux colons et aux sociétés coloniales (comme la Bambao) des perspectives et une main-d'œuvre peu chère dans les plantations de plantes à parfums et de vanille, notamment des esclaves de traites récentes, les Mruma.
an 1841 : Algérie - Le 22 février 1841, Bugeaud, nommé gouverneur général de l'Algérie française (jusqu'en 1847) arrive à Alger. Il décide la reprise des hostilités en vue d’une conquête totale de l'Algérie. L’effectif des troupes passe de 63 000 (1840) à près de 110 000 hommes. Par l’intermédiaire du « bureau arabe », Bugeaud recrute des autochtones et pose les premières bases de l'armée d'Afrique. Il encourage l’établissement de colonies. Abdelkader de son côté dispose de 8 000 fantassins, 2 000 cavaliers, 240 artilleurs, auxquels il faut ajouter les irréguliers (environ 50 000 cavaliers et goumiers).
Le 25 mai 1841, l'armée française occupe Tagdempt, puis Mascara le 30 mai (la nouvelle et l’ancienne capitale de l’émir), razziant les tribus favorables à l’émir et détruisant les récoltes et les silos à grains. Abdelkader fait en vain appel au sultan ottoman.
Le 23 août 1841, le Cheik el Kadiri, lors d'une réunion au Caire, publie une fatwa qui précise que les tribus sont autorisées à ne pas obéir à Abdelkader et qu'il est insensé de faire la guerre aux chrétiens, tant que ceux-ci laissent les musulmans exercer librement leur culte.
an 1841-1846 : Archipel des Comores - Le 25 avril 1841, à la suite de la signature d'un traité, Mayotte devient protectorat français et le sultan Adrian Tsouli, qui avait conquis l'île 9 ans plus tôt et était en train de perdre le pouvoir réel du fait des incessantes attaques anjouanaises et malgaches, s'installe à la Réunion avec une pension de l’État français16 et les paiements des frais de scolarité de ses enfants. La France trouve avec cet accord un port stratégiquement important, face à Nosy Bé dont ils viennent de prendre possession à partir de 1839. Le roi Louis-Philippe entérine cette acquisition en 1843. L’esclavage y est aboli dès 1846.
an 1841 : Libéria - En 1841, Joseph Jenkins Roberts devient le premier gouverneur noir. En 1847, le nouveau pays adopte une constitution et devient une république indépendante et Roberts est son premier président. Le suffrage censitaire assure la domination politique des populations d'origine américaine.
Dans la seconde moitié du siècle, le Liberia essaye d'étendre son territoire vers l'intérieur des terres mais se heurte aux territoires des colonies européennes.
an 1841 : Mayotte (Île de) - Mayotte est une île de l'archipel des Comores, située dans le canal du Mozambique, au nord-ouest de Madagascar dans l’océan Indien. Sous souveraineté de la France depuis 1841, elle en est un département d'outre-mer depuis 2011. Elle a été marquée par l'histoire du monde maritime de l'océan Indien, longtemps dépendante de la traditionnelle navigation saisonnière arabo-indienne, au contact des cultures africaines et malgaches, avant de passer petit à petit sous hégémonie européenne. L'islam tolérant et structuré qu'elle a préservé est un vieil héritage shirazien, apporté par des colons de la région d'Ormuz et du Hadramaout.
an 1842-1843 : Afrique du Sud - Craignant que les Boers ne développent des relations avec des puissances étrangères, les Britanniques envoient un corps expéditionnaire au Natal en 1842, ce qui aboutit à l'annexion de la région le 12 mai 1843 par les Britanniques.
Les Boers reprennent alors leur grand trek vers le Nord, au-delà des fleuves Orange et Vaal, rejoignant des communautés déjà établies mais ils se heurtent encore aux Gricquas, des métis khoïkhoï, et aux Sothos de Moshoeshoe.
Parallèlement, des groupes de métis font leur propre Trek. Les Oorlams, métis de Namas et de Néerlandais, sous la direction de Jager puis de son fils Jonker Afrikaner, s'établissent dans la région du TransGariep. Dans le Namaqualand, des Bastaards instaurent des républiques autonomes dotées de règles constitutionnelles mais sous souveraineté britannique. Ainsi, Kommagas, Steinkopf et Concordia sont érigées en marge de la colonie.
an 1842-1911 - Oubangui-Chari Centrafrique - Le dernier évènement notable de la période précoloniale est l’installation sous l’impulsion d’un soudanais, Rabah, d’un État esclavagiste à cheval sur la République centrafricaine et le Tchad. Il a pour capitale la ville de Dar el-Kouti (près de Ndélé) et est dirigé par un vassal de Rabah (1842c—1900), Mohamed es-Senoussi (?—1911). L’influence néfaste du sultanat de Bilad el-Kouti16 s’étend bien après les débuts de la colonisation française.
an 1843-1844 : Afrique du Sud - Du côté de la frontière nord de la colonie du Cap, les premiers traités sont signés avec les Gricquas en 1843-1844 pour la reconnaissance du Griqualand Ouest.
an 1843 : Algérie - Le 16 mai 1843, Le duc d'Aumale attaque par surprise avec 600 cavaliers la smala d'Abdelkader à la source de Taguin et fait 3 000 prisonniers.
an 1843-1857 : Afrique Côte d'Ivoire - En dépit d’une concurrence anglaise tenace et parfois l’hostilité des populations locales, des comptoirs français sont installés à Assinie et Grand-Bassam (Côte du Sud-Est) en 1843 et, en 1857, le fort de Dabou est édifié.
an 1843-1844 : Gabon - Un blockhaus, le poste d'Okolo, est établi en 1843 sur l'emplacement cédé par le souverain mpongwè Anguilè Ré-Dowé dit le « Roi Louis », établissant ainsi une présence française permanente à l'emplacement de la future capitale Libreville. Le 28 mars 1844 le roi Glass signe un traité avec le lieutenant de vaisseau Darricau. Le 1er avril est signé au poste français d'Okolo le traité général avec les chefs de l'estuaire, le roi Denis Rapontchombo, Quaben, Georges, Louis, François (de l'île de Coniquet), Kringer, Datyngha, Petit-Denis et Quavène. Le poste d'Okolo reçoit probablement à cette date le nom de Fort d'Aumale. Enfin sont signés, par Rodolphe Darricau, les traités avec les chefs Cobangoï et Buschy le 6 juillet et le roi Passol le 7 juillet, qui se mettent sous la protection de la France, et avec les chefs de l'estuaire du Muni le 8 septembre. Il est avéré que les rois sont loin de se rendre compte de la portée de leur engagement.
an 1843 : Gambie - En 1843 la Gambie est une « Colonie de la Couronne ». Elle inclut Bathurst, environ 600 habitants, ses environs, Albréda, le fort Barren et l’île fortifiée de Mc Carthy. La France souhaite acquérir la Gambie pour des raisons commerciales, et offrir au Royaume-Uni en échange des comptoirs du golfe de Guinée : pour Faidherbe, cela ferait « une belle Sénégambie compacte ». Cela permettrait à la France de contrôler le commerce des arachides et de combattre les rebelles anti-expansionnisme français du Sénégal qui se réfugiaient en Gambie. En 1857, le comptoir français d'Albreda est cédé après un commun accord aux Britanniques. En 1865, des négociations franco-britanniques débutent mais le Royaume-Uni voit peu d’intérêt dans les colonies proposées par la France. Il préférerait des concessions territoriales autour des îles de Loos et du fleuve Mellacorée (territoires guinéens commerciaux). Les négociations sont interrompues par la guerre de 1870.
an 1843 : Mayotte - Rivalités entre les sultanats d’Anjouan et de Mayotte
Après un siècle de troubles, Mayotte est totalement dépeuplée, passant de 12 000 habitants au XVIe siècle à moins de 5 000 lors des premiers recensements effectués après la prise de possession de l'île par les Français en 1843. De nombreuses localités pourtant jadis prospères sont abandonnées telle la capitale Tsingoni, délaissée vers 1795 pour le rocher fortifié de Dzaoudzi. La Grande Terre n'est alors réellement peuplée que sur la pointe Choa (Pointe Mahabou à Mamoudzou), tandis que de rares hameaux occupent le reste de l'île.
an 1844 : Algérie - Le 1er février 1844, la France crée une direction des Affaires arabes supervisant les bureaux arabes locaux dans les provinces d'Alger, Oran et Constantine pour d'établir un contact avec la population indigène.
Le 30 mai 1844, des troupes marocaines attaquent les troupes françaises basées dans l’Oranais et sont repoussées par le général Lamoricière. Abdelkader, réfugié au Maroc devant l’avance des troupes françaises, convainc le sultan Mulay Abd ar-Rahman d’envoyer une armée à la frontière algéro-marocaine. Les incidents de frontières se multiplient entre le Maroc et l’Algérie, et les militaires français construisent le fort de Lalla-Marnia au début de l’année. Le sultan du Maroc proteste contre ce qu’il considère comme une violation de territoire et appelle à la guerre sainte les tribus marocaines. Bugeaud, pour ne pas mécontenter la Grande-Bretagne, entre en pourparlers avec le caïd d'Oujda mais les négociations sont interrompues par une attaque de la cavalerie marocaine le 15 juin. Le 14 août 1844, le général Bugeaud écrase l'armée du sultan marocain à la bataille d'Isly. L'armée marocaine se replie en direction de Taza. Le sultan traite alors avec la France et s'engage à interdire son territoire à Abdelkader.
an 1844 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Les Britanniques prennent pied en Afrique de l’est
Les Britanniques cherchent notamment à éviter que la France ne prenne pied en Afrique de l’est. Pour les Britanniques, l’existence d’une puissance régionale forte, avec laquelle ils sont en bons termes, n’est pas pour leur déplaire, et le Royaume-uni apporte plutôt son soutien au sultan Sayyid Saïd.
Dans le même temps, les sociétés européennes désapprouvent de plus en plus largement le commerce des esclaves et le Royaume-Uni fait pression sur le sultanat pour réduire la traite des noirs. En 1822, un premier traité, dit de Moresby, est signé par le sultan. Par ce traité, le sultan accepte de rendre illégale la vente d’esclaves à des pays se déclarant chrétiens. Le traité impose également de circonscrire le commerce d’esclaves aux ports d’Oman et d’Afrique de l’est. En 1833, l’empire britannique montre l’exemple en abolissant l’esclavage dans ses colonies et en 1845, Sayyid Saïd signe le traité de Hamerton qui limite la traite des noirs à ses seules colonies d’Afrique de l’est. Mais sur le terrain, ces différents traités diplomatiques mettront des décennies avant d’être totalement appliqués.
Le sultanat multiplie les accords commerciaux et les échanges diplomatiques avec les puissances occidentales (en 1836 avec les États-Unis, 1840 avec la Grande-Bretagne et 1844 avec la France). Ces traités prévoient également l’établissement de consulats étrangers à Zanzibar, une première pour un pays africain sub-saharien.
an 1845 : Magreb - En vertu du traité d'El-Arisch, l'empereur du Maroc renonce au tribut que lui payaient jusqu'alors, pour la sécurité de leur navigation dans la méditerranée, la Suède et le Danemark.
an 1845 : Algérie - Si les troupes d'Abd El Kader sont victorieuses lors de la bataille de Sidi-Brahim (23 au 26 septembre 1845) engagée par le colonel Montagnac, mais l'émir doit se rendre aux spahis (nomades des régions steppiques de l'Algérie) du colonel Yusuf en décembre 1847. Placé en résidence surveillée pendant quatre ans en France, l'émir est libéré par Napoléon III, puis réside jusqu'à sa mort en Syrie.
an 1845 : Cameroun - Des missionnaires baptistes britanniques s'installent au Cameroun, qui entre de fait dans la zone d'influence de la Grande-Bretagne.
an 1846 : Afrique du Sud - Les Caffres soutiennent avec courage une guerre contre les Anglais de la colonie du Cap, qui ont dû intervenir dans la guerre des boërs, descendants des anciens colons hollandais, contre les indigènes.
En mars 1846, une nouvelle guerre Cafre est déclenchée sur la frontière orientale et se conclut par la défaite des guerriers Xhosas. Le district de la Reine Adélaide est déplacé à King William's Town et devient la Cafrerie britannique, administrée séparément de la colonie du Cap en tant que possession de la Couronne britannique.
an 1846 - 1890 : Mayotte - Période coloniale
De 1846 à 1886, Mayotte dépeuplée est une piètre et éphémère colonie sucrière. Le roseau sucré est cultivé sur la Grande Terre23. En 1856, un travail forcé est établi pour remédier à l'absence de main d'œuvre, il provoque la « Révolte de Bakari Koussou » le 18 mars 1856, réprimée dans le sang. Les travailleurs des plantations en nombre insuffisant sont en particulier soumis à des conditions de travail inhumaines. Très vite, les planteurs français qui ne veulent pas perdre le bénéfice des bons sols mahorais modernisent les installations de traitement de la canne à sucre. Alors que la population de simples travailleurs de plantations s'accroît après 1860, des usines à sucres modernes naissent à Debeney (Dembeni), Kaweni et Dzoumogné. La production annuelle de sucre atteint 1 500 tonnes et pourrait être étendue au besoin sur 8 000 ha de terres cultivables, soit le quart de la superficie de l'île. Mais les années 1880 confirment le déclin de l'activité sucrière, soumise à une forte concurrence internationale.
Mais les domaines ont déjà diversifié leurs productions : ils cultivent de la cannelle, du poivre, du girofle et du café qui poussent bien sur les sols rouges. Ils vendent aussi des fibres cellulosiques : coton et sisal, tout en gérant de façon spéculative leurs réserves de bambous géants, lianes et « bois noirs ». Ils importent de l'île de la Réunion des lianes de vanilles. Les bois de construction sont rares car, attestant des défrichements multiséculaires, il y a peu de grandes forêts avec des reliquats de takamaku blanc, de bois d'ébène et de bois de natte. Il ne reste que le bois de cocotier commun.
En 1870, le procureur impérial de Pondichéry Alfred Gevrey remet à Napoléon III un rapport sur Mayotte : s'il se montre confiant sur l'avenir sucrier et caféier de Mayotte (qui ne verra jamais vraiment le jour), il prévient que les nombreux marais nourrissent de nombreuses maladies paludéennes et qu'un Européen y possède une espérance de vie située entre trois et dix ans.
En 1886, Léon Humblot, un naturaliste amateur devenu aventurier politique, convainc le gouverneur de placer la Grande-Comores, où il a des intérêts, sous protectorat français. L'hégémonie française sur les Comores porte au paroxysme la rivalité franco-germano-anglaise. Puis la tension guerrière retombe en 1890, alors que les contentieux disparaissent subitement par un accord diplomatique entre les deux puissances coloniales : les Anglais obtiennent le sultanat de Zanzibar et la sécurité de leurs places dans l'océan Indien, les Allemands le Tanganyika, les Français sont désormais sans rivaux aux Comores et à Madagascar. Toutefois, l'ouverture à la même époque du Canal de Suez rend les comptoirs du canal du Mozambique beaucoup moins intéressants et l'activité portuaire s'effondre brutalement, plongeant les cités portuaires swahilies dans une crise durable.
an 1847-1848 : Algérie - Le territoire de l'ex-régence d'Alger est donc officiellement annexé par la France, mais la région de la Kabylie qui ne reconnaissait pas l'autorité de l'émir Abdelkader, et donc pas sa soumission à la France en 1847, résiste encore. L'armée française d'Afrique contrôle alors tout le nord-ouest de l'Algérie. Les succès remportés par l'armée française sur la résistance d'Abdelkader, renforcent la confiance française, et permettent de décréter, après débats, la conquête de la Kabylie qui doit intervenir à l'issue de la guerre de Crimée (1853-1856), qui mobilise une partie des troupes françaises. Napoléon III souhaite disposer d'une force suffisante pour permettre une conquête durable de la Kabylie.
Le 12 décembre 1848, la nouvelle Constitution française déclare l’Algérie partie intégrante du territoire français. Alger, Oran et Constantine deviennent les préfectures de trois départements français d'Alger, d'Oran et de Constantine, correspondant aux anciens beyliks ottomans. Musulmans et juifs d'Algérie deviennent « sujets français » sous le régime de l'indigénat.
Les insurrections continueront jusqu'en 1881.
an 1847 : Liberia - Fin de la guerre des Caffres avec les Anglais. La petite république de LIBERIA, fondée, en 1823, sur la cote de la Haute-Guinée, par la Société anglo-américaine de colonisation, en faveur d'environ 20 000 noirs ou hommes de couleur libérés de l'Union, est déclarée indépendante. Composée d'environ 215 000 individus en 1861. Elle sera gouvernée par un président, conformément à sa constitution, indépendamment de tout contrôle de la Société.
an 1847 : Cameroun - Le lamido Adama meurt en 1847. Le royaume Bamoun doit lutter contre l'avancée des peuples Peuls.
an 1847 : Libéria - L'histoire du Liberia en tant que pays commence en 1847, année où il devient officiellement indépendant de la Société américaine de colonisation, l'American Colonization Society, qui avait installé des esclaves noirs libérés à proximité du Cap Mesurado. Rapidement, un malaise entre Américano-Libériens et population autochtone apparaît.
En 1847, la colonie devenue Commonwealth du Liberia en 1838, devient une république indépendante. La Déclaration d'indépendance du Liberia est rédigée par Hilary Teague, un membre de l'American Colonization Society venu des États-Unis, et est ratifiée le 16 juillet 1847. Le suffrage censitaire permet aux américano-libériens de conserver le pouvoir durant un siècle.
an 1848 : Sénégal - Abolition de l’esclavage.
an 1849-1872 : Algérie - Le 26 novembre 1849, l'oasis de Zaatcha, dans le Sud algérien entre Biskra et Ouargla, dernier îlot de résistance d'insurgés conduits par Ahmed Bou Zian, ancien compagnon d’arme d’Abdelkader, tombe aux mains des troupes françaises au bout de 53 jours de siège. Sur 7 000 soldats français engagés, 1 500, dont 30 officiers, sont tués ou blessés, et 600 meurent du choléra.
Entre 1849 et 1852, la domination française s'étend à la Petite Kabylie. Le 11 juillet 1857, le dernier réduit de la résistance kabyle, dans le Djurdjura, est pris d’assaut par les troupes françaises. La maraboute Lalla Fatma N'Soumer est capturée. Avec la soumission de la Grande Kabylie, la France met fin à la résistance algérienne.
Bilan de la conquête : La population algérienne est estimée entre un et trois millions d'habitants par les observateurs européens à la veille de la conquête française de 1830. Pour le démographe Kamel Kateb, la population en 1830, peut être proche de quatre millions en partant de l’hypothèse qu’il existe un équilibre entre ressources disponibles et population.
La guerre, presque ininterrompue entre 1830 et 1872 a été extrêmement violente. Elle explique, pour partie, le déclin démographique, avec la perte d'environ 875 000 personnes. Selon les travaux d'Olivier Le Cour Grandmaison, cette diminution de l'« élément arabe » était considérée comme bénéfique sur le plan social et politique, car il réduisait avantageusement le déséquilibre numérique entre les « indigènes » et les colons. La conquête entraîne la destruction d'un nombre important de bâtiments dont l'objectif aurait eu pour but d'effacer l'identité culturelle et religieuse. Dans un rapport adressé à Napoléon III, un des généraux français a résumé la détermination de l'administration française à combattre les institutions culturelles algériennes en disant : « Nous sommes tenus de créer des entraves aux écoles musulmanes… chaque fois que nous le pouvons… En d'autres termes, notre objectif doit être de détruire le peuple algérien matériellement et moralement »[réf. nécessaire]. De fait, 349 zaouias, centres religieux soufis, ont été détruites.
Selon Daniel Lefeuvre, la chute de population entre 1830 et 1872 est également due à des crises agricoles et sanitaires considérables : les invasions de sauterelles de 1866 et 1868, ajoutées à un hiver très rigoureux en 1867-1868, sont à l'origine de la famine algérienne de 1866-1868, elle-même suivie d'épidémies de choléra entre 1861 et 1872.
La population algérienne connaîtra ensuite une rapide augmentation grâce à l'introduction de la médecine occidentale.
an 1849-1889 : Gabon - La naissance de Libreville (1849) est liée à l'incident du navire négrier brésilien Elizia. En effet, à la suite de la capture de ce navire négrier plein d'esclaves au large des côtes de Loango, les autorités françaises décident de les regrouper dans un village8, un peu à l'image de ce qui a eu lieu à Freetown. Ainsi, Libreville, nom choisi pour exprimer la liberté acquise par ces esclaves, est constituée à l'origine sur la base d'un peuplement de trente esclaves et constituera le fer de lance du processus d'occupation du territoire gabonais par les Français. À la suite de l'action d'explorateurs tels que le Marquis Victor de Compiègne, son ami Alfred Marche, ou encore Pierre Savorgnan de Brazza, les accords avec les groupes de population intérieure se multiplient ainsi que les missions catholiques. En 1886, le Gabon fait partie intégrante de l'empire colonial français par le décret du 26 juillet.
Voici comment le Bulletin de la Société de Géographie envisageait la présence française au Gabon, en 1889 : « Pour les Européens, il ne saurait être question d’un long séjour dans la Gabonie. Les fatigues, les marches y sont dangereuses. Cette contrée ne peut donc pas devenir une colonie de peuplement ; tout au plus restera-t-elle une colonie de commerce. Actuellement le nombre de Français résidant au Gabon ne dépasse pas le chiffre de cinquante, abstraction faite, bien entendu, des marins et des fonctionnaires. »
an 1849 : Réunion (Ile de la) - L'esclavage est aboli mais l'île reste une colonie française jusqu'en 1946. Un nouveau système d'asservissement des hommes — « l'engagisme » ou concept plus adapté le « servilisme » — est à la base de la nouvelle organisation économique et sociale de l'île. Au 1er janvier 1848, la population esclave s'élève à 62 151 individus soit 60 % de la population totale. Libérés le 20 décembre 1848, les affranchis auront chacun un nom (attribué par l'administration coloniale) rajouté à leur ancienne appellation d'esclave. Une minorité d'entre eux acceptent de rester auprès de leurs anciens maîtres, les autres vagabondent dans l'île ou se réfugient dans les hauteurs de l'île à la recherche de terres libres à défricher.
Les esclaves n'avaient pas de nom de famille et étaient désignés par leur nom de baptême ou par un surnom plus ou moins fantaisiste. Lors de leur affranchissement en 1848, les textes précisent que « le nom donné à l’affranchi doit être différent de ceux déjà utilisés dans la colonie » pour éviter toute confusion avec les familles blanches. Les officiers d'état civil leur attribuent un nom souvent moqueur tiré d'une particularité ou d'un jeu de mots, ou faisant référence à l'Antiquité classique. Certains affranchis ont cherché à se défaire de ces noms mais la plupart sont encore en usage.
Plus de 100 000 « engagés » malgaches et africains (nommés "Cafres"), indiens (nommés "Zarabes" pour les musulmans du Nord, et "Malbars" pour les tamouls du Sud de l'Inde) et chinois seront introduits dans la colonie par les propriétaires d'anciens esclaves pour remplacer ceux-ci sur les plantations.
La colonie reprend le nom d'île de la Réunion par arrêté gouvernemental du 7 mars 18486, promulgué sur place le 9 juillet 1848.
-
1849 : premières élections au suffrage universel.
an 1850 : En Afrique, la plus compacte des parties du monde, la plus directement exposée aux ardeurs d'un soleil brûlant, l'influence de l'Europe chrétienne s'arrête encore sur les côtes, et même celle de nos voisins musulmans, m^aîtres de l'Egypte, de la Nubie et du Sennar, des régences de Tripoli et de Tunis. La race noire domine l'Afrique, et c'est à elle qu'appartiennent tous les royaumes de l'intérieur, ceux des Fellatahs et des Peuls, de Bornou, de Darfour, du Fezzan, plus voisins de la mer, des Iolofs, des Aschantis, de Dahomé, de Bénin, puis, du coté opposé, des Somalis, des Malgaches, etc.
an 1850-1853 : Afrique du Sud - Le 24 décembre 1850, les Xhosas se soulèvent de nouveau. Les colons établis dans les villages frontaliers sont attaqués par surprise, la plupart sont tués et leurs fermes incendiées. Le conflit débouche finalement sur une nouvelle défaite Xhosa en 1853. La Cafrerie britannique change alors de statut pour devenir une colonie de la Couronne.
an 1850-1896 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Avant la colonisation, le territoire actuel du Burkina Faso était partagé entre différents royaumes ou chefferies :
+ le Gurma, pays des Gurmantchés et des Bembas ;
+ le Mossi, pays des Mossis ;
+ le Gwiriko, pays des Bobo-Dioulas ;
+ le Bissa, pays des Bisa ;
+ le Liptako, pays des Peuls, des Haoussas et des Bellas.
On oublie souvent la période des Amoravides et Ibn Tachfine ; il y a des récits historiques qui détaillent les conquêtes berbéres islamiques ayant fait allégeance au califat de Bagdad (Abbaside) qui étendirent le royaume almoravide jusqu'aux portes du Nord du Congo. On trouve peu de témoignages sur cette époque au Burkina Faso. Toutefois, une chronologie des royaumes mossis existe.
L'africaniste allemand Gottlob Krause (1850-1938) semble être le premier Européen à rejoindre Ouagadougou en 1886 (puis 1887).
En 1888, une première expédition française atteint le territoire de l'actuel Burkina Faso, menée par le capitaine Binger (1856-1936), qui est reçu à Ouagadougou par le Moro Naba (Mogho Naaba, Chef du monde, dirigeant du plus important royaume mossi.
Deux ans plus tard, sur les informations de Quinquandon (1857-1938), le docteur Crozat (1858-1893) traverse à son tour la région, s'arrêtant à Bobo-Dioulasso, où la princesse Guimbi-Ouattara le reçoit, puis à Ouagadougou, où il est lui aussi reçu par le Mogho Naaba.
Le climat entre Occidentaux et indigènes se tend en 1891, avec l'expédition du capitaine Monteil (1855-1925), chargée de reconnaître la ligne Say - Barroua fixée par la déclaration franco-britannique du 5 août 1890 : il visite Ségou, Sikasso, mais à Ouagadougou, le Mogho Naaba Wobgo dit Boukary Koutou refuse de le recevoir. D'autres missions suivent, notamment celles de Ménard (1861-1892)1 et Beaulot en 1891-1892. En 1894, les troupes françaises entrent à Ouagadougou.
Le fonctionnaire britannique de la Côte-de-l'Or (colonie britannique) (1821-1957, Ghana), arpenteur et cartographe, George Ekem Ferguson (en) (1864-1897) semble avoir obtenu vers 1892 un traité de protection de la part des autorités mossi.
Après l'occupation de Ouagadougou le 23 décembre 1896, le nouveau Mogho Naaba accepte le protectorat des Français, qui sont engagés dans une course aux colonies avec les Britanniques.
an 1850-1860 : Congo Kinshasa - Au XIXe siècle, des « princes marchands » africains comme Msiri dans les années 1850 au Katanga, ou Tippoo-Tip dans les années 1860 à l'ouest du Lac Tanganyika, établissent de véritables royaumes, mais aussi comme le royaume Zandé et le royaume Mangbetu.
an 1850-1875 : Afrique Côte d'Ivoire - La zone forestière dans le sud est par excellence une zone de développement de sociétés où l’autorité du chef de lignage s’exerce généralement au niveau d’une tribu. Elle connaît une mutation sociale significative caractérisée par la multiplication et le développement de diverses alliances d’où naissent des confédérations tribales, claniques ou régionales. Cette évolution ne se retrouve pas au nord dans les différentes branches du groupe sénoufo. S'étant développé à l’origine selon un schéma proche de celui des sociétés lignagères, le groupe sénoufo se constitue par la suite, peu à peu, en chefferies sur le modèle du « Kafu » malinké (un territoire restreint sur lequel s'exerce l'autorité d'un chef : le Faama) qui se consolident pour faire face notamment à l’expansionnisme de l’empire de Kong. Les autres sociétés vivant au nord, mais également celles du centre et de l’est, se présentent de manière encore plus hiérarchisée avec une organisation confortée par le renforcement de pouvoirs monarchiques ou l’apparition de nouvelles structures traditionnelles de type étatique. C’est le cas du royaume Abron de Gyaman dont l’autorité s’étend sur de nombreux peuples de l’est du territoire (Koulango de Nassian, Goro, Gbin, Ligbi, Huela, Agni et Dioula de Bondoukou) et qui s’affranchit du pouvoir Ashanti en 1875. Après une période d’expansion, ce royaume est cependant affaibli par des dissensions internes qui le fragilisent face aux conquêtes de Samory Touré et à l’impérialisme européen. Le Royaume du Sanwi tire le meilleur parti de ses relations avec l’extérieur et consolide son pouvoir sur les peuples du littoral du sud-est.
La monarchie baoulé est dominée par les Warébo et les Faafoué jusqu’à la dislocation après 1850, lorsque plusieurs groupes se constituent en entités indépendantes ou en nouvelles confédérations militaires aux contours plus ou moins précis. Dans le nord, les conquérants se multiplient mais sont tour à tour vaincus par Samory Touré qui soumet également tous les royaumes (Kong, Bouna, Koulango, Gyaman...). Ces conquêtes et guerres tribales sont fortement exacerbées par la traite négrière qui accentue la déstructuration des systèmes politiques et sociaux traditionnels en raison notamment de l’apparition de nouvelles hiérarchies sociales constituées par des personnes qu’elle enrichit.
Le XIXe siècle apporte ainsi de profondes mutations au niveau des organisations sociales traditionnelles et la création de nouvelles valeurs fondées sur la richesse, qui s’apprécie à la quantité de produits détenus (produits vivriers, cheptel, vêtements, poudre d’or, armes à feu) et au nombre d’individus sur lesquels l’autorité est exercée. Ainsi, les femmes, les enfants et les esclaves qui dépendent d’une même personne constituent pour celle-ci non seulement des ouvriers agricoles et des défenseurs du lignage, mais également une possibilité d’accroissement des alliances avec les autres familles par le mariage.
an 1850 : Ghana - Dans les années 1850, un métis né de père écossais et de mère africaine, James Bannerman, est nommé lieutenant gouverneur de la "Gold Coast" et son fils fondae le premier journal africain du Ghana, l'Accra Herald. Des écrivains comme Attoh Ahuma et Mensah Sarbah étudient le passé de leur pays et dénoncent les préjugés raciaux.
an 1850-1868 : Leshoto - Dans les années 1850, le royaume de Moshoeshoe était menacé par l'expansion des Boers qui venaient de fonder l'État libre d'Orange à ses frontières. Les Boers convoitaient alors la riche vallée du Caledon. En dépit de rapports d'abord cordiaux entre le roi des Sothos et le gouvernement de l'État libre d'Orange, les relations dégénérèrent en guerre de frontières6. Retranchés dans la région de Thaba Bosiu, Moshoeshoe, sur le conseil des missionnaires français ou de langue française (Suisses du canton de Vaud travaillant pour la SMEP, notamment Adolphe Mabille, et Français), fit appel en 1868 à la Grande-Bretagne pour demander à se placer lui et son peuple sous sa protection.
Le protectorat allait bien être établi mais les colons afrikaners poursuivirent leur poussée, menant une politique de faits accomplis suivis de quitus diplomatiques à répétition par les autorités britanniques. les Sothos perdirent la moitié de la vallée du Caledon (soit 50 % des terres cultivables), devenue une frontière entre le royaume et la république boer.
En 1868, le royaume sotho devenait un protectorat au sein de l'Empire colonial britannique sous le nom de « Basutoland ».
an 1850 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - La colonisation européenne 1850-1964
À cette époque débutent pour les Européens la découverte et l’exploration de l’intérieur du pays, encore largement « terra incognita ».
C’est dès la fin du XVIIIe siècle que des esprits du vieux continent commencent à se passionner pour le vaste et mystérieux continent africain. Les intérêts sont divers : passion anti-esclavagiste naissante, recherche d’aventure et d’exotisme, quête scientifique de la source du Nil…
La plupart des explorateurs qui veulent découvrir les terres situées au-delà de la bande côtière sous contrôle du sultanat d’Oman débarquent sur l’île de Zanzibar, porte d’entrée sur le monde de l’Afrique de l’est. Ils y recrutent de nombreux aides, achètent le matériel et les vivres nécessaires pour l’expédition, et choisissent les présents qu’ils devront offrir aux chefs de tribus locaux. monde occidental.
Deux pasteurs allemands, Krapf et Rebmann, sont parmi les premiers à parcourir l’intérieur des terres. Krapf traduit la Bible en Swahili et commence les premières évangélisations. Rebmann est le premier Européen à signaler le Kilimandjaro en 1848.
an 1851 : Archipel des Comores - En 1851, par l'Expédition d'Anjouan, les États-Unis imposent à Anjouan un traité de commerce privilégié.
an 1852-1854 : Afrique du Sud - Après l'annexion du Natal par les Britanniques au début des années 1840, l’épopée boer recommence pour atteindre son apogée dans les années 1852-1854 avec la création des deux républiques indépendantes, la Zuid Afrikaansche Republiek (« République sud-africaine ») au Transvaal et l'Oranje Frystaat (« État libre d'Orange »), reconnues par les Britanniques par le Traité de Sand River.
Ces républiques, économiquement arriérées, sont faiblement peuplées, 25 000 au Transvaal et la moitié dans l'État libre lors de leur fondation. Dans l'État libre d'Orange, le droit de vote permettant d'élire un parlement et un président, est accordé à tous les hommes blancs âgés de plus de 18 ans, quelle que soit leur origine. Dans la république sud-africaine du Transvaal, seuls les Voortrekkers sont à l'origine des citoyens. La citoyenneté sera accordée progressivement aux Boers d'arrivées plus récente. Si l'État libre d'Orange réussit rapidement à parvenir à une stabilité politique, la république sud-africaine au Transvaal mettra plusieurs années à assimiler une petite dizaine de micro-républiques boers réfractaires. La tentative, par le président Marthinus Wessel Pretorius, de fusionner les deux grandes républiques, au début des années 1860, est un échec.
an 1852 : Eswatini (Swaziland) - À partir de 1852, les Swazis entrèrent en conflit avec les Boers qui lorgnaient leurs terres fertiles puis avec les Portugais qui voulaient agrandir vers l'ouest leur colonie du Mozambique. Le territoire du royaume des Swazis ne cessait en effet d'attirer des chasseurs blancs, des commerçants, des missionnaires et des fermiers à la recherche de pâturage pour nourrir le bétail.
an 1852 - 1873 : Canaries (Îles des) - En 1852, la reine Isabelle II (1830-1904) déclare les îles Canaries zone de libre-échange par la Loi des ports francs des Canaries (es) de Juan Bravo Murillo (1803-1873). Les avantages tarifaires accordés conduisent à une relance de l'économie canarienne.
an 1852-1873 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Entre 1852 et 1873, trois maladies déciment plantations et habitants de l'île : le mildiou tout d'abord, qui détruit 90 % des plantations. En 1856, le choléra fait 7 000 victimes humaines. En 1873, le reste des cultures est détruit par le phylloxera.
an 1852 : Réunion (Ile de la) - Henri Hubert-Delisle devient gouverneur le 8 août.
an 1852 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1852, le royaume de Mzilikazi est reconnu par la République sud-africaine.
an 1853-1895 : Rwanda - Le Royaume du Rwanda , gouverné par le clan Tutsi Nyiginya, est devenu le royaume dominant à partir du milieu du XVIIIe siècle, s'étendant par un processus de conquête et d'assimilation, et atteignant son apogée sous le règne du roi Kigeli Rwabugiri en 1853–1895. Rwabugiri a étendu le royaume à l'ouest et au nord, et a lancé des réformes administratives qui ont provoqué un fossé entre les populations hutu et tutsi. Ceux-ci comprenaient uburetwa, un système de travail forcé que les Hutus devaient accomplir pour retrouver l'accès aux terres qui leur avaient été confisquées, et ubuhake, en vertu duquel les patrons tutsis cédaient du bétail à des clients hutus ou tutsis en échange de services économiques et personnels.
Lors de la colonisation, les ethnologues européens et les Pères blancs de l'Église catholique contribuent à diffuser une histoire du Rwanda, fortement discutable. Les premiers habitants auraient été des Pygmées, certainement des ancêtres des Twa actuels.
Pour les Pères Blancs, le Rwanda était divisé, jusqu'à l'arrivée des premiers colons, en quatre groupes :
-
les chefs des milices, des Hutu ;
-
les chefs de sol, principalement des Hutu ;
-
les chefs de pâturages, des Tutsi ;
-
les chefs des armées, également des Tutsi.
Cette conception ethniste est aujourd'hui remise en cause au profit de la conception socio-professionnelle. L'ensemble de la population partage la même langue, la même religion et la même culture, critères employés habituellement pour définir l'ethnie. Les catégories hutu (agriculteurs), tutsi (propriétaires de troupeaux), twa (ouvriers et artisans) n'étaient pas figées et il était fréquent de passer d'une classe à l'autre selon les mariages ou la richesse. En kinyarwanda, kwihutura signifie à la fois devenir tutsi et s'enrichir.
an 1853 : Sénégal - Naissance de Cheikh Ahmadou Bamba. Né en 1853 (an 1272 de l’Hégire), à Mbacke Baol, petit village du Sénégal fondé par son grand-père, Cheikh Ahmadou Ibn Mouhammad Ibn Habib Allah, appelé affectueusement par ses compatriotes Cheikh Ahmadou Bamba devint l’un des plus prestigieux fils de la communauté musulmane.
an 1854 : Ghana - En 1850 les Britanniques rachètent les forts danois et en 1871 ceux de la Hollande. Le territoire est déclaré colonie en 1874, et les Britanniques soumettront les territoires intérieurs, annexés en 1901.
an 1854 : Afrique du Sud - En mars 1854, la colonie du Cap se dote d'une constitution prévoyant l'établissement de deux assemblées dont les membres sont élus au suffrage censitaire. Le minimum de propriété pour voter à la chambre basse est très faible, 25 livres, permettant à 80 % de la population masculine d'exercer son droit de vote. La sélection des électeurs de la chambre haute est plus rigoureuse et nécessite de posséder déjà une certaine fortune, de 2 000 à 4 000 livres. L'égalité des races, reconnues depuis 1828, y est réaffirmée. Ainsi, un grand nombre de métis se retrouvent électeurs de plein droit à la chambre basse.
La colonie britannique du Natal est, quant à elle, sujette à de profonds troubles à la suite de la farouche résistance des Zoulous. L'autorité coloniale y crée des réserves afin d'assurer la sécurité du territoire, satisfaire les besoins en main-d'œuvre des fermiers et lutter contre le vagabondage. En 1849, sept réserves sont créés au Natal. Elles sont plus de quarante quinze ans plus tard, après l'extension du territoire. Mais, dans les années 1860, pour pallier le manque de main-d'œuvre dans les plantations de cannes à sucre du Natal, les Britanniques font venir des milliers d'indiens sous contrat qui resteront dans le pays, constituant un nouveau groupe ethnique.
an 1854 - 1869 : Egypte - la réalisation du grand projet du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps va changer la carte du monde. Par la suite, les Britanniques deviennent actionnaires majoritaires du canal en achetant aux Français 51 % des parts. Le contrôle du canal se fait désormais sous administration britannique.
an 1854-1865 : Sénégal - Faidherbe est le gouverneur de la colonie. Fondation de Dakar. Conquête des royaumes du Djolof et du Kayor.
an 1854 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1854, l’explorateur David Livingstone parvient aux chutes Victoria.
an 1855-1871 : Éthiopie - De 1855 au début du XXe siècle, trois souverains importants se succèdent. Le premier est Téwodros II dont le couronnement en 1855 marque la fin du Zemene Mesafent et le début de l'histoire moderne du pays. Premier véritable modernisateur, il lance un processus d'expansion, d'unification et de centralisation. Néanmoins, les résistances des notables régionaux devant les mesures adoptées et un conflit avec la Grande-Bretagne conduisent à son suicide en 1868 à Maqdala. Après le bref règne de Tekle Giyorgis II (de 1868 à 1871),
an 1855 à 1872 : Éthiopie - Le début de la période de centralisation : de Tewodros II à Yohannes IV
Sous les Negusse Negest Téwodros II (1855 - 1868), Yohannes IV (1872 - 1889), et Menelik II (1889 - 1913), l'Empire émerge de son isolement médiéval.
Téwodros II né sous le nom de Lij Kassa au Qwara, un petit district de l'Amhara occidentale, en 1818. Son père est un petit chef local, et l'un de ses oncles, Dejazmach Kinfu, est gouverneur des provinces du Dambya, Qwara et Chelga, entre le Lac Tana et la frontière au nord-ouest.
Kassa perd ses droits de succession à la mort de Kinfu, étant alors un jeune garçon. Après avoir reçu une éducation traditionnelle dans un monastère local, il prend la tête d'un groupe de pillards qui sillonnent le pays dans une existence digne de Robin des Bois. Le récit de ses exploits devient rapidement célèbre, et sa petite bande grandit rapidement en taille jusqu'à former une véritable armée.
Il est alors remarqué par le régent en place, le ras Ali Aloula, et sa mère la Nigiste Negest Menen Liben Amede (femme du Negusse Negest Yohannes III, marionnette du ras Ali Aloula). De façon à se rallier Kassa, le ras Ali Aloula et l'impératrice arrangent son mariage avec la fille d'Ali, et, à la mort de son oncle Kinfu, il est désigné chef du Qwara et de tout le Dambya sous le titre de Dejazmatch. Il s'attache alors à conquérir le reste des divisions du pays, le Godjam, le Tigré et le Choa, qui restaient alors insoumises. Les relations avec sa belle-famille (père et grand-mère) se détériorent rapidement, dégénérant en conflit armé contre eux et leurs suivants. Kassa finit par remporter gain de cause.
Le 11 février 1855, Kassa dépose le dernier souverain gondarien, et est couronné Negusse Negest sous le nom de Téwodros II. Il s'élance alors à la conquête du Choa la tête d'une armée.
Au Choa, le roi Haile Melekot, descendant de Meridazmach Asfa Wossen, s'oppose à lui. Des rivalités de pouvoir commencent à émerger au Choa, et après une attaque désespérée et de faible envergure contre Téwodros à Debre Berhan, Haile Melekot décède de maladie (en novembre 1855), désignant dans ses derniers soupirs son fils alors âgé de 11 ans à sa succession, sous le nom de Sahle Maryam (le futur Negusse Negest Menelik II).
Darge, frère de Haile Melekot, et Ato Bezabih, un noble du Choa, prennent en charge le jeune prince. Mais après une lutte sévère contre Angeda, le Choa doit se résigner à capituler. Menelik est confié au Negusse Negest, emmené au Gondar, et est élevé au service de Téwodros II, dans une détention confortable à la forteresse de Maqdala. Par la suite, Téwodros s'attache à moderniser et centraliser la structure législative et administrative du royaume, contre l'avis et la résistance de ses gouverneurs. Menelik se marie à la fille de Téwodros, Alitash.
En 1865, Menelik s'échappe de Magdala, abandonnant sa femme, et arrive au Choa, où il est acclamé en tant que négus.
En 1868, se sentant offensé par le refus de la Reine Victoria de répondre à l'une de ses lettres l'invitant à lui fournir de l'aide pour moderniser le pays, Téwodros II fait emprisonner plusieurs résidents britanniques, dont le consul alors en place. L'empire anglais lance alors uen 1868 une véritable expédition de 13 000 soldats (dont 4 000 Européens) sous les ordres de Sir Robert Napier, qui est alors envoyé de Bombay en Éthiopie.
Au cours de la bataille finale du 10 avril 1868 à Arogué, une pluie diluvienne met hors d'état les fusils à mèche de l'armée éthiopienne comme le signale l'historien britannique McKelvie, tournant ainsi rapidement à l'avantage des Britanniques pourtant épuisés par les conditions de l'expédition jusqu'à la forteresse de Maqdala.
Les Éthiopiens sont vaincus, et Magdala tombe le 13 avril 1868. Lorsque le Negusse Negest apprend que la porte de Magdala est tombée, il préfère se donner la mort, se tirant en pleine bouche, que de se rendre. Sir Robert Napier fou de rage, ordonne de mettre le feu à Magdala et à la bibliothèque impériale. La prise de Magdala fait alors l'objet d'un véritable pillage, au cours duquel des objets d'une valeur historique inestimable, en plus de la bibliothèque incendiée, ainsi que d'autres attributs du clergé, disparaissent. Certains de ces objets n'ont toujours pas, à ce jour, été rendus à l'Éthiopie, malgré les nombreuses réclamations.
À la mort de Téwodros II, de nombreux sujets du Choa, parmi lesquels le ras Darge, sont libérés, et le jeune Menelik commence à prendre de l'importance après ses victoires lors de quelques brèves campagnes contre les princes du Nord. Son ambition est de courte durée, puisque le ras Kassa Mercha du Tigré accède au titre impérial en 1872, se proclamant Negusse Negest sous le nom de Yohannes IV. Menelik est alors contraint de reconnaître sa légitimité.
an 1855 - 1876 : Malawi - En 1855, l’explorateur écossais David Livingstone descend le Zambèze depuis les chutes Victoria jusqu'à Tete. En 1856, il décide de remonter le grand fleuve jusqu'à son embouchure. Arrêté par les chutes de Quebrabasa, il oblique le long du fleuve Shire et en 1859, parvient sur les rives du lac Malawi qu'il baptise Nyassa (nyasa signifie « lac » en chiayo). Dans son sillage surviennent ensuite des missionnaires, des chasseurs et des trafiquants d'esclaves.
Des Églises presbytériennes écossaises installent alors des missions dans la région, avec entre autres objectifs l’intention de mettre fin au commerce d’esclaves vers le golfe Persique. Ainsi, en 1876, la mission de Blantyre est fondée, avec pour nom de baptême celui du village natal de Livingstone.
an 1855-1890 : Mali - Empire Toucouleur - Oumar Tall, à son retour de pèlerinage à La Mecque et de son séjour à l'université Al-Azhar du Caire, entreprend à partir de Dinguiraye la création d'un empire théocratique musulman.
Avec une armée de 30 000 hommes équipés d'armes à feu, il lance un Djihad en 1852. Il attaque le Bambouk et au Kaarta convertit par la force les habitants à l'islam.
Il s’attaque au Khasso mais doit faire face aux français qui avaient construit en 1855 un fort à Médine, sur un terrain acheté au roi du Khasso, Diouka Samballa Diallo. Oumar Tall assiège pendant 4 mois le fort, qui est libéré par les troupes françaises arrivées par le fleuve Sénégal en juillet 1857.
Oumar Tall se dirige vers l'est par Nioro puis Ségou, qu'il conquiert en 1861.
Vaincu par les peuls du Macina, il se réfugie ensuite dans la falaise de Bandiagara, où il se serait fait sauter.
Son fils, Amadou Tall, à qui il avait confié la ville de Ségou, prend sa succession mais ne réussit pas à maintenir l'unité de l'Empire.
En 1880, les Français lui promettent de ne pas toucher à ses possessions. Amadou croit en ces promesses et refuse de s'allier avec Samory Touré. Les Français conquièrent Ségou en 1890 et Amadou doit fuir à Sokoto, au nord du Nigeria.
an 1855 : Réunion (Ile de la) - ouverture du muséum d'histoire naturelle.
an 1856 : Afrique du Sud - Une jeune fille xhosa nommée Nongqawuse annonce avoir eu une vision, la puissance des Xhosas serait restaurée, le bétail multiplié et les Blancs chassés à la condition que, pour la pleine Lune, tout le bétail soit abattu, les récoltes brûlées et les réserves alimentaires détruites. Elle est entendue et les chefs xhosas ordonnent de procéder à la destruction du bétail et des récoltes. La prédiction ne se réalise pas à la date prévue alors que 85 % du bétail avait été abattu. La faute en est imputée aux récalcitrants et de violentes querelles achèvent de plonger la région dans la misère et la famine. La population est affamée, réduite à manger de la nourriture des chevaux, de l'herbe, des racines, des écorces de mimosa, certains s'adonnant jusqu'au cannibalisme pour survivre. D'autres fuient vers la colonie du Cap pour implorer des secours. En fin de compte, cette famine meurtrière signe la fin des guerres entre Britanniques et Xhosas. La population de la Cafrerie passe en deux ans de 105 000 à moins de 26 000 individus. Les terres dépeuplées sont alors attribuées à plus de 6 000 immigrants européens d'origine allemande.
an 1856 : Burundi - Les premiers explorateurs et missionnaires européens font de brèves incursions dans la région à partir de 1856. Contrairement à son homologue rwandais, qui accepte les propositions allemandes, le roi Mwezi IV Gisabo s'oppose à toute ingérence occidentale, refusant de porter des vêtements européens et interdisant la présence de missionnaires et d'administrateurs.
an 1856-1894 : Gambie - Les Français occupent un petit poste pris aux Portugais et qui végétait sur la rive nord de la Gambie, Albreda. Celui-ci est finalement cédé au Royaume-Uni en 1856. À la suite d'un accord franco-britannique sur ses frontières en 1889, la Gambie devient officiellement un protectorat britannique en 1894.
Les frontières actuelles sont tracées en 1889 après plusieurs tentatives sans suite d'échange de la Gambie contre d'autres territoires français dans le golfe de Guinée. L'accord franco-britannique de 1889 permet de définir les frontières avec le futur Sénégal, y compris la Casamance prise par les Français aux Portugais. Le Royaume-Uni fait officiellement du pays un protectorat britannique en 1894.
Plus petite colonie de l'Empire britannique, la Gambie ne connaît aucun événement notable et reste un territoire marginal.
an 1856 : Guinée équatoriale - En 1856, l’Espagne fonde officiellement la Guinée espagnole, initialement réduite au domaine maritime des côtes guinéennes, et de son île principale.
an 1856-1860 : Maroc - Le Royaume-Uni cherche à accroître sa puissance économique et signe en 1856 un traité commercial à son avantage. L'Espagne pousse son désir de reconquête. Répondant aux succès des colonisations accomplies par la France, elle prend possession des îles Jaafarines, petit archipel méditerranéen au large des côtes marocaines, en mai 1848. Elle déclenche et gagne par la suite la guerre hispano-marocaine de Tétouan en 1859-1860. Cette défaite impose au Maroc de lourdes pertes humaines ainsi qu'une importante indemnité de guerre empruntée auprès des Britanniques, ce qui aggrave une situation économique déjà fragile.
an 1856 : Ouganda - L’expansion du Bouganda se poursuit au détriment du Bounyoro, par la soumission de royaumes tributaires (Busoga, Bwera, Buhaya, Kooki) ou de royaumes clients (Karagwe, Kiziba, Busubi, Buzinza). Des contacts étroits et fréquents se sont établis dès la fin du XVIIIe siècle entre le kabaka Kyabagou et les commerçants arabes et européens établis sur la côte orientale de l’Afrique. Les échanges s’intensifient sous les règnes de Semakokiro et de son successeur Suna II (mort en 1856).
an 1856 - 1858 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - La colonisation européenne 1850-1964
Un peu plus tard, en 1856, deux explorateurs anglais (Richard Burton et John Speke) cherchent à trouver la source du Nil. Ils remontent la piste des caravanes commerciales arabes, et parviennent au lac Tanganyika en 1857-1858, puis Speke atteint une véritable mer intérieure qu’il nomme lac Victoria en l’honneur de sa majesté la reine. Un second séjour en 1861 le conforte dans l’idée qu’il avait bien trouvé par ce lac la source du Nil.
an 1856 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Le déclin du sultanat et les conditions d’une colonisation 1856-1886
En 1856, Sayyid Saïd décède et des luttes fratricides opposent les différents fils du sultan pour sa succession. Finalement, avec l’aide des Britanniques qui interviennent largement dans les affaires du sultanat, c’est le fils ainé Thuwaini qui récupère le trône à Oman tandis que Majid, son frère cadet, prend la tête des possessions de Zanzibar, qui est déclaré indépendant du sultanat omanais. Le territoire sous contrôle du sultanat de Zanzibar comprend alors, outre l’île principale, l’île de Pemba, l’île de Mafia, et la bande côtière qui leur fait face, du Mozambique portugais jusqu’à l’actuelle Somalie (la Côte de Zanguebar). Du côté ouest en direction des grands lacs, la limite de la zone zanzibarite n’est pas vraiment fixée.
an 1857 : Mali - L'avancée coloniale française sur le territoire de l’actuel Mali se déroule pendant la seconde moitié du XIXe siècle. L’armée coloniale avec Louis Léon César Faidherbe se heurte à la résistance de El Hadj Oumar Tall, notamment lors du siège du fort de Médine en 1857 et de Samory Touré capturé en 1898.
an 1858 : Guinée équatoriale - En 1858 est envoyé le premier gouverneur général de l’île, cette dernière bénéficiant un an plus tard du statut de colonie espagnole.
Cependant, le domaine de plus de 800 000 km2 laissé en Guinée par le Portugal à l’Espagne par les traités de San Ildefonso (1777) et du Pardo (1778) est plus ou moins abandonné, et l’Espagne rencontre bien des difficultés pour faire admettre ses droits de propriété auprès des autres puissances européennes qui viennent s'y installer : la France au Gabon, l'Allemagne au Cameroun et la Grande-Bretagne au Nigeria.
an 1859-1884 : Djibouti - Le 4 juin 1859, le commerçant réunionais et ancien agent consulaire de France à Aden, Henri Lambert, est assassiné dans le golfe de Tadjourah. Une mission navale dirigée par le vicomte Fleuriot de Langle arrête les coupables présumés, et envoie en France des représentants de l'autorité politique du pays, le sultanat afar de Tadjourah . C'est avec cette délégation qu'est signé le 11 mars 1862 un traité cédant à la France « les ports, rade et mouillage d'Obock (…) avec la plaine qui s'étend depuis ras Ali (en) au sud jusqu'à ras Douméra (ceb) au nord ».
Ce n'est cependant que vingt ans plus tard, après l'installation de quelques commerçants et l'interdiction d'Aden aux navires de guerre français durant la guerre du Tonkin, qu'une mission exploratoire est confiée à la fin de 1883 à un jeune administrateur, Léonce Lagarde, et au commandant de l'Infernet, le capitaine de frégate Conneau. C'est à la suite de ce repérage que Léonce Lagarde est nommé « commandant à Obock » le 24 juin ; il prend ses fonctions en arrivant sur place le 1er août 1884.
an 1859 : Afrique République de Djibouti - Le 4 juin 1859, le commerçant Henri Lambert, ancien agent consulaire de France à Aden, est assassiné dans le golfe de Tadjourah. Une mission conduite par le commandant de la station navale de la Côte orientale alors basée sur l’île de La Réunion, le vicomte Alphonse Fleuriot de Langle, arrête les coupables, remis aux autorités turques, puis envoie une délégation de notables afars à Paris.
an 1859 : Magreb - l'auteur de la constitution tunisienne, SIDI-AHMED-BACHA, meurt prématurément (22 septembre 1859) et a pour successeur sur le trône de la régence son frère SIDI-SADOK, qui jure aussitôt d'observer fidèlement cette loi fondamentale.
an 1859 : Magreb - Dans le Maroc, MULEY-ABDERRHAMAN termine un règne très long, à la veille de la guerre que l'Espagne prépare contre son empire. Son héritier (6 septembre 1859) est SIDI-MOHAMMED, l'ainé de ses dix-sept fils, âgé déjà de 56 ans. Dès cette année-ci, le Maroc se trouverait en guerre avec la France, si cette dernière ne trouvait pas plus simple de demander compte directement des offenses dont elle se plaint, aux Béni-Snassen et autres tribus kabyles insoumises, ou qui du moins osaient souvent commettre pour leur propre compte des actes d'hostilité contre leurs voisins.
an 1859-1873 : Maroc - À la suite de ce conflit catastrophique pour le makhzen, qui doit payer au gouvernement espagnol une indemnité de guerre de quatre millions de livres sterling empruntés auprès des banques britanniques, Mohammed IV (1859-1873) successeur de Moulay Abd al-Rahman amorce une politique de modernisation urgente de l'Empire chérifien. L'armée est le premier champ de ces réformes structurelles. Le système des tribus guich est aboli et remplacé par un recrutement au sein de toutes les tribus nouaïbs (soumises à l'impôt régulier) qui sont tenues de fournir des tabors (unités) d'askars (soldats) et tobjias (artilleurs); l'organisation et les uniformes militaires sont calqués sur ceux de la nouvelle armée ottomane du Nizam-i Djédid. L'instruction et la formation de ces troupes sont confiées à des conseillers militaires turcs puis européens, à l'instar de l’Écossais Sir Harry Mac-Lean (qui obtient le titre de caïd pour l'organisation des Harrabas, régiment d'élite du sultan formé sur le modèle britannique), et l'armement est acheté auprès d'entreprises étrangères telles que la firme allemande Krupp, (ce qui marque le début de l'influence de l'Allemagne dans les affaires marocaines), quand il n'est pas fabriqué sur place. En 1871, Mohammed IV envisage de demander l'assistance des États-Unis du président Ulysses S. Grant, sortis depuis peu de leur guerre de Sécession, sous forme d'un protectorat américain sur l'Empire chérifien, afin de se soustraire aux pressions anglo-espagnoles (la France étant momentanément absente de la scène nord-africaine en raison de sa défaite face aux Allemands en 1870).
Parallèlement à cette modernisation de l'armée, quelques industries sont créées par des étrangers (comme l'arsenal de Dar al-Makina fondé à Fès par des Italiens), et des progrès notables sont enregistrés comme l'installation de la première imprimerie moderne arabe du Maroc en 1865. Mais cette politique de remise à niveau entraîne des dépenses qui nécessitent d'importants financements. Le makhzen, affaibli par les conséquences de la guerre hispano-marocaine de 1860 et les emprunts bancaires, se voit donc contraint de lever des taxes supplémentaires non conformes à la Loi islamique et nommées mûkûs, rapidement impopulaires et désapprouvées par les oulémas et l'ensemble des corps sociaux et professionnels. Les tensions liées à cette décision éclatent au lendemain de la mort de Mohammed IV et à l'avènement de son successeur Hassan Ier en 1873. Elles prennent dans les villes la forme d'émeutes durement réprimées, dont la révolte des tanneurs de Fès est un exemple illustratif.
an 1859-1881 : Mauritanie - Néanmoins, peu après la mort de Moulay Ismail, l'autorité du Maroc sur les émirats mauritaniens devient nominale voire presque inexistante sur certaines de ces régions. Quoiqu'en 1859, le Sultan Sidi Mohammed IV envoie une lettre de félicitation au Cheikh Sidya al-Kabir alors chef de la tribu Oulad Biri de la confédération des Trarzas : «Nous avons bien reçu votre reconnaissance bénie de Notre Personne en tant que Prince légitime...». Ce n'est qu'à partir du règne de Hassan 1er que les activités marocaines au Sahara recommencent. En 1879 et en 1880 la Légation anglaise au Maroc a été informée par les autorités marocaines que les domaines du sultan Moulay Hassan allaient jusqu'au fleuve Sénégal et comprenaient la ville de Tombouctou et les parties voisines du Soudan, une revendication fondée sur le fait que les prédécesseurs de Moulay Hassan se considéraient toujours comme souverains de ces régions. En 1881, Hassan Ier interdit à l'Espagne d'établir des relations commerciales au Souss et au Oued Noun mais lui interdit aussi d'établir aucune autre communication entre Agadir et le Sénégal français. Une donnée assez précise de l'étendue du Sahara marocain est donnée par Louis Noir (1837-1901) dans son ouvrage "Voyages,explorations,aventures": «Des rives du Sénégal, près de son embouchure, le Sahara marocain s'étend de Tiourourt situé sur les bords de l'Océan, jusqu'à Figuig, oasis marocain, qui s'élève à peu de distance d'Aïn-Safra, [...]».
an 1859 : Réunion (Ile de la) - Epidémies de choléra et de variole. C'est aussi la fin de l'immigration africaine.
an 1859 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - La colonisation européenne 1850-1964
Le célèbre David Livingstone, de son côté, lors de ses expéditions d’exploration du fleuve Zambèze, atteint par le sud le lac Nyassa (aujourd’hui lac Malawi) le 19 septembre 1859, puis en explore les environs. En fait, ce lac avait certainement déjà été repéré des Portugais au XVIIe siècle, mais leurs observations ne furent pas communiquées au reste du monde.
an 1860 : Afrique du Sud - Dans les années 1860, des groupes de Bastaards fondent la communauté de Rehoboth dans le Sud-Ouest africain.
Si l'État libre d'Orange réussit rapidement à parvenir à une stabilité politique, la république sud-africaine au Transvaal mettra plusieurs années à assimiler une petite dizaine de micro-républiques boers réfractaires. La tentative, par le président Marthinus Wessel Pretorius, de fusionner les deux grandes républiques, au début des années 1860, est un échec.
Le Transvaal comme l'État libre d'Orange sont des sortes de patriarcats pastoraux, aux infrastructures des plus sommaires. La Zuid Afrikaansche Republiek est constituée essentiellement de fermes disséminées sur des milliers de kilomètres. Si l'inégalité des blancs et des gens de couleurs, dans l’État ou au sein de l'église réformée hollandaise, est affirmée dans la loi fondamentale de l'État, des traités sont signés entre le Transvaal et les chefs indigènes garantissant un droit de propriété foncier inaliénable dans les huit territoires tribaux reconnus au sein de la république. Les relations avec celles-ci sont peu conflictuelles même si elles obligent parfois à mener des expéditions militaires, parfois punitives, comme celles contre le chef Makapan. Si aucune armée au sens strict du terme n'existe au Transvaal, la défense du territoire boer est assuré par des Kommandos, composés de fermiers, relevant de chefs de districts lesquels sont sous les ordres du commandant général, élu par les Boers. Si dans l'état-libre, les conflits sont plus nombreux avec les Sothos, les alliances se nouent parfois même entre Boers et Bantous pour faire front face à un ennemi commun.
an 1860 : Cameroun - À partir de 1860, les Allemands s'intéressent aussi au territoire et partent explorer l'intérieur des terres avec Gustav Nachtigal, qui signe une série de traités avec les tribus, établissant de fait un protectorat allemand confirmé au congrès de Berlin en 1885. Les Allemands créent de grandes plantations (cacao, palmiers, hévéas), bâtissent des routes, une voie ferrée et le port de Douala.
an 1860-1868 : Leshoto - Des commerçants blancs s'installent sur le territoire dès le début du siècle.
Des années 1820 aux années 1860, le pays subit les raids zoulous, la poussée colonisatrice des Boers, pour finir sous protectorat britannique en 1868.
an 1860 : Réunion (Ile de la) - le 21 avril : inauguration de l'hôtel de ville de Saint-Denis.
l'île compte 179 190 habitants.
an 1861 : Mali - Le Royaume peulh du Macina succède au royaume Bambarra
an 1861 : Nigéria - Période britannique (1800-1960)
En 1861, les Britanniques prennent le contrôle de Lagos, ancien port de commerce d'esclave fondé par la portugais, dont ils font une colonie.
an 1862 : Afrique République de Djibouti - le traité d'Obock signé en 1862 établit un protectorat français sur ce petit mais stratégique pays.
Le « représentant » du « sultan de Tadjourah », Dini Ahmed Abou Baker, que le 11 mars 1862, Édouard Thouvenel, alors ministre de Napoléon III, signe un traité de paix et d'amitié perpétuelle par lequel la France achète « les ports, rade et mouillage d'Obock situés près du cap Ras Bir avec la plaine qui s’étend depuis Ras Aly au sud jusqu’à Ras Doumeirah au nord » pour 10 000 thalers de Marie-Thérèse
L'accord de mars 1862 qui cède le territoire d'Obock à la France signale le «cap Doumeirah», situé sur le territoire du sultanat de Rehayto, comme sa limite septentrionale.
an 1862 : Sénégal - Pinet-Laprade dresse le plan de Dakar.
an 1863 : Algérie - Napoléon III essaye de transformer la conquête en un « royaume arabe » associé à la France et dont il serait lui-même le souverain.
Dans les faits, Napoléon III adopte dès 1863 un sénatus-consulte destiné à garantir les terres des tribus. Dans les faits, le sénatus-consulte constitue surtout une étape en vue de la francisation de la propriété foncière.
an 1863-1890 : Bénin (anc. Dahomey) - Au XVIIIe siècle, Allada et Ouidah furent annexés. Les Européens développèrent des forts sur la côte comme des bases militaires afin d'imposer aux ethnies côtières une menace militaire pour qu'elles leur fournissent des esclaves (même si c'est l'or qui intéressait surtout les Portugais, lors des premières implantations colonisatrices dans le golfe de Guinée). C'est le roi Ghézo qui consolida le royaume en attaquant régulièrement les Yorubas au Nigeria, ce qui lui procurait des esclaves. Son successeur, le roi Glélé, irrita cependant les Français par son attitude belliqueuse et par son non-conformisme. Par le traité de 1863, il autorisa les Français à s'installer à Cotonou. Mais la présence de ceux-ci, ainsi que leur captation des droits de douane qui lui revenaient antérieurement, irrita le roi Gbê han zin qui lutta contre les Français pour recouvrer la souveraineté du royaume. Une statue géante du roi à l'entrée de la ville d'Abomey illustre et rappelle cette lutte face à l'envahisseur. Gbê han zin fait figure de résistant et jouit d'une haute estime en Afrique Noire. Béhanzin fit donc la guerre aux Français, mais il ne fut pas le seul des douze rois à s'être dressé contre l'envahisseur. Le Traité de Ouidah qui plaçait Porto-Novo et Cotonou sous tutelle française fut signé en octobre 1890. Ce même traité prévoyait le versement par la France d'une pension au roi du Dahomey. Le roi Béhanzin et les Danxoméens considéraient le roi Toffa de Porto-Novo comme un traître, celui-ci ayant fait alliance avec les Français. Battu militairement, s'étant enfui, Béhanzin, soucieux de son peuple, demanda à discuter avec le président français d'alors. Ainsi il se rendit en 1894 au général Alfred Amédée Dodds et fut déporté aux Antilles. Abomey devint alors un protectorat français. Allada et Porto-Novo, eux aussi sous protectorat, formèrent avec Abomey la colonie du Dahomey.
an 1863 : Maroc - La France quant à elle, désireuse de constituer en Afrique du Nord un territoire homogène signe, en 1863, une convention franco-marocaine.
an 1865 : Algérie - En 1865, 225 000 colons, français ou européens possèdent environ 700 000 hectares.
Le 14 juillet 1865, un sénatus-consulte laisse « le libre choix de la citoyenneté française aux Algériens tout en leur assurant sans condition les droits civils des Français ». Ce texte est considéré comme le plus libéral de la législation coloniale française. Les Juifs d’Algérie peuvent obtenir leur naturalisation française s'ils la demandent.
an 1865 : Éthiopie - Le siècle naissant trouve un pays morcelé, dont l'Église éthiopienne est la seule source d'unification, et dont l'ennemi extérieur principal est l'Égypte, qui lance une attaque en 1875, alors que les côtes de la Mer Rouge sont la convoitise depuis l'ouverture du Canal de Suez, des Italiens, des Britanniques et des Français.
an 1865-1885 : Ile Maurice - Période britannique (1810-1968) - Crise social et économique
Des épidémies de choléra et de malaria font entre 1866 et 1868 au moins 50 000 victimes.
De plus, l’économie basée sur la monoculture de la canne à sucre reste très vulnérable aux maladies et aux catastrophes naturelles. La société se polarise entre les planteurs d’une part et la masse des travailleurs sans qualification et sans droit d’autre part. En 1871 est mise en place une commission composée d’envoyés de la couronne et chargée d’examiner les conflits entre les travailleurs, les planteurs et les fabricants de sucre. Beaucoup de planteurs sont condamnés et il en découle de nouvelles lois en faveur des travailleurs qui améliorent quelque peu la situation sociale. La mesure la plus importante consiste à mettre fin à l’émigration forcée depuis l’Inde. De ce fait, les planteurs perdent leur principal moyen de pression : la menace de remplacer les travailleurs qui les dérangent par d’autres travailleurs venus d’Inde.
Cette période est également celle du développement des infrastructures de l’île. En 1865 sont inaugurées les deux premières lignes de chemin de fer. En 1869, Maurice est reliée par le télégraphe à l’Europe puis à l’Inde. Mais le développement économique de l’île ne s’accompagne pas des mesures sociales nécessaires et les inégalités augmentent.
Au début du XXe siècle, la population mauricienne atteignait les 371 000 habitants et la majorité de la population était déjà constituée d'Indiens. En 1870, l'île perdit sa position stratégique à l'occasion de l'ouverture du canal de Suez, et cet événement eut pour effet d'écarter l'île de Maurice de la route des Indes et d'aggraver la situation socio-économique.
an 1865 : Réunion (Ile de la) - épidémie de typhus.
an 1866 : Afrique du Sud - En 1866, la colonie du Cap étend également son territoire et annexe la cafrerie britannique alors que les premiers diamants sont découverts à Kimberley, puis des gisements d'or dans le Witwatersrand au Transvaal.Tout le territoire de la cafrerie britannique est incorporée à la colonie du Cap pour former les districts de King William's Town et de East London.
an 1866 : Algérie - Le 27 décembre 1866, un décret crée des conseils municipaux élus par quatre collèges séparés : français, musulmans, juifs et étrangers européens. Les Français disposent des deux tiers des sièges ; dans les « communes de plein exercice », les maires ont des adjoints indigènes.
an 1866 : Cap Vert - L'esclavage est définitivement aboli en 1866 alors qu'une grande partie de l'économie est fondée sur l'exploitation des esclaves dans les grands domaines.
L’abolition de l'esclavage porte un coup durable à l’économie capverdienne. C’est à cette époque que débute la première vague d’émigration vers les États-Unis.
À la fin du XIXe siècle, l’ouverture des lignes transatlantiques est l’occasion d’une embellie économique, Mindelo devenant une escale privilégiée de ravitaillement en fuel, eau et vivres. L’archipel continue cependant à souffrir de fréquentes sécheresses et famines qui font des milliers de victimes au cours de la première moitié du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, Mindelo cesse d’être une escale commerciale et le pays replonge dans une forme de misère.
Les Européens forment la première population connue du pays, les cap-verdiens ont bénéficié d'une plus grande proximité culturelle avec la métropole portugaise. La première école élémentaire ouvre en 1817, et le Cap-Vert reste la première colonie portugaise à être dotée d’un lycée dès 1866. Au jour de l’indépendance, un quart de la population était alphabétisée, contre 5 % en Guinée-Bissau.
an 1866-1888 : Gambie - De 1866 à 1888, la Gambie est à nouveau avec le Sierra Leone puisque quatre colonies britanniques (Gambie, Sierra Leone, Lagos et Côte de l’Or) sont regroupées dans « Les établissements britanniques de l’Afrique Occidentale » (West African Settlements). Le gouvernement central se situe à Freetown, au Sierra Leone. Des conflits ont lieu entre Peuls et Malinkés. La Gambie dispose de son propre gouverneur. Puis, des négociations franco-britanniques territoriales reprennent : le Royaume-Uni propose cette-fois la Gambie en échange de l’arrêt de toute activité française autour du golfe de Guinée, ce que la France refuse. En 1876, une brochure britannique écrit qu’il ne faut pas « abandonner la riche Gambie et ses populations » à la « barbarie du gouvernement français ».
an 1866 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - La colonisation européenne 1850-1964
En 1866, Livingstone repart de Zanzibar pour achever l’exploration du lac Tanganyika et des régions environnantes. Il souhaite aussi prendre part à la quête des sources du Nil, qui n’est encore pas terminée car John Speke n’a toujours pas réussi à faire accepter de tous, et notamment de Richard Burton son ancien compagnon de voyage, la véracité de sa théorie. Livingstone est supposé mort pendant plusieurs années, car on est sans nouvelle de lui à Zanzibar jusqu’en 1871. Un journaliste américain, Henry Stanley, part à sa recherche et le découvre en 1872 à Ujiji près de Kigoma. Livingstone poursuit ses voyages mais meurt de dysenterie l’année suivante près des rives du lac Tanganyika.
À côté de ces célèbres explorateurs, de nombreux missionnaires parcourent l’intérieur des terres de la côte est-africaine à partir du milieu du XIXe siècle : les spiritains qui s’installent à Morogoro et Kondoa, les anglicans, les pères blancs qui se rendent à Tabora, à Ujiji et Karema, les bénédictins…
La visite de tous ces explorateurs-missionnaires européens et les témoignages qui en reviennent de la vie des populations locales vont accélérer la prise de conscience par les opinions publiques européennes des horreurs liées à la traite des noirs. Livingstone notamment, lors de ses retours d’expéditions en Angleterre, multiplie les conférences et publications pour décrire ce qu’est la réalité du commerce des esclaves en Afrique.
an 1867 : Égypte - Les successeurs de Méhémet Ali, dont la semi-indépendance est reconnue en 1867 avec le titre de khédive, tombent sous la dépendance des institutions financières européennes et, après la révolte nationaliste du colonel Ahmed Urabi.
an 1867 : Guinée-Bissau - En 1867, le royaume de Gabu est vaincu par l'armée de la confédération peule et musulmane du Fouta Djalon.
an 1868 : Cameroun - Un comptoir allemand est ouvert près de Douala par Carl Woermann, un marchand de Hambourg.
an 1868 : Réunion (Ile de la) - Grand incendie de Salazie. Émeute et état de siège à Saint-Denis pendant six mois.
an 1869 : Érythrée - L'État ottoman garde le contrôle des zones côtières du nord durant près de trois siècles avant de céder leurs possessions, la province de Habesh, à l'Égypte en 1865. L'Italie acquiert progressivement des terres sur la côte, autour d'Assab, en 1869, 1879 et 1882. L'intérieur des terres, en particulier les hauts plateaux de Hamasien, Akkele Guzay et Serae, majoritairement chrétiens orthodoxes gardent leur indépendance. Un prêtre italien catholique du nom de Sapetto achète le port d'Assab au sultan Afar, un vassal de l'empereur d'Éthiopie, pour le compte du conglomérat commercial italien Rubatinno. Plus tard, lorsque l'Égypte se retire du Soudan pendant la révolte mahdiste, la Grande-Bretagne conclut un accord permettant aux forces égyptiennes de se retirer à travers l'Éthiopie, en échange de quoi ils autorisèrent l'Empereur à occuper les plaines dont il a disputé la possession avec l'Empire ottoman et l'Égypte. L'Empereur Yohannès IV pense que cela inclut Massaoua mais l'Égypte et la Grande-Bretagne cèdent le port à l'Italie qui l'unit au port d'Assab pour former un comptoir. L'Italie profite des troubles qui agitent le nord de l'Éthiopie à la suite de la mort de Yohannès IV pour occuper les hauts plateaux et établir une nouvelle colonie en Érythrée, reconnue par le nouvel empereur de l'Éthiopie, Ménélik II.
L'Italie commence à s'engager sur les rives de la mer Rouge le 17 novembre 1869, lorsque la Società di Navigazione Rubattino achète la baie d'Assab au sultan local.
an 1869 : Ouganda - Le déclin du Bounyoro se poursuit malgré la résistance du moukama Kamurasi (mort en 1869) aux empiétements du Bouganda.
Indépendance du Toro (Ouganda), ancienne province du Bounyoro. Le Toro contrôle les mines de sel de Katwe, des terres réputés pour leurs herbages et l’accès des routes conduisant à la côte swahili.
an 1870 : Algérie - L'avènement de la Troisième République provoque de grands troubles en Algérie, notamment entre civils et militaires. La Troisième République mène une politique d'assimilation : francisation des noms, suppression des coutumes musulmanes.
Le 24 octobre 1870, les décrets du gouvernement de la Défense nationale mettent notamment fin au gouvernement militaire en Algérie, pour le remplacer par une administration civile, et accordent la nationalité française aux Juifs d'Algérie par le décret Crémieux (1870). La très ancienne communauté juive d'Algérie se trouve séparée des musulmans et bientôt exposée à l'antisémitisme qui gagne les colons. Le décret permet la promotion d’une communauté en majorité pauvre et augmente la population française d’Algérie de 37 000 nouveaux citoyens. En accordant aux Juifs algériens le même statut que les Français d'Algérie, il divise les autochtones car les musulmans ne tiennent pas, dans un premier temps, à ce statut de citoyen français, surtout en raison de leur culture et religion. Plus tard, on accordera la citoyenneté française aux musulmans qui le demanderont expressément. Globalement, la communauté européenne et la communauté musulmane vivent ensemble mais sans se mélanger.
À la suite des décrets, de la défaite de la France en Europe dans la guerre franco-prussienne, de la lutte que se livrent colons et militaires pour le pouvoir et à cause de la condition misérable des indigènes, favorisée par plusieurs années de sécheresse et de fléaux, la dernière grande révolte d'Algérie a lieu en 1871. Elle débute au mois de janvier avec l'affaire des Spahis, s'aggrave en mars avec l'entrée en dissidence de Mohamed El Mokrani, qui fait ensuite appel au Cheikh El Haddad, le maître de la confrérie des Rahmaniya. Plus de 150 000 Kabyles se soulèvent et le mouvement touche une grande partie de l'Algérie. La révolte est cependant rapidement et sévèrement réprimée.
L'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne après la guerre de 1870 entraîne un exode de population vers l'Algérie.
an 1870-1875 : Afrique du Sud - Les deux républiques boers totalisent 45 000 habitants contre près de 200 000 Blancs dans la colonie du Cap.
Trois ans plus tôt, dans un territoire semi-indépendant, le Griqualand-Ouest, situé à la frontière de la colonie du Cap, de l'état-libre et du Transvaal, des diamants avaient été découverts. À la suite d'un arbitrage international, rendu par le lieutenant-gouverneur du Natal, le territoire est attribué en 1871 à Nicolaas Waterboer, chef des Griquas, lequel demande la protection britannique. Tout le gite diamantifère est alors annexé à la colonie du Cap, provoquant la fureur des républiques boers. La proposition faite par le ministre britannique des colonies, Lord Carnavon, de doter l'Afrique du Sud d'une structure fédérale sur le modèle canadien ne pouvait qu'échouer, après son rejet à la fois par les républiques boers et par les habitants des colonies. Quant au gîte diamantifère, il donna naissance à la ville de Kimberley, qui devient très rapidement la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique du Sud. De nombreux migrants noirs, venus des pays sothos et tswana, abandonnent la paysannerie pour s'embaucher volontairement comme mineurs sur les champs de diamants de la région. Certains d'entre eux parviennent notamment à acheter leurs propres concessions et en 1875, plus d'un cinquième des propriétaires de mine sont noirs ou métis.
L'annexion du Griqualand par la colonie du Cap accélère l'émergence d'un nationalisme afrikaans, englobant à la fois les Boers des républiques et ceux des colonies britanniques. Au Cap, un mouvement de revendication culturel, Die Genootskap van Regte Afrikaners (l'« Association des vrais Afrikaners ») se constitue avec pour objectif de faire reconnaitre l'afrikaans, au côté de l'anglais, comme langue officielle de la colonie et d'en faire un véritable outil de communication écrite.
an 1870 : Congo Kinshasa (Zaïre) - Les premières grandes explorations européennes eurent lieu dans les années 1870 derrière le britannique Henry Morton Stanley. En 1881, il fonde la ville de Léopoldville en l'honneur du roi des Belges, pour le compte duquel il travaillait. Le congrès de Berlin créa l'État Indépendant du Congo déclaré propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II.
Les agents de l'État indépendant du Congo (majoritairement des Belges mais on y retrouve aussi des Scandinaves, des Italiens et des ressortissants de la plupart des pays européens) matèrent avec brutalité les nombreuses résistances et brisèrent les États des princes-marchands, sous prétexte de lutte contre l'esclavage.
La traite des noirs sur la côte occidentale, du XVe au XIXe siècle, s’étend jusqu’à l’intérieur du continent et correspond, avec le commerce de l’ivoire, à l’essor économique ou au déclin des différents royaumes. Sur la côte occidentale, elle prend fin au milieu du XIXe siècle. Par contre, à cette époque, à l’est du pays, aujourd’hui Ituri et Kivu, les Arabo-Swahili, venus de Zanzibar, ne se contentent pas d'acheter les esclaves aux indigènes, ils fondent des sultanats. À partir de 1870 ces sultans étendent leur emprise jusqu'au bassin du Congo, et y fondent des villes telles Nyangwe ou Kasongo. En 1890, la zone sous influence arabe couvrait plus d'un tiers du territoire du Congo.
an 1870 : Ghana - Les Hollandais demeurèrent jusque dans les années 1870, lorsqu'ils cédèrent leurs possessions aux Anglais. Ces derniers se lancèrent alors dans la colonisation de territoires situés à l'intérieur des terres, et notamment de l'Ashanti (Asante).
La présence de marchands puis de soldats et de missionnaires européens sur la Côte de l'Or ne doit pas masquer l'histoire complexe des entités politiques africaines, dont ils n'étaient que les hôtes. Du XVIe au XIXe siècle, de nombreuses entités se développent, négocient, s'allient et s'affrontent pour dominer les échanges et assurer leur domination politique. Cette histoire est marquée par une grande diversité et inventivité de constructions sociopolitiques. Le commerce de l'or, puis des esclaves, qui le dépasse en volume à partir du tournant du XVIIIe siècle, ont fait l'objet de nombreuses monographies, dont certaines en français.
Le Ghana fut une colonie britannique sous le nom de Gold Coast (Côte-de-l'Or), avec un vicariat apostolique du même nom confié aux missionnaires de Lyon. Après la Première Guerre mondiale, la Gold Coast s'agrandit d'une partie du Togoland allemand. L'autre partie fut confiée à la France déjà présente au Dahomey (Bénin), et formera le Togo contemporain.
an 1870 : Leshoto - A sa mort, le 11 mars 1870, Moshoeshoe laissait à son fils Letsie Ier un royaume indépendant dont les sujets sont Britanniques. De plus, un interdit, décidé par Moshoeshoe en 1859, bloquait les possibilités d'acquisition de terre par les Blancs, ce qui limitait cette forme d'expansion territoriale des afrikaners.
an 1870 : Mayotte - Période coloniale
La souveraineté française sur Mayotte advient à un moment assez singulier, la France de Louis-Philippe n'ayant pas de politique coloniale en dehors de l'Algérie (conquise par son prédécesseur). Cet événement est également indépendant du partage de l'Afrique issu de la conférence de Berlin qui n'aura lieu qu'après 1885. Ainsi, c'est sans réel projet que le gouvernement français accueille ce nouveau territoire, qui va peiner à se trouver une vocation dans le réseau économique de l'empire.
Mayotte constitue surtout une île vidée de ses habitants par des décennies de pillages, ainsi que par l'exode des anciens maîtres et d'une partie de leurs esclaves : la plupart des villes sont à l'abandon, et la nature a regagné ses droits sur les anciennes zones agricoles. L'administration française tente donc de repeupler l'île, en rappelant tout d'abord les Mahorais réfugiés dans la région (Comores, Madagascar...), en proposant aux anciens maîtres exilés de revenir en échange d'un dédommagement, puis en invitant des familles anjouanaises fortunées à venir s'implanter. La France lance quelques premiers grands travaux, comme la réalisation en 1848 du Boulevard des Crabes reliant le rocher de Dzaoudzi à Pamandzi et au reste de Petite-Terre. Jusque dans les années 1870, la présence française est essentiellement cantonnée à Petite-Terre et même quasiment au rocher de Dzaoudzi, qui constitue un fort naturel, un point d'observation et une rade utile, ainsi qu'un site de villégiature réputé plus salubre que Grande-Terre, où sévit le paludisme. Obéissant au dernier vœu du sultan, les Français installent une première école à Dzaoudzi, le 27 juillet 1851. Le gouvernement de Mayotte qui y siège, appuyé par la flotte française, administre plus de 24 300 habitants d'îles, réparties sur trois secteurs assez éloignés : Helleville ou Nossi Bé, Sainte-Marie et Mayotte qui comptent respectivement 15 000, 5 900 et 3 400 habitants recensés.
an 1870-1880 : Namibie - Dorslandtrekkers
En 1870, la population de descendance européenne au nord du fleuve Orange et au sud du fleuve Kunene comporte cent trente-sept hommes et une dizaine de femmes et enfants.
Entre 1874 et 1892, quatre convois en provenance de la république sud-africaine du Transvaal amènent des immigrants Boers en quête de terre promise. Ils sont appelés les Dorslandtrekkers (« ceux qui voyagent au pays de la soif ») après leur traversée du désert du Kalahari. Leur épopée les conduit en pays héréros, au pied des montagnes du Waterberg, puis au bord de l'Okavango.
Décimés par les fièvres et la soif, les premiers de ces pionniers se joignent à William Worthington Jordaan, chasseur d'éléphants et journaliste métis du Cap, qui conta leur épopée. Sous sa conduite, ces Boers longent le lac salé d'Etosha, contournent le pays Ovambo et atteignent l'Angola en 1880 où cinquante-cinq familles s'établissent dans la région fertile de Sa da Bandeira (ils obtinrent par la suite la nationalité portugaise). Si les Dorslandtrekkers ne jouent qu'un rôle mineur dans la colonisation du territoire, ils introduisent au nord du fleuve Swakop la langue afrikaans appelée à devenir la lingua franca de Namibie.
En 1878, le Royaume-Uni annexe Walvis Bay à la colonie du Cap. Walvis Bay est pourtant située en plein cœur du Namib mais c'est le seul site en eau profonde où un port peut être construit.
Mais alors que décline la puissance des Oorlams afrikaners, Hendrik Witbooi, le meneur hottentot des Oorlams Namas se lance à la conquête du nord et se retrouve en prise avec les Héréros. Il parvient à devenir le chef du peuple nama tout entier après la défaite de Jan Jonker en août 1880 et la destruction de Winterkoek (les Oorlams Afrikaners n'ont plus d'existence politique après la mort de Jan Jonker en 1889).
an 1870 : Réunion (Ile de la) - départ volontaire de créoles pour la guerre contre la Prusse.
La traversée en bateau depuis l'Europe ne demande plus qu'une cinquantaine de jours, contre le double en 1840 grâce au passage par le canal de Suez. L'île compte 193 360 habitants.
an 1870 - 1873 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Le déclin du sultanat et les conditions d’une colonisation 1856-1886
À la mort de Majid en 1870, son frère cadet Bargash devient le nouveau sultan de Zanzibar. Les pouvoirs du sultan sont de plus en plus tributaires du bon vouloir du Royaume-Uni, et en 1873, sous la pression, Bargash signe enfin le traité mettant fin à la traite des noirs sur ses terres, même si la possession d’un esclave est toujours autorisée.
an 1870 - 1880 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - 1870-1880, les territoires shona et ndébélé sont explorés par des Européens dont Frederick Courtney Selous et Thomas Baines.
an 1871-1890 : Magreb Algérie - Ce n’est qu’après un ultime soulèvement, en 1871, lors de la révolte de Mokrani, menée depuis la Kabylie des Bibans, et qui réunira plus de 250 tribus à travers l'Algérie, que la mission de « pacification » s’achève. Conjugué à la famine de 1866-1868 et à l'épidémie de choléra, ce sont près d'un million de civils qui vont perdre la vie selon le démographe R. Ricoux, la perte démographique se concentrant en particulier sur les six dernières années de la conquête.
Il s'ensuit une grande guerre entre l'Armée française, les troupes du Cheikh Bouamama et la tribu des Ouled Sidi Cheikh.
L'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne après la guerre de 1870 entraîne un exode de population vers l'Algérie. La loi du 21 juin 1871 attribue 100 000 hectares de terres en Algérie aux immigrants d'Alsace-Lorraine. Les biens des insurgés ayant échappé à la destruction sont confisqués selon les mesures préconisées par le général de Lacroix en décembre 1871 : plus de 500 000 hectares sont confisqués après la révolte de 1871 et attribués aux réfugiés. Le 26 juillet 1873, est promulguée la loi Warnier visant à franciser les terres algériennes et à délivrer aux indigènes des titres de propriété. La loi Warnier donne lieu à divers abus et une nouvelle loi la complétera en 1887. Son application sera suspendue en 1890.
Le nombre des colons passe de 245 000 en 1872 à plus de 750 000 en 1914. De leur côté, les indigènes voient leur nombre passer de 2 000 000 à 5 000 000 grâce, en partie, à l'action sanitaire de la colonisation. Le Code de l'indigénat est adopté le 28 juin 1881. Il distingue deux catégories de ressortissants français en Algérie : les citoyens et les sujets. Les sujets français, soumis au Code de l'indigénat, sont privés de la majeure partie de leurs libertés et de leurs droits politiques ; ils ne conservent au plan civil que leur statut personnel, d'origine religieuse ou coutumière.
Dans le sud, la prise de Laghouat et de Touggourt, la soumission des Beni-M'zab du Mzab (1852) et celle du Souf, reculent les limites de l'Algérie jusqu'au grand désert, territoire autonome, non soumis aux Ottomans, et jusque-là contrôlé par une confédération de tribus nomades touarègues, les Kel Ahaggar. À la suite de la bataille de Tit, le lieutenant Guillo Lohan reçoit la soumission à la France des Kel Ahaggar en novembre 1902, dans le Hoggar.
an 1871 : Guinée équatoriale - Les traites négrières sont abolies en 1871, mais le trafic illégal d’esclaves menés par certaines riches familles se poursuivit au-delà, avant d’être remplacé d’abord par le commerce de brandy, d’huile de palme, de bois précieux et de textiles entre Barcelone et la colonie.
an 1871-1884 : Leshoto - En 1871, le Basutoland fut placé par les Britanniques sous le contrôle de la colonie du Cap, contre l'assentiment des Sothos lesquels, en 1880, refusant de céder leurs armes à la colonie du Cap, participèrent à la guerre des armes à feu. La rébellion se solda par un accord général garantissant aux Sothos qu'aucun colon blanc ne viendrait acquérir des terres dans le royaume et par la reprise du contrôle direct du territoire par la Grande-Bretagne en 1884.
an 1872-1896 : Éthiopie - Kassa Mercha arrive au pouvoir en janvier 1872 sous le nom de Yohannes IV. Moins centralisateur que Téwodros II, il assure néanmoins la suprématie du negusse negest et fait progresser la construction nationale.
Yohannes IV arrive au pouvoir dans un contexte de grande instabilité à la suite de la mort de Téwodros II. L'ensemble de son règne est marqué par sa volonté de défendre l'empire des multiples agressions extérieures, à une époque où les puissances coloniales s'emparent du reste du continent africain et menacent l'Empire éthiopien. L'ouverture du canal de Suez rendant le contrôle de la région d'une importance stratégique.
En 1872, le khédive d'Égypte installe comme gouverneur à Massaoua, un aventurier suisse nommé Werner Münzinger, occupe rapidement Asmara, Kérén et le nord de l'Éthiopie, qu'il proclame province de l'Égypte.
Durant l'année 1875, l'Égypte déclenche la guerre égypto-éthiopienne et lance trois campagnes d'envergure contre l'Empire éthiopien. En septembre, l'ex-colonel danois Ahrendrup accompagné de 4 000 soldats égyptiens lance une offensive au nord d'Adoua : l'opération est un carnage pour l'armée égyptienne. En octobre, Raouf Pacha s'attaque au Harar et s'y installe, il en est chassé en 1884 grâce aux Anglais remettant le pouvoir à l'émir Abdoullahi. En décembre, le suisse Münzinger et ses troupes sont défaits par les Afars dans le Haoussa.
En mars 1876, a lieu « l'un des combats les plus importants pour la sauvegarde de l'indépendance éthiopienne » : du 7 au 9 mars 1876, les troupes éthiopiennes infligent deux défaites consécutives aux troupes égyptiennes qui comptent 16 000 hommes, près de Gura.
En 1878, cherchant à mettre fin aux ambitions de son rival le plus puissant, Menelik II, alors Négus du Choa, Yohannes IV se dirige vers le Choa. Le conflit armé est évité et le traité de Fitché est signé le 20 mars 1878, où Menelik II renonce au titre de "Negusse Negest".
Sur les bords de la mer Rouge, le port d'Assab est acheté par une compagnie italienne à un sultan local, en 1870. Après avoir acquis de plus en plus de terres entre 1879 et 1880, l'ensemble finit par être acheté par le gouvernement italien en 1882. La même année, le comte Pietro Antonelli est envoyé au Choa de façon à améliorer les prospections de la colonie en concluant de traités avec Menelik, alors ras de la province et le sultan d'Awsa. Le 5 février 1882, les Italiens débarquent à Massaoua, en Érythrée, et bloquent la côte. Les Britanniques occupent Zeïla et Berbera. La France s'installe à Djibouti et à Tadjourah. L'année suivante, l'Éthiopie conquiert l'Arsi et le Wellega.
En janvier 1887, le ras Alula Engeda, chef de l'Asmara, défait les Italiens à Dogali ; le ras Tekle Haymanot Tessemma remporte la bataille contre les derviches soudanais et incendie Matamma. Six mois plus tard, une armée soudanaise de 60 000 hommes enfonce les troupes de Tekle Haymanot Tessemma au Godjam et envahit Gondar qu'elle saccage et brûle en massacrant ses habitants. Menelik est victorieux à la bataille de Chelenqo le 6 janvier 1887. Ses forces remportent la victoire contre 11 000 soldats et s'emparent de quelques canons Krupp, annexent le Harrar et l'Iloubabor. Menelik y installe son cousin le ras Mekonnen Welde Mikaél.
En 1888, Le négus Yohannes IV lance une grande offensive contre les mahdistes. Les Éthiopiens remportent la bataille de Metemma contre une armée de 70 000 hommes le 9 mars 1889.
Frappé d'une balle au cours de la bataille, Yohannes IV meurt le lendemain de la victoire.
Après l'ouverture du canal de Suez, les agressions étrangères le détournent des questions de politique interne. De 1875 à 1889, il défend les frontières éthiopiennes contre trois pays. Tout d'abord les Égyptiens, auxquels il inflige une lourde défaite en 1875-1876. Ensuite, les Italiens, installés à Metsewa depuis 1885, sont vaincus à la bataille de Dogali en 1887 par le ras Alula Engeda. Enfin, en partie à la suite d'un accord avec la Grande-Bretagne, Yohannes affronte les mahdistes soudanais. Il meurt de ses blessures le 10 mars 1889, au lendemain de la bataille de Metemma.
La même année, le négus du Choa est proclamé negusse negest sous le nom de Menelik II. Le troisième grand souverain de cette fin de siècle poursuit le processus d'expansion, d'unification et de modernisation du pays, tout en affrontant les menaces européennes. Il signe avec l'Italie le traité de Wouchalé, censé assurer la paix et l'amitié entre les deux pays. Cependant, les Éthiopiens refusent de reconnaître l'interprétation du texte par les Italiens (qui l'utilisent pour notifier un protectorat selon la procédure définie à Berlin) et le dénoncent en 1893. Ce conflit débouche sur une guerre en 1895, qui s'achève par la bataille d'Adoua au cours de laquelle plus de 100 000 Éthiopiens écrasent les forces italiennes en mars 1896. Ce succès garantit à l'Empire son indépendance et la reconnaissance internationale de la souveraineté éthiopienne, même si certains auteurs évoquent alors une « semi-souveraineté ».
L'Éthiopie connaît une famine particulièrement meurtrière entre 1889 et 1891, tuant environ un tiers de ses habitants.
an 1873-1893 : Kenya - Au début du siècle, sur la côte, le sultanat d'Oman, avec l'accord des Britanniques, fait la conquête des territoires Zenj situés au nord du cap Delgado, pour y établir des comptoirs commerciaux, fondés entre autres sur la traite des esclaves noirs, fait prisonniers à l'intérieur des terres et livrés aux commerçants arabes.
À partir de 1873, les Britanniques abolissent l'esclavage, et annexent peu à peu tout le Kenya, le transformant en colonie, officialisée en 1885. Ils construisent à partir de 1896 la ligne ferroviaire partant de Mombasa sur la côte vers le Lac Victoria et attirent des colons sur les meilleures terres.
an 1873-1894 : Maroc - Le règne de Hassan Ier (1873-1894) correspond à la volonté du sultan de concilier les exigences d'une modernisation de l'État aux complexités sociales et politiques du Maroc. Ce règne s'inscrit de plus dans la perspective des rivalités impérialistes européennes qui deviennent plus pressantes encore à la suite de la Conférence de Madrid de 1880, qui préfigure le futur partage de l'Empire chérifien sur l'échiquier international. À l'image de la Turquie, de l'Iran ou de la Chine de cette époque, le Maroc devient un « homme malade » selon l'expression consacrée par les milieux colonialistes du XIXe siècle. Par le biais des concessions économiques et du système des emprunts bancaires, chacune des puissances européennes intéressées, notamment la France, l'Espagne, le Royaume-Uni puis l'Allemagne, espère préparer la voie à une conquête totale du pays. L'habileté du makhzen est de savoir tenir à distance les convoitises conjuguées de l'impérialisme européen et de jouer des rivalités entre les puissances. Mais le décès de Hassan Ier, survenu au cours d'une expédition dans le Tadla en 1894, laisse le pouvoir au très jeune Abd-al-Aziz, fils d'une favorite circassienne du harem impérial du nom de Reqiya et originaire de Constantinople, qui par ses intrigues et son influence favorise l'ascension du grand vizir Bahmad ben Moussa.
an 1874-1877 : Congo Kinshasa - Exploration du fleuve Congo par Henry Morton Stanley
an 1874 : Ghana - Le royaume Ashanti, inquiet de perdre le bénéfice du commerce des esclaves lance alors une campagne contre l'ethnie vivant sur la côte, les Fanti. Cette campagne est suivie de plusieurs autres, mais en 1874, les Fanti trouvent dans l'Angleterre, qui a racheté la colonie danoise de ChristianBorg dès 1850, un allié providentiel qui défait le roi Ashanti.
Les Britanniques achètent les comptoirs hollandais et fondent une nouvelle colonie, le Togo britannique (Togoland) en 1874. Au cours du XIXe siècle, les Britanniques mènent de nombreuses guerres contre les Ashanti, armés de mousquets et regroupés dans une capitale de 100 000 habitants environ, Kumasi, découverte en 1817 par le premier explorateur anglais Thomas Bodwich. Les territoires sont confiés aux missionnaires de la Société des missions africaines.
an 1874-1879 : Soudan - En 1874, le prince marchand égyptien Zubeir Pacha s’empare du Darfour pour le compte du khédive. Il envisage de se passer des intermédiaires égyptiens et d’utiliser une liaison directe avec Benghazi par El Giof. Son influence inquiète les Égyptiens, qui l’emprisonnent lors de sa visite au Caire. Son fils, Soliman bey, réunit une armée pour le libérer, mais est battu et tué par les troupes égyptiennes en 1879.
an 1875-1879 : Congo Brazzaville - La pénétration française débute vers 1875 avec Pierre Savorgnan de Brazza ; il atteint le fleuve Congo en 1879 en remontant le cours de l'Ogoué, jusqu'à l'embouchure de l'actuelle île Mbamou.
an 1875-1885 : Gabon - Durant la seconde moitié du siècle, les territoires de l'intérieur sont explorés et des accords sont signés avec les peuples du Sud-Est. Entre 1875 et 1885, Pierre Savorgnan de Brazza explore l'Ogoué et atteint le fleuve Congo.
an 1875-1884 : Nigéria - Période britannique (1800-1960)
En 1875, le Britannique George Goldie reprend une petite maison de commerce établie sur le fleuve Niger à partir de laquelle il fonde un empire commercial baptisée United African Company en 1879. Il entreprend une guerre commerciale agressive envers ses concurrents qu'il élimine les uns après les autres. En novembre 1884, il est le maître du Bas-Niger.
an 1875 : Somalie - À partir de 1875, la Grande-Bretagne, la France et l’Italie revendiquent le territoire de la Somalie. La Grande-Bretagne s'est emparé déjà de la cité portuaire d’Aden au Yémen, et désire mettre la main sur Berbera, située juste en face. La mer Rouge est alors une voie cruciale vers les colonies britanniques en Inde.
La France s’intéresse aux gisements de charbon de l’intérieur des terres, et veut casser les ambitions britanniques de construire un chemin de fer longeant la côte est de l’Afrique du nord au sud. L’Italie, tout juste unifiée et sans expérience coloniale, cherche surtout à obtenir des territoires en Afrique sans devoir affronter de puissance européenne. Elle s’approprie le sud de la Somalie, ce qui va devenir la plus grande revendication européenne dans le pays, mais aussi la moins intéressante sur le plan stratégique.
an 1876 : Afrique du Sud - A partir de 1876, les Boers du Transvaal sont sérieusement accrochés par leurs voisins africains. Dans le Transvaal de l'ouest, où ils cherchent à s'implanter, les Boers subissent de sérieux revers face aux Pedis du roi Sekhukune Ier, bien armés et retranchés dans les montagnes. Au sud, le militarisme zoulou refait surface. Le roi Cetshwayo, qui a succédé à son frère Mpande, l'ancien allié des Boers, est décidé à expulser ces derniers de la région du fleuve Tugela.
En 1876, le mouvement publie Die Afrikaanse Patriot, la première revue en afrikaans, afin d'éveiller la conscience nationale des utilisateurs de la langue afrikaans et de les libérer de leur complexe d'infériorité culturelle face aux Anglais. L'année suivante, Stephanus Jacobus du Toit publie Die Geskiedenis van ons Land in die Taal van ons Volk, le premier livre d'histoire des Afrikaners, écrit en afrikaans, dans une version empreinte de mysticisme.
an 1876 : Congo Kinshasa - fondation de l’Association internationale africaine (AIA) par Léopold II de Belgique.
an 1876 : Sao Tomé et Principe - L'esclavage fut aboli en 1876.
an 1877 : Afrique du Sud - Les Britanniques annexent le Transvaal provoquant une première guerre avec les Boers.
Prétextant de l'incapacité du gouvernement de la république sud-africaine à réduire la rébellion Pedi, les Britanniques annexent le Transvaal en 1877. Sur le moment, les Boers n'opposent aucune résistance, leur État étant politiquement instable et au bord de la banqueroute, mais, en décembre 1880, débute la première guerre anglo-boer, menée par un triumvirat composé de l'ancien vice-président du Transvaal, Paul Kruger, de Piet Joubert et de Marthinus Wessel Pretorius, sur fond de nationalisme boer et d'hostilité à l'impérialisme britannique. Durant cette guerre, les Boers portent des habits kaki de la même teinte que la terre, tandis que les soldats britanniques portent un uniforme rouge vif, cible bien visible pour les francs-tireurs. À la suite de plusieurs victoires boers et de la défaite britannique retentissante lors de la bataille de Majuba, le gouvernement britannique décide de se retirer d'un conflit à l'issue incertaine. Il signe la convention de Pretoria, qui permet au Transvaal de recouvrer l'indépendance et de connaitre un début de développement économique sous la présidence du vénérable et légendaire Paul Kruger. Ce dernier peut compter, dans un premier temps, sur le soutien au Cap d'un puissant réseau politique, l'Afrikaner Bond, formé par l'association des vrais Afrikaners et celles des fermiers afrikaans, qui détient la majorité parlementaire à l'assemblée de la colonie.
an 1877 : Angola - Les territoires de l'Angola, sont une colonie portugaise depuis la fin du XVe siècle, mais ce siècle va connaître, après le congrès de Berlin, une forte consolidation de la présence portugaise.
an 1877-1881 : Eswatini (Swaziland) - En 1877, les Dlamini demandèrent la protection du Royaume-Uni et en 1881, amputé de sa frange orientale, le Swaziland devint un protectorat britannique, garantissant l'indépendance de la nation.
an 1877-1879 : Ouganda - Il faut attendre l’arrivée des missionnaires protestants en 1877, suivis des missionnaires catholiques en 1879, pour que des Européens s’installent dans le pays. L’implantation des deux missions marque le début d’une campagne d’évangélisation intense, au Buganda tout d’abord puis dans les royaumes dépendants. Cependant, les missionnaires chrétiens se heurtent rapidement à la présence plus ancienne des commerçants arabes et swahili musulmans. Le Kabaka du Buganda, Muteesa Ier, ne se convertit jamais réellement à l’une de ces trois religions.
an 1878-1915 : Guinée-Bissau - Des comptoirs européens existaient sur la côte, en particulier portugais. En 1879 le territoire devient colonie portugaise, mais subsistent un différend frontalier avec la France, réglé en 1886, et une certaine résistance des populations jusqu'en 1915.
an 1878 : Malawi - En 1878, des commerçants majoritairement originaires de Glasgow fondent la Compagnie des lacs africains pour ravitailler les missionnaires en biens et en services. Elle surclasse alors les quelques comptoirs portugais. D’autres missionnaires suivent encore ainsi que des commerçants, des chasseurs et des planteurs.
an 1878 : Réunion (Ile de la) - Travaux pour la construction du port et du chemin de fer.
an 1878 à 1956 : Tunisie - Le protectorat français sur la Tunisie
Au congrès de Berlin en 1878, la France obtient le soutien du Royaume-Uni et de l'Allemagne pour intervenir en Tunisie. Il s'agit de contrer les visées italiennes sur le pays et de priver de refuge les rebelles de l'Est-algérien. L'invasion de la Tunisie en avril 1881 et le bombardement de Tunis révolté en juillet 1881, oblige la Tunisie à accepter le protectorat français (Traité du Bardo en 1881 et convention de La Marsa en 1883).
En Tunisie, la France chargée de réorganiser l'administration locale y substitue, à partir de 1910, l'administration directe. Le mouvement nationaliste réclamant l'autonomie ou l'indépendance s'organise dès 1907 avec le Mouvement des Jeunes Tunisiens, se renforce en 1920 par la création du parti Destour. Ce dernier se divise en 1934 avec la scission du Néo-Destour dirigé par Habib Bourguiba. Ce dernier est arrêté plusieurs fois (1934, 1938 et encore en 1952).
En 1940, malgré les ambitions de l'Italie fasciste, la Tunisie reste sous le contrôle du gouvernement de Vichy. Après le débarquement des Anglo-Américains en Afrique du Nord (novembre 1942), la Tunisie est occupée par les Allemands qui en sont chassés en mai 1943. La Tunisie est alors dirigée par les différents gouvernements du Général de Gaulle, qui en mars 1944, maintiennent le protectorat sans céder aux revendications du Néo-Destour. La lutte pour l'indépendance reprend, animée par le Néo-Destour et le syndicat UGTT. Le terrorisme progressant, en 1954 la France promet l'autonomie, puis en 1955, elle permet aux Tunisiens de s'occuper de leurs affaires intérieures. En mars 1956, la Tunisie retrouve son indépendance.
an 1879 : Afrique du Sud - En 1879, durant la Guerre anglo-zouloue, les Britanniques subissent une défaite historique lors de la bataille d'Isandhlwana avant de finalement s'imposer au Zoulouland.
En janvier 1879, l'armée britannique subit une défaite mémorable à Isandhlwana contre les Zoulous du chef Cetshwayo. C'est lors d'une escarmouche avec les Zoulous que le jeune prince impérial, fils de Napoléon III et de l'Impératrice Eugénie, trouve la mort le 1er juin 1879. La guerre anglo-zouloue dure un peu plus de six mois et se termine par la victoire de l'armée britannique sous les ordres du général Garnet Wolseley. Le 4 juillet 1879, Ulundi, la capitale zouloue, est investie par l'armée et Cetshwayo fait prisonnier. Le grand royaume Zoulou est démantelé et divisé en treize petits royaumes. Débarrassé de toute menace sérieuse de la part des Zoulous mais aussi des Pedis, vaincus par Wolseley, le gouvernement colonial britannique peut reporter son attention sur les républiques boers, véritables épines dorées au milieu de leur Empire.
an 1879 : Magreb Algérie - Après 1879, le territoire connaît une forte immigration de populations européennes (français notamment alsaciens et espagnols). Ils seront appelés « pieds noirs »
an 1879 : Afrique Cap Vert - À partir de 1879, une grave crise économique provoque une très importante émigration et l'archipel se dépeuple.
an 1879 : Congo Brazzaville - À partir de 1879 le Français Pierre Savorgnan de Brazza explore le territoire et signe des traités plaçant le pays sous protectorat français. Le congrès de Berlin en fixera les frontières. La colonisation est marquée par l'implantation de compagnies concessionnaires qui exploite les fabuleuses richesses naturelles grâce au travail forcé qui va tuer plus de 300 000 personnes en vingt ans.
an 1879 : Congo Kinshasa - retour de Stanley au Congo pour fonder une chaîne de stations de l’AIA/AIC
an 1879 : Guinée-Bissau - La région devient une colonie portugaise en 1879
an 1880 : Afrique du Sud - le Transvaal se révèle immensément riches en or et diamants ; leurs découvertes à partir des années 1880 sont perçues par les Boers, fermiers avant tout, comme une véritable catastrophe. Des quatre coins du monde, des milliers d'aventuriers affluent vers le Transvaal, apportant avec eux un mode de vie à l’opposé de l'austérité et du puritanisme boer.
an 1880 : Afrique BURUNDI - Dans les années 1880 et 1890, le Burundi est colonisé par les Allemands et intégré avec le Rwanda à l'Afrique orientale allemande. Ce pays fait aussi partie de ce qu'on appelle l'Afrique des grands lacs.
an 1880-1883 : Congo Brazzaville - En 1880, il fait signer un traité de souveraineté au Makoko, le roi des Tékés à Mbé (100 km au nord de Brazzaville), et fonde un poste au village de Mfoa, (en référence à une petite rivière) à Nkuna qui deviendra Brazzaville en 1911. Dans le même temps, le lieutenant de vaisseau Cordier explore la région du Kouilou et du Niari, et fait signer au roi Maloango un traité qui reconnaît la souveraineté de la France sur le royaume de Loango, et fonde à son tour en 1883 Pointe-Noire, dont la gare ferroviaire CFCO est inspirée de celle alors existante à Trouville-Deauville en France.
an 1880-1884 : Guinée - Le village de Kiniéran est entouré de remparts de fortification, vestiges d’avant la colonisation, partiellement détruits par Samory Touré, grand guerrier mandingue de l'Afrique de l'Ouest. Né dans une famille de commerçants malinkés, Samory Touré s’appuya d’abord sur des populations encore largement animistes pour combattre l’influence des chefs musulmans. Puis, changeant de stratégie, voulant islamiser de force les populations animistes dans les années 1880, il provoqua leur révolte et les combattit durement. Il assit son autorité sur le Tôron, s’installa à Bissandougou et prit le titre de Faama faama (en) (roi). Après avoir imposé sa loi et sa religion, Samory s’empara de Kankan, captura les chefs Séré (en) Béréma et Saghadjigi, enrôla les vaincus dans son armée et se présenta en défenseur de l’islam. Il prit le titre d’Almany en 1884 et s’opposa pendant dix-sept longues années à la pénétration des troupes françaises avant d’être arrêté et exilé au Gabon.
an 1880-1898 : Mali - En 1880, les Français promettent à Amadou Tall de ne pas toucher à ses possessions. Amadou croit en ces promesses et refuse de s'allier avec Samory Touré. Les Français conquièrent Ségou en 1890 et Amadou doit fuir à Sokoto, au nord du Nigeria.
La pénétration coloniale française, menée par Louis Faidherbe puis Joseph Gallieni, se fait à partir du Sénégal en allant vers l’est : les français conquièrent progressivement tout le territoire de ce qui allait devenir le Soudan français puis le Mali après l’indépendance : Sabouciré en 1878, Kita en 1881, Bamako en 1883, Ségou en 1890, Nioro en 1891, Tombouctou en 1894, Sikasso en 1898, Gao en 1899. Cette conquête d’un territoire divisé en plusieurs royaumes s’est opérée par la force et par la diplomatie, les Français tentant de jouer les uns contre les autres, en faisant signer des traités, pas toujours respectés.
En 1863, Louis Faidherbe évoque le projet de pénétration coloniale en ces termes : « Vous voulez arriver au Soudan par l'Algérie ? Vous n'y réussirez pas. Vous vous perdrez dans les sables du Sahara et vous ne les traverserez pas. Mais si, profitant des voies naturelles qui nous sont offertes, vous vous servez du fleuve Sénégal pour gagner la route du Soudan et les rives du Niger, vous y créerez une colonie française qui comptera parmi les plus belles du monde ». Il envoie cette même année une mission de reconnaissance, la mission Quintin-Mage, puis une deuxième mission en 1879-1880, la mission Gallieni-Vallières auprès du roi de Ségou, Amadou Tall.
Le royaume khassonké de Logo, dont la capitale Sabouciré (actuellement commune de Logo) est située sur la rive gauche du fleuve Sénégal à 25 km. de Kayes est dirigé par le roi Niamodi Sissoko. Celui-ci refuse la pénétration coloniale française. Le 22 septembre 1878, les troupes françaises, conduites par le lieutenant-colonel Reybaud, fortes de 585 hommes, équipées de 4 canons et 80 chevaux affrontent pendant plusieurs heures les troupes du roi Niamodi Sissoko. Les Français dominent militairement et gagnent la bataille qui fait 13 morts et 51 blessés chez les Français et 150 morts chez les khassonkés, dont le roi Niamodi Sissoko. Cette bataille marque le premier acte de résistance contre les Français.
En 1880, Joseph Gallieni découvre Bamako qui « ne renferme plus actuellement qu'un millier d'habitants » et que « rien ne distingue des autres villages de la région »
Après son installation à Kita le 7 février 1881, Borgnis-Debordes se lance dès le 16 février 1881 vers Bamako. Le 26 février 1881, l'armée française bat en retraite devant l'armée de Samory Touré à Kéniéra. Le 1er février 1883, Gustave Borgnis-Desbordes, entre dans Bamako et commence la construction du fort le 5 février.
Samory Touré fonde un Empire, le Ouassoulou, qui s'étend sur une grande partie du pays malinké, correspondant à l'actuel Mali et la Guinée et atteignant les zones forestières de Sierra Leone et du Liberia.
L’armée était composée de Sofas bien entraînés et équipés de fusils, achetés avec les revenus tirés de la vente d'esclaves. Samory Touré résiste longtemps contre les troupes coloniales françaises, dirigées successivement par Gustave Borgnis-Desbordes, Joseph Gallieni, Louis Archinard. Samory Touré est arrêté par les Français dirigés par le capitaine Gouraud à Guélemou (Côte d'Ivoire). Il est déporté au Gabon où il meurt en 1900.
Le roi Tiéba Traoré du Kénédougou était allié des Français. Son frère et successeur, Babemba Traoré s'oppose aux français pour résister à leur visée expansionniste. Sikasso, capitale du royaume, est prise le 1er mai 1898 malgré son tata, muraille défensive. Babemba, qui refuse de se rendre, se donne la mort.
an 1880-1904 : Maroc - Les avantages accordés à la France et au Royaume-Uni sont élargis à tous les pays européens lors de la Conférence de Madrid de 1880. Le sultan Moulay Hassan à la tête du pays durant cette période (1873 - 1894) tente de le moderniser comme son prédécesseur Mohammed IV, et joue sur les rivalités européennes (opposant notamment la France au Royaume-Uni, à l'Allemagne et à l'Espagne) pour conserver son indépendance. Mais à son décès, et encore plus à la mort du grand-vizir régent Ahmed ben Moussa (dit « Ba Ahmad ») en 1900, les manœuvres coloniales reprennent de plus belle autour du Maroc. Si l'Espagne est présente dans une partie du Sahara atlantique (Rio de Oro) à partir de 1884, la France quant à elle occupe et annexe un grand nombre de régions marocaines orientales et surtout sud-orientales au département d'Oran et aux territoires sahariens de l'Algérie française entre 1902 et 1904. C'est ainsi que Lalla Maghnia et le Sahara central touchant la frontière du Mali, le Touat, Tidikelt, la Saoura, Béchar, Jorf Torba, Abbadia, Métarfa, Hassi Regel, N'khaila, El Hamira, Kenadsa et Timimoun, passent peu à peu sous contrôle français. En effet, depuis sa conquête et sa colonisation de l'Algérie, la France entreprend de sécuriser les confins algéro-marocains et lorgne sur l'Empire chérifien qui est alors l'un des derniers États indépendants du continent africain au même titre que l'Éthiopie et le Liberia. Les commerçants et entrepreneurs français établis au Maroc se montrent très actifs et en concurrence avec les Allemands, notamment à Casablanca, un port au développement récent qui sera promis à une grande expansion au temps du protectorat.
an 1880 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Tandis que les Britanniques affirment leur autorité sur leur dominion du sultanat de Zanzibar, les Allemands investissent l’intérieur du continent et, au début des années 1880, signent des traités de bonne entente avec des chefs tribaux africains, ces derniers ne comprenant d’ailleurs pas la plupart du temps les intentions des occidentaux. La compagnie de l’Afrique orientale allemande, fondée par l’aventurier Carl Peters, qui excelle dans cet exercice d’extension de l’influence allemande, enchaîne les signatures de traités « d’amitiés éternelles ».
an 1880 - 1940 : Tchad - Colonisation
L'État du Tchad, dans ses frontières actuelles, est une création de la colonisation européenne, ses frontières résultant de négociations entre Français et Allemands dans les années 1880. La domination française ne devient effective qu'à partir de 1897 quand trois colonnes venues d'Afrique du Nord et du Congo français se rejoignent dans la région tchadienne, battent Rabah qui est tué en 1900, puis soumettent le Ouaddaï en 1911. La confrérie musulmane de la Sanousiyya, puissance montante de la périphérie saharienne, est repoussée vers le désert en 1913. Un Territoire Militaire des Pays et Protectorats du Tchad est créé en 1900. En 1920, la France obtenant le contrôle total du territoire, érige le Tchad en colonie dans le cadre de l'Afrique-Équatoriale française (AEF). La particularité de la domination française au Tchad est caractérisée par une absence de politique d'unification du territoire, au sens administratif, et une modernisation relativement lente par rapport aux autres colonies françaises. La France maintient les sultanats et crée de nouvelles chefferies pour encadrer la population dans la culture du coton qui est imposée aux populations du Sud, le travail forcé pour la construction des routes et la conscription pendant les deux guerres mondiales.
Sous l'impulsion du gouverneur Félix Éboué, le Tchad est une des premières colonies françaises à se rallier à la France libre en 1940 et forme l'embryon de l'Afrique française libre. La colonne Leclerc, partie du Tchad, traverse le désert pour combattre les troupes de l'Axe en Libye italienne.
an 1880 : Togo - Le Togo actuel n'existe pas encore. Les Britanniques et les Français, occupant respectivement la «Gold Coast» (actuellement le Ghana) et le Dahomey (actuellement le Bénin), installent des postes douaniers à leurs frontières, d'où ils tirent l'essentiel de leurs ressources, prélevées sur des produits tels le tabac et l'alcool.
an 1881-1894 : Eswatini (Swaziland) - Le protectorat du Swaziland (1881-1968) - Le royaume n'en ayant pas moins été morcelé en concessions accordées aux Européens par le roi Mbadzeni, un imbroglio juridique concernant le statut du territoire permit à la république sud-africaine du Transvaal d'obtenir l'administration du territoire en 1894.
an 1881-1902 : Eswatini (Swaziland) - Le protectorat du Swaziland (1881-1968) - À la suite de la guerre des Boers, la régente du royaume demanda de nouveau que son pays soit placé sous protectorat britannique.
La première guerre des Boers : du 16 décembre 1880 au 23 mars 1881 ;; la seconde guerre des Boers : du 11 octobre 1899 au 31 mai 1902 .
an 1881-1884 : Soudan - Le 29 juin 1881, Mohamed Ahmed ibn Abd Allah, originaire de Dongola, se proclame le Mahdi (le sauveur) et prêche contre les « Turcs ». Il dispose au début de quelques partisans et d’armes de jet, mais le succès qu’il remporte auprès des garnisons égyptiennes abandonnées au Soudan renforce ses troupes et ses armements. Il conquiert tout le pays de 1881 à 1884. Sa révolte éveille pour la première fois une conscience nationale au Soudan.
an 1882 : Afrique Côte d'Ivoire - Les Français établis depuis le début du XVIIIe siècle sur les côtes du territoire, se retrouvent dans la seconde moitié du siècle en rude compétition avec les Britanniques, établis sur la Côte de l'Or (Ghana), pour le contrôle de la région. La culture du café est introduite en 1882 par les colonisateurs.
De 1882 à 1897, les Français se lancent à la conquête de l'intérieur des terres, mais se heurtent à la résistance des forces de Samory Touré armées de fusils par le soin des Britanniques. Le conflit dévasta toute la région et ne se termina réellement qu'en 1904.
an 1882 : Égypte - l'armée britannique débarquera en Égypte pour permettre aux Britanniques de contrôler cette nouvelle voie maritime devenue hautement stratégique. Lors de la guerre des mahdistes entre 1881 et 1899, les troupes anglo-égyptiennes affrontent les Mahdistes qui se sont emparés du Soudan : leur victoire fait naître un Soudan anglo-égyptien dominé de fait par les Britanniques.
an 1882-1890 : Érythrée - Le 5 juillet 1882, le gouvernement italien prend le contrôle du port d'Assab par décret.
Trois ans plus tard, en 1885, l'Italie remplace les Anglo-Égyptiens dans le port de Massaoua puis entreprend de conquérir l'intérieur. La colonie d'Érythrée qui regroupe les deux territoires est créée le 1er janvier 1890.
an 1882 : Réunion (Ile de la) - Livraison des deux premières lignes de chemin de fer : Saint-Benoît-Saint-Denis, le 11 février, et Saint-Louis-Saint-Pierre, le 19 juin.
an 1882 : Sénégal - Le gouverneur Servatius construit le chemin de fer Dakar-Saint-Louis.
an 1883-1891 : Malawi - En conflit avec les marchands d'esclaves, les négociants en appellent à la Couronne britannique. En 1883, la Grande-Bretagne nomme le diplomate Harry Johnston consul auprès des rois et chefs d’Afrique centrale afin de signer des traités d'amitié avec les chefs locaux. Il se heurte alors à un sérieux rival, l'explorateur portugais Serpa Pinto qui essaye de convaincre Lisbonne de faire relier la colonie portugaise d'Angola à celle du Mozambique. Pinto ne parvient pas à convaincre finalement sa métropole. Muni de 10 000 livres fournies par Cecil Rhodes, Johnston négocie le ralliement des chefs locaux et en 1891, les deux puissances européennes s'accordent pour placer le Nyasaland dans la sphère d'influence britannique.
Harry Johnston est nommé haut commissaire au Nyassaland et la gestion financière du territoire est alors confiée à la British South Africa Company de Cecil Rhodes qui vient de se voir remettre par charte royale l'exploitation de la Zambézie du sud et de la Zambézie du nord (les futures Rhodésies).
Le territoire est pacifié autant par la force que par la diplomatie.
an 1883-1920 : Namibie - La colonisation allemande (1884-1920)
La conquête allemande du territoire namibien à partir de 1885 a profondément marqué le futur État, dont l'allemand était encore une des langues officielles jusqu'en 1990. Marquée par le massacre des Héréros, mais aussi un relatif développement économique (dû notamment à l'exploitation des mines dont celles de diamants), la Namibie est devenu un protectorat sud-africain à la suite de la défaite allemande de 1918 à l'issue de la Première Guerre mondiale.
La fondation de la colonie (1884-1889)
Le 10 avril 1883 un commerçant allemand du nom d'Adolf Lüderitz envoie des explorateurs en reconnaissance dans le Sud-Ouest africain. Ils débarquent dans la baie d'Angra Pequena où le chef nama Joseph Frederiks II (les Namas sont un peuple de pasteurs qui vivent en Afrique du Sud, Namibie et Botswana) leur vend la baie pour 100 livres sterling et 200 fusils. La baie est placée sous la protection de l'Allemagne dès le 24 avril 1884, suivie de tout le territoire entre le fleuve Kunene et le fleuve Orange.
En 1885, Heinrich Göring est nommé commissaire impérial du Reich au Sud-Ouest africain où il est chargé de représenter l'autorité prussienne avec l'aide de deux fonctionnaires. Il signe des traités de protection avec le chef des Héréros Samuel Maharero et avec les Basters de Rehoboth.
Après la mort de Jordaan qui avait fondé avec des familles de Dorslandtrekkers une éphémère république d’Upingtonia, les terres de la région de Grootfontein sont rachetées en 1886 par une compagnie allemande et intégrées au protectorat du Reich. La même année, la frontière entre l'Angola et le Sud-Ouest africain allemand est fixée, coupant en deux le territoire du peuple ovambo.
an 1883 : Sénégal - Fondation du Mouridisme par Cheikh Ahmadou Bamba.
an 1883 - 1890 : Togo - En 1883, le chancelier allemand Bismarck décide d'imposer un protectorat sur le Togo. L'empire allemand est bien décidé à tirer profit de l'action des missionnaires protestants de la mission de Brême pour disposer d'un empire colonial,comme la France, l'Angleterre ou le Portugal. Malgré de nombreux décès, ces missionnaires de Brême ont installé dès 1853, puis en 1857, des points d'implantation chez les Ewes Anlo, à Keta et à Anyako, puis, en 1855 et 1859, chez les Ewes Adaklou et les Ewes Ho. En 1884, l'explorateur allemand Gustav Nachtigal signe un «traité de protectorat» le 5 juillet 1884 sur la plage de Baguida, avec le chef du lac Togo, Mlapa III de Togoville, représentant l’autorité religieuse du Togo, qui donna son nom au pays. C'est en 1885, lors de la conférence de Berlin qui délimite les zones d'influence économiques européennes en Afrique, que la côte togolaise est officiellement attribuée à l'Allemagne. Le gouvernement de Berlin, dans le cadre d'un négociation bilatérale avec la France, reconnaît, par une convention du 24 décembre 1885, les droits français sur le territoire de la future Guinée française en échange de l'abandon par la France à l'Allemagne des villages de Petit-Popo et de Porto-Seguro, sur la côte des Esclaves.
Comme les autres puissances coloniales de l'époque, l'Allemagne s'empresse de faire valoir ses droits sur l'arrière-pays. Ainsi elle annexe rapidement, en à peine quelques années 85 000 km² de territoires. Les Allemands fondent le port de Lomé et mettent en place une économie de plantations, en particulier dans la région de Kpalimé, propice à la culture du cacao et du café.
L'arrivée des Allemands se heurte à une plus forte résistance de la part des Africains dans le nord du territoire. Ainsi, la révolte des Kabyé (1890) et celle des Konkomba (1897-1898) ont du être matées violemment.
an 1884 : Botswana - C'est en 1884 que cette protection temporaire des Britanniques devient à proprement parler un protectorat à la demande des Tswana. Mais le Royaume-Uni veut déplacer la capitale en dehors du Bechuanaland, à Mafeking en Afrique du Sud. De plus, son administration est confiée à la British South Africa Company, dirigée par Cecil Rhodes. À la suite de la négociation des Tswana, Londres accepte d'annuler ces décisions, mais accorde à Cecil Rhodes une bande de terre pour y construire sa ligne de chemin de fer « Le Cap - Le Caire ».
Le protectorat britannique fait entrer l'anglais dans les administrations, bien que la langue majoritaire dans le pays demeure le Tswana. Cette colonisation britannique se déroule sans heurts.
an 1884 : Cameroun - Dans l'optique de protéger leurs intérêts commerciaux, la colonisation allemande commence en 1884 avec la signature en juillet d'un traité entre les rois Bell et King Akwa et les représentants des firmes Hambourgeoises, Johanness Vogt, représentant de la firme Jantsen and Thormälen et Edward S., représentant de la firme Woermann. (cf Saïd Sélassié, mémoire de master en histoire.) Le protectorat s'étend du lac Tchad au nord aux rives de la Sangha au sud-est. La ville de Buéa au pied du mont Cameroun en devient la capitale avant que celle-ci ne soit transférée à Douala en 1908.
les Allemands établissent le 5 juillet 1884 leur protectorat du nom de Kamerun. L'Allemagne est en particulier intéressée par le potentiel agricole du Cameroun et confie à de grandes firmes le soin de l'exploiter et de l'exporter. Le chancelier Otto von Bismarck définit l'ordre des priorités comme suit : le marchand d'abord, le soldat ensuite. C'est en effet sous l'influence de l'homme d'affaires Adolph Woermann, dont la compagnie implante une maison de commerce à Douala, que Bismarck, d'abord sceptique sur l'intérêt du projet colonial, se laisse convaincre. De grandes compagnies commerciales allemandes et compagnies concessionnaires s'implantent massivement dans la colonie. Laissant les grandes compagnies imposer leur ordre, l'administration se contente de les épauler, de les protéger, et d'éliminer les rébellions indigènes.
Afin d'assurer l'essor économique du protectorat, les Allemands se lancent dans des travaux importants : construction de routes et de la première ligne de chemin de fer, démarrage des travaux du port de Douala, édification d'écoles et d'hôpitaux, création de grandes plantations (cacaoyers, bananiers, caféiers, hévéas, palmiers à huile...). Mais les populations locales sont, pour la plupart, soumises au travail forcé et aux châtiments corporels. Quant aux Baka, ils sont piégés et étudiés comme des animaux ; certains sont emmenés en Allemagne pour être montrés, en cage, dans les expositions coloniales.
an 1884 : Afrique République de Djibouti - Ce n'est qu'en 1884 qu'une prise de possession réelle a lieu, avec l'arrivée du commandant Léonce Lagarde le 1er août. Il s'agit alors, dans le cadre de l'expansion coloniale française vers Madagascar et l'Indochine, de créer une escale de ravitaillement pour les navires sur une route impériale. Cependant, Léonce Lagarde étend le Territoire d'Obock et dépendances sous souveraineté française à toute la côte nord du golfe de Tadjourah, qui est occupée en octobre-novembre 1884.
Rapidement, il étend le territoire sous souveraineté française, signant un protectorat avec le sultan de Tadjourah (où se trouve une garnison égyptienne jusqu'au 16 novembre 1884), et occupe toute la côte nord du golfe de Tadjourah. L'emprise française s'étend sur la côte sud, avec la signature d'un traité avec les « chefs somalis issas » le 26 mars 1885, formant le « protectorat d'Obock et dépendances »
an 1884 : Guinée équatoriale - L’Espagne envoie un géographe, Manuel Iradier y Bulfy, qui s’emploie à partir de 1884 à ré-annexer les territoires du Rio Muni, en passant des traités avec les chefs locaux. La conférence de Berlin de 1884-1885 sur le « partage de l'Afrique » tourne au désavantage de l’Espagne, qui ne se voit octroyer que 180 000 km2, sans compter les dépossessions dont elle fait l’objet sur le terrain de la part de la France.
an 1884-1887 : Ile Maurice - Période britannique (1810-1968) - Déclin économique
La fin du XIXe siècle marque une période difficile pour Maurice, dont les exportations reculent et qui est frappée par des épidémies et des cyclones qui ont ravagé Port-Louis. La pauvreté s’accroît et beaucoup de gens émigrent vers Madagascar, l’Australie ou l’Afrique du Sud. Le nombre d’habitants retombe à 350 000 et Madagascar assure de plus en plus le rôle de plaque tournante dans l’océan Indien.
La compagnie havraise péninsulaire ouvre une ligne commerciale vers La Réunion et l'île Maurice en 1884 (départ tous les quinze jours à partir de 1886), mais elle n'est qu'en deuxième position derrière les Messageries maritimes dont la ligne Marseille-île Maurice est directe dès 1887.
an 1884-1886 : Nigéria - Période britannique (1800-1960)
La conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique entérine la domination britannique sur la région, alors que Goldie, une fois assuré du contrôle militaire des berges du fleuve par le biais de canonnières, constitue un vaste réseau commercial s'étendant à l'intérieur des terres. À la fin de l'année 1884, il avait conclu plus de 37 traités avec les chefs de tribus africaines stipulant que les signataires cédaient à jamais l'ensemble de leur territoire à la National African Company et à ses descendants tout en leur assurant le monopole commercial.
La compagnie de Goldie fonctionnait dorénavant comme un gouvernement de facto et il ne lui restait plus qu'à obtenir une charte royale, laquelle fut accordée le 10 juillet 1886 mettant au jour la Compagnie royale du Niger. Si cette dernière ne pouvait prétendre finalement à un monopole commercial sur le fleuve Niger, elle avait droit de prélever des taxes et des droits de passage sur tous les navires transitant sur le fleuve.
an 1884 : Togo - Togoland - Le Togo a souffert du commerce négrier que lui ont fait subir les liens commerciaux entre négriers occidentaux et rois tribaux à partir du XVIe siècle avant que la colonisation n'y mette fin au XIXe siècle. En 1884, le roi Mlapa III de Togoville signe un traité de protectorat avec l’Allemagne (représentée par Gustav Nachtigal), qui dure jusqu’à la Première Guerre mondiale.
Le Togoland est un protectorat allemand en Afrique de l'Ouest, ayant existé de 1884 à 1914.
Le Togoland allemand avait une superficie de 88 500 km2.
Le protectorat fut institué lors du Partage de l'Afrique, quand l’explorateur allemand Gustav Nachtigal arriva à Togoville en tant que commissaire spécial, envoyé par le chancelier Otto von Bismarck. Le 5 juillet 1884, un traité fut signé avec le chef local Mlapa III, dans lequel l’Empire allemand déclara un protectorat sur une bande de territoire le long de la côte du golfe du Bénin. Natchtigal ne fut Reichskommissar qu’une journée et fut remplacé par Heinrich Randad le 6 juillet. Nachtigal partit pour l'Afrique du Nord .
an 1884-1886 : Kenya - À la suite des explorateurs comme Emin Pacha, la colonisation complète du Kenya débuta par ce qui fut un protectorat allemand sur ce qui était auparavant une partie des possessions du sultan de Zanzibar. Les Anglais commencent la colonisation du Kenya entre 1884 et 1886. En 1885, le traité de Berlin confirme les ambitions coloniales des Anglais, qui se voient accorder la zone qui correspondra au futur Kenya.
an 1884 : Afrique du Sud - Alors que le nationalisme afrikaner se développe, les bantous, scolarisés et éduqués par les missionnaires du Transkei et du Zululand, commencent de leur côté à acquérir leur autonomie au sein de la société civile sud-africaine dite civilisée. En 1884, à King William's Town, John Tengo Jabavu fonde Imvo Zabantsundu (« opinion africaine »), le premier journal bantou indépendant d'une mission religieuse, écrit par des journalistes Noirs pour un lectorat Noir, principalement xhosa66. En quelques années, plusieurs autres journaux apparaissent dont Izwi Labantu, lancé par Walter Rubusana, sur une ligne éditoriale opposée à celle, estimée trop conservatrice, de John Tengo Jabavu, soutenue par les libéraux blancs du Cap.
an 1884-1885 : Somalie - En 1884, l’Égypte devenue indépendante de l’empire Ottoman souhaite restaurer son ancienne puissance et s’intéresse à l’Afrique de l’est. Le Soudan lui résiste cependant, et la révolution mahdiste de 1885 expulse les forces égyptiennes hors du Soudan, mettant un terme aux velléités de créer un nouvel empire égyptien. Les troupes qui sont parvenues en Somalie sont secourues par la Grande-Bretagne et escortées pour leur retour de leur côté des lignes.
Par la suite, la plus grande menace sur les ambitions européennes en Somalie vient de l’Éthiopie, en la personne de l’empereur Menelik II, qui a réussi à éviter à son pays l’occupation, et qui projette d’envahir à nouveau la Somalie.
an 1884 : Soudan - Les troubles menacent les intérêts des Britanniques. Le gouvernement britannique demande au khédive Tawfiq Pacha d’évacuer le Soudan. L’opération est confiée au général Gordon. Il remonte le Nil jusqu’à Khartoum, où il se trouve isolé en pays hostile, mais refuse de regagner l’Égypte et se retranche dans la ville pour organiser la résistance malgré la disproportion des forces en présence. La ville résiste pendant un an, du 13 mars 1884 au 26 janvier 1885 (siège de Khartoum). Gordon Pacha est tué lors de la prise de Khartoum par les mahdistes. Sa mort permet aux Britanniques de justifier stratégiquement leur présence en Égypte. L’armée de secours commandée par le général Wolseley rebrousse chemin sans tenter de reprendre la ville, puis abandonne Dongola, sa base de départ. Le Mahdi œuvre à la constitution d’un État islamique, qui s’étend sur la superficie approximative du Soudan actuel, et établit sa capitale à Omdourman, face à Khartoum.
an 1885 : Pays des Tswanas - République de Botswana - À la fin du XIXe siècle, les hostilités éclatent entre les Tswanas, habitant le Botswana, et les tribus Ndebele migrant sur ce territoire depuis le désert du Kalahari. Les tensions montent également d'un cran avec les colons Boers venant du Transvaal. Après les demandes d'assistance lancées par les dirigeants botswanais Khama III, Bathoen et Sebele, le gouvernement britannique met le Bechuanaland sous sa protection le 31 mars 1885. La partie nord de ce territoire passe sous administration directe en tant que protectorat du Bechuanaland, formant le Botswana actuel. La partie sud du territoire est intégrée à la colonie du Cap, et fait maintenant partie de la province nord-ouest de l'Afrique du Sud. La majorité des personnes parlant setswana vivent aujourd'hui en Afrique du Sud.
an 1885 : Cameroun - Congrès de Berlin en 1885. Les Allemands créent de grandes plantations (cacao, palmiers, hévéas), bâtissent des routes, une voie ferrée et le port de Douala.
an 1885 : République de Centrafrique - L'Oubangui-Chari est l'une des dernières taches blanches des cartes géographiques à partir desquelles les puissances européennes se partagent le continent africain.
Georges Grenfell, un pasteur d'origine britannique, est le premier à dresser la carte du fleuve Oubangui et à atteindre en 1885 le site qui va devenir celui de l'actuelle capitale Bangui.
En 1885, des explorateurs belges découvrent le fleuve Oubangui. Le territoire ainsi découvert est partagé entre la France et la Belgique de part et d'autre du fleuve qui marque ainsi la frontière entre ces deux puissances coloniales.
an 1885 : Congo Brazzaville - En 1885, le Congo devient l'un des quatre États de l'Afrique-Équatoriale française, et Brazzaville, la capitale de l'AEF.
an 1885-1908 : Congo Kinshasa (Zaïre) - Le roi Léopold II prend possession du territoire en son nom propre sous le nom d’État Indépendant du Congo. Des expéditions d'exploration sont lancées, et les voies de communication développées. La maîtrise du territoire s'achève en 1894 pour l'essentiel avec la fin de la guerre contre les Arabo-Swahilis.
L'exploitation intensive du territoire commence alors, où se côtoient tant les missionnaires que les aventuriers à la recherche de fortune facile par tous les moyens. La population locale doit notamment récolter par le travail forcé pour le compte du Domaine royal ou de compagnies privées du caoutchouc. Le marché de ce matériau est alors en pleine expansion en raison de la demande mondiale en pneus. À la fin du XIXe siècle, on commence à découvrir les richesses minières du Congo : le cuivre, l'or, le diamant... Après avoir servi à rembourser les emprunts, la vente du caoutchouc et des produits miniers, facilitée par la toute nouvelle ligne de chemin de fer Matadi-Léopoldville, fait la fortune de Léopold II, qui fait construire de nombreux bâtiments à Bruxelles et Ostende.
Au cours de la période 1885-1908, la population eut à souffrir de cette exploitation forcée, de façon directe ou indirecte. De très nombreuses exactions (meurtres, mutilations, tortures…) sont commises, et la population décroît. Il y a cependant des protestations contre ces traitements , notamment de la part de l’écrivain Mark Twain5, du diplomate britannique Roger Casement, dont le rapport de 1904 condamne les pratiques en vigueur au Congo5 et surtout du journaliste anglais du West Africain mail Edmund Dene Morel. Il y a également les photographies d'une britannique, Alice Seeley Harris. À la suite de ces dénonciations, Léopold II est contraint de laisser sa colonie à l’État belge.
Les frontières de l'actuelle république démocratique du Congo ont été reconnues à l'issue de la conférence de Berlin qui s'est tenue de novembre 1884 à février 1885. Le 1er août 1885, Léopold II de Belgique accepta la souveraineté sur l'État indépendant du Congo. Le terme « indépendant » signifie que toutes les puissances coloniales reçoivent la garantie de pouvoir y accéder librement. La spécificité de ce régime colonial résida dans le fait que dans un premier temps le Congo fut considéré comme une possession personnelle et privée du roi. Géré sous une forme commerciale, le Congo est divisé en deux parties : l'une constituant le domaine de la couronne et l'autre attribuée à des entreprises privées sous forme de concession.
Les richesses abondantes (caoutchouc, ivoire, mines, etc.) du Congo incitent la couronne et les compagnies concessionnaires à entreprendre l'exploitation brutale de sa population. Celle-ci diminue de moitié entre 1880 et 1926, au point que certains historiens désignent cette période comme un « holocauste oublié ».
an 1885-1896 : Afrique République de Djibouti - Après un traité sans suite avec le « sultan de Goba'ad » en janvier 1885, le 26 mars 1885, un accord avec les « chefs issas » place la côte sud sous souveraineté française. Un accord territorial avec la Grande-Bretagne, par l'échange de notes des 2 et 9 février 1888, arrête cette expansion.
C'est la même année, en 1888, qu'est créé le port de Djibouti, qui devient le chef-lieu de la nouvelle Côte française des Somalis en 1896. En 1895, la ville compte 5 000 habitants. Elle est placée sous l'autorité administrative de Bourhan Bey, fils de l'ancien gouverneur (pacha) de Zeilah, Abu Bakr Ibrahim.
an 1885 : Érythrée - Lointaine province ottomane, les côtes du territoire sont occupés à partir de 1885 par des troupes italiennes et connaissent un semblant de colonisation.
an 1885 : Réunion (Ile de la) - Fin de l'immigration indienne.
an 1885 : Rwanda - Pendant tout le XIXe siècle le Rwanda restera encore à l'écart de l'influence occidentale. Il semble connu à partir du milieu du XIXe siècle par des récits indirects et il est évoqué à la conférence de Berlin en 1885.
Les souverains du Rwanda (Yuhi IV Gahindiro, Mutara II Rwogera et Kigeri IV Rwabugiri, mort en 1895) consolident les conquêtes de leurs prédécesseurs. L’expansion est préparée par des réformes permettant une maîtrise plus grande de l’espace : établissement de camps militaires permanents et création de commandement militaires dans les régions frontalières.
Les premiers Européens qui évoquent le Rwanda dans leurs récits indirects sont Richard Francis Burton et John Hanning Speke, au milieu du XIXe siècle. Le pays est également évoqué en 1885 lors de la conférence de Berlin par Henry Morton Stanley, lors du Partage de l'Afrique..
an 1885 : Soudan - Après la mort du Mahdi dans des conditions mystérieuses le 22 juin 1885, son fils et lieutenant (Khalifa) Abd Allah (Abdallahi ibn Muhammad, 1846-1899) prend le pouvoir, maintient l’unité du Soudan, bat les Éthiopiens mais ne peut envahir l’Égypte.
an 1885 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1885, au traité de Berlin, qui partage l'Afrique aux grandes puissances Européennes, les Portugais sont évincés, et l'actuel Zimbabwe passe sous influence Britannique (mais il ne sera colonisé qu'après 1885).
an 1886 : Afrique du Sud - C'est la découverte des gisements d'or au Witwatersrand en 1886 qui fait du Transvaal le principal sujet préoccupant pour l'administration coloniale britannique. Longue d'environ 70 km d'ouest en est, la zone aurifère du Witwatersrand s'avère la plus riche jamais découverte ; elle fournit, à la fin du XIXe siècle, jusqu'à un quart de la production mondiale d'or. Au Cap, l'homme d'affaires Cecil Rhodes s'emploie dès lors à saper la stabilité des républiques boers afin de réaliser sa vision impérialiste, qui consistait à former un dominion sud-africain économiquement unifié ainsi qu'une Afrique britannique du Cap au Caire.
an 1886 : Archipel des Comores - L'archipel est placé sous protectorat français en 1886. Il fut pendant longtemps une étape de la traite orientale.
En 1886, la France établit un protectorat sur Anjouan, et utilise même la marine pour s'imposer face au sultan Saidi Abdallah bin Salim réticent. Le 24 juin 1886, le sultan de Grande Comores qui a réussi à unifier l'île grâce aux Français, accepte, sous la pression, de passer sous protectorat français. Il est ensuite exilé pour ne plus revenir. Mohéli est également placée sous protectorat cette même année. Même si les îles gardent une certaine indépendance du fait de la rivalité des grandes puissances, elles sont bien soumises et les sultans locaux n'ont pas les moyens de s'y opposer.
an 1886 : Réunion (Ile de la) - Livraison du port de la Pointe des Galets.
an 1886 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - La rivalité entre Allemands et Britanniques en Afrique de l’est s’exacerbe et de 1886 à 1890, différents accords et traités organisent le partage des zones d’influences entre les deux puissances coloniales, au grand désespoir du sultan Bargash qui fait les frais de ces luttes de pouvoir.
Au cours d’une première conférence, à Berlin en 1886, le Royaume-Uni et l’Allemagne reconnaissent la souveraineté du sultan sur Zanzibar, mais dans le même temps réduisent fortement l’étendue des zones où s’exerce cette souveraineté. Le sultan, outre les îles de Zanzibar, Pemba, Mafia et Lamu, ne possèdent plus qu’une bande côtière de 16 km de large qui va du Cap Delgado (dans l’actuel Mozambique) jusqu’à Kipini (dans l’actuel Kenya). À l’Allemagne revient l’intérieur du continent jusqu’au grands lacs, région qui sera bientôt appelée le Tanganyika, plus le Burundi et le Rwanda ; l’ensemble de ces possessions forme la nouvelle Afrique orientale allemande (Ostafrika).
La frontière entre les territoires allemands et britanniques est une simple ligne droite tracée vers l’ouest depuis la rivière Tana jusqu'au lac Victoria. Avec cette frontière, le Kilimandjaro est dans le territoire allemand.
an 1886 - 1919 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - La colonisation allemande du Tanganyika : 1886-1919
Les Allemands, de leur côté, ont de grandes ambitions pour leurs nouvelles « possessions » africaines, mais la prise en main du pays ne se fait pas sans heurts.
Dès 1888-1889, des soulèvements éclatent dans plusieurs villes côtières (Bagamoyo, Pangani, Tanga). Ils sont durement réprimés par les Allemands.
En 1891, le gouvernement allemand, constatant l’incapacité de la Compagnie de l’Afrique orientale allemande à tenir le pays, prend le contrôle direct des opérations et déclare l’intérieur du pays protectorat allemand. Un gouverneur est nommé, et Dar es Salam, alors simple petit port de commerce de 5 000 habitants, est choisie comme capitale du fait de sa baie portuaire en eaux profondes, plus pratique pour les bateaux à vapeur allemands.
Les Allemands, pour investir le continent, remontent les anciennes routes caravanières arabes jusqu’aux grands lacs et aux points de passage importants. Région après région, après avoir pris le contrôle par la force, ils installent des postes militaires et s’assurent de la docilité des chefs tribaux locaux, ou remplacent ces derniers par d’autres plus soumis.
Avant l’arrivée de ces colons à la fin du XIXe siècle, certaines des ethnies et tribus qui habitent l’intérieur du continent ont atteint un niveau d’organisation et de développement tout à fait remarquable. On peut citer les Maasaï, dont tout le système de société est construit sur l’âge des individus, le peuple Nyamwezi, à l’époque dirigé par le chef Mirambo, les Hehe, et d’autres royaumes comme les Chagga et les Haya.
À l’arrivée des Allemands, les Hehe, emmenés par le chef Mkwawa Mwamyinga, craignant pour leur indépendance et contestant les concessions de terres décidées par les colons pour la nouvelle culture du coton, se rebellent et attaquent avec succès les positions allemandes à partir de 1891 (bataille de Lugalo). Sur un autre front, les Allemands ont également fort à faire avec les Nyamwezi, plus à l’ouest, qui commencent les hostilités en avril 1892. Les rebelles sont matés avec brutalité, le chef Nyamwezi, Isike, attrapé et pendu au début 1893. En 1894, un imposant corps expéditionnaire de plusieurs milliers de soldats est constitué pour mettre définitivement au pas les Hehe. Il parvient à prendre d’assaut la place forte de Kalenga, mais le chef Mkwawa réussit à s’échapper et continue la lutte pendant 4 années en organisant une guérilla de harcèlement des Allemands. Cependant ces derniers arrivent peu à peu à leurs fins, et, en 1898, Mkwawa, traqué, épuisé et désespéré par la victoire inéluctable des occupants européens, se suicide. Sa tête, tranchée par un Allemand, est transférée dans un musée à Brême où elle restera jusque dans les années 19501.
Avec la fin de la rébellion Hehe, les Allemands disposent de quelques années de répit, contrôlant assez facilement quelques soulèvements disparates et jamais unis contre l’ennemi commun.
Jusqu’à ce qu’éclate en 1905 une importante révolte, qu’on appela rapidement la révolte Maji Maji, du nom d’un esprit censé habiter les montagnes Uluguru au sud de Dar-es-Salaam et dont on prétend qu’il procure à l’eau qui coule du massif le pouvoir de protéger des balles. Les habitants de cette région, auxquels se joignent d’autres tribus plus au sud, attaquent les Allemands simplement armés d’arcs et de lances. Les Allemands matent la rébellion de manière impitoyable, en menant une politique de terre brulée, qui, outre les victimes aux combats, fait de nombreux morts par famine du côté des populations indigènes. Les estimations vont de 75 000 à 120 000 morts au total du côté africain, jusqu’à la fin de la rébellion en 1907. Certains ont vu dans la révolte Maji-Maji la première manifestation d’un nationalisme tanzanien.
Le gouvernement allemand tire un certain nombre d’enseignements de cet important soulèvement qui a touché tout le sud-est du pays. Les budgets de financement des colonies sont augmentés et une administration plus libérale est mise en place en remplacement du régime semi-militaire qui prévalait auparavant.
Durant cette période, jusqu’au début de la Première Guerre mondiale, les Allemands vont promouvoir dans le pays un certain nombre de projets pour développer les infrastructures et amorcer le démarrage de l’économie. En 1911, est achevée la première ligne de chemin de fer, entre Tanga au nord de la côte, et Moshi au pied du Kilimandjaro. En 1914, c’est la ligne centrale qui est inaugurée, de Dar-es-Salaam à Tabora, près du lac Tanganyika.
L’agriculture est encouragée, notamment dans les régions fertiles au pied des grands volcans (Mont Méru, Kilimandjaro). De nouvelles plantations et cultures sont introduites, comme le café et le thé dans le nord et le coton dans le sud. Le sisal (agave sisalana) , fibre végétale servant à faire des cordages ou des tapis, est importé de sa région d’origine, le Mexique, par l’agronome allemand Richard Hindorff.
Les Allemands ont également besoin de personnes instruites pour occuper les postes de fonctionnaires dans l’administration naissante. La construction d’écoles est encouragée, ce qui complète les initiatives pour la scolarisation déjà menées par de multiples missionnaires chrétiens avant l’arrivée des colons.
Une autre conséquence de la présence allemande est la généralisation de la langue swahilie. Ayant rapidement compris qu’il était illusoire de vouloir faire apprendre l’allemand, les colons s’appuyèrent sur la langue pratiquée par les populations locales les plus instruites, à savoir les minorités arabes et swahilies parmi lesquelles étaient recrutés les fonctionnaires. De plus, le swahili avait l’avantage de commencer à être écrit en caractères latins, et les Allemands encouragèrent son apprentissage dans les écoles religieuses et gouvernementales. La pratique du swahili devint un critère d’embauche dans l’administration.
an 1886-1898 : Gabon - En 1886, le Gabon devient une colonie qui, dès 1888, est fusionnée avec celle du Congo sous le nom de Gabon-Congo puis, en 1898, de Congo français. De vastes concessions sont accordées et l'exploitation de l'Okoumé commence.
an 1886 : Sénégal - Mort de Lat Dior à la bataille de Dékhelé. Fondation de Touba.
an 1886 -1964: Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Les îles de Zanzibar et Pemba de 1886 à 1964
Les îles de Zanzibar et de Pemba connaissent une certaine stabilité politique du début du XXe siècle jusqu’au début des années 1960. Le territoire est toujours protectorat du Royaume-Uni, qui maintient en place le système politique du sultanat, tout en officialisant son exercice du pouvoir en constituant en 1925-26 des conseils exécutifs et législatifs à la place du conseil consultatif.
Sur le plan économique, les premières décennies du XXe siècle sont marquées par une grande crise du marché du clou de girofle, qui crée des tensions entre les communautés indiennes et arabes.
À partir du milieu des années 1950 se forment différents partis politiques plutôt indépendantistes, et chacun avec une dimension ethnique assez marquée. Le ZNP (Zanzibar National Party) est essentiellement composé d’Arabes. Beaucoup d'ouvriers agricoles africains, souvent issus des anciennes populations esclaves, se retrouvent pour leur part dans le Parti Afro-Shirazi (ASP), aux tendances assez radicales.
Pendant la présence des colons européens, allemands puis britanniques, les sociétés africaines sont bouleversées dans leur fonctionnement et leurs traditions. L’expansion des religions chrétiennes et des systèmes économiques occidentaux, c’est-à-dire notamment la monétarisation des échanges, modifie totalement les relations et les rapports de force inter-tribales. Ces changements identitaires et culturels sont cependant plus ou moins prononcés d’une tribu à l’autre. Certains, comme les Maasaïs, restent résolument à l’écart de cette « modernisation » de la société.
an 1888-1917 : Afrique République de Djibouti - Le vaste port en eau profonde de Djibouti fut fondé en 1888 et devint le port et le débouché naturel de l'Éthiopie.
Un échange de notes franco-britannique des 2 et 7 février 1888, fixe la limite côtière entre les colonies respectives à Loyada et ouvre aux négociants de deux pays les routes commerciales vers Harar. C'est alors que commence le transfert du centre de gravité du territoire du nord (Obock) au sud (Djibouti), achevé en 1896 lorsque cette dernière ville devient le chef-lieu du territoire, qui prend alors le nom de Côte française des Somalis (CFS). Au nord, les limites côtières sont fixées à Douméra dès 1891, et précisées par un accord franco-italien de 1900-1901.
Vers l'intérieur, le territoire s'étend avec la construction du chemin de fer vers l'Éthiopie : partie de Djibouti en octobre 1897 elle atteint en décembre 1902 la ville de Dire Dawa, créée de toutes pièces pour le chemin de fer. Le partage de l'Éthiopie en sphères d'influence entre l'Italie la Grande-Bretagne et la France par le traité du 13 décembre 1906 permet de continuer la construction de la ligne. Les travaux reprennent en 1910, et Addis-Abeba, le terminus, est atteint en 1917.
an 1888 : Gambie - En 1888, la Gambie est une colonie à nouveau à part entière. C’est le début du développement de la culture de l’arachide pour ce pays qui sera surnommé rapidement « colonie de l’Arachide ».
an 1888-1890 : Kenya - L'histoire coloniale du Kenya débute avec la création d'un protectorat allemand sur des possessions du sultan de Zanzibar, puis l'arrivée de la British East Africa Company en 1888. Les rivalités entre ces deux pays cessent lorsque l'Allemagne renonce à ses possessions côtières en faveur du Royaume-Uni en 1890.
an 1888-1893 : Ouganda - En 1888, la partie à l'Est du Kenya est donné à l’Impérial British East Africa Company. C'est une compagnie commerciale à chartes. L’arrangement est renforcé en 1890 par le Traité Heligoland-Zanzibar avec l'Allemagne, qui confirme la domination britannique sur le Kenya et l’Ouganda. Le fort coût de l’occupation du territoire contraint la compagnie à abandonner la gestion de l’Ouganda en 1893. Le fonctionnement administratif est alors confié à un Commissioner Britannique.
an 1888 -1897: Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - En 1888, les Allemands, qui ne se satisfont pas de ce partage des terres qui les gène puisqu’ils doivent traverser la bande côtière zanzibarite pour accéder à l’intérieur des terres, négocient avec le sultan un bail pour pouvoir exploiter la côte. Des tensions apparaissent et le chancelier Bismarck dépêche des troupes sur place.
La situation se décante avec le traité Heligoland-Zanzibar, signé en 1890. L’Allemagne récupère l’archipel de Heligoland située au large de ses côtes européennes et en contrepartie renonce à d’autres prétentions sur la côte orientale de l’Afrique et reconnaît la suprématie du Royaume-Uni sur Zanzibar. Cette même année, le Sultan perd officiellement tout contrôle sur la petite bande côtière qui était censé être sous sa mainmise, et il lui est donné un statut équivalent à un fonctionnaire payé par la Couronne Britannique.
En 1891, les Britanniques imposent la constitution d’un gouvernement à Zanzibar, et nomment à sa tête Sir Lloyd Mathews (en). À la mort du sultan régnant, en 1896, un fils de l’ancien sultan Bargash, Khalid, se proclame sultan et s’empare du palais royal de Zanzibar. Les Britanniques interviennent militairement, ils bombardent le palais, et chassent Khalid qui est remplacé par un nouveau sultan, Hamoud ibn Mohammed le 27 août 1896. En 1897, le statut d’esclave est définitivement aboli sur l’île, malgré l’opposition des notables locaux, principalement arabes et indiens, qui craignent la disparition de cette main d’œuvre bon marché si pratique pour les plantations de clous de girofles.
an 1888 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - L'année 1888 est marquée par la concession Rudd, traité par lequel le roi Lobengula cède à la British South Africa Company de Cecil Rhodes l’ensemble des terres situées entre les fleuves Zambèze et Limpopo.
an 1889 : Afrique du Sud - En 1889, joignant ses ambitions politiques et ses intérêts privés, Rhodes crée la British South Africa Company (BSAC), qui obtient du gouvernement britannique une « charte royale » pour occuper le Matabeleland, le royaume du roi Lobengula, successeur de Mzilikazi, situé au nord du Transvaal.
an 1889-1890 : République de Centrafrique - En 1889, sur la rive droite de l'Oubangui est fondé le poste de Bangui, qui deviendra en 1985 la capitale de la République centrafricaine.
Plusieurs missions ont lieu dans les années 1890, dont celle conduite par Paul Crampel, qui atteint le camp de Mohamed es-Senoussi, Jean Dybowski, Casimir Maistre, et François-Joseph Clozel, en plus de la célèbre expédition Marchand.
an 1889-1896 : Érythrée - La présence italienne dans la corne de l'Afrique est formalisée en 1889 avec la signature du traité de Wuchale avec Ménélik II – bien que Ménélik revient plus tard sur l'accord. Les relations entre l'Italie et l'Éthiopie sont marquées pour les cinquante années qui suivent par de fréquentes tentatives de l'Italie d'étendre sa base coloniale vers la Somalie et l'Éthiopie. Mais sa progression est bloquée par l'armée éthiopienne, notamment par la bataille d'Adoua en 1896 dans le Tigré.
an 1889-1902 : Éthiopie - À l'annonce de la mort de Yohannes IV, Menelik se fait proclamer Negusse Negest d'Éthiopie, et reçoit la soumission des provinces du Begemder, du Godjam, des Oromos, et du Tigré.
Le 2 mai 1889, Menelik signe le traité de Wouchalé avec les Italiens, leur accordant une région du nord de l'Éthiopie, connue plus tard sous le nom d'Érythrée et une partie du Tigré, en échange de 30 000 fusils, munitions et canons. Le traité s'avère être un tournant décisif dans les relations entre Menelik et l'Italie. En effet, l'article XVII prête à contestation : selon la version amharique, l'Éthiopie peut recourir aux autorités italiennes si elle veut entrer en relation avec d'autres pays alors que dans la version italienne, le recours à l'Italie est obligatoire.
De plus s'appuyant sur la version italienne, l'Italie prétend établir un protectorat en Éthiopie. Les Italiens occupent alors la ville d'Adoua pour soutenir leurs prétentions et font savoir au Ras Mangacha, gouverneur de la province du Tigré et fils de Yohannes IV qu'ils ne se retireraient pas tant que Menelik II n'aurait pas accepté leur interprétation du traité de Wuchalé.
Menelik refuse de céder à la manipulation et dénonça le traité de Wuchalé le 12 février 1893.
L'Érythrée entre en guerre contre l'Italie en décembre 1894. Les Italiens attaquent le ras Mangacha et commencent à s'emparer d'une grande partie de la province du Tigré. Les Éthiopiens reprennent l'avantage, notamment à Amba Alagi, où le fiaourari Guébéyéhou Abba Gora fait remporter la victoire à son armée au prix de sa vie, et à Maqalé, après un siège de la ville occupée par les Italiens.
Le Premier ministre italien M. Crispi, s'en prenant au général, indique qu'il « voulait une victoire authentique, c'est-à-dire sans équivoque ! » ; les Italiens décident de passer à l'offensive à Adoua, le 1er mars 1896.
S'engage alors la bataille d'Adoua, considérée comme « l'un des évènements les plus importants de l'histoire de Afrique moderne», « une des quatre batailles majeures dont l'histoire de l'Éthiopie se souvienne ».
L'armée italienne compte « 18 000 hommes dont 4 000 auxiliaires recrutés sur les territoires occupés». Se dirigeant vers les cols de Rebi Arrienni et Kidané-Mehret où ils pensaient trouver l'armée éthiopienne, les Italiens sont pris par surprise par « 40 à 50 000 Éthiopiens (informés de leur déplacement) là où ils les attendaient le moins». À l'erreur fondamentale de sous-estimer leur adversaire, les troupes italiennes ajoutent une mauvaise connaissance du terrain et des erreurs stratégiques qui leur seront fatales.
Carlo Conti Rossini indique que les pertes italiennes s'élèvent à « 289 officiers, 4 600 soldats blancs, un millier d'Érythréens(…) Immense sacrifice pour une armée qui ne comptait que 16 500 hommes » Dès le lendemain, les répercussions sont immenses. La victoire d'Adoua a un sens déterminant aussi bien pour l'Éthiopie elle-même, en faisant, définitivement, l'un des seuls pays non colonisés d'Afrique. Cette victoire a un sens tout aussi important pour le reste du monde. À une époque où toute l'Afrique est aux mains du colonialisme européen, la bataille d'Adoua commence à sonner la fin d'une ère, et un évènement « prémonitoire » comme le dit l'historien Berhanou Abebe. « Pour les peuples qui combattront le colonialisme et les militants qui se battront pour la liberté en Afrique, dans les Caraïbes et dans le reste du Tiers monde, Adoua pose les bases du mouvement panafricaniste et des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis » qui y puiseront inspiration.
Un traité de paix est conclu à Addis-Abeba le 26 octobre 1896, qui reconnaît l'indépendance absolue et sans réserves de l'Éthiopie. Indiquant que l'Éthiopie pouvait étendre ses frontières au sud et à l'est, doublant la superficie de l'Empire. L'Italie de son côté est confortée sur ses possessions érythréennes qui mènera à l'un des problèmes majeurs pour l'Éthiopie. Les années qui suivent la victoire d'Adoua sont caractérisées par une relative paix de l'Empire. Du point de vue intérieur, Menelik II accorde à la même époque, une première concession à une compagnie ferroviaire française à partir des côtes djiboutiennes, en 1894. La ligne s'étend jusqu'à Dire Dawa, à la fin de l'année 1902. Ce choix fera d'Addis Abeba et de Djibouti un axe central dans l'économie éthiopienne.
an 1889 : Gambie - En 1889, un traité franco-britannique fait de la Gambie une possession britannique. Les frontières, imposées par ces deux puissances coloniales, seront toutefois contestées en Gambie comme au Sénégal car elles dessinent un territoire en longueur et totalement enclavé dans le Sénégal français.
an 1889-1904 : Namibie - La colonisation allemande (1884-1920) -
Le recours à la troupe coloniale (1889-1904)
Le 24 juin 1889, le capitaine Curt von François débarque dans le Sud-Ouest africain à la tête d'un contingent militaire composé de vingt et un soldats avec pour mission d'imposer l'ordre allemand sur le territoire. Celui-ci est agrandi l'année suivante et la frontière à l'est avec le Bechuanaland britannique est fixée. Le 18 octobre 1890, von François fait bâtir un fort (Alte Feste) sur le site de Winterhoek destiné à devenir le quartier général des forces coloniales du Reich.
À partir du 7 décembre 1891, Winterhoek, germanisé en Windhuk devient le centre administratif de la colonie. L'année suivante, von François fonde le port de Swakopmund au bord de l'océan Atlantique.
En 1893, von François reçoit le titre de Landeshauptmann du Sud-Ouest africain allemand.
Mais l'incapacité du major de venir à bout de la révolte des Namas menée par Hendrik Witbooi conduisent le gouvernement allemand à relever von François de ses fonctions et à le remplacer en 1894 par le major Theodor Leutwein. Ce dernier parvient à vaincre les Namas qui lui opposent une résistance acharnée — ils deviendront finalement plus tard d'efficaces auxiliaires de l'armée coloniale.
En 1902, la colonie compte 200 000 habitants dont 1 500 colons allemands.
an 1889-1895 : Ouganda - Le Kabaka du Buganda, Muteesa Ier, ne se convertit jamais réellement à l’une de ces trois religions. Au contraire, les Baganda (habitants du Buganda) se convertissent en masse au christianisme et au protestantisme. Ce nouveau facteur religieux est rapidement intégré dans l’organisation du royaume au point de devenir un enjeu déterminant dans les guerres civiles de 1889 à 1895.
an 1889-1891 : Soudan - Le Soudan connait une famine particulièrement meurtrière entre 1889 et 1891, tuant environ un tiers de ses habitants.
an 1890 : Afrique du Sud - En 1890, alors que Rhodes est devenu Premier Ministre du Cap, avec le soutien de l'Afrikaner Bond, la BSAC occupe le Mashonaland. Ces deux territoires, ainsi que ceux conquis en amont du fleuve Zambèze, forment bientôt la Rhodésie.
À l'ouest, le Bechuanaland est sous contrôle britannique. Le Transvaal est encerclé et, mis à part l'unique débouché maritime que lui offre Lourenço-Marquès, dans la colonie portugaise du Mozambique, il ne peut se développer sans concertation avec les autorités britanniques.
L'irruption d'un système industriel dans une société rurale, autarcique et conservatrice telle que celle du Transvaal a des répercussions considérables, déplaçant le centre de gravité économique de l'ensemble régional sud-africain vers Johannesbourg, ville nouvelle et cosmopolite au cœur du Witwatersrand, fondée en 1886 à une cinquante de kilomètres de Pretoria, la capitale du Transvaal. Née de la ruée vers l'or, elle atteint en quelques années plus de cent mille habitants, principalement originaires du Cap ou d'outre-mer ; ce sont les uitlanders, qui réclament l'égalité politique avec les Boers de la république. À ces uitlanders s'ajoutent des milliers de nouveaux prolétaires noirs, venant du monde rural, qui constituent une nouvelle catégorie urbaine de population déracinée et coupée de ses origines tribales. Afin de gérer cette classe ouvrière noire dans le Witwatersrand, les autorités sud-africaines du Transvaal répliquent les lois adoptées à Kimberley sur le travail migrant, combinant confinement spatial dans des zones définies et emplois réservés.
Au milieu des années 1890, les tensions montent de nouveau entre le gouvernement colonial du Cap et le Transvaal, à propos notamment du montant des taxes ferroviaires et des tarifs douaniers appliqués par la république. Cette opposition finit par se personnaliser entre le président Kruger et Cecil Rhodes, premier ministre de la Colonie du Cap. Les géologues découvrent que le gisement d'or est énorme s'il est possible de l'exploiter en grande profondeur, ce qui génère, à Paris et Londres, une des plus grandes spéculations de l'histoire boursière.
an 1890 : Angola - À la toute fin du XIXe siècle, les Portugais commencent à développer l'intérieur du pays, mais la conquête du reste de l'Angola est lente. En 1890, l'Ultimatum britannique de 1890 entraîne quelques troubles, mais aussi le retrait partiel de troupes portugaises.
an 1890 : Congo Kinshasa - Les sultans (1870) étendent leur emprise jusqu'au bassin du Congo, et y fondent des villes telles Nyangwe ou Kasongo. En 1890, la zone sous influence arabe couvrait plus d'un tiers du territoire du Congo.
an 1890 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais)
Le gouvernement portugais développe le tourisme dans ce territoire attrayant dès les années 1890, en concevant parallèlement des services en métropole. Le recensement de 1891 indique une population de 132 223 habitants.
an 1890 : Réunion (Ile de la) - La traversée en bateau depuis l'Europe ne demande plus que 21 jours.
an 1890 : Togo - L'Allemagne encourage ses citoyens à s'installer dans la colonie togolaise appelée le Togoland, en leur offrant des concessions à des conditions très avantageuses. Elle fait également construire les infrastructures nécessaires à l'exploitation du Togo (coton et cacao notamment), comme des lignes de chemin de fer, en recourant massivement aux travaux forcés. Les Allemands en font une Musterkolonie (de) (une « colonie modèle ») où doivent régner l'équilibre, la prospérité et la bonne gestion, mais où la langue allemande n'est pas imposée aux populations locales. La politique coloniale allemande est fondée, en dernier ressort, sur la conviction que les races sont différentes et que la race blanche est supérieure aux autres. Dans cette logique, les Allemands ne doivent donc pas considérer l’indigène comme leur frère noir.
an 1890 - 1924 : Zambie - La tutelle britannique est imposée au Barotseland, d'abord par l'intermédiaire de la British South Africa Company (BSAC) (dans le cadre de l'Administration de la Rhodésie par la British South Africa Company) puis en 1924 par le système du protectorat. Elle s'étend à l'ensemble du territoire actuel de la Zambie, dont elle fixe les frontières actuelles, sous le nom de Zambézie du Nord puis Rhodésie du Nord.
En 1890, Lewanika, le roi des Lozis, place le haut-Zambèze sous la protection de la BSAC de Cecil Rhodes. En 1891, le territoire, brièvement appelé Zambézie du Nord, est administré par la BSAC, qui élimine la traite des esclaves. Les Bembas s'opposent brièvement à la BSAC. Durant ces deux années, ce territoire devient un enjeu géopolitique entre l'Empire colonial portugais, qui le revendique dans le cadre de l'« affaire de la Carte rose », et l'Empire colonial britannique.
Entre 1898 et 1899, les administrations de la Rhodésie du nord-est (qui deviendra le Malawi) et de la Rhodésie du nord-ouest sont mises en place.
En 1911, une constitution est définie et les frontières de la Rhodésie du Nord, sous administration de la BSAC, sont fixées.
an 1890 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1890, la colonne des pionniers, mise sur pied par Cecil Rhodes, annexe le Mashonaland. Au même moment, l'Empire colonial portugais revendique ce territoire dans le cadre de l'« affaire de la Carte rose », provoquant un conflit diplomatique avec Londres.
an 1891 : Congo Brazzaville - La colonie du Congo français est créée en 1891, l’actuel territoire gabonais en fait partie jusqu’en 1904.
an 1891-1902 : Afrique République de Djibouti - La frontière littorale entre les possessions françaises et italiennes est fixée à Douméra dès 1891 et confirmée en 1901. Une mission conjointe sur le terrain la valide en 1902.
an 1891-1899 : Guinée - Dans le denier tiers du siècle, la Guinée subit la poussée colonisatrice des Français qui, à partir de Tombouctou et du Lac Tchad, font la conquête du territoire et le déclarent colonie française en 1891, malgré une forte résistance menée par Samory Touré et par les peuples de la forêt. En 1898 le pays est entièrement soumis et les territoires du haut-Niger sont aussi annexés en 1899.
an 1891-1898 : Guinée - La zone côtière fut occupée au préalable par les Portugais, qui furent évincés par l'armée française, parce qu'affaiblis par l'occupation de la Guinée-Bissau. De nos jours, de nombreux Guinéens originaires de la côte Atlantique du pays portent des noms d'origine portugaise. La Guinée est proclamée colonie française en 1891, indépendamment du Sénégal, auquel elle était précédemment rattachée. Cette nouvelle appellation remplace celle qu'elle portait jusque-là: les Rivières du Sud. Samory Touré, relayé ensuite par les peuples de la forêt, mène une guerre organisée contre l'occupation française sur la côte et dans les massifs montagneux du sud-est avant d'être vaincu en 1898. La guerre qui oppose les Français au Fouta-Djallon, à Porédaka, s'achève par la victoire des premiers. L'Almamy Bocar Biro Barry est assassiné près des bords du Bafing, à Kollen. Il a choisi cette option pour ne pas être soumis ou réduit en vassal de la puissance colonisatrice. Ses guerriers s'éparpillent ou préfèrent se donner la mort à ses côtés. Les régions du Haut-Niger sont annexées l'année suivante.
an 1891 : Mali - En juillet 1891, le Soudan français est créé. Il devient la colonie du haut Sénégal Niger en 1904 pour reprendre son nom en 1920 après la création de la Haute-Volta.
an 1892 : Archipel des Comores - À partir de 1892, le pouvoir sur les îles des Comores est exercé par les résidents subordonnés aux gouverneurs de Mayotte, qui peu à peu ont pris le pouvoir. Les exploitations coloniales constituent près de la moitié de la Grande Comores, 40 % d'Anjouan, 20 % de Mohéli. Les îles deviennent alors colonie de « Mayotte et dépendances ». Alors que la main-d'œuvre devient de plus en plus chère à La Réunion, les Comores, oubliées par l'administration centrale, offrent aux colons et aux sociétés coloniales (comme la Bambao) des perspectives et une main-d'œuvre peu chère dans les plantations de plantes à parfums et de vanille. Durant cette période, les colons dépossèdent entièrement les paysans comoriens de leurs terres, et emploient ceux-ci dans les plantations coloniales à titre d'« engagés ». La langue administrative devenue le français, la France implante des collèges puis des lycées dont l'enseignement se fait en français - ceux-ci demeurant réservés aux familles comoriennes privilégiées, tandis que les madrassas se chargent de l'éducation basique du reste de la population en comorien et en arabe. L'usage du swahili comorien se poursuit cependant dans le milieu du commerce.
an 1892-1894 : Rwanda - Après la brève incursion de 4 jours en 1892 d'un explorateur autrichien, le comte allemand Gustav Adolf von Götzen entre officiellement au Rwanda à la tête d'une troupe de 620 soldats en 1894. Le Rwanda est ainsi probablement le dernier pays découvert et colonisé en Afrique par les Européens, sous le règne de Kigeli IV (1853-1895).
an 1893 - 1894 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Entre 1893 et 1894, c'est la Première Guerre ndébélé. Les Ndébélé sont battus sur la Shangani et à Bembesi, mais anéantissent la patrouille britannique du major Allan Wilson sur la Shangani. Vaincu, Lobengula s'enfuit et décède, au début de l'année 1894.
an 1894 : Gambie - En 1894, une ordonnance fait officiellement de la Gambie un protectorat britannique à l’exception de l’île Sainte-Marie qui reste une colonie. Les colonisateurs appliquent alors leur « Indirect Rule » : la Gambie est divisée en différent districts mais le système traditionnel de chef et sous-chefs est maintenu.
an 1894 : Dahomey (Colonie de) future Bénin - Les Français deviennent très présents sur le territoire du Bénin à partir de 1850, : traité de 1851, cession du territoire de Cotonou en 1868 et protectorat en 1880.
an 1894 : Oubangui-Chari Centrafrique - Victor Liotard, gouverneur de l'Oubangui dépendant du gouverneur du Congo Savorgnan de Brazza, récupère les postes belges sur la rive droite du M’Bomou. Les Français organisent le Haut-Oubangui en régions civiles et militaires, ainsi que le Chari après la première expédition d’Émile Gentil en 1896—97 jusqu’au lac Tchad.
an 1894 : Congo Kinshasa (Zaïre) - En 1894 prend fin la campagne menée par les Belges contre les Sultans arabes trafiquants d'esclaves.
an 1894 : Gambie - Après 1889 et un accord avec la France, le pays devient en 1894 un protectorat britannique.
an 1894-1909 : Maroc - Le décès de Hassan Ier, survenu au cours d'une expédition dans le Tadla en 1894, laisse le pouvoir au très jeune
Abd-al-Aziz, fils d'une favorite circassienne du harem impérial du nom de Reqiya et originaire de Constantinople, qui par ses intrigues et son influence favorise l'ascension du grand vizir Bahmad ben Moussa.
Une véritable régence est alors exercée par le grand-vizir Bahmad, issu de l'ancienne corporation des Abid al-Bukhari du Palais impérial. Le grand-vizir sait continuer intelligemment la politique pragmatique de Hassan Ier, mais sa disparition en 1900 entraîne une aggravation de l'anarchie et des pressions étrangères, de même qu'une rivalité entre Moulay Abd al-Aziz et son frère Moulay Abd al-Hafid, khalifa du sultan à Marrakech, rivalité qui se transforme en guerre de course au pouvoir en 1907. Après la victoire d'Abd al-Hafid sur Abd al-Aziz (désormais exilé sous la protection des troupes françaises qui occupent déjà Casablanca et sa région à la suite d'un bombardement et d'un débarquement très meurtriers), des intellectuels réformateurs influencés par la révolution des Jeunes-Turcs dans l'Empire ottoman et par la Nahda venue d'Égypte et du Levant, représentés notamment par Ali Zniber et dont les idées sont exprimées par le journal Lisan Al-Maghrib, tentent de soumettre au nouveau sultan un projet de Constitution chérifienne le 11 octobre 1908. Cependant, la crise profonde des institutions du sultanat et la pression accrue de l'impérialisme européen rendent impossible l'aboutissement du projet constitutionnel.
La faiblesse du makhzen permet en outre à un aventurier du nom de Jilali Ben Driss plus connu comme le rogui Bou Hmara de se faire passer pour un fils de Hassan Ier, et de se faire reconnaître comme sultan à Taza et dans l'ensemble du nord-est du Maroc, de lever sa propre armée capable de tenir en échec les mehallas impériales chérifiennes pendant quelques années, avant d'être finalement capturé et exécuté à Fès en 1909. Un autre chef rebelle, El-Raisuni, établit son fief dans la région des Jebalas et à Asilah d'où il rejette l'autorité du gouvernement impérial de Fès et provoque par ses enlèvements de ressortissants américains (affaire Perdicaris) l'intervention personnelle du président des États-Unis Theodore Roosevelt, qui menace le makhzen d'envoyer des navires de l'US Navy débarquer des troupes pour occuper Tanger. La libération des otages évitera les représailles de Theodore Roosevelt et donc la menace d'une invasion américaine, dans un contexte international déjà marqué par une forte tension entre la France et l'Allemagne au sujet de l'avenir de l'Empire chérifien.
an 1894 : Nigéria - Période britannique (1800-1960) - Le protectorat britannique (1900-1914)
Deux autres compagnies avaient également bénéficié de charte royale pour administrer le sud du territoire, la Oil rivers protectorate et la Niger Coast Protectorate.
En 1894, Frederick Lugard est envoyé par la compagnie royale du Niger à Borgu pour conclure des traités avec plusieurs chefs de tribus plaçant leurs chefferies sous la souveraineté britannique. Lugard est ensuite chargé par le gouvernement britannique d'assurer la protection de la région de Lagos contre les Français, susceptibles d'attaquer les positions britanniques.
an 1894 : Ouganda - C’est finalement en 1894 que le royaume du Buganda signe un traité avec les représentants de l'Empire britannique. Un second traité est signé en 1900. Il est connu sous le nom d’Agreement. Le Buganda et les royaumes subordonnés deviennent officiellement un protectorat britannique. Le pays est unifié sous le nom d'Uganda.
an 1894 : Réunion (Ile de la) - Livraison du pont suspendu de la rivière de l'Est.
an 1894 : Rwanda - Le Rwanda n'est pénétré qu'en 1894 par Gustav Adolf von Götzen, officier allemand qui établira les premiers contacts avec le roi du Rwanda.
Comme le Burundi, son faux jumeau, le Rwanda est à l'époque une monarchie de type féodal. Mais son organisation sophistiquée suscitera l'étonnement chez les premiers colons. Dès le début, des théories de mouvements de populations africaines non confirmées vont entraîner des contresens tenaces dans la compréhension de ce pays. Elles sont probablement inspirées de quelques découvertes ponctuelles dans des régions assez proches, et abusivement généralisées au Rwanda, sans doute à cause de préjugés raciaux contemporains qui n'admettaient pas que des Africains puissent avoir une civilisation élaborée. On considéra ainsi la catégorie dominante de la population rwandaise comme des nègres blancs, des métis, ce qui renforça le contresens initial.
an 1895 - Afrique du Sud - Après l'annexion d'autres territoires tribaux, une des plus grandes spéculations de l'histoire boursière provoque la crise boursière des mines d'or sud-africaines de 1895, au moment du Raid Jameson, perpétré par les britanniques, en vue du percement de mines jusqu'à 4 kilomètres sous terre.
Les territoires au nord du fleuve Limpopo étant sous domination britannique, il ne reste plus aux impérialistes britanniques qu'à contrôler les républiques boers et leurs gisements aurifères.
Depuis des années, les étrangers (uitlanders) de Johannesbourg, représentant le tiers des 200 000 habitants blancs du Transvaal, réclament la citoyenneté, afin de disposer du droit de vote et d'influencer les affaires du gouvernement. Paul Kruger refuse obstinément afin de préserver l'identité boer et d'empêcher, à terme, une majorité de réclamer l'annexion pure et simple de la république indépendante à la couronne britannique
En 1895, confronté à l'opposition du Transvaal à toute démarche d'intégration régionale, le docteur Leander Starr Jameson, bras droit de Rhodes, organise un complot doublé d'une expédition punitive contre la république sud-africaine, avec pour but de renverser le gouvernement. Le Raid Jameson est un fiasco, qui débouche sur l'arrestation de son auteur au Transvaal, la mise en cause de Cecil Rhodes et sa démission, en 1896, de son poste de Premier ministre de la colonie du Cap. L'évènement déclenche la Crise boursière des mines d'or sud-africaines.
an 1895-1902: Kenya - le Kenya est cédé par Berlin au Royaume-Uni à la suite de l'arrivée dans l'intérieur des terres, en 1888, de la Compagnie britannique impériale d'Afrique de l'Est. La famine survenue en 1899 tue, selon les estimations, entre 50 % et 90 % de la population[réf. nécessaire] de la région qui deviendra l'ex-province centrale du Kenya.
Le gouvernement britannique établit en 1895 l'Afrique orientale britannique, et en 1902 il permet aux colons blancs d'accéder aux hautes plaines fertiles. Ces colons eurent une influence dans le gouvernement avant même qu'il ne soit officiellement déclaré colonie de la Couronne en 1920, mais les Africains furent exclus de participation politique directe jusqu'en 1944.
an 1895 - 1905 : Madagascar - La mission de « pacification » du général Gallieni (1896-1905) s'exerce avec brutalité. La conquête est suivie de dix ans de guerre civile larvée, due à l'insurrection des Menalamba. La « pacification » conduite par l'administration française dure plus de quinze ans, en réponse aux guérillas rurales dispersées dans le pays. Au total, la répression de cette résistance à la conquête coloniale fait environ 100 000 victimes, sur une population totale de moins de 3 millions d’habitants.
Le calme revenu, Gallieni s'applique à réaliser sa « politique des races », mettant en place dans les provinces des administrateurs locaux, en lieu et place de l'administration Mérina. D'après lui, pour gouverner efficacement Madagascar, « il y a des haines et des rivalités qu'il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes28. » L'esclavage est supprimé. Les autochtones, soumis au régime de l'indigénat, perdent tout droit et toute représentation spécifique. Les écoles subissent une francisation forcée et perdent une bonne partie de leurs effectifs. Par la suite, à partir surtout de 1901, le pouvoir colonial entame la « mise en valeur » de la nouvelle colonie pour le profit des colons et de la métropole en accordant de très vastes concessions à des grandes sociétés et des particuliers. Les chefs indigènes loyaux envers l'administration française se voient également accorder une partie des terres. Le travail forcé est instauré en faveur des compagnies françaises et les paysans se voient incités, à travers l'impôt, à se salarier (notamment dans les concessions coloniales) au détriment des petites exploitations individuelles. Sur emprunt public, une voie ferrée est démarrée : la ligne Tananarive-Tamatave est ouverte en 1913 et devient l'axe essentiel du développement de l'économie malgache. Gallieni porte une attention particulière au domaine de la santé : ouverture d'une École de Médecine en 1897 pour la formation de médecins auxiliaires, fondation d'un Institut Pasteur de Madagascar en 1899 pour la prophylaxie de la variole et de la peste, création de l'A.M.I. en 1902 pour des soins gratuits aux populations
an 1895-1907 : Mali - Le Soudan français est intégré à l’Afrique-Occidentale française en 1895.
Le Mali a été le berceau de trois grands empires : l'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire songhaï. Il est par la suite une colonie française de 1895 à 1960.
Le territoire malien, dénommé Haut-Sénégal-Niger devient, en 1895, une colonie française intégrée à l'Afrique-Occidentale française avec une portion de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger. Kayes devient son chef-lieu pour laisser la place, en 1907, à Bamako.
an 1895 : Sénégal - Création du Gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française (A.O.F.).
Emprisonnement de Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis (août) puis déportation au Gabon.
an 1895 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1895, le territoire, baptisé « Rhodésie » en l’honneur de Cecil Rhodes, est administré complètement par la BSAC.
an 1896 : Haute -Volta future Burkina Faso - A partir de 1896, les Français entreprennent la conquête du territoire car les royaumes Mossi sont affaiblis, et ils craignaient l'arrivée des britanniques.
Le royaume mossi de Ouagadougou devient un protectorat français. En 1898, la majeure partie de la région correspondant à l'actuel Burkina Faso est conquise.
an 1896 : Érythrée - L'avancée italienne en Éthiopie est arrêtée à la bataille d'Adoua en 1896.
an 1896 - 1930 : Mayotte - Période coloniale
Le 30 mars 1896, le protectorat s'étend sur l'ensemble de l'archipel, Mamoudzou en devient la capitale. Le 9 avril 1908, Mayotte, au statut de colonie, et les trois îles comoriennes, au statut de protectorat, sont rattachés au gouvernement général de Madagascar. Le 25 juillet 1912, la France confirme par une loi la précédente annexion de l'ensemble de l'archipel. Celui-ci est désormais placé sous la dépendance administrative régionale de Madagascar. Désormais Mayotte n'est qu'une des quatre îles des Comores sous la vaste égide malgache. Noyé au sein de l'immense gouvernement français de Madagascar, les Comores souvent méconnues sont oubliées pendant l'apogée coloniale française des années 1930, alors que la réalité du pouvoir passe par les intérêts des comptoirs des puissantes sociétés commerciales, telle la société coloniale homonyme du lieu de sa fondation Bambao, sur l'ile d'Anjouan.
Confrontés à une baisse de leurs revenus avec l'effondrement de l'industrie sucrière, les domaines mahorais prennent en partie modèle sur les pratiques culturales des populations mahoraises les plus modestes qui marquent les zones habitées, par des champs de manioc environnés de bananiers et de cocotiers. La distillation traditionnelle par alambic de plantes à parfum les incite à étendre les cultures traditionnelles de basilic, de citronnelle, de palmarosa ou commencer la culture d'ylang-ylang. Pour cette culture, Denis de Bellemare importe dans son domaine de Kangani en 1905 des plants de Cananga odoranta, dont il adapte la pratique culturale sous forme de sarments développés par contrainte en branches tordues à hauteur d'homme.
Pendant toute la première moitié du XXe siècle, un état de déréliction s'installe durablement sur tout l'archipel ; de nombreux Comoriens quittent leur contrée natale pour gagner les côtes de l'Afrique ou Madagascar et y tenter leur chance, parfois avec succès, créant une diaspora dans tout l'océan Indien occidental. Pourtant beaucoup reviennent avec en tête l'utopie nationaliste. Ils se sentent frustrés de toutes les commodités d'un progrès inenvisageable dans leur pays figé dans des structures qui ont résisté tant bien que mal aux dernières offensives colonialistes des années 1930.
an 1896 : Rwanda - En 1896, se déroule le coup d'État de Rucunshu, avec l'assassinat de Mibambwe IV (1895-1896), puis l'intronisation de Yuhi V (roi de 1896 à 1931).
an 1896 : Soudan - En 1896, un corps expéditionnaire anglo-égyptien du général Kitchener s’empare de Dongola. Cette intervention britannique s'explique par plusieurs éléments, notamment : l'impact de la mort du général Charles Gordon dans l'opinion publique au Royaume-Uni, l'intérêt de plusieurs puissances coloniales pour la vallée du Nil, l'importance du contrôle des eaux dans cette région, la montée du mouvement libéral et l'influence des milieux de la finance en Angleterre.
an 1897-1917 : Afrique République de Djibouti - La construction, entre 1897 et 1917, du chemin de fer entre Djibouti et Addis-Abeba ajoute une nouvelle dimension au territoire, en le consacrant comme une porte maritime de l'Éthiopie moderne.
Durant la Première Guerre mondiale, la colonie reste très largement en dehors du conflit, en particulier il ne s'y déroule pas d'événement militaire. La colonie est en «état de siège» à partir du 5 août 1914. À partir de 1916, des navires patrouillent en mer Rouge jusqu'au début de 1918. La principale activité militaire est l'engagement de tirailleurs.Profitant ensuite de l'expansion économique qu'apporte le chemin de fer, le port se développe et la ville se bâtit peu à peu. Des ouvriers somalis et afars, construisent ces maisons qui constituent le cœur de la « ville européenne » et que l'on peut encore admirer, conservées dans leur esthétique originelle.
an 1897 : Réunion (Ile de la) - 173 190 habitants
an 1897 : Soudan - Les troupes du général Kitchener s'emparent, en 1897, d'Abu Hamad, puis de Berber.
an 1898 : Oubangui-Chari Centrafrique - Après la mort de Rabah, vaincu à Kousseri en 1898 par les Français, les territoires colonisés sont partagés en circonscriptions administratives, le Chari étant joint à l’Oubangui, base de la future Centrafrique.
an 1898 : Afrique République de Djibouti - En 1898 fut créée la colonie sous le nom de Côte française des Somalis.
an 1898 : Guinée équatoriale - Pendant la guerre hispano-américaine de 1898, l'occupation militaire américaine de la colonie espagnole est relative, l'intérêt des Américains se portant sur les colonies de l'Espagne, vaincue, hors de l'Afrique : Philippines, Guam, Cuba et Porto Rico.
an 1898 - 1905 : Mauritanie - Vers 1898, Ma El Aïnin (1831-1910) construit un ribat à Smara, d'où il lance un appel à la guerre sainte contre les colonisateurs. Armé et financé par le sultan du Maroc Moulay Abdelaziz en échange de la reconnaissance de la souveraineté de celui-ci sur le Sahara occidental et la Mauritanie et ne cessa de se battre contre la présence européenne en Mauritanie et au Sahara occidental.
Vers 1905, il envoie un de ses fils dans l'Adrar mauritanien afin d'y mener la résistance contre les Français et il est peut-être à l'origine de l'assassinat à Tidjikdja de Xavier Coppolani, le commissaire français de Mauritanie (12 mai 1905). La mort de Coppolani désorganise l'avancée française mais ne l'arrête pas.
an 1898 : Soudan - Les troupes du général Kitchener écrasent le 2 septembre 1898 les mahdistes à Omdurman, près de Khartoum, où 10 000 soudanais sont fauchés par les mitrailleuses britanniques. « Les milliers de mahdistes mourants ou blessés sur le champ de bataille ne reçurent aucun soin des Britanniques, qui leur tournèrent le dos et s'en allèrent ». « Ils demandaient de l'eau et appelaient à l'aide, mais nos officiers les repoussèrent avec mépris », relata un soldat britannique.
Quelques jours plus tard, le 18 septembre 1898, commence une confrontation avec des troupes françaises, appelée incident franco-britannique de Fachoda, mais l'affrontement est évité et les deux puissances coloniales conviennent de zones d'influences réciproques entre d'une part l’Égypte et le Soudan et d'autre part le Soudan français devenu depuis le Mali. Abdallahi ibn Muhammad, successeur du Mahdi, meurt le 25 novembre 1898.
an 1899 : Afrique du Sud - Motivée en partie par ces mines d'or, la Seconde guerre des Boers (1899-1902) et l'annexion du Transvaal et de l'État libre d'Orange consacre la domination britannique sur la majeure partie de l'Afrique australe, au prix de l'internement et de la mort de milliers de civils boers dans des camps de concentration britanniques.
En septembre 1899, après l'échec d'ultimes tentatives de médiation du président Marthinus Steyn de l'État libre d'Orange, le Ministre britannique des colonies, Joseph Chamberlain, envoie un ultimatum à Kruger, exigeant la complète égalité de droits pour les citoyens britanniques résidant au Transvaal, ce que celui-ci ne pouvait accepter. C'est en connaissance de cause que Kruger lance, en retour, son propre ultimatum avant même d'avoir reçu celui de Chamberlain. Il fixe un ultimatum aux Britanniques pour évacuer leurs troupes des frontières du Transvaal, ou la guerre leur sera déclarée en accord avec leur allié, l'État libre d'Orange. La guerre est ainsi déclarée le 12 octobre 1899.
En dépit des victoires remportées lors des premiers combats, du siège de Mafeking, de celui de Kimberley et du siège de Ladysmith, les Boers ne peuvent résister bien longtemps et les capitales des deux républiques sont occupées dès l'été 1900 par une armée britannique suréquipée et renforcée par les contingents envoyés des quatre coins de l'Empire, dont l'Australie et le Canada. Mais les succès de la guérilla qui se développe immédiatement dans le pays, prolongent la guerre encore deux années. Désarçonné, le commandement britannique fait placer les civils boers dans des camps de concentration et leurs serviteurs noirs dans d'autres, où la malnutrition et les maladies sont fréquentes. Ils brûlent les fermes et les récoltes afin de couper les combattants de leurs bases et de leur retirer le support populaire dont ils bénéficient. Le sort des civils boers est alors dénoncé par une infirmière britannique, Emily Hobhouse qui fait vigoureusement campagne dans l'opinion en leur faveur. Le gouvernement britannique diligente une commission d'enquête, sous la responsabilité de Millicent Fawcett, qui, non seulement confirme les accusations d'Emily Hobhouse, mais formule aussi de nombreuses recommandations, telles que l'amélioration du régime alimentaire et des équipements médicaux. L'impopularité de la guerre oblige le gouvernement britannique à envisager des négociations. Au total, 136 000 boers accompagnés de 115 000 de leurs serviteurs noirs et métis sont internés dans les camps de concentration ; cela coûte la vie à plus de 28 000 blancs, essentiellement des femmes, des personnes âgées et des enfants, et 15 000 noirs et métis.
an 1899 : Burundi - À partir de 1899, les forces allemandes infligent de lourdes pertes aux armées du roi mais sans parvenir à la victoire. Elles soutiennent alors l'un des beaux-fils du roi, Maconco, dans une révolte contre le souverain, ce qui contraint Gisabo à leur faire allégeance pour maîtriser l'insurrection.
an 1899 : Congo Brazzaville - Dès 1899, le territoire est cédé à des compagnies concessionnaires, qui versent un impôt à l’administration française. Ces compagnies exploitent majoritairement le caoutchouc. Elles reçoivent pour trente ans, d’immenses domaines variant entre 200 000 et 14 millions d’hectares. Lesdites compagnies doivent verser 15 % de leurs bénéfices comme impôts à l’administration française. Elles exploitent les ressources naturelles de la colonie comme le sucre, le caoutchouc, l’ivoire ou le bois précieux. Le principal défenseur de ce système économique est Eugène Étienne, alors sous-secrétaire d’État aux colonies. Un autre sous-secrétaire d’État aux colonies, Théophile Delcassé, accorde discrètement, sans publication officielle du contrat, une concession de 11 millions d’hectares (soit 1/5 de la France), située dans le Haut-Ogooué. Puis, de mars à juillet 1899, le ministre des Colonies Guillain accorde, par décret, quarante concessions au Congo français, comme l'indique le rapport Brazza. De nombreuses compagnies concessionnaires sont aux mains de nombreux actionnaires, dont Léopold II de Belgique qui achète des actions sous un faux nom. Ce fait, découvert après la mort du souverain belge, choque beaucoup les autorités françaises de l’époque, qui doivent constater que leur colonie est exploitée par un pays étranger.
an 1899 : Guinée équatoriale - En 1899, les Américains renoncent définitivement à annexer la colonie espagnole du golfe de Guinée, qui avait à leurs yeux des mauvaises infrastructures, des pistes mal entretenues et trop de maladies tropicales endémiques. La colonie était alors peuplée majoritairement de Bubis dans l'île de Fernando Poo et d'Ekangs dans le territoire continental du Rio Muni.
an 1899 : Nigéria - Période britannique (1800-1960) - Le protectorat britannique (1900-1914)
En 1899, le gouvernement britannique rachète la compagnie du Niger et procède aux transferts de compétence pour créer le Niger Coast Protectorate comprenant le delta du Niger rattaché à la région du Bas-Niger. L'ensemble est rebaptisé protectorat du Nigeria du Sud. Le nom de Nigeria en référence au fleuve Niger et qui signifie « noir » est préféré à celui de "Negretia" et à celui de "Goldésie" après que George Goldie eut refusé que son patronyme soit donné au territoire.
an 1899 : Togo - Togoland - Un territoire au nord, qui avait longtemps été disputé par l'Empire britannique et l'Empire allemand, fut déclaré neutre par le traité de Samoa en 1899. C'est le territoire de Salaga. L'Empire allemand étendit progressivement sa zone d'influence à l'intérieur des terres. Les colons allemands apportèrent le savoir-faire et implantèrent des cultures (cacao, café et coton), tout en développant des infrastructures à l'un des niveaux les plus élevés d'Afrique à cette époque. En raison du fait qu'elle était devenue la seule colonie allemande auto-suffisante, le Togoland était considéré comme un modèle. Cette situation perdura jusqu'au début de la Première Guerre mondiale.
an 1899 : Soudan - En 1899, un condominium anglo-égyptien sur le Soudan est établi. Le statut juridique adopté est hybride et inédit, mais il présente pour l'Angleterre plusieurs avantages : elle a de facto le contrôle du pays, elle ne supporte pas les charges financières liées à son administration, et elle évite une annexion qui aurait tendu les relations avec l’Égypte, la France et la Turquie. Les deux premiers gouverneurs généraux sont le général Kitchener, puis Francis Reginald Wingate.
Fin XIXème siècle :
XXème siècle : Bénin (anc. Dahomey) - La colonie du Dahomey - Au début du XXe siècle, les trois royaumes cessent d'être autonomes et sont confondus dans un ensemble divisé en cercles gérés par des administrateurs et cantons gérés par des chefs africains. Pendant la Première Guerre mondiale, des troubles éclatent dans le nord du pays après l'envoi de troupes autochtones sur le front européen. À la fin de la guerre, la colonie se structure : les moyens de communication se développent, la production agricole se rationalise et la scolarisation augmente. Sous l'influence de missions catholiques et protestantes d'une part, de l'enseignement laïc d'autre part, un enseignement primaire et secondaire se met en place. Intégrés dans l'Afrique-Occidentale française (AOF), les Dahoméens entrent dans la fonction publique et servent dans d'autres territoires de la fédération ; le pays est alors souvent qualifié de Quartier latin de l'Afrique.
XXème siècle : Liberia - Au début du XXe siècle, près d'un tiers du budget de l’État libérien provient de la taxe des travailleurs africains, dont l'élite elle-même ne s’acquitte pas. Cette situation entraine des soulèvements réprimés avec violence. Lourdement endetté, le Liberia reste aligné sur Londres, Paris et Washington pour les questions de natures diplomatiques. Le pays connait une reprise économique dans les années 1920 grâce à la vente des propriétés allemandes confisquées pendant la guerre.
an 1900 : Algérie - Au début du XXe siècle, plusieurs dirigeants algériens revendiquent le droit à l'égalité ou à l'indépendance. Plusieurs partis vont être créés et plusieurs pamphlets seront écrits pour défendre les droits des Algériens. Plusieurs penseurs algériens vont vilipender les plus importantes personnalités du régime colonial français.
La plupart des figures du mouvement algérien vont être surveillées de près par les services policiers français, et d'autres exilées vers d'autres pays comme l'émir Khaled el-Hassani ben el-Hachemi en Égypte puis en Syrie.
Ben Badis d'après Bachir Yellès.
Les précurseurs de l'indépendance, Messali Hadj, Malek Bennabi82, Mohamed Hamouda Bensai, Ben Badis, Mohamed Bachir El Ibrahimi, Fodil El Ouartilani, Larbi Tébessi, Ferhat Abbas..., divergeront souvent sur la question algérienne, provoquant l'émergence de plusieurs associations et partis algériens : Parti de la réforme ou Mouvement pour l'égalité, Association des oulémas musulmans algériens, association de l'Étoile nord-africaine, Parti du peuple algérien, Amis du Manifeste des Libertés, Parti communiste algérien, etc.
an 1900 : Mauritanie - Vers 1900, l'émir de l'Adrar Mokhtar Ould Aïda ne cessait de guerroyer contre la présence française en Mauritanie et arrivait à capturer beaucoup de prisonniers. Ces derniers avait le choix entre la mort ou être livrés au Sultan du Maroc. Le Sultan Moulay Abdelaziz est alors encore écouté et obéi jusqu'au fleuve Sénégal et à Tombouctou.
an 1900 : Mozambique - Le bilan de ces compagnies est décevant. Les politiques, visant à l’enrichissement de la métropole portugaise et des colons européens, ont tendance à négliger le développement des infrastructures sociales (dispensaires, écoles) et de l’équipement du pays. Un accord inter-étatique est même conclu entre le Portugal et l'union d'Afrique du Sud, afin de permettre le recrutement de travailleurs migrants mozambicains dans les mines du Transvaal.
En fait, seule la compagnie de Mozambique développe des infrastructures, notamment la ligne de chemin de fer reliant Beira à Salisbury, achevée en 1900. C'est aussi cette compagnie qui développe la culture commerciale de la canne à sucre, le sucre devenant la principale exportation du Mozambique.
an 1900 : Réunion (Ile de la) - La première automobile arrive dans l'île
an 1900-1920 : Somalie - En 1900, il annexe l’Ogaden, région désertique de l’ouest qui fait encore l’objet périodiquement de conflits territoriaux entre les deux États.
La résistance somalienne à la colonisation commence sérieusement en 1899 derrière Mohammed Abdullah Hassan, issu de la tribu Darod et du sous-clan Dulbahante par sa mère. Leurs cibles principales sont leurs ennemis héréditaires d’Éthiopie et l’administration britannique, qui contrôle les ports les plus lucratifs et prélèvent des taxes auprès des paysans qui envoient leur bétail à leurs clients au Moyen-Orient et en Inde. Brillant orateur soutenu par les derviches fondamentalistes issus de sa lignée maternelle, Hassan mène une guérilla sanglante pendant deux décennies, jusqu’à ce que la Royal Air Force britannique bombarde la région en 1920. Hassan prend la fuite et meurt d’une pneumonie peu de temps après, devenant une figure héroïque du nationalisme somalien. Ce conflit est l’une des plus longues et des plus sanglantes guerres de résistance en Afrique subsaharienne, qui coûte la vie à près d’un tiers de la population du nord de la Somalie.
Les Dhulbahante sont alors les seuls à avoir refusé de signer le traité de protectorat et de se soumettre à la Grande-Bretagne : ils se voient comme les garants de la grande Somalie. Toutefois, même si les Isaaq, les Issas, les Warsangali et les Gadabuursi aient signé sans opposé de résistance, la Grande-Bretagne ne leur fait pas confiance, et invoque immédiatement l’article 7 du traité, qui lui permet d’instaurer une politique de ségrégation. Elle fait également usage de la sous-section 3k qui l’autorisa à retirer un certain nombre d’enfants de leurs mères pour leur inculquer une éducation spécifique – avant tout pour inspirer une certaine crainte parmi la population. Certains chefs tribaux en viennent à regretter de ne pas avoir soutenu la guérilla des Dhulbahante.
an 1900-1908 : Soudan - Le mouvement mahdiste reste une force religieuse et politique vivace et mène des soulèvements, notamment en 1900, 1902, 1903, 1904 et 1908. En 1906, une émeute arabe éclate à Talodi, dans les monts Nouba, suivie d'une répression brutale. Dans le Sud du Soudan, une résistance est conduite par le peuple nuer, vivant dans les territoires arrosés par le Sobat et le Nil blanc.
an 1901 : Ghana - Les colonisateurs fixent dès 1901 les frontières du Ghana : le territoire Ashanti et le nord du pays, annexé à partir de 1896, furent soumis et rattachés à la colonie.
an 1901-1906 : Nigéria - Période britannique (1800-1960) - Le protectorat britannique (1900-1914)
Le territoire du Nigeria du Nord est alors administré par Lugard en tant que haut-commissaire britannique avec pour mission de faire accepter des traités d'allégeance aux sultans de Sokoto et de Fula. En 1901, le territoire de Nigeria du Nord est placé sous l'autorité du Royaume-Uni. L'esclavage, qui y était encore pratiquée par les tribus locales, est immédiatement aboli. En 1903, la région est entièrement soumise en dépit de quelques soulèvements sporadiques impitoyablement réprimés par les troupes de Lugard.
En 1906, la colonie de Lagos est intégrée au protectorat du Protectorat du Nigeria du Sud dont elle devient la capitale administrative.
an 1901 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
En 1901, l'archipel reçoit la visite de Charles Ier, roi de Portugal et son épouse.
an 1901 : Réunion (Ile de la) - L'île exporte 41 500 tonnes de sucre.
an 1901 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1901, une division administrative est créée entre les territoires du nord du Zambèze, baptisés Rhodésie du Nord, et ceux au sud, baptisés Rhodésie du Sud.
an 1902 : Afrique du Sud - Démoralisés, désorganisés et dispersés, les combattants boers finissent par être acculés. Leur commandement se résigne alors à négocier un traité de paix qui est signé à Pretoria, le 31 mai 1902, le traité de Vereeniging. En plus des pertes civiles dans les camps de concentration, 22 000 Britanniques et soldats de l'Empire ainsi que 4 000 combattants boers sont morts, auxquels s'ajoutent de nombreuses pertes parmi les Noirs et les Métis engagés au côté des deux armées.
Vaincus, humiliés et ruinés, les Boers se retrouvent dans une détresse totale à la fin de la guerre ; ils perdent aussi leurs républiques, et deviennent des sujets britanniques. Si plus de 50 000 uitlanders se retrouvent privés d'emplois, 200 000 réfugiés, Noirs et Blancs, affectés par la guerre, se retrouvent entassés dans des conditions de vie très précaires et misérables. Le souvenir des milliers de civils morts dans les camps de concentration britanniques alimente pendant très longtemps la rancune, voire la haine, d'une partie des Afrikaners (tels qu'ils seront désormais appelés) contre le Royaume-Uni et leurs propres concitoyens d'origine britannique, même si Londres multiplie les gestes d'ouverture à leur égard, en supprimant notamment la loi martiale, en rapatriant les prisonniers déportés à Ceylan et Sainte-Hélène, et en investissant plus de seize millions de livres sterling dans les régions dévastées.
an 1902 : Sénégal - Retour d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba.
an 1903-1914 : Afrique du Sud - Sur à peu près quatre millions et demi d'habitants en 1904, un million de personnes est d'origine européenne, dont plus de deux tiers sont afrikaners.
À l'instar des blancs, organisés dans des partis politiques à dominante ethno-linguistique (Het Volk, Orangia uni et Afrikaner Bond pour les Afrikaners du Transvaal, de la colonie de la rivière Orange et du Cap, Unionistes pour les anglophones), les populations de couleur commencent à s'organiser aussi sur des bases ethniques. En 1902, l'African people organisation (APO) voit le jour au Cap. Très majoritairement coloured (métis), présidé par Abdullah Abdurahman (1872-1942), un petit-fils d'esclave, il prône des « droits égaux pour tous les hommes civilisés ». Au Natal, les indiens sont regroupés dans le congrès indien du Natal (1894), fondé par un jeune avocat, Gandhi. Sous sa direction, jusqu'à son départ pour l'Inde en 1914, la minorité indienne est mobilisée dans une lutte non violente pour le respect de ses droits dans une forme de résistance appelée satyagraha (« fermeté dans la vérité »). En 1906, éclate au Natal une dernière rébellion tribale, la Rébellion Bambatha. Une pétition contre les laissez-passer, lancée par le Congrès des Indigènes du Transvaal, est adressée au gouvernement de Londres ; elle reste sans réponse. C'est durant cette parenthèse coloniale de l'Afrique du Sud entièrement britannique, que la ségrégation à grande échelle se met en place sous l'ère d'Alfred Milner, alors haut-commissaire à l'Afrique du Sud, avec la création de la commission inter-coloniale des affaires indigènes sud-africaines présidée par Godfrey Lagden (1851-1934). Cette commission, composée uniquement de britanniques, pose comme principe la supériorité intellectuelle des Blancs afin de proposer plusieurs plans concernant les futures relations raciales dans un pays unifié. L'une de ses propositions est notamment d'établir des réserves indigènes à travers tout le territoire sud-africain.
Au lendemain de la seconde Guerre des Boers, les républiques boers annexées par la Grande-Bretagne sont conjointement gérées par le Colonial Office, aux côtés des colonies britanniques du Cap et du Natal. Après avoir accordé la formation de gouvernements autonomes et l'élection de parlements au Transvaal et dans la colonie de la rivière Orange, le gouvernement britannique décide d'unifier politiquement les quatre colonies pour créer un dominion, à partir des modèles canadiens et australiens. Cette volonté coïncide avec les aspirations des populations boers. Une Convention nationale sud-africaine est réunie, à Durban, à partir de 1908. Au bout de trois sessions, qui se tiennent à Bloemfontein et au Cap, la convention achève ses travaux le 11 mai 1909 sur un projet d'Union Sud-Africaine, proposée ensuite aux assemblées législatives du Transvaal et de l'Orange, qui l'approuvent à l'unanimité, ainsi qu'à l'assemblée de la colonie du Cap alors qu'au Natal, les trois quarts des électeurs donnent leur assentiment au cours d'un référendum. Le projet est ensuite présenté au gouvernement britannique, qui le soumet sous forme de projet de loi au parlement britannique. L’administrateur Alfred Milner est un des personnages qui a joué un rôle important dans la création de l’Union avant son départ en 1905. Son argument principal pour cette union entre les 4 états était que « [l’union] éliminerait la compétition économique entre eux »
Exclues des négociations commencées à Durban, les élites bantoues du pays, souvent formées au sein des missions anglicanes, se réunissent à Bloemfontein en mars 1909, pour participer à une convention indigène, première manifestation nationale d'une résistance politique noire au pouvoir blanc. Sous la conduite de William Philip Schreiner, ancien premier ministre de la colonie du Cap, les représentants des Bantous et des Métis, viennent à Londres pour exposer leurs doléances, sans succès. Le projet de loi, nommé South Africa Act, donne la souveraineté interne en instituant en Afrique du Sud un régime parlementaire, sur le modèle du système de Westminster, est voté par le Parlement britannique le 20 septembre 1909. Son entrée en vigueur est prévue pour le 31 mai 1910. À cette date anniversaire de la fin de la guerre des Boers, la Colonie du Cap, rassemblée avec le Griqualand, le Stellaland et le Béchuanaland britannique, devient la nouvelle province du Cap et forme l'Union d'Afrique du Sud, aux côtés des provinces du Natal, du Transvaal et de l'État libre d'Orange. La capitale administrative de l'Union est fixée à Pretoria. Le siège du parlement est au Cap, et le siège de la cour suprême est à Bloemfontein. L'anglais et le néerlandais sont les langues officielles du parlement. Le pays est doté d'armoiries qui figurent sur le drapeau officieux d'Afrique du Sud, le Red Ensign.
Cette constitution permet aux Afrikaners de reprendre en main le pouvoir politique, à l'échelle d'un grand pays composé de quatre provinces distinctes.
La constitution de 1910 permet également aux anciennes républiques boers de continuer d'appliquer un système électoral ségrégationniste favorable ainsi aux Afrikaners du Transvaal et de l’Orange, tandis que, dans la colonie du Cap, les coloured et les noirs, représentant alors 15 % du corps électoral, exercent leur droit de vote sous conditions censitaires.
C’est dans ce cadre que les Afrikaners, vaincus militairement, dominés économiquement par la minorité anglo-sud-africaine, s'attellent à la conquête du pouvoir politique.
an 1903 : Burundi - L'Afrique orientale allemande, établie en 1891, annexe officiellement le Burundi et les petits royaumes adjacents sur les rives orientales du lac Tanganyika le 6 juin 1903.
an 1903 : Congo Brazaville - En 1903, le Congo Français devient territoire du Moyen-Congo.
an 1903 : Sénégal - Cheikh Ahmadou Bamba exilé vers la Mauritanie.
an 1904 : Archipel des Comores - En 1904 le rattachement juridique officiel se fait entre les îles. Il est suivi, le 9 avril 1908, d’un second décret rattachant officieusement Mayotte et ses dépendances à Madagascar, rattachement officialisé le 25 juillet 1912.
an 1904-1905 : Maroc - Crise de Tanger
En 1904, un accord conclu entre les partenaires de l'Entente cordiale, la France et le Royaume-Uni, laisse à la France le Maroc comme zone d'influence, le Royaume-Uni se concentrant sur l'Égypte ; le nord du Maroc est concédé à l'Espagne. Grâce à cet accord, la France a toute liberté d'agir au Maroc ; en échange, elle concède aux Britanniques le droit d'instaurer leur tutelle sur l'Égypte où la France conservait de fortes positions économiques et financières, dont la présidence de la Compagnie du Canal de Suez. Un accord similaire avait été conclu avec l'Italie en 1902, qui accordait une totale liberté d'action aux Italiens contre les Turcs en Libye en échange de leur désintéressement du Maroc. L'empereur Guillaume II et le chancelier Bülow protestent contre les ambitions de la France au Maroc. Conformément à sa nouvelle doctrine de Weltpolitik, l'Allemagne veut avoir sa part des conquêtes coloniales, notamment en Afrique subsaharienne, en Chine, dans l'Empire ottoman, et au Maroc où réside une colonie germanique influente (dont font partie par exemple les frères Mannesmann, propriétaires du groupe industriel éponyme ainsi que d'un important patrimoine foncier dans l'arrière-pays de Fédala).
Le 31 mars 1905, en vue de prévenir la mainmise de la France sur le Maroc, Guillaume II débarque théâtralement à Tanger, traverse la ville à cheval, à la tête d'un imposant cortège, va à la rencontre du sultan Abd al-Aziz pour l'assurer de son appui et lui faire part de son désaccord face aux droits concédés à la France sur le Maroc. Il est prêt à entrer en guerre si la France ne renonce pas à ses ambitions marocaines. Le sultan Abd el-Aziz impressionné par ce discours décide de refuser toutes les réformes préconisées par l'ambassadeur Eugène Regnault. La France hésite, mais ne s'estimant pas prête pour la guerre, accepte la demande d'arbitrage de l'Allemagne. Ce « coup de Tanger » entraîne une poussée de germanophobie en France et la démission du ministre français des Affaires étrangères, Théophile Delcassé.
an 1904-1908 : Namibie - La colonisation allemande (1884-1920)
Le génocide des Héréros et des Namas (1904-1908)
Le 10 janvier 1904 marque le début du soulèvement herero commandé par le chef Samuel Maharero. Witbooi, chef du peuple nama, se joint aux insurgés qui harcèlent les fermiers allemands et détruisent les infrastructures.
En 1904, le lieutenant-général Lothar von Trotha, nommé commandant en chef des troupes de la colonie allemande, prend la relève du gouverneur Theodor Leutwein avec pour mission d'en finir avec la révolte des Héréros. Il remporte une victoire décisive à la bataille de Waterberg, le 11 août 1904, qui se solde par le massacre des Héréros, non seulement guerriers mais aussi femmes et enfants. Les actions de von Trotha révulsent l'opinion publique allemande. Il est finalement démis de son commandement.
Mais les survivants hereros et leurs alliés namas ont été parqués dans des camps de concentration ou servent de main-d'œuvre à bon marché ; beaucoup meurent de malnutrition ou de maladie. La population héréro, estimée à 80 000 âmes avant le début de la guerre, est réduite à 15 000 individus en 1911. Quelque 10.000 Namas ont également été tués. La population humaine totale de la colonie avoisine désormais les 100 000 habitants.
an 1904 : Sénégal - Dakar devient capitale de l’A.O.F.
an 1905 : République de Centrafrique - l'Oubangui-Chari devient une colonie française, dont la population est exploitée.
an 1905 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
En 1905, les Allemands de la "Madeira Aktiengesellschaft", dirigée par le prince Friedrich Karl Hohenlohe-Öhringen, lancent la construction à Madère de Hospital dos Marmeleiros, sanatorium pour soigner gratuitement une quarantaine de tuberculeux de la population locale. L'exemption fiscale dont les Allemands disposeraient entraîne un conflit diplomatique avec les Anglais qui exigent l'équivalent pour leurs projets d'intérêt public. Le projet allemand se double d'hôpitaux modernes, mais le contrôle des plans semble indiquer des établissements de luxe, plus adaptés dans l'hypothèse d'une colonisation. La découverte d'armes et de munitions provoque la confiscation de tous les biens allemands à Madère en 1914. La construction est interrompue, s'achève en 1930, sous le nom d'hôpital Santa Casa da Misericórdia de Funchal.
an 1905 : Mauritanie - Vers 1905, Ma El Aïnin envoie un de ses fils dans l'Adrar mauritanien afin d'y mener la résistance contre les Français et il est peut-être à l'origine de l'assassinat à Tidjikdja de Xavier Coppolani, le commissaire français de Mauritanie (12 mai 1905). La mort de Coppolani désorganise l'avancée française mais ne l'arrête pas.
an 1906-1908 : Éthiopie - La défaite d'Adoua ne met pas entièrement fin aux ambitions des puissances coloniales qui à défaut d'occupation du pays optent pour un choix de pénétration économique. Le 13 décembre 1906 est signé à Londres un accord entre la France, l'Angleterre et l'Italie qui, tout en reconnaissant l'indépendance de l'Éthiopie dans ses premiers articles, traduit de l'autre côté cette nouvelle orientation politique de l'Europe : en cas d'évènements intérieurs à l'Éthiopie, les puissances coloniales s'attribuent elles-mêmes des « sphères d'influences ». Sir John Harrington, représentant anglais en Éthiopie, fait « campagne pour remettre la construction de la voie ferrée entre les mains d'une compagnie internationale », par ailleurs si « le chemin de fer restera français, les intérêts étrangers sont officiellement reconnus dans son administration qui se doit de comprendre un Anglais, un Italien et un représentant de Menelik ». Pour De Marinis, député italien, il s'agit d'enfermer l'Éthiopie dans « un cercle de fer » au moyen d'une « politique pacifique de conquête ».
Ménélik est frappé de deux crises d'apoplexie en 1908 et n'est plus en mesure d'assurer le pouvoir.
an 1906-1907 : Gabon - Charles Noufflard (1906-1907). — Né à Louviers (département de l'Eure, France) où il exploita une usine d'apprêt de draps, Charles Noufflard (1872-1952) était en 1905 secrétaire général des colonies, et exerçait la fonction de lieutenant-gouverneur par intérim du Gabon. Amené à intervenir pour réprimer une révolte des Noirs qui avaient tué un collecteur d'impôts, il se rendit alors sur les lieux, sans escorte militaire, parlementa avec les mutins, et finit par les apaiser. Charles Noufflard devint gouverneur du Gabon de 1906 à 1907. Il fut par la suite gouverneur au Congo, aux Nouvelles-Hébrides, au Dahomey (aujourd'hui le Bénin) et au Togo.
an 1906 : Lesotho - À partir de 1906, le Lesotho fut administré avec les protectorats du Swaziland et du Bechuanaland par la même administration coloniale sous l'autorité d'un seul et même haut-commissaire britannique. Les chefs traditionnels gardaient néanmoins de larges pouvoirs. Cependant, les efforts de développement coloniaux furent quasiment inexistants, le seul objectif des Britanniques étant de maintenir la paix civile en attendant un hypothétique rattachement des trois territoires à l'Afrique du Sud.
an 1906-1909 : Maroc - Du 7 janvier au 6 avril 1906, à la suite de l'affaire de Tanger, se tient à Algésiras, au sud de l'Espagne, une conférence internationale sur le Maroc afin d'apaiser les tensions entre les différentes puissances qui se disputent le pays. Elle rassemble les principaux pays européens (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Autriche-Hongrie, Espagne, Russie, Suède, Belgique, Portugal, Pays-Bas) ainsi que les États-Unis. Cette conférence confirme l'indépendance de l'Empire chérifien, mais rappelle le droit d'accès de toutes les entreprises occidentales au marché marocain, et reconnaît à l'Allemagne un droit de regard sur les affaires marocaines.
Toutefois, au grand dam de Guillaume II, la France et l'Espagne se voient confier la sécurité des ports marocains et un Français est chargé de présider la Banque d'État du Maroc. La police franco-espagnole des ports, dirigée par un officier helvétique, est créée officiellement pour assurer l'ordre dans l'ensemble des ports marocains ouverts au commerce extérieur. En 1909, l'Espagne étend sa zone d'influence sur tout le Rif, afin de contrôler ses mines de fer. Les troupes du général Diaz-Ordonez se heurtent néanmoins à une résistance efficace des tribus locales menées par le Chérif Améziane. Les Espagnols cherchent alors au Maroc un terrain d'expansion pour compenser la perte de leurs dernières colonies (Cuba, Porto Rico, Philippines, Guam) à la suite de leur guerre contre les États-Unis.
an 1906 : Mauritanie - En 1906, lors de la Conférence d'Algésiras aperçu d'un compte rendu: «[...] C'était pour appuyer les prétentions du Sultan que nous avions fait venir les délégués des tribus citées plus haut et qui firent leur soumission à Cheikh Ma El-Aïnin et au Sultan; ces tribus ont donc déclaré qu'elles étaient de sujets marocains, et qu'elles avaient trouvé dans des livres que Moulay Ismaïl était descendu jusqu'à Saint-Louis (Sénégal) limite de ses États vers le sud».
La même année Moulay Abdelaziz envoie un agent à lui, Moulay Idriss ainsi que des contingents marocains pour prêcher la guerre sainte contre les Français : « C'est avec ces contingents qu'il put créer une longue agitation dans l'Adrar et jusque dans le Tagant, pillant les populations qui nous étaient soumises, prêchant la guerre sainte contre les Français au nom de son maître le Sultan du Maroc. Cet agitateur avait même l'audace, l'année dernière, d'envoyer au gouverneur de la Mauritanie, au nom de Ma-el-Aïnin représentant de Moulay Abd-el-Aziz, un « ultimatum », lui enjoignant de reculer les limites des possessions françaises jusqu'aux bords du Sénégal et de reconnaître la souveraineté du Sultan du Maroc jusque sur la rive droite de ce fleuve.».
an 1907-1921 : Éthiopie - Conscient de la crise de succession qui se prépare, Menelik II a désigné son petit-fils ledj Iyassou à sa succession, en 1907 ; Itege Taytu Betul tente, en vain, de s'arroger le pouvoir, dans un contexte d'affaiblissement d'un Negusse Negest devenu malade. Le conseil des ministres met fin à l'incertitude en 1909 en écartant Taytu et Iyassou est porté au pouvoir à la mort de Menelik II en décembre 1913, sans être jamais couronné.
À peine a-t-il accédé au trône que le jeune prince agace rapidement la noblesse éthiopienne, attachée à sa culture chrétienne ; plus encore, son rapprochement avec la Turquie ottomane inquiète Anglais et Français en ce début de Première Guerre mondiale. En 1915, Iyassou offre un drapeau éthiopien orné d'inscriptions musulmanes, symbolisant le serment qu'il fait aux Éthiopiens musulmans d'amener l'égalité religieuse au sein de l'Empire. Plus généralement Iyasou cherche à donner aux musulmans un droit de complète égalité religieuse. Il rompt aussi la tradition en attribuant des responsabilités à de jeunes intellectuels non issus du rang des notables. Ses ambitions, ainsi que son goût pour « le vin, la musique et les femmes » déplaisent aux notables de l'Empire éthiopien. Par ailleurs, les pays de l'Entente (France, Royaume-Uni, Italie), inquiets du positionnement du jeune souverain (notamment son opposition à l'accord tripartite et sa politique anticolonialiste en soutien aux Somalis et Afars) exercent des pressions sur le conseil des ministres.
Ainsi, le 27 septembre 1916, l'évêque d'Éthiopie, l'abuna Mattéwos, cède à la demande des notables conservateurs et autorise la noblesse à rompre le testament de Menelik II : Iyassou est écarté du pouvoir et toute personne le soutenant, menacée d'excommunication.
Une guerre civile s'ensuivit lors de laquelle, avec l'appui français notamment, les partisans du coup d'État repoussent les attaques de Ras Mikael, père d'Iyassou, fait prisonnier peu après. Iyassou, en fuite dans le nord-est du pays, est capturé en 1921 seulement.
À la suite du coup d'État, Zewditou, fille de Menelik II, est proclamée Nigiste Negest, et Ras Tafari Makonnen comme héritier du trône. En cette période d'occupation coloniale du reste du continent, Zewditou est ainsi la première femme chef d'État d'un pays indépendant.
an 1907-1953 : Malawi - Le protectorat du Nyasaland (1907-1964)
Ce n'est qu'en juillet 1907 que le Nyassaland devient officiellement un protectorat britannique appelé un temps protectorat britannique d'Afrique centrale.
Les colons ne se précipitent pas au Nyassaland, lui préférant le Kenya ou la Rhodésie du Sud pour développer les plantations de tabac et d'arachides. C'est pourquoi les plantations de tabac, la principale culture du Nyassaland, sont lentes à se développer.
La plus sérieuse rébellion contre l'ordre établi eut lieu en janvier 1915. Les fidèles de l'Église évangélique du pasteur John Chilembwe, adversaire de la colonisation, tentent alors de prendre d'assaut le dépôt d'armes de Blantyre et de s'en prendre aux plantations. Après 15 jours de rébellion, le mouvement est réprimé et Chilembwe est abattu lors de sa fuite.
En 1927, le recensement dénombre alors seulement 1 700 Blancs pour 1 350 000 Africains (99,6 %). La discrimination raciale existe peu en comparaison avec les autres colonies ou protectorats britanniques voisins. Si les Africains doivent présenter un laissez-passer lors de leurs déplacements, ils ne sont pas soumis à de mesures discriminatoires dans les banques, les administrations, les bureaux de poste ou dans les magasins de Blantyre et de Zomba, les deux plus importantes villes du protectorat. En conséquence de ce peu d'attrait du Nyassaland sur les immigrants européens, la politique indigène diffère des colonies voisines. Les chefs traditionnels constituent un relais et un appui essentiel du colonisateur. En 1933, les responsables administratifs locaux sont à leur tour intégrés dans un conseil des chefs afin d'être associés aux prises de décisions.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une élite africaine, formée en Europe et aux États-Unis, commence néanmoins à se montrer active sur le plan politique. En 1944, le Congrès africain du Nyasaland est fondé, regroupant des intellectuels sur une base pluriethnique.
Le territoire reste sous-développé par rapport aux colonies voisines et de nombreux ressortissants partent chercher du travail dans les Rhodésies ou en Afrique du Sud.
En 1949, les Africains obtiennent leur droit de représentation au Conseil législatif du Nyassaland (ils étaient jusque-là représentés par les mian 1901 : Réunion (Ile de la) - ssionnaires) mais celui-ci n'est effectif qu'en 1953, année où entre en fonction la fédération de Rhodésie et du Nyasaland, largement rejetée par les Africains du Nyassaland.
an 1907 : Mali - Kayes devient son chef-lieu pour laisser la place, en 1907, à Bamako
an 1907 : Réunion (Ile de la) - Saint-Gilles brûle entièrement.
an 1908-1960 : Congo Kinshasa (Zaïre) - En 1908, le Parlement belge reprend la tutelle sur le territoire désormais appelé Congo belge. Une colonisation plus « classique » se met en place. Un ministre des Colonies est institué tandis qu'un gouverneur général est installé sur place, à Boma. Un réseau d'établissements sanitaires permet de faire reculer les maladies et la malnutrition. L'enseignement est développé notamment par les missionnaires protestants et catholiques. Mais le pays est mis en exploitation, avec notamment la découverte des ressources minières du Katanga. Le travail forcé, en particulier dans les mines, persiste sous diverses formes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). S'agissant de l'éducation, comme l'explique un recueil destiné aux fonctionnaires de la colonie, l'objectif consiste à « toucher [...] la personnalité intime de l'indigène, à transformer sa mentalité, à le rallier dans son for intérieur à l'ordre social nouveau ».
Les Congolais s'acculturent à l'Europe par l'intermédiaire des missions qui établissent des écoles et des chapelles à travers le pays, par l'incorporation dans l'armée (la Force publique) ou par le travail de boy (serviteur) pour les Blancs. En travaillant dans les mines, sur les chantiers de chemin de fer ou dans les plantations, ils découvrent le salariat alors que l'économie domestique était principalement fondée sur le troc.
Le contrôle de la population se structure, ayant notamment recours au fichage ethnique et à des méthodes d'apartheid. Les Blancs ne vivent pas dans les mêmes quartiers que les Noirs. Ces derniers ne peuvent pas entrer dans la police ou dans l'enseignement. Une émancipation de la population, notamment par l'accès à des études supérieures, n'est envisagée qu'à l'aube de l'indépendance en 1960. À cette date, il n'y a aucun médecin ou juriste congolais. Toutefois, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale émerge la classe des évolués, des Congolais instruits, salariés, citadins, dont le mode de vie ressemble à celui d'un Européen. C'est parmi eux que se trouveront les leaders de la lutte pour l'indépendance : Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Moïse Tshombe...
Lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, la Force publique participe à la campagne victorieuse contre l'Afrique orientale allemande. La Belgique récupère par conséquent le protectorat sur le Ruanda-Urundi. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Force publique remporta un certain nombre de victoires sur les troupes italiennes en Afrique du Nord. Le Congo belge fournit aussi le minerai d'uranium extrait de la mine de Shinkolobwe et employé pour les bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. Les États-Unis négocient un droit de préemption sur l’uranium de la colonie pour le développement de leur armement nucléaire. Avant l'indépendance, le pays compte 14 000 km de voies ferrées et une centaine de centrales électriques ou à charbon. Il est un des principaux producteurs au monde de cuivre et de diamant.
an 1908-1912 : Maroc - La politique menée par Abd al-Aziz conduit le pays à une quasi-faillite financière, et accélère le processus de domination précoloniale puis coloniale qui sera confirmé durant le court règne de Moulay Abd el-Hafid entre 1908 et 1912, qui se conclura par la mise en place d'un protectorat franco-espagnol sur l'Empire chérifien.
an 1908-1914 : Namibie - La colonisation allemande (1884-1920)
Le début de l’exploitation économique (1908-1914)
En 1908, les premiers diamants sont découverts dans la baie de Lüderitz. Le Sud-Ouest Africain cesse dès lors d'être la plus pauvre des colonies allemandes.
Les premières lois ségrégationnistes sont votées la même année : interdiction des mariages entre noirs et blancs, réglementation à l'accès des écoles en fonction de la couleur de peau, mise en place d'un laissez-passer pour les noirs âgés de plus de huit ans, obligation d'une autorisation spéciale de l'administration pour permettre à un noir de posséder des terres, du bétail, des chevaux ou des armes.
En 1909, le protectorat du Sud-Ouest Africain obtient un statut d'autonomie. Des municipalités sont constituées à Windhuk, Karibib, Keetmanshoop, Lüderitz, Okahandja, Omaruru, Swakopmund et Warmbad. Le réseau ferroviaire se développe pour atteindre 2 100 km à la veille de la Première Guerre mondiale. Les colons allemands s'efforcent alors de créer un pays à l'image de la mère patrie en dépit de l'immensité désertique du sud-ouest africain et parviennent à marquer durablement l’urbanisme local.
En 1914, les colons allemands sont au nombre de 13 000 individus, représentant alors 83 % de la population blanche (15 700 personnes). Environ 1 000 fermiers possèdent à eux seuls 13 millions d'hectares.
an 1908 : Sénégal - Voyage du Ministre français des Colonies, Raphaël Milliès-Lacroix, à la côte d’Afrique.
an 1909 : Canaries (Îles des) - Catastrophes naturelles : éruption du volcan Chinyero (1909).
an 1910 : Réunion (Ile de la) - Incendie du lycée de La Réunion, l'actuel lycée Leconte de Lisle, reconstruit.
an 1910 : Togo - En matière de formation scolaire, le Togo allemand met en place des écoles gérées par des missions catholiques et protestantes. Vers, 1910, le pays compte 163 établissements scolaires évangéliques et 196 catholiques. Les catholiques ont aussi créé un centre de formation pour les enseignants.
Les missionnaires, tant catholiques que protestants, privilégient également l'enseignement «en langue indigène» pour mieux convertir les «païens» à leur religion. Par exemple, la Mission de Brême assure l'enseignement primaire entièrement en éwé, tandis que la formation supérieure est surtout dispensée en anglais, très rarement en allemand. Ainsi, dans l'ensemble, les missionnaires n'imposent jamais la langue allemande. L'influence de la langue allemande demeure presque nulle chez les Togolais. Les missionnaires de Brême favorisent aussi l'émergence d'une littérature en langue ewé.
an 1911 : Réunion (Ile de la) - création du musée des Beaux-Arts, l'actuel musée Léon Dierx.
an 1912 : Canaries (Îles des) - Le 11 juillet 1912, une « loi des conseils insulaires » (Ley de Cabildos) est adoptée : les îles doivent constitutionnellement être administrées par leurs propres conseil de gouvernement (Cabildos).
an 1914 - 1916 : Madagascar - Durant la Première Guerre mondiale29, les autorités françaises enrôlent 41 000 Malgaches dans des unités combattantes et 2 400 meurent au combat. Parmi les survivants, certains étaient porteurs de la grippe espagnole qu'ils propagent en revenant à Madagascar provoquant la disparition de plusieurs dizaines de milliers de personnes, en particulier sur les hautes terres dont une multitude de villages allaient être désertés. Entretemps apparut, en 1915, un premier mouvement de résistance, celui des VVS (Vy Vato Sakelika) qui subit aussitôt une violente répression. Ce mouvement nationaliste se développa ensuite vers la fin des années vingt sous l’impulsion de Ralaimongo et de Ravoahangy (Ligue malgache pour l'accession des indigènes de Madagascar à la citoyenneté française). Ses méthodes restèrent toutefois légalistes, malgré la constance de la répression.
an 1914-1920 : Namibie - La colonisation allemande (1884-1920) - La première guerre mondiale
La Première Guerre mondiale va mettre fin au protectorat allemand sur le Sud-Ouest Africain en dépit du soutien aux Allemands de plusieurs milliers de combattants de la Seconde Guerre des Boers et de l'appel à la neutralité du général Koos de la Rey.
En effet, le premier ministre sud-africain Louis Botha confirme l'engagement de son gouvernement au côté du Royaume-Uni contre l'Allemagne. La principale mission confiée aux troupes sud-africaines est de combattre dans les colonies allemandes d'Afrique, principalement le Sud-Ouest Africain et le Tanganyika.
Militairement, la situation des Allemands est préoccupante du fait que leurs adversaires disposent d'une nette supériorité militaire et de la maîtrise des mers. Frontalière de possessions britanniques, la colonie ne peut être ravitaillée que par l'Angola, possession portugaise neutre dans le conflit avec qui les bonnes relations sont primordiales.
Les premiers engagements commencent dès août 1914 quand des patrouilles allemandes et sud-africaines s'affrontent à Kummernais. D'autres escarmouches ont lieu début septembre à Nakop et Beenbreck. À Sandfontein, les troupes allemandes remportent leur première victoire sur les Sud-Africains.
En octobre 1914, une petite expédition allemande chargée d'aller chercher des vivres en Angola est interceptée par une patrouille portugaise. À la suite d'une méprise, les Portugais ouvrent le feu et tuent la plupart des Allemands. Au lieu d'essayer de comprendre les raisons de l'incident, les autorités allemandes déclenchent des opérations de représailles contre l'Angola, qui culminent le 18 décembre avec le combat de Naulila, au cours duquel les troupes portugaises sont sévèrement défaites. La conséquence en est cependant l'isolement du Sud-Ouest africain alors que les Sud-Africains s'apprêtent à lancer une grande offensive.
Lors de la bataille de Gibeon, les 25 et 26 avril 1915, les troupes sud-africaines remportent une victoire décisive contre l'armée allemande qui perd le quart de ses effectifs et toute son artillerie.
Le 9 juillet 1915, elle est définitivement vaincue à Khorab par le corps expéditionnaire britannico-sud-africain. Les 1 552 soldats allemands sont internés à Aus alors que les réservistes sont autorisés à regagner leurs fermes.
Le 6 février 1917, le dernier royaume Ovambo indépendant est annexé au Sud-Ouest Africain.
Lors de la signature du traité de Versailles, l'Allemagne renonce définitivement à ses colonies. Le Sud-Ouest africain allemand a vécu.
an 1914 : Nigéria - Période britannique (1800-1960) - La colonie britannique (1914-1960)
Le Nigeria du Nord et celui du Sud sont groupées dans la nouvelle colonie du Nigeria en 1914. Son premier gouverneur est alors Frederick Lugard. Sur le plan administratif, le pays reste toutefois divisé entre les provinces du Nord et du Sud. L'éducation occidentale et les entreprises se développent beaucoup plus rapidement au Sud qu'au Nord, créant ainsi un clivage Nord/Sud qui va perdurer.
an 1914-1918 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Madère entre en guerre en 1916, après déclarations de guerre croisées. Comme l'archipel est une position stratégique pendant la Première Guerre mondiale, il est bombardé par les sous-marins allemands, avec destruction de trois navires. La bataille de Funchal a lieu en décembre 1916.
Le 12 décembre 1917, Funchal est à nouveau bombardé par deux sous-marins allemands.
Charles Ier, dernier empereur d'Autriche, renonce au trône le 11 novembre 1918, s'exile (Autriche, Suisse) avant d'être capturé en Hongrie, remis aux Anglais, qui lui permettent de rejoindre Madère en novembre 1921 ou il décède quelques mois d'hiver plus tard en 1922, de bronchite aiguë.
an 1914 : Réunion (Ile de la) - Election législative la plus sanglante de La Réunion (14 morts, 300 blessés). Les Créoles participent à la Grande Guerre.
an 1914 - 1919 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - La Première Guerre mondiale et ses conséquences
Le conflit mondial qui oppose les grandes puissances européennes à partir de 1914 touche logiquement l’Afrique de l’est puisque deux des principaux protagonistes de la guerre sont présents dans la région.
Les Britanniques ont l’avantage de contrôler l’accès maritime. Ils massent leurs troupes sur les îles de Zanzibar et Pemba, et, au sud du Kenya, à Mombasa et Nairobi. Mais les Allemands vont opposer jusqu’à 1916 une résistance farouche et efficace. En septembre 1914, le croiseur léger Königsberg coule près de Zanzibar un important navire anglais, le Pegasus. Le navire allemand, pourchassé par la Royal Navy, se fait oublier en se cachant un peu plus au sud dans un delta de la rivière Ujiji. Il faudra 10 mois aux Britanniques pour le retrouver et en venir à bout.
Plus au nord et à l’intérieur du continent, des combats ont lieu sur les grands lacs. Le général à la tête de l’armée allemande dans la région, Paul von Lettow-Vorbeck, mène la vie dure aux alliés. Les Britanniques sont sévèrement battus à Tanga et Jassin, attaqués à Mombasa, et de manière générale harcelés par les Allemands qui adoptent une véritable stratégie de guérilla.
À partir de 1916, la situation s’améliore pour les alliés. Il faut dire que les soldats allemands sont isolés de la mère patrie et que le haut commandement allemand a d’autres priorités que de soutenir de manière importante ses troupes d’Afrique de l’est.
Le 8 mai 1916, Kigali, dans l’actuel Rwanda, est pris aux Allemands, puis quelques mois plus tard Kigoma et Ujiji sur les bords est du lac Tanganyika. Enfin, le 19 septembre, les alliés s’emparent de Tabora, jusqu’alors capitale militaire des Allemands.
Après la réussite de quelques contre-offensives, les Allemands sont définitivement battus à la fin de l’année 1917.
La guerre a complètement stoppé les projets de développement et d’aménagement que les Allemands avaient entrepris en Afrique de l’est. À la fin des hostilités, le pays se retrouve avec une administration totalement démantelée et une économie au point mort. Pour subsister, les populations africaines retrouvent un temps leurs anciens modes de vie.
En 1919, à la suite du Traité de Versailles, les alliés se répartissent le contrôle des territoires de l’ancienne « Ost-Afrika » allemande. Le Royaume-Uni se voit confier le mandat de ce qui est désormais officiellement appelé le Tanganyika. Les Belges récupèrent eux le « Ruanda-Urundi » (aujourd’hui le Rwanda et le Burundi). On estime alors à 3 500 000 personnes la population du Tanganyika.
an 1914 : Togo - En 1914, aucune langue africaine ne peut faire état d'une littérature imprimée aussi abondante que l'éwé.
Les autorités allemandes tentent bien d'organiser le partage de la nouvelle colonie entre les missions chrétiennes et de n'autoriser que la présence de missionnaires de nationalité allemande, mais elles se désintéressent rapidement de la question scolaire. En 1913, on ne compte que quatre écoles publiques (Regierungschulen), qui rassemblent 341 élèves, comparativement à 348 écoles confessionnelles qui en reçoivent plus de 14 000.
Après le début de la Première Guerre mondiale, une opération conjointe franco-britannique force les Allemands, retranchés à Atakpamé (capitale de la région des Plateaux), à capituler dès le mois d'août 1914. Le gouverneur allemand Adolphe-Frédéric de Mecklembourg (1912-1914) doit quitter le Togo, de même que le vicaire apostolique, Mgr Wolf (qui reste de jure en poste jusqu'en 1921).
Après la défaite des Allemands contre les Français et les Britanniques le 26 août 1914 à Kamina, le Togo est partagé entre les deux puissances victorieuses le 27 août 1914. Un second partage a ensuite lieu le 10 juillet 1919 à Londres, car selon la France, le premier partage n'était pas équitable. Le Togo devient alors un mandat de la Société des Nations (SDN), partagé entre la partie française (à l'est appelée le « Togo français » ou Togoland oriental) et la partie britannique (à l'ouest appelée le « Togoland britannique »). Le Togo français obtint une superficie de 56 000 km², le Togo britannique, 33 900 km².
Par crainte que les Togolais ne restent loyaux à l'Allemagne, les Français font en sorte de supprimer toute trace de la colonisation allemande. Tout en appliquant un régime plus souple, ils réduisent à néant l'influence des Togolais instruits par les Allemands et interdisent l'usage de la langue allemande, notamment aux missionnaires alsaciens et lorrains. Le français devient la langue officielle du Togo et l'enseignement public se fait seulement dans cette langue.
À l'inverse des Allemands qui n'avaient pas défini, ni appliqué une politique linguistique réellement coercitive, les Français imposent sans ambiguïté la langue française. Dès 1915, l'allemand est interdit dans leur zone, puis c'est le tour de l'anglais à partir de 1920. L'arrêté de 1922, qui organise le secteur scolaire public et assure le contrôle des écoles confessionnelles, impose le français comme seule langue admise dans les écoles. Publié dans le Journal Officiel du Togo, son article 5 stipule cette disposition sans équivoque : « L'enseignement doit être donné exclusivement en français. Sont interdits les langues étrangères et les idiomes locaux ».
an 1915-1921 : Kenya - Sur le modèle de l'Afrique du Sud, l’administration coloniale britannique impose en 1915 l'obligation pour tous les noirs de plus de quinze ans de porter en permanence autour du cou un certificat prouvant leur identité et leur emploi. En 1920, le gouverneur fait augmenter l’impôt par tête pour contraindre les Kikuyus à s'engager comme salariés agricoles auprès des colons et ainsi pouvoir payer. Toutefois, quand en 1921 les colons réduisent les salaires des ouvriers indigènes d'un tiers, des manifestations et des grèves se déclenchent. Le 16 mars, 57 manifestants sont abattus et les dirigeants des associations nationalistes sont arrêtés puis déportés.
an 1916 : Burundi - En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, les troupes belges débarquent dans la région.
an 1916 : Libye - En 1916, l'Italie ne contrôle qu'une partie des grandes villes libyennes.
an 1916 : Rwanda - En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, dans le cadre de la liquidation de l'Empire colonial allemand, les Belges chassent les Allemands du Rwanda ou Ruanda-Urundi, et occupent à leur tour le pays.
an 1916 : Sénégal - Les habitants des «Quatre Communes» (Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis) reçoivent la citoyenneté française. Envoi des premiers élus à la Chambre des députés.
an 1916 : Soudan - En 1916, le dernier sultan du Darfour, Ali Dinar (en), resté neutre par rapport à l'Empire britannique, doit faire face à une attaque de l'armée anglaise, qui anticipe une hypothétique alliance entre ce sultan et les Empires centraux, pour déstabiliser les positions britanniques en Afrique durant la Première Guerre mondiale. Ali Dinar est battu et tué. C'est la fin de l'indépendance du Darfour.
an 1917-1930 : Éthiopie - L'impératrice Zewditou (1917-1930)
Zewditou est couronnée Negiste Negest, le 11 février 1917. Au fur et à mesure de son règne, des différences de plus en plus grandes finissent par apparaître avec son héritier désigné, Tafari Mekonnen.
Tafari cherche à « moderniser » le pays croyant en la nécessité de s'ouvrir vers les Alliés pour pouvoir faire survivre le pays. Il est soutenu dans cette voie par les jeunes de la noblesse. Un collège moderne, Tafari Makonnen, une imprimerie et un hebdomadaire diffusant la voie du pouvoir sont créés à cette époque.
Zewditou a, elle, une vision plus conservatrice. Veillant à la mémoire de son père, Menelik II, et croyant en la nécessité de préserver avant tout la tradition éthiopienne, elle reçoit un très fort soutien de l'Église orthodoxe éthiopienne. Zewditou s'occupe ainsi principalement des activités religieuses, en faisant construire de nombreuses églises, et se détourne peu à peu des activités purement politiques, en laissant un pouvoir accru à Tafari sur ces sujets.
L'Éthiopie entre ainsi, sous l'impulsion de Tafari Makonnen, à la Société des Nations le 28 décembre 1923. Tafari s'emploie à consolider les relations internationales afin de préserver l'indépendance du pays. Pour les conservateurs, il s'agit d'une aliénation de l'Empire. Plusieurs tentatives, venant notamment de ces conservateurs, ont lieu pour écarter Tafari du pouvoir, mais finissent par échouer : coup d'État éthiopien de 1928.
En 1930, Gougsa Wellé, époux de Zewditou, mène une rébellion dans le Bégemeder, espérant mettre fin à la régence, particulièrement dans la province de Qwara. Il est battu et trouve la mort au combat à la bataille d'Anchem (en) le 31 mars 1930.
Deux jours plus tard, le 2 avril, Zewditou s'éteint. Selon la croyance populaire, Zewditou est morte du choc et du chagrin de la mort de son époux, pour d'autres, elle était alors agonisante et il est peu probable qu'elle ait été informée du sort de son époux, pour d'autres enfin elle fut alors empoisonnée par son médecin grec. Les spéculations sur la cause de sa mort continuent encore de nos jours.
an 1917 : Liberia - Le Liberia s'était proclamé neutre au début de la Première Guerre mondiale. Mais le blocus de l'Empire allemand par les Alliés et la guerre sous-marine que les Allemands leur opposaient réduisirent à néant le commerce extérieur de ce petit pays d'Afrique occidentale provoquant une grave crise financière et économique. Espérant se faire bien voir des États-Unis dont il voulait obtenir un prêt, le Libéria rompit ses relations diplomatiques avec l'Allemagne le 5 mai 1917 (en raison de son isolement la nouvelle ne fut connue en Europe et à New York que le 9 mai). Le 4 août 1917, il lui déclara la guerre sans l'intention de la mener, le but étant de s'emparer des biens des ressortissants allemands relativement nombreux car l'Allemagne était le premier partenaire du Libéria avant 1914 (la nouvelle ne fut connue en Europe et à New York que le 7 août). Le
10 avril 1918, un sous-marin allemand pénétra dans le port de Monrovia, coula l'unique navire de la marine libérienne (un voilier), bombarda la ville dans le but de détruire les stations de radio et du télégraphe tuant plusieurs civils puis quitta la place quand un bateau à vapeur britannique alerté par radio s'approcha.
an 1918-1925 : Cameroun - Après la Première Guerre mondiale, pendant laquelle le Cameroun est conquis par les forces franco-britanniques, la colonie allemande est partagée en deux territoires lors d'une rencontre entre les generaux francais et britanniques le 04 mars 1916 à Londres où une partie est confiée à la France (pour les quatre cinquièmes) et l'autre au Royaume-Uni, confirmé par des mandats de la Société des Nations (SDN) en 1922( Saïd Selassié Npeyou). Pendant les vingt premières années, la France s'emploie notamment à liquider les rébellions de populations Kirdi dans le nord du Cameroun. Si la pacification de cette région s'accompagne de massacres et de pillages récurrents, la France, à la différence de l'Allemagne, pratique aussi une politique d'assimilation à l'instar de ce qui se passe dans ses autres colonies.
L'administration française, réticente à rétrocéder aux compagnies allemandes leurs possessions d'avant guerre, en réattribue certaines à des compagnies françaises. C'est notamment le cas pour la Société financière des caoutchoucs, qui obtient des plantations mises en exploitation pendant la période allemande et devient la plus grande entreprise du Cameroun sous mandat français. Des routes sont construites pour relier les principales villes entre elles, ainsi que diverses infrastructures telles que ponts et aéroports. La ligne de chemin de fer Douala-Yaoundé, commencée sous le régime allemand, est achevée. Des milliers d'ouvriers sont déportés de force vers ce chantier pour y travailler cinquante-quatre heures par semaine. Les ouvriers souffrent également du manque de nourriture et de la présence massive de moustiques. En 1925, le taux de mortalité sur le chantier s'élève à 61,7 %. Les autres chantiers ne sont cependant pas aussi meurtriers, bien que les conditions de travail y soient généralement très dures.
an 1919 : Algérie - Charles Jonnart, gouverneur général de l'Algérie pour la troisième fois depuis 1881, fait voter plusieurs réformes en faveur des Algériens musulmans, adoptées avec la loi du 4 février 1919, dite « loi Jonnart ».
an 1919-1937 : Burkina Faso (anc. Haute-Volta) - Colonie de la Haute-Volta - Un décret du 1er mars 1919 crée la colonie de la Haute-Volta, par partition de la colonie du Haut-Sénégal et Niger. Son territoire recouvre les cercles de Gaoua, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ouagadougou, Dori, Say et Fada N'Gourma. Son chef-lieu est Ouagadougou. Elle est administrée par un gouverneur, portant le titre de lieutenant-gouverneur, assisté d'un secrétaire général et d'un conseil d'administration.
En 1927, le cercle de Say est rattaché à la colonie du Niger.
Un décret du 5 septembre 1932 supprime la colonie de la Haute-Volta et répartit son territoire entre les colonies du Niger, du Soudan français et de la Côte-d'Ivoire.
Les cercles de Tenkodogo, Kaya, Ouagadougou, Koudougou, Gaoua, Batié et Bobo-Dioulasso ainsi qu'une partie du cercle de Dédougou — boucle de la Volta Noire — sont incorporés à la colonie de la Côte-d'Ivoire (2 011 916 habitants sur 153 650 km². Les cercles de Fada N'Gourma et Dori — moins le canton d’Aribinda — sont incorporés à la colonie du Niger (278 512 habitants sur 67 850 km²). Les cercles d'Ouahigouya — plus le canton d’Aribinda — et de Dédougou — subdivision de Tougan et rive gauche de la Volta Noire — sont incorporés à la colonie du Soudan français (708 501 habitants sur 50 700 km²).
Un décret du 13 juillet 1937 crée la région de la Haute-Côte-d'Ivoire.
La création de nouvelles infrastructures politiques contribuent à associer les autochtones à la gestion du territoire. Les premiers conseils municipaux sont élus, ainsi qu'une Assemblée territoriale. Des représentants sont envoyés auprès du Parlement métropolitain (à l'Assemblée nationale : Gérard Ouédraogo, Joseph Conombo, Nazi Boni, Henri Guissou, Mamadou Ouédraogo), de l'Assemblée de l'Union française et du Grand Conseil de l'AOF. Le 31 mars 1957, la nouvelle Assemblée territoriale est élue au suffrage universel, et désigne un gouvernement de douze membres. Ouezzin Coulibaly, député de Côte d'Ivoire mais originaire de Haute-Volta, est élu vice-président, puis président de ce gouvernement, mais meurt le 7 septembre 1958. Maurice Yaméogo (1921-1993), soutenu par Félix Houphouët-Boigny3 et l'UDV (Union démocratique voltaïque) lui succède. Le 17 octobre, le Mogho-Naaba fait rassembler plusieurs centaines de personnes devant le palais de l'Assemblée territoriale, en vue d'établir une monarchie constitutionnelle, sans succès.
an 1919-1923 : Burundi - Au sortir de la guerre, l'Allemagne perd toutes ses colonies et, lors de la conférence de Versailles en 1919, le royaume de Belgique obtient un mandat sur la province du Ruanda-Urundi, constituée des Rwanda et Burundi actuels, mandat renouvelé par la Société des nations en 1923. Les royaumes bordant la rive orientale du Tanganyika sont, quant à eux, attribués au protectorat du Tanganyika administré par le Royaume-Uni. La Belgique administre le territoire de manière indirecte, en s'appuyant sur l'aristocratie tutsi.
an 1919-1938 : Libye - Le 1er juin 1919, le parlement italien vote une loi fondamentale proclamant la République de Tripolitaine, État disposant d'une autonomie partielle par rapport à l'Italie, sur les territoires de l'ouest. Il s'agit là du premier État islamique au monde à disposer d'un gouvernement républicain et de la première entité libyenne indépendante depuis la chute de l'Empire ottoman. Une loi similaire est votée pour l'Émirat de Cyrénaïque, reconnaissant à Idris, chef de la Famille al-Sanussi, le titre d'émir. Mais les accords ne sont pas respectés, et dès 1921, Giuseppe Volpi est nommé gouverneur de la Tripolitaine, qui repasse sous contrôle italien. Après l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini, des opérations militaires sont entreprises pour pacifier le pays, le général Emilio De Bono remplaçant Volpi dans cette optique : fin 1922, l'émir Idris s'enfuit de Cyrénaïque, où ses partisans continuent la résistance; à la fin 1927, le Golfe de Syrte est intégralement occupé. La Libye italienne est désormais composée de la colonie de Tripolitaine et de celle de Cyrénaïque. En 1927 est créée une « citoyenneté italienne libyque », qui donne un statut aux indigènes, en les maintenant néanmoins dans une position sociale inférieure à celles des Italiens de la métropole. Le maréchal Pietro Badoglio est nommé en 1929 gouverneur des deux colonies, avec pour vice-gouverneur le général Rodolfo Graziani, qui achève les opérations de reconquête dans le Fezzan en 1929 et 1930. Mais en Cyrénaïque, le cheikh Omar Al Mokhtar, soutenu par les Sanussi, continue de mener la résistance contre les Italiens : il n'est capturé qu'en 1931.
Après l'exécution d'Omar Al Mokhtar, la Libye est soumise, mais économiquement ruinée, la guerre ayant détruit l'équilibre agro-pastoral du pays. La colonisation reste très faible jusqu'au début des années 1930. La nomination en 1934 d'Italo Balbo au poste de gouverneur de Libye vient donner une impulsion nouvelle au territoire. Le 9 juin 1934, la Libye italienne se voit dotée d'une administration unifiée. Balbo fait construire un réseau routier, rénove les villes et développe la colonisation par la création de nouveaux villages de colons, auxquels sont attribués des lopins agricoles. La colonisation s'accélère, certaines estimations évoquant une population d'environ 100 000, voire 120 000, colons italiens en Libye à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les Italiens développent également les fouilles archéologiques en Libye.
La Libye connaît à partir de 1938 un regain de tension, dû au rapprochement de l'Italie avec l'Allemagne nazie. Les frontières de la Libye avec le Protectorat français de Tunisie, le Royaume d'Égypte et les colonies françaises en Afrique ont été délimitées par une série de traités entre 1910 et 1935, mais un nouveau litige a lieu en 1938 avec la France au sujet de l'attribution à la Libye d'une bande de terre de 1 200 km au nord du Tibesti. Dans un contexte de tensions internationales renforcées, la proximité de la Libye italienne avec le Protectorat français de Tunisie suscite des inquiétudes de part et d'autre.
an 1919-1922 : Rwanda - En 1919, le Traité de Versailles attribue le Rwanda à la Belgique, en 1922 la Belgique instaure un protectorat, qui s'appuie sur la minorité Tutsi, la classe dominante traditionnelle.
an 1919 - 1964 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Le Tanganyika britannique : 1919-1964
Le premier gouverneur britannique de la Tanganyika est Sir Horace Byatt (en), de 1920 à 1924. Le pays qu’il doit administrer est économiquement exsangue et totalement désorganisé, et le Royaume-Uni ne fournit qu’un faible soutien financier. La première préoccupation du gouverneur est de sécuriser la situation des populations africaines. En 1923, il prépare une ordonnance qui vise à s’assurer que les droits fonciers des populations africaines sont respectés. Il s’attire les foudres d’une partie des colons britanniques qui souhaiteraient une politique qui leur soit plus favorable, comme au Kenya par exemple.
Sir Donald Cameron (en), gouverneur de 1925 à 1931, cherche à imprimer un nouveau dynamisme au pays. Le principe clé de sa politique part du concept de « gouvernement indirect » (indirect rule en anglais), déjà expérimenté par les Britanniques au Nigeria. Cette politique consiste, pour administrer et diriger le pays, à s’appuyer sur les structures politiques traditionnelles existantes et à agir presque en conseiller auprès des autorités indigènes, plutôt que de traiter ces dernières comme de simples agents administratifs subordonnés aux ordres centralisés venant des Européens. Sir Donald Cameron, qui conçoit le rôle des Britanniques comme étant de créer les conditions d’un transfert progressif de la responsabilité du pays aux Africains, met aussi l’accent sur l’éducation, qui voit son budget augmenté.
Le 18 juin 1926 est créé un conseil législatif, composé de 20 membres nommés par le gouverneur.
Sur le plan économique, le gouverneur s’active pour faire avancer des projets de développement. En 1928, il obtient du gouvernement britannique l’approbation et le soutien financier pour un projet de prolongement de la ligne centrale de chemin de fer de Tabora à Mwanza. La politique du gouverneur vis-à-vis des colons propriétaires terriens est plus accommodante, car Cameron a besoin de leur soutien politique et ils sont une importante contribution à l’économie de la Tanganyika.
Mais la Tanganyika bute tout de même sur un désintérêt global du Royaume-Uni pour cette colonie, handicap auquel s’ajoute la crise financière de 1929 qui a pour conséquence de freiner brutalement les projets de développement économique dans le pays.
À partir des années 1920, il est à noter que les Britanniques font venir de nombreux Indo-pakistanais au Tanganyika. Pour occuper des postes dans l’administration et participer aux constructions d’infrastructures, cette population immigrée présente en effet l’avantage d’être généralement plus instruite que la moyenne des Africains et est parfaitement anglophone.
Beaucoup restèrent définitivement en Afrique de l’est, et, au départ des Britanniques, se convertirent dans le commerce. Encore aujourd’hui, la plupart des commerces de certaines grandes villes tanzaniennes sont tenus par des Indo-pakistanais.
Dans le même temps, les conditions d’une future autonomie politique émergent progressivement dans la société. Des coopératives de producteurs agricoles indépendants se forment et en 1929 est créée l’association africaine de Tanganyika (TAA) par l’élite africaine du pays dont le niveau d’instruction monte.
Les années 1930 sont difficiles pour le Tanganyika. Le pays doit faire face à une importante crise économique et le Royaume-Uni ne fait pas de gros efforts financiers pour compenser le manque de ressources locales. Le financement du système éducatif est notoirement insuffisant et, régulièrement, le gouverneur fait appel aux missionnaires religieux pour assurer l’existence et le fonctionnement des écoles, le salaire d’un enseignant religieux étant beaucoup plus faible que celui d’un enseignant fonctionnaire britannique.
De plus, durant cette période, des rumeurs circulent qui prétendent que le Tanganyika va être rétrocédé à l’Allemagne hitlérienne. L’incertitude qui en découle freine les projets et les prises d’initiatives.
Après la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle le Tanganyika est utilisé par les Britanniques comme centre de production de certaines matières premières et cultures utiles aux approvisionnement de l’effort de guerre (café – caoutchouc), l’Organisation des Nations unies nouvellement créée met en place un système de mise sous tutelle pour les populations qui ne s’administrent pas encore elles-mêmes. Ainsi en décembre 1946, l’ONU confie-t-il la tutelle du Tanganyika au Royaume-Uni, avec comme perspective de parvenir à l’autodétermination et à l’indépendance. Il faudra une quinzaine d’années pour que cela soit le cas.
an 1920-1922 : Ghana - Une partie du Togo allemand, peuplée par les Éwé, fut ajoutée au Ghana en 1922. Dans les années 1920, la « Côte de l'Or » devient la colonie africaine la plus prospère grâce à sa contribution majeure à l'histoire de la culture du cacao, et aux exploitations minières. Les Anglais construisent les premières écoles du pays, celles-ci seront peu nombreuses. L’anglais devient la langue officielle, mais les langues locales sont tolérées par les autorités coloniales dans les écoles primaires, l’anglais restant la principale langue d’enseignement.
an 1920 - 1946 : Madagascar - À partir de 1920, le plan Albert Sarraut permet de réaliser des équipements d'infrastructure : 14 500 km de réseau routier, aménagement des ports de Tamatave détruit en 1927 et de Diego-Suarez, ajout de voies ferrées vers Antsirabé et Lac Alaotra (1923) et ligne Fianarantsoa-Manakara (1936). Les investissements privés suivent dans le domaine agricole (café, riz, vanille, girofle), minier (graphite, mica) et industriel (rizeries, sucreries, conserveries, travail du bois). Ces transformations entraînent l'insertion de la Grande Ile dans les circuits économiques internationaux et des mutations importantes de la société malgache.
La période coloniale est toutefois accompagnée de mouvements de lutte pour l'indépendance : les Menalamba, les Vy Vato Sakelika, le Mouvement démocratique de la rénovation malgache (MDRM). En 1927, d’importantes manifestations sont organisées à Antananarivo, notamment à l'initiative du militant communiste François Vittori, emprisonné à la suite de cette action. Les années 1930 voient le mouvement anti-colonial malgache gagner encore en dynamisme. Le syndicalisme malgache commence à apparaître dans la clandestinité et le Parti communiste de la région de Madagascar se constitue. Mais dès 1939, toutes les organisations sont dissoutes par l’administration de la colonie, qui opte pour le régime de Vichy. Le MDRM est lui accusé par le régime colonial d'être à l'origine de l'insurrection de 1947 et sera poursuivi par de violentes répressions.
Durant la Seconde Guerre mondiale, en mai 1942, Madagascar est envahi par les troupes britanniques, ce qui achève de miner le prestige de la France aux yeux des indigènes, même si le pouvoir est remis aux représentants de la France libre. Les hostilités entre Britanniques et Français vichystes ne cessent qu'en novembre 1942 : ce n'est que trois mois plus tard, en janvier 1943, que le pouvoir est ensuite remis au général Paul Legentilhomme, représentant de la France libre. Les Malgaches contribuèrent ensuite à l'effort de guerre en maintenant la production du riz et en augmentant celle du café.
an 1920-1959 : Mali - En 1920, elle est appelée Soudan français. Parmi les différents gouverneurs coloniaux, on peut citer Henri Terrasson de Fougères, qui fut Lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal-Niger en 1920-1922, gouverneur intérimaire en mars 1920, puis à nouveau le 21 août 1921 pour être ensuite nommé Gouverneur du Soudan français du 26 février 1924 à 1931.
En vue d’assurer sa domination sur les populations africaines, le colonisateur français met en place un système très centralisé.
Des communes mixtes, prévues par un arrêté du gouverneur général du 1er janvier 1911 sont érigées dans un premier temps à Bamako et Kayes au 1er janvier 1919) puis à Mopti au 1er janvier 1920. Les communes de Ségou et Sikasso sont érigées respectivement en 1953 et 1954. Ces communes-mixtes sont gérées par un administrateur-maire nommé par arrêté du lieutenant-gouverneur, assisté d’une commission municipale du 1er degré composée de 8 membres titulaires (4 notables citoyens français, 4 notables sujets français) et 4 membres suppléants (2 citoyens français, 2 sujets français).
Le 18 novembre 1955, une loi permet à plusieurs communes africaines de devenir des communes de plein exercice. C’est le cas de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti en 1956 et de Sikasso en 1959. Dans ces communes, un collège unique élit le conseil municipal qui désigne le maire en son sein. Modibo Keïta devient ainsi le premier maire élu de Bamako. Des communes de moyen exercice, où le maire est un fonctionnaire nommé par le chef de territoire, assisté d’un conseil municipal élu par un collège unique sont érigées en 1958 : Kita, Kati, Koulikoro, Koutiala, San, Tombouctou et Gao.
Les Français veulent développer les cultures irriguées dont les productions étaient exportées vers la métropole. L'essentiel des investissements est ainsi concentré sur l'Office du Niger, dont les coûts d'investissement sur la période 1928-1939 s'élèvent à 4 milliards de francs.
Cette politique a permis d'augmenter les productions exportées.
Le décret du 17 août 1944 crée le service de l'inspection du travail en Afrique noire, puis la loi du 11 avril 1946 abolit le travail obligatoire. Le Fonds d'investissement pour le développement économique et social pour accélérer le développement des colonies françaises.
an 1920-1928 : Namibie - Le 17 décembre 1920, la Société des Nations donne un mandat de type C à l'Union d'Afrique du Sud pour administrer le Sud-Ouest africain et assurer le bien-être des populations.
En 1921, un administrateur sud-africain est nommé. Les fonctionnaires allemands sont invités à retourner en Allemagne. Plus de 1 500 civils allemands les suivent. Seuls 6 500 colons allemands sont autorisés à rester dans un premier temps alors que s'intensifie l'immigration de blancs sud-africains, souvent de conditions très modestes à qui sont attribuées des aides financières et des terres. Le nom de la capitale, Windhuk, est « afrikanerisé » en Windhoek.
Quoique les Sud-Africains héritent d'un territoire qui a subi une véritable purification ethnique sous la colonisation allemande, des lois ségrégationnistes sont néanmoins adoptées pour compléter les anciennes dispositions allemandes (prohibition du vagabondage hors des réserves, interdiction pour un indigène de démissionner de son emploi sans autorisation de son patron, passeport intérieur, contrats de travail restrictifs). Entre 1922 et 1925, des soulèvements indigènes ont lieu notamment chez les Basters de Rehoboth qui revendiquent leur indépendance. Ils sont sévèrement réprimés.
En 1924, les colons allemands ne représentent plus que 37 % de la population blanche (contre 83 % en 1913). La même année, les partis politiques propres au Sud-Ouest Africain sont créés. Les blancs fondent alors trois partis : le parti national de Frikkie Jooste (afrikaner), le parti de l'Union (anglophone) et l'Alliance allemande du Sud-Ouest Africain (Union allemande).
En 1925, la communauté blanche élit ses premiers représentants à l'assemblée législative du Sud-Ouest Africain (dix-huit élus, auxquels s'ajoutent six membres désignés par l'administration). L'Union allemande favorable à l'indépendance l'emporte grâce aux votes des Afrikaners anglophobes et hostile à l'Union sud-africaine. Les vaincus fusionnent et forment le Parti unifié du Sud-Ouest qui devint le parti majoritaire dès les élections suivantes (et le demeurera jusqu'aux années 1950).
En 1925, 43 % du territoire est constitué en réserves sous l'autorité de chefs coutumiers (Ovamboland, Kavangoland, Hereroland, Damaraland, Namaland, Kaokoland), 41 % des terres appartenant aux blancs et le reste à l'État ou aux Basters de Rehoboth.
En 1926, tous les natifs du Sud-Ouest Africain deviennent des ressortissants de l'Union sud-africaine. L'ancienne colonie allemande est dorénavant considérée comme une cinquième province de l'Afrique du Sud.
En 1928, la population blanche atteint 28 000 habitants soit 10 % de la population totale. Les fermiers afrikaners voisinent avec les anciens propriétaires fonciers allemands. Sur d'immenses fermes de 10 000 à 100 000 hectares, ils développent l'élevage intensif de bovins et de moutons karakul. Quant aux droits des populations noires, ils restent restreints à ceux accordés à l'époque allemande : la propriété foncière privée leur est interdite et ceux qui sont employés ne peuvent circuler hors de leurs zones de résidences que s'ils sont munis d'un pass.
Pendant vingt ans, la colonie sombre dans l'oubli. Le réseau ferroviaire est cependant complété et relié au réseau sud-africain. Les investissements sont peu nombreux dans un territoire dont le statut n'est pas définitif et restera pour longtemps incertain. L'exploitation des diamants, des divers minerais et l'élevage sont les seules richesses du territoire.
Après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne, la communauté germanique se remet à croire au retour du Südwest. Des sections du NSDAP sont constituées dans la colonie. Elles sont rapidement interdites par le gouvernement sud-africain mais la suspicion engendrée l'amène à interner dès le début de la Seconde Guerre mondiale plus de 1 200 des 10 000 germanophones que compte le territoire. Conformément à l'accord de Londres de 1923, les Allemands du Sud-Ouest sont cependant dispensés de servir contre leur pays d'origine et échappent à leur incorporation dans l'armée sud-africaine.
an 1920 - 1930 : Zambie - Dans les années 1920 et 1930, des Américains découvrent d'importants gisements miniers. L'activité minière favorise le développement de la région et l'immigration.
En 1923, la Rhodésie du Nord devient un protectorat britannique sous le contrôle du Colonial office britannique alors que la Rhodésie du Sud devient une colonie autonome.
an 1921 : Congo Brazzaville - En 1921, est donné le premier coup de pioche des travaux de la construction du chemin de fer et de ses ports par le gouverneur général Victor Augagneur.
an 1921 : Eswatini (Swaziland) - Le protectorat du Swaziland (1881-1968) - Le 22 décembre 1921, le jeune roi Sobhuza II montait sur le trône. Il ouvrit largement le royaume aux investisseurs britanniques et sud-africains afin d'exploiter les mines d'amiante et de charbon. Parallèlement, il fit racheter, par les chefs traditionnels, les terres occupées par les fermiers blancs du pays.
an 1921-1933 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Charles Ier, dernier empereur d'Autriche, renonce au trône le 11 novembre 1918, s'exile (Autriche, Suisse) avant d'être capturé en Hongrie, remis aux Anglais, qui lui permettent de rejoindre Madère en novembre 1921 ou il décède quelques mois d'hiver plus tard en 1922, de bronchite aiguë.
L'Histoire du Portugal est agitée au Portugal et dans ses colonies, dont, pour l'archipel de Madère :
-
Révolte de Farinha (4 février 1931), contre un décret centralisateur,
-
Révolte de Madère (4 avril 1931, ou des Îles, ou des Déportés), soulèvement militaire contre le régime de dictature nationale (1926-1933).
Le régime dictatorial salazariste domine le Portugal et son empire de 1933 jusqu'en 1974.
an 1921-1926 (1948) : Maroc - La guerre du Rif
En 1921, la tribu berbère des Beni Ouriaghel de la région d'Al-Hoceïma, sous la conduite d'Abdelkrim al-Khattabi, se soulève contre les Espagnols. Le général espagnol d'origine cubaine Manuel Fernández Silvestre dispose alors d'une armée forte d'environ 60 000 soldats pour réprimer l'insurrection. En juin, cette armée espagnole est presque totalement anéantie à Anoual. Cette défaite pousse le général à se suicider sur le champ de bataille. En février 1922, Abdelkrim al-Khattabi proclame la République confédérée des Tribus du Rif, et met en place toutes les structures d'un État moderne avec drapeau, ministères, assemblée législative, armée permanente et télécommunications. Les Rifains espèrent alors rallier les tribus de la zone française et initier un vaste soulèvement au Maroc et dans le reste de l'Afrique du Nord. Le gouvernement d'Ajdir bénéficie au niveau international du soutien du Komintern et de la neutralité bienveillante du Royaume-Uni. Le prestige d'Abdelkrim est célébré du Maghreb jusqu'au Machrek et en Turquie, où l'opinion publique le compare à Mustafa Kemal Atatürk et le surnomme le "Ghazi victorieux". En France le Parti communiste et la CGT appellent à des mutineries et à des grèves en solidarité avec la cause rifaine. La résonance d'Anoual atteint l'Extrême-Orient et l'Amérique du Sud et l'épopée rifaine sera citée comme modèle de référence de la guerre de libération moderne par les plus célèbres leaders révolutionnaires du XXe siècle, tels que Mao Zedong, Ho Chi Minh, Che Guevara, ainsi que par Tito qui dans les Balkans s'inspirera des méthodes de guérilla des Rifains pour libérer la Yougoslavie de l'occupation nazie.
Les troupes d'Abdelkrim, équipées du matériel abandonné par les Espagnols, menacent dès lors directement Fès, cœur spirituel du Maroc sous protectorat français. Face à leur avancée, la puissance coloniale française envoie le maréchal Philippe Pétain, rendu célèbre par la bataille de Verdun, pour mener l'offensive militaire sur le Rif à la tête de 250 000 soldats et auxiliaires et d'une quarantaine d'escadrilles d'aviation (dont une unité américaine), et avec l'assistance des troupes coloniales fournies par le gouvernement espagnol de Miguel Primo de Rivera. Le résident général Lyautey, jugé trop attentiste, est contraint de démissionner puis est rappelé à Paris en 1925. S'ensuit alors une lourde répression contre les Rifains, où bombardements terrestres et aériens, usage d'armes chimiques de fabrication allemande (y compris sur des populations civiles) et supériorité numérique obligent les troupes d'Abdelkrim à capituler en mai 1926.
Abd el-Krim est exilé dans un premier temps à La Réunion jusqu'en 1948, puis s'établit en Égypte où il prend la tête du Comité de Libération du Maghreb (qui réunit également Allal El Fassi et Habib Bourguiba), et ce jusqu'à son décès au Caire en 1963, pour lequel le raïs égyptien Gamal Abdel Nasser fera organiser des funérailles nationales. Si la reddition de 1926 marque la fin de l'expérience rifaine, une résistance politique issue des milieux citadins marque le pas dès le début des années 1930 avec la création du Comité d'action marocaine, embryon du mouvement nationaliste marocain.
an 1922 : Érythrée - L'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini en 1922 est l'occasion de profonds remaniements du gouvernement colonial en Érythrée. Le régime fasciste adopte des lois raciales et ségrégationnistes et les Érythréens employés dans la fonction publique sont relégués aux postes subalternes. Les réformes agricoles se poursuivent, mais réservées aux fermes possédées par des Italiens.
an 1923 : Réunion (Ile de la) - La Réunion exporte les produits suivant : sucre, vanille, manioc, géranium, ylang ylang, vétyver, café, cacao, thé, tabac, chouchou, aloes, maïs, fruits et légumes.
an 1923 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1923, l’administration de la BSAC prend fin. L’intégration à l’Afrique du Sud de la Rhodésie du Sud est un échec. Cette dernière prend alors le statut de colonie autonome. Londres conserve la mainmise sur l’administration de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland.
an 1924 : Afrique du Sud - Les élections générales de 1924 sont une déroute électorale pour Smuts et son parti sud-africain, face à l'alliance formée du parti national et du parti travailliste de Frederic Creswell. La victoire ainsi acquise, Hertzog est propulsé aux Union Buildings, le parlement de Pretoria, où il forme un cabinet de coalition comprenant deux ministres travaillistes.
Sa priorité est d'arracher les quelque 160 000 blancs à leur misère en étendant les emplois réservés dans l'industrie et le commerce.
Une de ses premières mesures symboliques est aussi de remplacer le néerlandais par l’afrikaans comme langue officielle au côté de l'anglais. Il met également en route une consultation populaire devant aboutir à la création d'un hymne officiel sud-africain et d'un drapeau national, en remplacement du drapeau colonial aux couleurs britanniques.
an 1924 : Canaries (Îles des) - En 1924, est créé à La Havane le Parti nationaliste canarien
an 1924 : Réunion (Ile de la) - Naissance de Raymond Barre (futur 1er Ministre et Maire de Lyon) à Saint-Denis, le 12 avril.
an 1924 : Rwanda - En 1924 la Société des Nations confie à la Belgique un mandat de tutelle. Le gouvernement colonial s'appuie sur les autorités locales en place, le Mwami Yuhi Musinga et l'aristocratie tutsi.
an 1925-1958 : Gabon - La population du Gabon travaille pour la puissance coloniale afin d'exploiter principalement ses ressources forestières. Lors de la construction de la ligne de chemin de fer Congo-Océan, les conditions de travail sont si dures qu'elles provoquent les premières grandes révoltes. Vient ensuite l'exploitation minière qui fut la cause du va-et-vient de la province du Haut-Ogooué entre le Congo et le Gabon en 1925 et 1946.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Gabon ne veut d'abord pas se rallier à la France libre ; des Forces françaises libres venues du reste de l'Afrique française libre investissent le territoire en novembre 1940 et soutiennent les colons Gaullistes contre les vichystes pendant la bataille du Gabon, aboutissant au ralliement forcé du Gabon à la France libre. En 1946 le pays devient un territoire français d'outre-mer dans le cadre de l’Union française et envoie des députés à L’Assemblée nationale en France. En 1958, le Gabon devient une république autonome, et Léon Mba en est élu président.
En octobre 1958, la Communauté française étant nouvellement créée, le Conseil de gouvernement du Gabon, s'appuyant sur l'article 76 de la Constitution, demanda à devenir un département français. Léon Mba, président du Gabon, chargea Louis Sanmarco de présenter la demande auprès du gouvernement métropolitain. Reçu à Paris par le ministre de l'Outre-mer, Bernard Cornut-Gentille, Louis Sanmarco reçut cette réponse sans ambiguïté : " Sanmarco, vous êtes tombé sur la tête ? N’avons-nous pas assez des Antilles ? Allez, indépendance comme tout le monde !".
La réponse du ministre Cornut-Gentille reflétait la pensée du général de Gaulle, qui confia à Alain Peyrefitte : "Nous ne pouvons pas tenir à bout de bras cette population prolifique comme des lapins (…). Nos comptoirs, nos escales, nos petits territoires d’outre-mer, ça va, ce sont des poussières. Le reste est trop lourd". Le général de Gaulle s'expliqua en ces termes sur l'"affaire gabonaise" : " Au Gabon, Léon M'Ba voulait opter pour le statut de département français. En pleine Afrique équatoriale ! Ils nous seraient restés attachés comme des pierres au cou d'un nageur ! Nous avons eu toutes les peines du monde à les dissuader de choisir ce statut".
Dans Le Colonisateur colonisé, Louis Sanmarco explique : "Ce fut pour moi un vrai désastre, la fin des illusions, l’effondrement de tout ce qui avait été le support intellectuel de toute ma carrière, de toute ma vie. J’étais trop abattu, trop discipliné aussi, pour réagir comme j’aurais dû, faire appel de la décision du ministre au général de Gaulle ou à l’opinion elle-même, démissionner avec éclat, que sais-je ? J’avais cru, avec l’adhésion des Africains, atteindre l’apogée de ma carrière, et j’étais dans le trou, désavoué par une métropole qui ne voulait ni de la gloire que lui apportait cette adhésion ni des efforts qu’elle exigeait. À partir de là, comme gouverneur, je ne fis plus que me survivre, et il faudra que j’entame une deuxième carrière pour retrouver mon tonus. Qu’on m’imagine retournant à Libreville pour expliquer au Conseil de gouvernement que la solution souhaitée par la France c’était l’indépendance et non pas le département ! Je n’étais pas fier, et Léon Mba m’en voulut d’avoir échoué. Il avait raison."
an 1925 : Maroc - Les protectorats français et espagnols (1912-1956)
En zone française le pouvoir exécutif est incarné par le résident général désigné par la France, et qui dispose d'une assez large liberté de manœuvre. Le sultan et son makhzen sont maintenus comme éléments symboliques de l'Empire chérifien, l'autorité réelle étant exercée par le résident et par ses fonctionnaires et soldats (contrôleurs civils et officiers des affaires indigènes). Les Français divisent en effet leur zone de protectorat au Maroc en sept régions administratives : trois civiles (Casablanca, Rabat, Oujda), trois militaires (Meknès, Fès, Agadir), et une à statut mixte civil et militaire (Marrakech). À la suite du départ de Lyautey en 1925, la résidence devient néanmoins sensible aux pressions exercées par les puissants lobbys coloniaux, représentés par les patrons de la haute finance et de la grande industrie, et par les Chambres françaises d'agriculture du Maroc.
an 1925 : Réunion (Ile de la) - Une liaison Le Port-Marseille en paquebot est inaugurée.
an 1926 : Sénégal - Ouverture de la liaison Aéropostale Casablanca – Dakar.
an 1927 : Afrique du Sud - Le nouveau drapeau national d'Afrique du Sud est adopté par le parlement en 1927. Consensuel, il symbolise l'histoire blanche du pays et l’union entre les quatre provinces, en reprenant les trois couleurs horizontales, orange, blanc et bleu du Princevlag hollandais du XVIIe siècle, les drapeaux Boers et l'Union Jack. L'hymne national adopté est Die Stem van Suid-Afrika, dont les paroles proviennent d'un poème de l'écrivain sud-africain Cornelis Jacobus Langenhoven.
Parallèlement, à partir de 1927, le congrès national africain tout comme l'Industrial and Commercial Union (ICU), le syndicat des ouvriers noirs, se déchirent pour des raisons similaires. Durant les années 1920, l'ICU avait dirigé avec succès d'importants mouvements de luttes syndicales, qui s'étaient étendues jusqu'aux villes minières du Witwatersrand. En 1927, avec 100 000 affiliés, l'ICU est le plus grand syndicat ouvrier du continent africain. Mais il est en même temps miné par des dissensions internes, des défauts de gestion et un manque de reconnaissance par les partis et mouvements de gauche sud-africain. Une tendance dure exige une action directe combinant grève et refus de l'impôt ainsi qu'un changement de politique et une réorganisatione du mouvement. Une tendance modérée, dans laquelle se reconnait Clements Kadalie, le chef et fondateur de ce mouvement syndical, préfère ménager le gouvernement Hertzog. Il ne remet en cause que les aspects marginaux du système politique, économique et social de l'Afrique du Sud et ne conçoit aucune alternative globale. Kadalie finit par exclure de l'ICU les représentants de la tendance dure dont les membres du parti communiste sud-africain.
an 1927 : Canaries (Îles des) - Le 21 septembre 1927, la province des îles Canaries est divisée entre la province de Las Palmas et la province de Santa Cruz de Tenerife.
an 1927 : Sénégal - Mort de Cheikh Ahmadou Bamba le 27 juillet.
an 1928-1931 : République de Centrafrique - la guerre du Kongo-wara fait rage dans la région, les populations sont soutenues activement par les missionnaires et refusent le travail forcé imposé dans les concessions.
an 1929 : Afrique du Sud - Aux élections de 1929, le Parti National obtient la majorité absolue des sièges avec seulement 41 % des suffrages contre 47 % des voix au Parti sud-africain de Smuts. Les travaillistes restent néanmoins au gouvernement. Ce sont des années de prospérité pour les Afrikaners, notamment pour les petits blancs pour lesquels le gouvernement Hertzog manifeste tout autant un souci de promotion sociale que celui de protéger la classe moyenne blanche laborieuse face au « dumping racial » pratiqué par les compagnies minières.
an 1929 : Mozambique - En 1929, à la fin du mandat de ces compagnies, le territoire du Mozambique est encore pauvre, non développé et mal contrôlé.
an 1929 : Nigéria - Période britannique (1800-1960) - La colonie britannique (1914-1960)
Les décisions des autorités coloniales, et surtout l'imposition de taxes, sont plusieurs fois mal acceptées. Ainsi, éclate en 1929 une «Guerre des femmes» qui secoue cette administration britannique.
an 1929 : Réunion (Ile de la) - 26 novembre : atterrissage du premier avion sur l'île dans un champ de 300 mètres Sainte-Marie.
an 1930 : Algérie - Des manifestations du centenaire de la prise d'Alger sont ressenties comme une provocation par la population.
an 1930 : Afrique du Sud - la crise économique frappe le pays dans les années 1930.
ICU entame alors un déclin inexorable avant de péricliter au début des années 1930. De son côté, l'ANC se déchire entre une aile conservatrice, qui maintient sa loyauté aux institutions de l'Empire britannique, et une aile réformiste panafricaine, favorable à des revendications nettement plus radicales. L'aile conservatrice animée par John Dube est très hostile à Josiah Gumede, le président de l'ANC, qui prône le suffrage universel, la restitution des terres, l'abrogation des laissez-passer. Ce dernier est finalement mis en minorité lors de la conférence du parti en 1930 et remplacé par Pixley Ka Isaka Seme, proche de Dube. Le rapprochement initié par Gumede avec le parti communiste sud-africain, tout en se distinguant de son idéologie, n'est néanmoins pas remis en cause par la nouvelle direction102, dont l'objectif est de reconstruire un parti qui ne compte plus que 4 000 membres en 1938.
Le début des années 1930 est marqué par les effets de la crise économique mondiale qui atteint l'Afrique du Sud. Le commerce du diamant s'effondre, tout comme les prix agricoles, et les exportations se raréfient. L'abandon de l'étalon-or par la Grande-Bretagne provoque en Afrique du Sud une fuite de capitaux vers l'étranger. La rentabilité des mines est menacée, le chômage augmente. L'autorité d'Hertzog est contestée, notamment par les partisans de Tielman Roos, en dissidence du parti.
an 1930-1974 : Éthiopie - Haile Sélassie I (1930-1974)
Tafari Makonnen est couronné Negusse Negest sous le nom de Haïlé Sélassié Ier (Force de la Trinité) le 2 novembre 1930. Le couronnement a lieu à la cathédrale Saint-Georges d'Abbis-Abeba, en présence de représentants officiels venus du monde entier, ce qui lui donne très rapidement une envergure internationale.
La première Constitution est introduite le 16 juillet 1931 ; elle met en place un système parlementaire à deux chambres. Le Negusse Negest et les notables gardent un contrôle total sur le Parlement dont ils désignent les députés, néanmoins une transition vers des principes démocratiques est envisagée « jusqu'à ce que le peuple soit à même de les élire lui-même » (art. 32). La succession au trône y est limitée à la succession d'Haïlé Sélassié Ier, ce qui marque un point de controverse avec les autres dynasties princières, notamment les princes du Tigré et le cousin du Negusse Negest, lui-même, le ras Kassa Haile Darge.
Le 12 octobre 1931, une nouvelle banque nationale est créée, remplaçant la Bank of Abyssinia créée en 1906 par Menelik II, et provoque une crise économique. Profitant de la contestation, les dignitaires du régime montent un complot autour du ras Haïlu, fils de Tekle Haïmanot du Godjam, afin de faire évader Iyasou V et le faire remonter sur le trône. Le plan échoue et Iyasou V (1897-1935) est capturé. Conscient de la contestation qui l'entoure, Haïlé Sélassié Ier procède à des purges au sein de tous les dirigeants régionaux au profit de personnes de confiance, menant de fait à une véritable centralisation de l'Empire.
Durant les années qui suivent, une véritable modernisation de l'Empire éthiopien suit son cours, avec apparition de l'aviation (premiers pilotes éthiopiens et un atelier de montage), développement du réseau routier, mise en circulation du papier-monnaie en 1933, création de nombreuses écoles en province, du cinéma.
an 1930 : Maroc - De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle
28 août 1930 : signature à Salé du manifeste contre le dahir berbère promulgué en mai ; première prise de conscience politique des nationalistes.
an 1930-1968 : Ile Maurice - Période britannique (1810-1968) - Déclin économique et indépendance
À partir des années trente, des mouvements populaires en faveur de la démocratisation commencèrent à se manifester et aboutirent graduellement au droit de suffrage universel et aux élections législatives de 1948.
Un mouvement rétrocessionniste demande le rattachement à la France. Le Parti travailliste mauricien est fondé et cherche à défendre les intérêts des travailleurs d’origine indienne et obtient leur représentation à l’assemblée. Au début du XXe siècle et jusque dans les années 1950, l'île est reliée par trois lignes maritimes commerciales: la plus importante étant celle des Messageries maritimes (avec notamment le Compiègne dans les années 1930) au départ de Marseille avec un départ toutes les deux semaines. Les escales principales sont à Naples, Port-Saïd, Suez, Djibouti, et ensuite soit vers Mombassa, Zanzibar, Nossi-Bé, Diego-Suarez, Tamatave (trente jours de voyage) ou soit vers Aden, Diego-Suarez, Sainte-Marie, Tamatave (vingt-cinq jours de voyage) avant de s'arrêter à La Réunion et à l'île Maurice. La deuxième ligne est celle de l'Union Castle Line qui part une fois par mois de Southampton pour rejoindre par l'Atlantique Madère, Tenerife, l'île de Sainte-Hélène, Le Cap, Durban, Port Elizabeth. D'autres vapeurs font ensuite la correspondance Afrique du Sud-île Maurice. La troisième ligne enfin, également de l'Union Castle Line, passe par l'est et le canal de Suez au départ de Southampton, Gibraltar ou Marseille, puis fait escale à Naples, Port-Saïd, Suez, Aden, Mombassa, Zanzibar, Port-Amélie, Beira et Durban. Les passagers prennent dans ces deux derniers ports une correspondance pour l'île Maurice. Les deux lignes de l'Union Castle Line sont plus onéreuses, plus longues et ne sont pas directes15. Le Pierre-Loti16 est avec le La Bourdonnais, l'un des derniers paquebots des Messageries maritimes à relier Maurice et La Réunion à la France, jusqu'en 1970.
La Seconde Guerre mondiale met un nouveau coup d’arrêt à l’activité économique de l’île. De 1939 à 1942, les liaisons par bateau sont interrompues et Maurice est coupée du monde. Des soldats mauriciens sont recrutés, à nouveau sur la base du volontariat, et servent pour la plupart en Afrique dans la 8e Armée commandée par le général Montgomery, et au Moyen-Orient. Les îles Maurice et Rodrigues n'ont pas dans ce conflit une importance stratégique, sauf à imaginer la prise du canal de Suez par l'Axe. Les Britanniques maintiennent cependant une présence militaire sur l'île aux Aigrettes, en face de Mahébourg, et quelques Mauriciens font partie de la Home Guard et donc de la garnison. En 1942, les Britanniques construisent un aéroport pour des raisons militaires et dont les liaisons avec l’Europe et l’Asie changent durablement la vie sur l’île. Après la Seconde Guerre mondiale, le Colonial Office a radicalement changé sa politique et cherche désormais à instituer de manière systématique des administrations indépendantes dans les colonies. De plus, de fortes sommes ont été investies dans la lutte contre les pandémies et dans le développement des infrastructures. En 1965, la situation économique est stabilisée, la vie politique et une presse locale se sont développées ; le Colonial Office décide d’organiser l’indépendance de l’île.
Le suffrage universel est introduit à Maurice en 1958.
an 1930 - 1970 : Mayotte - Période coloniale
Pourtant beaucoup reviennent avec en tête l'utopie nationaliste. Ils se sentent frustrés de toutes les commodités d'un progrès inenvisageable dans leur pays figé dans des structures qui ont résisté tant bien que mal aux dernières offensives colonialistes des années 1930. Cet état de déréliction de l'économie, le désintérêt de l'État français qui n'a plus de facto qu'un pouvoir nominal, l'abandon des populations fidèles à la France qui rend justice des droits et des devoirs ne sera dénoncé que dans les années 1960 par quelques Français intéressés par le monde maritime. Paul-Émile Victor et les rédacteurs de l'encyclopédie Marco Polo tirent ainsi une sonnette d'alarme, totalement inaudible pour les représentants métropolitains, au début des années 1970.
an 1930-1933 : Mozambique - Le Mozambique sous le régime de Salazar (1933-1974)
L'arrivée au pouvoir au Portugal d'António de Oliveira Salazar marque le début d'une politique plus volontariste de développement des colonies. Elle se manifeste par l'idée, novatrice par rapport aux époques précédentes, qu'il faut assurer l'intégration du territoire mozambicain et de sa métropole. Ainsi, le cadre juridique et institutionnel du territoire est déterminé par le principe de l'indivisibilité de l'État et de la Nation, les gouvernements coloniaux étant une émanation du pouvoir central de la métropole. Au Mozambique, les organes représentatifs ne concernent cependant que les colons. Aucune consultation ou représentation des populations indigènes dans les conseils exécutifs ou législatifs n'est encore prévue. Un statut indigène est même rédigé afin de réglementer la circulation des Africains, leur accès aux lieux publics, la répartition territoriale et l'accès à l'emploi.
La politique d'intégration territoriale des colonies à l'espace national portugais, menée par le régime salazariste, repose également sur une politique favorable à l'émigration et à l'établissement des Portugais en Angola et au Mozambique. Elle est censée être favorisée par le développement des activités productrices comme les mines et l'industrie. Cette politique d'intégration vise aussi les Africains qui, par une politique d'assimilation « au mérite », peuvent intégrer la nation portugaise.
En 1930, le nombre de colons européens au Mozambique n'est que de 30 000 personnes. La politique d'intégration territoriale la fait rapidement augmenter ; elle atteint 200 000 personnes au début des années 1970 (3 % de la population). Néanmoins, l'importance de cette immigration portugaise au Mozambique reste relativement insuffisante et inférieure à ce qui était attendu, les candidats portugais à l'émigration préférant nettement, durant cette période, aller s'établir au Brésil.
an 1931 : Liberia - En 1931, la Société des Nations condamne les conditions de travail forcé imposées aux autochtones par les américano-libériens pour le compte de multinationales de l'industrie du caoutchouc. Le scandale contraint le gouvernement à la démission.
an 1930-1956 : Maroc - Les protectorats français et espagnols (1912-1956)
Le Maroc connaît en effet une expansion économique importante, illustrée par le développement fulgurant de Casablanca (en 1930 le port de Casablanca devient ainsi le septième de l'Empire colonial français par l'intensité de son trafic) et la construction de nombreuses infrastructures (routes, voies ferrées, barrages, usines, création de villes nouvelles comme Port-Lyautey, Petitjean, Khouribga, Louis-Gentil ou Martimprey-du-Kiss). Par conséquent, se forme un puissant milieu capitaliste européen qui dispose de groupes de pression parfaitement organisés, aussi bien à Rabat qu'à Paris. Un tel essor économique accroît le fossé des inégalités, et à l'exception d'une poignée de dignitaires locaux — tels que le célèbre pacha de Marrakech Thami El Glaoui, qui jouera un rôle primordial dans les événements de 1953 — le peuple marocain subit le sort dramatique d'oppression et d'exploitation partagé par tous les autres peuples colonisés. Une politique de colonisation de peuplement comparable par certaines caractéristiques à celle de l'Algérie française se met également en place, encouragée par les résidents successifs et par les milieux d'affaire français. À la veille de l'indépendance en 1956, la population européenne du protectorat s'élève ainsi à plus de 500 000 personnes, constituée d'éléments de toutes origines (français, espagnols, italiens, grecs, suisses, russes, etc.) à l'image des Pieds-noirs d'Algérie. C'est de cette époque coloniale charnière que datent les entreprises-clés de l'économie marocaine, tels que le groupe ONA et l'Office chérifien des phosphates, et plus généralement plusieurs données sociales et politiques du Maroc contemporain.
La zone espagnole dispose d'une organisation assez semblable à la zone française, avec un haut-commissaire nommé par Madrid. Le sultan est représenté par un khalifa, lequel réside à Tétouan, capitale du protectorat hispanique. Ce territoire ne connaît pas de développement économique comparable à la zone française, mais joue un rôle décisif dans l'avenir de l'Espagne. C'est en effet depuis le Maroc espagnol qu'éclate le soulèvement du général Franco, commandant des troupes coloniales (Légion espagnole des tercios et unités indigènes regulares), contre la République espagnole le 17 juillet 1936. Cet événement déclenche la guerre civile opposant les nationalistes et la phalange fasciste ibérique aux républicains, conflit particulièrement sanglant et dévastateur qui se solde par la victoire des partisans de Franco en 1939. En 1946 le régime franquiste commet une violation du traité hispano-marocain en soustrayant les territoires sahariens à la responsabilité du khalifa du sultan à Tétouan et en les annexant directement comme "provinces d'outre-mer" sous le nom d'Afrique occidentale espagnole.
La ville de Tanger quant à elle constitue une zone internationale au statut particulier défini en 1923. Cette entité territoriale est régie par une commission de puissances étrangères dans laquelle siègent les États-Unis et un certain nombre de pays européens. Le mendoub, haut fonctionnaire du makhzen, est le délégué du sultan et à ce titre le représentant officiel de l'Empire chérifien, mais le pouvoir appartient en réalité aux membres de la commission internationale. La France, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie sont les pays les plus influents au sein de la commission et les plus représentés dans la gestion de la zone internationale.
an 1931-1939 : Canaries (Îles des) - La période de la république et de la guerre civile (1931-1939)
En 1931, la deuxième république est établie en Espagne, mais se retrouve incapable de résoudre les conflits dans les différentes régions du pays. En 1936, les élections portent au pouvoir une coalition de gauche, le Front populaire.
Juan Negrín (1892-1956), licencié en médecine et chirurgie en Allemagne, créateur d'une école de physiologie de renommée internationale, membre du Parti socialiste ouvrier espagnol, est élu député de la province de Las Palmas (1931-1934, Canaries orientales). Ministre des Finances en 1936, il est désigné président du Conseil des ministres espagnol (1937-1939), puis président du gouvernement de la République espagnole en exil, depuis la France, puis le Mexique. Très contesté, il est enfin réhabilité par le PSOE en 2008.
Francisco Franco (1892-1975) est nommé commandant militaire (capitaine général) aux îles Canaries et au Maroc espagnol. Quand, après l'assassinat de José Calvo Sotelo, une grande partie de l'armée espagnole se soulève contre le gouvernement (18 juillet), Franco prend le commandement des troupes au Maroc espagnol le 19 juillet 1936, après avoir quitté la Grande Canarie.
L'armée espagnole prend le contrôle de plusieurs régions et villes : c'est le début d'une guerre civile qui va durer jusqu'en 1939, opposant les nationalistes aux républicains. Elle aboutit à la victoire des nationalistes qui établissent le régime de l'Espagne franquiste (1939-1975), dans lequel Franco est le caudillo, régent d'un royaume à venir.
an 1931 : Rwanda - En 1931, le roi Yuhi Musinga, qui refuse de se faire baptiser, est obligé de partir en exil dans l'actuelle République démocratique du Congo. La Belgique confie le pouvoir à son fils le Mwami Mutara Rudahigwa, converti au catholicisme. La carte d'identité ethnique est instituée.
Les missions catholiques prennent de plus en plus d'importance dans le pays. Elles se chargent de l'éducation sur tout le territoire.
an 1932 : Afrique du Sud - Après s'y être longtemps refusée, l'Afrique du Sud abandonne à son tour l'étalon-or, permettant le retour des capitaux et la baisse des taux d'intérêt. La dette publique s'efface et les budgets deviennent excédentaires.
an 1932 : Burkina Faso (anc. Haute-Volta) - Un décret du 5 septembre 1932 supprime la colonie de la Haute-Volta et répartit son territoire entre les colonies du Niger, du Soudan français et de la Côte-d'Ivoire.
Les cercles de Tenkodogo, Kaya, Ouagadougou, Koudougou, Gaoua, Batié et Bobo-Dioulasso ainsi qu'une partie du cercle de Dédougou — boucle de la Volta Noire — sont incorporés à la colonie de la Côte-d'Ivoire (2 011 916 habitants sur 153 650 km². Les cercles de Fada N'Gourma et Dori — moins le canton d’Aribinda — sont incorporés à la colonie du Niger (278 512 habitants sur 67 850 km²). Les cercles d'Ouahigouya — plus le canton d’Aribinda — et de Dédougou — subdivision de Tougan et rive gauche de la Volta Noire — sont incorporés à la colonie du Soudan français (708 501 habitants sur 50 700 km²).
an 1933 : Afrique du Sud - Les nationalistes d'Hertzog et les libéraux de Smuts se sont accordés pour former, en 1933, un gouvernement d’union nationale qui développe un programme d'industrialisation, centré autour de l'initiative de l'État.
Aux élections de mai 1933, avec 136 députés sur un total de 150, les deux partis marginalisent les travaillistes de Cresswell et les centristes de Roos. En 1934, le parti national et le Parti sud-africain fusionnent pour créer un nouveau parti, le parti uni, reflétant le gouvernement d'union nationale dirigé par Hertzog. Le parti abandonne la distinction entre deux nations blanches en Afrique du Sud, afrikaner et anglaise, pour la notion d'unité. Ce ralliement provoque un nouveau schisme. Les partisans nostalgiques de la tradition impériale se regroupent dans un parti du Dominion, mené par Charles Stallard, tandis que les nationalistes, l'aile droite du parti, à l'initiative du pasteur Daniel Malan, refuse l'union et forme un « parti national purifié ». Dix-sept parlementaires rejoignent ce parti national purifié dont les dirigeants renchérissent alors dans les revendications nationalistes : réaffirmation de la rupture avec le Royaume-Uni, instauration de la république, institutionnalisation de la ségrégation et de la domination blanche, promotion de l'histoire afrikaner et du social-christianisme afin de permettre de maintenir la domination politique des Afrikaners sur toute l'Afrique du Sud. L'une des premières décisions symboliques du nouveau gouvernement du parti uni est de proposer Sir Patrick Duncan à la fonction de gouverneur général d'Afrique du Sud. C'est la première fois qu'un Sud-Africain, et non un Britannique, est proposé pour exercer la plus haute fonction du pays. Par ailleurs des lois importantes sont adoptées dans les domaines économique et social. Ainsi, des accords préférentiels comprenant des prix garantis sont-ils négociés avec la Grande-Bretagne pour permettre l'exportation de la laine sud-africaine sur les marchés mondiaux ; des programmes de grands travaux d'équipements (logements, routes) ou à caractère scientifique (création d'un conseil national pour stimuler et coordonner la recherche industrielle et scientifique) sont mis en place.
an 1933 : Angola - À partir de 1933, date de la fondation de l'Estado Novo (« Nouvel État ») par António de Oliveira Salazar au Portugal, le régime colonial se durcit considérablement. Le Portugal instaure alors le « régime de l'indigénat ».
Trois catégories d'individus sont instituées :
* les civilizados, les Portugais ;
* les assimilados regroupant les métis et quelques Noirs qui ont accès à l'instruction (en portugais) ;
* les indígenas, les Noirs (98 % de la population), dont une partie est soumise aux travaux forcés, à l'interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts sur les « réserves » et à un ensemble d'autres mesures tout aussi répressives telles que les châtiments corporels (dans certains cas).
Ce système colonial perdure jusqu'en 1954, alors qu'il est considérablement allégé, puis définitivement aboli en 1962.
an 1933-1953 : Côte d'Ivoire - De 1904 à 1958, le pays est inclus dans la Fédération de l'ouest africain français appelée Afrique-Occidentale française (AOF). C'était une colonie et un territoire d'outre-mer pendant la Troisième République. Jusqu'à la période suivant la Seconde Guerre mondiale, les affaires gouvernementales sont caractérisées par l'association qui faisait des habitants des colonies des sujets français sans droit de représentation. Sa capitale est Bingerville jusqu'en 1933, puis Abidjan.
an 1933 : Maroc - De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle
18 novembre 1933 : célébration à Fès de la première fête du Trône.
an 1934 : Maroc - De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle
Création de l'Action marocaine
an 1935 : Afrique du Sud - Une convention panafricaine est ouverte en décembre 1935, à Bloemfontein, par le maire blanc de la ville. Elle réunit cinq cents délégués représentant les zones rurales et urbaines d'Afrique du Sud, le Transkei, le Zoulouland, les protectorats du Bechuanaland, du Basutoland et du Swaziland mais aussi des indiens et métis. Le but de la convention est de manifester contre les projets de lois du gouvernement concernant leurs droits politiques et sociaux. En janvier 1936, elle envoie une délégation auprès du gouvernement. Bien que reçue par Hertzog, elle ne parvient pas à bloquer l'adoption des lois sur la représentation des indigènes et celle sur les terres indigènes, qui avaient reçu dans leur principe le soutien de John Dube. La première de ces lois institue des conseils de représentations indigènes (Native Representative Councils), purement consultatifs et composés de noirs élus, d'autres nommés, et de fonctionnaires. En contrepartie, les électeurs noirs sont radiés des listes communes de la province du Cap et réinscrits sur une liste séparée afin d'élire trois députés blancs représentant leurs intérêts au parlement. La seconde de ces lois controversées, la « loi sur le fonds d'investissement foncier et la terre indigènes » (Native Trust and Land Act, 1936), agrandit la superficie des réserves indigènes existantes à 13 % de la surface du pays, ôtant dans le même temps aux résidents noirs du Cap le droit d'acheter de la terre en dehors des réserves.
an 1935-1936 : Érythrée - En 1935 – 1936, l'Italie utilise l'Érythrée comme base pour sa campagne de 1935-1936 visant à occuper l'Éthiopie. La période durant laquelle l'Érythrée est colonisée par l'Italie est cependant faste pour le développement des infrastructures portuaires (port de Massaoua), ferroviaire (chemins de fer d'Érythrée), ou par câble (le téléphérique de Massaoua à Asmara constituant la plus longue ligne de téléphérique du monde). La ville d'Asmara a alors une population de 98 000 habitants, dont 53 000 Italiens. Elle est la principale «ville italienne» de l'empire colonial italien en Afrique. Du fait de l'architecture des bâtiments construits, Asmara est appelée «Piccola Roma» (Petite Rome)
an 1935-1941 : Éthiopie - La guerre italo-éthiopienne (1935-1941)
Les visées de l'Italie sur l'Éthiopie répondent à plusieurs besoins : d'une part développer le faible empire colonial dont l'Italie dispose alors (Libye, l'Érythrée et la Somalie) qui provoque un retard économique lié au manque de matières premières, mais aussi venger l'humiliation subie à Adoua que l'Italie garde en mémoire. La présence de l'Éthiopie à la Société des Nations, (Mussolini la juge « indigne de figurer parmi les peuples civilisés »), est considérée comme un affront à sa politique raciale et fasciste.
La succession d'évènements qui mènera à l'invasion fasciste est déclenchée par l'incident de Walwal. Prétexte qui sera qualifié par Hailé Sélassié Ier, en 1936, dans son discours d'« Appel à la Société des Nations » de « provocation évidente » : en novembre 1934, des patrouilles frontières éthiopiennes escortant une commission frontalière anglo-éthiopienne protestent contre l'incursion italienne créée par la construction d'un poste italien en rupture avec le traité éthio-italien de 1928. Début décembre, un conflit éclate où 150 Éthiopiens et 50 Italiens trouvent la mort. L'incident conduit au déclenchement d'une crise à la Société des Nations.
L'Angleterre et la France, soucieux de conserver l'Italie comme allié contre l'Allemagne, décident de ne prendre aucune mesure pour décourager le développement militaire italien. L'Italie commence ainsi à accumuler ses troupes aux frontières éthiopiennes, en Érythrée et dans le Somaliland italien, et consolide contractuellement le soutien des grandes puissances.
Le 16 janvier, Mussolini prend la direction du ministère des colonies.
Le 17 mars, l'Éthiopie présente un nouveau recours, faisant appel à l'article XV de l'organisation.
Le 2 octobre, Mussolini annonce la déclaration de guerre à l'Éthiopie. En attaquant ce pays, membre de la Société des Nations, Mussolini viole l'article XVI de l'organisation.
Alors que le Pape Pie XI tient des propos ambigus au cours des années de l'invasion de l'Éthiopie par les troupes fascistes, ses prêtres se montrent beaucoup moins équivoques en soutenant ouvertement les forces italiennes. Le fascisme clérical se développe alors en Italie.
Le 18 novembre, l'Italie est frappée par les sanctions économiques de la Société des Nations, en riposte l'Italie met en œuvre des programmes économiques autarciques. Les sanctions se montrent en fait inefficaces, puisque de nombreux pays les ayant votées officiellement maintiennent de bons rapports avec l'Italie en l'approvisionnant en matières premières. L'Allemagne nazie est un de ceux-ci.
Le déclenchement de l'invasion de l'Éthiopie marque ainsi deux tournants sur le plan international : elle est le point de départ du rapprochement entre Mussolini et Hitler, et elle décrédibilise la Société des Nations en marquant, selon les mots de Stanley Baldwin, Premier ministre du Royaume-Uni, à la Chambre des communes (Royaume-Uni)e 23 juin 1936, son « échec total » à la « sécurité collective ».
Devant le conflit devenant imminent, Hailé Sélassié Ier décrète une mobilisation générale. Son armée est composée d'environ 500 000 hommes, dont beaucoup ne sont souvent armés que de lances et de boucliers. Seuls quelques soldats disposent encore d'armes modernes, dont certains fusils usagés datant d'avant 1900. Un embargo sur les armes, imposé en 1918 par les trois puissances coloniales limitrophes (France, Angleterre et Italie), avait en effet fortement limité depuis près de 20 ans l'armement de l'empire. Soucieux de s'assurer la victoire, Benito Mussolini triple les moyens en hommes : en mai 1936, presque un demi-million d'hommes est engagé sur le théâtre des opérations dont 87 000 askari, 492 chenillettes L3/35, 18 932 véhicules et 350 avions. Dans l'arsenal à disposition des Italiens, il y a aussi des armes chimiques et bactériologiques interdites par la convention de Genève : 60 000 grenades à l'arsine pour l'artillerie, 1 000 tonnes de bombes à ypérite pour l'aéronautique et 270 tonnes de produits chimiques agressifs pour l'emploi tactique.
Le 2 octobre 1935, l'offensive est déclenchée.
Dès le début des opérations, le 3 octobre, Mussolini prend la direction des opérations et envoie presque quotidiennement des ordres radiotélégraphiés à ses généraux présents sur le champ de bataille. Parmi ses ordres, ceux relatifs à l'emploi des armes chimiques.
Le 6 octobre, Adoua, ville symbole de l'humiliation italienne, tombe.
Le 9 janvier, Mussolini autorise la guerre totale avec ces paroles : « J'autorise Votre Excellence à employer tous les moyens de guerre, je dis tous, qu'ils soient aériens comme de terre. Décision maximum. »
Les bombardements chimiques d'artillerie et par avions se poursuivent aussi bien sur le front Nord (jusqu'au 29 mars 1936) que sur le front Sud (jusqu'au 27 avril), employant un total de 350 tonnes d'armes chimiques. Dans ce contexte, fin janvier, malgré l'emploi massif d'armes chimiques, les armées italiennes du front Nord sont en graves difficultés (harcelées par les troupes du ras Kassa, Badoglio est sur le point d'ordonner l'évacuation de Mékélé). La conduite d'une vraie politique d'extermination envers les Éthiopiens ne se limite pas à l'emploi des armes chimiques mais est conduite avec d'autres moyens, comme l'ordre de ne pas respecter les marquages de la Croix rouge ennemie ce qui conduit à la destruction d'au moins 17 hôpitaux (dont un suédois) et installations médicales éthiopiennes ou par l'emploi de troupes askari (libyens de religion musulmane) contre les armées et la population chrétienne d'Éthiopie. Les membres de la Croix Rouge auprès des troupes éthiopiennes rapportent y être délibérément visés par les troupes musoliniennes.
De l'autre côté, les troupes du négus, moins nombreuses et moins bien armées, résistèrent parfois héroïquement, comme à May Chaw ou Amba Alagi.
Le 5 mai 1936, après sept mois de conflit, Addis Abeba tombe ; le 9 mai, la victoire est proclamée par Mussolini.
Haïlé Selassié, après une décision majoritaire du Conseil impérial, prend le chemin de l'exil vers l'Angleterre afin de sauvegarder le gouvernement national.
Il lance à Genève un appel à la Société des Nations le 27 juin 1936 devant ses pays membres. Dans son discours, Hailé Sélassié Ier dénonce les agissements de l'occupant comme des actes « barbares », et met en garde la communauté internationale contre les conséquences à venir de leurs positions, déclarant notamment :
« J'ai décidé de venir en personne, témoin du crime commis à l'encontre de mon peuple, afin de donner à l'Europe un avertissement face au destin qui l'attend, si elle s'incline aujourd'hui devant les actes accomplis » — Hailé Sélassié, « Appel à la Société des Nations », 27 juin 1936.
« Je déclare à la face du monde entier que le Negusse Negest, le gouvernement, et le peuple d'Éthiopie ne s'inclineront pas devant la force, qu'ils maintiennent leur revendication d'utiliser tous les moyens en leur pouvoir afin d'assurer le triomphe de leurs droits et le respect de l'alliance » - — Hailé Sélassié, « Appel à la Société des Nations », 27 juin 1936.
Malgré les mises en garde du Negusse Negest devant le danger fasciste que laisse apparaître cette guerre, la Société des Nations se contente de décréter des sanctions économiques jamais entrées en application.
L'occupation et la résistance éthiopienne (1936-1941) - La période d'occupation italienne est marquée par la violence de l'occupant et par l'échec de la politique de colonisation. Le développement des mouvements de résistance éthiopiens, ainsi que la violence elle-même qui nourrit en retour la résistance, sont autant d'éléments participant de cet échec.
Le 9 mai 1936, Benito Mussolini proclame néanmoins l'Empire italien et le roi d'Italie Victor-Emmanuel III, nouvel Empereur d'Éthiopie, cette proclamation est, selon les mots de John H. Spence, une « façade vaniteuse » qui tente de masquer la véritable situation puisque, selon Paul B. Henze, « aucune région d'Éthiopie ne fut entièrement sous le contrôle italien ».
La violence avec laquelle est menée l'occupation culmine dans plusieurs épisodes tragiques qui symbolisent encore aujourd'hui cette période en faisant chacun l'objet d'un monument commémoratif présent de nos jours à Addis-Abeba.
-
Le massacre de Graziani tout d'abord, où à la suite de la tentative d'assassinat du leader de l'occupation par deux jeunes Érythréens, les fascistes procèdent au massacre de civils dans la capitale où près de 30,000 personnes trouve la mort en à peine trois jours. Après cet incident, Graziani est remplacé par Amédée II de Savoie-Aoste le 21 décembre 1937.
-
Le massacre de Debre-Libanos, le 20 mai 1937, où plus de 300 prêtres sont fusillés en quelques jours.
-
Enfin la mort de l'Aboune Pétros, devenu martyr de la résistance éthiopienne.
Tout au long de cette période, la violence est aggravée lorsqu'il s'agit de lutter contre les mouvements de résistance. Un télégramme de Mussolini daté du 5 juin, ordonne notamment de « fusiller tous les résistants fait prisonnier ». Le gaz moutarde continue d'être employé et les exécutions sommaires de prisonniers se multiplient.
Un mouvement de résistance prend forme dès 1936 et lance durant la saison des pluies plusieurs offensives et reprendre la capitale, Addis-Abeba : le 28 juillet, un des jeunes chefs du Choa Dejazmach Abarra Kasa, lance l'assaut du nord-ouest, mais est repoussé par l'artillerie aérienne ; le 26 août, Dejazmach Balcha Safo, lance un assaut du sud-ouest, repoussé de la même manière. Après la saison des pluies, les Italiens reprennent l'offensive et continuant de mener des campagnes de bombardement et de gazage de villages, dans le Choa, le Lasta, Charchar, Yergalam, entre autres.
Les offensives reprennent durant la saison des pluies de l'été 1937, dans le Lasta dirigé par Dajazmach Haïlu Kabada, et dans le Godjam dirigé par Dajazmach Mangasha et Belay Zalaka. Tout comme lors de l'invasion du pays, Mussolini ordonne à nouveau à Graziani d'« utiliser tous les moyens possibles, y compris les armes chimiques », cette fois-ci pour écraser la résistance. Graziani se révèle malgré tout incapable de mettre fin à l'insurrection dans le Choa, et ouvre des négociations de paix avec le leader, le ras Ababa Aragay. Les forces italiennes repartent à l'offensive après les pluies.
Les principaux mouvements de résistance se condensent dans le Choa, le Begemder et le Godjam. Peu de temps après sa prise de fonction, le général Ugo Cavallero, admet que de « large parties » du Choa et de l'Amhara sont entrées en rébellion, et que des « poches de résistances persistent dans le sud-ouest, en ayant « le soutien complet » de la population qui était prête à les joindre.
Le chef fasciste Arcanovaldo Bonacorsi reconnaît dès 1939 que l'empire se trouve partout dans « un état de rébellion latent », qui peut avoir :
« son dénouement tragique lorsque la guerre éclatera avec nos ennemis. Si un détachement anglais ou français était amené à entrer en un point, il n'aurait besoin que de peu ou d'aucune troupe puisqu'il trouverait alors un vaste nombre d'Abyssins prêts à les rejoindre et à faire battre en retraite nos forces. » — Arcanovaldo Bonacorsi, mai 1939
En 1939, année du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la situation d'impasse dans laquelle se trouve l'Italie ne fait que s'accentuer. D'un côté les Italiens échouent à mettre fin à la résistance, de l'autre les Éthiopiens sont eux aussi incapables de pénétrer les lignes ennemies.
La campagne d'Afrique de l'Est et la libération (1941) - La campagne qui mène à la libération de l'Éthiopie s'inscrit dans le cadre plus général de la campagne de libération de l'Afrique de l'Est qui débute le 13 juin 1940. À la fin octobre 1940, Anthony Eden, secrétaire aux Affaires étrangères de Grande-Bretagne, réunit à Khartoum le Negusse Negest Haile Sélassié, le général sud-africain Jan Smuts, Wavell, Platt ainsi que le lieutenant-général Cunningham. Ils adoptèrent le plan général d'attaque, qui faisait également appel aux troupes irrégulières éthiopiennes.
Après la libération de l'Érythrée, la 5e division indienne poursuit son offensive vers le sud en Éthiopie, tandis que des troupes venues du Kenya s'emparent d'Addis-Abeba le 6 avril. Le duc d'Aoste se rend en mai à Amba Alagi, mais des troupes italiennes sous le commandement des généraux Nasi et Gazzera poursuivent la lutte, respectivement au nord-ouest et sud-ouest de l'Éthiopie. Le dernier affrontement d'importance se produit à Gondar et débouche sur la reddition du général Nasi le 27 novembre. Quelques troupes italiennes mènent une guerre de guérilla dans les déserts érythréens et les forêts éthiopiennes jusqu'à la reddition de Rome aux Alliés en septembre 1943.
L'Éthiopie est libérée le 5 mai 1941, date célébrée depuis comme le Jour de la Victoire, le Negusse Negest Hailé Sélassié revient à Addis-Abeba avec le soutien des Britanniques. À la suite de la signature du traité de Paris de 1947, l'Italie doit verser 25 millions de dollars de réparation. Les estimations éthiopiennes sont dans les faits 12 fois supérieures. On dénombre finalement sur cette période :
-
300 000 personnes mortes de privations à la suite de la destruction de leurs villages ;
-
275 000 morts au combat ;
-
78 500 patriotes tués pendant l'occupation ;
-
35 000 personnes mortes dans des camps de concentration ;
-
30 000 civils tués lors du massacre de Graziani en février 1937 ;
-
24 000 patriotes exécutés par des juridictions sommaires ;
-
17 800 femmes et enfants tués par les bombardements.
Au total, ces cinq années auront causé la mort de 760 300 personnes
an 1936 : Algérie - Sous le Front populaire, qui voit 40 000 grévistes en Algérie en juillet 1936, le projet de loi Blum-Viollette est présenté en janvier 1937, visant à l'octroi à certains musulmans du « droit de suffrage [en] récompense des services rendus, dans l'armée par exemple, ou de l'effort intellectuel réalisé ». Les élus musulmans sont enthousiastes, mais les élus d'origine européenne partent en guerre contre le projet : en mars 1938, 320 d'entre eux démissionnent. Entre-temps, Léon Blum a dû céder la présidence du conseil à Camille Chautemps et le projet ne sera jamais déposé au parlement.
an 1936 : Liberia - En 1936, le nouveau gouvernement interdit le travail forcé. Néanmoins, les autochtones, privés de droit de vote, restent des citoyens de seconde zone.
an 1936 : Réunion (Ile de la) - 19 décembre-28 décembre : première liaison aéropostale Le Bourget-Gillot.
an 1936 : Sénégal - (7 décembre) : Disparition en mer de Jean Mermoz peu de temps après son décollage de Dakar à destination de l’Amérique du Sud à bord du Latécoère 300 « La Croix du Sud ».
an 1937 : Burkina Faso (anc. Haute-Volta) - Un décret du 13 juillet 1937 crée la région de la Haute-Côte-d'Ivoire.
an 1937 : Maroc - De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle
Scission de l'Action marocaine ; Mohamed Hassan El Ouazzani fonde le mouvement populaire qui deviendra après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, le Parti démocratique de l'indépendance (PDI) ; Allal El Fassi crée le Parti national, qui se transformera en Parti de l'Istiqlal (PI) en décembre 1943.
an 1938 : Afrique du Sud - Lors des élections de 1938, si les électeurs confirment le Parti Uni, ce sont les nationalistes de Malan qui gagnent dix élus grâce aux voix des Blancs ruraux ou des plus démunis, confirmant leur statut d'opposition officielle.
Sur fond de crise économique, la décennie est marquée par la montée du nationalisme afrikaner. Celui-ci est d'abord exalté autour de l’anti-britanisme par la littérature de langue afrikaans à partir de la fin de la seconde guerre des Boers et de la paupérisation qui s'ensuivit dans les régions du Transvaal et de l'État libre d'Orange. Les thèmes abordés par les écrivains Eugène Marais, Louis Leipoldt ou Jan Celliers tournent notamment autour de la guerre, du martyre des enfants boers et de la religion chrétienne, avant de laisser la place à une écriture plus intimiste. Tandis que Totius s’inspire du calvinisme pour proposer une lecture religieuse de l’histoire des Afrikaners, dont les souffrances auraient été la preuve de leur élection divine, D.F. Malherbe s’inspire de l’histoire des pionniers boers pour proposer une nouvelle morale aux jeunes générations déracinées. Des écrivains comme Toon van der Heever et Eugène Marais se posent pour leur part des questions existentielles avant de s’interroger sur la destinée des Afrikaners en tant que nation. Durant cette époque, l’un des thèmes dominants de la littérature afrikaans est la description du déchirement des Afrikaners entre villes et campagnes et l’exaltation de la liberté individuelle et de la frontière. Ce mouvement est suivi, dans les années 1930 et 1940, par le mouvement des Dertigters, dont les chefs de file sont N.P. Van Wyk Louw, Dirk Opperman, C. M. van den Heever et Uys Krige, marquant la mobilisation de l’élite intellectuelle afrikaner autour de la lutte contre la « massification et pour la défense » des valeurs et de la culture afrikaner. L'anti-britannisme, qui reste virulent, commence aussi à être concurrencé chez les Afrikaners par la crainte d'un nationalisme noir en gestation. L'année 1938 culmine ainsi avec les célébrations du centenaire du Grand Trek, rassemblant autour de ce thème des communautés blanches disparates dont les seuls dénominateurs communs sont la religion et la langue. Ces célébrations, marquées par un déferlement sans précédent du nationalisme afrikaner à travers le pays, se terminent à la date symbolique du 16 décembre par la pose à Pretoria de la première pierre des fondations du Voortrekker Monument, dédié aux pionniers boers.
an 1938-1943 : Afrique République de Djibouti - Le port de Djibouti se développe au rythme du commerce avec l'Éthiopie et des besoins de la navigation coloniale. L'invasion puis l'occupation de l'Éthiopie par l'Italie entraîne un bref boom économique à Djibouti, avec un très important accroissement du trafic du port et des liaisons vers Addis-Abeba entre 1936 et 1938.
Il faut attendre la fin des années 1920 pour que la conquête de l'intérieur du territoire par l'administration coloniale commence, symbolisée par la mort de l'administrateur Albert Bernard le 17 janvier 1935. Elle aboutit en 1943, après de durs affrontements avec les tribus nomades, et de nombreuses exactions, à l'installation d'un poste français à Afambo. Il faut ensuite 10 ans de négociations avec l'Éthiopie (1945-1955) pour que la frontière du territoire soit tracée à l'est des lacs.
an 1939-1945 : Afrique du Sud - Au moment de faire accepter par le parlement l'entrée en guerre au côté du Royaume-Uni, la coalition gouvernementale vole en éclats. Alors qu'Hertzog défend le principe de neutralité de l'Afrique du Sud, Smuts soutient celui de l'engagement au côté des Britanniques. Malgré l'appui des voix nationalistes, de Malan à Hertzog, l'entrée en guerre est votée à une courte majorité. Hertzog démissionne et Smuts se retrouve seul au pouvoir.
Sur le front international, l'Afrique du Sud est engagée au côté des alliés et Jan Smuts fait partie du cabinet de guerre de Winston Churchill. L'intervention de l'aviation sud-africaine permet de libérer l'Éthiopie des Italiens, alors qu'un fort contingent sud-africain contribue à éliminer les forces vichystes à Madagascar. L'armée de terre sud-africaine subit de lourdes pertes lors de la bataille de Tobrouk, mais les fantassins sud-africains, sous le commandement de Montgommery, repoussent les troupes allemandes hors de l'Afrique. En Europe, la sixième division blindée sud-africaine participe à la guerre en Italie au côté de la cinquième armée américaine. En tout, 334 000 Sud-Africains servent, à titre volontaire, dans les forces sud-africaines durant la Seconde Guerre mondiale et 12 080 y perdirent la vie. Seuls les blancs sont autorisés à porter les armes et à servir dans les unités combattantes, mais plusieurs milliers de noirs et de métis servent dans les troupes auxiliaires et près de 5 000 d'entre eux sont tués dans les combats et bombardements d'Afrique du Nord et d'Italie.
Sur le plan intérieur, durant les années 1939-1945, des groupuscules armés afrikaners et pronazis, tel l'Ossewabrandwag (littéralement, « la sentinelle des chars à bœufs »), se multiplient et mènent des actions de sabotages. La répression du gouvernement Smuts est impitoyable ; ces groupements sont vite dissous et leurs dirigeants arrêtés et emprisonnés. Parmi les militants et sympathisants de ces organisations, figure le futur premier ministre Balthazar John Vorster. Ces Afrikaners ne sont pas les seuls à s'opposer à l'entrée de l'Afrique du Sud dans le second conflit mondial. Par hostilité tout à la fois envers le capitalisme, l'impérialisme britannique et le colonialisme, des dirigeants noirs et indiens expriment leur désapprobation. Yusuf Dadoo, un influent dirigeant du congrès indien du Transvaal et membre du parti communiste sud-africain, prononce plusieurs virulents discours contre la guerre et le suivisme du gouvernement sud-africain, ce qui lui vaut plusieurs séjours en prison. En conséquence des discours anti-guerre et par prévention des troubles, les grèves des travailleurs noirs sont déclarées illégales au titre de l'effort de guerre
Malan et les nationalistes, auxquels s'étaient joints Hertzog et ses alliés, s’unissent dans un « Parti national réunifié ». Mais, très vite en désaccord avec les ultras proches de Malan, Hertzog quitte le parti et fonde le Parti afrikaner, repris après sa mort en 1943 par Nicolaas Havenga.
Malan et les « nats » évitent dans ces années de guerre d'être impliqués dans des actions de sabotage mais sont équivoques dans leur soutien ou condamnation morale de ces groupuscules. En 1941, Malan prend ostensiblement ses distances vis-à-vis de tous les mouvements sud-africains pro-nazis ou antiparlementaires, faisant condamner dans le journal Die Transvaler, par la plume d'Hendrik Verwoerd, la dissidence de l'ancien ministre Oswald Pirow et de son nouveau parti, « Ordre Nouveau » (Nuwe Order), au programme ouvertement pro-nazi. Lors des élections de 1943, en remportant 16 sièges supplémentaires par rapport aux élections de 1938 et 36 % des suffrages, le Parti National parvient à juguler le parti de Pirow, qui n'a aucun élu, alors que le Parti Uni (105 sièges), toujours victorieux, voit sa majorité se réduire enco.
De son côté, le congrès national africain, qui peine à s'imposer dans la société civile noire sud-africaine, entreprend de se reconstruire sous la direction d'Alfred Xuma. Son but est de transformer l'organisation intellectuelle qu'est l'ANC en un véritable parti de masse. En 1943, il fait adopter une nouvelle charte constitutionnelle qui ouvre l'adhésion à l'ANC aux gens de toute race, élimine de l'organigramme la chambre des chefs tribaux et accorde aux femmes des droits égaux aux hommes au sein du mouvement. En 1944, il facilite, au sein du monde étudiant, principalement à l'université de Fort Hare, la création de la ligue des jeunes de l'ANC par Nelson Mandela, Walter Sisulu et Oliver Tambo, dont l'objet est un renouvellement des idées et la formation des cadres d'un parti vieillissant. Cette ligue de jeunesse se révèle vite plus radicale que son aînée dans son mode d'expression, partisan de manifestations de masse pour faire aboutir les revendications d'égalités raciale et politique de la majorité noire121. Elle conteste notamment le bilan de ses aînés, plaide pour une émancipation morale vis-à-vis du paternalisme blanc et pour l'affirmation d'un nationalisme sud-africain noir, débarrassé de ses oripeaux ethniques.
an 1939-1945 : Algérie - En Algérie, la conscription engage 123 000 musulmans et 93 000 Européens (« pieds-noirs ») dans l'armée française ; 2 600 des premiers et 2 700 des seconds sont tués dans les combats de 1940. L'occupation allemande (1940-1944) voit également plusieurs centaines de musulmans nord-africains installés en métropole s'engager dans la Milice française (vichyste), constituant la Légion nord-africaine.
Fin juillet 1940, le gouverneur général Georges Lebeau, en place depuis septembre 1935, est limogé et remplacé par l’amiral Abrial qui préside à la mise en œuvre des lois du régime de Vichy avant de laisser lui-même la place au général Weygand : le nouvel ordre colonial voulu par Vichy est instauré. Le statut des Juifs est appliqué aux Juifs d'Algérie, le décret Crémieux est aboli en 1940, avant d'être rétabli en 1944.
Parallèlement à la prise de contrôle d'Alger par la résistance le 8 novembre 1942, à laquelle des Juifs d'Algérie prennent part, les Anglo-Américains débarquent à Oran, Arzew, Alger et à Bône : c'est l'opération Torch, avec sa déclinaison oranaise, l'opération Reservist. Contrairement à ce qui se passe à Alger, les troupes vichystes d'Oran combattent les Alliés, et de nombreux Anglo-Américains sont tués et les survivants faits prisonniers. Malgré l'échec de Reservist, les vichystes se rendront deux jours plus tard.
Le 8 novembre 1942, au lendemain du débarquement anglo-américain en Algérie, réalisé sans le concours de la France Libre, le général de Gaulle lance depuis Brazzaville (Congo) un appel aux Français d'Afrique du Nord sur les ondes de la BBC. Il s'adresse aux colons et leur demande de collaborer avec les Anglo-Américains.
Le général Henri Giraud prend alors le commandement civil et militaire en Algérie. Les Algériens sont remobilisés pour poursuivre la guerre aux côtés des Alliés. L'hymne de l'armée d'Afrique est la version 1943 du chant des Africains. Les effectifs mobilisés en Algérie s'élèvent sur cette période à 304 000 Algériens (dont 134 000 musulmans, et 170 000 Européens). Ils sont engagés en Tunisie de novembre 1942 à mai 1943, en Italie de novembre 1943 à juillet 1944, et enfin en France et en Allemagne d'août 1944 à juin 1945.
En 1944, les grandes lignes du projet Viollette ont été reprises, voire amplifiées : les élections législatives de 1946 sont un succès pour l'Union démocratique du manifeste algérien (UDMA) de Ferhat Abbas. Son parti remporte onze des treize sièges réservés à l'Algérie à l'Assemblée nationale. La loi sur le statut de l'Algérie est promulguée en septembre 1947 : l'Algérie reste composée de trois départements et le pouvoir est représenté par un gouverneur général nommé par le gouvernement français. Une Assemblée algérienne est créée, composée de deux collèges de 60 représentants chacun ; le premier sera élu par les Européens et une élite algérienne (diplômés, fonctionnaires…) (63 194 exactement) et le second par le reste de la population algérienne. Enfin l'article 2 précise « l'égalité effective est proclamée entre tous les citoyens français ».
an 1939 : Cameroun - Le médecin colonial Jean-Joseph David (1900c-1969) est en poste au Haut-Nyong de 1939 à 1943, à la direction de la "région médicale" du Haut-Nyong, avec les pleins pouvoirs, avec comme centre Ayos. Secondé par cinq médecins, il y mène un gouvernement par la médecine, contre la maladie du sommeil (en résurgence malgré le travail d'Eugène Jamot dans cette même région), et pour l'exploitation du latex et du rutile4. Il y reconduit son expérience de médecin-résident à Wallis des années 1933-1938. Guillaume Lachenal en a tiré le livre d'enquête biographique Le médecin qui voulut être roi. Sur les traces d’une utopie coloniale (Paris, Seuil, 2017)5,6. Les cinq autres médecins sont Henri Koch (à Messamena)7, Eugène Pape (à Abong-Mbang), Fernand Gailhbaud, Sylvain Lagarde et le capitaine Giraud. La superficie du territoire équivaut à celle de la Suisse ou de la région Rhône-Alpes.
Les travaux d'Eugène Jamot (1879-1937) et de ses équipes (et ceux de leurs prédécesseurs allemands) sont repris, avec les hypnoseries, cantonnements sanitaires pour les populations atteintes de maladie du sommeil (trypanosomiase africaine), ou sommeilleux.
Les léproseries, ou colonies agricoles de lépreux, la lèpre n'étant pas (ou plus) une maladie prioritaire, sont déléguées aux missionnaires, de même que le traitement du pian, du paludisme, de la filariose ou de la syphilis.
La région se revendique expérience d'hygiène intensive et de développement local (relèvement rural à la française) : protocoles expérimentaux, formation s d'infirmiers et de médecins locaux (et de moniteurs agricoles et d'aides-surveillants), écoles, aménagements divers, routes, villages-modèles, sport, petit cheptel, cacao, margousier (arbre neem), etc. L'obligation de planter 500 pieds de cacaoyers par individu (puis de café) peut et doit se comprendre comme incitation à une production personnelle et à la création d'une société de petits planteurs indépendants : « l'émergence de communautés villageoises fixées dans l'espace, productives, imposables et contrôlables reste l'objectif auquel aspirent ensemble médecins et administrateurs » (Lachenal).
Une interprétation totalitaire est également possible, même pour un tel territoire périphérique : le système David (David l'Empereur, façon colonel Kurtz (du roman Au cœur des ténèbres (1899)) devient « le mauvais rêve des missionnaires » (avec leurs sixa, sisters schools, ou écoles de fiancées) et surtout des entrepreneurs coloniaux (grandes plantations de café, chantiers routiers, forestiers, caoutchouc, huile de palme, minerais (rutile). L'expérience manque vite de personnels formés, de médicaments, de crédits ; elle est stoppée en 1947. Et Jean Joseph David, après Alger, Belfort, Dachau, Mainau, Reichenau, Fréjus, Abidjan, Saïgon, prend une retraite anticipée en 1955 et travaille ensuite comme délégué médical pour une petite entreprise pharmaceutique. Seul Henri Koch semble avoir été plus efficace à son poste (« il a beaucoup travaillé ici »).
an 1939-1945 : Canaries (Îles des) - La période franquiste (1939-1975) - Les Canaries et la Seconde Guerre mondiale
Lors de la bataille de l'Atlantique (1939-1945), selon l'implication de l'Espagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'abord la politique extérieure franquiste durant la Seconde Guerre Mondiale (es), l'archipel des Canaries semble avoir été peu touché par les combats. L'histoire militaire de Gibraltar durant la Seconde Guerre mondiale, dont l'opération Felix, concerne directement les mouvements des convois de bateaux, commerciaux ou non, en Atlantique, et particulièrement entre les Canaries et l'Espagne. La zone semble avoir été relativement calme, à part la bataille de Dakar, le sous-marin italien Giuseppe Finzi. Une escadrille de 24 avions de combat est installée à l'aéroport de Gando pour contrer d'éventuelles attaques anglaises ou françaises.
an 1939-1957 : Ghana - En 1939, lors de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni s'engage contre l'Allemagne nazie. Les grandes villes britanniques sont bombardées et la flotte anglaise est gravement endommagée. Le pays ne sort victorieux de la guerre que grâce à son courage et à l´aide de son empire et de ses alliés : États-Unis, Australie, Canada. Les troupes américaines, canadiennes et alliées occupent la Grande-Bretagne pour préparer les débarquements en Italie puis en France. Le pays dévasté ne se reconstruit que grâce à l’aide financière américaine. Le Royaume-Uni est donc lourdement endetté et soutenu avec toutes ses colonies par les États-Unis. Le glas de l’Empire britannique sonne. L’Inde, colonie gigantesque devient indépendante deux ans après la guerre, en 1947.
Les superpuissances américaine et soviétique sont opposés au colonialisme, et poussent la Grande-Bretagne à faire des réformes en 1956. Pendant la crise du canal de Suez, les troupes britanniques sont obligées de se retirer sous la menace nucléaire soviétique. La Grande-Bretagne est alors diminuée sur le plan international.
En 1925, les Britanniques ont organisé des élections au Ghana, afin d’élire un conseil législatif des chefs autochtones. Mais la vie politique ne se développe réellement qu’après la Seconde Guerre mondiale. À la suite des troubles nationalistes incessants, les Britanniques donnent plus d’autonomie au pays. Un fait majeur dans le chemin vers l’indépendance a lieu en 1951, avec la victoire du Parti de la convention du peuple (Convention People's Party, CPP), fondé en 1949 par Kwame Nkrumah. Aux élections législatives qui suivent, Kwame Nkrumah devient chef du gouvernement local, et, en collaboration avec les autorités britanniques, il obtient l’indépendance, proclamée en janvier 1957.
an 1939-1945 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Le régime dictatorial salazariste domine le Portugal et son empire de 1933 jusqu'en 1974.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Portugal étant réputé neutre et non belligérant, Madère peut accueillir des réfugiés européens à titre humanitaire, environ 2 000, depuis Gibraltar, menacée par l'opération Felix.
an 1939-1945 : Maroc - La Seconde Guerre mondiale
La promulgation en mai 1930 du Dahir berbère va, à partir de la médina de Salé, provoquer la réaction pacifique de la jeunesse nationaliste dans tout le pays, avec la récitation de la prière du latif dans les mosquées et la signature de télégrammes de protestation contre ledit dahir le 28 août 1930, avant de passer à une coordination nationale de la protestation par la création d'un Comité d'action marocaine dès 1934. Interdit en 1937, tous ses initiateurs sont pourchassés, emprisonnés ou exilés. Parmi eux il faut citer Allal El Fassi (exilé au Gabon), Mohamed Hassan Ouazzani (placé sous résidence surveillée), Ahmed Balafrej, qui sont les fondateurs historiques du mouvement pour l'indépendance. L'affaire du dahir berbère aura tout de même déclenché une vaste mobilisation médiatique dans le monde musulman, grâce notamment à l'action de l'émir druze libanais Chekib Arslan, fervent militant de la cause arabe et ami personnel de nombreux leaders nationalistes marocains.
La Seconde Guerre mondiale se déclenche en Europe alors que l'opposition nationaliste au Maroc est décimée par la répression. Ses dirigeants n'ont jamais appelé à pactiser avec les forces de l'Axe germano-italo-japonais contre l'occupant français (à l'exception de Brahim Ouazzani). Mieux ils ont attendu, et profité du débarquement américain de 1942 au Maroc, pour reprendre leur mouvement public de revendication.
La défaite de la France a pour conséquence de placer l'administration coloniale sous les ordres du régime de Vichy pro-hitlérien et collaborationniste, qui veut obliger le sultan Sidi Mohammed ben Youssef (futur roi Mohammed V), souverain chérifien depuis 1927, à appliquer les lois antisémites d'inspiration nazie aux Marocains de confession juive. Mais le sultan s'y refusera et cette attitude ainsi que son soutien indéfectible à la cause de la France libre lui vaudront la reconnaissance de Charles de Gaulle lors de la victoire alliée de 1945, reconnaissance symbolisée par la dignité de compagnon de la Libération conférée au sultan marocain.
En novembre 1942 a lieu le débarquement américain sur les côtes marocaines, à Port-Lyautey (Kénitra), Fédala (Mohammedia), Casablanca et Safi. Il s'agit de l'opération Torch, supervisée par les généraux Eisenhower et Patton. Les forces fidèles à l'État français sont rapidement mises en déroute, et le protectorat français du Maroc quitte le camp de Vichy et de l'Axe pour celui des Alliés. Il s'ensuit en janvier 1943 la conférence de Casablanca, qui rassemble le président américain Franklin Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill, ainsi que le chef de la France libre, le général de Gaulle, et son rival en Afrique française du Nord le général Henri Giraud. Cette conférence, malgré l'absence remarquée de Staline, marque un tournant dans le déroulement de la guerre. Les dirigeants alliés annoncent en effet la poursuite du conflit jusqu'à capitulation inconditionnelle de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste et du Japon impérial, ainsi qu'une aide matérielle importante à l'URSS et l'ouverture de nouveaux fronts en Europe occidentale avec les débarquements projetés en Sicile (opération Husky) et en Normandie (opération Overlord). Localement la conférence a également un impact déterminant. Le sultan Mohammed Ben Youssef est en effet invité à Anfa par Roosevelt et Churchill, et reçu avec tous les honneurs dus à un chef d'État à part entière. L'impact d'un tel événement influe sur la structuration forte du mouvement nationaliste marocain qui réclame désormais ouvertement l'indépendance et l'abrogation du traité de Fès.
Le souverain chérifien, à la suite de la victoire alliée, donne son appui à la France libre, et soutient l'organisation et le recrutement des forces françaises en Afrique du Nord. Le Maroc paie un lourd tribut à la guerre européenne : entre 25 000 et 30 000 hommes tombent pour la libération de la France. Les goumiers marocains s'illustreront notamment au cours de la campagne de Tunisie, de la campagne d'Italie, du débarquement en Provence, puis au cours de la campagne d'Allemagne.
Par conséquent, un puissant esprit de contestation nationaliste se développe dans le pays. L'invasion de la France par les Allemands puis, en 1942, le débarquement américain sur les côtes marocaines, avaient atteint l'autorité de la métropole et jeté le discrédit sur le résident Charles Noguès, qui avait autorisé l'installation d'une délégation de la Commission allemande d'armistice à Casablanca en 1940, dans le cadre de la collaboration entre les autorités françaises de Vichy et le IIIe Reich. En 1943, le parti de l'Istiqlal (Indépendance) est créé par le principal courant nationaliste marocain qui publie le Manifeste de l'Indépendance le 11 janvier 1944.
Mohamed Hassan El Ouazzani, alors en exil intérieur au Sud marocain, rival d'Allal El Fassi depuis 1934, fonde son propre parti, le modeste PDI (Parti démocratique de l'indépendance). L'Istiqlal et, dans la mesure de ses moyens le PDI, vont organiser des réseaux clandestins à travers de nombreuses régions avec comme objectif ultime l'obtention finale de l'indépendance. Dans la zone espagnole s'active le Parti de la Réforme nationale d'Abdelkhalek Torrès, inspiré par certains mouvements nationalistes arabes du Machrek comme le PSNS ou Misr El-Fatat, et marqué sur le plan idéologique par une influence notable du phalangisme hispanique avec son organisation paramilitaire de jeunesse des Fityanes.
an 1939-1945 : Oubangui-Chari Centrafrique - Durant la Seconde Guerre mondiale, la colonie se joint aux Forces alliées.
an 1939-1945 : Afrique Côte d'Ivoire - Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale accroît les difficultés économiques et financières locales. Outre l’impôt de capitation, les prestations obligatoires se multiplient et les populations versent des « dons pour la défense de la Côte d’Ivoire et de la France ». Mais l’effort de guerre est surtout militaire avec des milliers de recrues mobilisées et envoyées sur les champs de bataille en Europe et en Afrique du Nord. Après la défaite de juin 1940, ce sont de nombreux volontaires ivoiriens qui s’engagent aux côtés du général Charles de Gaulle dans la Résistance.
Avant la fin de la guerre 1939-1945, les populations encore inorganisées commencent assez timidement une lutte pour l’émancipation politique, sociale et économique. Mais à partir de 1945, en Côte d’Ivoire comme dans toutes les colonies françaises d’Afrique, la vie politique s’organise en prenant appui sur la Conférence de Brazzaville. Les Ivoiriens participent à leurs premières élections municipales (Abidjan et Grand-Bassam) et législatives, les territoires d’outre-mer devant désormais, par décision de l’autorité coloniale, être représentés à l’Assemblée nationale constituante française. En dépit de l’opposition de l’administration locale, Félix Houphouët-Boigny se porte candidat en Côte d’Ivoire devant le collège des non-citoyens. Il devance son adversaire de plus de mille voix et, au deuxième tour le 4 novembre 1945, est élu député avec 12 980 voix sur 31 081 suffrages exprimés. À la seconde Assemblée nationale Constituante, il est réélu plus facilement au Parlement français avec 21 099 voix sur 37 888 suffrages exprimés.
an 1939-1945 : Afrique République de Djibouti - Jusqu'en 1939, le pays connaît un important développement économique, autour du port, du chemin de fer et des salines. Une nombreuse main-d'œuvre afflue dans la ville, principalement issue de territoires limitrophes (Éthiopie, Somalie britannique et Yémen principalement). L'invasion de l'Éthiopie par l'Italie en 1936 donne un coup de fouet temporaire à l'activité commerciale.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés instaurent un blocus du pays dont les autorités choisissent de soutenir le gouvernement de Vichy. Une partie de la « population indigène » est expulsée de la ville de Djibouti, qui connaît alors une grave crise, voire une véritable famine. Le ralliement du territoire aux Alliés en décembre 1942 permet sa réintégration dans les circuits économiques.
Les forces armées françaises appuient leur allié britannique en Somalie britannique jusqu'à l'armistice du 24 juin 1940. Les Potez 25 TOE de l'escadrille de la Côte française des Somalis mènent en juin 1940 des missions de reconnaissance en Éthiopie et en Somalie. Ils bombardent le poste italien de Dewele, lors de la conquête italienne du Somaliland britannique. La Regia Aeronautica bombarde Djibouti du 21 au 23 juin 1940 ou le seul 22 juin.
En juin 1940, Paul Legentilhomme, commandant supérieur des troupes françaises en Côte des Somalis, refuse les armistices signés par la France avec l’Allemagne (armistice du 22 juin 1940) et l’Italie (armistice du 24 juin 1940) et souhaite poursuivre le combat aux côtés de l’Angleterre. Mais il ne parvient pas à entraîner la colonie qui préfère faire acte d’allégeance au gouvernement de Vichy. Il passe au Somaliland britannique le 2 août 1940 pour rejoindre de Gaulle.
Le gouverneur vichyste Pierre Nouailhetas, en place depuis le 2 septembre 1940, est confronté au blocus maritime et terrestre par les forces britanniques. Le général britannique Archibald Wavell pensait ainsi forcer l'administration de la colonie à rallier les gaullistes. Le blocus s'intensifia surtout après le mois d'avril 1941, coïncidant à la fin de l'occupation italienne en Éthiopie. Les Britanniques qui contrôlent alors l'Éthiopie, coupent le ravitaillement terrestre de Djibouti. Des avions de l'escadrille de la Côte française des Somalis (CFS) exécutent des missions de ravitaillement, mais le tonnage reste insuffisant. L'administration coloniale décide alors d'expulser de la ville les « bouches inutiles » autochtones (en particulier les femmes, enfants et personnes âgées) pour limiter les besoins en approvisionnement. Cette mesure augmente les difficultés alimentaires de la population, au point que certains parlent de famine.
Malgré cela, les Britanniques ne purent imposer un blocus total, ne pouvant interrompre les réseaux commerciaux sur terre et sur mer. En effet, ces événements faisaient monter les prix des denrées, et l'administration participait au financement de la contrebande.
Les forces du général Wawell relâchèrent néanmoins leur emprise après l’entrée en guerre de la zone Pacifique en décembre 1941, et les mois suivants, tentèrent en vain de rallier la Somalie française aux forces alliées. Le gouvernement de Vichy, inquiété par ces tentatives de pourparlers, rappela le gouverneur Nouailhetas qui quitta le territoire djiboutien le 9 octobre 1942. Les événements de novembre, largement en défaveur du gouvernement de Vichy (prise du contrôle par les Alliés de l’Afrique du Nord, invasion de la zone libre par les nazis et sabordage de la flotte française à Toulon), ébranlèrent l’opinion des Français de Djibouti. Le général Truffert, nouveau gouverneur vichyste, est désavoué par une forte faction de militaires et de civils européens. Il démissionna en faveur de son adjoint, le général Dupont qui également proche de Vichy dut faire face à cette même fronde. La période d’instabilité qui s’ensuivit prit fin le 28 décembre avec la signature d’un accord cédant tous les pouvoirs au Comité national français. Le 30 décembre, le gouverneur André Bayardelle, nommé par le général de Gaulle, prenait ses fonctions.
Le blocus prenait fin et tous territoires de l’océan Indien passaient alors du côté des Alliés. Djibouti pouvait de nouveau jouer son rôle de port de transit à l'entrée de la mer Rouge et de débouché de l'Éthiopie. De plus, les gaullistes trouvaient dans les 300 officiers, les 8 000 hommes et le matériel en place non négligeable, un précieux renfort.
an 1940 : Algérie - Sous le régime de Vichy les juifs d'Algérie furent à nouveau discriminés par la loi comme l'étaient les Algériens issus d'une culture musulmane en Algérie de 1940 à 1942 (Chantiers de la jeunesse française).
Descendant direct de l'émir Abd el Kader, l'émir Khaled mit sa prestance personnelle et son prestige, au service d'un programme essentiellement moderniste, qui lui a valu l'exil : représentation au Parlement à proportion égale avec les Européens algériens ; suppression des lois et mesures d'exception des tribunaux répressifs, des cours criminelles, de la surveillance administrative, mêmes charges et droits que les Français en ce qui concerne le service militaire, accession pour les indigènes algériens à tous les grades civils et militaires, sans d'autres distinctions que le mérite et les capacités personnelles, application de la loi sur l'instruction publique obligatoire, liberté de presse et d'association, application au culte musulman de la loi de séparation des Églises et de l'État, amnistie générale, application aux indigènes des lois sociales et ouvrières ; liberté absolue pour eux de se rendre en France.
L'Algérie connaît alors une croissance économique rapide, en particulier dans le minerai de fer, avec l'émergence de la Société de l'Ouenza, dixième entreprise française, qui prend le relais de l'importante et plus ancienne Société Mokta El Hadid.
an 1940 : Cameroun - Le Cameroun français se rallie à la France libre en août 1940 au sein de l'Afrique française libre. Le système instauré par la France libre s'apparente à une dictature militaire. Leclerc instaure l'état de siège sur tout le territoire et abolit presque toute liberté publique. L'objectif est de neutraliser tout sentiment potentiellement indépendantiste ou de sympathie pour l'ancien colonisateur allemand. Les indigènes connus pour leur germanophilie sont exécutés en place publique.
an 1940-1946 : Archipel des Comores - En 1940 à Anjouan, éclate une grève lorsque l'administration fait savoir qu'elle va réquisitionner la main d'œuvre pour les exploitations coloniales. Des violences éclatent lorsque la grève échoue, les notables finissent par appeler au calme
Pendant la Seconde Guerre mondiale, du 6 juin 1940 à 1942, l'administration coloniale est exercée par le régime de Vichy. Après 1942, celui-ci échoit, comme celui de Madagascar, au Royaume-Uni jusqu'au 13 octobre 1946 où l'ensemble est restitué à la France du Général de Gaulle.
an 1940 : Congo Kinshasa - Le Congo entre en guerre du côté des Alliés. La force publique remporte les victoires de Saïo et d'Asosa contre les forces italiennes d'Abyssinie. Certains de ses éléments s'en iront combattre en Égypte et Palestine.
Dès les années 1940, dans ce qui était alors le Congo belge, deux tendances indépendantistes importantes se manifestaient dans la capitale Léopoldville : celle des « gens d'en bas » (Bas-Congo et Bandundu) parlant le kikongo et kikongo ya leta puis celle des « gens d'en haut » parlant le lingala, venant de l'Équateur d'abord et finalement de tout l'intérieur du pays.
an 1940 : Gabon - Le Gabon est d'abord tenu par des forces vichystes, mais après la brève campagne du Gabon, il passe, avec l'AEF, dans le camp de la France libre. Ses dirigeants coloniaux sont alors internés.
an 1940 - 1945 : Libye - Le 28 juin 1940, peu après l'entrée en guerre de l'Italie, Italo Balbo meurt dans un incident aérien. Rodolfo Graziani est rappelé en Libye pour lui succéder. Les autorités fascistes déportent des milliers de Juifs libyens dans des camps de concentration en plein désert, où beaucoup mourront. L'offensive menée par Graziani, sur ordre de Mussolini, contre les forces britanniques de Archibald Wavell, est un échec, qui tourne à la déroute pour les Italiens lors de la contre-offensive alliée. En février 1941, les Britanniques occupent Benghazi; l'Afrikakorps d'Erwin Rommel est appelée à la rescousse des Italiens et les combats se poursuivent jusqu'en 1943, quand la contre-offensive de Bernard Montgomery aboutit à l'occupation de Tripoli. Les Forces françaises libres prennent quant à elles le contrôle du Fezzan et du Ghadamès au sud-ouest du pays.
À la fin de la guerre mondiale, la Tripolitaine et la Cyrénaïque sont sous occupation britannique, et le Fezzan sous occupation française. L'émir Idris, naguère exilé par les Italiens, fait un retour triomphal en Cyrénaïque en 1945.
an 1940 : Sénégal - Bombardement de Dakar par les Anglais. Echec de la tentative de débarquement de De Gaulle.
an 1940 - 1942 : Togo - La Seconde Guerre mondiale arrive à un moment où, dans l'ensemble, le Togo est paisible. Après l'armistice signé en juin 1940, le pays est placé sous le contrôle du Régime de Vichy. La frontière avec l'ancien Ghana (la Gold Coast) est fermée. Les approvisionnements deviennent rares. L'une des premières conséquences du débarquement en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, est l'internement des commerçants anglophiles, dont Sylvanus Olympio. Cependant comme le régime de Vichy perd le contrôle de ce territoire et que l'Afrique-Occidentale française (AOF) entre en guerre contre l'Allemagne, les frontières s'ouvrent petit à petit, et les suspects sont libérés.
an 1941-1945 : Algérie - Condamné en 1941 puis mis en résidence surveillée dès 1943, Messali Hadj continue de correspondre avec ses partisans. En avril 1945, quand le projet de son évasion est mis à jour il est transféré au Sahara puis à Brazzaville. Un projet d'insurrection est mis en place par les Amis du manifeste et de la Liberté (AML). Le 8 mai 1945 ont lieu des manifestations d'Algériens dans plusieurs villes de l'Est du pays (Sétif et le Constantinois), pour rappeler les revendications nationalistes de manière concomitante avec la liesse de la victoire. À Sétif, après des heurts entre policiers et nationalistes, la manifestation tourne à l'émeute et la colère des manifestants se tourne contre les Français: 102 européens trouveront la mort lors de ces événements. La répression exercée par l'armée française et les milices d'auto-défense créées par les Européens est extrêmement brutale : elle provoque la mort de 3 000 à 20 000 Algériens mais le nombre exact est inconnu. La radicalisation que cela engendre dans les milieux nationalistes algériens est telle que certains historiens considèrent ces massacres comme le véritable début de la guerre d'Algérie.
an 1941 - Cap Vert - Les sécheresses chroniques dues à la déforestation entraînent toutefois des famines régulières, accentuées par l'absence d'aide alimentaire.
Entre 1941 et 1948, on compte ainsi 50 000 morts, soit plus du tiers de la population, dans l'indifférence des autorités portugaises.
Le manque de ressources naturelles et d'investissements effectués par les Portugais provoquent le mécontentement de la population. Les colons refusent en outre toute velléité d'autonomie locale. Les revendications autonomistes croissent au cours du XXe siècle.
En 1941, les Rabelados (pt) de l'île de Santiago, des groupes de villageois, ainsi désignés par leurs contemporains, décident à l'époque, de s’isoler des autres cap-verdiens. Les Rabelados constituent un cas unique au Cap-Vert Ils se sont rebellés à l’époque contre de nouveaux prêtres qui arrivaient aux Iles du Cap-Vert pour moderniser l’église catholique et dont les pratiques plus "standard" que celles de leurs prédécesseurs s’opposaient aux croyances locales. Après un isolement de plus d’un demi-siècle, les Rabelados, groupe d'environ mille personnes, qui se considèrent comme africains et non comme métisses, reprennent progressivement des liens avec les autres habitants de l'ile.
an 1941 : Érythrée - Les Britanniques envahissent l'Érythrée le 18 janvier 1941, jour de la prise de Kassala à la frontière avec le Soudan. La direction des opérations est assurée par le lieutenant général William Platt, commandant des forces britanniques au Soudan. Les 4e et 5e divisions d'infanterie indiennes, commandées respectivement par les majors généraux Noel Beresford-Peirse et Lewis Heath, progressent durant les deux semaines suivantes en direction de la ville fortifiée d'Agordat. La 4e division indienne prend la route septentrionale par Sabderat, Keru et Agordat et la 5e division indienne la route méridionale par Tessenei et Barentu. Elles parcourent 160 km en 9 jours et enlèvent successivement plusieurs villes aux Italiens. Elles percent les positions italiennes dans les collines et prennent Agordat le 1er février, après deux jours de combat (4e division), et Barentu le lendemain (5e division).
La bataille décisive de la campagne a lieu à Keren, ville à 100 kilomètres à l'est d'Agordat. La bataille de Keren marque un tournant de la conquête de l'Érythrée et de l'Éthiopie par les Britanniques. Après cet affrontement, la résistance des troupes italiennes est beaucoup plus faible. Selon Pierre Messmer, les Italiens estiment ne plus être en mesure de remporter la victoire sur ce théâtre d'opérations et la capitulation de leurs unités est en général rapide.
La 5e division indienne se dirige ensuite vers la capitale Asmara, à 80 kilomètres à l'est de Keren, tandis que la 4e division indienne reste à Keren quelques jours et retourne en Égypte début avril. Asmara est déclarée ville ouverte et les troupes britanniques s'en emparent le 1er avril. Trois jours plus tard, la 10e brigade indienne se dirige vers Massaoua située à une centaine de kilomètres d'Asmara, sur la côte. Les Italiens disposent de 10 000 hommes, de tanks et de véhicules blindés pour défendre Massaoua, un objectif portuaire stratégique. Après quelques affrontements initiaux, la résistance s'effondre et les unités indiennes et la brigade française d'Orient prennent Massaoua le 8 avril.
an 1941-1974 : Éthiopie - En 1941, année de la libération, s'ouvre une nouvelle période nommée Addis Zemen (en français : Nouvelle Ère) à la suite de la défaite italienne devant les forces anglo-françaises au nord du pays, les Italiens qui occupaient Addis-Abeba ayant capitulé et la Force publique du Congo belge, attaquant au sud, ayant reçu la capitulation italienne d'Asosa. Dès lors, il s'agit pour Haïlé Sélassié de reprendre les chantiers ouverts en début de son règne. Le pays connaît alors une période d'industrialisation et de croissance économique, mais également divers troubles, notamment de la part de troupes restantes italiennes qui y mènent une guérilla.
Les premières années de reconstruction voient se succéder de nombreuses réformes conduisant à de nettes améliorations sociales et économiques dans le pays.
Du point de vue législatif, un journal officiel, la Negarit Gazeta est créé le 30 mars 1942. Une loi sur l'abolition de l'esclavage parait le 27 août 1942. Le parlement rouvre le 2 novembre 1942. Le 30 novembre une loi donne la mainmise du gouvernement sur les revenus de l'Église.
De plus, des rébellions éclatent dans le Tigré en 1943, ainsi que dans le Godjam, le Balé, l'Ogaden et en Érythrée durant les années 1960.
On observe également durant ces années de très nettes améliorations de la santé publique (augmentation du nombre d'hôpitaux, progrès de la médecine), du système éducatif (on compte 36 fois plus d'écoles modernes en 1955 qu'en 1930), des infrastructures (construction de routes, télécommunications). Le Collège Universitaire d'Addis-Abeba ouvre le 27 janvier 1951.
Une nouvelle monnaie, le birr éthiopien est créée en 1945 et remplace le Thaler de Marie-Thérèse. Les exportations passent de 37 millions de birr en 1946 à 169 millions en 1954, essentiellement dues à la production de café multipliée par 10. Le budget passe de 1 million de dollars avant-guerre à 100 millions en 1955 ; la circulation monétaire de 80 millions en 1946 à 220 millions en 1954.
En 1955, date du jubilé du couronnement de Hailé Sélassié, une révision de la Constitution de 1931 est adoptée. Les députés sont élus au suffrage universel, mais les partis politiques restent interdits. Dans les faits, cette révision consolide le caractère absolutiste du pouvoir.
Haïlé Sélassié entame dès la libération une ouverture du pays à l'international dans l'idée « d'assimiler les nouvelles idées du progrès sans se départir de sa propre culture ». Cette approche lui offre très vite une stature internationale.
Le Negusse Negest renouvelle sa confiance dans l'idée de sécurité collective en dépit de l'agression de 1936, et l'Éthiopie adhère à la Charte des Nations unies en 1945.
L'ouverture à l'international conduit dès 1951 au soutien de l'Éthiopie à la guerre de Corée en échange d'une assistance militaire américaine. celle-ci conduit à la formation de trois bataillons éthiopiens et à la création d'Ethiopian Airlines. En échange de quoi, la base américaine de Qagnew, du nom du contingent éthiopien ayant servi en Corée, est créée en Érythrée.
L'Éthiopie participe activement au mouvement des non-alignés à partir de la conférence de Bandung en 1955 et joue un rôle de premier plan pour attirer dans cette coalition les États africains sortis du colonialisme.
De 1960 à 1964, l'Éthiopie fournit une brigade de casques bleus destinée au maintien de l'ordre et à l'évacuation des Belges durant la crise congolaise.
Manifestations contre le pouvoir politique ainsi que des grèves. Dans le contexte de la guerre froide, alors que la politique du Négus est plutôt favorable à l'occident, le bloc est européen soutient le mouvement de contestation, pris en main par un comité de militaires appelé Derg qui parvient en septembre 1974 à destituer Haïlé Sélassié Ier et à renverser la plus vieille monarchie du monde.
an 1941-1945 : Somalie - La domination italienne est de courte durée. Face aux attaques des alliés, Mussolini mobilisa toutes ses troupes pour défendre le front européen et la Grande-Bretagne reprend la Somalie dès 1941. Tant que dure la guerre, le pays est dirigé par l’administration militaire britannique appliquant la loi martiale, en particulier au nord où le souvenir de la révolte est encore frais. Cette politique est aussi mal accueillie que précédemment, et les rebelles peuvent se fournir en armes auprès des colons italiens restants et des autres ennemis de la Grande-Bretagne. Le protectorat britannique, qui a pour capitale la cité d’Hargeisa, perdure jusqu’en 1949, et connaît un certain développement économique. Les tribunaux autochtones restent compétents pour juger la plupart des cas. L’occupant n’expulse pas les citoyens italiens, à l’exception de ceux qui représentent clairement un danger. Le fait que la majorité d’entre eux restent fidèles à Mussolini et envoient des renseignements en Italie n’effraie guère la Grande-Bretagne en raison du peu d’intérêt stratégique de la région. Bien que considérés techniquement comme des ressortissants d’un État ennemi, les italiens sont même autorisés à créer leurs propres partis politiques en compétition directe avec l’autorité britannique.
Après la guerre, la Grande-Bretagne assouplit son contrôle militaire sur la Somalie et introduit un début de démocratisation. Plusieurs partis politiques autochtones voient le jour, dont la Ligue de la jeunesse somalie (LJS) en 1945. La Conférence de Potsdam ne règle pas définitivement le cas de la Somalie et ne tranche pas la question de savoir s’il faut continuer l’occupation par la Grande-Bretagne, rétrocéder la région à l’Italie ou lui accorder l’indépendance. Cette question est largement débattue sur la scène politique somalienne au cours des années qui suivent. Le nord et l’ouest désirent l’indépendance, tandis que les populations du sud apprécient la prospérité économique apportée par l’Italie et désiraient rester sous son administration.
an 1942 : Congo Brazzaville - L'amicale chargée de venir en aide aux tirailleurs (anciens combattants qui ont participé aux côtés de l'armée française à la Première Guerre mondiale). Cette amicale devient vite un mouvement de protestation, l'administration coloniale prend peur, et fait incarcérer Matsoua, qui meurt en prison en 1942, dans des conditions restées obscures. Le mouvement se transforme alors en une église qui recrute surtout dans l'ethnie d'origine.
an 1942-1946 : Côte d'Ivoire - Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Régime de Vichy garde le contrôle du territoire jusqu'à la fin 1942 : l'AOF se rallie ensuite à l'exécutif d'Alger, et passe l'année suivante sous l'autorité du Comité français de Libération nationale. La conférence de Brazzaville en 1944, la première assemblée constituante de 1946 et la gratitude de la France pour la loyauté des Africains poussèrent à des réformes à partir de 1946. La citoyenneté française fut accordée aux sujets africains, le droit de s'organiser politiquement leur fut reconnu, et le travail forcé fut aboli par la loi du 11 avril 1946, proposée par Félix Houphouët-Boigny.
La répression contre son parti, le PDCI, s'accentue à la fin des années 1940. Des militants sont régulièrement arrêtés et battus par des policiers, avec parfois des actes de tortures ; d'autres sont renvoyés de leurs emplois. L'un des principaux dirigeants du parti, le sénateur Victor Biaka Boda, est retrouvé pendu et déchiqueté dans la foret, alors qu'il était recherché par la police. Les tensions culminent au début de l'année 1950, quand, à la suite d’un incident, la quasi-totalité de la direction du PDCI est arrêtée. Des rassemblements de protestation sont organisés ; alors que la police tire à blanc pour disperser la foule, des colons tirent à balles réelles, tuant treize manifestants. Au lieu de rechercher les auteurs du massacre, les autorités, craignant des émeutes, font arrêter des milliers de militants indépendantistes.
an 1942-1947 : Érythrée - À la suite des victoires alliées du printemps 1941, les Britanniques administrent alors l'Érythrée. Dès 1942, des projets divers sont élaborés pour l'avenir du territoire. L'armistice, signé par l'Italie le 3 septembre 1943, ne contient aucune disposition concernant les anciennes colonies italiennes.
Dès 1944, l'ONU et les États-Unis proposent de rattacher l'Érythrée à l'Éthiopie, qui réclame un port sur la mer Rouge. Lors des conférences internationales (Potsdam, Londres, Paris), plusieurs solutions sont débattues (partition, indépendance, rattachement à l'Éthiopie, etc.), sans qu'une solution soit trouvée lors de la signature de la paix le 10 février 1947.
an 1942-1948 : Éthiopie - développement des troubles avec la Somalie
Le traité anglo-éthiopien de 1942 arrive à échéance en septembre 1944. L'Éthiopie exige un respect des conditions du traité soit l'évacuation du Haud et du Territoire Réservé par les Britanniques qui cherchent à retenir ces régions pour des raisons stratégiques. Ceux-ci sont finalement placés sous administration britannique jusqu'en 1948.
Le Territoire Réservé est rendu en 1948, mais Ernest Bevin, secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'Angleterre, se montre réticent à rendre le Haud et conçoit l'idée d'une Grande Somalie, comprenant la Somalie britannique, italienne, et l'Ogaden éthiopien. Cette idée est reprise par le mouvement de libération somalien en 1955 lorsque le Haud est rendu à l'Éthiopie.
an 1942 : Réunion (Ile de la) - le 30 novembre, La Réunion se rallie à la France libre.
an 1943 : Gambie - Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Gambie constitue une escale pour les vols de l'armée de l'air américaine et un port d'escale pour les convois des forces alliées. Fait anecdotique, le président américain Franklin Delano Roosevelt fait escale, en 1943, à Banjul, capitale de la Gambie, avant de se rendre à la conférence de Casablanca, ce qui constitue la première visite d'un président américain en exercice sur le continent africain.
an 1944 : Bénin (anc. Dahomey) - Le 8 février 1944 se termine à Brazzaville une conférence réunissant les dix-huit gouverneurs et gouverneurs généraux de l’AOF, de l’Afrique-Équatoriale française, de la Côte française des Somalis, de Madagascar et de La Réunion. Sous la présidence de René Pleven, commissaire aux Colonies du Comité français de la Libération nationale, cette réunion a pour mission d’émettre des recommandations sur la future législation coloniale. La présence du général Charles de Gaulle et la tenue d’une telle réunion alors que la guerre est loin d’être terminée montre le réel intérêt porté à l’avenir de ces territoires qui apparaissent alors comme l’incarnation de la permanence de la République hors du territoire métropolitain. Il ressort de Brazzaville l’idée d’une participation accrue de la population africaine à la vie politique et le désir d’abandonner les régimes d’exceptions auxquels elle est alors soumise comme le code de l’indigénat.
an 1944 : Maroc - De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle
11 janvier 1944 : signature du Manifeste de l'indépendance par 67 leaders nationalistes de toutes tendances ; les manifestations de soutien sont sévèrement réprimées et de nombreux leaders emprisonnés.
an 1945 : Afrique du Sud - En 1945, Smuts participe à la rédaction du préambule de l'Organisation des Nations unies.
an 1945 : Algérie - Dès l'issue de la Seconde Guerre mondiale, en 1945 et à la suite de la naissance d'un mouvement nationaliste, les partis (FLN, MNA, PCA, Mouvement libéral algérien, etc.) revendiquent l'indépendance de l'Algérie par rapport à la France ; s'ensuivit une guerre de 1954 à 1962 où intervinrent également les partisans d'une Algérie française (FAF et OAS).
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Charte de l'Atlantique, la première charte de l'ONU, le plan Marshall, la Ligue arabe, la conférence de San Francisco, etc., tout cela a contribué à l'indépendance de l'Algérie. Lors du congrès de mars de 1945 que les AML ont tenu, les délégués ont proclamé la nation algérienne constituée, Messali Hadj fut élu comme chef du peuple algérien.
Le 8 mai 1945 ont lieu des manifestations d’Algériens dans plusieurs villes de l’Est du pays (Sétif, et le Constantinois), qui devaient permettre de rappeler leurs revendications nationalistes, de manière concomitante avec la liesse de la victoire. À Sétif, après des heurts entre policiers et nationalistes, la manifestation tourne à l’émeute et la colère des manifestants se retourne contre les « Français » : une centaine trouveront la mort dans les jours suivants. La répression de l’armée française est brutale. Officiellement, elle fait 1 500 morts parmi les Algériens, chiffre potentiellement sous-estimé et probablement plus proche des 20 000 à 30 000 selon l’historien Benjamin Stora. Le Parti du peuple algérien (PPA) estime qu'il y a eu 45 000 morts. De par la radicalisation qu'ils ont engendrée dans les milieux nationalistes algériens, certains historiens considèrent ces massacres comme le véritable début de la guerre d'Algérie.
À la suite de ces massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, le jour même et alors qu'ils venaient présenter leurs vœux à Yves Chataigneau à l'occasion de la défaite de l'Allemagne nazie ; Mohamed Bachir El Ibrahimi, Ferhat Abbas et Hadj Ahmed Chérif Saâdane seront arrêtés à 10h30, car accusés d'avoir « porté atteinte à la souveraineté française » par fomentation des sanglants événements de Sétif. Ils seront incarcérés à la maison d'arrêt d'Alger puis transférés à celle de Constantine.
À la suite de l'emprisonnement de Messali Hadj et l'interdiction du Parti du peuple algérien, le parti Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques revendique après le statut de l'égalité ou de l'indépendance des Algériens en 1948. Aussi, l'Association des oulémas musulmans algériens fut interdite. Alors, l'Organisation spéciale apparaît et elle a pour but de rassembler les armes pour le combat. Mohamed Belouizdad fut le premier chef de l'organisation clandestine. Ensuite, Hocine Aït Ahmed prend la tête de l'Organisation et continua à œuvrer pour l'achat des armes. La Poste d'Oran fut attaquée par les membres de l'OS.
an 1945-1947 : Bénin (anc. Dahomey) - Par trois décrets publiés en août et en septembre 1945, le gouvernement provisoire fixe à trente-trois le nombre de députés pour l’outre-mer sur un total de cinq cent quatre-vingt-six à l'Assemblée constituante. Le double collège est généralisé, le premier regroupant les citoyens français et le second les sujets de l’Empire colonial français. Le scrutin est uninominal à deux tours, le Dahomey et le Togo forment une seule circonscription qui obtient deux sièges.
Lors des élections constituantes françaises tenues le 21 octobre 1945, Sourou Migan Apithy, candidat des Comités électoraux, remporte, dès le premier tour, le siège du second collège en arrivant largement en tête devant sept autres candidats. Le siège au premier collège revient au révérend-père Francis Aupiais, autre candidat des Comités électoraux, élu au second tour le 4 novembre. Mais cette victoire des Comités électoraux, présentant un front uni face aux échéances électorales à venir, n’a été possible qu’en évitant d’afficher une orientation politique claire. Ainsi, Apithy s’inscrit dans le groupe de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) au Palais Bourbon, alors qu’Aupiais s’inscrit au Mouvement républicain populaire (MRP). Le décès de ce dernier, dans la nuit du 14 au 15 décembre, entraîne une élection partielle le 10 février 1946. Seul candidat, le révérend-père Jacques Bertho est élu au premier collège et s’inscrit à son tour au MRP.
La Constituante adopte le 11 avril 1946, la loi n° 46-645, dite loi Houphouët-Boigny, portant sur l’abolition du travail forcé ou obligatoire dans les colonies françaises, étend le code pénal métropolitain aux colonies le 30 avril et accorde le 7 mai la citoyenneté française « à tous les ressortissants des territoires d’outre-mer sans qu’il soit porté atteinte au statut personnel » (Loi Lamine Guèye). Mais le référendum du 5 mai, dont le vote est limité au premier collège, est rejeté.
Une nouvelle élection législative est organisée le 2 juin. Sourou Migan Apithy et Jacques Bertho sont, dès le premier tour, élus députés. Le 13 octobre 1946, la Constitution de la Quatrième République est adoptée par référendum, encore limité au premier collège.
Au niveau fédéral, l’année 1946 est marquée par le congrès fondateur du Rassemblement démocratique africain (RDA) à Bamako (Soudan français devenu depuis le Mali). Sourou Migan Apithy, Émile Derlin Zinsou et Louis Ignacio-Pinto forment la délégation du Dahomey. Apithy est élu vice-président du nouveau parti et signe le manifeste, alors que Pinto est élu président de la Commission de politique générale. Mais, Zinsou refuse le poste de secrétaire général mettant en cause l’affiliation du RDA au Parti communiste français (PCF), seul parti métropolitain invité à Bamako. Si la position de Zinsou est soutenue par la majorité des membres du Comité directeur des Comités électoraux, l’importance prise par Apithy, qui est élu à la première législature de la Quatrième République le 10 novembre, limite les moyens de pressions à son encontre.
Sur le plan national, l’année 1946 voit les Comités électoraux perdre le monopole de l’espace politique, les structures politiques s’organisent et le premier parti de l'histoire du pays est fondé en avril, prenant le nom d’Union progressiste dahoméenne (UPD). Mais rapidement les premières oppositions commencent à voir le jour avec le départ de certains de ses membres et la création le 7 décembre du Bloc populaire africain (BPA) mené par Émile Poisson et Justin Ahomadegbé.
Lors des premières élections territoriales entre le 15 décembre 1946 et le 5 janvier 1947, l’UPD, très bien implantée, obtient la majorité des sièges au Conseil général.
Une série d’élections, tout au long de l’année 1947, permet la désignation par le Conseil général des représentants du Dahomey au Conseil de la République, au Grand conseil de l’AOF et à l’Assemblée de l’Union française. En janvier, Émile Poisson (BPA), pour le premier collège, et Louis-Ignacio Pinto (UPD), pour le second collège, sont élus conseillers de la République. Puis en septembre, c’est l’élection de Sourou Migan Apithy (UPD), de Justin Ahomadegbé (BPA), de Pierre Bartoli (UPD), d’Hubert Maga (UPD) et de Gaston Nègre (UPD) au Grand conseil de l’AOF. Enfin, en novembre, deux membres de l’UPD, Émile Derlin Zinsou et Paul Hazoumé, sont élus à l’Assemblée de l’Union française.
an 1945 : Cameroun - Le pays est placé sous tutelle de l'ONU. Malgré cela, il devient en 1946 un « territoire associé » de l'Union française.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement de l'UPC (Union des populations du Cameroun), dirigé par Ruben Um Nyobe, revendique l'indépendance et la réunification avant d'être interdit puis réprimé par les Français en pays bassa et en pays bamiléké (« guerre bamiléké »).
Après la Seconde guerre mondiale, deux évènements accélèrent le développement d'un sentiment nationaliste et anticolonial. En septembre 1945, à Douala, des colons ouvrent le feu sur une manifestation de grévistes la faisant dégénérer en émeute. Les affrontements s'étendent et un avion sera même utilisé pour mitrailler les émeutiers. Officiellement, selon les autorités coloniales, le bilan serait de 8 morts et 20 blessés, mais selon l'historien Richard Joseph, ce bilan serait très inférieur à la réalité et les morts se compteraient en dizaines.
an 1945 : Congo Brazzaville - Le nationalisme congolais prend réellement corps après la Seconde Guerre mondiale. Le 21 octobre 1945, les Congolais élisent le premier député congolais, Jean Félix-Tchicaya, à l'assemblée constituante de Paris.
an 1945 : Libéria - C'est en mai 1945 que le président William Tubman accorde le droit de vote aux autochtones.
an 1945-1974 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Le régime dictatorial salazariste domine le Portugal et son empire de 1933 jusqu'en 1974.
Madère, île et archipel, reste très lié aux mouvements de biens, de capitaux, et de militaires, entre la métropole et les colonies portugaises d'Afrique. Né dans les guerres coloniales portugaises (1961-1975), le Mouvement des Forces armées (portugais : Movimento das Forças Armadas, MFA, 1973), mouvement révolutionnaire portugais, fait tomber la dictature de l'Estado Novo en 1974 lors de la Révolution des Œillets.
an 1945-1946 : Mali - Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la vie politique reprend au Soudan français. La France souhaite l’intégration d’Africains à la vie politique. Deux collèges sont créés, un pour les citoyens français, les colons, l'autre pour les autochtones. Ce deuxième collège, plus important numériquement, comprend 4 groupes principaux d'électeurs :
1. les fonctionnaires et les agents de l'administration ;
2. les anciens militaires ;
3. les notables et les chefs indigènes ;
4. les titulaires d'un diplôme de l'enseignement à partir du Certificat d'études primaires.
La première élection se déroule le 21 octobre 1945, quatorze candidats se présentent. Fily Dabo Sissoko, instituteur soutenu par l'administration et les chefs traditionnels arrive en tête avec 10 406 voix, suivi de Mamadou Konaté (2 905 voix), Ibrahim Sall (1 433 voix) et Modibo Keïta (937 voix)
Le Parti démocratique soudanais, proche du Parti communiste français et le Bloc démocratique soudanais, officiellement proche de la SFIO mais qui se rapproche du PCF, sont créés respectivement les 6 et 26 janvier 1946. Le Parti progressiste soudanais (PSP) est créé le 13 février 1946, constitué essentiellement de notables locaux, les chefs de canton désignés par le colonisateur.
Le Rassemblement démocratique africain (RDA) tient son congrès constitutif à Bamako du 18 au 21 octobre 1946 et le lendemain, sa section soudanaise, l'Union soudanaise-Rassemblement démocratique africain voit le jour par la fusion du Bloc démocratique soudanais et du Parti démocratique soudanais. Mamadou Konaté devient président et Modibo Keïta secrétaire général de ce nouveau parti.
Le PSP de Fily Dabo Sissoko domine dans un premier temps grâce à son implantation sur l’ensemble du territoire. Aux élections législatives de novembre 1946, la liste du PSP obtient deux députés24, et aux élections législatives trois députés contre un seul pour l’US-RDA.
La constitution française adoptée en 1946 définit l’Union française « formée, d'une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer, d'autre part, des territoires et États associés », c’est-à-dire les colonies
Chaque territoire a un conseil général dont les membres sont élus par un double collège. Le conseil général n'a pas de pouvoir de décision, il adopte des délibérations à caractère consultatif. Le territoire est géré par un gouverneur qui est responsable devant les autorités centrales.
L'échelon fédéral (Afrique-Équatoriale française et Afrique-Occidentale française) est doté d’un grand conseil. Le Grand conseil de l'AOF siège à Dakar. Il est constitué de 5 membres de chaque territoire. Un gouverneur général, puis un Haut-commissaire ont autorité sur la fédération.
L'Assemblée de l'Union française composé pour moitié de représentant des conseils généraux, pour l'autre de représentant du parlement français, avait une fonction consultative.
an 1945 : Namibie - En 1945, le chef coutumier des Héréros, Hosea Kutako, participe avec le chef Frederick Maharero à la création du conseil tribal héréro pour protester contre la politique sud-africaine dans le Sud-Ouest africain.
an 1945 : Togo - En 1945, la Charte des Nations unies établit un régime de tutelle visant à « Favoriser l'évolution des populations vers la capacité de s'administrer eux-mêmes ; Développer le sentiment de l'indépendance. Encourager le respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe, ou de religion ».
Le Togo est, par la suite, un des premiers pays à se doter d'institutions politiques et électorales. Les partis politiques togolais travaillent activement à l'évolution du statut du pays, mais se divisent en deux camps, opposés dans leurs objectifs :
-
le Comité de l'unité togolaise (CUT), partisan d'un État Ewe puis, dans un deuxième temps, d'un État togolais réunifié et autonome,
-
le Parti togolais du progrès (PTP), futur Mouvement populaire togolais (MPT), qui demande l'abolition de la tutelle et réclame une association plus étroite avec la France.
an 1946 : Algérie - Ferhat Abbas et Chérif Saâdane, à leur sortie de prison en avril 1946 de Constantine, créent l'UDMA (Union démocratique du manifeste algérien)
La guerre d'Indochine (1946-1954) absorbe les cadres militaires et mobilise volontaires et soldats de métiers, légionnaires et troupes coloniales, dont 35 000 Maghrébins (Marocains & Algériens) qui comptent pour 1/4 de l'effectif du corps expéditionnaire. Les troupes françaises en Algérie avant le déclenchement de la guerre d'Algérie sont peu nombreuses : 40 000 hommes en 1948, 48 300 au 1er juin 1954, 145 au 1er janvier 1955.
an 1946-1947 : Archipel des Comores - En 1946, les îles ne sont plus rattachées administrativement à Madagascar et forment pour la première fois de leur histoire une entité administrative unie et reconnue (TOM).
Les Comores obtiennent en 1946 une autonomie administrative vis-à-vis de Madagascar et Dzaoudzi (à Mayotte) est choisie comme capitale du nouveau territoire, ce qui alimente la rivalité entre cette île et les trois autres. À partir de 1946, les Comores sont représentées directement au Parlement français pour la première fois en tant que telles et acquièrent une certaine autonomie administrative grâce notamment à l'action du député Said Mohamed Cheikh. Les Comores obtiennent également un conseiller à l'Union française (Georges Boussenot, déjà député de Madagascar en 1945-1946) puis, en 1947, à la suite du changement de statut de l'île en devenant un territoire, un conseiller de la République (Jacques Grimaldi). Un conseil général, assemblée locale, est mis en place dans l'archipel pour représenter la population et discuter des problèmes locaux, mais le véritable pouvoir est toujours détenu par l'administrateur supérieur de la République française.
an 1946 : Cameroun - Le second évènement majeur dans le pays est la création du Rassemblement démocratique africain à Bamako en septembre 1946, auquel participe des militants camerounais comme Ruben Um Nyobe!;
an 1946 : Congo Brazzaville - Jean Félix-Tchicaya fonde en 1946 le Parti progressiste congolais (PPC), section congolaise du Rassemblement démocratique africain (RDA). Tchicaya s'oppose à Jacques Opangault.
an 1946 : Afrique Côte d'Ivoire - Plusieurs partis politiques (souvent soutenus par des syndicats) sont créés à partir de 1946. Ils sont de simples prolongements de la diversité des formations politiques de France ou la concrétisation de la liberté d'initiatives locales : Parti démocratique de Côte d'Ivoire (1946), Parti progressiste de Côte d’Ivoire (1947), Bloc démocratique éburnéen (1949), section ivoirienne de l’Internationale ouvrière (1946), section ivoirienne du Rassemblement du peuple français. La Constitution de la Quatrième République (France) et les lois anticoloniales (suppression du travail forcé, suppression du Code de l'indigénat ou extension de la citoyenneté française), sans changer véritablement le système colonial local, provoquent à la fois la colère des colons et la déception des populations colonisées qui durcissent leur lutte pour l’émancipation à travers des actions de plus en plus violentes conduites par les partis politiques.
an 1946 : Gabon - En 1946, le Gabon devient un territoire d'outre-mer
an 1946-1950 : Leshoto - Le développement de l'éducation fut laissée à la charge des missions chrétiennes jusqu'aux années 1950 alors que les élites locales étaient formées à l'université de Fort Hare en Afrique du Sud. En 1946, l'université de Roma est fondée au Basutoland par des catholiques.
an 1946 - 1960 : Madagascar - Guerre de l'indépendance - À partir de 1946, le combat pour la restauration de l’indépendance est mené par le Mouvement démocratique pour la rénovation malgache (MDRM), dirigé notamment par Joseph Raseta, Joseph Ravoahangy et Jacques Rabemananjara. Ravoahangy et Raseta vont devenir les premiers députés malgaches de l’Assemblée constituante française. Pour le contrer, les Français encouragent le développement du Parti des déshérités de Madagascar (PADESM), un parti anti-indépendantiste regroupant uniquement les Mainti-enindreny et les Tanindrana ou Côtiers.
L’éclatement de l'insurrection de 1947 est matée par une violente répression des autorités coloniales françaises entraînant la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes environ et qui servira de prétexte à la dissolution du MDRM par les autorités françaises. La répression s'accompagne d'exécutions sommaires, de tortures, de regroupements forcés et d'incendies de villages. L'armée française expérimente la « guerre psychologique » : des suspects sont jetés, vivants, depuis des avions afin de terroriser les villageois dans les régions d’opération27. Selon l'historien Jean Fremigacci le bilan s'établit ainsi : jusqu'à deux mille civils tués par les insurgés ; mille à deux mille civils tués par des soldats français ; cinq à six mille insurgés tués au combat ; vingt à trente mille insurgés morts de malnutrition ou de maladie. Il reste que cette querelle de chiffres, en l'absence d'archives précises, ne peut être tranchée avec certitude, et que ces estimations détaillées, rapportées à près de soixante années de distance, posent la question de leur fiabilité.
De 1947 à 1960, grâce au Fonds d'investissement pour le développement économique et social (FIDES), l'économie malgache reçoit 57 milliards de francs CFA qui seront investis dans l'outillage et la production agricole, les infrastructures et l'équipement social. Le commerce restera surtout orienté vers la France et la balance commerciale sera régulièrement déficitaire. Par le jeu des banques et des sociétés de navigation et de commerce, les Français tiennent l'économie.
Après leur défaite en Indochine en 1954 cependant, les Français sont obligés d’envisager la possibilité de l’accession de leurs autres colonies à l’indépendance. C’est ainsi que la loi-cadre Defferre, prévoyant le transfert du pouvoir exécutif aux autorités locales est mise en place en 1956. Ceci permet en juillet 1958 l’accès à la tête du gouvernement de Philibert Tsiranana, un ancien leader du PADESM, devenu député en 1956. Le 14 octobre de la même année, la République malgache est instituée par le pouvoir colonial, suivie le 26 juin 1960 de la proclamation de l’indépendance.
an 1946 : Mauritanie - Le 27 octobre 1946, avec la promulgation de la IVe Constitution française, la Mauritanie devient un territoire d'Outre-mer. Le 10 novembre, Horma Ould Babana est le premier député mauritanien à entrer à l'Assemblée nationale française. Horma Ould Babana fut le premier député représentant la Mauritanie à l'Assemblée française à la suite des élections législatives de 1946.
an 1946 : Namibie - En 1946, l'Afrique du Sud, pays cofondateur de l'ONU, refuse de considérer celle-ci comme le dépositaire des pouvoirs détenus par la défunte Société des Nations. Elle réclame l'annexion du Sud-Ouest mais celle-ci lui est refusée par l'Assemblée générale le
an 1946 : Réunion (Ile de la) - le 19 mars, la colonie est intégrée dans l'État français et devient département français d'outre-mer. La modernisation de l'île (écoles, hôpitaux, réseau routier) attendra cependant les années 1960.
an 1946 : Sénégal - Création de l’ “Union Française”.
an 1946 - 1979 : Tchad - Les débuts de l'indépendance (1946 - 1979)
Après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, la France accorde au Tchad le statut de territoire d'outre-mer et à ses habitants le droit d'élire deux représentants à l'Assemblée nationale, René Malbrant et Gabriel Lisette. Une assemblée locale tchadienne, appelée le Conseil représentatif et rassemblant trente membres élus par les Tchadiens, est également constituée la même année, en parallèle.
Le Tchad devient ensuite une république autonome en 1958. En 1960, elle fait partie de l'éphémère Union des républiques d'Afrique centrale puis accède à l'indépendance le 11 août 1960. François Tombalbaye, chef du PPT, devient le premier président. Deux ans plus tard, Tombalbaye interdit les partis d'opposition et instaure un système de parti unique. L'autocratie et une gestion froide et brutale exacerbent les tensions inter-ethniques38. Homme des territoires du sud, issu de l'ethnie Sara, François Tombalbaye doit bientôt faire face à la révolte de peuples du Nord, en majorité musulmans. En 1965, le Front de libération nationale du Tchad, déclenche des manifestations qui se transforment rapidement en guerre civile. Trois ans plus tard, en 1968, faute de calme revenu, le Président sollicite l'aide des troupes françaises mais l'opération Bison (1969-1972) ne peut venir à bout de la rébellion. Tombalbaye est renversé et tué en 1975 mais l'insurrection continue. Le pouvoir échoit au général Félix Malloum, qui doit pourtant rapidement céder sa place à Goukouni Oueddei à la suite de la première bataille de N'Djaména en 1979.
an 1946 : Togo - En 1946, le pays passe sous tutelle internationale de l’ONU, toujours gérée par la France. Le Togo français est détaché de l'AOF. Il obtient sa propre représentation au Parlement français et devient la République autonome du Togo.
an 1947 : Afrique du Sud - Le problème racial se manifeste à nouveau au sortir de la Seconde Guerre mondiale, époque où la totalité de la population urbaine noire dépasse, pour la première fois celle de la population urbaine blanche, atteignant 1,5 million de personnes. En 1947, Xuma formalise son alliance avec le Congrès indien du Natal et le Congrès indien du Transvaal, du docteur Yusuf Dadoo, afin de présenter un front uni, dépassant les clivages raciaux, face à la classe politique blanche.
Chez les Blancs, les tensions entre les nationalistes afrikaners et les modérés du Parti Uni sont exacerbées par la politique raciale ambigüe de Smuts, oscillant entre assouplissement et renforcement de la ségrégation. L'approbation de Jan Smuts aux conclusions du rapport de la commission Fagan, qui préconisait une libéralisation du système racial en Afrique du Sud, en commençant par l'abolition des réserves ethniques, ainsi que la fin du contrôle rigoureux des travailleurs migrants, amène le Parti National à mandater sa propre commission, la commission Sauer, qui recommande, à l'inverse, le durcissement des lois ségrégationnistes.
an 1947-1960 : Algérie - En octobre 1947, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques en Algérie (MTLD) de Messali Hadj obtient une large victoire lors des élections municipales. Ce parti devient la cible de la répression des autorités françaises. En avril 1948, des fraudes massives ont lieu lors des élections à l'Assemblée algérienne : par des intimidations, l'armée force les populations à voter, les urnes sont remplies d'avance, et les populations les plus rebelles ne sont pas convoquées. Trente-six des 59 candidats du MTLD sont arrêtés. Hocine Aït Ahmed organise, en mars 1949, le cambriolage de la poste d'Oran qui rapporte 3 070 000 francs : cet argent constitue le début du trésor de guerre du FLN.
La population indigène croît fortement entre 1880 (environ trois millions de musulmans, pour environ 500 000 non-musulmans) et 1960. À cette date, l'Algérie compte environ 9,5 millions de musulmans et un million d'Européens, dont 130 000 Juifs séfarades.
Les villes sont traditionnellement peuplées surtout d'Européens, Juifs séfarades compris, mais la population musulmane urbaine progresse pendant toute la première moitié du XXe siècle. En 1954, certaines villes sont à majorité musulmane comme Sétif (85 %), Constantine (72 %) ou Mostaganem (67 %).
L'essentiel de la population musulmane est pauvre. Ce sont essentiellement de petits propriétaires terriens vivant sur les terres les moins fertiles, ou des journaliers. Dans les années 1950, les surfaces cultivables occupent environ 7 millions d'hectares. La production agricole augmente peu entre 1871 et 1948, contrairement au nombre d'habitants. La production annuelle de céréales passe de 3,88 quintaux/hab. à 2 q/hab. L'Algérie doit donc importer des produits alimentaires.
Le chômage est important, 1,5 million de personnes est sans emploi en 1955. La commune d'Alger compterait 120 bidonvilles avec 70 000 habitants en 1953.
Si la population musulmane est majoritairement pauvre, environ 600 000 Algériens musulmans « appartiennent aux groupes sociaux les plus favorisés » (grands propriétaires fonciers, professions libérales, membres de l'armée et de la fonction publique).
an 1947 : Burkina Faso (anc. Haute-Volta) - Après la Seconde Guerre mondiale, les Mossi renouvelèrent leur pression pour avoir un statut territorial séparé.
Le 4 septembre 1947, la Haute-Volta devint à nouveau un territoire ouest-africain.
La population indigène est fortement discriminée. Par exemple, les enfants africains n'ont pas le droit d'utiliser une bicyclette ou de cueillir des fruits aux arbres, "privilèges" réservés aux enfants des colons. Contrevenir à ces règlements pouvait mener les parents en prison.
an 1947 : Afrique République de Djibouti - À partir de la Seconde Guerre mondiale, la population de la ville de Djibouti croît rapidement, passant officiellement d'environ 17 000 habitants en 1947.
an 1947 - 1952 : Libye - Après le conflit mondial, la reconstruction du pays est rendue difficile par les munitions non explosées, mines et matériels et séquelles de guerre laissés par les belligérants. Le statut exact du territoire libyen fait par ailleurs l'objet d'incertitudes, et de désaccords entre les Alliés. Le chapitre colonial n'est définitivement clos qu'en 1947 par l'une des clauses du traité de Paris, qui amène l'Italie à renoncer irrévocablement à ses droits sur la Libye. Le pays demeure cependant divisé entre l'administration britannique, qui a toujours l'autorité sur la Tripolitaine et la Cyrénaïque, et l'administration française du Territoire du Fezzan. La France, dont la présence au Fezzan est relativement légère, envisage un temps le rattachement du territoire, non viable individuellement, à l'Algérie française.
Les Britanniques souhaitent favoriser l'émergence d'un nouvel État, qui serait pour eux un allié dans la région, et soutiennent les revendications de l'émir Idris, revenu définitivement en Libye en 1947. Le 1er mars 1949, avec l'assentiment du Royaume-Uni mais de manière unilatérale vis-à-vis de la communauté internationale, Idris proclame le 1er mars 1949 l'indépendance de l'Émirat de Cyrénaïque. La Tripolitaine demeure quant à elle administrée par le Royaume-Uni, qui conserve certains fonctionnaires coloniaux italiens, tandis que le Fezzan demeure sous l'autorité de la France. Des partis politiques s'organisent en Tripolitaine et se divisent quant au statut du pays : c'est cependant l'option, défendue par certains libyens, de la constitution d'une monarchie libyenne confiée à Idris, qui reçoit le soutien des Britanniques. Les Alliés demeurent divisés, le Royaume-Uni soutenant l'indépendance, au moins de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, au sein d'un État constitué; les États-Unis souhaitent quant à eux une indépendance intégrale de la Libye, le plus vite possible, et la France préfère une politique de statu quo avec le maintien des administrations séparées28. L'Italie, quant à elle, n'a pas renoncé à conserver un certain contrôle sur son ancienne colonie, et mène en ce sens une propagande auprès des Italiens restés en Tripolitaine, comme auprès de certains notables libyens. Le comte Carlo Sforza, ministre italien des affaires étrangères, tente de négocier avec les Britanniques un compromis, qui permettrait à l'Italie d'organiser le nouvel État tripolitain, tandis qu'Idris conserverait la Cyrénaïque et les Français le Fezzan. Cette idée provoque de violentes réactions à Tripoli entre le 11 et le 19 mai 1949.
C'est finalement à l'ONU que revient la tâche de trancher la question du statut de la Libye : le 21 novembre 1949 est votée la résolution 289, qui prévoit l'accès du pays, avant le 1er janvier 1952, au rang d'État indépendant. Avec l'aide des Nations unies, les Libyens mettent progressivement en place des assemblées locales en Cyrénaïque et dans la Tripolitaine, et forment une commission préparation de l'Assemblée nationale, préalable à l'élection d'un gouvernement ainsi qu'à la rédaction de la constitution et à la proclamation officielle de l'indépendance. L'Assemblée nationale se réunit le 25 novembre 1950 et offre la couronne à l'émir Idris, qui devient le roi Idris Ier. Le 7 octobre 1951, la constitution est adoptée, faisant de la Libye un royaume fédéral. Le 24 décembre, l'indépendance totale du Royaume-Uni de Libye est proclamée.
an 1947 : Maroc - De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle
Le sultan Mohammed Ben Youssef prononce le discours de Tanger, réclamant l'indépendance du pays et son intégrité territoriale. Ce discours provoque le limogeage du résident Labonne, considéré comme trop tolérant envers les nationalistes. Il est remplacé par le général Alphonse Juin, qui inaugure une logique de confrontation avec le sultan et l'ensemble du mouvement nationaliste marocain.
an 1947 - 1972 : Mayotte - Émancipation des Comores et dissidence de Mayotte
En 1947, les quatre îles des Comores obtiennent une autonomie administrative et à la suite du référendum de 1958, restent territoire d'outre-mer. L'instabilité politique de l'archipel s'accroît, focalisée par la lutte entre le Rassemblement Démocratique du Peuple Comorien et l'Union Démocratique Comorienne. En 1972, le gouvernement du prince Saïd Ibrahim est mis en minorité, remplacé par celui du prince Saïd Mohamed Jaffar contraint à son tour à démission le 19 octobre suivant. En septembre 1972, empruntant une idée fédératrice, celle de la revendication d'indépendance, aux membres du Mouvement de Libération des Comores, réfugiés à Dar es-Salaam, les formations majoritaires fusionnent momentanément. Le conseil des ministres de la métropole observant les divergences de vues des appareils politiques, prononcent la dissolution de la chambre des députés du Territoire des Comores le 15 novembre 1972.
an 1947 : Réunion (Ile de la) - De 1947 à nos jours, l'île de La Réunion connaît une accélération de son histoire. En un demi-siècle, les bouleversements sociaux, économiques, politiques sont considérables. La société de plantation de l'époque coloniale laisse la place à la société de consommation, mais l'économie réunionnaise reste fragile, artificielle, déséquilibrée avec un secteur tertiaire hypertrophié et des transferts sociaux abondants qui entretiennent un assistanat aux conséquences catastrophiques. En l'espace d'un demi-siècle, la population (227 000 habitants en 1946) a triplé (740 000 habitants en 2004), résultat de progrès médicaux considérables entraînant une baisse spectaculaire de la mortalité tandis que la natalité reste forte, et, plus récemment d'un pouvoir attractif de l'Ile qui attire de plus en plus d'immigrants de la métropole, d'Europe et de l'océan Indien. La croissance économique, bien que forte, ne suffit pas à donner de l'activité à toute cette population, d'où l'importance du taux de chômage.
an 1948 : Afrique du Sud - Auréolé de la victoire des alliés, dont fait partie l'Afrique du Sud, de la participation du pays à la création des Nations unies, d'un taux de croissance économique en nette hausse, de 5 % en moyenne par an pendant près de 30 ans, Jan Smuts semble assuré d'une réélection confortable aux élections générales de 1948. Il peut ainsi proposer de mettre en forme les propositions de la commission Fagan, alors que les nationalistes proposent aux Sud-Africains afrikaners, mais aussi aux anglophones, leur nouveau projet de société fondé sur les conclusions de la commission Sauer, l'apartheid.
À la surprise générale, et bien que minoritaire en voix, l'alliance du Parti national de Daniel Malan et du Parti afrikaner (Afrikaner Party - AP) de Nicolaas Havenga, remporte la majorité des sièges aux élections de 1948 avec 42 % des voix et 52 % des sièges. Les électeurs du Natal, des grandes zones urbaines du Cap et de Johannesbourg apportent leurs voix au parti du premier ministre sortant Jan Smuts, et les circonscriptions rurales et ouvrières surreprésentées du Transvaal et de l'état libre d'Orange, permettent au parti de Daniel François Malan de former le nouveau gouvernement. Quand il est nommé Premier ministre le 4 juin 1948, Malan est déjà âgé de 74 ans. En prenant enfin le pouvoir au bout de trente années de carrière parlementaire, il s'exclame « Aujourd'hui l'Afrique du Sud nous appartient une fois de plus… Que Dieu nous accorde qu'elle soit toujours nôtre. », un « nous » qui désigne exclusivement les Afrikaners. Cette victoire du parti national consacre aussi celle du Broederbond, une société secrète fondée en 1918, et consacrée exclusivement à la promotion des Afrikaners dans la société civile.
Avant 1948, la politique indigène des gouvernements de l'Union Sud-Africaine est constamment présentée comme un expédient provisoire en attendant que, devenues « civilisées, les masses indigènes » accèdent à la citoyenneté. Après 1948, l’apartheid, ou développement séparé des races, vient rompre avec le pragmatisme de la Colour Bar et avec la discrimination conjoncturelle héritée de l’ère coloniale. Théoriquement, selon les déclarations de D.F. Malan, l'objectif de l'apartheid est la division du pays en deux parties avec d'un côté les Noirs et d'un côté les Blancs, sans que les premiers continuent à être les réservoirs de main-d'œuvre des seconds. Par ailleurs, il considère que l'équilibre racial en Afrique du Sud repose sur un accord tacite entre Noirs et Blancs, fondé sur le respect et l'exemplarité que ces derniers doivent inspirer. C'est pourquoi, régler le problème des Blancs pauvres doit aussi permettre de gérer la question autochtone.
L'historien Hermann Giliomee considère que l'apartheid ne doit pas être considéré, au départ, comme un projet clairement défini dans sa conception. Sa mise en œuvre est loin d'être immédiate ou globale et sa vision d'ensemble n'est ni cohérente ni uniforme. L'apartheid est cependant présenté à l'époque comme un arsenal juridique, destiné à assurer la survie du peuple afrikaner, mais aussi comme un « instrument de justice et d’égalité qui doit permettre à chacun des peuples qui constitue la société sud-africaine d’accomplir son destin et de s’épanouir en tant que nation distincte ». Ainsi, beaucoup de nationalistes afrikaners pensent que l’apartheid ouvre des carrières et laisse leurs chances aux Noirs, chances qu’ils n’auraient pu saisir s’ils avaient été obligés d’entrer en compétition avec les blancs au sein d’une société intégrée. Les chefs du parti national tâtonnent d'ailleurs beaucoup en mettant en place les premières législations et, parfois, se contredisent. Les premières lois ne font d'ailleurs que renforcer des lois déjà existantes, telle la loi sur l’interdiction des mariages interraciaux qui date de 1949. Par ailleurs, le ministère des affaires indigènes est d'abord confié à un pragmatique modéré, Ernest George Jansen, qui maintient la tradition libérale du Cap et se montre essentiellement préoccupé par la réhabilitation des réserves ou la pénurie de logements dans les townships.
an 1948 : Afrique du Sud - En 1948, le parti national remporte les élections générales. Le nouveau premier ministre, Daniel François Malan, met en place la politique d'apartheid, renforcée en 1956 par la suppression de la franchise du droit de vote des Coloureds (gouvernement Strijdom).
an 1948 : Algérie - À la suite de la mort de Abdelhamid Ben Badis en 1940, de l'emprisonnement de Messali Hadj et de l'interdiction du Parti du peuple algérien, le parti Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) revendique le statut de l'égalité ou de l'indépendance des Algériens en 1948. L'Association des oulémas musulmans algériens est également interdite. L'Organisation spéciale (OS) est alors créée en vue de rassembler les armes pour le combat. Mohamed Belouizdad est le premier chef de l'organisation clandestine. Hocine Aït Ahmed prend ensuite sa tête et continue à œuvrer pour l'achat d'armes. La poste d'Oran est attaquée par les membres de l'OS.
an 1948-1952 : Bénin (anc. Dahomey) - La vie politique dahoméenne est rythmée par les sessions du Conseil général et par les échéances électorales. Mais l’éloignement des élus les plus influents dans les assemblées fédérales et nationales, que ce soit à Dakar ou à Paris, entraîne sa léthargie le reste du temps.
Première épisode électoral durant cette période, l’élection en novembre 1948 par le Conseil général de deux nouveaux conseillers de la République, Albert Marescaux du Rassemblement du peuple français (RPF) pour le premier collège et Louis Ignacio-Pinto (UPD) pour le second collège. Mais Albert Marescaux, fonctionnaire en poste au Dahomey, est invalidé le 25 janvier 1949. Une élection partielle permet l’élection d’Émile Poisson (BPA) le 27 février.
En mai 1951, la circonscription du Dahomey obtient un second siège à l’Assemblée nationale. Mais l’instauration d’un scrutin par liste provoque une double rupture au sein de l’UPD. Sa direction tente de mettre à l’écart Apithy jugé incontrôlable en le plaçant second sur la liste. Mais il refuse, quitte l’UPD et lance une liste indépendante dite d’« Union Française » dont il est à la tête. Puis, c’est au tour de la majorité des membres de l’UPD originaire du Nord de faire sécession, leur demande d’une place pour l’un des leurs ayant été refusée par le Comité directeur. Le 17 juin 1951, Hubert Maga (liste du Groupement ethnique du Nord-Dahomey, GEND) et Sourou Migan Apithy (liste d’Union Française) sont élus députés à la deuxième législature de la Quatrième République. Le premier s’inscrit aux Indépendants d'outre-mer (IOM) alors que le second s’inscrit aux Indépendants et paysans d'action sociale (IPAS), marquant ainsi sa rupture avec les IOM dont il était l’un des fondateurs.
En septembre, Apithy fonde son propre parti, le Parti républicain dahoméen (PRD), en vue des élections à l’Assemblée territoriale amenée à remplacer le Conseil général. La très large victoire du PRD et l’implantation réussie du GEND lors de ces élections le 30 mars 1952 mettent en péril l’existence de l’UPD. D’autant qu’un mois plus tard lors des élections pour les représentants du Dahomey au Grand conseil de l’AOF, aucun candidat de l’UPD ne parvient à se faire élire. Cette élection voit la victoire de Justin Ahomadegbé (BPA), Sourou Migan Apithy (PRD), Jacques Bertho (non-inscrit), Robert-Henri Chaux (non-inscrit) et Hubert Maga (GEND).
an 1948 : Cameroun - Le 10 avril 1948, l'Union des Populations du Cameroun (UPC), un mouvement nationaliste, est fondée par 12 personnes dont Jacques Ngom, Charles Assalé, Guillaume Hondt, Joseph Raymond Etoundi, Leopold Moumé-Etia, George Yemi, Theodore Gosso, Guillaume Bagal, Leornard Bouly, Emmanuel Yap, Jacques René Bidoum, Henry Manga Mado (cité par Saïd Sélassié Npeyou, université de Douala) et Ruben Um Nyobe prendra la direction par la suite.
an 1948 : Congo Kinshasa - En 1948 est créée l'université Lovanium.
an 1948-1954 : Érythrée - Faute d'accord entre les puissances, la question est renvoyée à l'ONU en septembre 1948. Les États-Unis souhaitent conserver leurs bases installées à Massaoua et Asmara, ce qui leur semble garanti par un rattachement à l'Éthiopie. En mai 1949, l'accord Bevin-Sforza prévoit la partition de l'Érythrée entre le Soudan et l'Éthiopie, mais il est rejeté par l'Assemblée de l'ONU. C'est finalement la résolution 390 (V) du 2 décembre 1950 qui fait de l’Érythrée « une unité autonome, fédérée avec l’Éthiopie sous la souveraineté de la couronne éthiopienne ».
Cette résolution prévoit que l'acte fédéral final devra être ratifié par la future Assemblée nationale érythréenne, et lors de la proclamation de la future Constitution érythréenne. Ces premières élections parlementaires se déroulent le 16 mars 1952 sous la surveillance d'une commission des Nations unies. Une assemblée représentative de 68 membres est élue par les Érythréens. L'assemblée approuve le projet de constitution proposée par l'ONU le 10 juillet 1952. Le 11 septembre 1952, l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, ratifie la constitution. L'Assemblée représentative devient alors l'Assemblée érythréenne et la résolution des Nations unies visant à fédérer l'Érythrée avec l'Éthiopie devient effective. Elle est confirmée par une nouvelle résolution du 15 septembre 1952.
L'Érythrée et l'Éthiopie sont alors liées par une structure fédérale assez souple sous la souveraineté de l'empereur. L'Érythrée dispose de sa propre organisation administrative et judiciaire, son propre drapeau et une autonomie sur ses affaires internes, y compris la police, l'administration locale et la fiscalité. Le gouvernement fédéral impérial est chargé des affaires étrangères (y compris commerciales), de la défense, des finances et des transports.
Bien que cette fédération soit théoriquement entre égaux, en 1954, Haïlé Sélassié interdit les partis politiques érythréens, ainsi que la presse indépendante.
an 1948 : Réunion (Ile de la) - Un cyclone dévaste La Réunion: des vents de 300 km/h font 165 morts et 3 milliards de francs CFA de dégâts.
an 1948-1960 : Somalie - En 1948, une commission dirigée par des représentants des forces alliées victorieuses veut trancher la question somalienne une fois pour toutes. Dans un premier temps, elle attribue la province de l’Ogaden à l’Éthiopie. L’année suivante, après des mois de discussion et après avoir porté l’affaire devant les Nations unies, l’Italie se voit accorder un protectorat de dix ans en reconnaissance du développement économique apporté à la région, après quoi la Somalie deviendrait entièrement indépendante. La LJS, qui revendique une indépendance immédiate, s’oppose vivement à cette décision. La Ligue va devenir une source d’agitation pour les années à venir. Malgré cela, la décennie 1950 est prospère et n'est marquée par aucun incident notoire. La Somalie obtient son indépendance comme prévu en 1960, et la passation de pouvoir se fait sans heurts.
an 1948 - 1951 : Zambie - En 1948, le premier parti politique africain de Rhodésie du Nord, alors un état ségrégationniste, est créé. En 1951, le « Congrès national africain » (ANC) de Rhodésie du Nord, dirigé par Harry Nkumbula, est créé.
an 1949-1950 : Algérie - Ahmed Ben Bella remplace Hocine Aït Ahmed en 1949. Le plan de l'organisation est dévoilé et les autorités françaises arrêtent plusieurs de ses membres en 1950. Le MTLD nie toute relation avec l'Organisation spéciale pour faire obstacle aux arrestations.
an 1949 : Afrique République de Djibouti - En 1949, Djibouti devient un port franc, sa nouvelle monnaie, le franc Djibouti, est rattaché au dollar américain. La même année, de violents affrontements entre des groupes identifiés comme « issas » et « gadabuursi » causent plusieurs dizaines de morts. Ils sont révélateurs des rivalités pour l'accès à la ressource que représente le travail disponible, en particulier au port. Ces tensions, qui ont déjà commencé avant la Seconde Guerre mondiale, durent jusqu'à la fin de la présence française, marquées par le renvoi des dockers yéménites, puis somalis.
an 1949-50 : Algérie - Ahmed Ben Bella prend la place de Hocine Aït Ahmed en 1949. Le plan de l'organisation est dévoilé et une série d'arrestations est entamée par les autorités françaises en 1950. Le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques niait toute relation avec l'Organisation spéciale.
an 1949 : Namibie - En 1949, la constitution du Sud-Ouest est révisée par le gouvernement de Daniel François Malan qui a amené le Parti national au pouvoir en Afrique du Sud un an plus tôt. Une représentation directe du territoire au parlement sud-africain est désormais assurée par six députés et quatre sénateurs alors que la tutelle des populations indigènes est désormais du seul ressort du gouvernement de Pretoria.
an 1950 : Afrique du Sud - Le thème récurrent des gouvernements nationalistes est, dès lors, non plus celui la défense de l’identité afrikaans face au danger de domination ou d’acculturation anglophone, mais celui du peuple blanc d’Afrique du Sud. Ce « peuple » est composé des anglophones, des afrikaners, des lusophones soit 2,5 millions de personnes en 1950, 21 % de la population totale. Il est considéré comme menacé par la puissance de la démographie africaine, 8 millions de personnes en 1950 et 67 % de la population totale ; c'est le swaartgevaar'' (« le péril noir »), la crainte d'un soulèvement de millions de Noirs, qui balaieraient le peuple afrikaner, sa langue, sa culture, ses institutions et son mode de vie. L'idée est aussi de mettre en place une politique permettant de satisfaire les deux tendances constitutives du parti national, l'une portée sur la suprématie blanche garantissant la sécurité des Blancs, l'autre mobilisée autour de la promotion et de la défense de la culture afrikaner, enracinée dans l'histoire « d'un peuple élu » (le volk).
Si Hendrik Verwoerd, successeur de Jansen en tant que ministre des affaires indigènes à partir de 1950, est parfois considéré comme le grand architecte de l'apartheid, ses inspirateurs sont à rechercher non seulement du côté de la théorie de la prédestination de l'église réformée hollandaise, mais aussi du côté de l'école afrikaans d'anthropologie et de l'un de ses représentants les plus emblématiques, le professeur d'ethnologie Werner Max Eiselen. Si Eiselen rejette le racisme scientifique prédominant dans les années 1920, il justifie néanmoins dans l'un de ses ouvrages la ségrégation raciale comme moyen de maintenir et renforcer les identités ethniques et linguistiques des peuples bantous. Allant plus loin, et en conclusion de ses analyses sur les effets acculturant de l'urbanisation et du travail migrant sur les structures traditionnelles africaines, il appuie, dès le début des années 1930, l'idée d'un séparatisme géographique, politique et économique, non seulement entre les Noirs et les Blancs mais aussi entre les différentes ethnies. Rejetant l'idée même d'existence d'une société unique sud-africaine, il est convaincu que les civilisations bantoues ont été corrompues par leur interaction avec la société urbaine de type occidental, et qu'elles ne peuvent plus se développer en respect de leurs propres impératifs culturels.
Les principales lois fondamentales organisant l'apartheid sont la loi d'habitation séparée, la loi d'immoralité, loi de classification de la population, la loi de suppression du communisme qui sont votées en février 1950. Ces différents textes législatifs sont organisés autour d'un principe de cloisonnement. Les individus sont classés en quatre groupes (blancs, noirs, coloured et indiens), qui déterminent leur vie, résidence, études, mariage, etc. Les Noirs sont progressivement expulsés de quartiers entiers, tel Sophiatown, et obligés de vivre dans des townships, construits pour eux à la périphérie lointaine des villes, ce qui les contraint à parcourir de longues distances pour se rendre sur leur lieu de travail.
an 1950-1952 : Érythrée - Faute d'accord entre les alliés, l'administration britannique se poursuit jusque dans les années 1950. En 1950, constatant l'absence d'un accord entre les alliés et face aux requêtes de l'Érythrée à l'auto-détermination[réf. nécessaire], les Nations unies envoient une commission dans l'espoir de trouver une solution. La commission propose une forme d'union avec l'Éthiopie, proposition adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies avec une disposition mettant fin à l'occupation britannique pour le 15 septembre 195210. La Grande-Bretagne organise des élections le 16 mars 1952 en vue de constituer une assemblée représentative de 68 membres divisée à parts égales entre chrétiens et musulmans.[réf. nécessaire] L'assemblée approuve un projet de constitution proposée par le commissariat de l'ONU le 10 juillet. Le 11 septembre 1952, l'Empereur d'Éthiopie Hailé Sélassié Ier ratifie la constitution.
L'Assemblée représentative devient alors l'Assemblée érythréenne et la résolution des Nations unies visant à fédérer l'Érythrée avec l'Éthiopie devient effective. Selon la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU du 15 septembre 1952, l'Érythrée et l'Éthiopie doivent être liées par une structure fédérale assez libre sous la souveraineté de l'Empereur. L'Érythrée aurait sa propre organisation administrative et judiciaire, son propre drapeau et une autonomie sur ses affaires internes, y compris la police, l'administration locale et la fiscalité. Le gouvernement fédéral impérial est chargé des affaires étrangères (y compris commerciales), la défense, les finances et les transports. Hailé Sélassié s'empresse cependant de limiter l'autonomie de l'Érythrée et pousse le pouvoir exécutif à la démission, déclare l'amharique langue officielle à la place du tigrinya et de l'arabe, interdit l'usage du drapeau érythréen, impose la censure et déplace les centres d'affaires hors de l'Érythrée. En 1962, la fédération est abolie, l'Érythrée est désormais réunie avec l'Éthiopie et soumise au pouvoir impérial de ce pays.
an 1950 : Maroc - De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle
Expansion du gisement de minerai de fer de l'Omnium nord-africain, première entreprise marocaine et huitième française.
an 1950-1953 : Maroc - À partir des années 1950, le mouvement national marocain prend la forme d'une lutte armée avec la création de l'Armée de libération nationale qui établit des foyers de guérilla principalement dans les régions montagneuses du Moyen-Atlas, du Rif et de la frontière algérienne, ainsi que dans les confins du Sud. Dans les villes se développent des groupes combattants adaptés au milieu urbain, tels que le Croissant noir (proche du PDI et du PCM), et l'Organisation secrète (liée à l'Istiqlal). Les actions combinées des organisations nationalistes aboutissent aux représailles des autorités françaises, qui s'enchaînent sur un cycle de violences qui culmineront après la déposition du sultan Mohammed Ben Youssef par le résident général Augustin Guillaume, qui place sur le trône chérifien le "sultan fantôche" Mohammed Ben Arafa. Ce coup de force du 20 août 1953 est soutenu par les colons ultra-conservateurs, le préfet de police de Casablanca Philippe Boniface, les grands notables marocains liés à la France comme le pacha El Glaoui, ainsi que par le parti extrémiste Présence française du docteur Causse qui assassine les personnalités françaises favorables à l'indépendance marocaine à l'instar de Jacques Lemaigre Dubreuil.
an 1950-1955 : Namibie - Au début des années 1950, les débats sont vifs à l'ONU entre les partisans du colonialisme (conduits par le Portugal et l'Afrique du Sud) et les partisans de la décolonisation. Le chef coutumier héréro Hosea Kutako est le premier représentant noir du Sud-Ouest africain à faire présenter une pétition aux Nations unies dénonçant l'administration sud-africaine. Par un avis consultatif, la Cour internationale de justice confirme que l'Union sud-africaine est liée par ses obligations internationales résultant du mandat donné par la SDN et qu'elle ne peut modifier unilatéralement le statut du territoire. En 1955, cette même Cour confirme le droit de l'Assemblée générale des Nations unies d'adopter des résolutions concernant le Sud-Ouest africain et de procéder aux auditions de pétitionnaires. Pour l'Afrique du Sud, il s'agit d'une intervention dans ses affaires intérieures.
an 1950-1954 : Nigéria - Période britannique (1800-1960) - La colonie britannique (1914-1960)
Dans les années 1950, dans la ville d'Abeokuta se forme l'union des femmes d'Abeokuta sous la direction de Funmilayo Ransome-Kuti qui parvient à faire plier le gouvernement colonial : le roi Alake, Ademola II, qui était encore une autorité reconnue par les anglais, est contraint à l'exil, les femmes sont libérées des taxes et elles obtiennent le droit de siéger dans les instances locales.
En 1952, le Nigeria compte 34 millions d'habitants dont 12 000 colons anglais et 250 différentes tribus ethniques. Il est déjà le pays le plus peuplé d'Afrique et avec ses 967 000 km2, la plus grande colonie anglaise.
En réponse au nationalisme montant surgi après la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques dotent le pays d'un gouvernement représentatif en 1951 puis d'une constitution fédérale en 1954.
an 1951-1956 : Afrique du Sud - De 1951 à 1956, le gouvernement Malan mène une véritable bataille constitutionnelle pour radier les Coloured des listes électorales communes et instituer des collèges électoraux séparés. Politiquement, la mesure vise à priver le Parti uni et le Parti travailliste de voix déterminantes dans plus de la moitié des cinquante-cinq circonscriptions de la province du Cap. En 1951, une première loi est votée au terme de laquelle les Coloured et métis du Cap et du Natal sont désormais représentés au parlement par quatre députés blancs élus pour cinq ans sur des listes séparées. La loi est vivement attaquée par l'opposition parlementaire. Des manifestations sont organisées par l'association des vétérans de guerre, avec le soutien de la Springbok Legion. Partout dans le pays, se forment des mouvements de soutien au maintien des métis sur les listes électorales communes ; celui des Torch commando, dirigé par Louis Kane-Berman et Sailor Malan, héros de la bataille d'Angleterre, est le plus emblématique. Le mouvement reçoit l'appui financier de Harry Oppenheimer et forme un front commun avec le parti uni et le parti travailliste. Finalement, la question de la suprématie législative du Parlement se retrouve placée au centre des débats après l'invalidation de la loi par la Cour suprême, par référence au South Africa Act. La tentative de D.F. Malan de contourner la décision est également un échec.
De son côté, l'ANC, la principale organisation anti-apartheid extra-parlementaire, en lutte pour l'égalité politique, économique et juridique entre Noirs et Blancs, est de tendance socialiste et alliée au Parti communiste, ce qui en fait un adversaire des Blancs d'Afrique du Sud et lui donne une mauvaise image aux yeux du gouvernement des États-Unis. Dès l'arrivée au pouvoir du parti national, la ligue de jeunesse de l'ANC se montre déterminée. En interne, elle fait écarter le président du parti, Alfred Xuma, jugé trop modéré, pour imposer James Moroka et préparer une grande campagne de défiance. En juin 1952, l'ANC sous la férule de Walter Sisulu, organise avec d'autres organisations anti-apartheid une campagne nationale contre les restrictions politiques, sociales et résidentielles imposées aux gens de couleur. Cette campagne de résistance passive, marquée par l'arrestation de 8 400 personnes, prend fin en avril 1953, quand de nouvelles lois interdisent les rassemblements et les manifestations politiques ; elle permet à l'ANC de gagner en crédibilité, passant de 7000 à 100 000 adhérents. Son option non-raciale lui permet de s'ouvrir aux indiens et aux communistes blancs, mais les métis restent plus circonspects. Quand James Moroka tente de plaider la conciliation avec le gouvernement, il est renversé par la ligue des jeunes du parti, qui impose alors Albert Lutuli à la tête de l'ANC.
Durant toute la décennie des années 1950, les mouvements opposés à l'apartheid, issus des différentes communautés, peinent à s'unir et à organiser des manifestations inter-raciales. Malgré les appels de l'ANC, la communauté blanche échoue totalement à constituer un mouvement unique blanc anti-apartheid. Bien au contraire, l'opposition blanche à l'apartheid est morcelée en deux grandes familles, radicaux et libéraux, elles-mêmes divisées en sous-groupes divers. L'opposition libérale ignore également les appels de l'ANC à manifester ou à se rassembler (campagne de défiance, rassemblement de Kliptown), préférant privilégier les procédures légales. En fait, les motifs de mobilisation des blancs, centrés surtout sur le droit de vote des métis, sont différents de ceux de l'ANC et, tant le parti uni que le parti libéral, ne sont pas favorables à l'extension d'un droit de suffrage sans restriction aux populations de couleur. De ce fait, l'opposition libérale est définitivement discréditée aux yeux de l'ANC qui ne privilégie que ses alliés radicaux.
an 1951-1956 : Angola - En 1951, l'Angola devient une « province ultramarine ». Les Angolais peuvent devenir des « citoyens portugais » moyennant certaines conditions.
Cependant les mouvements d'opposition grandissent, des partis politiques tels que le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA) un mouvement d'orientation marxiste, expression des métis et des citadins et l'UNPA sont créés en 1956. Le 4 février 1961, des membres du MPLA parmi lesquels Deolinda Rodrigues de Almeida attaquent la prison de Luanda13 afin de libérer les prisonniers politiques et massacrent 2 000 colons portugais. Les représailles de l'armée portugaise font 10 000 victimes dans la communauté noire et des centaines de milliers d'Angolais doivent fuir vers le Congo-Léopoldville. Cette « insurrection de Luanda » assimilée à une véritable « prise de la Bastille » déclenche la guerre d'indépendance.
Le Portugal est présent avec un contingent d'environ 200 000 hommes venus de métropole et des corps de colons volontaires, avec le soutien logistique de l'OTAN14. Trois groupes armés se constituent en face :
- le MPLA d'Agostinho Neto ;
- le FNLA d'Holden Roberto ;
- l'UNITA de Jonas Savimbi.
Le Portugal n'envisage alors pas du tout de décoloniser l'Angola mais prévoit de l'intégrer comme une province. En effet ce Brésil avorté avait un rôle clé dans l'économie portugaise : fournir des devises fortes (diamant, pétrole), des matières premières bon marché pour l'industrie (coton, sucre, café, bois), la politique du président Salazar étant basée sur une substitution des importations. Il constituait également un réservoir de travailleurs forcés.
an 1951 - Cap Vert - Afin d'apaiser la situation politique et satisfaire le mouvement nationaliste émergent, le Portugal modifie le statut juridique du Cap-Vert en 1951 : de simple colonie, l'archipel devient une province ultramarine.
an 1951 : Guinée-Bissau - La colonie portugaise devient une province ultramarine en 1951.
an 1951-1959 : Mauritanie - N'Diaye Sidi el Moktar succéda de 1951 à 1959 à Horma Ould Babana.
En juin 1957, le premier Conseil de gouvernement se prononce pour le transfert du chef-lieu de Saint-Louis à Nouakchott. Le décret est signé par la France le 27 juillet 1957.
an 1951 : Mozambique - Le Mozambique sous le régime de Salazar (1933-1974)
Après la Seconde Guerre mondiale, en 1951, le Mozambique et les autres possessions africaines deviennent des provinces portugaises ultramarines. Des provinces, et non plus des colonies. D'une manière générale, l'absence de moyens financiers suffisants pour la mise en valeur des ressources naturelles du territoire mozambicain est patent et se manifeste par un faible développement des infrastructures.
Néanmoins, des efforts sont accomplis au niveau des activités agricoles, développées autour de deux grands types d'agriculture, d'un côté les plantations de canne à sucre, de thé, de coprah et de sisal et, de l'autre côté, celle du coton, des cultures toutefois d'exportation, peu tournées vers les besoins de la population du pays. La principale réalisation d'ampleur du régime est le développement énergétique, marqué par l'exploitation de gisements charbonniers et par le début de la construction du barrage de Cahora Bassa.
an 1951 : Sao Tomé et Principe - En 1951, São Tomé et Príncipe devinrent une province d'outre-mer portugaise.
an 1951-1954 : Sierra Leone - En 1951, un programme de décolonisation est préparé. Milton Margai, ancien médecin et chef du Parti du peuple de Sierra Leone (Sierra Leone People's Party), est nommé Premier ministre en 1954.
an 1951 : Soudan - Le roi Farouk prend le titre de roi d’Égypte et du Soudan. En 1953, un traité anglo-égyptien reconnait le droit du Soudan à l’autodétermination.
an 1952 : Congo Brazzaville - Le bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé s'installe à Brazzaville en 1952.
an 1952 : Égypte - L'histoire du pays est particulièrement marquée par le second Président de la République, Gamal Abdel Nasser. Le gouvernement de Nasser entreprend de moderniser les infrastructures et de doter l’Égypte d'une industrie. Des nationalisations sont effectuées et le secteur public devient prépondérant. De nombreuses politiques sociales sont impulsées (réforme agraire, gratuité de l'enseignement, salaire minimum, réduction du temps de travail des ouvriers, etc).
an 1952-1962 : Éthiopie - développement des troubles érythréen
Deux mémorandum éthiopiens, l'un à la Conférence de Londres de 1945, le second à la Conférence de la Paix à Paris en 1946, exposent les arguments historiques, économiques et stratégiques de la complémentarité de l'Éthiopie avec l'Érythrée. Les grandes puissances de l'époque, incapables d'aboutir à un consensus s'en réfèrent aux Nations unies qui adoptent la résolution, le 21 novembre 1949, établissant une commission pour l'Érythrée. Celle-ci recommande suivant la résolution, la constitution d'une entité séparée rattachée par voie fédérale à l'Éthiopie.
Le 17 octobre 1952 est créée la fédération Éthio-Érythréenne.
Le 14 novembre 1962, l'assemblée érythréenne vote sa dissolution et la réunion de l'Érythrée à l'Éthiopie.
L'accès à la mer dont bénéficie le pays facilite le développement économique dans les années d'après-guerre et l'ouverture internationale.
Néanmoins la réunion des deux entités exacerbe les revendications des mouvements séparatistes, le Djabha (Front de Libération Érythréen) et le Cha'abiya (Front populaire de libération de l'Érythrée). L'historien éthiopien Berhanou Abebe note à cet égard que les grandes puissances de l'époque ne se montrent pas non plus favorablement disposées à cette union : « le parti unioniste représentait la force politique organisée le plus efficacement et qu'il ne reçut aucune organisation extérieure d'aucune sorte.(...) Le déploiement de forces extérieures contre les intérêts éthiopiens en Érythrée indique, de surcroît, que les principales puissances occidentales n'étaient pas favorablement disposées à l'égard des revendications unionistes ».
an 1952-1959 : Kenya - D'octobre 1952 à décembre 1959, la révolte des Mau Mau combat la loi coloniale britannique. Les décideurs britanniques firent alors participer de plus en plus d’Africains aux processus gouvernementaux, afin de couper les rebelles de leur soutien. Les premières élections directes pour les Africains au Conseil législatif eurent lieu en 1957. La guerre s’achève avec 100 000 morts côté africain et 320 000 détenus dans des camps, dont plus d'un millier seront exécutés et des milliers d'autres torturés.
an 1952 : Maroc - De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle
7 décembre 1952 : Émeutes de Casablanca.
an 1952 : Réunion (Ile de la) - Débuts de la Sakay à Madagascar.
an 1953 : Afrique du Sud - Aux élections de 1953, le Parti National remporte de nouveau la majorité des sièges du parlement. En 1954, Malan, malade, démissionne de son fauteuil de Premier ministre qui est récupéré par Johannes Strijdom, un élu ultraconservateur du Transvaal, qui accentue la politique ségrégationniste. Au parlement, et au bout de quatre années de batailles législatives et judiciaires, il parvient à supprimer la franchise électorale des populations coloured du Cap, malgré l'opposition du parti uni et du petit parti libéral. Ces populations sont désormais représentées à l'assemblée par quatre députés blancs élus pour cinq ans sur des listes spécifiques. Il met en place des gouvernements autonomes dans les bantoustans (territoires tribaux administrés par les populations autochtones), à la suite de l'adoption du Bantu Self-government Act, venant compléter le Bantu Authorities Act de 1951.
Liée à l'ANC, la Fédération des femmes sud-africaines (Federation of South African Women, FSAW) joue également un rôle important dans la protestation contre l'apartheid en assurant la coordination des campagnes contre les laissez-passer et faisant rédigeant des pétitions. Organisée sur une base inter-raciale, elle comprend des syndicalistes, des enseignantes et des infirmières. En juin 1955, 3 000 délégués de l'ANC et de divers autres groupes anti-apartheid, comme le congrès indien, le Congrès des Démocrates ou la FSAW, se réunissent à Kliptown, un township de Johannesbourg, en un congrès du peuple. Ces délégués adoptent la Charte de la liberté (Freedom Charter), énonçant les bases fondamentales des revendications des gens de couleur, appelant à l'égalité des droits, quelle que soit la race. Un million de personnes signent le texte. En janvier 1956, environ 2 000 femmes de groupes de couleurs différentes, parmi lesquelles Lillian Ngoyi, Ruth Mompati et Helen Joseph, défilent au nom de la FSAW, devant les Union Buildings à Pretoria. Ignorée par le gouvernement, la FSAW organise une seconde manifestation avec le concours la Ligue des femmes de l'ANC au mois d'août 1956. Environ 20 000 femmes défilent alors contre les laissez-passer devant les Union Buildings. La même année, à la suite de l'adoption de la charte de la liberté, 156 membres de l'ANC et des organisations alliés sont arrêtés et accusés de haute trahison. Parmi les accusés se trouvent Albert Luthuli, Oliver Tambo, Walter Sisulu, Nelson Mandela, tous de l'ANC, mais aussi Ahmed Kathrada du South African Indian Congress (SAIC), ou encore Joe Slovo du parti communiste sud-africain (SACP). L'affaire est très médiatisée. L’instruction judiciaire dure pendant quatre ans, période durant laquelle les charges tombent progressivement contre les inculpés. Finalement, en mars 1961, les trente derniers accusés restants sont à leur tour acquittés au motif que, selon les attendus du jugement, l'ANC ne pouvait être reconnu coupable d'avoir défendu une politique visant au renversement du gouvernement par la violence.
an 1953-1957 : Bénin (anc. Dahomey) - Moribond, l’UPD reçoit le coup de grâce le 10 octobre 1953 lors de la désignation des représentants du territoire pour l’Assemblée de l’Union française. Une alliance UPD/BPA a été conclue afin de barrer la route au PRD qui, pour l’occasion, s’était allié avec le Mouvement démocratique dahoméen (MDD), un nouveau parti créé par Hubert Maga pour succéder au GEND qui était menacé d’éclatement. La défaite de la paire Zinsou/Ahomadegbé (UPD/BPA) face au tandem Hazoumé/Deroux (PRD/MDD) met un point final à l’UPD et entame gravement le futur du BPA. Émile Derlin Zinsou parvient cependant à se faire élire conseiller de la République en juin 1955 en se présentant sans étiquette au premier collège et, en bénéficiant des voix des indépendants et du RPF. Le candidat du PRD, Maximilien Quenum, est élu au second collège.
La fin de l’UPD, l’historique parti national, et les difficultés du BPA, dont la base électorale se situe dans le sud-ouest du Dahomey, semblent laissé apparaître la double domination du PRD pour le sud et du MDD pour le nord. La victoire des leaders de ces deux partis, Sourou Migan Apithy pour le PRD et Hubert Maga pour le MDD, aux élections législatives du 2 janvier 1956 tend à le démontrer. D’autant que l’Union démocratique dahoméenne (UDD), le nouveau parti destiné à succéder à l’UPD et au BPA, se déchire six mois après sa création sur la question de l’affiliation au RDA, donnant naissance à une tendance pro-RDA menée par Justin Ahomadegbé et, une tendance anti-RDA menée par Émile Derlin Zinsou et Alexandre Adandé.
Le 31 mars 1957, les élections territoriales donnent une large victoire au PRD qui obtient la majorité des sièges. L’UDD arrive en deuxième position, suivi du MDD. Mais ce dernier bénéficie du ralliement d’indépendants qui fait de ce parti l’incontestable deuxième force politique du Dahomey. Cela se confirme le 15 mai avec les élections des représentants du territoire au Grand conseil de l’AOF et l’échec des candidats UDD. Jean Agier, Michel Ahouanmènou et Valentin Djibodé Aplogan sont élus pour le PRD, alors que Mama Arouna et Pedro Boni Salifou sont élus sur la liste Entente Nord-Dahomey, qui regroupe le MDD et la mouvance Jeunesse et progrès.
Le 17 août, le MDD devient le Rassemblement démocratique dahoméen (RDD). Le but de ce changement étant de créer une force politique unique pour tout le nord du pays et, de faire taire les divergences qui se sont exprimées lors des élections à l’Assemblée territoriale et au Grand conseil. La peur d’un sud plus peuplé et plus riche est le ciment d’un espace nord pourtant composé de territoires aux histoires et aux cultures très diverses. La personne d’Hubert Maga apparaît comme rassembleuse d’autant que, cas unique dans l’histoire dahoméenne, il est nommé à un poste ministériel le 18 novembre et devient le véritable pendant de Sourou Migan Apithy qui a été élu le 27 mai vice-président du Conseil de gouvernement du Dahomey (le gouverneur est président de droit) en application de la Loi-cadre Defferre.
an 1953 : Archipel des Comores - Le 15 juin 1953, plusieurs politiques comoriens osent sans y croire faire une déclaration commune demandant l’indépendance. Un référendum est prévu et les textes permettant une autonomie plus grande sont votés. À cette date, la plupart des élus comoriens et anjouanais sont pour une indépendance à terme, mais reste en majorité contre une indépendance sans indépendance économique. Les créoles ou riches planteurs d'origine française sont tous farouchement contre.
an 1953 - 1967 : Libye - Dans ses premières années d'indépendance, la Libye est classée par l'ONU parmi les pays les plus défavorisés de la planète : 94 % de la population est analphabète. L'unité nationale demeure fragile, et l'influence du Royaume-Uni, qui renouvelle en 1953 pour vingt ans ses bases militaires en Libye, demeure prépondérante. Les États-Unis renouvellent également leur base militaire en 1954 pour seize ans. L'Italie obtient la garantie des biens de ses colons, qui peuvent librement les conserver ou les vendre, mais verse des dommages de guerre à la Libye. Le Royaume-Uni, dont les anciens fonctionnaires de Tripolitaine sont restés en Libye des conseillers très écoutés, et les États-Unis, conservent une forte influence sur le royaume, auquel ils accordent une aide financière et alimentaire substantielle, et qui leur accorde en retour l'usage de bases militaires et aériennes. En 1956, la découverte de gisements de pétrole par la compagnie Libyan American Oil bouleverse l'économie de la Libye, en lui apportant des royalties inespérées. En 1965, le pays est devenu le premier producteur de pétrole d'Afrique. L'unité nationale du pays demeure cependant fragile, la dynastie Sanussi ayant bien plus d'assise en Cyrénaïque qu'en Tripolitaine et la structure du pouvoir restant essentiellement entre les mains des chefs des tribus, faisant de la Libye une société segmentaire. En 1963, le gouvernement tente de renforcer l'unité du pays et d'en moderniser l'administration en révisant la constitution : la forme fédérale est abandonnée, de même que le nom de Royaume-Uni de Libye, qui cède la place à l'appellation Royaume de Libye. Malgré l'augmentation spectaculaire du niveau de vie moyen, le développement et l'urbanisation du pays, mal maîtrisés, contribuent à entraîner de fortes inégalités sociales et entretiennent le mécontentement populaire : les réformes entreprises dans les années 1960 ne suffisent pas à dissiper le malaise social, qui s'exprime de façon particulièrement aigüe en 1967 lors de la guerre des Six Jours. Le nationalisme et le ressentiment à l'égard de l'Occident sont de plus en plus forts au sein de la population, mais aussi de certains secteurs de l'armée : si la personne du roi demeure respectée, le discrédit de la monarchie s'accroît.
an 1953-1964 : Malawi - La fédération de Rhodésie et du Nyasaland (1953-1963)
En 1953, les protectorats du Nyassaland, de Rhodésie du Nord et la colonie de Rhodésie du Sud s'unissent pour former la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, renforçant malgré elle les aspirations à la décolonisation et à l'indépendance.
Les Africains du Nyasaland refusent cette union par rejet de la politique de ségrégation raciale pratiquée notamment en Rhodésie du Sud et la peur de passer sous la domination des colons blancs ou des propriétaires de mines rhodésiennes. Les populations rurales craignent également d'être marginalisées et de perdre la protection britannique. Enfin, les avantages de la fédération pour les peuples du Nyassaland paraissent bien minces. Quatre cent mille Nyassas versent alors un ou deux pennies chacun, afin d'envoyer à Londres une délégation pour présenter une pétition à la reine. Le Colonial office refuse d'accéder finalement à leur demande et la délégation revient au Nyassaland les mains vides.
La mise en place de la fédération relance l'action militante du Congrès africain du Nyasaland qui reçoit, dès 1953, l'appui de la chefferie paysanne sous l'impulsion du chef suprême des Angonis, Philip Gomani, plus connu jusque-là pour son loyalisme envers la Grande-Bretagne pour qui il a combattu pendant les deux guerres mondiales et en Malaisie. Gomani refuse tout recours à la violence et en appelle à la résistance passive. Les Britanniques procèdent cependant à son arrestation malgré son grand âge sous l'accusation d'avoir abusé de ses pouvoirs de grand chef et d'avoir contrevenu à la loi.
En août 1953, de graves désordres éclatent dans la région de Cholo faisant craindre aux Britanniques un soulèvement analogue à celui des Mau Mau au Kenya. Ce n'est plus seulement la fédération qui est remise en cause. Des griefs relatifs à l'exploitation de la terre se sont ajoutés à la revendication principale (400 000 hectares de terres étaient exploités par la minorité blanche).
Après la mort naturelle de Gomani, la campagne de boycott et de désobéissance civile est alors reprise sous l'impulsion de Masauko Chipembere, un ancien assistant de district qui, en 1956, est élu au Conseil législatif. Un autre leader émerge également, au charisme incontesté, en la personne de Hastings Kamuzu Banda, un médecin formé aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Ghana, représentant du Congrès africain du Nyasaland (CAN) à Londres. Le 6 juillet 1958, Hastings Kamuzu Banda, de retour au pays, prend la tête du CAN. Le gouverneur décrète alors l'état d'urgence. Le CAN est interdit et Banda emprisonné en 1959 puis libéré en avril 1960 pour participer à la conférence constitutionnelle de Londres sur l'avenir de la Fédération.
Le 15 avril 1961, le Parti du congrès du Malawi, qui a succédé au Congrès africain du Nyasaland, remporte une victoire décisive lors des élections législatives. Il obtient également un rôle important au nouveau conseil exécutif et gouverne de fait le Nyasaland l’année suivante. La modération de Banda est alors appréciée par les Britanniques et par la société indo-pakistanaise du Nyassaland. Lors de la deuxième conférence constitutionnelle de Londres, en novembre 1962, le gouvernement britannique s’engage à accorder l’autodétermination au Nyasaland pour l'année 1963. Banda devient président le 1er février 1963, bien que les finances, la sécurité et la justice restent sous contrôle britannique. Une constitution entre en vigueur en mai de la même année, jetant les bases d’un gouvernement autonome.
an 1953-1959 : Mali - l’US-RDA va s’imposer. Il arrive en tête aux premières élections municipales organisées à Bamako le 12 avril 1953 ainsi qu’aux élections municipales du 18 novembre 1956. Modibo Keïta devient le premier maire élu de Bamako. Et aux élections pour l’Assemblée territoriale soudanaise de mai 1957, l’US-RDA obtient 35 députés, le PSP cinq. Dès 1959, une grande partie des membres du PSP décide de rejoindre l’US-RDA, faisant de ce dernier un parti unique de fait.
an 1953 : Maroc - De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle
20 août 1953 : exil du sultan Mohammed Ben Youssef et de la famille royale en Corse, puis à Madagascar (Antsirabé). Un nouveau sultan âgé de 70 ans, Mohammed ben Arafa, est élu par les oulémas avec l'appui du pacha de Marrakech, Thami El Glaoui. Cette manœuvre engendre des émeutes populaires à Casablanca, durement réprimées. L'Espagne de Franco, non prévenue de la décision, refuse d'en reconnaître la légitimité.
1953 : le général Augustin Guillaume, successeur du général Juin au poste de résident, échappe de peu à un accueil aux cocktails Molotov préparé par le PDI pour sa première visite officielle à Agadir.
20 août 1953 : déclenchement de la « Révolution du Roi et du Peuple »
an 1953 : Sao Tomé et Principe - Les autorités coloniales matèrent brutalement les émeutes nationalistes de 1953.
an 1953 : Zambie - En 1953, les deux Rhodésies et le Nyassaland sont incorporés dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, dans le but de développer la région et de limiter les visées indépendantistes noires. Les colons et les compagnies minières soutiennent ce regroupement afin de préparer une indépendance sous domination « blanche », sur le modèle sud-africain.
an 1953 - 1963 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Entre 1953 et 1963, le territoire fait partie de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland regroupant la Rhodésie du Sud, la Rhodésie du Nord (actuelle Zambie) et le Nyassaland (actuel Malawi).
an 1954 : Algérie - Le Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA) est fondé en mars 1954, il organisera la lutte armée. Le parti du Mouvement national algérien est fondé en juillet 1954 par les messalistes. Par la suite, le Front de libération nationale est fondé en octobre 1954 par la branche du CRUA (Comité révolutionnaire d'unité et d'action).
Guerre d'Algérie : En 1954, l’Algérie compte huit millions d'Algériens non français et un million de « Français d'Algérie » (Pieds-noirs et autochtones juifs naturalisés français). Après la crise au sein des mouvements nationalistes algériens et les autorités françaises, un groupe de patriotes se démarque et envisage le passage à la lutte armée en vue de l'indépendance. La guerre commence le 1er novembre 1954, après la réunion à Alger des six chefs du Front de libération nationale (Algérie) et anciens membres de l'Organisation spéciale, bras armé du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques et aussi responsables du Comité révolutionnaire d'unité et d'action, et après la déclaration du 1er novembre 1954.
L'action armée a été proclamée pendant la nuit dite de la Toussaint rouge. Le déclenchement des attentats a été signalé à travers le pays et les premiers attentats eurent lieu dans les Aurès. Les six partagent l'Algérie en 6 Wilayas et le ministre de l'Intérieur François Mitterrand est dépêché dans la région des Aurès pour dénoncer les attentats dans le même mois.
Il s'ensuit une guérilla, des maquis et des affrontements. l’Armée française, qui comprend des unités de supplétifs « musulmans » appelés « Harkis », la Direction de la Surveillance du territoire et la police française s'attaquent au FLN et à ses proches. Le FLN organise alors son combat sur deux fronts. Sur le plan interne, il met en place une résistance à travers sa branche armée, l’Armée de libération nationale qui au début fait face au Mouvement national algérien et à de multiples crises internes. Le Congrès de la Soummam organise le mouvement insurrectionnel et dégage les propriétés de la Révolution. L’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) sont créées pour organiser des révoltes en 1956. Tandis que sur le front diplomatique, il engage ses activités sous la supervision du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui plaide la cause algérienne et aussi vécut plusieurs crises ; il réussit néanmoins en 1958 à introduire pour la première fois dans l’agenda des Nations unies la question algérienne, ce qui représenta un franc succès pour la diplomatie algérienne.
Le conflit fut inscrit dans le cadre du processus de décolonisation qui se déroule après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour la France, cela concerne entre autres l’Indochine française, Madagascar, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Afrique-Équatoriale française et l’Afrique-Occidentale française. Le cas de l’Algérie se différencie des autres en ce sens qu’elle appartenait officiellement au territoire français, avec un million de citoyens dits « du Premier Collège » (les « Pieds-noirs »), dont certains, les Juifs d'Algérie et de huit millions de citoyens du Deuxième Collège (dit les musulmans), avant l'arrivée du général de Gaulle. Ce dernier négociera directement avec les chefs du FLN lors des accords d'Évian. De Gaulle réussit à sauver la République après le putsch des généraux à Alger 1961.
an 1954 : Algérie - Le Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA) est fondé en mars 1954. Il prépare l'organisation de la lutte armée. Le Mouvement national algérien (MNA) est fondé en juillet 1954 par les messalistes. Le Front de libération nationale (FLN) lui succède en octobre 1954, à l'initiative du CRUA. Le FLN, partisan de la lutte armée, et le MNA entrent dès lors dans une lutte fratricide pour le contrôle de la révolution.
an 1954-1962 : Algérie - Guerre d'Algérie (1954 à 1962) - Le terme de Révolution algérienne est utilisé en Algérie pour désigner ce qui est appelé en la France guerre d'Algérie (officiellement nommée évènements d'Algérie jusqu'en 1999). Un vaste mouvement de révoltes naît au fil des ans. L'Algérien autochtone, jusqu'alors sujet sans droit politique, est devenu citoyen français par la loi du 20 septembre 1947 et peut désormais circuler librement entre l'Algérie et la métropole.
L'action armée émane du CRUA (Mohamed Boudiaf, Mostefa Ben Boulaïd, etc). Le lancement de la révolution algérienne est décidé en juillet dans la Casbah d'Alger lors de la réunion des 22 cadres du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA) sous la présidence du Batnéen Mostefa Ben Boulaïd. Le CRUA se transforme en octobre 1954 en Front de libération nationale (FLN). Les six chefs du FLN qui déclenchent la révolution Algérienne le 1er novembre 1954 sont Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulaïd, Mourad Didouche, Mohamed Boudiaf, Belkacem Krim et Larbi Ben M'hidi. La Déclaration du 1er novembre 1954 est émise par radio depuis Tunis. La nuit du 1er novembre 1954, appelée alors la Toussaint rouge, est considérée comme le début de la guerre d'Algérie. Elle voit se dérouler soixante-dix attentats dans différents endroits du pays, marquée par la mort de quatre soldats français, d'un caïd et d'un couple d'instituteurs.
Les autorités françaises répondent par des mesures policières, (des militants du MTLD sont arrêtés : 2 000 arrestations en Algérie et en métropole à la fin décembre), militaires (augmentation des effectifs) et politiques (projet de réformes présenté le 5 janvier 1955). François Mitterrand déclare : « L'Algérie, c'est la France ». Il déclenche la répression dans les Aurès. L'Armée de libération nationale se développe néanmoins. Forte au départ de 500 hommes, elle en rassemble 15 000 après quelques mois, qui seront plus tard plus de 400 000. Pour l'heure, 100 000 soldats français sont affectés dans les Aurès.
Les massacres du Constantinois des 20 et 21 août 1955, notamment à Philippeville (Skikda), marqués tant par leur cruauté du côté des insurgés que par la terrible répression du côté français, sont une nouvelle étape de la guerre. La même année, l'affaire algérienne est inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée générale de l'ONU. Plusieurs chefs de l'insurrection, Mostefa Ben Boulaïd, Zighoud Youcef..., sont tués, d'autres emprisonnés.
Des intellectuels français partisans de l'indépendance commencent à aider le FLN. La plupart d'entre eux viennent des milieux de chrétiens de gauche, trotskistes, syndicalistes ou communistes dissidents, à l'instar du réseau Jeanson Ils agissent principalement en collectant et en transportant fonds et faux papiers, dénigrés par les tenants de l'Algérie française comme « porteurs de valise du FLN ».
Les heurts se poursuivent en 1955 et 1956, notamment en Kabylie. Près de Palestro, à 70 km à l'Est d'Alger, le 18 mai 1956, 19 soldats du contingent sont tués dans une embuscade. La presse se fait l'écho de cet accrochage sanglant. Au même moment Guy Mollet envoie de nombreux appelés en Algérie. L'émotion est intense en métropole. Le conflit apparaît sous un jour nouveau. L'Algérie n'est plus, comme en Indochine, un conflit lointain mené par des professionnels, mais une affaire intérieure française. Du coup, l'opinion métropolitaine devient potentiellement l'acteur principal du drame.
Après la condamnation de Larbi Ben M'hidi et après le congrès de la Soummam (20 août 1956), du nom du fleuve près duquel le FLN se réunit à Ifri, plusieurs partis algériens adhèrent à la cause du FLN. Le Front de libération nationale et l'Armée française tiennent le même langage : « Ceux qui ne sont pas avec nous, sont contre nous ».
Parallèlement à la guerre contre l'occupant, un conflit oppose certains chefs du mouvement insurrectionnel. La guerre éclate entre les chefs kabyles (Belkacem Krim, Ouamrane, etc) et les chefs chaouis, mais aussi entre les chefs chaouis des Aurès et les chefs chaouis de Nemencha. Abdelhai et Abbès Laghrour seront condamnés à mort par les partisans du Comité de coordination et d'exécution (CCE), organe de direction du FLN créé lors du congrès de la Soummam. La Tunisie est notamment le théâtre d'affrontements entre les différents chefs.
La délégation des principaux dirigeants du FLN (Mohamed Khider, Mostefa Lacheraf, Hocine Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf et Ahmed Ben Bella) est arrêtée, à la suite du détournement, le 22 octobre 1956 par l'armée française, de leur avion civil marocain, entre Rabat et Tunis, en direction du Caire (Égypte).
L'opération d'intoxication du complot bleu (1957-1958), menée par les services secrets français, abuse particulièrement le colonel Amirouche Aït Hamouda, qui procède à des purges internes dans la Wilaya III. Ces purges font plusieurs milliers de morts dans les différentes wilayas et éliminent notamment de nombreux officiers haut gradés, des ex-médecins-chefs, des pharmaciens, des ex-étudiants et aspirants sanitaires100. Lorsque le commandement français décide de déclencher les grandes opérations prévues par le plan Challe (1959-1961), les maquis sont déjà considérablement affaiblis par l'intoxication du complot bleu.
Face aux craintes que la nomination de Pierre Pflimlin à la présidence du Conseil fait peser sur l'Algérie française, les généraux d'Alger ( Raoul Salan, Edmond Jouhaud...), appuyés par les milieux pieds-noirs (Pierre Lagaillarde...) et par les gaullistes (Jacques Soustelle...), fomentent le putsch d'Alger, ou coup d'État du 13 mai. La Quatrième République s'effondre. L'arrivée du général Charles de Gaulle au pouvoir stabilise la situation du point de vue politique. Son « Je vous ai compris » est acclamé à Alger le 4 juin, laissant entendre aux pieds-noirs qu'il les soutient, sans hypothéquer l'avenir. Il engage une lutte contre les éléments de l'Armée de libération nationale et apporte les réformes attendues pour donner davantage de droits aux Algériens. Le référendum du 28 septembre 1958, qu,i fonde la Cinquième République est approuvé par 96 % des Algériens, Européens et musulmans, soit 75 % des 4 412 171 électeurs inscrits, en dépit des appels en faveur du boycottage lancé par le FLN. Il s'agit du premier scrutin auquel les femmes algériennes participent.
L'Armée française élimine presque tous les réseaux de l'Armée de libération nationale en Kabylie et dans quelques régions sensibles lors de différentes opérations : 26 000 combattants sont tués, 10 800 faits prisonniers, 20 800 armes récupérées. Le plan Challe entraîne, en quelques mois, la suppression de la moitié du potentiel militaire des wilayas. Les colonels Amirouche Aït Hamouda et Si El Haouès sont tués lors d'un accrochage avec les éléments de l'Armée française. Le FLN, très amoindri, appelle les éléments de son armée à tenir jusqu'au bout.
Messali Hadj est libéré en 1958 mais reste sous surveillance policière, et échappe à un attentat. Les Algériens organisent des attentats et des manifestations en France en faveur du FLN.
Début 1960 à Alger, la semaine des barricades fait 22 morts, dont 8 pieds-noirs et 14 gendarmes, et des centaines de prisonniers. Le général de Gaulle annonce la tenue d'un référendum pour l'autodétermination de l'Algérie. Algériens et Français sont appelés à se prononcer. Certains généraux français se rebellent contre l'autorité du général lors du putsch des généraux en avril 1961, qui reste sans lendemain. Le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) est proclamé. Ferhat Abbas décline l'invitation française. Le colonel Houari Boumédiène est alors le chef de l'Armée de libération nationale.
En 1960, l'ONU reconnaît le droit à l'autodétermination du peuple algérien. La partie française organise des pourparlers avec le Gouvernement provisoire de la République algérienne. Le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie a lieu dès janvier 1961, en France métropolitaine comme en Algérie française. Au total, la participation est de 76 %, et de 59 % en Algérie. Le Oui à l'autodétermination l'emporte avec 75 % des votants en métropole et 69 % en Algérie, même si le Non fait 72 % des voix dans la ville d'Alger, peuplée de nombreux Européens.
Plusieurs réunions à l'extérieur du pays vont aboutir aux accords d'Évian (18 mars 1962). Le colonel Houari Boumédiène refuse que les pieds-noirs restent en Algérie. Sur le terrain, les accords d'Évian, loin d'apporter aux populations la paix attendue, inaugurent une période de « violence extrême » : pour les rendre inapplicables, l'OAS intensifie les attentats, provoquant des réactions de l'ALN qui dépassent « par leur ampleur le stade des représailles » : les enlèvements d'Européens et les massacres de harkis et de notables pro-français se multiplient. Un million de pieds-noirs, mais aussi de harkis, de Juifs..., doit quitter l'Algérie en quelques mois, principalement d'avril à juin 1962. Le massacre d'Oran (5 juillet 1962), qui fait des dizaines de morts pieds-noirs et musulmans (peut-être pro-français), précipitera encore les départs.
En Algérie, une grande partie des pieds-noirs, mais aussi certains musulmans, s'oppose encore à la Révolution algérienne. Le mouvement anti-indépendantiste compte ainsi, parmi les musulmans, le bachaga Saïd Boualam, et parmi les pieds-noirs, le général Edmond Jouhaud ou les fondateurs de l'OAS Jean-Jacques Susini et Pierre Lagaillarde.
Le référendum sur l'indépendance de l'Algérie du 1er juillet 1962 confirme les accords d'Évian : l'indépendance est approuvée par 90,8 % des suffrages exprimés ; ce pourcentage monte à 99,7 % en Algérie.
Le bilan des pertes algériennes est sujet à de nombreuses controverses. Les recherches les plus récentes avancent des chiffres compris entre 250 000 et 300 000 morts. La guerre fratricide entre le FLN et le MNA, mouvement de Messali Hadj fait 4 300 tués et 9 000 blessés en France, et environ 6 000 tués et 4 000 blessés en Algérie. Le FLN est responsable, entre 1954 et le 19 mars 1962, de la mort de plus de 16 000 civils algériens et d'environ 13 000 disparus. Quant au nombre de harkis massacrés après le cessez-le-feu, les estimations varient entre 15 000 et 100 000 personnes.
Les conflits internes nés pendant la guerre, marqués par des luttes des clans au sein du Front de libération nationale (FLN), minent la nouvelle république. Deux factions revendiquent le pouvoir : d'un côté le pouvoir civil et l'organe qui l'incarne, le GPRA appuyé par les wilayas III et IV, de l'autre côté le pouvoir militaire à travers le « clan d'Oujda » et son « armée des frontières », dirigée par Houari Boumédiène.
an 1954-1979 : Canaries (Îles des) - La période franquiste (1939-1975) - Le régime franquiste aux Canaries
Le régime franquiste se manifeste entre autres par la création d'un établissement pénitentiaire de relégation, la colonie pénitentiaire agricole de Tefía (es) (1954-1966, Puerto del Rosario, Fuerteventura), à destination des prisonniers, politiques ou de droit commun, qui est aussi un centre de rééducation pour les homosexuels. Le livre La répression franquiste aux Canaries (es) (2002, José Francisco López Felipe) témoigne de l'ampleur de la répression franquiste.
Le nationalisme canarien se manifeste par la création en 1964 d'un mouvement indépendantiste, le Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC, « Mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance des îles Canaries »), basé à Alger, avec comme secrétaire général Antonio Cubillo (1930-2012, Antonio de León Cubillo Ferreira), revendiquant une « république des Guanches ». Le groupe « Forces Armées Guanches (es) » (FAG, 1976-1978) en est le bras armé. Le mouvement prend fin en 1979.
Les Détachements Armés Canariens (es) sont un autre groupe indépendantiste.
Le système de libre-échange des ports francs évolue avec le régime économique et fiscal des Canaries (es) de 1972.
an 1954 : Congo Kinshasa - Ceux d'en-bas formèrent en 1949 une association d'abord culturelle et finalement politique, l'Alliance des Bakongo (ABAKO), dont Joseph Kasa-Vubu devint président en 1954. Son rêve devint de rétablir l'ancien royaume du Kongo de l'époque portugaise, en fait celui des Bakongo. Cette tendance se durcit très vite et réclama bientôt l'indépendance immédiate tout en demeurant fédéraliste lorsqu'il s'agit plus tard de discuter le problème du reste du Congo.
an 1954-1961 : Gambie - Progressivement, des Gambiens sont intégrés dans l’administration de leur pays. En 1954, la Grande-Bretagne donne son accord pour que la Constitution soit amendée pour augmenter la représentation au sein du Conseil Législatif des Gambiens, les « membres non fonctionnaires » deviennent majoritaires. La Constitution est une nouvelle fois amendée en 1960 : le Conseil Législatif devient la « Chambre des Représentants » , six ministres sont prévus avec un ministre principal instauré en 1961.
an 1954 : Kenya - Peter Anyang' Nyong'o explique que « quand, en 1954, le gouvernement colonial et le colonat européen reconnurent qu'il fallait mettre fin à l'apartheid au Kenya pour parvenir à un règlement politique de la crise, il était clair que, parmi les Africains, il y avait suffisamment de partisans d'une alliance de classe avec les colons, prêts à partager le pouvoir politique contre les Mau Mau et les autres "nationalistes extrémistes" »
an 1954 : Maroc - De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle
mai 1954 : le général Guillaume est remplacé par un civil, Francis Lacoste.
an 1955 : Afrique du Sud - Le professeur Tomlinson, un conseiller du gouvernement, informe le cabinet que la séparation des races telle que mise en œuvre est vouée à l'échec et ne peut être sinon que très coûteuse. Il suggère de nombreux investissements pour améliorer l'agriculture dans les réserves tribales et propose de mettre en place des usines à leurs frontières afin de fournir suffisamment d'emplois pour les Noirs et les détourner des « villes blanches ». Bien que le rapport Tomlinson soit partiel et omette certains indicateurs importants, comme la taille trop petite de la superficie accordée aux réserves, et ne donne pas de calendrier précis pour la création de bassins d'emplois à la périphérie des réserves, le gouvernement refuse de dépenser autant d'argent. Verwoerd relance plus globalement le projet de grand apartheid, la politique des bantoustans, après avoir échoué à obtenir du Conseil représentatif autochtone d'accepter l'autonomie gouvernementale dans les townships. Avec Eiselen, son secrétaire aux affaires indigènes puis à l'éducation bantoue, il durcit le système législatif et constitutionnel, à commencer par les anciennes lois raciales et spatiales comme le Land Act. La question raciale finit par intervenir à tous les stades de la vie, avec la codification issue de lois ségrégationnistes d'application quotidienne, visant à faire coexister deux mondes qui, jamais, ne vivront ensemble.
Cette nouvelle législation est destinée à promouvoir et organiser un séparatisme géographique, politique et économique au sein de l'Afrique du Sud. Procédant à un renversement de logique par rapport aux politiques antérieures dont l'impératif était l'unité de la nation et du territoire, l'apartheid vise à sacrifier à l'ordre racial, non seulement l'intégrité territoriale du pays, mais aussi à gérer les relations entre les groupes. Avec le recul, l'apartheid se révèle même être plutôt une variante d'une politique raciale générale, remontant au XVIIe siècle et connue dans les territoires dominés par les Hollandais puis les Boers sous le nom de baasskap (« domination du patron »). Ce principe d'apartheid devient, pour plusieurs décennies, la pierre angulaire de la politique nationale, figeant le système et les rapports entre races. Pour nombre de chefs d’États étrangers, dans les pays desquels sévit déjà une séparation plus subtile voire coutumière entre les classes, les ethnies ou les religions, la ségrégation affichée et revendiquée de l’apartheid leur permet d'utiliser à leur profit la politique intérieure de l'Afrique du Sud et de faire de ce pays un bouc émissaire providentiel. Pendant plusieurs décennies, l'Afrique du Sud est considérée par les intellectuels occidentaux comme un État européen situé dans une région non occidentale. Mais l'instauration de la politique d'apartheid, dans le contexte international de la décolonisation, ruine progressivement la réputation du pays dans l'élite occidentale.
an 1955 : Cameroun - En mai 1955, les arrestations de militants indépendantistes sont suivies d'émeutes dans plusieurs villes du pays. La répression fait plusieurs dizaines (l'administration française en recense officiellement vingt-deux, bien que des rapports secrets en reconnaissent beaucoup plus) ou centaines de morts. L'UPC est interdite et près de 800 de ses militants sont arrêtés, dont beaucoup seront battus en prison. Recherchés par la police, des militants de l'UPC se réfugient dans les forêts, où ils forment des maquis, ou au Cameroun britannique voisin. Les autorités françaises répriment ces événements, et procèdent à des arrestations arbitraires. Le parti reçoit le soutien de personnalités comme Gamal Abdel Nasser et Kwame Nkrumah et l'action de la France est dénoncée à l'ONU par les représentants de pays comme l'Inde, la Syrie et l'Union soviétique
an 1955-1959 : Érythrée - En 1955, l'arabe et le tigrinia, les langues les plus couramment utilisées sur le territoire érythréen, sont remplacées au profit de l'amharique, et en 1959 le drapeau érythréen est interdit.
an 1955-1959 : Mali - Le 18 novembre 1955, une loi permet à plusieurs communes africaines de devenir des communes de plein exercice. C’est le cas de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti en 1956 et de Sikasso en 1959. Dans ces communes, un collège unique élit le conseil municipal qui désigne le maire en son sein. Modibo Keïta devient ainsi le premier maire élu de Bamako. Des communes de moyen exercice, où le maire est un fonctionnaire nommé par le chef de territoire, assisté d’un conseil municipal élu par un collège unique sont érigées en 1958 : Kita, Kati, Koulikoro, Koutiala, San, Tombouctou et Gao.
an 1955 : Maroc - De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle
22-26 août 1955 : des pré-pourparlers de négociation sont menés à Aix-les-Bains (Savoie) entre, côté marocain : Si El-Hadj El-Mokri, Grand Vizir, Si Kolti, délégué du Grand Vizir aux PTT, Si Thami El-Mosbi, délégué du Grand Vizir aux Finances, Si Berrada, Vizir adjoint au Grand Vizir pour les affaires économiques, Si Abderrahaman El-Hajoui, directeur adjoint au protocole et S.E. Hadj Fatemi Ben Slimane, ancien pacha de Fès, et côté français : Edgar Faure, président du Conseil, Antoine Pinay, ministre des Affaires étrangères, Robert Schumann, garde des Sceaux, Pierre July, ministre des Affaires marocaines et tunisiennes et le général Koenig, ministre de la Défense nationale ; le sultan Moulay Ben Arafa démissionne le 1er octobre 1955.
6 novembre 1955 : le gouvernement français reconnaît le principe de l'indépendance du Maroc.
16 novembre 1955 : retour triomphal du sultan Mohammed Ben Youssef à Rabat-Salé.
18 novembre 1955 : Mohammed Ben Youssef célèbre la fête du Trône à la Tour Hassan de Rabat
an 1955 : Namibie - On dénombrait environ 20 311 bushmen en 1955 sur le territoire namibien et un peu plus de 30 000 individus à la fin du XXe siècle (2 % de la population).
an 1955 - 1964 : Zambie - En 1955, Roy Welensky, un député blanc de Rhodésie du Nord, devient premier ministre de la fédération. En 1958, le Parti national uni pour l'indépendance » (UNIP), est fondé à partir d'une dissidence de l'ANC, hostile à la fédération. En 1962, l'ANC de Nkumbula remporte les élections en Rhodésie du Nord et s'allie à l'UNIP de Kenneth Kaunda. En 1963, la fédération est dissoute, ne pouvant surmonter l'antagonisme racial et nationaliste entre blancs et noirs. Le pays devient indépendant le 24 octobre 1964.
an 1956 - Afrique du Sud - Suppression de la franchise du droit de vote des Coloureds (gouvernement Strijdom).
an 1956-1960 : Burkina Faso (anc. Haute-Volta) - Une révision de l'organisation des territoires français d'outre-mer commença par le passage de la loi cadre du 23 juillet 1956 dite « loi Deferre ». Cette loi fut suivie par des mesures ré-organisationnelles approuvées par le Parlement français en 1957 et qui assuraient un large degré d'autonomie à chaque territoire. Le territoire devint ainsi une République autonome au sein de la Communauté française le 11 décembre 1958 : la République de Haute-Volta.
Elle accède finalement à l'indépendance le 5 août 1960. Le premier président, Maurice Yaméogo, était à la tête de la section locale du Rassemblement démocratique africain.
an 1956-1958 : Cameroun - Une insurrection éclate chez les bassa dans la nuit du 18 au 19 décembre 1956 : plusieurs dizaines de personnalités hostiles à l'UPC sont assassinées ou enlevées, des ponts, des lignes téléphoniques et d'autres infrastructures sont sabotées. Des unités de la garde camerounaise répriment violemment ces évènements ce qui entraîne le ralliement des paysans aux maquis. Plusieurs maquis de l'UPC sont constitués avec ses « généraux » et ses « capitaines » à la tête de « régiments » (150-200 guérilleros) et « bataillons » (50 guérilleros). L'armement est très sommaire : quelques fusils et pistolets dérobés, mais essentiellement des machettes, gourdins, arcs et flèches. Pour isoler la rébellion de la population civile Bassa, suspectée d’être particulièrement indépendantiste, cette dernière est déportée vers des camps situés le long des principaux axes routiers. Le général Lamberton, responsable des forces françaises, ordonne : « Toute case ou installation subsistant en dehors des zones de regroupement devra être entièrement rasée et leurs cultures avoisinantes saccagées. » Les villageois sont soumis au travail forcé pour le compte de la société Razel, notamment dans la construction de routes. Les Bassa vivant en ville sont expulsés vers leur région d'origine pour éviter que le « virus de la contestation » ne se propage.
L'Assemblée territoriale est élue au suffrage universel et avec un collège unique pour la première fois en décembre 1956 mais seules des formations sélectionnées par les autorités peuvent y participer. André-Marie Mbida est choisi par Pierre Messmer comme premier ministre en mai 1957 et Ahmadou Ahidjo est nommé premier ministre adjoint. Il est remplacé par Ahmadou Ahidjo en février 1958.
an 1956 - Cap Vert - À partir de 1956, les indépendantistes du Cap-Vert, menés par Amílcar Cabral, et de la Guinée — autre possession portugaise en Afrique de l'Ouest —, s'allient pour former le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC).
Le PAIGC exige alors des améliorations sur les plans économique, social et politique au Cap-Vert et en Guinée portugaise, posant ainsi les bases des mouvements indépendantistes de ces deux nations.
an 1956 : Congo Brazzaville - l'abbé Fulbert Youlou, fondateur de l'Union démocratique de défense des intérêts africains (UDDIA), remporte avec éclat les élections municipales de 1956.
Les premières élections municipales ont lieu en 1956 ; l'abbé Fulbert Youlou est élu maire de Brazzaville, et Stéphane Tchitchelle maire de Pointe-Noire. L'idée de l'indépendance fait son chemin, notamment grâce à l'influence du matsouanisme sur les milieux politiques laris du Pool (l'abbé Youlou revendique l'héritage d'André Matsoua), même si, comme dans le reste de l'Afrique équatoriale française, elle est moins avancée qu'en Afrique occidentale.
an 1956 : Congo Kinshasa - Les populations « d'en haut », venant de régions plus diversifiées et séduits par le « plan de 30 ans pour l'émancipation de l'Afrique » du professeur belge Jef Van Bilsen, publié en 1956, étaient aussi désireux de maintenir le grand Congo unitaire. Leur manifeste dans ce sens pour la conscience africaine, publié le 1er juillet 1956 sous la direction de Joseph Ileo, fut vigoureusement combattu par l'ABAKO dès son assemblée générale du 23 août 1956. Le plan de 30 ans est déclaré utopique : « la nationalisation des grandes compagnies vivrières et agricoles comme des parastataux est souhaitable. Puisque l'heure est venue, il faut accorder aujourd'hui même l'indépendance immédiate ! ».
an 1956-1960 : Congo Kinshasa (Zaïre) - Les Belges pensent avoir trouvé le système parfait : une présence permanente tout en gardant l'estime des Africains. L'amélioration lente mais continue du niveau de vie semble justifier les vertus de la colonisation belge. Mais sous cet ordre en surface se développent des revendications venant de sectes religieuses, des tribus et des intellectuels. Vers 1920, Simon Kimbangu prêche une forme originale de christianisme ; les autorités belges jugeant son enseignement subversif le condamne à mort puis à la détention perpétuelle.
Cependant, la prise de conscience politique des Congolais se manifeste tardivement. En 1956, sont publiés trois manifestes, Conscience Africaine, la Déclaration de l'épiscopat du Congo belge et le Contre-Manifeste. Dans le premier texte, les signataires notamment Joseph Malula (futur cardinal de Kinshasa), Joseph Ileo et d'autres élèves des Pères de Scheut, revendiquent « l'émancipation politique complète dans un délai de trente ans ». Dans le second texte, l'Église prend ses distances avec l’État colonial en insistant sur le fait que les Congolais « ont le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques ». Le Contre Manifeste rédigé par l'ABAKO de Joseph Kasavubu est encore plus radical en exigeant l'émancipation immédiate. En 1957, la Belgique accepte l'organisation d'élections locales. Les Congolais votent pour la première fois. L'annulation d'un meeting de l'ABAKO provoque le 4 janvier 1959 des émeutes à Léopoldville que la répression militaire noie dans le sang (quelques centaines de morts, tous Congolais). En octobre, les gendarmes ouvrent le feu lors d'une manifestation du MNC, faisant 30 morts et des centaines de blessés. Au début de l'année 1960, au cours d'une table ronde réunissant à Bruxelles des indépendantistes congolais et des délégués du Parlement et du gouvernement belges, l'indépendance du Congo est fixée au 30 juin de la même année. Une partie significative de la population européenne commence à quitter le pays. La Belgique précipite l'événement car elle craint une rébellion du Congo (les Algériens se battent alors pour leur indépendance) et un isolement international dans un contexte où les grandes puissances (Royaume-Uni et France principalement) se séparent une à une leurs colonies en Afrique Noire. Enfin, la métropole espère conserver finalement la mainmise sur son ex-colonie : les grandes entreprises et les officiers de l'armée congolais resteront belges tandis que les futurs dirigeants solliciteront l'aide de conseillers belges. La Belgique organise des élections législatives pour élire les membres du parlement à qui elle signerait et remettrait les documents signifiant l'indépendance de la république démocratique du Congo Patrice Lumumba joue un rôle crucial, mettant en avant une vision nationale du Congo et non fédérale comme le voulaient les Belges et des Congolais opportunistes. Le MNC de Lumumba et ses alliés remportent les élections nationales avec 65 % de sièges au Parlement. L'État indépendant sera sous régime parlementaire, le Premier Ministre étant le chef du gouvernement, le président n'ayant qu'un rôle symbolique. À l'occasion de la nomination du président, Lumumba convainc ses amis et alliés d'offrir ce poste à son adversaire Joseph Kasavubu car estime-t-il la victoire contre les colons est d'abord celle de tous les Congolais.
an 1956 : Côte d'Ivoire - En 1956, la loi-cadre de réforme de l'outremer décida du transfert de pouvoirs de Paris vers des autorités locales, sans pour autant freiner le mouvement vers l'indépendance.
an 1956 : Mali - La loi-cadre du 23 juin 1956 consacre la territorialisation des colonies françaises, marquant la victoire des thèses du leader ivoirien du Rassemblement démocratique africain Félix Houphouët-Boigny sur le fédéralisme défendu par Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor. Chaque territoire est doté d'un Conseil de gouvernement. Les conseils généraux deviennent des assemblées territoriales avec des compétences limitées. Les Assemblées territoriales sont élues au suffrage universel direct et élisent en leur sein 5 représentants pour siéger au Grand conseil de l'AOF ou de l'AEF.
Un chef de territoire est nommé par le gouvernement français. Il préside le conseil de gouvernement. Les décisions de ce conseil peuvent être annulées par le ministre de la France d'Outre-mer.
an 1956 : Maroc - De l'idée d'indépendance à l'indépendance réelle
15 février 1956 : visite du sultan en France. Ouverture des négociations franco-marocaines en vue de l'indépendance du Maroc et de l'abrogation du traité de Fès de 1912, établissant le protectorat français. Le parti de l'Istiqlal, représenté par Abderrahim Bouabid, Mohamed Lyazidi et Mehdi Ben Barka, ainsi que le PDI (Parti pour la démocratie et l'indépendance), représenté par Abdelhadi Boutaleb et Ahmed Cherkaoui, participent à ces négociations.
2 mars 1956 : le sultan et le gouvernement français annoncent officiellement l'indépendance du Maroc (déclaration commune franco-marocaine)
7 avril 1956 : Mohammed Ben Youssef et le général Franco mettent fin au protectorat espagnol sur le nord du pays (déclaration commune hispano-marocaine).
29 octobre 1956 : la zone de Tanger, qui était soumise à un statut international particulier, est elle aussi réintégrée au Maroc.
an 1956 : Sénégal - Loi-cadre créant les huit états autonomes en A.O.F. (y compris le Sénégal).
an 1956-1960 : Togo - Togoland - En 1956, le premier ministre, chef du gouvernement, est désormais élu par l'Assemblée nationale, et la république autonome, instituée le 30 août 1956, dispose de pouvoirs de plus en plus larges.
La même année, à l'issue d'un référendum, le Togo britannique est incorporé à la Côte-de-l'Or (ou « Gold Coast »), qui devient le Ghana à son indépendance en 1957. Les Éwés refusent ce choix qui consacre la partition de leur peuple, dont le territoire s'étendait avant la colonisation européenne de Notsé aux rives de la Volta. Cet éclatement nourrit par la suite des tensions périodiques entre le Ghana et le Togo.
Sous la pression de l'ONU — le Togo étant officiellement un territoire sous tutelle et non une colonie — le gouvernement français est contraint d'organiser des élections sous surveillance d’émissaires onusiens. Le CUT remporte une écrasante victoire le 27 avril 1958, et Sylvanus Olympio, son chef, est amnistié et est ainsi élu Premier Ministre de la République. En 1958, un nouveau référendum, organisé sous l'égide de l'Organisation des Nations unies (ONU), permait au Togo français d'accéder à l'autonomie, en tant que république, au sein de la Communauté française.
En février 1960, Sylvanus Olympio (1902-1963), refuse l'offre du président ghanéen, Kwame Nkrumah, d'unir les deux pays.
an 1956 : Rwanda - Mutara Rudahigwa commence à revendiquer l'indépendance du pays auprès de l'ONU.
Dans les années cinquante, la société Rwandaise a largement assimilé une idéologie raciale issue de la pensée Européenne du XIXème siècle (portée notamment par Gobineau, Vacher de Lapouge). L'administration coloniale et les missions catholiques ont largement contribué à la diffusion de celle-ci, s'appuyant notamment sur l'hypothèse hamitique, aujourd'hui réfutée. Durant les années qui précèdent l'indépendance, après avoir longtemps œuvré à mettre en place et justifier la supériorité des Tutsi, l'Église et les politiques changent de discours et encouragent la majorité Hutu à se libérer de son "oppression".
an 1956-1972 : Soudan - Le 1er janvier 1956, le Soudan accède à l'indépendance. Les premiers mouvements rebelles apparaissent dans les provinces du sud du pays. C'est le début de la Première guerre civile soudanaise de 1955 à 1972.
an 1957 : Congo Kinshasa - En 1957 se tiennent les premières élections communales dans trois villes du Congo.
La Belgique, qui croyait à la progressivité de la transition vers l'indépendance organisa les premières élections à l'échelon communal, limitées aux grandes villes en 1957. L'ABAKO triompha inévitablement à Léopoldville et cela impressionna certains unitaristes, tel Patrice Lumumba, un Tetela du Kasaï, intelligent et idéaliste, qui ne tarda pas à fonder son propre « mouvement national congolais » MNC-Lumumba, plus revendicatif que celui du MNC-Kalonji, Albert Kalonji étant aussi un Kasaïen unitariste.
an 1957 : Ghana - La Côte de l'Or est le premier pays noir-africain colonisé à accéder à l’indépendance. Un de ses premiers actes de souveraineté, le 6 mars 1957 est d’abandonner son nom colonial de Côte de l’Or au profit de son actuel nom, 'Ghana', en hommage à l’Empire du Ghana. Le Ghana entra dans les jours suivants aux Nations unies.
an 1957-1958 : Mali - Le 3 mars 1957, les élections des assemblées territoriales ont lieu dans l'ensemble des territoires. Au Soudan français, l'US-RDA obtient 57 sièges contre 7 à l'Union Dogon et 6 au PSP. Le premier conseil de gouvernement est constitué le 21 mai 1957 sous la présidence de Jean-Marie Koné. Modibo Keïta devient secrétaire d'État à la présidence du conseil (Gouvernement Félix Gaillard du 6 novembre 1957 au 17 mai 1958).
an 1957-1961 : Maroc - Règne de Mohammed V
En 1957, le sultan prend le titre de roi sous le nom de Mohammed V. Son fils Hassan II lui succède en 1961, puis son petit-fils Mohammed VI, en 1999.
Au cours des premières années d’indépendance, jusqu'en 1960, la politique marocaine consiste à reconstituer le « Grand Maroc » (ou du moins l'Empire chérifien dans ses frontières antérieures à 1912) englobant la Mauritanie, une partie de l'Algérie, le nord-ouest du Mali, voire l'archipel des îles Canaries, projet dans lequel le roi ne voulait pas être débordé par le parti de l’Istiqlal. Après le retrait d'Allal El Fassi, l'abandon de cette idéologie se confirme par la reconnaissance officielle par Rabat de la République islamique de Mauritanie nouvellement indépendante. Le gouvernement d'Abdallah Ibrahim (1958-1960), d'orientation socialiste, marque la volonté d'émancipation du Maroc qui se traduit diplomatiquement par son adhésion à la Ligue arabe et par son soutien au panafricanisme, et financièrement par l'abandon du franc marocain, indexé sur le cours du franc français, au profit du dirham. Les négociations s'accélèrent pour l'évacuation des bases militaires américaines situées sur le territoire marocain. Le Maroc s'affirme en outre comme l'un des membres fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine, et abrite en 1961 un sommet auquel participent le Mali, la Guinée, le Ghana, la République arabe unie et le GPRA, tous réunis au sein du groupe de Casablanca qui milite pour une unification avancée du continent.
L'opposition à la France et à sa politique coloniale, notamment durant la guerre d'Algérie, conduit également le Maroc à abriter des bases et des camps d'entraînement du FLN algérien, ainsi que le commandement de la Wilaya V : il s'agit de l'état-major de l'armée des frontières, connu sous le nom de clan d'Oujda et regroupant les futurs dirigeants de l'Algérie indépendante, tels que Houari Boumédiène et Abdelaziz Bouteflika.
an 1957 : Namibie - En 1957, des étudiants et ouvriers agricoles créent le Congrès populaire de l'Ovamboland. On y trouve Herman Toivo ya Toivo (un ancien mineur), Andreas Shipanga (un matelot) ou encore Sam Nujoma (un employé des chemins de fer)
an 1957 à 1987 : Tunisie - Indépendance
En Tunisie, entre 1957 et 2011, le Parti Socialiste Destourien (renommé Rassemblement Constitutionnel Démocratique en 1987) conserve le pouvoir, et la république n'a eu que deux présidents : Habib Bourguiba de 1957 à 1987 et Zine el-Abidine Ben Ali depuis 1987 (il espérait pouvoir le rester jusqu'en 2014 et même se présenter à un sixième mandat présidentiel).
an 1958 : Afrique du Sud - A la mort soudaine du premier ministre Strijdom, Hendrik Verwoerd lui succède à la tête du gouvernement. Alors que l'opposition libérale blanche se scinde en deux, des dissidents du parti uni formant le parti progressiste, la politique sud-africaine est de plus en plus contestée au niveau international, notamment aux Nations unies. Mais, dans le même temps, les mouvements noirs de libération se divisent eux aussi ; de nombreux radicaux de l'ANC quittent leur mouvement pour protester contre son ouverture aux autres races et forment une organisation nationaliste concurrente, le Congrès panafricain d'Azanie dirigé par Robert Sobukwe.
an 1958 : Algérie - Libéré en 1958, Messali Hadj restera en France où il restera sous surveillance policière et échappera à un attentat. Lors de l'indépendance, des centaines de combattants du MNA seront tués par le FLN.
an 1958-1960 : Bénin (anc. Dahomey) - Le 28 septembre 1958, le Dahomey vote « oui » au référendum instituant la Communauté française. La République du Dahomey est proclamée le 4 décembre et Sourou Migan Apithy devient président du Conseil de gouvernement. Il bénéficie d’une très large majorité avec le Parti progressiste dahoméen (PPD), fondé en mars 1958, et rassemblant le PRD, le RDD et d’anciens membres de l’UDD qui se sont opposés à l’affiliation au RDA. Mais le 17 janvier 1959, la création de la Fédération du Mali à laquelle participent des parlementaires du PPD, provoque son éclatement. Maga et Apithy s’opposent au projet de la Fédération et reconstituent leurs partis respectifs, le RDD et le PRD. C’est donc en ordre dispersé que se déroulent les élections à la première Assemblée nationale dahoméenne, les 2 et 23 avril 1959. L’entre-deux tours est marqué par la démission de leurs postes ministériels d’Alexandre Adandé, de Louis-Ignacio Pinto et d’Émile Derlin Zinsou qui entendent montrer leur attachement à la Fédération. Mais aucun parti n’obtient la majorité à l’issue des élections qui donnent vingt-huit sièges au PRD, vingt-deux au RDD et vingt à l’UDD-RDA. Un gouvernement d’union nationale est donc formé avec Sourou Migan Apithy à sa tête. Le RDD apparaît cependant comme le véritable arbitre de la scène politique dahoméenne entre Sourou Migan Apithy et Justin Ahomadegbé dont l’alliance est impossible du fait d’anciennes rancœurs personnelles.
Le 21 mai 1959, Apithy démissionne. Avec le soutien des élus de l’UDD-RDA, Hubert Maga le remplace. Pressé par l’aile gauche de son parti, il propose même la fusion à l’UDD. Ahomadegbé refuse et les ministres de l’UDD décident finalement de quitter le gouvernement en décembre 1959. Sans majorité, Hubert Maga parvient tant bien que mal à se maintenir. L’élection à la présidence de la République du Dahomey entraîne la formation le 9 mars 1960 du Parti des nationalistes dahoméens (PND) qui regroupe le PPD de Zinsou et le PRD d’Apithy. Mais soucieux de barrer la route au PPD, l’UDD-RDA soutient la candidature d’Hubert Maga qui est élu premier président du Dahomey le 26 juillet 1960 et qui proclame l’indépendance du Dahomey le 1er août de cette même année en présence de Louis Jacquinot, qui représente la France.
an 1958-1960 : République de Centrafrique - Le pays Oubangui-Chari devient la République centrafricaine le 1er décembre 1958 et proclame son indépendance le 13 août 1960.
Depuis, le pays a conservé le français comme langue officielle, utilisée dans les documents administratifs, alors que le sango, langue véhiculaire, agit comme unificateur du pays, permettant à chacun de se comprendre, même sans éducation scolaire avancée.
Le premier chef de l'État, Barthélemy Boganda, est considéré comme le père de la nation centrafricaine. Parlementaire à Paris, il fut l'auteur de brûlots réguliers et de demandes de maintien de tous les droits français au peuple d'Afrique équatoriale française. Parlementaire français véhément, il prônait depuis longtemps l'indépendance des colonies et avait proposé la création d'un État d'Afrique centrale unique, groupant Gabon, Congo, Cameroun et République centrafricaine. Il y voyait la seule solution permettant d'éviter l'éclatement de la région en territoires trop petits, non viables, et sans rôle à jouer sur la scène internationale. Il meurt le 29 mars 1959, peu après son élection, dans un accident d'avion dont les causes n'ont jamais été élucidées.
an 1958 : Congo Brazzaville - Le référendum sur la Communauté française obtient 99 % de « oui » au Moyen-Congo. Le Congo devient une république autonome, avec Fulbert Youlou pour Premier ministre.
En novembre 1958, à la suite de la loi-cadre de Gaston Defferre de 1956, le territoire du Moyen-Congo devient la république du Congo ; elle est dotée de l'autonomie, mais non de l'indépendance. Le Congo se prononce pour l'entrée dans la Communauté, et l'Assemblée nouvellement élue transfère la capitale à Brazzaville.
an 1958-1960 : Côte d'Ivoire - En décembre 1958, la Côte d'Ivoire devient une république autonome par le référendum, qui crée la Communauté française entre la France et ses anciennes colonies. Elle est alors dirigée par un premier ministre, Auguste Denise, auquel succédera Félix Houphouët-Boigny en avril 1959. Avec cette autonomie la Côte d'Ivoire ne devait plus partager ses richesses avec les autres colonies pauvres du Sahel, le budget de l'administration ivoirienne augmenta ainsi de 152 %. Le 7 août 1960 l'indépendance prend effet. Le pays reste cependant très lié à la France :
- sa monnaie est dirigée par la Banque de France, par le biais de l'union monétaire d'Afrique occidentale (franc CFA) ;
- de nombreux investissements français rendent l'économie ivoirienne dépendante de la France.
La loi-cadre ouvre de nouvelles perspectives en Côte d’Ivoire par l’introduction de la décentralisation, l’autonomie interne des colonies et l’extension des pouvoirs des Assemblées territoriales. Elle instaure également un collège unique d’électeurs et le suffrage universel. La voie s’ouvre ainsi pour l’instauration, de prime abord, de la Communauté franco-africaine après le référendum du 28 mars 1958 puis, par la suite, pour l’accession de la Côte d’Ivoire à la souveraineté internationale le 7 août 1960.
an 1958-1963 : Archipel des Comores - En 1958 application de la loi-cadre, le conseil de gouvernement, organe exécutif est toujours présidé par l'administrateur supérieur entouré par des ministres désignés par le conseil général. Le poste de vice-président du conseil de gouvernement confié à Ahmed Mohamed est symbolique. Certains politiciens reprochent à la France de ne pas traiter les Comores comme les autres TOM. L'éducation est très largement négligée depuis le début de la colonisation, on ouvre cependant le premier lycée en 1963 à Moroni (qui recevra les meilleurs élèves des quelques collèges des quatre îles, qui devaient auparavant terminer leurs études à la Réunion).
Après avoir accepté d'adhérer à la Communauté française lors du Référendum du 28 septembre 1958 organisé par le général de Gaulle, les Comores obtiennent le 22 décembre 1961 (loi no 1412) un statut d'autonomie interne. Ce statut d'autonomie interne donne jour à un gouvernement comorien élu par l'Assemblée territoriale. En application de la loi-cadre, on crée le Conseil de gouvernement, organe exécutif toujours présidé par l'administrateur supérieur, entouré par des ministres désignés par le Conseil général.
Fin décembre 1961, Saïd Mohammed Cheikh devient Président du Conseil de Gouvernement, premier personnage du Territoire, avant le haut-commissaire de la République. Il est élu parmi les représentants de l'assemblée.
an 1958 : Afrique République de Djibouti - La colonie devient un territoire d'outre-mer (TOM) français en 1958.
an 1958-1971 : Égypte - Un acte fort du nassérisme, une idéologie panarabe révolutionnaire, est ainsi l'union entre 1958 et 1971 de l'Égypte et de la Syrie sous l'entité République arabe unie. Le gouvernement de Nasser entreprend de moderniser les infrastructures et de doter l’Égypte d'une industrie. Des nationalisations sont effectuées et le secteur public devient prépondérant. De nombreuses politiques sociales sont impulsées (réforme agraire, gratuité de l'enseignement, salaire minimum, réduction du temps de travail des ouvriers, etc.).
an 1958-1962 : Érythrée - L'opposition contre l'incorporation de l'Érythrée à l'Éthiopie débute en 1958 avec la fondation du Mouvement de libération de l'Érythrée (MLE). Mené par Hamid Idris Awate, le MLE se livra à des activités politiques clandestines pour soutenir la résistance au pouvoir central impérial. Il est découvert et dissous par les autorités impériales en 1962. Dans la foulée, Hailé Sélassié dissout le parlement érythréen de manière unilatérale et annexe le pays.
Au cours des années 1960, le combat pour l'indépendance est repris par le Front de libération de l'Érythrée fondé au Caire par des exilés. Contrairement au MLE, le FLE est un mouvement de lutte armée, composé en majorité de musulmans originaires des plaines rurales de l'ouest du pays. Il bénéficie rapidement du soutien militaire et financier d'États arabes comme la Syrie et l'Irak.
Le FLE lance ses premières opérations militaires en 1961 et intensifie ses activités en réponse à la dissolution de la fédération en 1962.
an 1958 : Gabon - En octobre 1958, la Communauté française étant nouvellement créée, le Conseil de gouvernement du Gabon, s'appuyant sur l'article 76 de la nouvelle Constitution de la Ve République (version de 1958), demande la transformation du Gabon en département français. Léon Mba, président de ce Conseil, charge Louis Sanmarco, administrateur colonial, de présenter la demande auprès du gouvernement métropolitain. Sanmarco reçoit une fin de non recevoir, le général de Gaulle n'y étant pas favorable, au grand dam de Léon Mba.
an 1958 : Guinée - La France impose un système d'administration coloniale identique à celui appliqué dans les autres territoires africains de son empire colonial. Sous l'autorité d'un gouverneur général, le pays est divisé en vingt-neuf cercles, eux-mêmes dirigés par un commandant de cercle. Les chefferies traditionnelles sont souvent transformées et leurs systèmes de transmissions bouleversés. Elles constituent progressivement un instrument efficace de la domination coloniale française. Ce système joue un rôle important dans l'unification d'un pays artificiellement créé par les puissances coloniales au cours des conquêtes.
L'exploitation des ressources s'oriente vers la satisfaction des besoins de la métropole. Au détriment des cultures vivrières, les cultures d'exportation, monopolisées par des sociétés françaises, se multiplient. La monnaie et l'impôt se généralisent également durant cette période.
Cependant, une conscience politique anticoloniale se développe peu à peu, pour s'affirmer après la Seconde Guerre mondiale. En effet, Conakry devenant un port important, beaucoup de Guinéens y sont employés. Ils ont alors la possibilité de former leurs propres syndicats, d'où émergent des mouvements contestataires. À la tête de la puissante Union générale des travailleurs d'Afrique noire (UGTAN), Ahmed Sékou Touré, arrière-petit-fils de Samory Touré, mène une action pour obtenir davantage de représentants africains dans le gouvernement local. La constitution française d'octobre 1946, plus libérale à l'égard des pays colonisés, permet la création de partis politiques, dont Sékou Touré devient la personnalité la plus importante. Lors du référendum de septembre 1958, la Guinée est le seul pays de l'Afrique francophone à rejeter la proposition du général de Gaulle concernant l'intégration des colonies de l'A.O.F. au sein d'une Communauté française
Lors du référendum de septembre 1958, la Guinée est le seul pays d'Afrique francophone à rejeter la proposition du général de Gaulle concernant l'intégration des colonies de l'AOF au sein d'une Communauté française, ce qui entraîne une rupture immédiate des relations politiques et économiques avec la France. L’indépendance fut proclamée le 2 octobre 1958. La France retira dans le mois qui suivit son armée, ses fonctionnaires et ses crédits. Les colons français emportent avec eux tout leur matériel de valeur, et rapatrient les archives souveraines françaises. Le Washington Post observe l'intransigeance avec laquelle les colons français ont démoli tout ce qu'ils pensaient être leur contribution en Guinée : « En réaction [au vote pour l'indépendance], et comme avertissement aux autres territoires francophones, les Français se sont retirés de la Guinée en deux mois, emportant tout ce qu'ils pouvaient avec eux. Ils ont dévissé les ampoules, emporté les plans des canalisations d'égouts à Conakry, et même brûlé les médicaments plutôt que de les laisser aux Guinéens. ».
Le pays accède à l'indépendance le 2 octobre 1958 et Ahmed Sékou Touré en devient le président à 36 ans. La France mène alors une guerre économique contre son ancienne colonie notamment à travers l'Opération Persil les services secrets français vont notamment répandre de faux francs CFA pour déstabiliser la Guinée monétairement. Des maquis d'opposition sont constitués avec l'aide des services secrets français. Maurice Robert, chef du secteur Afrique au service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) de 1958 à 1968, souligne que « nous avons armé et entraîné ces opposants guinéens pour qu’ils développent un climat d’insécurité en Guinée et, si possible, qu’ils renversent Sékou Touré.».
an 1958 : Guinée équatoriale - Création d'un gouvernement autonome.
an 1958-1960 : Mali - La question du fédéralisme divise les dirigeants africains au sein même du RDA. L’ivoirien Félix Houphouët-Boigny s'oppose à la fédération ne voulant pas que la Côte d’Ivoire devienne « la vache à lait des autres territoires ». À l’opposé le Soudanais Modibo Keïta et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor soutiennent l’idée d’une fédération.
Le référendum du 28 septembre 1958 sur la Constitution de la République française voulue par le général De Gaulle contribue à la désunion, partageant les Africains en trois camps : les indépendantistes, les fédéralistes et les anti-fédéralistes.
Léopold Sédar Senghor qui souhaite une Afrique de l'Ouest unie et associée à la France appelle à voter oui. L’US-RDA appelle également à voter oui. Elle pense que le pays n'est pas prêt pour l'indépendance et souhaite avant toute indépendance réaliser l'unité entre les territoires. Les Ivoiriens soutiennent cette constitution. Seul le guinéen Ahmed Sékou Touré et le nigérien Bakari Djibo appellent à voter non.
La Guinée vote majoritairement non et devient indépendante. les autres territoires de l’AOF votent majoritairement pour et deviennent des États autonomes au sein de la Communauté française qui se substitue à l’Union française.
Au congrès fédéral du RDA qui se tient à Bamako en décembre 1958, les Soudanais et les Sénégalais mènent la bataille du fédéralisme. Les délégués du Dahomey et de la Haute-Volta les soutiennent.
Le 31 décembre 1958, l'Assemblée constituante du Soudan adopte à l'unanimité une déclaration prévoyant la création d'une assemblée constituante fédérale dotée d'une délégation de pouvoir en vue de la définition des institutions fédérales.
Le 8 janvier 1959, Modibo Keïta est élu président du grand conseil de l'AOF.
Le 14 janvier 1959, l’Assemblée fédérale de la Fédération du Mali se réunit à Dakar. Les délégations de 4 territoires étaient représentées : le Sénégal (présidée par Léopold Sédar Senghor), la République Soudanaise (présidée par Mahamane Haïdara), le Dahomey (présidée par Alexandre Adandé) et la Haute-Volta (présidée par Maurice Yaméogo). Modibo Keïta est élu président de l’Assemblée. En quatre jours, la constitution de la Fédération du Mali est adoptée. Chaque délégation doit rentrer dans son pays pour la faire ratifier.
Le 23 janvier 1959, l’Assemblée du Soudan adopte la constitution de la république soudanaise et la constitution fédérale. En Haute-Volta, Maurice Yaméogo change de position : après avoir défendu la Fédération du Mali, il souhaite maintenant une adhésion individuelle de son pays à la Communauté. Cette volte-face se fait sur la pression de la Côte d’Ivoire voisine. Au Dahomey, les partisans du fédéralisme échouent et le pays ne rejoint pas la Fédération. Seuls le Sénégal et le Soudan français adhérent à la Fédération du Mali.
Le 8 mars 1959, des élections générales ont lieu. L'US-RDA obtient la totalité des 80 sièges de l'Assemblée territoriale.
Le 31 mars 1959, le Soudan français accède au statut d’autonomie interne.
Le 4 avril 1959, la Fédération du Mali devient officielle par la signature des accords de transfert de compétence et de coopération avec la France. La première assemblée fédérale est composée de 20 membres élus par pays, Sénégal et Soudan français. Elle se réunit la première fois le 4 avril 1959 à Dakar, capitale de la Fédération du Mali. Léopold Sédar Senghor est élu président de l’assemblée et Modibo Keïta devient chef du gouvernement fédéral. L’Assemblée fédérale vote l’adhésion de la Fédération du Mali à la communauté.
Modibo Keïta est désigné président du gouvernement de la Fédération du Mali. Le lendemain, le gouvernement fédéral est constitué, à parité de Soudanais et de Sénégalais.
-
Président du conseil : Modibo Keïta (Soudan français)
-
Vice-président du conseil : Mamadou Dia (Sénégal)
-
Ministre de la Justice : Boubacar Guèye (Sénégal)
-
Ministre de l'information et de la sécurité : Tidiani Traoré (Soudan français)
-
Ministre de la Fonction publique : Ousmane Bâ (Soudan français)
-
Ministre des Finances : Doudou Thiam (Sénégal)
-
Ministre des Travaux publics Amadou Mamadou Aw (Soudan français)
-
Ministre de l'Éducation et de la Santé : Abdoulaye Fofana (Sénégal)
Le congrès constitutif de Parti de la fédération africaine se tient à Dakar du 1er au 3 juillet 1959. Il regroupe l'US-RDA, l'Union progressiste dahoméenne, le Mouvement populaire sénégalais, le Parti du rassemblement africain (PRA) et l'Union démocratique voltaïque (UDV-RDA) de Haute-Volta.
Les négociations entre la France et la Fédération du Mali se tiennent à Paris du 18 janvier 1960 au 4 avril 1960. Les accords remettent aux deux États fédérés toutes les compétences détenues par la Communauté. Le président de la République française était de droit le président de la communauté. La France participe à la formation des armées fédérales et possède des bases militaires sur leur territoire. Ces accords sont ratifiés par l’Assemblée nationale française le 9 juin 1960 puis par le Sénat le 13 juin. Ils sont ensuite ratifiées par les Assemblées du Sénégal et du Soudan qui votent le 14 juin le transfert de leur compétence à la Fédération du Mali dans plusieurs domaines : politique étrangère, défense, monnaie, politique financière et économique commune, contrôle de la justice et de l'enseignement supérieur, organisation générale des transports communs et des télécommunications. L’indépendance est proclamée le 20 juin 1960.
an 1957 : Namibie - En 1958, la population du Sud-Ouest africain atteint 450 000 habitants dont 200 000 Ovambos résidant très majoritairement dans le quart septentrional du territoire. Les 50 000 blancs du territoire résident dans le nord et le sud, principalement dans les centres urbains (représentant la moitié des 20 000 habitants de la zone urbaine de Windhoek dont plus de 95 % des habitants de la ville elle-même et plus de 90 % de la zone urbaine de Swakopmund). Il n'est pas étonnant dans ces conditions que le gouvernement sud-africain propose alors, mais sans succès, de diviser le territoire en deux afin de se débarrasser du quart septentrional du Sud-Ouest africain qui aurait été directement géré par les Nations unies.
an 1958 : Soudan - En novembre 1958, le général Ibrahim Abboud effectue un coup d'État militaire et s'empare du pouvoir.
an 1959 : Afrique du Sud - En novembre 1959, dans le cadre de la politique d'apartheid mise progressivement en place dans le Sud-Ouest africain, territoire occupé par l'Afrique du Sud depuis 1915, les autorités sud-africaines déclarent insalubre le quartier de Old Location et décident de déplacer les populations indigènes qui y résident vers un nouveau quartier, situé à cinq kilomètres plus au nord, le futur township de Katutura, signifiant « là où on ne veut pas rester ». Le 10 décembre 1959, la campagne de protestation organisée par la SWANU (un parti politique de Namibie) dérape et se solde par la mort de treize manifestants, abattus par les forces de police sud-africaines, et cinquante-quatre blessés. La répression policière s'abat sur la province, contraignant les dirigeants de la SWANU, dont Sam Nujoma, à s'exiler au Bechuanaland, en Rhodésie du Sud, puis en Tanzanie, quelques années plus tard.
an 1959 : Burundi - Après la Seconde Guerre mondiale, le Ruanda-Urundi devient un territoire sous tutelle de l'Organisation des nations unies sous autorité administrative belge. Le 10 novembre 1959, la Belgique accepte de réformer la politique et légalise le multipartisme. Deux partis politiques émergent : l'Union pour le progrès national (UPRONA), un parti multiethnique fondé et dirigé par le prince tutsi et Premier ministre Louis Rwagasore et le Parti chrétien-démocrate, soutenu par la Belgique.
an 1959 - Cap Vert - Au cours des trois premières années de son existence, le PAIGC ne fait guère de vagues et prépare ses ressources militaires. Sa première grande action est l’incitation à la grève des dockers du port de Bissau le 3 août 1959. La police coloniale interdit la grève et ouvrit le feu sur les grévistes, tuant plus de 50 personnes. Cet événement est le premier d’une guerre de treize ans, au cours de laquelle 10 000 soldats du PAIGC, soutenu par Cuba et par l’Union soviétique, combattent les 35 000 soldats, portugais et africains, des troupes portugaises.
an 1959 : République de Centrafrique - La figure emblématique de l'indépendance du pays est l'abbé Barthélemy Boganda, qui meurt en pleine campagne électorale, dans un accident d'avion le 29 mars 1959.
an 1959-1960 : Congo Kimshasa - En 1959, des troubles éclatent à Brazzaville et l'armée française intervient : Youlou est élu président de la République, et, le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance.
Les jeunes rivalités politiques confrontées aux structures tribales compliquées du Congo allaient former un mélange détonant qui détruirait au bout de cinq années la première démocratie parlementaire congolaise. On ne peut que rappeler ici quelques épisodes saillants :
-
Les 4–7 janvier 1959, l'interdiction tardive d'un meeting de l'ABAKO provoque des émeutes à Léopoldville, dont la répression fait officiellement 47 morts et 241 blessés parmi les Congolais. Le nombre réel de morts pourrait se situer entre 200 et 300.
-
Le 13 janvier, déclaration gouvernementale annonçant l'intention belge de réaliser rapidement l'indépendance du Congo unitaire. L'ABAKO rejette cette déclaration deux jours plus tard.
-
En octobre, les gendarmes ouvrent le feu lors d'une manifestation du MNC, faisant 30 morts et des centaines de blessés.
La suite de l'année 1959 voit d'abord l'autorisation des partis congolais, suivie d'élections générales sur l'ensemble du territoire congolais marquées par toutes sortes de manœuvres de ces partis dont se dégagent trois pôles : un Cartel des nationalistes fédéralistes formés de 6 partis séparatistes ou autonomistes dont l'ABAKO et le MNC-Kalonji, le pôle du MNC-Lumumba et finalement celui de l'homme fort du Katanga, Moïse Tshombé, conscient de la force économique de sa région et de l'intérêt de s'entendre avec l'Union minière du Haut Katanga (tout comme Kalonji vis-à-vis des exploitations de diamant au Kasaï). Parmi les partis qui émergent on retrouve le PSA (Parti Solidaire Africain d'Antoine Gizenga), le PNP (Parti national du peuple conduit par Albert Delvaux et Laurent Mbariko) Le LUKA (L'Union kwangolaise) par André Petipeti Tamata et Pierre Masikita.
Du 20 janvier au 20 février 1960, ce fut la Table ronde de Bruxelles qui fixe au 30 juin suivant l'indépendance du Congo, et où représentants congolais et belges fixèrent les étapes suivantes :
-
En mai eurent lieu les élections législatives. La première chambre des députés désigne par tirage au sort André Petipeti Tamata comme le premier président de chambre des représentants. Il dirige le bureau provisoire pour valider les mandats des députés élus et l'élection définitive du bureau.
-
Les élections législatives et provinciales marquèrent de nouveaux clivages et alliances (scission de l'ABAKO) d'où résulta un compromis : Joseph Kasa-Vubu fut élu Président par le Parlement, Lumumba étant Premier ministre.
Au moment de l'indépendance du pays, le roi des Belges se rendit en personne à Léopoldville (future Kinshasa) pour assister aux cérémonies consacrant la fin de l'union coloniale entre la Belgique et le Congo, et marquant la naissance sur la scène internationale de ce nouvel État francophone (langue officielle) d'Afrique.
an 1959-1960 : Guinée - La Guinée inscrit à l'article 34 de sa Constitution qu'elle « peut conclure avec tout État africain les accords d'association ou de communauté, comprenant l'abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine ». Après des discussions avec Kwame Nkrumah, apôtre du panafricanisme, la Guinée et le Ghana forment une union le 1er mai 1959, puis sont rejoints le 24 décembre 1960 par le Mali. Officiellement non-aligné, le régime s'appuie sur l'Union soviétique sans rejeter l'aide des États-Unis.
an 1959 : Guinée-Bissau - Une grève ouvrière au port de Bissau aboutit à un massacre. Cinquante ouvriers sont tués par les forces de l'ordre portugaises et plus de 100, blessés. Ce massacre constitue un « tournant de la réflexion des nationalistes révolutionnaires », les incitant à reconsidérer les luttes pacifiques menées jusqu'alors pour envisager la lutte armée.
an 1959 - 1975 : Madagascar - Sous la présidence de Philibert Tsiranana de 1959 à 1972, les Français continuent à exercer une domination sur l’administration et l’armée de la nouvelle république, ainsi que sur les activités économiques et la vie culturelle. En 1972 cependant, la révolte des étudiants, massivement appuyée par les lycéens et le monde ouvrier de la province de Tananarive aboutit à la chute du régime. Le général Ramanantsoa, chef de l’état-major se voit confier par la rue les rênes du pouvoir. Mais celui-ci ne réussit pas à affermir son autorité et, confronté à l’aggravation des troubles et au risque d’éclatement du pays, préfère se retirer au début de 1975 en abandonnant le pouvoir aux mains du colonel Ratsimandrava, qui est assassiné au bout d’une semaine. Au terme enfin d’une instabilité de plusieurs mois, une conjuration militaire place à la tête de l’État le capitaine de corvette Ratsiraka, qui était chargé du ministère des Affaires étrangères sous le gouvernement de Ramanantsoa.
Dès son accès au pouvoir, Didier Ratsiraka proclame sa volonté d’instaurer un régime « révolutionnaire », proche du « bloc socialiste », sous l’égide d’une Deuxième République, la République démocratique de Madagascar. De nombreux secteurs de l’économie sont ainsi nationalisés et un parti unique, l’Avant-garde de la révolution malgache (AREMA) domine toute la vie politique. Découragés, les investisseurs se retirent, entraînant une dégradation rapide de l’activité économique et une aggravation de la paupérisation. Des troubles, chaque fois durement réprimés éclatent alors un peu partout, achevant de démoraliser la population. Au bout d’une quinzaine d’années de ce régime, Madagascar se retrouve parmi les pays les plus pauvres de la planète.
an 1959-1960 : Namibie - En 1959, l'Organisation populaire de l'Ovamboland (OPO) succède au Congrès populaire de l'Ovamboland et ouvre des bureaux à Windhoek et à Walvis Bay. Sam Nujoma en devient le président. Dans le même temps, d'autres organisations sont constituées comme l'Organisation des métis du Sud-Ouest Africain (SWACO), l'Association des contribuables de Rehoboth (RTA) ou l'Union nationale du Sud-Ouest Africain (SWANU), créée avec le soutien du conseil tribal héréro et du chef Hosea Kutako, qui représente la quasi-totalité des forces politiques (dont l'OPO) opposées à la colonisation sud-africaine.
En novembre 1959, dans le cadre de la politique d'apartheid mise progressivement en place dans le Sud-Ouest africain, les autorités de Windhoek déclarent insalubre le quartier de « Old Location » et décident de déplacer les populations indigènes qui y résident vers un nouveau quartier situé à cinq kilomètres plus au nord (le futur township de Katutura signifiant « là où on ne veut pas rester »)27. Le 10 décembre 1959, la campagne de protestation organisée par la SWANU dérape et se solde par la mort de 13 manifestants, abattus par les forces de police, et 54 blessés27. La répression policière s'abat sur la province contraignant les dirigeants de la SWANU dont Sam Nujoma à s'exiler au Bechuanaland, en Rhodésie du Sud, puis en Tanzanie quelques années plus tard.
Dans les mois qui suivent le massacre du 10 décembre, la SWANU qui aspirait à dépasser les barrières tribales traditionnelles se divise. Les militants ovambo de l'OPO quittent la SWANU. Le 19 avril 1960, ils créent un mouvement ethnique rival, l'Organisation du peuple du Sud-Ouest Africain (SWAPO) dont la présidence est assurée par Sam Nujoma. Cette scission majeure durera jusqu'à l'indépendance en dépit de tentatives réitérées pour fusionner les deux mouvements. Les clivages idéologiques contribuent à l'éloignement des deux formations. Alors que la SWANU, dominée par les Héréros, reste un parti intellectuel adoptant une ligne socialiste radicale et est soutenue par la Chine populaire et la Suède, la SWAPO se tourne vers le marxisme-léninisme et obtient le soutien de l'Union soviétique ainsi que de la majorité des pays du Tiers monde. La SWAPO s'organise également en parti de masse, recrutant principalement chez les illettrés, les ouvriers et les paysans ovambos.
an 1959 : Rwanda - Le 25 juillet 1959, Mutara Rudahigwa meurt dans des conditions mystérieuses. Kigeli V Ndahindurwa est alors placé au pouvoir par les conseillers de Mutara Rudahigwa. Avec le soutien de l'Église, les Hutu refusent cette succession. Ils veulent être intégrés au nouveau gouvernement. Des manifestations dégénèrent en révoltes après la rumeur de l'assassinat d'un homme politique hutu. Les Tutsi étant minoritaires, ils sont pourchassés et massacrés, le pays plonge alors en pleine guerre civile.
an 1960 : Afrique du Sud - En 1960, le massacre de Sharpeville, où soixante-neuf protestataires pacifiques sont tués par la police, met l'Afrique du Sud à la une de l'actualité internationale. Pour riposter, le gouvernement fait interdire la plupart des mouvements de libération comme l'ANC ou le Congrès panafricain d'Azanie. Leurs dirigeants entrent alors dans la clandestinité. Nelson Mandela fonde l'aile militaire de l'ANC, appelé Umkhonto we Sizwe, ce qui signifie la « Lance de la Nation », qui se lance dans des actions de sabotage des infrastructures industrielles, civiles et militaires153. En fin d'année, le chef de l'ANC, Albert Lutuli, obtient le Prix Nobel de la paix.
Dans un discours mémorable sur le « vent du changement », prononcé au parlement au Cap, le Premier ministre britannique, Harold Macmillan, en profite pour critiquer l’immobilisme et le passéisme des dirigeants d’Afrique du Sud. Exaspérés, les nationalistes proposent de soumettre un projet de référendum pour instituer la république. Bien qu'on ait cru un moment à une sécession des Blancs anglophones du Natal, le principe de la république est approuvé le 5 octobre 1960. À cette occasion, les Blancs se divisent entre républicains Afrikaners et loyalistes anglophones, mais la transition se fait dans le calme, sans émigration excessive des anglophones.
an 1960-1972 : Bénin (anc. Dahomey) - Comme beaucoup de pays africains, le Dahomey accède à l’indépendance en 1960, le 1er août. Une nouvelle constitution est adoptée. Le chef de gouvernement, Hubert Maga, devient le premier président de la jeune république, et affirme la volonté de garder des liens vivaces avec l'ancienne puissance coloniale. L'enclave portugaise de Ouidah, ancien port de la traite esclavagiste, revient au sein de cette nouvelle république. Pour éviter les effets néfastes du tripartisme dahoméen, un parti unique (Parti dahoméen de l'unité) est formé, mais des troubles sociaux et politiques entraînent, le 28 octobre 1963, un coup d’État militaire mené par le colonel Christophe Soglo.
En janvier 1964, le pays revient à la gestion civile. Sourou Migan Apithy assure la fonction de président, mais la situation politique demeure instable. Une nouvelle crise, entre son premier ministre Justin Ahomadegbé et Sourou Migan Apithy, bien que tous deux membres du même parti, conduit les militaires à reprendre le pouvoir, sans un coup de fusil, le 22 décembre 1965. Le général Soglo préside alors un Comité de rénovation nationale qui entreprend d’assainir l’économie et les finances du pays, mais des grèves éclatent en 1967. le gouvernement est renversé le 17 décembre de la même année par le commandant Maurice Kouandété qui met en place un comité révolutionnaire chargé de superviser l’action du gouvernement provisoire, de constituer une commission constitutionnelle et de contrôler les biens des anciens gouvernants. La nouvelle Constitution, approuvée le 31 mars 1968, établit un régime de type présidentiel. Émile Derlin Zinsou devient président, mais est renversé par un nouveau coup d’État qui le remplace par un directoire militaire présidé par Paul Emile de Souza le 10 décembre 1969. Un Conseil présidentiel composé des trois partis traditionnels est instauré le 7 mai 1970 ; il met en place une organisation qui doit permettre la cohabitation des trois chefs des partis traditionnels.
an 1960 : Haute-Volta future Burkina Faso - La Haute-Volta accède à l'indépendance le 5 août 1960. Le premier président de la république de Haute-Volta est Maurice Yaméogo.
an 1960 : Afrique du Sud - En 1960, le massacre de Sharpeville puis l'interdiction de l'ANC et des mouvements nationalistes africains mènent à la condamnation de la politique d'apartheid par les Nations unies et par la communauté internationale.
an 1960 - Cap Vert - En 1960, le parti installe son siège social à Conakry, en Guinée. L'année suivante, débute la rébellion armée du PAIGC contre les troupes portugaises : les actes de sabotage se transforment peu à peu en véritable guerre entre les 10 000 soldats du PAIGC, soutenus par l'Union soviétique, et les 35 000 soldats des troupes gouvernementales alliées à d'autres pays africains.
an 1960 : Cameroun - Le Cameroun français acquiert son indépendance le 1er janvier 1960 et devient la République du Cameroun. Les élections sur le territoire sous tutelle française sont entachées par des émeutes ethniques notamment en pays bamiléké. Les différentes ethnies réclament chacune leur indépendance. L'année suivante, la colonie britannique se divise en deux après un référendum d'autodétermination. Le Nord, principalement musulman, choisit d'intégrer le Nigeria. Quant au Sud, principalement chrétien, il choisit de rejoindre la République du Cameroun pour former la République fédérale du Cameroun. Le premier président du Cameroun est Ahmadou Ahidjo – Peul musulman du Nord – qui était Premier ministre depuis 1958. Dès son arrivée au pouvoir, Ahidjo favorise son ethnie, les Peuls (ou Foulbés) (politique, emploi, formation). Ahidjo est invité et reçu par le Président John Fitzgerald Kennedy aux États-Unis en 1962.
Pendant les premières années du régime, l'ambassadeur français Jean-Pierre Bénard est parfois considéré comme le véritable "président" du Cameroun. Cette indépendance est en effet largement théorique puisque des « conseillers » français sont chargés d'assister chaque ministre et disposent de la réalité du pouvoir. Le gouvernement gaulliste préserve son ascendant sur le pays à travers la signature « d'accords de coopération » touchant à tous les secteurs de la souveraineté du Cameroun. Ainsi, dans le domaine monétaire, le Cameroun conserve le franc CFA et confie sa politique monétaire à son ancienne puissance tutrice. Toutes les ressources stratégiques sont exploitées par la France, des troupes françaises sont maintenues dans le pays, et une grande partie des officiers de l'armée camerounaise sont Français, y compris le chef d'état-major.
Lors de son accession à l'indépendance, en 1960, le Cameroun se dote d'une Constitution à vocation pluraliste qui prévoyait le multipartisme. Cette constitution est, à peu de chose près, similaire à la constitution française. La France, "gendarme" des États-Unis, se fait l'apôtre des idées libérales face à la menace communiste. Toutefois, Dès le début des années 1960, les autorités multiplient les dispositions légales leur permettant de s’affranchir de l’État de droit : prolongation arbitraire des gardes à vue, interdiction des réunions et rassemblements, soumission des publications à la censure préalable, restriction de la liberté de circulation à travers l'établissement de laissez-passer ou du couvre-feu, interdiction pour les syndicats de lancer des souscriptions, etc. Toute personne accusée de « compromettre la sécurité publique » se voit privée d'avocat et ne peut faire appel du jugement prononcé. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité ou à la peine capitale — les exécutions peuvent être publiques — se font ainsi nombreuses. Un régime à parti unique est instauré en 1966
an 1960 : République de Centrafrique - Après la mort accidentelle du père de l'indépendance centrafricaine, Barthélemy Boganda en 1959,bAbel Goumba semble être son successeur mais David Dacko, soutenu par la France, devient le premier président de la république en 1960. Il instaure très vite un régime dictatorial et commet l'erreur de se rapprocher de la Chine. La France se décide alors de soutenir le chef d'état-major de l'armée centrafricaine, Jean-Bedel Bokassa.
an 1960-1963 : Congo Brazaville - Le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance, comme la plupart des pays colonisés de l'Afrique noire sous domination française en Afrique, d’abord sous le nom officiel de « République congolaise » jusqu’en 1965 (pour la distinguer de la première « république du Congo », ex-Congo belge devenu indépendant peu avant la même année). Depuis cette période de confusion, les deux pays seront informellement mais couramment désignés avec le nom de leurs capitales respectives (Congo-Brazzaville pour l’ancien Congo français au nord-ouest du fleuve, et Congo-Kinshasa pour l’ancien Congo belge), d’autant que le nom des deux pays a changé plusieurs fois.
En 1960, l'abbé Fulbert Youlou, alors Premier ministre, devient le premier président de la république du Congo. Il reste à ce poste jusqu'en 1963. Au cours des événements des 13, 14 et 15 août 1963 - ces journées sont appelées les « Trois Glorieuses » - l'abbé Youlou, est contraint à la démission sous la pression des syndicalistes. Le général de Gaulle ne le soutient pas à cette occasion - alors que l'armée française intervient six mois plus tard pour rétablir Léon Mba à la tête du Gabon.
an 1960 : Congo Kimshasa - Le 30 juin 1960 l'indépendance du Congo belge est proclamée en tant que « république du Congo », Joseph Kasa-Vubu, Président; Lumumba Premier ministre.
En même temps, l'ancienne colonie française voisine du Moyen-Congo adoptait également le titre de « république du Congo » à son indépendance, le 15 août 1960. Les deux pays se différenciaient en accolant le nom de leur capitale au nom du pays (Congo-Léopoldville, Congo-Brazzaville).
Dans l'armée du nouvel État indépendant, les blancs gardent le pouvoir. La radio accuse alors les anciens colons de complot contre le nouvel État, ce qui provoque la colère des soldats bangalas et balubas qui se mettent à persécuter la communauté blanche. La Belgique menace alors d'intervenir militairement.
Le 11 juillet 1960, les dignitaires du Katanga, sous la direction de Kapenda Tshombé Moïse et à l'instigation de quelques colons belges, proclament l'indépendance de l'État du Katanga, en état de sécession depuis juin. Les autorités du Katanga créent alors leur propre monnaie et leur propre police. L'ONU propose sa médiation et Lumumba sollicite la venue des casques bleus.
Le 20 aout 1960, fait sécession le Sud-Kasaï, qui avait également proclamé son indépendance avant l'indépendance du reste du Congo, le 14 juin 1960. Ainsi, le gouvernement central perd ses deux provinces minières. L'ONU ordonne à la Belgique de retirer ses troupes, mais, après plusieurs résolutions contradictoires, rejette l'option militaire et qualifie le conflit au Katanga de « conflit intérieur ». Le 12 aout, la Belgique signe un accord avec Tshombé, reconnaissant de facto l'indépendance du Katanga. Alors que Lumumba décide de réagir en envoyant des troupes reprendre la région, l'ONU revient sur sa position initiale et impose militairement un cessez-le-feu, empêchant l'entrée des troupes congolaises. Dans un télégramme en date du 26 aout, le directeur de la CIA Allen Dulles indique à ses agents à Léopoldville au sujet de Lumumba :
« Nous avons décidé que son éloignement est notre objectif le plus important et que, dans les circonstances actuelles, il mérite grande priorité dans notre action secrète ».
Le 2 septembre 1960, le Premier ministre Lumumba appelle alors l'Union soviétique à l'aide. Les 5-14 septembre, lutte entre Joseph Kasa-Vubu et Lumumba. Les soldats balubas et bangalas n'étant pas représentés dans le gouvernement, ils commettent alors un coup d'État, et renversent le Premier ministre.
Au sein de l'armée, devenue complètement africaine, le général Mobutu Sese Seko prend les rênes et installe un gouvernement de commissaires. Mobutu est bientôt soutenu par les États-Unis, qui voient d'un mauvais œil le socialisme de Lumumba. Les médias occidentaux montrent en effet Lumumba du doigt et saluent la sécession katangaise comme seul rempart de la liberté individuelle contre l'étatisme.
an 1960-1980 : Afrique Côte d'Ivoire - Entre 1960 et 1980, le développement de l’économie ivoirienne est spectaculaire dans tous les domaines, notamment agriculture, industrie, commerce et finances. Il est le résultat d’une politique qui fait jouer un rôle éminent à l’État, à l’investissement privé et aux capitaux étrangers. La société ivoirienne connaît au cours de cette période une profonde mutation provoquée par la hausse du niveau de vie des habitants, les équipements sanitaires, éducatifs et sociaux, mais également du fait de l'augmentation de la population avec un taux de croissance annuel moyen de 3,8 %, la faisant passer de 3,7 millions en 1960 à 12,2 millions d’habitants en 1988.
Cependant, depuis le milieu des années 1980, l’économie stagne, conséquence de la dégradation des termes de l'échange avec l’extérieur, de l’accroissement des dettes de l’État et d’erreurs de gestion.
an 1960 : Afrique République de Djibouti - 40 000 habitants au début des années 1960.
an 1960-1968 : Éthiopie - Les troubles intérieurs
Les tensions internes éclipsées par l'euphorie de la libération ne tardent pas à refaire surface. Une première tentative d'assassinat du Negusse Negest a lieu par le blatte Tekkelé. Une autre a lieu le 5 juillet 1951, fomentée par le dejazmach Negache Bezabbeh, petit-fils de Téklé Haymanot.
Le 14 décembre 1960, un putsch est mené par le commandant en chef de la Garde Impériale, le général Menguistu Neway (1919-1961), instigué par son frère Guermamé formé aux États-Unis. Les insurgés emprisonnent les notables au Palais, les exterminent et forment un gouvernement sous l'égide du Prince Amha Sélassié (né Asfa Wossen Tafari, 1916-1997) . Le Negusse Negest rentre d'urgence d'une visite officielle au Brésil, les auteurs du putsch sont tués ou capturés.
Des révoltes paysannes commencent à voir le jour dans les années 1960 en opposition au système de taxation des revenus agricoles. C'est notamment le cas dans la région du Balé en 1963, où le conflit est exacerbé. La région est placée sous garde de la 4e division en 1966. Une autre révolte se produit dans le Godjam en 1968, et fait l'objet d'une intervention militaire dénoncée pour sa violence. L'armée finit par se retirer.
En 1965, un mouvement en faveur d'une réforme agraire prend le leitmotiv de marèt larachou (« la terre au cultivateur »)
an 1960-1964 : Gabon - Le 17 août 1960, comme la grande majorité des colonies françaises d'Afrique subsaharienne, le Gabon accède à l'indépendance. Indépendance contraire au souhait de son Premier ministre Léon Mba, qui avait demandé à ce qu'il devienne un département français d'outremer; ce dernier en devient le premier président. Il sera soutenu par la France qui assurera même militairement son maintien au pouvoir (intervention de l'armée française en 1964 à son profit), cela jusqu'à son décès en 1967 où il est remplacé par son directeur de cabinet, Albert-Bernard Bongo, appelé par la suite « Omar Bongo Ondimba ».
Le président Bongo instaure le monopartisme avec la création du Parti démocratique gabonais. L'exploitation des richesses naturelles du pays (bois, minerais et surtout pétrole) assure une relative prospérité au Gabon ; le président Bongo devient un chef d'État très courtisé, notamment par la France qui en fait un de ses alliés africains les plus sûrs. En échange du soutien de l’Élysée, qui peut intervenir pour le destituer, Bongo consent à mettre à disposition de la France une partie des richesses du Gabon et en particulier son pétrole et son uranium, ressources stratégiques. Sur les questions de politique internationale, le Gabon s'aligne sur Paris.
an 1960 : Ghana - En 1960, Nkrumah devient naturellement le premier président du pays. Le système scolaire s’étend, les écoles privées deviennent publiques et le taux de scolarisation est multiplié par sept. Dès les années 70, Le Ghana obtient ainsi l’un des meilleurs taux d’alphabétisation d’Afrique, avec plus de 60 % des enfants, garçons et filles, scolarisés et alphabétisés. Le 31 janvier 1964, il organise un referendum constitutionnel imposant un parti unique. Les résultats sont officiellement à 99,91 % en faveur du oui. Une dérive autoritaire s'amorce. Le pays s´endette aussi pour se moderniser et s´ouvre au commerce international.
Avant l'indépendance, le Royaume-Uni a mis en place un bureau de commercialisation du cacao. Ce bureau propose de payer les paysans en dessous des prix du marché et de placer la différence dans un fonds qui leur serait versé en cas de crise lors des faibles années de production. La production totale de paysans est acheté par le Bureau, qui la revend ensuite aux entreprises sur le marché international et réalise des profits stockés à Londres. Ainsi, en 1953, le Bureau vend le cacao ghanéen pour 74 millions de livres mais les paysans n'en reçoivent que 28 millions. Nkrumah décide de lancer une compagnie nationale pour assurer un prix plus équitable aux paysans, mais doit faire face à l’opposition d'une partie de la bourgeoisie qui fait affaires avec le Royaume-Uni. Le pays tente également de diversifier son économie et de réduire sa dépendance extérieure avec le développement d'une industrie lourde. une série de grands projets est lancée, tels que le barrage de la Volta pour produire de l'électricité afin de soutenir les nouvelles industries. Un port en eau profonde est construit à Tema notamment afin de développer un programme d'exportation de l'aluminium.
Le Ghana organise les 6e et 7e conférences panafricaines en 1953 à Kumasi et 1958 à Accra, qui est également la première conférence des États Indépendants d'Afrique. Un premier pas vers une réalisation concrète du panafricanisme est tenté en formant le 1er mai 1959 une union avec la Guinée, rejointe le 24 décembre 1960 par le Mali. Ces initiatives valent à Nkrumah l'hostilité des pays occidentaux (la CIA indique que « Nkrumah faisait plus pour saper nos intérêts qu'aucun autre noir africain ») mais également certains dirigeants africains qui l'accusent, dans ses projets de panafricanisme, de vouloir propager le communisme en Afrique.
an 1960 : Leshoto - Le Parti du congrès des Basothos (Basotho Congress Party, BCP), lié au Congrès national africain remporta les premières élections générales du territoire.
an 1960 : Libéria - À partir de 1960, le Liberia entre dans une période de vingt années de prospérité, grâce à des concessions offertes à des multinationales étrangères (principalement américaines et allemandes) pour l'exploitation des gisements de minerai de fer.
an 1960 : Mali - L’indépendance est proclamée le 20 juin 1960.
La fédération du Mali est indépendante depuis le 20 juin 1960 mais les divergences entre les Soudanais et les Sénégalais sont nombreuses. Les Soudanais souhaitent rapidement la fusion entre les deux nations pour n’en former qu’une seule. Ils souhaitent aussi éviter que Léopold Sédar Senghor ne deviennent président, fonction que doit occuper selon eux Modibo Keïta.
En août 1960, Modibo Keïta critique les essais nucléaires français dans le Sahara, ce qui irrite le président français Charles de Gaulle et le Premier ministre Michel Debré.
Au conseil fédéral du 19 août 1960, Mamadou Dia est déchargé de ses fonctions ministérielles qui sont confiées à Modibo Keïta, prétextant, selon une déclaration faite à Radio-Mali, des menaces graves pour la Fédération du Mali. Mamadou Dia déclare que le président Modibo Keïta vient de tenter un coup d'État.
Le 20 août, l'assemblée sénégalaise proclame l'indépendance du Sénégal en dehors de la fédération du Mali. Le gouvernement de Dakar reçoit les pleins pouvoirs pour 3 mois et l'état d'urgence est proclamé. Les frontières du Sénégal sont fermées et le trafic ferroviaire vers Kayes et Bamako est interrompu. Modibo Keïta est reconduit par train à la frontière soudanaise.
Le 5 septembre, Léopold Sédar Senghor est élu président du Sénégal.
Le 11 septembre, Claude Hettier de Boislambert, haut-représentant de la France auprès de la Fédération du Mali remettait ses lettres de créance au président du Sénégal, ce qui vaut reconnaissance de fait l’indépendance du Sénégal par la France.
Le 22 septembre, les Soudanais proclament à leur tour leur indépendance en dehors de la fédération du Mali mais conservent le nom de Mali pour leur nouveau pays, la première constitution du Mali est datée de ce jour ; cette proclamation vaut aussi reconnaissance de l’indépendance sénégalaise proclamée le mois précédent. La fédération du Mali comprenant Sénégal et Soudan est définitivement terminée, indépendante de la France depuis le 20 juin, elle n’aura vécu qu’un trimestre. Cette date coïncide avec l’anniversaire de la bataille du 22 septembre 1878, premier acte de résistance contre la puissance coloniale française..
Le 28 septembre 1960, le Mali et le Sénégal entrent aux Nations unies.
Dans une déclaration lue par Mamadou Diarrah, le congrès assigne au gouvernement des tâches prioritaires :
-
s'attaquer immédiatement et vigoureusement à la décolonisation économique ;
-
instituer rapidement des structures économiques nouvelles en renversant et en développant les circuits commerciaux dans le cadre d'une planification socialiste fondée sur les réalités africaines ;
-
user de tous les moyens pour implanter une infrastructure ferroviaire, routière, fluviale et aérienne conforme aux besoins du pays ;
-
intensifier la production agricole pour augmenter la consommation intérieure et le potentiel d'exportation ;
-
user de tous les moyens pour l'implantation d'industries de transformation afin d'éviter des frais inutilement élevés ;
-
accentuer les recherches minières pour faire du Mali un État digne de l'Afrique moderne ;
-
diriger et contrôler efficacement l'économie du pays par l'État qui y prendra une part de plus en plus active, notamment par la mise en place d'un Office national du commerce extérieur et l'intensification du secteur coopératif.
Le régime souhaite une modernisation de l'agriculture dans le sens d'un socialisme collectiviste. L'État tente de lutter contre les chefferies traditionnelles et de mettre en place des collectivités socialistes dans les campagnes, afin de promouvoir le « champ collectif », cultivé par l'ensemble des villageois. Ainsi, sont mis en place des groupements ruraux de producteurs et de secours mutuels (GRPSM) au niveau des villages, regroupés à l'échelon des arrondissements au sein de groupements ruraux associés et au plan des cercles au sein des sociétés mutuelles de développement rural (SMDR). Les paysans sont incités à adhérer à l'US-RDA et à participer aux « contributions volontaires » et aux « investissements humains », travaux non rémunérés tel que construction de routes ou de dispensaires.
Le champ collectif (maliforo en bambara) est obligatoire dans chaque village. Le bénéfice de la vente de ses produits est utilisé pour l'entretien des structures coopératives et les investissements intra-villageois. Les paysans s’investissent peu dans ces champs collectifs dont la production est inférieure de 30 % en moyenne par rapport aux champs familiaux.
Les paysans sont forcés de vendre leur production de céréales à des prix très bas fixés par l'État. L’objectif est d'assurer un approvisionnement des villes, sûr et à faible coût. Mais les paysans préfèrent vendre leur production aux commerçants privés plutôt qu'à l’Office des produits alimentaires maliens (OPAM), organisme étatique qui bénéficie pourtant du monopole.
En octobre 1960, la Société malienne d’importation et d’exportation (Somiex) est créée et se voit attribuer le monopole des exportations des productions locales et de l’importation des produits manufacturés et de biens alimentaires comme le sucre, le thé et le lait en poudre, et leur distribution à l’intérieur du pays. Ce qui mécontente les commerçants dont beaucoup ont soutenu l’US-RDA avant l’indépendance.
an 1960-1966 : Nigéria - Indépendance et présidence de Nnamdi Azikiwe (1960-1966)
Le Nigeria proclame son indépendance le 1er octobre 1960. Le 7 octobre 1960 le pays est admis à l'ONU. Nnamdi Azikiwe, jusqu'alors gouverneur de l'Est, l'une des trois provinces nigérianes depuis la constitution Lyttleton de 1954, devient d'abord gouverneur général du Nigéria le 16 novembre 1960 puis président en 1963 lors de la proclamation de la République. À la suite d'un référendum en février 1961, une partie du Cameroun anglophone vient agrandir ce pays.
Le Nigeria dispose déjà, en 1960, d'atouts économiques significatifs. C'est par exemple le premier producteur mondial d'huile de palme, le plus gros exportateur d'arachides, le troisième producteur mondial de cacao (après le Ghana et le Brésil), et un important producteur de coton. L'exploitation des gisements de pétrole commence. La production minière également repose sur l'étain du plateau de Jos, et le charbon d'Enugu.
Par contre, dès l'indépendance, des tensions ethniques se font sentir dans le pays. Ces tensions concernent les principaux groupes ethniques que l'on retrouve dans les provinces autonomes établis en 1954 :
* Les Ibos, ethnie du pouvoir en place, installée majoritairement à l'Est et composée majoritairement de chrétiens et d'animistes.
* Les Peuls et Haoussas, ethnie peuplant le Nord du pays et composée majoritairement de musulmans. Le recensement de 1963 compte 55 millions d'habitants dont 30 millions de Peuls et d'Haoussas, ce qui donne la majorité absolue au Nord.
* Les Yorubas, ethnie peuplant l'Ouest du pays, composée à la fois de musulmans et de chrétiens.
Le royaume du Nigéria devient une République le 1er octobre 196313. L'ancien gouverneur général, devenu président de la République, Nnamdi Azikiwe, d'origine Ibo, nomme comme premier ministre Alhaji Abukabar Tafawa Balewa. La première constitution républicaine de 1963 laisse le pays dans le Commonwealth. Lors des élections de 1965, l'Alliance nationale nigériane (Nigerian National Alliance), parti conservateur Yoruba, allié à d'autres conservateurs Haoussas, l'emporte largement sur la Grande Alliance progressiste unie (United Progressive Grand Alliance ou UPGA), parti progressiste Ibo, allié à des progressistes Haoussas. Considérant que les votes sont frauduleux, des officiers Igbos à tendance gauchisante renversent alors le gouvernement et placent le général Johnson Aguiyi-Ironsi à la tête de l'État le 15 janvier 1966. Ironsi met fin le 24 mai 1966 au fédéralisme et renforce la domination de la capitale, mais les tensions s'attisent dans le pays. Une rébellion anti-Ibos éclate cinq jours plus tard dans le Nord, déclenchant un exode massif vers la province de l'Est. Selon Jean Guisnel, « les massacres provoquent plus de 30 000 morts jusqu'en octobre ».
an 1960 - 1962 : Réunion (Ile de la) - La Réunion est envisagée comme site d'essais nucléaires.
Les cyclones sont désormais baptisés par des noms féminins. 1962, le cyclone Jenny fait 37 morts et 150 blessés (28 février).
L'île compte 354 294 habitants.
an 1960 : Rwanda - En 1960, l'ancien gouvernement de Kigeli Ndahindurwa quitte le pays pour l'Ouganda, ainsi que plus de 200 000 Tutsi.
an 1960 : Sénégal - 1956 : Loi-cadre créant les huit états autonomes en A.O.F. (y compris le Sénégal). 4 avril 1960 : Le Sénégal accède à son indépendance au sein de la Fédération du Mali. 20 Août 1960 : Éclatement de la Fédération du Mali. 5 septembre 1960 : Léopold Sedar Senghor est élu premier président de la république Sénégalaise. Il entame son mandat pour 7 ans.
an 1960 : Somalie - Pendant que la Grande-Bretagne est en prise avec les troupes d’Hassan, la France ne fait guère usage de ses possessions en Somalie. L’Italie établit par contre une réelle colonie où de nombreux citoyens italiens s’établissent et investissent dans l’agriculture. Mussolini, arrivé au pouvoir, veut montrer au monde qu’il faut également compter avec l’Italie comme puissance économique capable de faire de l’ombre à la Grande-Bretagne. Cette dernière, freinée par ses nombreuses guerres avec les autochtones, n’ose guère investir dans des infrastructures coûteuses qui risqueraient à tout moment d’être détruites. Plus tard, lors de l’unification du pays dans les années 1960, le Nord accuse un retard considérable sur le plan du développement économique, et est rapidement dominé par le Sud. Les frustrations qui en résultent contribuent à déclencher la guerre civile.
Malgré la défaite infligée aux troupes d’Hassan, les Dulbahante n’acceptent aucune négociation, et toute la période d’occupation britannique est traversée par des violences sporadiques. La situation s’aggrave lorsque l’Italie envahit avec succès l’Éthiopie et entre le 5 mai 1936 dans Addis-Abeba, confisquant à la Grande-Bretagne son seul allié de la région contre les rebelles somalis. La Grande-Bretagne en est réduite à se débrouiller seule ou à chercher des terres moins hostiles. Pendant ce temps, l’économie de la Somalie italienne fleurit, et il devient de plus en plus évident que c’est l’Italie qui a gagné la corne de l'Afrique. Intimée par Mussolini de quitter la région, la Grande-Bretagne obtempère sans guère protester. La France abandonne également ses quelques possessions, laissant ainsi à l’Italie le contrôle de l’Éthiopie, de Djibouti, de la Somalie et du nord du Kenya.
an 1960-1969 : Somalie - Le début de l’indépendance de la Somalie est prometteur, avec une bonne participation politique des nomades et des femmes. Les disparités économiques entre le nord et le sud et le problème de l’Ogaden ne tardent cependant pas à surgir. La Somalie ne reconnait pas en effet la juridiction éthiopienne sur l’Ogaden, tandis que les aspirations pan-somalis provoquent la guerre des Shifta (1963-1967) dans la province sécessionniste du Kenya, au sud de la Somalie.
Au début des années 1960, des troubles éclatent lorsque le nord conteste des référendums qui ont recueilli la majorité des votes, au motif que le sud était favorisé. En 1961, des organisations paramilitaires du nord se révoltent lorsqu’elles se voient imposer des chefs originaires du sud. Le deuxième plus grand parti politique du nord revendique ouvertement la sécession. Une tentative de mettre fin à ces divisions en créant un parti pan-somalien reste infructueuse.
On tente également de créer un sentiment nationaliste autour de la cause de l’Ogaden et des régions du nord du Kenya, où vivent en majorité des ethnies somalies. Des milices somaliennes lancent des attaques près des frontières éthiopienne et kényane entre 1960 et 1964, date à laquelle le conflit entre la Somalie et l’Éthiopie éclate ouvertement. Il dure quelques mois et les deux parties conviennent d’un cessez-le-feu la même année. L’empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, et le Premier ministre kényan, Jomo Kenyatta, concluent ensuite un traité de défense mutuel (1964) pour se protéger d’agressions futures de la part de la Somalie.
Au milieu des années 1960, la Somalie développe des relations militaires étroites avec l’Union Soviétique, qui fournit du matériel et entraîne les forces armées somaliennes. La Chine finance de nombreux projets industriels non militaires. Les relations entre la Somalie et l’Italie restent cordiales mais se dégradent avec les États-Unis qui ont soutenu l’Éthiopie contre la Somalie.
La démocratie vacille à la fin des années 1960. Le vainqueur des élections de 1967 n'est pas reconnu en raison de la structure complexe des alliances claniques. Les sénateurs procèdent à un nouveau vote. Le résultat de l’élection est déterminant pour savoir si la Somalie va user de la force pour réaliser le rêve de l’unité pan-somalienne, ce qui signifie déclarer la guerre à l’Éthiopie, au Kenya et éventuellement à Djibouti. En 1968, un traité avec l’Éthiopie portant sur le commerce et les télécommunications est l’occasion d’un bref répit qui profita aux deux pays, en particulier aux habitants de la zone frontalière qui vivaient dans l’instabilité depuis le cessez-le-feu de 1964.
1969 est une année tumultueuse, avec de nombreuses défections, collusions et trahisons. La LJS et ses alliés passent d’un quasi-monopole à l’Assemblée (120 sièges sur 123) à 46 sièges. La Ligue ne reconnaît pas le résultat des élections, les qualifiant de frauduleuses.
an 1960-1963 : Togo - Intépendance
Le Togo devient indépendant, le 27 avril 1960, et obtient un siège à l'ONU en septembre de la même année. Sylvanus Olympio est élu président aux dépens de Nicolas Grunitzky, candidat soutenu par la France, lors d'élections supervisées par l'ONU.
Sylvanus Olympio dirige la rédaction de la Constitution de la République du Togo, qui devient un régime présidentiel, à la tête duquel Olympio engage une politique autoritaire et met fin au multipartisme en 1961 au profit d'un parti unique. Il modifie également la constitution le jour même de son élection pour s'octroyer des pouvoirs élargis, faisant ainsi passer le pays d'un régime parlementaire à un régime semi-présidentiel.
Sylvanus Olympio est le premier président togolais. Il instaure rapidement une dictature avec un parti unique, ce qui lui permet de remporter la totalité des sièges lors des élections législatives de 1961. Sous l’instigation du commandant français Georges Maitrier, chef de la gendarmerie nationale et conseiller du président dont le contrat de coopération arrive à terme, 626 vétérans togolais de l’armée française, dont une grande partie a combattu en Indochine et en Algérie, demandent à être intégrés dans les forces de sécurité togolaises qui comptent 300 membres. Sylvanus Olympio refuse. Ils le destituent dans un coup d’État, le 13 janvier 1963, dans lequel Olympio trouve la mort. Ce coup d'État est revendiqué par Gnassingbé Eyadema, le père de l'actuel président. Par ailleurs, avant son assassinat, Sylvanus Olympio avait un important projet, celui de retirer le Togo du franc CFA.
En 1963, l'Afrique des indépendances connaît son premier coup d'État. Sylvanus Olympio refuse la réintégration dans l'armée togolaise des soldats qui avaient combattu au sein de l'armée française pendant la Guerre d'Algérie. Ces soldats, majoritairement issus des Kabyê du Nord du Togo, décident avec le soutien d'éminents « coopérants » français d'organiser un coup d'État dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, une poignée de militaires dont fait partie Gnassingbé Eyadema assassinent Sylvanus Olympio.
Rapidement, un comité militaire insurrectionnel fait appel à Nicolas Grunitzky, qui est élu président en 1963, tout en adoptant une nouvelle Constitution. Il signe des « accords de coopération » avec la France, permettant à celle-ci d'user à sa convenance des ressources stratégiques.
Cependant, les difficultés persistent. Nicolas Grunitzky, favorable à une administration sous assistance française, fait de plus en plus face à d'autres figures politiques togolaises plus nationalistes, au rang desquelles Antoine Meatchi, son vice-président majoritairement soutenu par les chefs et les populations septentrionales. La bataille pour la préséance entre les deux figures atteint son paroxysme, à tel point que, le 13 janvier 1967, les militaires prennent à nouveau le pouvoir. La Constitution est suspendue et l'Assemblée nationale dissoute. Le lieutenant-colonel Étienne Gnassingbé Eyadema, appartenant à l'ethnie des Kabyê, prend le pouvoir, et met en place un nouveau gouvernement où les personnalités issues du Nord du pays sont majoritaires. Un colonel, Kléber Dadjo, ancien chef du cabinet militaire du président Grunitzky, est placé à la tête d'un Comité togolais de réconciliation nationale composé de civils.
an 1962 : Algérie - Guerre d'Algérie, le 19 mars 1962, après la signature du cessez-le-feu, le conflit prend officiellement fin. Un double référendum est organisé le 8 janvier 1961 et le 8 avril 1962 : les Français de métropole se prononcent pour le choix du général de Gaulle pour les deux. Le 1er juillet 1962, les Algériens votent massivement pour l'indépendance (99,72 % en faveur du « oui »). L'indépendance de l'Algérie est proclamée le 3 juillet 1962
Les évènements de la guerre d'Algérie, la déclaration d'indépendance - qui consomme la décolonisation -, le climat de violence générale qui régnait dans les derniers mois de la guerre ou encore des évènements traumatisants comme le massacre d'Oran amèneront la plupart des pieds-noirs à quitter le pays : sur près d'un million, cent cinquante mille partent avant 1962, six cent cinquante et un mille au cours de cette année. L'histoire des deux-cent mille pieds noirs encore présents après 1962 reste à écrire, selon l'historien Benjamin Stora. L'Organisation de l'armée secrète se prononce contre l'indépendance de l'Algérie et commet, à la fin de la guerre, plusieurs attentats meurtriers en Algérie dont 7 000 au plastic contre les biens et 2 000 contre les individus.
Suivant le procédé comparatif de pyramides des âges, les historiens estiment entre 350 000 et 400 000 — soit 3 % de la population — le nombre d'Algériens morts durant le conflit. Depuis 1962, le FLN estime de son côté qu'il y a eu 1 million et demi de morts - chiffre qu'aucun historien ne cautionne - et 3 millions d'Algériens déplacés dans des camps de regroupement. En outre, la torture pendant la guerre d'Algérie a été pratiquée par l'armée française et par la police française dans des proportions qui concerneraient des centaines de milliers d'Algériens. Du côté des civils « européens », le nombre de morts s'élève à environ 4 500 personnes.
Au bilan humain, on peut ajouter les 8 000 villages incendiés, quatre millions de têtes de bétail anéantis entre 1954 et 1962 - sur un cheptel de six millions en 1954 - et des dizaines de milliers d’hectares de forêts incendiés avec le napalm.
L'indépendance, proclamée le 5 juillet 1962 laisse le pays dans une situation difficile due à la guerre, aux affrontements internes et au départ massif des Européens, qui formaient l'essentiel de l'encadrement en place durant la période coloniale. Les rapports de la nouvelle république sont difficiles avec la France, mais aussi avec le Maroc voisin : le conflit de la guerre des Sables éclate en 1963, suivie par une crise durable sur la question du Sahara occidental à partir des années 1970.
Malgré l'apaisement qui suit la signature du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, l'armée française évacue ses dernières bases en Algérie, enclaves autorisées par les accords d'Évian : Reggane et Colomb-Bechar (1967), Mers el-Kébir (1968), Bousfer (1970) et B2-Namous (1978).
Le Gouvernement provisoire de la République algérienne, émanation politique du FLN, est contesté et évincé par l'Armée de libération nationale (ALN), sa branche militaire, qui place Ahmed Ben Bella à la tête du nouvel État le 27 septembre. Ce dernier fait du Front de libération nationale (FLN) le parti unique et mène une politique socialisante et populiste inspirée du modèle nassérien. Le très faible taux de scolarisation (environ 10 %) sous la période coloniale rend le pays démuni de cadres techniques et administratifs. Il ne compte aucun architecte, seulement quelques dizaines d'ingénieurs et de médecins, et moins de 2 000 instituteurs.
an 1962 : Burundi - L'indépendance du pays est proclamée le 1er juillet 1962, date alors choisie pour célébrer la fête nationale, et le roi Mwambutsa IV établit un régime de monarchie constitutionnelle qui sera aboli en 1966.
« La tribu des Tutsis, qui compte pour 10 à 15 % de la population, y domine et y dépouille de ses droits celle des Hutus, lesquels sont cinq à six fois plus nombreux. Le pouvoir politique central reste un monopole tutsi.
an 1962-1963 : Congo Kimshasa - En 1962, le gouvernement central s'attèle à reconquérir les provinces sécessionnistes. Une fois Lumumba éliminé, la reprise du Katanga (renommé en 1971 Province du Shaba) et du Sud-Kasaï marqueront le début de l'ascension du général Mobutu Sese Seko. Les troupes de l'ONU, au départ immobiles, passeront soudainement à l'offensive avec les troupes de Mobutu pour reconquérir les deux provinces rebelles. En janvier 1963 prend fin la sécession katangaise.
an 1962 : Érythrée - En 1962, une pression sur l'Assemblée érythréenne lui fait abolir la fédération et accepter l'annexion par l'Éthiopie. C'est le début de la guerre d'indépendance de l'Érythrée.
an 1962 : Mali - Le 1er juillet 1962, le gouvernement créé le Franc malien qui remplace le franc CFA. Le franc malien n’est pas convertible et la détention de l’ancienne devise est interdite. Cette décision aggrave les dissensions avec les commerçants. L’un d’eux est emprisonné pour détention de francs CFA. Le 20 juillet 1962, une manifestation de commerçant est violemment réprimée, faisant plusieurs morts. Fily Dabo Sissoko, Hamadoun Dicko, ancien responsable du Parti progressiste soudanais sont arrêtés avec Kassim Touré, chef de file des commerçants de Bamako. Ils sont jugés pour complot contre l’État par un tribunal populaire du 24 au 27 septembre 1962 qui les condamne à la peine de mort, peine commuée en condamnation à perpétuité. Ils mourront au bagne de Kidal dans le Nord du Mali.
Le franc malien ne parvient pas à se maintenir face aux francs Cfa. Un marché noir s’instaure par des commerçants vendant aux pays voisins du bétail ou des céréales et achetant des marchandises importées pour être revendues au Mali sans paiement des taxes et droits de douanes. Ce marché noir entraîne un manque à gagner pour le budget de l’État, déficitaire de 1960 à 1968.
la régie des transports du Mali est créée en vue d’assurer l’acheminement des marchandises exportées (arachides et cotons) ou importées vers et depuis le Port d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Cet acheminement par camion a été mis en place à la suite de la fermeture de la ligne de chemin de fer entre Bamako et Dakar.
La compagnie Air Mali, nouvellement créée, est entièrement équipée d’appareils Iliouchine importés d’Union soviétique. Les pays satellites de l’URSS entretiennent d’excellentes relations diplomatiques avec le Mali dans les premières années de l'indépendance. La Tchécoslovaquie figure au deuxième rang, derrière l’URSS, pour la coopération avec le régime. Les accords de coopération signés en 1961 mettent en place une assistance technique tchécoslovaque. Plusieurs centaines de techniciens sont envoyés pour la formation de spécialistes en matière d’aviation civile, et soutiennent le développement de la société aérienne nationale en fournissant des pièces de rechange. Néanmoins, les tensions croissantes entre les deux pays conduisent au désengagement progressif de la Tchécoslovaquie dès le milieu des années soixante.
En 1962 a lieu le 6e et dernier congrès de l’US-RDA qui institue six commissaires politiques chargés du contrôle du parti et de l’administration. Le mouvement de la jeunesse soudanaise, créée en 1959, est intégré au sein de l’US-RDA. Une milice populaire est mise en place ainsi qu’un service civique obligatoire et des brigades de vigilances. Ces mesures vont accroître l’impopularité du régime de Modibo Keïta.
En 1962, une première rébellion touarègue, limitée à la région de Kidal éclate pour refuser l'autorité du président Modibo Keïta. Les autorités maliennes répriment férocement et place la région du nord sous surveillance militaire.
an 1962-1964 : Mozambique - La guerre d'indépendance (1964-1974)
Le 25 juin 1962, au Tanganyika, plusieurs groupes anticoloniaux fondent le Front de libération du Mozambique (FRELIMO), un mouvement qui prône le rejet global du système colonial-capitaliste dans un contexte de lutte des classes et de lutte révolutionnaire. Le FRELIMO opte pour placer l'insurrection armée au centre de la lutte politique, afin de mobiliser les populations rurales, amenées à constituer la base sociale et politique du mouvement. Il engage ses premières actions de guérilla à partir de septembre 1964. Le COREMO, soutenu par le président zambien Kenneth Kaunda mais aussi allié à l'UNITA angolais et au Congrès panafricain d'Azanie, n'arrive pas à s'imposer face au FRELIMO dans le domaine de la lutte armée contre l'administration portugaise.
an 1962 : Ouganda - Le 9 octobre 1962, lors de son indépendance, l'Ouganda voit se poser, de manière aiguë, le problème des structures politiques. La solution retenue, exprimée dans la première constitution, est de type fédéral - elle associe les quatre anciens royaumes - mais le Buganda maintient sa prépondérance jusque dans le nom du nouvel État, l'Ouganda, pays des Bagandas. Le roi Mutesa II en devient le président à vie. Cependant, Milton Obote, fondateur, en 1960, du Congrès du peuple ougandais, (UPC), l'Uganda People's Congress, devient Premier ministre. L'UPC, à l'image de son dirigeant, est le parti des populations nilotiques du Nord, opposées à la domination économique et politique du Bouganda et, donc, favorable à la centralisation. Dès lors, les tensions entre le Nord nilotique et le Sud bantou s'exacerbent.
an 1962 : Rwanda - Le Conseil de tutelle des Nations unies insiste pour que la Belgique accorde l'indépendance au Rwanda. C'est chose faite le 1er juillet 1962.
an 1962 : Sénégal - 18 décembre 1962 : Accusé d’avoir porté atteinte aux droits du Parlement, le Premier Ministre, Mamadou Dia est arrêté ; le président de la République, Léopold Sedar Senghor exerce alors l’ensemble du pouvoir exécutif.
an 1963 : Afrique du Sud - En juillet 1963, plusieurs des principaux chefs de l'ANC interdite, dont Nelson Mandela et Walter Sisulu, sont arrêtés à Rivonia et inculpés de haute trahison et de complots envers l'État. Nelson Mandela, l'un des chefs de Umkhonto we Sizwe est condamné à perpétuité pour terrorisme et les autres chefs de l'ANC sont emprisonnés ou exilés.
an 1963 : Bénin (anc. Dahomey) - Depuis l'indépendance, le Bénin a connu une histoire politique mouvementée. Les douze premières années furent marquées par une instabilité chronique, les anciennes élites coloniales, pour la plupart originaires du Sud, se disputèrent le pouvoir.
En 1963, le nord du pays veut sa revanche, tandis que les élites et la nouvelle bourgeoisie semblent peu préoccupées par les nombreux défis du sous-développement. C'est à cette période qu'un certain colonel Christophe Soglo (l'oncle de Nicéphore Soglo) arrive sur la scène politique du pays, en forçant Hubert Maga, premier président de la république du Dahomey indépendant, à démissionner.
En six ans, on enregistra quatre coups d'État et régimes militaires, venant abréger d'éphémères périodes civiles qui voient se succéder Sourou Migan Apithy, Justin Ahomadegbé et Émile Derlin Zinsou au pouvoir.
an 1963-1968 : Congo Brazzaville - Les 13, 14 et 15 août 1963, l'abbé Fulbert Youlou, premier président de la république congolaise, est contraint à la démission sous la pression des syndicalistes et de l'armée.
De 1963 à 1968, Alphonse Massamba-Débat remplace l'abbé Youlou à la tête de l'État ; celui-ci, avec son équipe gouvernementale formée en grande partie dans les écoles occidentales, se rapproche de la Chine communiste en matière de politique internationale, et se prononce en faveur du socialisme. Le président utilise l'expression de « socialisme bantou », instaure un parti unique, et abandonne le pluralisme politique. Pascal Lissouba puis Ambroise Noumazalaye sont Premiers ministres. Beaucoup des cadres politiques de l'époque sont fascinés par le socialisme scientifique ; mots d'ordre et articles de presse s'inspirent du style alors en usage en URSS, en Chine et dans les démocraties populaires. En témoigne ce mot d'ordre publié en une de l'hebdomadaire Etumba en juin-juillet 1968 :
* « Que ceux qui se sont infiltrés dans les rangs des comités révolutionnaires pour se servir et non pour servir le peuple tremblent. Car le châtiment de ce même peuple les attend au tournant.
* Que ceux qui ont été portés aux comités révolutionnaires par la confiance des militants continuent comme par le passé à travailler sans relâche pour la cause de tous avec abnégation et désintéressement et le peuple lui-même saura reconnaître leurs mérites."
La politique économique privilégie les sociétés d'État en matières d'équipement (logement, etc.) et les sociétés mixtes. Le secteur privé reste toujours très puissant par le biais des sociétés étrangères, notamment la CPC (Compagnie des Potasses du Congo), ELF-Congo dans le secteur du pétrole, et plusieurs sociétés d'exploitation du bois, qui représente la première ressource budgétaire.
En 1964, des Brazzavillois expulsés de Kinshasa par le gouvernement de Moïse Tshombe reviennent au Congo. À cette date, la voisine « république du Congo » (à Kinshasa) devient la première « république démocratique du Congo » par décision présidentielle (dans une quête de légitimité et « d’authenticité »), et la « République congolaise » (ex-Congo français au nord-ouest du fleuve Congo) gardera pour elle le nom de « république du Congo » ce qui ajoutera à la confusion entre les deux pays, et entérinera pour longtemps la désignation informelle de « Congo-Brazzaville ».
Le 2 août 1968, à la suite du soulèvement de certains éléments de l'armée, Massamba-Débat est contraint de se retirer à Boko (région du Pool), son village natal, puis de donner sa démission le 4 septembre 1968. L'élément déclencheur du putsch a été l'arrestation du capitaine Marien Ngouabi, officier de l'armée congolaise connu pour ses convictions socialistes. Libéré le 31 juillet par un groupe de parachutistes, celui-ci crée le 2 août le CNR (Conseil national de la Révolution), dont il prend la tête. Le capitaine Alfred Raoul, proche de ce dernier, fait fonction de chef de l'État jusqu'à ce que le CNR s'autoproclame « organe suprême de l'État » le 31 décembre 1968. À partir de cette date, Marien Ngouabi, qui s'est entretemps promu au grade de commandant, est chef de l'État congolais.
an 1963-1968 : Eswatini (Swaziland) - Le protectorat du Swaziland (1881-1968) - À partir de 1963, un mouvement anti-colonial commença à se développer mené par le prince Dumisa Dlamini et par le Ngwane National Liberatory Congress (NNLC). Opposé au parlementarisme, Sobhuza II, conseillé par un avocat sud-africain, accepta de rechercher et d'obtenir l'appui d'une formation politique. Il fonda l'« Imbokodvo National Movement » (INM) qui remporta 85 % des suffrages lors des élections de 1964 face à quatre partis adverses. Une dizaine de milliers de colons blancs se rallièrent au roi en 1967, rassurés par son conservatisme politique, social et économique. L'INM obtint ainsi aux élections la totalité des sièges de député contre les pan-africanistes du NNLC.
an 1963 : Guinée-Bissau - En 1963, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) déclenche la guerre d'indépendance.
an 1963 : Kenya - Bien que les Britanniques souhaitaient transmettre le pouvoir à un groupe modéré, ce fut le Kenya African National Union (KANU) de Jomo Kenyatta, membre de la tribu des Kikuyus et ancien prisonnier sous la loi martiale, qui forma le premier gouvernement peu après l'indépendance du pays le 12 décembre 1963. D'abord monarchie constitutionnelle, le Kenya devient un an plus tard une république, Kenyatta devenait le premier Président de la République.
Le régime met aussitôt fins aux espoirs des indépendantistes radicaux de redistribution des terres : les terres sont rachetés aux colons qui veulent partir et revendus aux Kényans qui en ont les moyens, les capitaux britanniques sont épargnés et les investissements étrangers encouragés. Le choix d'une économie de marché renforce une classe de capitalistes locaux au détriment des anciens rebelles, au sujet desquels Kenyatta déclare : « nous ne laisseront pas des gangsters diriger le Kenya, les Mau Mau étaient une maladie qui a été éradiquée et qu'il nous faut oublier à jamais ». Témoin de cette orientation, le journal conservateur britannique The Economist lui consacre en 1965 un article élogieux intitulé « Notre homme au Kenya ». La majorité des Britanniques quittent le Kenya et sont indemnisés par leur propre gouvernement et le gouvernement kényan. 120 000 des 176 000 Indiens quittent aussi le pays et, grâce à leur ancien passeport britannique, émigrent, pour la plupart, vers le Royaume-Uni. Dès décembre 1963, le Royaume-Uni fait signer au Kenya des accords militaires leurs reconnaissant le droit d'utiliser le Kenya comme base militaire pour d'éventuelles opérations dans la région.
an 1963 : Mali - En octobre 1963, Le Mali joue le rôle de médiateur dans le conflit qui oppose le Maroc et l'Algérie, dénommé la « Petite guerre des sables ». Le Mali joue un rôle actif au sein de l'Organisation de l'unité africaine.
an 1963 : Maroc - guerre des Sables
La guerre des sables d'octobre 1963 est un conflit militaire opposant le Maroc et l’Algérie peu après l’indépendance de celle-ci. Après plusieurs mois d'incidents frontaliers, la guerre ouverte éclate dans la région algérienne de Tindouf et Hassi-Beïda, puis s'étend à Figuig au Maroc. Les combats cessent le 5 novembre, et l'Organisation de l'unité africaine obtient un cessez-le-feu définitif le 20 février 1964, laissant la frontière inchangée.
an 1963 : Namibie - En 1963, le gouvernement sud-africain de Hendrik Verwoerd met en place une commission d'enquête sur le Sud-Ouest africain dont la présidence est confiée à F. H. Odendaal, l'administrateur du Transvaal. Son rapport connu sous le nom de rapport Odendaal préconise la division du territoire en trois parties dont la première serait réservée à dix homeland (foyers nationaux ou réserves indigènes), la seconde aux Blancs, destinée à intégrer l'Afrique du Sud et une troisième comprenant les parcs naturels (Etosha, Côte des squelettes, désert du Namib) et les zones interdites (dont le Sperrgebiet — une zone diamantifère). Dans le schéma de l'apartheid appliqué au Sud-Ouest africain, les homelands sont ainsi répartis sur 39 % du territoire. Le rapport Odendaal fut rejeté par l'Assemblée générale des Nations unies.
an 1963 : Réunion (Ile de la) - le 6 mai, Michel Debré est élu pour la première fois à La Réunion aux élections législatives.
Michel Debré crée le Bumidom : Le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, ou Bumidom, fut un organisme public français chargé d'accompagner l'émigration des habitants des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine. Fondé en 1963, il disparaît en 1981 pour céder la place à l'Agence nationale pour l’insertion et la protection des travailleurs d’outre-mer (ANT), renommée Agence de l'outre-mer pour la mobilité ou LADOM depuis 1992.
« Enfants de la Creuse » : des centaines d'enfants « orphelins » sont déplacés pour repeupler la Creuse et contenir le risque démographique à La Réunion.
an 1963-1967 : Rwanda - En décembre 1963, les Tutsis exilés essayent de revenir sur le territoire rwandais par la force : ils échouent. Lors des tentatives de retour par la force des Tutsi exilés, des massacres sont commis contre des Tutsi vivant au Rwanda. Jusqu'en 1967, environ 20 000 Tutsis sont tués et 300 000 autres prennent le chemin de l'exil.
an 1963 : Sénégal - 3 mars 1963 : Approbation par référendum de la nouvelle constitution. Institution d’un régime présidentiel.
an 1963-1967 : Togo - L'ancien Premier ministre Nicolas Grunitzky devient président du Togo à la suite de ce coup d’État. Il est favorable à un rapprochement avec la France et signe des « accords de coopération » avec celle-ci, permettant à l'ancienne puissance coloniale d'user à sa convenance des ressources stratégiques. Quatre ans plus tard en 1967, il est destitué par un nouveau coup d’État où l'on retrouve Étienne Gnassingbé Eyadema. En exil, il meurt le 27 septembre 1969 à Paris dans un accident de voiture.
an 1964 : Afrique du Sud - En 1964, les principaux chefs de l'ANC sont condamnés à la prison à vie. L'ANC et Umkhonto we Sizwe, décapités, sont alors totalement désorganisés et installent leurs quartiers généraux à l'étranger. En raison de sa politique d'apartheid, l'Afrique du Sud est exclue des jeux olympiques d'été de 1964, qui se déroulent à Tokyo au Japon.
Verwoerd intensifie l'application de sa politique de séparation forcée en procédant à de nombreuses expulsions de populations noires vers les zones qui leur sont attribuées afin que de bonnes terres soient développées ou habitées par les Blancs. Un système de contrat oblige les salariés noirs de l'industrie à vivre dans des résidences dortoirs au sein des townships loin de leurs familles demeurées en zone rurale. Les conséquences pour ces populations sont souvent catastrophiques au niveau social tandis que la population carcérale atteint cent mille personnes, un des taux les plus élevés au monde.
Entre 1960 et 1980, ce sont plus de trois millions et demi de paysans noirs qui sont dépossédés de leurs terres sans aucun dédommagement pour devenir un réservoir de main-d'œuvre bon marché et qui ne sont plus des concurrents pour les fermiers blancs.
an 1964 : Pays des Tswanas - République de Botswana - En juin 1964, le Royaume-Uni accepte les propositions de création d'un gouvernement autonome élu démocratiquement au Botswana. En 1965, le siège du gouvernement est transféré depuis Mafikeng en Afrique du Sud, vers Gaborone nouvellement créée. La constitution de 1965 mène aux premières élections générales et à l'indépendance, le 30 septembre 1966. Seretse Khama, un chef de file du mouvement pour l'indépendance, est élu premier président de la République du Botswana. Réélu à deux reprises, il meurt en fonction en 1980.
an 1964 : Cameroun - En avril 1964, Marguerite Mbida, épouse de André-Marie Mbida, se présente comme tête de liste du PDC aux élections législatives d’avril 1964. Le PDC est le seul parti politique à se présenter à ces élections. Les responsables politiques camerounais de cette époque sont tous soit en exil soit en prison. Les électeurs du PDC descendent dans la rue pour protester contre les fraudes. Le gouvernement fait alors intervenir la gendarmerie dans les villages, et les protestataires sont massivement déportés vers les camps de concentration de Mantoum, Tcholliré et Mokolo.
L’État camerounais de l'autorite harold poursuit la lutte contre l'UPC et sa branche armée, l'Armée de libération nationale du Kamerun (ALNK). Il passe des accords de défense avec la France : « des personnels français sont chargés de procéder à l'organisation, à l'encadrement et à l'instruction des forces armées camerounaises ». De violentes émeutes ensanglantèrent le pays Bamiléké et la région Bassa.
an 1964-1968 : Archipel des Comores - Entre 1964 et 1968, Cheick doit gérer l'expulsion des Comoriens de Tanzanie, et plus précisément de Zanzibar après la Révolution menée par l'ASP21. Beaucoup de ces expulsés appartiennent au Mouvement de libération nationale des Comores. Au cours de cette période naissent les premiers mouvements politiques qui contestent le pouvoir de Saïd Mohamed Cheikh et pour certains, réclament l'indépendance et à l'opposé, comme le Mouvement populaire mahorais réclament au départ plus d'autonomie vis-à-vis des autres îles.
an 1964 : Congo Kimshasa - le titre « république démocratique du Congo », un nouveau drapeau et une nouvelle devise sont adoptés le 1er août 1964 lors de la proclamation de la nouvelle constitution, dite constitution de Luluabourg, adoptée par référendum le 10 juillet précédent
an 1964-1965 : Gabon - En 1964, Mba essaie de frauder les élections pour se maintenir au pouvoir. Le 18 février 1964, il est renversé par l’armée gabonaise qui confie le pouvoir à son opposant Jean-Hilaire Aubame. Le 19 août 1964, l'armée française intervient pour remettre Mba au pouvoir. En 1967, alors que Léon Mba est atteint d'un cancer, Albert Bernard Bongo, directeur de cabinet de Mba, est choisi par Jacques Foccart, secrétaire général à la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches, avec l'accord du général de Gaulle qui l'a rencontré en 1965, pour lui succéder. À cette fin, le SDECE demande à Mba, alors agonisant, d'enregistrer un message radio désignant Bongo comme vice-président , avant de décéder le 28 novembre.
an 1964 : Gambie - En 1964, une nouvelle conférence constitutionnelle a lieu à Londres pour fixer les modalités de l’indépendance.
an 1964 : Kenya - Sur le plan politique, Kenyatta instaure un régime à parti unique fondé sur la doctrine Haraambee (« Agir ensemble » en swahili). Le président pratique une politique autoritaire et clientéliste pour assurer l'unité nationale. Pourtant, selon l'historien britannique John Lonsdale, Kenyatta perpétue l'héritage colonial qui « institue un État et non une nation ». Son pouvoir repose sur « un féodalisme ethnique [...] avec son contrat inégal de vassalité garanti par un discours normatif de l'ethnicité morale »
En 1964 le parti minoritaire, le Kenya African Democratic Union (KADU), coalition de petites tribus craignant la domination des plus grandes, s'auto-dissout et rejoint le KANU.
an 1964-1990 : Malawi - Indépendance
La Fédération de Rhodésie et du Nyassaland est dissoute le 31 décembre 1963. Des trois territoires qui la composaient, la Rhodésie du Nord devient indépendante sous le nom de Zambie en 1964, et un deuxième territoire, le Nyassaland, accède à l'indépendance sous le nom de Malawi le 6 juillet 1964. Le Malawi devient membre entièrement indépendant du Commonwealth.
Deux ans plus tard, une nouvelle constitution définit le pays comme une république à parti unique, avec Hastings Kamuzu Banda comme président malgré les divergences apparues en septembre 1964 entre ce président, et quelques-uns de ses ministres. Ces divergences conduisent notamment au départ en exil de Orton et Vera Chirwa. le caractère autocrate de Banda apparaît dès cette époque. À la suite de la visite de sa délégation commerciale reçue avec toutes les honneurs à Pretoria par le premier ministre sud-africain John Vorster en mars 1967, le Malawi établit des relations diplomatiques et économiques au niveau le plus élevé avec l'Afrique du Sud. Il est le seul pays africain à ouvrir une ambassade à Pretoria. Bien que condamnant la politique d'apartheid, le Malawi s'aligne sur la politique régionale de Pretoria, refusant d'accueillir les membres des organisations nationalistes noires interdites en Afrique du Sud et en Rhodésie tout en tolérant l'établissement sur son territoire de camps d'entrainement de la Résistance nationale du Mozambique, une organisation hostile au régime marxiste du Mozambique après 1975 et soutenue financièrement par les deux derniers régimes blancs d'Afrique australe. En 1970, c'est également au Malawi que John Vorster effectue sa première visite officielle dans un pays africain. Banda est proclamé président à vie du PCM en 1970, puis du Malawi en 1971. L’aile paramilitaire du PCM, les Jeunes pionniers, contribue à maintenir le pays sous un régime autoritaire jusque dans les années 1990. Le président Banda développe un culte de la personnalité et son régime persécute un certain nombre de minorités religieuses (Témoins de Jéhovah) ou ethniques (confinement des habitants d’origine indienne dans des ghettos). Le transfert de fonds privés à l’étranger ou l’importation de devises étrangères sont interdits, ce qui force les candidats à l’émigration à abandonner leurs biens derrière eux. Tous les médias (presse, livres, films) sont soumis à la censure et le courrier privé (surtout le courrier provenant de l’étranger) ainsi que les conversations téléphoniques sont systématiquement interceptés.
an 1964 : Mali - En avril 1964, les 80 candidats de la liste unique présentée par l’US-RDA sont élus aux élections législatives.
Face aux difficultés économiques que connaît le Mali, auxquelles s’ajoute la rébellion touarègue au nord, le parti unique US-RDA est en proie aux divisions entre une aile modérée et une aile radicale.
an 1964 : Namibie - En 1964, le conseil tribal héréro se retire de la SWANU pour former l'Organisation démocratique d'unité nationale, présidée par Clemens Kapuuo, alors que la SWAPO est incluse dans la liste des mouvements de libération bénéficiaires de l'aide soviétique. La même année, la SWAPO s'ouvre aux Capriviens d'origine mafwe en fusionnant avec la petite Union nationale de Caprivi. En 1965, Nujoma obtient que la SWANU soit radiée des listes du comité de libération de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), permettant à la SWAPO de devenir le seul représentant officiel (au niveau international) du Sud-Ouest africain.
an 1964 : Réunion (Ile de la) - construction du barrage hydroélectrique de Takamaka.
an 1964 : Soudan - En octobre 1964 éclate une insurrection populaire (« révolution d'Octobre ») qui aboutit à la chute du régime militaire et dictatorial d'Abboud et à l'instauration d’un régime parlementaire.
an 1964 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - L’indépendance et la création de la Tanzanie
En 1953, Julius Nyerere, brillant et ambitieux enseignant né en 1922, passé par Édimbourg pour terminer ses études, prend à 31 ans la tête de la TAA, qu’il transforme rapidement en un véritable parti politique – le Tanganyika African National Union (TANU) – qui prône l’indépendance. Celle-ci est accordée par la Grande-Bretagne le 9 décembre 1961, sans aucune violence.
En 1961, la population était de 6 millions de Noirs, 213 000 Asiatiques principalement originaires du sous-continent indien et 66 000 Européens principalement britanniques.
Le budget est déficitaire malgré l'aide du Royaume-Uni et de la banque internationale pour la reconstruction et le développement. L'économie est celle d'un pays du tiers monde et le tourisme avec ses 5 500 000 de livres sterling apporte une part importante des recettes du pays. Celui-ci dispose à cette date de 43 aérodromes.
Julius Nyerere est un court temps premier ministre, puis à la suite des élections de décembre 1962, devient le premier président de la République du Tanganyika.
L’indépendance de Zanzibar et Pemba est obtenue le 10 décembre 1963. Le nouvel État commence par être contrôlé par les partis initiés par les Britanniques (une coalition du ZNP et de petits partis de Pemba). Mais, à peine un mois le plus tard, en janvier 1964, les tensions communautaires qui couvent depuis des années se libèrent, et le parti ASP, étant écarté depuis longtemps du pouvoir alors qu’il est majoritaire dans les urnes, déclenche une révolution. Celle-ci fait de nombreuses victimes dans les rangs des communautés arabes et indiennes. On estime à environ 10 000 le nombre de personnes qui furent massacrées dans la nuit du 11 au 12 janvier à Zanzibar. À la suite de ce renversement, Karume, leader de l’ASP, devient président de la République de Zanzibar.
Le 26 avril 1964, Le Tanganyika et Zanzibar fusionnent pour former la République Unie de Tanzanie. Nyerere devient le président de l’État nouvellement créé, tandis que Karume, restant président de Zanzibar, devient le vice-président de la Tanzanie. Dans les faits, même si l’union est bien célébrée avec le reste du pays, Zanzibar a conservé jusqu'à aujourd’hui une large autonomie. En pratique, c’est le gouvernement central tanzanien qui s’occupe des domaines « nationaux » de la politique à Zanzibar : Défense, Intérieur, affaires étrangères, tandis que le gouvernement local zanzibarite traite des sujets comme l’éducation, l’économie, etc.
an 1964 - 1985 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Le régime de Nyerere : 1964-1985
Soucieux d’accélérer l’émancipation des Africains par rapport au monde occidental, inspiré des expériences communistes en Chine, Nyerere s’engage résolument dans une politique socialiste. En février 1967, lors de la déclaration d'Arusha, il définit les principes et doctrines de la forme de socialisme africain qu'il préconise pour le pays. Selon l’idéal de Nyerere, tout cela doit conduire à la création d’une société égalitaire, juste, solidaire, qui trouve dans ses propres ressources les moyens de son autosuffisance. L’éducation est la priorité numéro un, la Tanzanie ne produit à cette époque que 120 diplômés par an.
Les premières mesures concrètes d’application de cette politique ne tardent pas à arriver. Les principales industries et sociétés de services sont nationalisées, les impôts augmentés pour une plus grande répartition des richesses et les discriminations raciales abolies. C’est sur le plan de l’agriculture, principal secteur économique du pays, que les changements sont les plus forts. Appelé Ujamaas, c’est-à-dire cofraternité, des communautés villageoises sont organisées sur des principes collectivistes. Des incitations financières encouragent la formation de coopératives. En octobre 1969, Bibi Titi Mohammed et l'ex-ministre Michael Kamaliza sont arrêtés avec quatre officiers de l'armée. Ils sont accusés d'avoir fomenté un coup d'État. À Zanzibar, l’Afro-Shirazi Party mène une politique autoritaire, à tendance ouvertement révolutionnaire. Les propriétés arabes et indiennes sont nationalisées. Quelques désaccords apparaissent même entre Nyerere et Karume, ce dernier voulant se rapprocher davantage du monde communiste que le président tanzanien qui cherche, lui, à ménager au maximum les relations avec les Occidentaux. En 1972, Karume est assassiné par des opposants au régime. Des obsèques nationales lui sont rendues, en présence de Julius Nyerere3.
En politique extérieure, la Tanzanie donne son appui à la guérilla lumumbiste au Congo et l'OUA établit son siège à Dar es Salaam et plusieurs mouvements révolutionnaires ont une représentation dans le pays (l'ANC, la ZANU, la SWAPO, le MPLA et le FRELIMO). Parallèlement, les relations se détériorent avec les pays occidentaux ; en 1965 la Tanzanie rompt ses relations avec le Royaume-Uni et expulse hors du pays les troupes britanniques en réaction au soutien de Londres à un régime ségrégationniste en Rhodésie, tandis que l’Allemagne de l'Ouest rompt ses propres relations avec la Tanzanie à la suite de l'ouverture dans le pays d'une ambassade de l’Allemagne de l'Est. Les aides économiques accordées par certains pays occidentaux sont coupées. D'autre part, les forces coloniales portugaises bombardent le sud du pays pour couper les voies d’approvisionnement du FRELIMO mozambicain, soutenu par le gouvernement de Julius Nyerere.
Pendant ces années, la Tanzanie reçoit l’aide de la Chine, bien qu'étant elle-même en voie de développement. C’est avec un soutien chinois que la ligne de chemin de fer TAZARA de Dar-es-Salaam à la Zambie est construite en 1975. C’est aussi sur le modèle des communes chinoises que sont créés 800 villages collectifs, regroupant des populations d’origine ethniques et tribales différentes, et déplacées de force en camion. On estime qu’en 4 ans, de 1973 à 1976, 9 millions de personnes sont ainsi déplacées. Cette politique, si elle permet un certain brassage entre les différentes ethnies qui composent la population tanzanienne, casse brutalement les repères humains et communautaires des individus.
Ces politiques dirigistes et utopiques apportent de moins en moins les résultats escomptés. Le premier choc pétrolier de 1973 assombrit fortement les perspectives économiques du pays. Les productions manufacturière et agricole régressent, la planification de l’économie par l’administration est inefficace. Sur le plan politique, les partis TANU de Nyerere et l’ASP se rapprochent et fusionnent en 1977 pour former le Chama cha Mapinduzi (CCM), c’est-à-dire le parti de la Révolution. Malgré les difficultés économiques, le pays est en paix et reçoit de nombreux réfugiés venus des pays voisins en guerre ou fuyant le régime d'Amin Dada en Ouganda. Nyerere refuse que la politique d'africanisation de l’administration favorise les seuls Tanzaniens et autorise l'accès aux empois publics aux étrangers. Beaucoup obtiennent également la nationalité tanzanienne, y compris des réfugiés blancs.
Les relations de la Tanzanie avec ses voisins africains, en particulier ceux du nord, Ouganda et Kenya, se détériorent au fil des années. Les intentions étaient pourtant bonnes puisque ces trois pays ont formé en 1967 l'East Africain Community (Communauté d'Afrique de l'Est) dans le but de constituer à terme un marché économique commun. Les premières coopérations visent notamment à uniformiser la politique des changes et de contrôle des devises. Mais le Kenya, proche des pays occidentaux, s’éloigne de plus en plus de la Tanzanie soutenue par les communistes chinois, et la frontière entre ces deux pays est même fermée de 1977 à 1983. En Ouganda, le dirigeant Idi Amin Dada, qui nourrit des ambitions d’expansions territoriales, reproche à son voisin tanzanien d’héberger des opposants à son régime. L’Ouganda attaque la Tanzanie à la fin de l’année 1978, et envahit les environs du lac Victoria. Les Tanzaniens, avec l’aide du matériel militaire chinois, parviennent, au bout de plusieurs mois d’efforts et au prix de lourdes pertes humaines, à reprendre les territoires perdus et occupent même l’Ouganda pendant presque deux ans.
La guerre a coûté cher, environ 500 millions de dollars, et au début des années 1980, sans réelle industrie, avec un secteur agricole improductif, la Tanzanie est l’un des pays les plus pauvres de la planète. Le pays s’enfonçant dans l’échec, Nyerere commence à modifier progressivement sa politique dirigiste menée depuis le milieu des années 1960. Avec l’intervention de plus en plus grande de la Banque mondiale et du FMI, les incitations financières à la production collectiviste sont en partie réorientées vers un investissement pour les grandes fermes de l’État et pour les infrastructures routières. En 1984, la possibilité d’une propriété privée des moyens de production apparaît et la société est, très progressivement, libéralisée.
an 1964 : Zambie - Les premières élections portent Kenneth Kaunda et son parti l'UNIP au pouvoir, qu'il va garder jusqu'en 1991 de manière autoritaire.
En janvier 1964, les élections générales sont largement remportées par l'UNIP (50 députés) reléguant les 10 élus de Nkumbula dans l'opposition avec les 10 députés blancs. Kenneth Kaunda devient Premier ministre à la tête d'un gouvernement autonome.
Le 24 octobre 1964, l'indépendance de la Rhodésie du Nord est proclamée et devient la Zambie. Le pouvoir est exercé par le Parti uni de l'indépendance nationale ou UNIP (Parti National Uni pour l'Indépendance) de Kenneth Kaunda qui devient le premier président de la République.
En devenant indépendant, la Zambie intègre l'organisation internationale du Commonwealth dès 1964.
an 1964 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1964, la fédération est dissoute. La Rhodésie du Nord, rebaptisée Zambie, et le Nyassaland, rebaptisé Malawi, déclarent leur indépendance.
an 1965 : Afrique du Sud - En 1965, Verwoerd refuse la présence de joueurs et de spectateurs Maoris à l’occasion de la tournée des All Blacks néo-zélandais en Afrique du Sud, prévue en 1967, ce qui oblige la fédération néo-zélandaise de rugby à XV à l'annuler.
an 1965 : Algérie - Le groupe d'Oujda s'oppose à Ben Bella qui a passé un accord avec l'opposition conduite par Hocine Aït Ahmed, et annonce l'éviction d'un de ses membres, Abdelaziz Bouteflika Le 19 juin, un coup d'État militaire le renverse et porte Houari Boumédiène au pouvoir. Boumédiène continue dans cette voie socialiste tout en renforçant la planification de l'économie et la bureaucratie de l'État.
Il entame une politique basée sur l'exploitation de la rente pétrolière pour la création d'une industrie lourde : la « révolution industrielle » est menée au prix de la marginalisation de l'agriculture, malgré la « révolution agraire ». Le pays connait un développement économique et social important sous son gouvernement. Entre 1962 et 1982, la population passe de 10 à 20 millions de personnes et, massivement rurale avant l'indépendance, est urbanisée à 45 %. Le revenu annuel par habitant, qui n’excédait pas 2 000 francs (305 euros) en 1962, dépasse 11 000 francs (1 677 euros) vingt ans plus tard, tandis que le taux de scolarisation oscille de 75 à 95 % selon les régions, loin des 10 % de l'Algérie française. Cette scolarisation massive est accompagnée, sous le terme de « révolution culturelle », d'une arabisation volontariste de l'enseignement.
an 1965-1970 : Burundi - Le 15 janvier 1965, le Premier ministre Pierre Ngendandumwe (hutu) est assassiné : dans les milieux hutus, sa mort est attribuée à des Tutsis. Des émeutes éclatent, aussitôt réprimées par le gouvernement. Le 10 mai de la même année, les élections législatives se déroulent sous la bannière ethnique, notamment sous l’impulsion du Parti du peuple (PP).
La monarchie refuse de reconnaître les victoires des candidats hutus. En réaction, le 18 octobre 1965, un groupe de militaires hutus assassinent plusieurs de leurs collègues tutsis et tentent de renverser le roi, sans succès. Des politiciens et intellectuels hutus sont assassinés en représailles. Le 8 juillet 1966, le roi est déposé par son fils, Ntare V, renversé à son tour par son Premier ministre Michel Micombero le 28 novembre. Ce dernier abolit la monarchie et proclame la république. Un régime militaire émerge de facto et des émeutes éclatent ponctuellement jusqu'au début des années 1970. Micombero s'appuie sur un groupe d'origine hima, un sous-groupe tutsi du sud du pays. Comme en 1965, des rumeurs de coup d'Etat hutu en 1969 provoquent l'arrestation et l'exécution de nombreuses figures politiques et militaires hutues.
an 1965 : République de Centrafrique - En 1965, lors du « coup d'État de la Saint-Sylvestre », Jean-Bedel Bokassa renverse son cousin David Dacko et prend le pouvoir.
an 1965 : Congo Kimshasa - le Congo est pacifié, toutes les révoltes tribales, ethniques ou des partisans de Lumumba sont matées.
24, 25 novembre 1965: Mobutu Sese Seko renverse Joseph Kasa-Vubu et s'empare définitivement du pouvoir. La libération de Stanleyville marque le début des années de guerre qui se poursuivirent jusqu'en 1966. Toute cette région vit des atrocités qui firent au moins 500 000 morts civils et militaires. Il faudra l'intervention de troupes étrangères pour mettre fin à ce carnage.
an 1965 : Gambie - La Gambie acquiert son indépendance le 18 février 1965 en qualité de royaume du Commonwealth. . C’est la dernière colonie britannique à devenir indépendante : le manque de ressources économiques et sa petite taille rendent son avenir incertain. Un référendum sur le passage à une république est organisé dès le mois de novembre 1965, sans succès, et la Gambie reste une monarchie dans les premières années de son indépendance. Il n’y aurait plus de monarque mais un président, Jawara. C’est un échec à très peu de voix (758). Il est difficile d’interpréter ce vote qui peut être une position de principe mais aussi un simple « vote d’opposition » à Jawara. De plus, une partie de la population craint le souhait d’une partie de la population du Sénégal : l’annexion de la Gambie. Il y a donc derrière ce vote aussi l’idée que la reine Élisabeth II empêcherait l’invasion militaire par le Sénégal et protégerait l’autonomie de la Gambie.
an 1965 : Leshoto - Dès 1965, le Parti du congrès des Basothos était renvoyé dans l'opposition par le Parti national basotho (Basotho National Party, BNP) du chef Joseph Leabua Jonathan, un catholique-conservateur soutenu par la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud.
an 1965 : Mali - En décembre 1965, le Mali rompt ses relations diplomatiques avec Londres pour protester contre l'attitude du Royaume-Uni en Rhodésie.
an 1965 : Réunion (Ile de la) - Saint-Pierre, « capitale du Sud » devient sous-préfecture de l'île. 6 juin 1965 Éboulis de Mahavel
an 1965 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1965, la déclaration unilatérale d’indépendance de la Rhodésie du Sud est décrétée par le gouvernement blanc dirigé par Ian Smith.
an 1966 : Botswana - le Botswana, ex-Bechuanaland , obtient son indépendance de la part du Royaume-Uni. Seretse Khama devient le président du pays. L'anglais demeure la langue officielle, bien que la population continue de parler d'autres langues.
an 1966 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Le 4 janvier 1966, le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana remplace Maurice Yaméogo au pouvoir après un soulèvement populaire.
Au nom de l'armée, et après trois jours d'hésitation, le lieutenant-colonel Aboubacar Sangoulé Lamizana prend le pouvoir ; il renverse la Première République, instaure un régime militaire autoritaire et supprime les partis politiques. Le 12 février 1969, il nationalise les écoles privées catholiques. Le régime s'assouplit peu à peu, et le 20 novembre de la même année, les partis politiques sont à nouveau autorisés. Le 14 juin 1970, le chef de l'État fait approuver par référendum une nouvelle Constitution ; c'est le début de la Deuxième République. Ce texte attribue la présidence de la République au militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et accorde au moins un tiers des portefeuilles ministériels à l'armée.
an 1966-1970 : Afrique du Sud - Aux élections du 30 mars 1966, le parti national remporte 58 % des suffrages, alors qu'à ses frontières, la « colonie » de Rhodésie du Sud de Ian Smith a déclaré unilatéralement son indépendance du Royaume-Uni pour maintenir le principe de la domination blanche sur son territoire.
La fin du mandat de Verwoerd en tant que premier ministre d'Afrique du Sud est également marquée par le début de la guerre de la frontière, qui allait durer vingt-deux ans (26 août 1966 au 21 décembre 1988).
Le 6 septembre 1966, un déséquilibré, Dimitri Tsafendas, un métis d'origine grecque et mozambicaine, assassine Verwoerd en plein cœur du parlement mettant ainsi fin à la phase d'élaboration et d'application intensive et méthodique de l'apartheid. Au moment de sa mort, Verwoerd est encore loin d'être le symbole démoniaque de l'apartheid pour un large spectre de l'opinion publique occidentale du milieu des années 1960. Bien au contraire, le magazine Time le considère alors comme « l'un des plus habiles chefs blancs » que l'Afrique ait connu et le financial Mail lui consacre une édition spéciale post-mortem glorifiant la réussite économique que connait le pays entre 1961 et 1967. Pour Hermann Giliomee, le soutien indéfectible dont Hendrik Verwoerd a alors bénéficié de la part de la majorité de la communauté blanche repose davantage sur la transformation institutionnelle du pays en République que sur l'apartheid, une politique que Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU en 1961, considérait avec lui comme une « alternative concurrentielle à l'intégration » suffisamment convaincante pour être poussée plus avant.
Une semaine après l'assassinat de Verwoerd, le ministre de la justice, John Vorster succède à ce dernier au poste de président du parti national et à celui de premier ministre, après l'avoir emporté contre le ministre des transports, Ben Schoeman, président du parti national dans le Transvaal.
Moins dogmatique que son prédécesseur, John Vorster est le premier chef de gouvernement nationaliste à affirmer qu'il n'y a pas de races supérieures ou inférieures en Afrique du Sud. Sous le gouvernement Vorster le concept du Baasskap est définitivement abandonné au profit de la lutte contre le communisme.
En politique intérieure, John Vorster assouplit certaines lois vexatoires du petty apartheid (apartheid au quotidien dans les lieux publics) en autorisant l'ouverture des bureaux de poste, des parcs, et de certains hôtels et restaurants aux Noirs. Il autorise également les équipes sportives internationales, comprenant à la fois des joueurs blancs et des joueurs de couleur, à venir en Afrique du Sud, à la condition qu'elles n'aient pas de visées politiques. Pour pouvoir concourir aux Jeux olympiques de Mexico, le gouvernement abroge la législation d'apartheid interdisant la formation d'équipes sportives multiraciales mais l'équipe ainsi sélectionnée ne peut finalement participer en raison de l’hostilité des pays africains. En dépit de ces assouplissements, le gouvernement refuse d'autoriser Basil D'Oliveira, un joueur métis de cricket anglais d'origine sud-africaine, à venir jouer en Afrique du Sud au sein de l'équipe d'Angleterre de cricket, provoquant finalement l'annulation de la tournée suivie de celle de l'équipe d'Afrique du Sud de cricket en Angleterre en 1970, à la suite de virulentes manifestations anti-apartheid. La décision d'autoriser la présence de joueurs et de spectateurs maoris lors de la tournée de l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV en Afrique du Sud en 1970, provoque un schisme au sein du parti national, poussant ses membres les plus extrémistes, menés par Albert Hertzog, à faire scission pour créer le Parti national reconstitué (Herstigte Nasionale Party, HNP).
an 1966-1969 : Congo Kimshasa - Après les décrets de 1966, 1967 et 1969, les mines et les plantations sont nationalisées.
Les évêques dénoncent les penchants dictatoriaux du régime. Mobutu lance un plan économique qui permettra de doubler la production du cuivre
an 1966-1968 : Archipel des Comores - En 1966, Saïd Mohamed Cheick fait transférer la capitale des Comores de Dzaoudzi à Moroni, huit ans après la décision, ce qui provoque la méfiance des élus de Mayotte envers les indépendantistes. Il s'efforce de faire élargir les compétences territoriales (cela lui est plus facile à partir de 1968 par la loi no 6804). Cette période d'autonomisation progressive est marquée par un certain développement économique et social. Le réseau routier commence à être bitumé et les politiciens les plus autonomistes, après les événements de 1968 réclament l'indépendance ce qui aboutira aux « Accords de juin 1973 ».
an 1966-1982 : Afrique République de Djibouti - La visite à Djibouti en août 1966 de Charles de Gaulle, qui se rendait en Asie de l'Est, donne lieu à des manifestations en faveur de l'indépendance. Vexé par cet accueil, le chef de l’État français refuse de recevoir les représentants de l'opposition. Le lendemain, la place où le général doit prononcer son discours est envahie par des milliers de manifestants. Il donne l'ordre qu'on « déblaie la place ». Sans sommation, les troupes françaises dispersent la foule à coups de grenade offensive. Les autorités décomptent officiellement six morts et des centaines de blessés, mais des journaux estiment ce bilan sous-estimé. Après la manifestation d'une revendication d'indépendance en août 1966, puis des conflits sociaux, un barrage, miné et électrifié, est érigé autour de la ville, officiellement pour contenir les migrations. Plusieurs personnes perdent la vie en tentant de le franchir. Dénoncé comme mur de la honte par l'opposition, le barrage ne sera démantelé qu'en 1982.
Cependant les tensions perdurent. Un référendum est organisé le 19 mars 1967 sur le maintien du territoire sous souveraineté française. Après un scrutin entaché de fraudes qu'il est difficile de quantifier, officiellement 60,6 % des votants approuvent un changement de la dénomination de la colonie, qui devient le Territoire français des Afars et des Issas (TFAI). Ses structures de gouvernement sont modifiées mais restent sous la tutelle française. Les tensions politiques et sociales restent fortes. Le jour du vote, une manifestation est brutalement réprimée : douze personnes sont tuées. En novembre 1975, mois où les dernières colonies portugaises d'Afrique accèdent à l'indépendance, Pierre Messmer annonce un processus devant conduire à l'indépendance du territoire, maintenant dernière colonie européenne du continent. Les listes électorales sont ouvertes aux habitants pour leur permettre de s'exprimer. En juillet 1976, Ali Aref Bourhan, lié aux réseaux gaullistes, démissionne de la présidence du Conseil de gouvernement, il est remplacé par Abdallah Mohamed Kamil.
En 1976, des membres du Front de libération de la Côte des Somalis, qui cherchait à obtenir l'indépendance de Djibouti de la France, se sont également affrontés avec le Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale au sujet du détournement d'un bus scolaire en route vers Loyada. Tous les membres du commando indépendantiste et deux des enfants enlevés sont tués dans cette opération. Cet événement, en montrant les difficultés de maintenir la présence coloniale française à Djibouti, est une étape importante dans l'indépendance du territoire. La probabilité qu'un troisième référendum paraisse fructueux pour les Français s'était encore atténuée. Le coût prohibitif du maintien de la colonie, dernier avant-poste de la France sur le continent, est un autre facteur qui oblige les observateurs à douter que les Français tentent de s'accrocher au territoire.
Le 8 mai 1977, la population, consultée pour la troisième fois (après 1958 et 1967) choisit l'indépendance avec officiellement 98,8 % des suffrages exprimés. Elle est proclamée le 27 juin, avec la naissance de la République de Djibouti. Son premier président est Hassan Gouled Aptidon, et quatre premiers ministres se succèdent en un an et demi. Le dernier, Barkat Gourad Hamadou reste finalement en poste pendant 23 ans. En 1981, est imposé un système de parti unique.
an 1966-1968 : Ghana - Un coup d'état militaire, le 24 février 1966, met fin à cette Première République. Au moment du coup d’Etat, Nkrumah est en voyage pour la Chine. Il est alors au faîte de sa notoriété à l’international mais a perdu sa popularité au sein de son pays. La Guinée accepte de l’accueillir en asile politique. Il y reste jusqu'à sa mort en 1972, dans un hôpital roumain.
Un Conseil national de libération est mis en place par le général Joseph Ankrah, le chef d’État militaire, et un ancien leader de l’opposition à Nkrumah, Kofi Abrefa Busia, est nommé Président du Comité consultatif national de ce conseil militaire. En 1967-1968, Busia dirige le Centre pour l'éducation civique. Il devient également membre du Comité de révision constitutionnelle. Lorsque le Conseil national de libération lève l'interdiction des partis politiques, Busia fonde le Parti du Progrès.
an 1966 : Guinée-Bissau - L'insurrection rencontre progressivement l’adhésion des populations rurales et les « zones libérées » s'étendent sur 50 % du territoire dès 1966, puis 70 % à partir de 1968. Sous la direction d'Amílcar Cabral, les rebelles tentent d'y reconstruire un modèle politique où le pouvoir serait exercé par les paysans eux-mêmes et entreprennent de développer le système sanitaire et l'alphabétisation.
L'objectif se situe au-delà de la simple indépendance nationale. Selon Cabral : « Nous ne luttons pas simplement pour mettre un drapeau dans notre pays et pour avoir un hymne mais pour que plus jamais nos peuples ne soient exploités, pas seulement par les impérialistes, pas seulement par les Européens, pas seulement par les gens de peau blanche, parce que nous ne confondons pas l’exploitation ou les facteurs d’exploitation avec la couleur de peau des hommes ; nous ne voulons plus d’exploitation chez nous, même pas par des Noirs »
an 1966 : Kenya - En 1966 est créé le Kenya People's Union (KPU), parti de gauche modeste mais jouant un grand rôle. Il était dirigé par Jaramogi Oginga Odinga, ex vice-président et sage Luo. Après une visite mouvementée de Kenyatta dans la province de Nyanza, le KPU est interdit et son chef emprisonné.
an 1966 : Leshoto - Le 4 octobre 1966, le Basutoland devenait un État indépendant, sous le nom de « royaume du Lesotho »
Depuis l'indépendance, la vie politique du pays est marquée par l'opposition entre les partisans d'un régime militaire, ceux de la monarchie, ceux d'une démocratie parlementaire et les partisans d'un régime socialiste. Le Lesotho avait choisi de demeurer une monarchie traditionaliste. Le roi du Lesotho était le chef suprême des Sothos, Moshoeshoe II. Jonathan était le premier ministre. Les prérogatives royales étaient cependant limitées et bornées à désigner onze des trente trois sénateurs du parlement.
État totalement enclavé dans l'Afrique du Sud, le Lesotho était totalement dépendant de son puissant voisin et, tout en rejetant sa politique d'apartheid, ne pouvait se permettre de trop le critiquer.
Dès 1966, le gouvernement du Lesotho commença à démontrer son peu de considération pour la démocratie en faisant disperser par le feu une réunion du parti royaliste, panafricaniste et socialisant, le Basutho Congress Party, de Ntsu Mokhehle. Dans les jours qui suivirent, le roi lui-même fut placé en résidence surveillée dans son propre palais. L'épreuve de force opposant le roi Moshoeshoe II et Leabua Jonathan, le premier ministre, se résout progressivement au bénéfice du premier ministre : le souverain a signé en janvier 1967 un accord dans lequel il s'engage à se conformer au rôle de monarque constitutionnel que lui attribue la Constitution, sous peine d'abdication automatique.
an 1966 : Mauritanie - En février 1966, à la suite du vote d'une loi sur l’arabisation de l’enseignement secondaire, des troubles éclatent entre les communautés noires et maures. Les établissements scolaires resteront fermés jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Le 7 août 1966, Moktar Ould Daddah est élu président de la république pour un deuxième mandat.
an 1966 : Namibie - En 1966, le Liberia et l'Éthiopie, les deux seuls pays dont l'indépendance est antérieure à celle de l'Afrique du Sud, saisissent la Cour internationale de justice considérant comme illégale l'occupation du Sud-Ouest africain par la République sud-africaine — mais la Cour rejette leur demande. La décision de la Cour provoque l'indignation de l'Assemblée générale des Nations unies qui vote le 17 octobre 1966 la résolution 2145 déclarant que l'Afrique du Sud a failli à ses obligations (la France fait partie des abstentionnistes).
En 1966, l'Assemblée proclame alors que le territoire est désormais géré par un conseil pour le Sud-Ouest Africain pour le compte des Nations unies. Quelques semaines plus tard, le 26 août 1966, un accrochage sérieux entre militants de la SWAPO et la police sud-africaine marque le début de la guérilla. Les premières opérations ont lieu dans la partie orientale de la bande de Caprivi.
an 1966-1975 : Nigéria - La dictature d'Yakubu Gowon (1966-1975)
Ironsi est assassiné le 29 juillet 1966, et un autre coup d'État instaure un gouvernement fédéral militaire. La junte, en majorité musulmane, place à la tête de l'État un chrétien, le général Yakubu Gowon, avec pour mission de rétablir la paix dans le pays et un régime civil à son gouvernement. Mais dans le Nord du pays, en majorité peuplé de musulmans, des persécutions et des pogroms sont perpétrés sur des Igbos, ethnie chrétienne, malgré les tentatives de Lagos de ramener le calme. Le général Gowon modifie les structures administratives du pays, ce qui suscite l'opposition des Ibos, qui perdent le pétrole, qui est présent principalement à l'est du Delta, et est l'objet d'exploitations par les compagnies britanniques Shell et British Petroleum (BP).
Odumegwu Emeka Ojukwu, le gouverneur militaire de la région de l'Est, fief des Igbos, refuse alors de reconnaître l'autorité de Yakubu Gowon et la tension monte entre chrétiens et musulmans, plaçant le pays au bord de la guerre civile. En janvier 1967, l'accord d'Aburi est proposé au Nigeria au terme d'une médiation ghanéenne. Il prévoit l'abandon de la division du pays en régions afin d'instaurer une République fédérale composée de douze États. Le général Gowon propose de son côté un nouveau découpage administratif qui aurait privé les Igbos de la grande partie des ressources pétrolières. Ojukwu rejette ces propositions et déclare que tous les revenus générés dans la région de l'Est seront réquisitionnés par le gouvernorat en termes de réparation au coût du déplacement des dizaines de milliers d'Igbos fuyant le Nord.
an 1966 : Ouganda - En mai 1966, Milton Obote, afin d'imposer la centralisation, envoie l'armée au Bouganda et dépose le roi Kabaka Mutesa II, avec l'appui de son chef d'état-major, Idi Amin Dada, appartenant à une ethnie musulmane minoritaire du nord-ouest. Obote fait promulguer, l'année suivante, une nouvelle constitution abolissant les royaumes, et instituant un régime présidentiel à parti unique. La résistance des Baganda, dont les intérêts sont menacés par la politique de nationalisation du commerce entreprise par Obote, la dégradation économique et les accusations de corruption se conjuguent pour déstabiliser Obote.
an 1967-1969 : Algérie - Le développement agricole étant significativement limité par le désert, Boumédiène se tourne vers le développement industriel. Un plan triennal est imaginé pour la période 1967-1969, auquel succèdent deux plans quadriennaux (1970-1973 et 1974-1977). Ils s'accompagnent de grands travaux, comme la Transsaharienne (ou « route de l'unité ») qui relie la Méditerranée à l'Afrique noire, ou le « barrage vert », programme de reboisement sur vingt ans destiné à empêcher l'avancée du désert. Alors que le réseau routier restait centré sur les villes portuaires sous la colonisation, il est sensiblement étendu à l'intérieur du territoire.
an 1967 : Afrique République de Djibouti - 62 000 habitants.
En 1967, le territoire change de nom pour devenir le Territoire français des Afars et des Issas.
La mise en place concomitante d'une politique de contrôle de la population de la ville de Djibouti, et d'expulsions massives des « indésirables » à partir de 1960 (10 000 entre 1947 et 1962, 10 000 entre 1963 et 1968, encore plus sans doute ensuite) n'empêche pas l'accroissement de la population. Les tensions politiques et sociales s'accroissent, que la répression ne parvient pas à endiguer. Plusieurs mouvements indépendantistes sont créés dans les pays limitrophes, en particulier en Éthiopie et Somalie qui ont des prétentions territoriales sur le territoire;
an 1967 : Érythrée - En 1967, le mouvement a considérablement gagné en popularité auprès des paysans, en particulier du nord et de l'ouest, et à Massaua. Haile Selassié tente d'apaiser les troubles en visitant le pays et en garantissant à ses habitants un traitement égal sous le nouvel ordre. Il accorde titres, argent et fonctions officielles aux opposants dans l'espoir de les voir se rallier au gouvernement central mais la résistance se poursuit.
an 1967 : Gambie - En 1967, Jawara rencontre Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal. Ils concluent un accord le 19 avril qui prévoit la création d’un comité ministériel interétatique et prévoit une rencontre tous les ans en janvier.
an 1967 : Mali - En janvier 1967, de nouvelles négociations débutent à Paris, prévoyant le retour à terme du Mali au sein de l'UMOA. Des accords conclus en décembre 1967 prévoient à partir du 1er mars 1968 le principe de convertibilité du franc malien.
Face aux difficultés économiques que connaît le Mali, auxquelles s’ajoute la rébellion touarègue au nord, le parti unique US-RDA est en proie aux divisions entre une aile modérée et une aile radicale. En 1967 Modibo Keïta, qui a tenté l’équilibre, s’allie avec les radicaux qui prônent la révolution active. Le bureau politique national de l’US-RDA est dissous et remplacé par le Comité national de défense de la révolution (CNDR).
an 1967-1970 : Ile Maurice - Des mouvements nationalistes se forment et, à la suite d'un référendum le 7 août 1967 et malgré le vote négatif des Rodriguais, l'indépendance devient effective le 12 mars 1968. Le premier Premier ministre élu est Seewoosagur Ramgoolam, chef du parti travailliste.
En 1970, les victoires électorales du Mouvement militant mauricien (MMM), fondé par des étudiants en protestation contre la politique clientéliste des partis existants, conduisent les dirigeants à emprisonner les leaders et à contrôler la presse pour protéger leur pouvoir.
an 1967-1970 : Nigéria - La guerre du Biafra (1967-1970)
Les Ibos, ethnie majoritaire de l'est du pays, sont alors victimes de représailles raciales sanglantes qui aboutissent en 1967 à la sécession de la république du Biafra. S'ensuit une terrible guerre qui s'achève par une capitulation des indépendantistes le 12 janvier 1970.
an 1967-1971 : Sierra Leone - En mars 1967, Siaka Stevens, chef du parti All People's Congress (APC), remporte les élections, mais son accession au pouvoir est retardée jusqu'en avril 1968 par une série de coups d'État militaires. Le 19 avril 1971, il instaure un régime de parti unique. Il tente alors d'assainir la vie politique, en luttant contre la corruption par exemple. Mais il abandonne vite cette voie pour exploiter les mines de diamants au nord du pays.
En 1971 la Sierra Leone adopte la conduite à droite
an 1967-1979 : Togo - Kléber Dadjo, colonel dans l'armée de la République togolaise, est président éphémère du Togo du 14 janvier au
14 avril 1967. Il est déposé lui-même par le sergent Gnassingbé Eyadema, qui impose une dictature au Togo durant presque quatre décennies, de 1967 à 2005.
Devenu Président de la République, il commence par supprimer le multipartisme et fait ainsi de son parti, le Rassemblement du peuple togolais (RPT), le seul autorisé et y fait adhérer les chefs coutumiers. Par référendum en 1972, il fait ratifier ce régime politique, qui durera pendant vingt et un ans.
À partir de ce moment, le général Eyadéma inaugure une longue période de calme et de développement qui donne à l'étranger une impression de stabilité. L'État, dirigé par son chef Gnassingbé Eyadema instaure une politique de nationalisation, notamment en 1974 celle des phosphates, une des principales richesse du pays, et développe aussi une politique de promotion agricole afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire.
Durant les années 1970, la conjoncture internationale devient enfin favorable, les nombreux investissements étrangers permettent un développement important du pays, entraînant une certaine prospérité.
Tirant les leçons des divisions constatées dans le cadre du multipartisme, Étienne Gnassingbé Eyadema crée le Rassemblement du peuple togolais (RPT), un parti unique et d'État.
an 1968-1969 : Congo Brazzaville - Le 1er août 1968, le président Alphonse Massemba-Debat dissout l'Assemblée nationale congolaise et tente d'écarter le bureau politique du Mouvement national de la révolution (le parti unique). Mais cette tentative de reprise en main reste sans lendemain, et le 2 août, a priori incapable d'imposer son autorité, il se retire dans son village natal. L'armée prend le pouvoir. Les officiers congolais créent un conseil de la révolution et abrogent la Constitution. Un gouvernement provisoire est constitué sous la direction du capitaine Alfred Raoul qui assume pendant plusieurs mois la charge de chef de l'État. Puis, le 30 décembre 1968, un autre officier, Marien Ngouabi est désigné chef de l'État, tandis qu'Alfred Raoul, promu commandant, passe au second plan, comme Premier ministre puis vice-président. D'un point de vue idéologique, l'option socialiste est réaffirmée : la république du Congo devient même une démocratie populaire, la république populaire du Congo.
Le 31 décembre 1968, le capitaine Marien Ngouabi devient président du Congo, celui-ci réaffirmant l'option socialiste du pays. Le Congo connaît sa deuxième république, cette fois une république populaire. L'administration est centralisée à Brazzaville, les principaux postes sont occupés par les cadres du Parti congolais du travail (PCT), qui a tenu son congrès constitutif du 29 au 31 décembre 1969 à Brazzaville. La république du Congo devient « république populaire du Congo5 », elle adopte le drapeau rouge et un nouvel hymne national, Les Trois Glorieuses, qui fait référence aux trois journées de soulèvement qui avaient entraîné la chute de Fulbert Youlou en août 1963.
an 1968 : Eswatini (Swaziland) - Le royaume du Swaziland et le changement de nom en Eswatini - Le 6 septembre 1968, l'indépendance du Royaume du Swaziland est proclamée. C'est initialement une monarchie constitutionnelle, inspirée du modèle britannique. La vie politique est toutefois depuis l'indépendance marquée par l'opposition entre les partisans d'un régime démocratique et ceux soutenant le principe de la monarchie absolue.
Le roi s'arroge des pouvoirs institutionnels, ignorant le parlement, désignant les ministres à sa guise, ne prenant conseil qu'auprès du conseil traditionnel des monarques swazis.
an 1968 : Gabon - En janvier 1968, Bongo est reçu par de Gaulle à l'Elysée. En échange du soutien de l’Élysée, qui peut intervenir pour le destituer, Bongo consent à mettre à disposition de la France une partie des richesses du Gabon et en particulier son pétrole et son uranium, ressources stratégiques. Sur les questions de politique internationale, le Gabon s'aligne sur Paris. Le pays est utilisé comme base logistique par la sécession biafraise en 1968. C’est aussi depuis le Gabon que les mercenaires de Bob Denard tentent de déstabiliser le régime marxiste-léniniste du Bénin.
En 1968, Omar Bongo, toujours sous l'influence de Jacques Foccart, est contraint par la France de reconnaître la pseudo-indépendance du Biafra (sud-est du Nigeria). Il doit même accepter que l'aéroport de Libreville serve de plaque tournante aux livraisons d'armes opérées en faveur du colonel Ojukwu (le dirigeant sécessionniste du Biafra). Ce sera aussi depuis le Gabon que les mercenaires de Bob Denard tenteront de déstabiliser le régime marxiste-léniniste du Bénin.
an 1968-1990 : Gabon - Le 12 mars 1968, Albert Bongo instaure un régime de parti unique avec la création du Parti démocratique gabonais (PDG). À partir de cette date et jusqu'en 1990, les activités de l'opposition sont cantonnées à l'étranger.
L'économie se développa autour de l'exploitation forestière (okoumé), minière (manganèse, uranium) et surtout pétrolière (Elf, sous la présidence de Giscard). L'exemple de développement d'infrastructures le plus marquant fut le Transgabonais.
Bongo est reçu à l'Elysée par le président Georges Pompidou. En 1973, il se convertit à l'islam et prend pour prénom Omar, ce qui facilite l'adhésion du Gabon, l'année suivante, à l'Opep. L'État fortement centralisé assurait, comme aujourd'hui, l'essentiel de l'emploi national grâce à la rente pétrolière.
En novembre 1982, une quarantaine d'opposants se réclamant du Morena (Mouvement de redressement national) sont jugés pour atteinte à la sûreté de l'Etat. 13 sont condamnés à 20 ans de prison. Ils seront amnistiés en 1986.
Bongo est reçu à nouveau à l'Elysée, en 1984, par François Mitterrand. Les revendications sociales et politiques se multiplient.
À la fin des années 1980, la chute du cours du pétrole plonge le Gabon dans une crise économique, incitant la population à multiplier les revendications sociales et politiques. Malgré l'importante rente pétrolière, le politologue Thomas Atenga estime que « l’État rentier gabonais a fonctionné durant des années sur la prédation des ressources au profit de sa classe dirigeante, autour de laquelle s’est développé un capitalisme parasitaire qui n’a guère permis d’améliorer les conditions de vie des populations »
an 1968 : Guinée-équatoriale - Les îles d’Annobón et Fernando Poo deviennent, avec les îles de Corisco, Elobeye et Mbanié la partie insulaire de la Guinée espagnole en 1778, puis de la Guinée équatoriale en 1968.
L’ancienne dépendance autonome de Guinée espagnole accède à une indépendance pleine et entière et prend le nom de Guinée équatoriale.
an 1968 : Mali - Le 22 janvier 1968, Modibo Keïta dissout l’Assemblée nationale et décide de gouverner par ordonnance.
Le 19 novembre 1968 des quartiers officiers militaires, dont les capitaines Yoro Diakité et Mamadou Cissoko et les lieutenants Youssouf Traoré, Kissima Doukara et Moussa Traoré renversent le régime de Modibo Keïta. Le président est arrêté au retour d’un voyage officiel dans la région de Mopti.
Un Comité militaire de libération nationale (CMLN) est formé qui met en place un régime d’exception. Le 23 novembre 1968, un gouvernement placé sous l'autorité du CMLN est constitué avec le capitaine Yoro Diakité comme Premier ministre. Le capitaine Charles Samba Cissokho et le chef d'escadron de gendarmerie Balla Koné sont nommés respectivement ministre de la Défense nationale et ministre de l'Intérieur, de l'Information et de la Sécurité. Deux personnalités modérées du régime de l’US-RDA font partie du gouvernement: Jean-Marie Koné qui a négocié les accords franco-malien, nommé ministre des Affaires étrangères et Louis Nègre qui conserve son poste de ministre des Finances auquel s'ajoute le Plan et les Affaires économiques.
Le 7 décembre 1968, la constitution du 22 septembre 1960 est abolie et remplacée par la Loi fondamentale. le CMLN est l'organe suprême du pays, son président, Moussa Traoré, est chef de l'État. Le CMLN promet l'adoption rapide d'une nouvelle constitution et des élections dans l'année à venir.
Yoro Diakité est démis rapidement de ses fonctions de Premier ministre qui sont attribués au chef de l'État.
an 1968 : Ile Maurice - Période britannique (1810-1968) - 12 mars 1968 - Proclamation de l'indépendance de l'Île Maurice
Lors de la Conférence de Lancaster de 1965, il apparait clairement que la Grande-Bretagne souhaite se débarrasser de la colonie de l'île Maurice. En 1959, Harold Macmillan prononce son célèbre "discours du vent du changement" dans lequel il reconnait que la meilleure option pour la Grande-Bretagne est de donner une indépendance totale à ses colonies. Ainsi, dès la fin des années 1950, la voie est ouverte à l'indépendance.
Plus tard, en 1965, après la conférence de Lancaster, l'archipel des Chagos est retranché du territoire de l'île Maurice pour former le territoire britannique de l'océan Indien (BIOT). Des élections générales ont lieu le 7 août 1967, et le Parti de l'indépendance obtient la majorité des sièges. En janvier 1968, six semaines avant la déclaration d'indépendance, les émeutes mauriciennes de 1968 se produisent à Port-Louis, entraînant la mort de 25 personnes.
L'île Maurice adopte une nouvelle constitution et l'indépendance est proclamée le 12 mars 1968. Sir Seewoosagur Ramgoolam devient le premier Premier ministre d'une île Maurice indépendante, la reine Élisabeth II restant chef d'État en tant que reine de Maurice.
an 1968-1969 : Mozambique - La guerre d'indépendance (1964-1974)
En 1968, le premier gouverneur civil du Mozambique est nommé, l'armée ayant fourni jusque-là la majorité des gouverneurs coloniaux. En dépit de l'assassinat en 1969 de son chef historique, Eduardo Mondlane, le FRELIMO devient le mouvement nationaliste de guérilla le plus actif contre le pouvoir colonial.
Le FRELIMO est finalement reconnu internationalement comme mouvement de libération nationale. Sa direction tricéphale est alors composée de Samora Machel, du poète Marcelino dos Santos et du révérend Uria Simango. Après que ce dernier eut rejoint le COREMO, Samora Machel prend vite l'ascendant sur le mouvement alors que Dos Santos préfère s'effacer devant un Noir représentant la classe ouvrière. Dos Santos demeure néanmoins l'idéologue en chef du FRELIMO.
Le Frelimo n'attend pas le retrait des troupes portugaises de l'Angola pour développer sa propre administration dans les régions « libérées » perçues comme un « contre-État » : création d'écoles, de centres de santé, développement de cultures agricoles, premiers « comités du parti », création d'une « École du parti », chargée de former idéologiquement ses cadres.
an 1968-1970 : Namibie - En février 1968, à la suite d'escarmouches qui eurent lieu l'année précédente, trente-sept membres de la SWAPO dont Herman Toivo ya Toivo sont jugés à Pretoria en vertu de la loi sur le terrorisme et condamnés à des peines allant de cinq ans de prison à la détention à perpétuité. Le 8 mai 1968, Tobias Hainyeko, le tout récent premier commandant de la non moins récente Armée populaire de libération de la Namibie, est tué au cours d'une autre escarmouche qui eut lieu dans la Bande de Caprivi.
Le 12 juin 1968, L'Assemblée générale des Nations unies vote la révocation du mandat sud-africain. La résolution de l'Assemblée générale reste sans effet car l'Afrique du Sud ne reconnaît pas la compétence de cette assemblée (ni l'ONU comme le successeur de la SDN). Ce même jour, le nom de Namibie, de préférence à celui de Kalanami (contraction entre Kalahari et Namib), est donné par l'ONU à tout le territoire (la paternité du nom reviendrait à Mburumba Kerina, le premier directeur exécutif de la SWAPO).
De son côté, le gouvernement sud-africain met en place le dispositif du rapport Odendaal prévoyant la constitution de dix homelands dont six districts représentant plus des deux tiers de la population, ayant vocation à devenir autonome (Damaraland, Ovamboland, Kaokoland, Kavangoland, Caprivi oriental et Hereroland).
De son côté, en 1969, lors de son congrès à Tanga en Tanzanie, la SWAPO se donne comme objectif d'obtenir des Nations unies le statut d'« unique représentant du peuple namibien en lutte pour sa libération ». L'action armée est avalisée comme le seul moyen de lutte efficace pour atteindre cet objectif. Des dissensions internes apparaissent quand Paul Helmuth soulève notamment la corruption de certains dignitaires ou le sort des prisonniers politiques (une dizaine de dissidents du parti) détenus par la SWAPO (il est aussitôt démis de ses fonctions et sera par la suite contraint de se réfugier en Suède).
Ce n'est qu'en 1970 que le Conseil de sécurité saisi du dossier déclare pour la première fois illégale la présence de l'Afrique du Sud en Namibie. Mais il faut attendre le 21 juin 1971 pour que la révocation du mandat sud-africain soit confirmée par un avis consultatif de la Cour internationale de justice.
an 1968 : Réunion (Ile de la) - Le 9 mars 1968 survient l'accident aérien le plus grave de l'histoire de l'île dans les Hauts de Sainte-Marie.
an 1969-1980 : Botswana - le Parlement évoque le problème de discrimination linguistique : le tswana serait encouragé par rapport aux autres langues nationales (dont le kalanga). Ce même problème est soulevé à plusieurs reprises en 1988 puis en 1995.
La découverte de diamants à Orapa donne au pays une certaine aisance financière. La gestion du pays est bien assurée par Seretse Khama qui est réélu trois fois. À sa mort, en 1980, il est remplacé par Quett Masire.
an 1969 : Kenya - Le 25 octobre 1969, Odinga est arrêté après que Kenyatta et lui-même se sont insultés mutuellement, verbalement et publiquement. Trois jours plus tard, le KPU est interdit et le pays redevient de facto un État de monopartisme. Sur le plan politique, Kenyatta instaure un régime à parti unique fondé sur la doctrine Haraambee (« Agir ensemble » en swahili). Le président pratique une politique autoritaire et clientéliste pour assurer l'unité nationale. Pourtant, selon l'historien britannique John Lonsdale, Kenyatta perpétue l'héritage colonial qui « institue un État et non une nation ». Son pouvoir repose sur « un féodalisme ethnique [...] avec son contrat inégal de vassalité garanti par un discours normatif de l'ethnicité morale ».
an 1969 : Libye - Le régime de Kadhafi
Le 1er septembre 1969, alors que le roi Idris Ier séjourne à l'étranger, un groupe d'« officiers unionistes libres » influencés par les idées nasséristes, réalise un coup d'État et abolit la monarchie, proclamant la République arabe libyenne. Un jeune officier de 27 ans, Mouammar Kadhafi, devient chef de l'État en tant que président du Conseil de commandement de la révolution.
Kadhafi instaure un régime inspiré par les courants du nationalisme arabe et du socialisme arabe, à la nette orientation à la fois panarabe, panafricaine et tiers-mondiste. Il tente rapidement d'unir la « nation arabe » par le biais d'une Union des républiques arabes unissant la Libye avec l'Égypte et la Syrie, mais cette fédération échoue à trouver une existence concrète. Les tentatives ultérieures d'alliance étroite et d'union avec d'autres États arabes et d'Afrique subsaharienne n'ont pas davantage de succès.
an 1969 : Ile Maurice - En 1969, le parti d'opposition Mauritian Militant Movement (MMM) dirigé par Paul Bérenger est fondé.
an 1969 : Mauritanie - Le 26 septembre 1969 le roi Hassan II du Maroc reconnait officiellement la Mauritanie, neuf ans après son indépendance.
an 1969 - 1970 : Réunion (Ile de la) - campagne d'avortements et de stérilisations forcées clandestine ciblant les femmes de couleur, dans une clinique de Saint-Benoît. Les avortements sont organisés par la classe dirigeante de l'île. L'affaire se double d'un scandale d'escroquerie à la Sécurité sociale
an 1969 : Somalie - Le 15 octobre 1969, le président Abdirashid Ali Shermarke est tué dans un attentat. Le 21 octobre, l'armée et la police prennent le contrôle des points stratégiques de la capitale. Un Conseil révolutionnaire suprême (CRS), dirigé par les généraux Salaad Gabeyre Kediye et Mohamed Siad Barre, est installé à la tête de l'État. La constitution est suspendue.
an 1969 : Soudan - Le 25 mai 1969, un nouveau coup d’État militaire des « officiers libres » permet au colonel Gaafar Nimeiry de s'emparer du pouvoir. Il va s'y maintenir jusqu’en 1985
an 1970-1972 : Bénin - En 1970, un Conseil présidentiel constitué de trois membres, Maga, Apithy et Ahomadegbé (une présidence tournante à trois) prend le pouvoir et suspend la constitution. La ronde des présidents n'a pu se faire. En effet, seul Maga a pu passer les deux ans retenus à la tête du Dahomey. À peine Ahomadegbé a-t-il entamé son tour de direction en 1972 que l'armée, sous la direction du capitaine Mathieu Kérékou, décide de reprendre en main le gouvernement, destitue le Conseil présidentiel, et Mathieu Kérékou devient le nouveau chef de l'État dahoméen. Il est rapidement nommé commandant. Mais les militaires se trouvent désemparés, sans programme et sans idées. Leur pouvoir est vide et c'est dans ce vide que vont s'engouffrer les idées des jeunes militaires et des étudiants qui ont vécu en France la période de mai 68.
an 1970-1974 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Des élections législatives ont lieu le 20 décembre 1970. La démocratisation est cependant de courte durée, puisque le 8 février 1974, Lamizana opère à nouveau un coup de force, suspend la constitution, dissout l'Assemblée nationale, mettant ainsi fin à l'éphémère Deuxième République. La rivalité entre Gérard Ouédraogo, le premier ministre, et Joseph Ouédraogo, président de l'Assemblée nationale, avait dans les mois précédents conduit à une paralysie des institutions. L'armée reprend le pouvoir. Fin 1974, un conflit frontalier oppose la Haute-Volta au Mali, ne se traduisant cependant que par quelques escarmouches frontalières.
Les années 1970 voient le développement de l'agro-industrie cotonnière au Burkina Faso, via la Société Burkinabè des Fibres Textiles (Sofitex), une société d'économie mixte, d'abord publique puis privatisée, créée en 1974 qui a pour mission de succéder à la Compagnie Française pour le Développement des Textiles. Dans l'ouest du pays, la région cotonnière de Bobo Dioulasso, près de la frontière ivoirienne, elle devient le principal levier des changements économiques et sociaux. L'histoire de la culture du coton en Afrique noire s'étant traduit par une forte croissance entre 1970, et 2005, elle fait du Burkina le premier producteur du continent à la fin des années 2000.
an 1970-1977 : Congo Brazzaville - Le régime est instable et doit faire face à de nombreux soubresauts : à la tête d'un commando, le lieutenant Kinganga s'empare des bâtiments de la radiodiffusion et télévision congolais le 23 mars 1970, avant d'être abattu ; le 22 février 1972, le lieutenant Ange Diawara, soutenu par l'aile gauche du Parti, tente lui aussi un coup d'état, avant de prendre le maquis dans la région du Pool, où il résiste au pouvoir jusqu'au printemps 1973, tandis que le vice-président Moudileno Massengo démissionne en août 1972 depuis la République Démocratique d'Allemagne. De nombreuses vagues d'arrestations touchent les personnalités soupçonnées d'être impliquées dans ces tentatives, notamment l'ancien Premier ministre Pascal Lissouba, arrêté à plusieurs reprises, notamment à l'occasion des grèves de 1976 à Brazzaville et de l'assassinat de Marien Ngouabi en 1977.
Au cours de cette période, le Congo reste dépendant de l'extérieur, en particulier en ce qui concerne les produits alimentaires et manufacturés ; son économie repose sur les exportations de matières premières brutes (bois, potasse, pétrole, fer, etc.). Les ressources pétrolières restent modestes, et le pays est loin d'atteindre la prospérité relative du Gabon voisin.
Le 18 mars 1977, le président Marien Ngouabi est assassiné dans sa résidence. Dans les jours qui suivent, le cardinal Émile Biayenda, archevêque de Brazzaville (le 22 mars) et l'ancien président de la République Alphonse Massamba-Débat sont également assassinés. Le 5 avril 1977, le colonel Joachim Yhombi-Opango, devient président de la République, et ce jusqu'en février 1979.
an 1970 : Gambie - Le 24 avril 1970, la Gambie devient une république au sein du Commonwealth, à la suite d'un second référendum. Le Premier ministre Dawda Jawara assure les postes de président ainsi que de ministre des Affaires étrangères.
an 1970 : Ghana - Busia devient le premier ministre en septembre 1970. C’est la seconde République qui commence, avec l'intermède militaire. Le collège électoral choisi comme président Edward Akufo-Addo, l'un des principaux hommes politiques nationalistes de l'United Gold Coast Convention (UGCC) qui, bien qu'ayant participé à la lutte pour l'indépendance aux côtés de Nkrumah, s’étaient opposé à lui à partir de 1964.
Les mesures initiées par le gouvernement de Busia sont l'expulsion d'un grand nombre de non-ressortissants du pays et la limitation des participations étrangères dans les petites entreprises. Ces initiatives visant à réduire le chômage créé par la situation économique précaire. Elles sont populaires parce qu'elles forcent les étrangers , en particulier les Libanais, les Asiatiques, et les Nigérians, à quitter le secteur de la distribution où ils étaient accusés injustement de monopoliser l’activité commerciale au détriment des Ghanéens. D’autres initiatives de Busia ne sont pas populaires. Ainsi, en est-il de la décision d'introduire un programme de prêts pour les étudiants à l'université, en lieu et place d’un accès libre, a été contestée parce qu'elle a été interprétée comme l'introduction d'un système de classe dans les plus hautes institutions éducatives. Certains observateurs ont même considérée de la dévaluation de la monnaie nationale et ses encouragements à l'investissement étranger dans le secteur industriel étaient de nature à nuire à la souveraineté du pays. Il impose également des mesures d’austérité à l’administration et à l’armée, et cède aux mêmes dérives, au fil des ans, que le premier président du pays, Nkrumah : harcèlement de l’opposition, pression sur le pouvoir juridique.
an 1970 à 1981 : Egypte - Anouar el-Sadate succède à Gamal Abdel Nasser et lance la politique de l'Infitah (ouverture) qui vise, en réduisant le rôle de l’État, à attirer les investissements étrangers. Une classe de nouveaux riches se développe rapidement. En 1975, on compte plus de cinq-cents millionnaires en Égypte mais plus de 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et des bidonvilles se développent autour de la capitale. Par ailleurs, le pays accumule une dette monumentale durant les années de l'Infitah. Pour la restructurer, le FMI demande la suppression de toutes les subventions aux produits de base ce qui provoque des émeutes en janvier 1977. Le gouvernement fait intervenir l'armée, générant un nombre de victimes inconnu. Dans les campagnes, Sadate cherche à obtenir le soutien des élites rurales traditionnelles, dont l'influence avait décliné sous le nassérisme. Des paysans sont expulsés des terres contestées.
an 1970-1974 : Éthiopie - La révolution de février (Yekakit 66)
Au début des années 1970, une famine de très large ampleur ravage la région du Wollo. Rapidement, le régime tente de masquer la situation ; un rapport préparé à l'automne 1972 par le ministère de l'Agriculture et la FAO (Commission de l'alimentation et de l'agriculture des Nations unies) sur la situation est même passé sous silence avec la complicité de l'agence. Le 17 avril, les étudiants manifestent et ouvrent les yeux du pays sur l'ampleur de la situation ; une répartition des terres plus juste fait partie des premières revendications. Des heurts violents les opposent à la police. Le 28 avril, un nouveau gouverneur est nommé dans le Wello et des ravitaillements sont envisagés. Néanmoins, le gouvernement continue à minimiser l'ampleur de la situation. Haïlé Sélassié Ier admet finalement son incapacité à gérer la situation et fait appel à l'aide internationale. Les pertes humaines sont estimées à 200 000 personnes.
Les professeurs, universitaires et intellectuels sont au premier rang de la contestation qui se prépare à la suite de l'annonce d'une réforme du secteur de l'éducation. Celle-ci préconise entre autres de limiter l'éducation aux stricts besoins économiques du pays et de conserver la part infime d'étudiants accédant au cursus secondaire : pour beaucoup ce rapport condamne la jeunesse à l'illettrisme et au statut de prolétaire, par ailleurs les enfants des classes dirigeantes ne sont pas concernés par ces réformes. Le 14 février, les étudiants manifestent et font face à une riposte armée de la police. Le 18 février les professeurs accompagnés des conducteurs de taxis, qui entendent protester contre une hausse de 50 % du prix du carburant, bloquent la capitale. De nombreuses attaques contre les propriétés de la classe dirigeante ont lieu.
Le 23 février une diminution du prix du pétrole est décrétée et la réforme de l'éducation reportée indéfiniment ; les associations universitaires refusent néanmoins de mettre fin au mouvement. De nombreuses publications clandestines fleurissent à cette époque à Addis Abeba ; les tracts des étudiants font appel à toutes les classes sociales mais également aux soldats. Simultanément, le gouvernement accorde des augmentations de salaire aux militaires et policiers. Le 27 février le premier ministre Aklilu Habte-Wold démissionne ; la haute aristocratie en profite pour reprendre le contrôle et Endalkachew Mekonnen est nommé premier ministre. La première mesure du nouveau cabinet consiste à accroître la solde des soldats et des officiers : en dépit de quelques agitations, la quasi-totalité des soldats prête allégeance au nouveau gouvernement et disperse une manifestation le 1er mars 1974.
Néanmoins la grève des professeurs ne faiblit pas. L'Association des professeurs d'Universités Éthiopiens se joint au mouvement et publie un document intégrant les demandes des différents groupes sociaux. La démocratie, une nouvelle constitution, une presse libre, une réforme de la répartition des terres, des libertés civiles font partie des revendications premières. De son côté, l'union des syndicats éthiopiens se joint aux mouvements de protestation et menace le Premier ministre de grève générale. Les syndicats demandent entre autres un salaire minimum et une meilleure sécurité de l'emploi ; en outre, ils se joignent aux demandes des enseignants. La première grève générale dans l'Histoire de l'Éthiopie a lieu le 7 mars. Le 22 avril, le ministre de la Défense menace de réprimer toute manifestation et s'autorise à répondre « par tous les moyens nécessaires pour arriver à ses fins »
an 1970 : Guinée - Le Portugal, enlisé dans des guerres coloniales, organise en 1970 une tentative de coup d’État contre le régime de Sékou Touré afin de priver les indépendantistes du PAIGC de leur plus proche allié, mais l'opération aboutit à un fiasco.
an 1970 : Leshoto - En 1970, le régime évolua nettement vers l'autoritarisme et la dictature. Les élections prévues pour janvier, et qui s'annonçaient difficiles pour le gouvernement, furent annulées et l'état d'urgence proclamé. Le roi fut exilé aux Pays-Bas pendant neuf mois alors que le premier ministre Joseph Jonathan suspendait la constitution et le parlement, reléguant le roi à un rôle honorifique. Les partis d'opposition furent interdits et leurs chefs arrêtés.
Un parlement croupion fut instauré et Jonathan gouverna, réprimant toute hostilité avec l'aide technique de l'Afrique du Sud. L'opposition elle-même était divisée. Ntsu Mokhehle fit alors le choix de la lutte armée mais sans grand résultat.
À la fin des années 1970, contre toute attente, Jonathan se rapprocha des pays socialistes du bloc soviétique.
an 1970 - 1972 : Libye - En 1970, une loi a été adoptée qui affirmait l'égalité des sexes et insistait sur la parité salariale. En 1971, Kadhafi soutient la création d'une Fédération générale des femmes de Libye. En 1972, une loi est adoptée pénalisant le mariage des filles de moins de seize ans et fait du consentement de la femme une condition indispensable pour le mariage.
an 1970-1971 : Mali - Du 10 septembre au 26 novembre 1970 il occupe les fonctions de ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité. Il est démis de ces fonctions au profit de Kissima Doukara. Rayé des cadres de l'armée, il est arrêté pour tentative de coup d'État le 7 mars 1971 et condamné le 31 juillet aux travaux forcés à perpétuité dans une mine de sel où il meurt de mauvais traitement deux ans plus tard. Le capitaine Malick Diallo, ministre de l'Information est condamné en même temps à la même peine. En octobre 1971, Moussa Traoré prend le titre de colonel.
Les conseils municipaux élus sont dissous et remplacés par des délégations spéciales dont les chefs remplissaient les fonctions de maire.
Malgré l’interdiction des partis politiques, le parti malien du travail (PMT) s’active dans la clandestinité pour la défense des libertés individuelles et l'instauration du pluralisme politique. Les militants du PMT s'impliquent au sein de l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui, lors de son 2e congrès (appelé « congrès de revitalisation des travailleurs maliens », réclame le départ des militaires. La junte militaire fait dissoudre la direction de l'UNTM et arrêter des membres du bureau syndical.
an 1970 : Namibie - C'est en 1970 que le Conseil de sécurité saisi du dossier déclare pour la première fois illégale la présence de l'Afrique du Sud en Namibie. Mais il faut attendre le 21 juin 1971 pour que la révocation du mandat sud-africain soit confirmée par un avis consultatif de la Cour internationale de justice.
Au début des années 1970, la proportion d'habitants blancs de Namibie est 15 %, soit le plus haut taux de l'histoire de la colonie. Sur presque la moitié du territoire, cette représentation atteint voire dépasse les 50 %, ce qui motive le gouvernement de Pretoria à faire appliquer le rapport Odendaal et annexer les parties de territoire sur lesquelles l'Afrique du Sud revendique sa souveraineté.
an 1970 : Sénégal - 26 février 1970 : Création d’un poste de Premier Ministre par réforme de la constitution approuvée par référendum. Le président Senghor nomme Abdou Diouf à ce poste.
an 1970 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1970, la république de Rhodésie est proclamée.
an 1971-1977 : Congo-Kinshasa (Zaïre) - République du Zaïre sous Mobutu (1971-1977) Dans les années qui suivent la prise du pouvoir par le général Mobutu Sese Seko, ce dernier entame à partir de 1972 une campagne d’« authenticité » afin de maintenir sa popularité. Le pays est renommé république du Zaïre le 27 octobre 1971 d’après un mot local pour rivière, et portera ce nom jusqu’en 1997. Dès lors il n’y aura plus de confusion avec la « République congolaise » voisine dont le nom va aussi être modifié en « république du Congo », mais les deux républiques du Congo étaient généralement distinguées par leur capitale : on parlait de Congo-Léopoldville et de Congo-Brazzaville. De même, le fleuve Congo est rebaptisé Zaïre et une nouvelle monnaie, le zaïre, divisé en 100 makuta (singulier likuta), remplace le franc.
Les noms des personnes sont africanisés. Le général Mobutu prend le nom de Mobutu Sese Seko et oblige tous ses concitoyens à supprimer les prénoms à connotation occidentale et à rajouter un « postnom ». L’abacost est promulgué, interdisant le port de costumes occidentaux, et de nombreuses villes sont rebaptisées.
À partir de 1974, de nombreux biens des étrangers sont confisqués (zaïrianisation), nombre d’étrangers commencent à quitter le pays.
an 1971 : Érythrée - En 1971, l'Empereur déclare l'entrée en vigueur de la loi martiale en Érythrée et déploie ses armées pour contenir la résistance.
an 1971 : Libéria - William Tolbert, vice-président depuis 1951, accède à la présidence à la suite de la mort du président Tubman. La politique économique qu'il mène accroît le clivage entre américano-libériens et autochtones.
an 1971 : Ile Maurice - Le Mauritian Militant Movement (MMM), soutenu par les syndicats, appelle à une série de grèves dans le port, ce qui provoque l'état d'urgence dans le pays. Le gouvernement de coalition du Parti travailliste et du PMSD (Parti Mauricien Social Démocrate) réagit en restreignant les libertés civiles et en limitant la liberté de la presse. Paul Bérenger fait l'objet de deux tentatives d'assassinat infructueuses. Le 1er octobre 1971, son partisan Fareed Muttur meurt dans des circonstances suspectes au Réduit alors qu'il conduisait la voiture de Paul Bérenger. La seconde entraîne la mort d'Azor Adélaïde, docker et militant, le 25 novembre 1971. Les élections générales sont reportées et les réunions publiques sont interdites. Des membres du MMM, dont Paul Bérenger, sont emprisonnés le 23 décembre 1971. Le leader du MMM est libéré un an plus tard.
an 1971 : Mauritanie - Le 9 août 1971, Moktar Ould Daddah est élu président de la République pour un troisième mandat.
an 1971-1972 : Namibie - Entre décembre 1971 et juin 1972, des milliers d'ouvriers ovambos se mettent en grève, faisant la preuve de leur importance et de leur influence sur l'économie du territoire. La réaction du gouvernement sud-africain est brutale. Il est décidé le rapatriement de tous les Ovambos grévistes dans leur homeland et l'interdiction des réunions politiques des partis comme la SWAPO interne ou le Parti démocratique coopératif, tous deux impliqués dans le mouvement social. Le gouvernement entreprend cependant des réformes et abroge la loi de 1920 dite « maîtres et serviteurs ». C'est dans ce contexte que l'Organisation des Nations unies tente de renouer avec le gouvernement de Pretoria. En mars 1972, le Secrétaire général des Nations unies, Kurt Waldheim, se rend dans le Sud-Ouest Africain / Namibie (nom usuel depuis 1968) et prend contact avec les autorités locales et les représentants des mouvements politiques.
an 1971 : Ouganda - Le 25 janvier 1971, Idi Amin Dada prend le pouvoir lors d'un coup d'État. Ce qui entraînera le départ des indiens qui tenaient les commerces.
an 1971 : Sénégal - Février 1971 : Visite à Dakar du président de la république française, Georges Pompidou.
2 novembre 1971 : Le président Léopold Sedar Senghor se rend en Israël et en Egypte, avec trois autres chefs d’état africains, pour se poser en médiateur du conflit au Moyen-Orient.
an 1971 : Soudan - Le 19 juillet 1971, une tentative de coup d'État montée contre Nimeiry et attribuée aux communistes échoue. Nimeiry décide alors d'écraser définitivement le parti communiste soudanais.
an 1971 : Zambie - En 1971, la constitution est amendée avec l'adoption du principe d'une démocratie participative à parti unique. Kaunda rejette le tribalisme et tente d'unifier plus de 72 tribus sous la devise « Une Zambie, une nation ». Il est perçu comme un chef d’État modéré, défenseur du multiracialisme, et a toujours espéré une société pacifique qui accueillerait aussi bien les Africains blancs que les Noirs.
Au moment de son indépendance, les caisses de l'État zambien sont vides et le système éducatif presque inexistant. Les mines et le chemin de fer sont nationalisés. La nationalisation des mines de cuivre, qui représentaient 90 % des recettes en devises du pays, a coïncidé avec une crise énergétique mondiale et une chute des prix du cuivre qui sont à l'origine d'une spirale de la dette dont le pays ne parviendra jamais à sortir. Des projets d'industrialisation sont menés en coopération avec la Chine, dont l'emblématique « Tanzam », la ligne ferroviaire reliant le pays au port de Dar es Salam en Tanzanie, et le barrage de Kafue Gorge pour ne plus dépendre du charbon rhodésien.
Dans les années 1970, la Zambie est une base arrière des mouvements de libération et de guérilla de Rhodésie du Sud, de Namibie et d'Afrique du Sud.
an 1972-1990 : Bénin (anc. Dahomey) - Mais le 26 octobre 1972, le commandant Mathieu Kérékou prend le pouvoir et établit un gouvernement militaire révolutionnaire. Le 30 novembre 1975, le pays devient la République populaire du Bénin, adhère au marxisme-léninisme et le Parti de la révolution populaire du Bénin (PRPB) est créé.
Le régime de la République populaire du Bénin connaît des transformations importantes au cours de son existence : une brève période nationaliste (1972-1974), une phase socialiste (1974-1982) enfin une étape comportant une ouverture vers les pays occidentaux et le libéralisme économique (1982-1990).
En 1974, sous l'influence de jeunes révolutionnaires – les « Ligueurs » – le gouvernement engagea un programme de nature socialiste : nationalisation des secteurs stratégiques de l'économie, réforme du système éducatif, mise en place de coopératives agricoles et de nouvelles structures d'administration locale, lancement d'une campagne d'éradication des « forces féodales » dont notamment le tribalisme. Une nouvelle constitution est adoptée le 9 septembre 1977 et restera en vigueur jusqu’en 1990. L'État dirige tous les secteurs de l’économie, conduit la réforme agraire et développe l’industrialisation.
Dans les années 1980, la situation économique du Bénin est de plus en plus critique. Le pays connaît des taux de croissance économique élevés (15,6 % en 1982, 4,6 % en 1983 et 8,2 % en 1984) mais la fermeture par le Nigeria de sa frontière de sa frontière avec le Bénin entraine une chute brutale des revenus douaniers et fiscaux. L'État n'est plus en mesure de payer les salaires des fonctionnaires. L'ancien président Émile Derlin Zinsou caractérisera le Bénin après ces dix-sept années de « pays sans industrie mais gouverné au nom de la classe ouvrière », de « Roumanie sans exportations, de Bohême sans usines, de Pologne sans charbon, de Prusse sans discipline ».
an 1972 : Burundi - Jusqu'en 1972 la jeune armée burundaise est composée de Hutus et de Tutsis, depuis l'homme de troupe jusqu'aux officiers supérieurs. Le 29 avril 1972, des groupes hutus sous la houlette de l'organisation UBU, Umugambwe w'Abakozi b'Uburundi ou Parti des Travailleurs du Burundi, tentent de prendre le pouvoir tout en éliminant les Tutsis. Aussitôt l'insurrection déclenchée, l'ex-roi Ntare V est assassiné, ce qui met fin à toute possibilité de retour à la monarchie, puisque Ntare Ndizeye était le dernier mâle de la dynastie Ganwa et donc le seul prétendant légitime au trône. Les insurgés sont réprimés avec une grande férocité, au prix du massacre d'environ 100 000 personnes. Certaines organisations suggèrent que le nombre de victimes aurait atteint 200 000 voire 300 000, mais selon la seule étude démographique viable qui ait été faite sur le nombre de victimes de cette tragédie, en appliquant l'estimation la plus maximaliste, on atteindrait un maximum de 93 600 morts.
L'organisation et la planification des massacres de Tutsis étant l'œuvre d'officiers et sous-officiers de l'armée, une épuration aveugle est faite dans les rangs de ceux-ci après les massacres qui durent deux semaines. Les partis politiques hutus souhaiteraient que cet événement soit qualifié officiellement de génocide. Cependant, les organisations des rescapés tutsis de 1972 considèrent que cette thèse du « double génocide » tendrait à banaliser le plan d'extermination initial visant les Tutsis, et rappellent que l'organisation UBU revendiquait avoir appelé les Hutus à massacrer les Tutsis jusqu'aux fœtus
an 1972 : Cameroun - Le 20 mai 1972, un référendum conduit à un État unitaire et met fin au fédéralisme.
En 1972, la république fédérale est remplacée par un État unitaire. Le Cameroun devient un pays producteur de pétrole en 1977. Prétendant vouloir faire des réserves pour les temps difficiles, les autorités gèrent les recettes pétrolières « hors budget » dans la plus totale opacité (les fonds sont placés sur des comptes parisiens, suisses et new-yorkais). Plusieurs milliards de dollars sont ainsi détournés au bénéfice de compagnies pétrolières et de responsables du régime. L'influence de la France et de ses 9 000 ressortissants au Cameroun reste considérable. La revue African Affairs note au début des années 1980 qu'ils « continuent à dominer presque tous les secteurs clés de l'économie, à peu près comme ils le faisaient avant l'indépendance. Les ressortissants français contrôlent 55 % du secteur moderne de l'économie camerounaise et leur contrôle sur le système bancaire est total.
an 1972 : Cap-Vert - En 1972, les troupes du PAIGC contrôlent la plus grande partie du territoire de la Guinée portugaise, malgré la présence de soldats portugais, mais l'organisation ne parvient pas à s'emparer des îles du Cap-Vert. En 1972, les Nations unies finissent par considérer le PAIGC comme « véritable et légitime représentant des peuples de la Guinée et du Cap-Vert ».
an 1972-1974 : Archipel des Comores - Le 25 août 1972, le Comité spécial de la décolonisation de l'Organisation des Nations unies inscrit l'archipel des Comores à sa liste des territoires devant accéder à l'autodétermination. Le 22 décembre des élections sont favorables aux indépendantistes. Le 15 juin 1973, la France et les Comores signent des accords relatifs à l'accession à l'indépendance. D'un commun accord, dans un objectif d'indépendance concerté, la France propose un référendum d'autodétermination. Le 22 décembre 1974, la France organise aux Comores une consultation référendaire.
an 1972-1974 : Érythrée - Des disputes internes au FLE à propos des tactiques et stratégies à adopter aboutissent à la scission du FLE et à la fondation du Front populaire de libération de l'Érythrée (FPLE), mouvement multi-ethnique dirigé par des dissidents chrétiens parlant le tigrinya, langue majoritaire en Érythrée. Les deux mouvements s'affrontent sporadiquement entre 1972 et 1974. Le combat pour l'indépendance se poursuit après la chute de Sélassié, à la suite du coup d'État de 1974 en Éthiopie, et l'accession au pouvoir du Derg, junte militaire pseudo-marxiste avec Mengistu Haile Mariam à sa tête. À la fin des années 1970, le FPLE devient le principal groupe de lutte contre le gouvernement éthiopien, avec le futur président Issayas Afeworki à sa tête.
an 1972 : Eswatini (Swaziland) - Le royaume du Swaziland et le changement de nom en Eswatini - En 1972, le NNLC remporta 3 sièges au parlement, aux dépens notamment du prince Mfanabilisi Dlamini, le chef de la lignée la plus importante de la famille royale. L'année suivante, en réaction, le roi mène un coup d'État contre le parlement, dissout les partis politiques et proclama l'état d'urgence. La constitution est suspendue. Jusqu'en 1978, Sobhuza II gouverne par décret depuis sa résidence royale de Lobamba. Il introduit une nouvelle constitution, qui reste lettre morte, où l'essentiel du pouvoir est concentré entre les mains du monarque alors que la désignation des membres du gouvernement et du parlement, au rôle essentiellement administratif, relève des structures traditionnelles.
an 1972 : Ghana - Malgré un large soutien populaire lors de sa création et de fortes relations à l'étranger, le gouvernement de Busia tombe, victime d’un nouveau coup d’État de l’armée, après vingt-sept mois d’activité, le 13 janvier 1972 et alors qu’il est en traitement dans une clinique londonienne. Le lieutenant-colonel Ignatius Kutu Acheampong, temporairement commandant de la Première Brigade autour d'Accra, mène ce coup d'état, sans effusion de sang , mettant ainsi fin à la Seconde République, et s’installe au pouvoir.
an 1972 - 1975 : Mayotte - Émancipation des Comores et dissidence de Mayotte
Les élections du 3 décembre 1972 confirment le succès de deux partis majoritaires, œuvrant à l'indépendance. La France accepte les négociations mais se trouve embarrassée car, seule île de l'archipel affirmant une dissidence marquée vis-à-vis de ces voisines depuis 1958, Mayotte a voté négativement à la Consultation pour l'indépendance pour conserver ses liens avec la France. Les autres îles déclarent leur indépendance. Le vote est de 63,8 % en faveur de la conservation de ce lien, alors qu'il n'est que de 0,6 % dans les autres îles (soit 99,4 % contre).
La société mahoraise, plus encore que celles des autres îles des Comores, est très peu influencée par le mode de vie occidental et vit au rythme de la vie musulmane traditionnelle. Mais les causes réelles de ce puissant refus sont triples :
-
une véritable crainte de l'expansionnisme anjouanais, associé aux humiliations de la période coloniale préservées par une forte mémoire orale séculaire,
-
le transfert de la capitale à Moroni en 1958, effectivement réalisé en 1966, laissant dans un sordide abandon l'îlot de Dzaoudzi trop exigu pour les administrations et causant des pertes d'emplois en cascade dans une île à l'économie moribonde,
-
le statut des femmes dans la société mahoraise.
Jouant sur les rancœurs exacerbées, le Mouvement Populaire Mahorais n'a pas de mal à mobiliser pour la préservation d'une légitime tutelle française. Il bénéficie de surcroît de l'incroyable enthousiasme des femmes mahoraises et de leurs généreuses associations pleinement actives à défendre cette dissidence.
Hésitante devant les pressions internationales attisées par la République des Comores qui s'estime flouée d'une part de son territoire naturel, la République française accepte de reconduire un nouveau scrutin pour Mayotte. Le débat à l'Assemblée nationale suscite une motion politique du Rassemblement pour la République qui, voté le 3 juillet 1975, propose une loi de validation d'autonomie île par île.
Mais tout s'accélère : pressé par l'opinion publique comorienne, le président Ahmed Abdallah proclame l'indépendance le 6 juillet 1975. Le mouvement mahorais entre en dissidence, s'affirme le seul légaliste, et condamne la sortie du cadre des discussions. Un coup d'État organisé le 3 août met en place un gouvernement présidé par le Jaffar, homme de paille d'Ali Soilih. En septembre, les révolutionnaires capturent à Anjouan le président Ahmed Abdallah en résistance et contrôlent l'essentiel des trois îles. Des négociations commencent toutefois à Paris, mais en octobre 1975, l'ONU reconnaît l'État comorien dans les limites définies avant 1975, mettant un point final à la négociation laborieusement ouverte. Par peur de représailles sur ses ressortissants, la France décide de retirer tous ses agents et fonctionnaires des Comores. Les services restent sans techniciens, les lycées vides d'enseignants. Alors qu'ils partent dans l'anonymat ou sous des huées organisées d'insultes dans le reste des Comores, Mahorais et Mahoraises les retiennent et s'opposent à ceux qui voudraient abandonner, par crainte des troubles à venir, le service public. Le 21 novembre 1975, Ali Soilih organise une marche rose, pacifique, pour reprendre Mayotte mais échoue à convaincre les dissidents mahorais.
an 1972 : Mozambique - La guerre d'indépendance (1964-1974)
En 1972, un « mouvement national de résistance » est créé par les services secrets de Rhodésie, avec pour mission de s'attaquer aux bases arrière des mouvements nationalistes de Rhodésie.
an 1972-1975 : Nigéria - La société nigériane sous le régime de Yakubu Gowon
La rébellion du Biafra réduite, le général et chef de l'État Gowon fait tout pour mettre fin aux massacres et aux règlements de comptes post-guerre civile. Placé à la tête d'un Conseil militaire suprême composé des gouverneurs militaires des douze États, il promet de rétablir la démocratie et de lever l'interdiction des activités politiques . En 1972, le Nigeria adopte aussi la conduite à droite, comme ses voisins. Le 1er octobre 1974, Yakubu Gowon revient en arrière sur sa promesse de rétablir la démocratie, devant, dit-il, « des signes de rivalités politiques ». Il s'engage par contre à lutter davantage contre la corruption et à prendre des mesures en faveur de l'agriculture. Mais ça ne suffit pas. Il est destitué le 29 juillet 1975, sans un coup de feu, alors qu'il est à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine à Kampala.
Le pays, dont le chef de l'État vient d'être destitué, est devenu le huitième producteur mondial de pétrole, ce qui génère un excédent de sa balance commerciale de plus de 4 milliards de nairas. Son produit national brut croit également. Ces revenus favorisent une large corruption.
an 1972-1973 : Rwanda - Fin 1972 et début 1973, le pouvoir de Grégoire Kayibanda est menacé par des politiciens et des militaires issus du nord du pays qui lui reprochent une faible riposte envers les Tutsi de l'extérieur. Kayibanda tente en vain de créer une unité nationale tout en se voulant ouvert au dialogue avec les Tutsi exilés mais son pouvoir semble fortement affaibli par ses opposants. Les militaires nordistes commencent alors une campagne de diabolisation à son égard et profitent de la peur provoquée dans la population rwandaise par les massacres de Hutu qui ont eu lieu au Burundi voisin en 1972. En juillet 1973, à la suite d'une violente campagne anti-tutsi orchestrée par l'état major de l'armée rwandaise dans les institutions scolaires, une nouvelle vague de Tutsi prend le chemin de l'exil. Le 5 juillet, un coup d'État dirigé par le général major Juvénal Habyarimana, également ministre de la Défense, renverse le président Grégoire Kayibanda qui mourra en détention.
an 1972 : Soudan - En 1972, la signature des accords d'Addis Abeba entre l'Etat soudanais et les dirigeants du muvement rebelle dans le Sud accorde une autonomie, mais pas l'indépendance, aux trois provinces méridionales et met fin à la Première guerre civile soudanaise.
an 1973- 1974 : Cap-Vert - Amílcar Cabral est assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry par des membres de la branche militaire du parti, en relation avec des agents des autorités portugaises La Guinée déclare son indépendance en 1973 et est reconnue indépendante de jure en septembre 1974 par le Portugal : elle devient la Guinée-Bissau et a pour premier dirigeant Luís Cabral, le demi-frère du leader indépendantiste capverdien. Déstabilisé par des problèmes politiques internes (la Révolution des œillets d'avril 1974), le Portugal ne peut s'opposer au retour en force du PAIGC au Cap-Vert, soutenu depuis la Guinée-Bissau par Cabral. En décembre 1974, le PAIGC et le Portugal signent un accord prévoyant la constitution d'un gouvernement de transition composé de Portugais et de Capverdiens. Le 30 juin 1975, les Capverdiens élisent une Assemblée nationale à laquelle le Portugal reconnaît la souveraineté le 5 juillet. Aristides Pereira, figure du mouvement anti-colonial et dirigeant du PAIGC, devient le premier président du pays.
an 1973 : Mauritanie - En 1973, la Mauritanie sort du franc CFA et crée sa monnaie nationale, l’ouguiya. La Mauritanie adhère à la Ligue arabe.
an 1973 : Namibie - En 1973, seulement trois des six districts autonomes prévus par le rapport Odendaal et dirigés par un conseil tribal sont créés (Ovamboland, Kavangoland et Caprivi oriental). En fait, des désaccords opposent les autorités tribales au gouvernement sud-africain sur les pouvoirs de compétence déléguée et le maintien de la discrimination par le ministère des affaires bantoues. En juillet, les élections de l'assemblée législative tribale de l'Ovamboland sont remportées par le Parti de l'indépendance de l'Ovamboland mais le taux de participation n'est que 3 %, les électeurs ayant répondu à l'appel au boycott lancé par la SWAPO et le Parti démocratique coopératif. Les autorités tribales et sud-africaines réagissent à ce camouflet en faisant arrêter les dirigeants de la SWAPO interne, et pour les autorités tribales en faisant fouetter les opposants en place publique (sur ordre du ministre ovambo Filemon Elifas) et en multipliant les brimades.
Le 12 septembre 1973, dans sa résolution no 3111, l'Assemblée générale des Nations unies désigne la SWAPO comme « représentant unique et authentique du peuple namibien ». Cette résolution est très mal perçue par les autres mouvements politiques namibiens, notamment par le mouvement de Clemens Kapuuo qui accuse la SWAPO de tribalisme et lui reproche de n'avoir jamais participé à la moindre guerre contre l'occupant allemand.
À ce moment-là, percevant les divisions au sein même des mouvements d'opposition du Sud-Ouest Africain, le premier ministre sud-africain John Vorster abandonne les objectifs du rapport Odendaal et décide dans le cadre de sa politique de détente avec les pays africains de s'engager dans la voie de l'autodétermination du territoire « y compris celle de l'indépendance. Il va ainsi faire de la Namibie un terrain de négociations politiques dont il réutilisera les résultats pour la Rhodésie dirigée par Ian Smith (des résultats qui servirent de modèle pour l'Afrique du Sud elle-même dans les années 1990).
an 1974-1975 : Angola - Le 25 avril 1974, un groupe de capitaines de l'armée portugaise, regroupés dans le Mouvement des Forces armées, et qui avaient participé à la guerre coloniale, prend le pouvoir à Lisbonne, où ils sont largement soutenus par la population et renversent le régime dictatorial de Marcelo Caetano. Cette révolution, connue sous le nom de « révolution des Œillets », permet la fin de la guerre coloniale entre le Portugal et ses colonies. En janvier 1975, les nouvelles autorités portugaises réunissent les représentants des trois mouvements indépendantistes pour établir les paramètres du partage du pouvoir dans l'ex-colonie entre ces mouvements et l'indépendance de l'Angola.
Malgré les accords d'Alvor, la transition de l'Angola vers l'indépendance ne se fait pas de façon pacifique. Dans plusieurs quartiers de Luanda, les civils noirs commencent à s'en prendre aux colons, et les troupes des trois mouvements commencent à se battre les unes contre les autres pour le contrôle de la capitale. La ville sombre alors dans l'émeute et les pillages. Entre janvier et novembre 1975, les troupes portugaises repartent précipitamment vers Lisbonne, avec 300 000 colons dans ce qui fut l'un des plus grands ponts aériens au monde. Au cours de l'été 1975, le MPLA remporte la guerre des villes et expulse les deux autres mouvements (FNLA et UNITA) de la capitale et des principales villes.
an 1974-1975 : Afrique du Sud - Du côté de l'opposition parlementaire, le parti uni, qui a voté en faveur de plusieurs des lois destinées à maintenir l'ordre public et s'est à plusieurs reprises montré solidaire du parti national face aux critiques internationales, est victime de divisions internes. Peu convaincu de la politique prônée en matière raciale, consistant à créer un État sud-africain décentralisé sous forme de fédération de communautés ethniques et géographiques afin de faciliter les coopérations entre les divers groupes raciaux du pays, Harry Schwarz, le chef de file du parti uni au Transvaal signe avec le chef Mangosuthu Buthelezi, le 4 janvier 1974, la Déclaration Mahlabatini en faveur de l'établissement d'une société non raciale en Afrique du Sud. Pour la première fois dans l'histoire sud-africaine contemporaine, un document écrit atteste d'une communauté d'idées et de vision politique entre des dirigeants politiques blancs et noirs. Si la déclaration ravit les libéraux des différents mouvements politiques du pays ainsi que la presse libérale, elle met en colère les membres conservateurs du parti uni et suscite la condamnation et les moqueries du parti national et de sa presse. Lors des élections d'avril 1974, 6 députés progressistes rejoignent Helen Suzman sur les bancs de l'assemblée. Alors que ces derniers sont principalement élus au détriment de députés du parti uni, Schwarz et ses partisans réformistes sont expulsés du parti uni. Après avoir créé un parti réformiste, Schwarz et ses alliés fusionnent leur mouvement avec le parti progressiste pour former le parti progressiste réformiste, dorénavant dotés de 11 élus au parlement. Dirigé par Colin Eglin, le parti progressiste réformiste entend supplanter le parti uni et propose l’abolition des lois de l'Apartheid ainsi que des réformes constitutionnelles pour permettre une évolution fédérale de l'Afrique du Sud et le partage du pouvoir avec la population noire du pays. Il n'entend pas cependant instaurer le suffrage universel mais reste favorable à une franchise électorale basée sur des critères d'instructions et des critères de revenus. Le 27 septembre 1975, les dirigeants du parti progressiste réformiste signent à Johannesbourg une déclaration conjointe de principes avec les dirigeants des bantoustans du KwaZulu, du Gazankulu, du Lebowa et du QwaQwa ainsi qu'avec les dirigeants du parti travailliste des métis et du congrès indien. Dans cette déclaration, ils déclarent vouloir travailler ensemble pour aboutir à un changement pacifique en Afrique du Sud et en appellent à une convention nationale représentative pour établir une nouvelle Afrique du Sud protectrice des droits des individus et des groupes, dont le gouvernement serait basé sur les territoires et non sur le statut racial.
Vorster entreprend une politique de détente avec les pays africains comme Madagascar et noue des relations suivies avec de nombreux chefs d'état africains comme l'Ivoirien, Félix Houphouët-Boigny ou le Zambien, Kenneth Kaunda. Les diplomates du Malawi sont exemptés de l'application des lois d'apartheid tandis que le premier ministre du Lesotho, Joseph Leabua Jonathan, est reçu au Cap à déjeuner.
Si cette politique d'ouverture à l'Afrique suscite le plus grand intérêt, l'ambition de faire de l'Afrique du Sud une superpuissance régionale se heurte au contexte géopolitique de l'époque alors que les relations de l'Afrique du Sud avec l'ONU se détériorent. Le mandat sud-africain sur le Sud-Ouest africain est révoqué par l'Assemblée générale des Nations unies en 1968, la présence sud-africaine en Namibie est déclarée illégale par le Conseil de sécurité des Nations unies en 1970, la révocation du mandat étant confirmée par un avis consultatif de la Cour internationale de justice le 21 juin 1971. L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Nations unies, Pik Botha, est exclu par l'Assemblée générale des Nations unies en 1974.
Au Sud-Ouest africain, contrôlé de facto par l'Afrique du Sud, l'apartheid est également la politique en vigueur. Un rapport gouvernemental y prévoit l'instauration de dix bantoustans dont six ayant vocation à devenir autonomes, représentant plus des deux tiers de la population.
Dans ce cadre, une autonomie limitée est accordée à la zone tribale de l'Ovamboland. Le 12 septembre 1973, la désignation, par l'Assemblée générale des Nations unies, de la SWAPO, le mouvement local anti-apartheid, comme représentant unique et authentique du peuple namibien, provoque des divisions au sein des divers mouvements d'opposition du Sud-Ouest Africain qui n'apprécient guère le geste. John Vorster en profite pour s'engager dans la voie de l'autodétermination du territoire « y compris celle de l'indépendance. » En novembre 1974, l'ensemble des autorités du territoire, y compris les autorités tribales et les représentants des partis politiques autochtones, sont invités à déterminer leurs avenirs politiques. Toutefois l'invitation est déclinée par la SWAPO (parti politique qui est resté légal sur le territoire). Les pourparlers constitutionnels de la Conférence de la Turnhalle s'étalent de septembre 1975 à octobre 1977 et débouchent sur les premières élections multiraciales su Sud-Ouest Africain (boycottées par la SWAPO) en décembre 1978. Elles sont remportées par l'Alliance démocratique de la Turnhalle (82 % des voix) alors que les lois d'apartheid sur les mariages mixtes, sur l'immoralité et les contrôles intérieurs, à l'exception de la zone diamantifère, sont supprimées.
En Rhodésie du Sud, dirigée par une minorité blanche anglophone, l'Afrique du Sud engage des forces militaires au côté de l'armée rhodésienne. John Vorster entreprend un rôle de médiation entre le gouvernement de Ian Smith et les mouvements noirs de libération nationale car l’État tampon de Rhodésie du Sud apparait de plus en plus comme un fardeau politique et économique pour son puissant voisin.
Lorsque la Rhodésie bloque sa frontière avec la Zambie, menaçant indirectement les intérêts économiques sud-africains, un pont aérien doit être mis en place entre la Zambie et l’Afrique du Sud pour le transport de matériel d’exploitations des mines. En 1975, avec le soutien des Britanniques et des Américains, John Vorster fait pression sur Ian Smith pour qu'il accepte de négocier le principe d'un transfert du pouvoir à la majorité noire. Une rencontre entre tous les protagonistes du conflit est organisée aux Chutes Victoria, à la frontière entre la Zambie et la Rhodésie, le 25 août 1975. Mais la conférence est un échec.
an 1974-1975 : Angola - Le 25 avril 1974, un groupe de capitaines de l'armée portugaise, regroupés dans le Mouvement des Forces armées, et qui avaient participé à la guerre coloniale, prend le pouvoir à Lisbonne, où ils sont largement soutenus par la population et renversent le régime dictatorial de Marcelo Caetano. Cette révolution, connue sous le nom de « révolution des Œillets », permet la fin de la guerre coloniale entre le Portugal et ses colonies. En janvier 1975, les nouvelles autorités portugaises réunissent les représentants des trois mouvements indépendantistes pour établir les paramètres du partage du pouvoir dans l'ex-colonie entre ces mouvements et l'indépendance de l'Angola.
Malgré les accords d'Alvor, la transition de l'Angola vers l'indépendance ne se fait pas de façon pacifique. Dans plusieurs quartiers de Luanda, les civils noirs commencent à s'en prendre aux colons, et les troupes des trois mouvements commencent à se battre les unes contre les autres pour le contrôle de la capitale. La ville sombre alors dans l'émeute et les pillages. Entre janvier et novembre 1975, les troupes portugaises repartent précipitamment vers Lisbonne, avec 300 000 colons dans ce qui fut l'un des plus grands ponts aériens au monde. Au cours de l'été 1975, le MPLA remporte la guerre des villes et expulse les deux autres mouvements (FNLA et UNITA) de la capitale et des principales villes.
Le 11 novembre 1975, jour convenu pour l'indépendance, les autorités portugaises descendent pour la dernière fois le drapeau portugais du Palais du gouverneur civil et le soir même Agostinho Neto proclame l'indépendance de la république populaire d'Angola, au son des combats à quelques kilomètres de Luanda. Le pays est déjà entré dans la guerre civile qui ne se terminera qu'avec les accords de Bicesse, le 31 mai 1991.
En 1975, le premier ministre sud-africain John Vorster et son chef des services de renseignements, Hendrik van der Bergh, envisagent une implication minimum et circonstanciée des forces armées sud-africaines pour installer un gouvernement pro-occidental en Angola tandis que Pieter Willem Botha, ministre de la défense, et le chef des armées, Magnus Malan, convaincus de l'existence d'un plan global soviétique dont l'objectif serait la prise de pouvoir en Afrique du Sud, se font les avocats d'une invasion du pays par les troupes sud-africaines pour chasser le MPLA de Luanda. Finalement, la première option est approuvée et, en août 1975, avec le soutien du gouvernement américain du président Gerald Ford, les troupes sud-africaines envahissent le sud de l'Angola jusqu'à atteindre quelques semaines plus tard la banlieue de Luanda.
De leur côté, les troupes zaïroises, sous le gouvernement de l'autocrate Mobutu Sese Seko, soutenu par la Belgique et les États-Unis, entrent également en Angola où ils soutiennent le FNLA contre le MPLA. Cette coalition menace de prendre Luanda. C’est alors que des milliers de soldats cubains affluent pour aider Neto et défont les troupes zaïroises. Les dirigeants du MPLA s’emparent alors de vastes contrées du pays mais ne parviennent pas à vaincre la guérilla de l'UNITA, tandis que le Zaïre se retire de la guerre privant le FNLA de son soutien. Ce mouvement perd alors toute importance dans la guerre.
Au mois de décembre, le congrès des États-Unis retire finalement son aide financière aux mouvements et aux troupes hostiles au MPLA alors que l'armée sud-africaine est aux portes de la capitale angolaise (les activités de la CIA en Angola (en) persisteront cependant jusque dans les années 2000). Furieux et humiliés par ce revirement, les sud-africains apparaissent alors comme les seuls coupables de l'invasion et sont obligés de se retirer du pays. Ils apporteront dorénavant une aide logistique au mouvement rebelle de l'UNITA de Jonas Savimbi afin notamment de protéger la frontière nord de leur colonie du Sud-Ouest africain contre les infiltrations de la SWAPO, le mouvement de libération nationale de la Namibie.
L'Angola s’enfonce dans une guerre civile ethnique, entre le MPLA, soit les métis et les citadins soutenus par l’Union soviétique et Cuba, et d’autre part, l'UNITA, un mouvement regroupant surtout les Ovimbundus (40 % de la population) et appuyé par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud. Un autre mouvement le FNLA, attaquant le MPLA par le nord en venant du Zaïre, approche de la capitale soutenu par des troupes de Mobutu dont la direction tactique et logistique est soutenue par la Belgique et les États-Unis. Mais la guerre s’enracine dans la différence de développement entre la côte occidentalisée et moderne et l’arrière-pays moins industrialisé et resté beaucoup plus africain et où le sentiment clanique est encore omniprésent en opposition avec les stratégies des partis fondées sur des doctrines politiques.
Alors que les forces du MPLA sont appuyées par des soldats cubains (commandées par le général Arnaldo Ochoa, exécuté à Cuba plus tard pour haute trahison et trafic de drogue en 1989) et l’aviation soviétique, celles de l’UNITA le sont par des soldats sud-africains.
Neto lance une opération militaire au Zaïre voisin dans la région du Shaba et fait noyer des mines afin de nuire à l’économie du puissant voisin. Les troupes zaïroises se retirent alors qu'une tension se développe entre Mobutu et les Belgo-Américains. Le FNLA perd alors toute importance et son chef Holden Roberto, père historique du mouvement indépendantiste, doit s'exiler au Zaïre.
À la mort de Neto en 1979, Dos Santos prend le pouvoir à Luanda. Politicien habile, il désamorce lentement la guerre en se tournant vers l’Occident, en écartant l’aile radicale de son parti. Les secteurs agricole et minier sont ravagés par la guerre qui fait venir de nombreux réfugiés à Luanda, le pétrole reste la seule source de richesse sur laquelle repose la fortune des hauts fonctionnaires du MPLA, tandis que l’UNITA se finance grâce au trafic de diamants. Même indépendant le pays est encore dépendant du Portugal notamment en matière d’éducation ; si l’alphabétisation progresse c’est grâce aux ONG portugaises et brésiliennes qui développent aussi pour la première fois l’enseignement secondaire et universitaire.
an 1974 - 1990 : Bénin (anc. Dahomey) - République populaire du Bénin (1974-1990)
En novembre 1974, Mathieu Kérékou impose le marxisme-léninisme comme idéologie officielle de l'État. En 1975, pour réduire le poids politique du Sud, le nom de Dahomey est symboliquement abandonné pour celui de Bénin, du nom du royaume qui s'était autrefois épanoui au Nigeria voisin. Le pays prend le nom officiel de république populaire du Bénin.
Le régime de la république populaire du Bénin connut des transformations importantes au cours de son existence : une brève période nationaliste (1972-1974) ; une phase socialiste (1974-1982) ; et une phase comportant une ouverture vers les pays occidentaux et le libéralisme économique (1982-1990).
De vastes programmes de développement économique et social sont mis en place, mais les résultats sont mitigés. En 1974, sous l'influence de jeunes révolutionnaires – les « Ligueurs » – le gouvernement engagea un programme de nature socialiste : nationalisation des secteurs stratégiques de l'économie, réforme du système éducatif, mise en place de coopératives agricoles et de nouvelles structures d'administration locale, lancement d'une campagne d'éradication des « forces féodales » dont notamment le tribalisme. Le régime interdit les activités de l'opposition. Élu président par l'Assemblée nationale révolutionnaire en 1980, réélu en 1984, Mathieu Kérékou échappe à trois tentatives de coup d'État en 1988.
Dans les années 1980, la situation économique du Bénin est de plus en plus critique. Le pays connait des taux de croissance économique élevés (15,6 % en 1982, 4,6 % en 1983 et 8,2 % en 1984) mais la fermeture par le Nigeria de sa frontière avec le Bénin entraine une chute brutale des revenus douaniers et fiscaux. L'État n'est plus en mesure de payer les salaires des fonctionnaires. En 1987, les plans du FMI imposent des mesures économiques draconiennes : prélèvements supplémentaires de 10 % sur les salaires, gel des embauches, mises à la retraite d'office. En 1989, un nouvel accord avec le FMI sur un programme d'ajustements des structures économiques déclenche une grève massive des étudiants et des fonctionnaires. Le Bénin, avec l'appui décisif de la France à laquelle le président Kérékou a décidé de faire confiance, entame une transition démocratique parfaitement réussie conjointement avec le processus de réformes économiques.
Après la conférence des forces vives de la nation dirigée par le Prélat catholique Isidore De Souza, un gouvernement de transition, mis en place en 1990, ouvre la voie au retour de la démocratie et du multipartisme. Le Premier ministre, Nicéphore Soglo, bat Mathieu Kérékou à l'élection présidentielle du 24 mars 1991.
an 1974-1980 : Bénin - En novembre 1974, Mathieu Kérékou impose le marxisme-léninisme comme idéologie officielle de l'État. En 1975, pour réduire le poids politique du Sud, le nom de Dahomey est symboliquement abandonné pour celui de Bénin, du nom du royaume qui s'était autrefois épanoui au Nigeria voisin. Le pays prend le nom officiel de république populaire du Bénin.
Le régime de la République populaire du Bénin connut des transformations importantes au cours de son existence : une brève période nationaliste (1972-1974) ; une phase socialiste (1974-1982) ; et une phase comportant une ouverture vers les pays occidentaux et le libéralisme économique (1982-1990.
De vastes programmes de développement économique et social sont mis en place, mais les résultats sont mitigés. En 1974, sous l'influence de jeunes révolutionnaires – les « Ligueurs » – le gouvernement engagea un programme de nature socialiste : nationalisation des secteurs stratégiques de l'économie, réforme du système éducatif, mise en place de coopératives agricoles et de nouvelles structures d'administration locale, lancement d'une campagne d'éradication des « forces féodales » dont notamment le tribalisme. Le régime interdit les activités de l'opposition. Élu président par l'Assemblée nationale révolutionnaire en 1980, réélu en 1984, Mathieu Kérékou échappe à trois tentatives de coup d'État en 1988.
an 1974-1975 - Cap Vert - La chute du régime de Salazar et la révolution des Œillets, en avril 1974, sont l’occasion de troubles accrus au Cap-Vert et le nouveau gouvernement portugais entame des négociations avec le PAIGC. L’indépendance est acquise le 5 juillet 1975.
an 1974-1976 : Archipel des Comores - En 1974, la France organise un référendum d'autodétermination dans l'archipel : trois des quatre îles optent pour l'indépendance (Grande Comore, Anjouan et Mohéli) et forment en 1975 un État souverain appelé initialement État comorien. Mayotte devient une collectivité territoriale10, en dépit de plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui se sont prononcées en faveur de l'unité et de l'intégrité du territoire des Comores11,12. Ces résolutions ne sont pas contraignantes. La France organisant un nouveau référendum sur la seule île de Mayotte le 8 février 1976, la Tanzanie dépose un projet de résolution auprès du Conseil de sécurité des Nations-Unies, appelant la France à ne pas organiser ce référendum et à respecter l'intégrité du territoire comorien. Le 6 février 1976, la France use alors de son droit du veto dont elle dispose en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations unies.
an 1974-1978 : Érythrée - En 1974, débute la révolution éthiopienne. La junte militaire Derg qui gouverne l'Éthiopie après la chute du négus Haïlé Sélassié doit faire face à trois conflits : la guerre érythréenne de sécession, la guerre civile éthiopienne et la guerre de l'Ogaden. Elle est aidée par l'Union soviétique, notamment après 1978 et la défaite des somaliens.
an 1974 : Éthiopie - La Révolution de l'armée
Face à un mouvement populaire d'ambition révolutionnaire touchant tous les secteurs de la société, le régime ne peut plus compter que sur ses forces armées. Vers la fin du mois d'avril 1974, un comité de représentants élus comprenant tous les échelons de l'armée se met en place sous le nom de Comité de Coordination des Forces armées, plus connu sous le nom de Derg (Comité en amharique). Les ambitions du Derg sont initialement confuses : il rend initialement allégeance au Negusse Negest, effectue les arrestations ordonnées par le régime, et condamne les manifestations populaires progressistes. Le Derg présente sa propre liste de revendications au Premier ministre. Celle-ci ne clarifie pas sa direction qui reste assez confuse à cette époque, une confusion révélatrice, comme le note John Markasis, de l'incertitude du comité sur sa capacité à assumer le pouvoir. Le Derg pousse le Premier ministre à présenter sa démission le 22 juillet, remplacé par Mikael Imru.
Les intellectuels et universitaires éthiopiens continuent parallèlement leur offensive. L'abolition du régime féodal et l'indépendance face au capitalisme étranger sont définis comme les seules bases possibles d'un changement radical. Le Derg, dénoncé comme non représentatif135, masque initialement sa confusion. En août 1974, il se saisit de la première des demandes des contestataires : le renversement de Haile Sélassié. Le 12 septembre, l'annonce de sa déposition est faite dans tout le pays.
Le 15 septembre, le comité prend officiellement le nom de Provisional Military Administrative Council (PMAC), « Comité militaire administratif provisoire »
an 1974-1980 : Éthiopie - Le 12 septembre 1974, Haïlé Sélassié est déposé et arrêté, les anciens dignitaires sont emprisonnés, les grèves et manifestations sont interdites. Le Derg, la junte militaire, commence à s'installer au pouvoir. Les étudiants sont envoyés dans les provinces afin de mener des campagnes d'alphabétisation et diffuser la nouvelle idéologie, d'inspiration soviétique. Mais beaucoup y sont victimes des maladies et des bandes armées par les propriétaires terriens, hostiles au nouveau régime. Néanmoins, le taux d'alphabétisation passe de 5 % en 1974 à 35 % en 1981, ce qui a valu à l’Éthiopie la reconnaissance de l'UNESCO qui lui a décerné son prix en 1980.
L'État prend le contrôle partiel de l'économie, plusieurs entreprises sont nationalisées. En 1975, une réforme agraire est lancée. Les terres sont nationalisées, des coopératives de paysans sont mises sur pied, des terres sont distribuées à ceux qui n’en avaient pas avec une limite de taille par exploitation. Le Derg promet de faire de l’Éthiopie un État plurinational : « plus aucune nationalité ne dominera les autres ». Elle met en place un Institut des nationalités qui regroupait des géographes, des ethnologues, des économistes afin de mieux appréhender les caractéristiques de chaque ethnie. Les musulmans sont admis comme de véritables Éthiopiens pour la première fois dans l'histoire du pays et trois jours de fêtes musulmanes sont reconnus par l’État. Enfin, un grand parti unique est mis en place sur une base nationale et socialiste. Si le Derg arrive initialement à affirmer son autorité, les partis politiques civils réclament un transfert du pouvoir et le retour des militaires dans les casernes. Les deux principaux partis d'opposition sont le Meison et le Parti révolutionnaire du peuple éthiopien (PRPE). Les affrontements entre le deuxième parti et le régime vont dégénérer et de la fin 1976 à la fin 1978, le pays vit « deux années terribles ». Les confrontations sont particulièrement brutales et la répression accentue le radicalisme du régime. Les familles des membres du PRPE sont visées et la participation de jeunes écoliers aux côtés du PRPE conduit le Derg à massacrer des classes entières du 29 avril au 1er mai 1977, près d'un millier d'étudiants et lycéens sont assassinés après des mobilisations étudiantes contre le régime. Cette période de violence politique, surnommée Terreur rouge, a marqué les Éthiopiens, les rapprochant ainsi des autres peuples du bloc communiste. Les meurtres sont également courants au sein du Derg, où les rivalités entre personnes donnent lieu à des arrestations et à des fusillades. C'est finalement le lieutenant-colonel Mengistu Haile Mariam qui émerge au sein de la junte et qui dirige le pays à partir de 1977.
Cette même année 1977, le pays fait face à une offensive de l'armée somalienne qui envahit le territoire national en juillet. La guerre de l'Ogaden est déclenchée ; avec le soutien des pays communistes européens et de Cuba, l'Éthiopie remporte le conflit. Durant la guerre civile, les violences du régime touchent durement les civils et favorisent les séparatistes du Tigré et de l'Érythrée qui progressent : dans le nord du pays, le régime rencontre de réelles difficultés militaires. Alors que l'URSS, en pleines perestroïka et glasnost, n'est plus en mesure de soutenir le régime, la fin du Derg semble se rapprocher lorsque les deux principaux mouvements de guérilla, le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) et le Front populaire de libération de l'Érythrée (FPLE) coordonnent leurs opérations à partir du milieu des années 1980. Une série de victoires conduit le premier mouvement à élargir ses objectifs au sein de la coalition du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE), censé libérer tout le pays.
an 1974 : Guinée-Bissau - Après la révolution des Œillets en 1974, les Portugais quittent le pays qui devient indépendant. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert qui avait mené la lutte politique puis l'insurrection pour l'indépendance pendant 12 ans remporte les élections.
an 1974-1975 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
En 1974, après un coup d'État, Madère acquiert le statut de territoire autonome, ce qui lui retire la tutelle portugaise sans lui donner une indépendance totale. En 1976, le gouvernement et le système politique sont mis en place : un exécutif propre et une assemblée législative régionale les composent. Avec cette officialisation, Madère devient une région ultrapériphérique de l'Union européenne.
Le Front de Libération de l'Archipel de Madère (pt) (1975-1978, FLAMA), a réactivé un certain temps un sentiment indépendantiste ou au moins autonomiste.
an 1974 : Mali - Moussa Traoré fait approuver le 2 juin 1974 une nouvelle constitution créant la 2e république par référendum. Le Oui l’emporte par 99,71 % mais l’opposition qualifie ce référendum de « farce électorale »
an 1974 : Mauritanie - Le 28 novembre 1974, la société anonyme des mines de fer de Mauritanie (MIFERMA) est nationalisée et devient la Société nationale industrielle et minière (SNIM).
an 1974 : Mozambique - La guerre d'indépendance (1964-1974)
En avril 1974, le FRELIMO contrôle le nord du pays et la région de Tete, soit un tiers du territoire, tandis qu'au Portugal la révolution des Œillets met fin à la dictature salazariste. Le FRELIMO devient l'interlocuteur privilégié des Portugais bien qu'en quelques semaines une trentaine de partis politiques voient le jour au Mozambique. Le 7 septembre 1974, un accord est signé à Lusaka entre le Portugal et le FRELIMO, fixant un calendrier pour un cessez-le-feu et l'établissement d'un gouvernement provisoire en vue de la proclamation de l'indépendance du Mozambique.
Une partie des colons portugais est alors ulcérée de l'abandon annoncé de la colonie. Certains veulent prendre modèle sur la Rhodésie du Sud et, à l'instar de Ian Smith, faire déclarer unilatéralement l'indépendance. Une tentative de coup d'État mal préparée a alors lieu. Des colons s'emparent des locaux de la radio nationale, occupent le central téléphonique et libèrent les agents de la PIDE, la police secrète salazariste, arrêtés lors de la révolution des Œillets. Mais la majorité des colons se résigne en fait à l'arrivée du FRELIMO au pouvoir. Une grande majorité d'entre eux se résigne au départ et, en quelques mois, la population portugaise tombe de 200 000 à 80 000 personnes, alors que l'indépendance n'est toujours pas proclamée. Les derniers soubresauts ont lieu en octobre 1974. Certains des colons brûlent leurs propriétés en partant, la majorité vers l'Afrique du Sud et le Portugal. Au début des années 1990, il ne demeure plus que 7 000 Mozambicains d'origine portugaise vivant au Mozambique, principalement à Maputo.
an 1974 : Namibie - Le 24 avril 1974, les blancs de Namibie sont invités à voter pour l'élection de l'assemblée législative du Sud-Ouest Africain, cette élection qui a lieu le même jour que les élections générales sud-africaines de 1974 seront remportées par le Parti national du Sud-Ouest Africain, comme en 1950, 1953, 1955, 1961, 1965, et 1970. Ce sera la dernière élection où seuls les blancs de Namibie auront le droit de voter.
En novembre 1974, l'assemblée législative du Sud-Ouest africain invita l'ensemble des autorités du territoire, y compris les autorités tribales et les représentants des partis politiques noirs, à déterminer leur avenir politique. L'assemblée est à l'époque dominée par le Parti national du Sud-Ouest Africain. Deux de ses représentants, Dirk Mudge et Ebenezer Van Zijl, sont chargés des négociations alors que la SWAPO et la SWANU déclinent l'invitation faite par l'assemblée.
an 1974 : Sénégal - 26 mars 1974 : Le président Léopold Sedar Senghor annonce la libération de tous les prisonniers politiques en avril, à l’occasion du 14ème anniversaire de l’indépendance du pays.
an 1975 : Afrique du Sud - L'invasion de l'Angola par les troupes sud-africaines (août-décembre 1975) - La politique de détente régionale entamée au début du mandat de Vorster laisse aussi place à une politique très offensive de sécurité nationale, notamment après l'indépendance octroyée aux anciennes colonies portugaises du Mozambique et de l'Angola. En 1975, soutenu par le gouvernement américain de Gerald Ford, les troupes sud-africaines envahissent le sud de l'Angola pour arriver jusqu'aux portes de Luanda. L'objectif des forces armées sud-africaines est d'installer un gouvernement pro-occidental à la place du gouvernement marxiste du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), afin de contrer l'influence grandissante des soviétiques sur la région. En décembre, le congrès américain fait cependant retirer son aide financière aux mouvements et aux troupes hostiles au MPLA. Furieux et humiliés, les sud-africains apparaissent comme des fauteurs de guerre et les seuls responsables de l'invasion. Ils se retirent vers la frontière mais maintiennent un appui logistique au mouvement rebelle de l'UNITA de Jonas Savimbi, afin de protéger la frontière nord de leur colonie du Sud-Ouest africain des infiltrations de la SWAPO, organisation indépendantiste.
an 1975 : Angola - Le 11 novembre 1975, jour convenu pour l'indépendance, les autorités portugaises descendent pour la dernière fois le drapeau portugais du Palais du gouverneur civil et le soir même Agostinho Neto proclame l'indépendance de la république populaire d'Angola, au son des combats à quelques kilomètres de Luanda. Le pays est déjà entré dans la guerre civile qui ne se terminera qu'avec les accords de Bicesse, le 31 mai 1991.
En 1975, le premier ministre sud-africain John Vorster et son chef des services de renseignements, Hendrik van der Bergh, envisagent une implication minimum et circonstanciée des forces armées sud-africaines pour installer un gouvernement pro-occidental en Angola tandis que Pieter Willem Botha, ministre de la défense, et le chef des armées, Magnus Malan, convaincus de l'existence d'un plan global soviétique dont l'objectif serait la prise de pouvoir en Afrique du Sud, se font les avocats d'une invasion du pays par les troupes sud-africaines pour chasser le MPLA de Luanda. Finalement, la première option est approuvée et, en août 1975, avec le soutien du gouvernement américain du président Gerald Ford, les troupes sud-africaines envahissent le sud de l'Angola jusqu'à atteindre quelques semaines plus tard la banlieue de Luanda.
De leur côté, les troupes zaïroises, sous le gouvernement de l'autocrate Mobutu Sese Seko, soutenu par la Belgique et les États-Unis, entrent également en Angola où ils soutiennent le FNLA contre le MPLA. Cette coalition menace de prendre Luanda. C’est alors que des milliers de soldats cubains affluent pour aider Neto et défont les troupes zaïroises. Les dirigeants du MPLA s’emparent alors de vastes contrées du pays mais ne parviennent pas à vaincre la guérilla de l'UNITA, tandis que le Zaïre se retire de la guerre privant le FNLA de son soutien. Ce mouvement perd alors toute importance dans la guerre.
Au mois de décembre, le congrès des États-Unis retire finalement son aide financière aux mouvements et aux troupes hostiles au MPLA alors que l'armée sud-africaine est aux portes de la capitale angolaise (les activités de la CIA en Angola (en) persisteront cependant jusque dans les années 2000). Furieux et humiliés par ce revirement, les sud-africains apparaissent alors comme les seuls coupables de l'invasion et sont obligés de se retirer du pays. Ils apporteront dorénavant une aide logistique au mouvement rebelle de l'UNITA de Jonas Savimbi afin notamment de protéger la frontière nord de leur colonie du Sud-Ouest africain contre les infiltrations de la SWAPO, le mouvement de libération nationale de la Namibie.
L'Angola s’enfonce dans une guerre civile ethnique, entre le MPLA, soit les métis et les citadins soutenus par l’Union soviétique et Cuba, et d’autre part, l'UNITA, un mouvement regroupant surtout les Ovimbundus (40 % de la population) et appuyé par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud. Un autre mouvement le FNLA, attaquant le MPLA par le nord en venant du Zaïre, approche de la capitale soutenu par des troupes de Mobutu dont la direction tactique et logistique est soutenue par la Belgique et les États-Unis. Mais la guerre s’enracine dans la différence de développement entre la côte occidentalisée et moderne et l’arrière-pays moins industrialisé et resté beaucoup plus africain et où le sentiment clanique est encore omniprésent en opposition avec les stratégies des partis fondées sur des doctrines politiques.
an 1975 : Canaries (Îles des) - Le retour à la démocratie et l'entrée dans l'Union européenne
Après la mort du général Franco, l'Espagne devient une démocratie à partir de 1975.
an 1975-1980 : Cap-Vert - Dès 1975 est envisagée la réunion du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Le coup d'État en Guinée de novembre 1980 provoque un refroidissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le projet d'union est ainsi enterré, et le PAIGC modifie son nom en PAICV (Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert).
an 1975-1974 : Archipel des Comores - Indépendance - Si le suffrage obtient dans son ensemble plus de 90 % pour l'indépendance du territoire, Mayotte se singularise en votant pour le maintien des Comores au sein de la République française (65 % pour le maintien, 35 % contre le maintien).
Plusieurs explications sont données pour expliquer ce choix :
* Mayotte était française depuis 1841 (contre 1886 pour les autres îles), la population beaucoup plus francisée et souvent en rivalité avec les autres îles ;
* la craintes des Mahorais de se sentir marginalisés dans un système politique dominé par la Grande Comore ;
* La crainte de voir les libertés des femmes diminuées (épisode des mamies chatouilleuses) ;
* Une partie de la population étant d'origine malgache, utilisant le malgache comme langue première, l'île est relativement moins islamisée (pratique animiste sakalave) et craint la mainmise de la Ligue Arabe ;
* Un certain nombre d'élus locaux d'origine comorienne (Anjouan, Mayotte) et les descendants des familles créoles, peu nombreux, mais marqués par une éducation républicaine, militent en faveur du statu quo ;
* Les relations entre Mayotte et Madagascar étant plus grandes, la désillusion apparue après l'indépendance était bien mieux connue
La France prend acte mais, le 3 juillet 1975, est promulguée une loi stipulant qu'une constitution comorienne doit être proposée dans les six mois et adoptée île par île, permettant de fait à Mayotte de pouvoir rester française, en contradiction avec une déclaration antérieure du gouvernement français datant du 26 août 1974 selon laquelle la consultation pour l'indépendance serait globale25. Le 6 juillet 1975, le président du Conseil de Gouvernement, Ahmed Abdallah, déclare unilatéralement l'indépendance immédiate des Comores. Le 9 juillet 1975, la France reconnaît l'indépendance des trois îles où le oui l'a emporté, mais Mayotte reste cependant sous administration française au détriment de la déclaration du gouvernement comorien. Le 17 octobre 1975, sans que la France ne prenne part au vote, le Conseil de sécurité des Nations unies recommande à l'Assemblée générale des Nations unies d'admettre au sein de l'Organisation des Nations unies le nouvel État comorien. Cette admission est validée le 12 novembre 1975 par l'Assemblée générale, qui, à cette occasion réaffirme « la nécessité de respecter l'unité et l'intégralité territoriale de l'archipel des Comores ». Cette position de l'Assemblée générale répond à la position du nouvel État qui revendique Mayotte et refuse cette séparation qui remet selon elle en cause l'intégrité territoriale de l'archipel. L'Union africaine considère alors ce territoire comme occupé par une puissance étrangère.
La France reconnaît l’État des Comores en décembre 1975, mais organise un referendum à Mayotte le 8 février 1976 au cours duquel les habitants de Mayotte se déclarent massivement pour le maintien dans la République Française. Plusieurs autres référendums suivront, plébiscitant toujours le maintien de Mayotte dans la France, jusqu'au Référendum sur la départementalisation de Mayotte en 2009 qui scelle l'inclusion administrative de Mayotte à la France, en tant que 101e département.
an 1975-1976 : République de Djibouti - En novembre 1975, mois où les dernières colonies portugaises d'Afrique accèdent à l'indépendance, Pierre Messmer annonce un processus devant conduire à l'indépendance du territoire, maintenant dernière colonie européenne du continent. Les listes électorales sont ouvertes aux habitants pour leur permettre de s'exprimer.
En 1975, après une résolution de l'ONU, la France reconnaît le droit à l'indépendance du territoire. Dans la perspective de l’organisation d’un référendum d’autodétermination, le ministère des Armées prépare, dans le plus grand secret, dès 1976, un déploiement naval, apparu également inéluctable pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la région. La prise en otage d'un bus scolaire à Loyada en février 1976 précipite la suite des événements.
an 1975 : Égypte - Anouar el-Sadate lance la politique de l'Infitah (ouverture) qui vise, en réduisant le rôle de l’État, à attirer les investissements étrangers. Une classe de nouveaux riches se développe rapidement. En 1975, on compte plus de cinq-cents millionnaires en Égypte mais plus de 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et des bidonvilles se développent autour de la capitale10. Par ailleurs, le pays accumule une dette monumentale durant les années de l'Infitah.
an 1975-1976 : Éthiopie - Le PMAC et les années de contradictions (1975-1976)
Rapidement, après novembre 1974, le Derg est dominé par deux personnages, ses deux vice-présidents. Le premier d'entre eux, Mengistu Haile Mariam dont les ambitions personnelles l'opposent très vite aux officiers plus éduqués du régime qui rejettent ses solutions radicales139. Le second est Atfanu Abate, considéré comme l'un des plus sérieux rivaux, les éliminations brutales qui suivront ne lui laisseront pas l'occasion de le distancer. Malgré le changement de régime, l'aide militaire américaine vers l'Éthiopie ne faiblit pas : Washington réagit très peu à la nationalisation des investissements étrangers dans le pays et considère favorablement les demandes d'assistance militaire de la part du Derg, les experts américains considérant que « cette très longue relation avec le pays vaut la peine d'être préservée ». « Nous recevons en même temps des livres marxistes imprimés en Chine, et des armes modernes fabriquées aux États-Unis » cite Le Monde daté du 7 juin 1975.
En janvier et février 1975, une première vague de nationalisation est annoncée. Dans la déclaration de politique économique de février 1975 une économie en trois tiers est envisagée : un secteur réservé à l'État, un secteur conjoint État-privé et un secteur privé assez large. Le secteur de l'État s'accroît ainsi de près de 30 000 postes. Sur la question de la répartition des terres, le Derg proclame la réforme le 4 mars 1975 : toutes les terres rurales deviennent les propriétés collectives de l'État ; cette mesure suscite les plus grandes manifestations et les plus enthousiastes de l'histoire du pays.
Alors que le régime tente de récupérer la sympathie des paysans, la situation des ouvriers urbains n'est quasiment pas améliorée par la nouvelle législation du travail promulguée en décembre 1975. Celle-ci ne propose ni salaire minimum, ni aucune mesure de sécurité sociale. Le Derg commence alors à s'attaquer à l'existence même des syndicats en développant de nouvelles structures concurrentes appelées « comités de travailleurs » ; les syndiqués sont soumis à une campagne d'intimidation. Le Derg ordonne la suspension de l'union des syndicats jusqu'aux élections du prochain congrès et les dirigeants sont emprisonnés. Le régime décide plus tard de mettre fin à l'activité de l'organisation et retient prisonniers ses représentants. Le 25 septembre 1975, des membres des forces de sécurité ouvrent le feu sur des personnes distribuant des tracts de l'union à l'aéroport d'Addis-Abeba, causant plusieurs morts. L'état d'urgence est déclaré, de larges vagues d'arrestations touchent des ouvriers syndiqués, des intellectuels et des étudiants.
an 1975-1976 : Kenya - En 1975, l’Ouganda s’engage dans une vaste politique de développement militaire qui inquiète le gouvernement kényan. Au début du mois de juin, ce dernier confisque le chargement d’un gros convoi d’armes de fabrication soviétique en route pour l’Ouganda depuis le port Kilindini Mombasa.
La tension atteint son maximum en février 1976 quand le président ougandais, Idi Amin Dada, annonce soudainement qu’il va enquêter sur le fait qu’une grande partie de l'actuel Soudan du Sud et de l’ouest et du centre du Kenya, jusqu’à 32 km de Nairobi, sont historiquement partie intégrante de l’Ouganda colonial. La réponse kényane, très lapidaire, arrive deux jours plus tard indiquant que « le pays ne partagera pas ne serait-ce qu'un pouce de son territoire ». Amin Dada fait finalement marche arrière en voyant les Kényans déployer des troupes et des transports blindés en position défensive sur la frontière avec l’Ouganda.
an 1975 : Ile Maurice - En mai 1975, une révolte étudiante qui débute à l'Université de Maurice s'étend à tout le pays. Les étudiants sont insatisfaits d'un système éducatif qui ne répond pas à leurs aspirations et offre des perspectives d'emploi limitées. Le 20 mai, des milliers d'étudiants tentent d'entrer à Port-Louis par le pont de la Grand River North West et se heurtent à la police. Une loi du Parlement est adoptée le 16 décembre 1975 pour étendre le droit de vote aux jeunes de 18 ans. Cette mesure est considérée comme une tentative d'apaiser la frustration de la jeune génération.
an 1975 : Mozambique - Le 25 juin 1975, l'indépendance du Mozambique est proclamée et Samora Machel devient le premier président de la République. Selon les accords passés avec le gouvernement portugais, des élections pluralistes doivent être organisées et un gouvernement d'union nationale doit assurer la stabilité du nouveau pays. En fait, le FRELIMO accapare immédiatement le pouvoir que les Portugais lui avaient donné, et s'aligne politiquement sur le bloc soviétique, en mettant en place un État socialiste. Les élections pluralistes n'ont pas lieu. La nouvelle constitution proclame l'établissement d'une démocratie populaire, fondée sur un système de parti unique et d'élections indirectes.
L'état économique et social semble alors déplorable mais le nouveau gouvernement compte sur l’aide économique et politique de l’Union soviétique et de Cuba relayant alors celles qui étaient apportées jusque-là par le Portugal et l'Afrique du Sud.
Le pays s'enfonce dans une guerre civile, attisée par des intérêts qui dépassent ceux du Mozambique.
an 1975 : Namibie - En juillet 1975, le ministre de l'administration et du développement bantou de John Vorster, Michiel Coenraad Botha, mit fin à un projet de délocalisation des tribus Ovaherero dans le Bantoustan du Hereroland dans l'est du pays. Ce faisant, Botha mettait fin à la mise en œuvre des conclusions du rapport Odendaal.
Le 17 août 1975, le ministre du conseil tribal de l'Ovamboland Felimon Eliphas est assassiné à Ondangwa par un guérillero de la SWAPO
an 1975-1977 : Namibie - La conférence de la Turnhalle et contexte (1975-1977)
La conférence constitutionnelle de la Turnhalle s'ouvre le 1er septembre 1975 à Windhoek. Le parti national du Sud-Ouest Africain représente la communauté blanche du Sud-Ouest africain. Les populations noires sont représentées par plusieurs petits partis politiques dont les plus hostiles à la coopération se regroupent au sein de la Convention nationale namibienne.
De son côté, la SWAPO poursuit sa guérilla contre les troupes sud-africaines. Elle a établi des bases arrière en Zambie, puis en Angola après la prise du pouvoir par le MPLA le 11 novembre 1975. Malgré ce soutien logistique qui s'ajoute à celui de Cuba, la SWAPO n'a jamais été en mesure d'inquiéter militairement l'armée sud-africaine qui elle-même intervient dans la guerre civile angolaise en soutenant le mouvement rebelle de Jonas Savimbi et en occupant le sud de l'Angola (voir bataille du pont 14). Cependant, l'exode en masse des colons portugais dont beaucoup rejoignent la Namibie manque de torpiller le processus de la Turnhalle au cours duquel les blancs namibiens manifestent leur inquiétude. L'armée sud-africaine est alors redéployée en zone nord où elle crée une zone opérationnelle — dans laquelle la population locale est pris en tenaille entre les guérilleros et l'armée. C'est dans l'Ovamboland que les forces de la SWAPO (environ 6 000 hommes) vont concentrer leurs attaques face à 20 000 soldats sud-africains appuyés par leurs efficaces et redoutables supplétifs indigènes34 (dont la Koevoet, une unité contre-insurrectionnelle).
En avril 1976, Andreas Shipanga, l'un des cofondateurs de la SWAPO, dénonce le népotisme, la corruption et l'inefficacité de la direction du mouvement. Avec 2 000 de ses partisans dont Nathaniel Maxuilili, il tente de s'emparer du quartier général du parti à Lusaka en Zambie. Sam Nujoma est obligé de requérir l'aide du président Kenneth Kaunda pour éviter d'être démis de ses fonctions par la force. Les rebelles sont finalement arrêtés et emprisonnés, et accusés de collusion avec l'Afrique du Sud. Certains sont relâchés au bout de six mois, d'autres sont transférés dans des camps en Tanzanie, d'autres encore disparurent définitivement (Shipanga n'est lui-même libéré qu'en mai 1978).
Le 14 août 1976, Dirk Mudge appelle les blancs à rejoindre les noirs sur le chemin de l'indépendance. Deux jours plus tard, les délégués s'accordent sur un gouvernement intérimaire chargé de transformer le territoire en État indépendant sur le modèle d'une fédération.
Cependant, le 20 décembre 1976, dans sa résolution no 385, l'Assemblée générale des Nations unies refuse de reconnaître l'évolution interne de la Namibie et apporte « son soutien à la lutte armée » menée « sous la conduite de la SWAPO ». La SWAPO obtient le statut d'observateur et devient le seul mouvement de libération à disposer à New York d'une tribune officielle. Cette résolution comme la précédente en 1973 est votée avec l'appui des pays du Tiers monde, des pays scandinaves et des pays de l'Est contre la majorité des puissances occidentales (dont la France).
L'année suivante, le gouvernement de Pretoria accepte la médiation de cinq membres occidentaux du Conseil de sécurité (Allemagne, Canada, France, États-Unis et Royaume-Uni, encore appelé groupe de contact ou groupe des Cinq) pour négocier une solution acceptable pour tous. La SWAPO finit par se rallier aux propositions du groupe à condition que le port de Walvis Bay (annexé par l'Afrique du Sud entre 1971 et 1977) soit réintégré dans les discussions, que l'armée sud-africaine quitte le territoire et que des élections aient lieu sous supervision des Nations unies.
Pendant ce temps, le 18 mars 1977, le principe d'un gouvernement à trois niveaux est adopté à la conférence de la Turnhalle : un pouvoir central, des autorités locales à base ethnique, des autorités municipales. L'assemblée nationale serait élue au suffrage indirect par l'intermédiaire d'assemblée locale. Le nom du futur État fait l'objet d'un compromis : Sud-Ouest Africain/Namibie, du moins pour la période intérimaire.
Certains partis ne sont pas satisfaits du compromis et se regroupent dans le Front national de Namibie (NNF). De leur côté, les blancs se prononcent en mai 1977 par référendum à plus de 60 % pour les propositions de la Turnhalle et avalisent le principe d'indépendance.
En août 1977, la gestion de l'enclave de Walvis Bay (rattachée depuis 1971 aux autorités de la province du Cap) est transférée au gouvernement sud-africain, et ainsi soustraite au processus d'indépendance.
Le sort des terres est aussi évoqué lors de la conférence mais les délégués se séparent sur un constat d'échec. Chez les blancs, les divisions sont aiguës. En septembre 1977, Mudge entre en conflit avec la direction du Parti national du Sud-Ouest, présidé par A. H. du Plessis, qui souhaite conserver des lois d'apartheid. Mis en minorité de justesse, Mudge et quatre-vingts de ses partisans quittent le parti en octobre et créent le Parti républicain.
an 1975-1983 : Nigéria - En 1975, le nouveau coup d'État, mené sans effusion de sang, amène Murtala Ramat Mohammed au pouvoir. Il promet lui-aussi un retour rapide à la démocratie, mais il est tué dans un coup d'État avorté et est remplacé par son second Olusegun Obasanjo..
Une nouvelle constitution est établie en 1977 et les premières élections ont lieu en 1979, gagnées par Shehu Shagari.
Le suffrage universel est étendu à toutes les femmes du pays pour le scrutin de 1979. Auparavant, certaines femmes pouvaient déjà voter, mais dans des cas particuliers : ainsi pour l'élection municipale de Lagos en 1950 puis en 1951 au niveau national mais sous condition de ressources (suffrage censitaire). Plusieurs militantes s'impliquent particulièrement pour obtenir le droit de vote pour toutes les Nigérianes, comme Elizabeth Adekogbe, Funmilayo Ransome-Kuti et Margaret Ekpo. En 1959, le suffrage censitaire est aboli dans le sud du pays mais reste en vigueur dans le nord, marqué par le poids de la religion musulmane. La constitution de 1979 interdit finalement toute forme de « discrimination de sexe » au niveau national mais l'engagement politique des femmes reste ensuite minime.
an 1975 : Réunion (Ile de la) - le 1er janvier marque l'abandon du franc CFA au profit du franc français.
an 1975-1990 : Rwanda - Après son coup d'État, le nouveau président et chef de l'armée Juvénal Habyarimana pratiquera une politique de discrimination ethnique en mettant en place un système de quotas. Seules 10 % des places dans les écoles, les universités et les emplois sont accordées aux Tutsis et presque aucun n'accède à un poste de maire ou de préfet. Si quelques-uns réussissent à s'enrichir, comme Valens Kajeguhakwa (ami du Général Bizimungu qui deviendra membre de l'Akazu), d'autres payent leur succès en subissant emprisonnements arbitraires et confiscation de leurs biens. Valens Kajeguhakwa finit par subir le même sort avant de s'enfuir rejoindre le FPR avec Pasteur Bizimungu en 1990.
En 1975, Juvénal Habyarimana fonde son parti, le Mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND). En 1978, il change la Constitution et fait adopter un régime à parti unique.
an 1975 : Sao Tomé et Principe - Manuel Pinto da Costa, secrétaire du Mouvement de libération de São Tomé et Príncipe (MLSTP, d'inspiration marxiste) devint président de la République, indépendante depuis le 12 juillet 1975. Colons portugais et travailleurs du continent émigrèrent aussitôt en masse. La Constitution instaura le MLSTP en parti unique et mit en place un régime de type marxiste. Les plantations furent nationalisées.
an 1975 : Sénégal - 4 février 1975 : Réunion à Dakar des représentants des 110 pays en voie de développement et des pays non alignés au sujet des prix des matières premières.
an 1975 : Sierra Leone - Le 28 mai 1975, avec 14 autres États, la Sierra Leone fonde la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
an 1976 : Afrique du Sud - Henry Kissinger, le secrétaire d’État américain, partisan de la détente avec les régimes blancs d’Afrique et de l'adoucissement des relations avec l’Afrique du Sud, apporte son soutien à une médiation sud-africaine en échange de quoi le gouvernement américain de Gerald Ford promet de s'abstenir de pressions directes sur les questions concernant l’avenir du Sud-Ouest africain et sur la pérennité de l’apartheid. Si Ian Smith accepte finalement le principe de l'accession de la majorité noire au pouvoir, les obstacles à la concrétisation de cette promesse s’amoncèlent vite concernant le processus de transition, organisation du cessez-le-feu, désarmement des forces armées, surveillance des élections, coordination interne entre les mouvements de guérilla, etc.
En 1976, l'imposition par le vice-ministre de l’administration et de l'éducation bantoue, Andries Treurnicht, de l'enseignement obligatoire en afrikaans pour les écoliers noirs provoque un soulèvement de ces derniers dans les Townships. Une marche de protestation est organisée dans le district noir de Soweto près de Johannesbourg le 16 juin 1976. Environ 20 000 étudiants se présentent et, malgré des appels au calme des organisateurs, affrontent les forces de l'ordre. La répression des forces de sécurité sud-africaines et de la police de Jimmy Kruger est féroce et fait près de 1 500 victimes. La plupart des autres pays, à l'exception du Royaume-Uni et des États-Unis, qui craignent le basculement du pays dans le camp de l'Union soviétique, condamnent la répression et imposent une limitation du commerce ou même des sanctions. Les images et les témoignages sur le massacre de Soweto font le tour du monde alors que l'Umkhonto we Sizwe reçoit l'apport de nouvelles recrues en provenance des townships.
an 1976 : Algérie - L'allusion à la révolution socialiste est néanmoins abandonnée en 1976, sous Houari Boumédiène, l'Algérie se rapprochant du mouvement des non-alignés.
an 1976 : Burundi - Le régime Micombero tombe le 1er novembre 1976. Le nouveau chef de l’État, le colonel Jean-Baptiste Bagaza amorce une politique économique de grande envergure, espérant de cette façon passer par la satisfaction des besoins de la population et l’instauration d’une justice sociale pour réduire ces tensions. Mais c’est sous son régime que naissent les mouvements de libération des Hutus : Palipehutu, UBU, Tabara, Bampere. Ces organisations créent de vives tensions dans le pays. Au cours de cette même période surtout après 1985 le torchon brûle entre l’État et l’Église catholique notamment.
La 3e république est proclamée dans cette conjoncture : le major Pierre Buyoya remplace Jean-Baptiste Bagaza à la tête de l’État le 3 septembre 1987. Une année après, le 15 août 1988, éclate la « crise de Ntega et Marangara ». Des initiatives diverses sont prises en vue de promouvoir l’unité nationale : accueil et réinstallation des réfugiés, gouvernement de l’unité nationale, charte de l’unité nationale.
Malgré ces actions posées en vue de résoudre le problème de l’unité nationale, une explosion de violence a lieu à nouveau, à Bujumbura et dans le Nord-Ouest en octobre 1991, sans s'étendre toutefois sur d’autres territoires.
an 1976 : République de Centrafrique - Le 4 décembre 1976, il devient l'empereur Bokassa Ier. Il met alors en place une politique très répressive dans tout le pays.
an 1976 : Djibouti - En juillet 1976, Ali Aref Bourhan, lié aux réseaux gaullistes, démissionne de la présidence du Conseil de gouvernement, il est remplacé par Abdallah Mohamed Kamil.
En 1976, des membres du Front de libération de la Côte des Somalis, qui cherchait à obtenir l'indépendance de Djibouti de la France, se sont également affrontés avec le Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale au sujet du détournement d'un bus scolaire en route vers Loyada. Tous les membres du commando indépendantiste et deux des enfants enlevés sont tués dans cette opération. Cet événement, en montrant les difficultés de maintenir la présence coloniale française à Djibouti, est une étape importante dans l'indépendance du territoire. La probabilité qu'un troisième référendum paraisse fructueux pour les Français s'était encore atténuée. Le coût prohibitif du maintien de la colonie, dernier avant-poste de la France sur le continent, est un autre facteur qui oblige les observateurs à douter que les Français tentent de s'accrocher au territoire.
an 1976-1987 : Éthiopie - Le durcissement du régime : la dictature (1976-1987)
Ayant épuisé les réformes socio-économiques inspirées du mouvement populaire, le Derg se montre non seulement incapable de concevoir de nouvelles mesures dans les mois suivant, mais voit aussi resurgir avec d'autant plus de force l'une des premières revendications du mouvement : celle d'un gouvernement du peuple. Parallèlement le Derg suit une transformation interne clarifiant la nature du régime : la plupart des membres sont décimés au cours de purges violentes ramenant le pouvoir dans les mains d'une clique de plus en plus réduite.
La première des pressions exercées par la junte reste l'opposition populaire dirigée par les intellectuels, les ouvriers et les étudiants. La campagne de propagande basée sur l'envoi massif des étudiants dans les campagnes prend fin au début de 1976, du fait de l'hostilité de plus en plus grande des universitaires face au gouvernement militaire. Ils sont remplacés, comme les professeurs, par des militaires et des sympathisants du régime, le Derg prenant des mesures sévères contre leurs prédécesseurs : un nombre indéterminé de ces militants universitaire est tué dans des heurts avec les autorités, beaucoup sont emprisonnés, des centaines traversent les frontières pour se réfugier à l'étranger.
La campagne prend fin officiellement en juillet 1976.
En décembre 1976, une délégation éthiopienne se rend à Moscou et signe un accord d'assistance militaire avec l'Union soviétique. En avril, l'Éthiopie résilie son accord d'assistance militaire avec les États-Unis et expulse les forces militaires basées en Éthiopie (base de Kagnew). En juillet 1977, la Somalie de Mohamed Siad Barre attaque l'Éthiopie pour soutenir les indépendantistes de la province de l'Ogaden. Le conflit voit la défaite de la Somalie en mars 1978.
Les années sous Mengistu sont marquées par un gouvernement totalitaire et la militarisation du pays financée par l'URSS et Cuba. En 1977 et 1978, des milliers de personnes suspectées d'être des ennemis du Derg sont torturées ou tuées. Lorsque les corps ne sont pas abandonnés aux hyènes, les familles doivent payer la balle qui a servi à l'exécution. Cette période est nommée la « terreur rouge ». Les slogans annoncent : « Pour un révolutionnaire abattu, mille contre-révolutionnaires exécutés ». 30 000 étudiants sont mis en prison et 5 000 sont tués en une seule semaine.
La guerre civile provoque l'abandon et la destruction des cultures et détourne une part importante des énergies et crédits vers les opérations militaires. En 1979, une famine importante touche le Nord du pays du Wollo à l'Érythrée. À cette occasion, le régime entame une politique de déplacements forcés, dite de « villagisation ». Cette politique obéit à plusieurs objectifs : les autorités poussent d'une part les paysans à abandonner les zones sinistrées -pour cause de famine ou de guérilla- pour les transférer dans les régions du Sud plus clémentes et plus sures, de l'autre ces déplacement diminuent les capacités de regroupements dans les régions du Nord hostiles au régime. Cette politique est conduite à une plus grande échelle, lors de la famine de 1984-1986 : d'octobre 1984 à mai 1986, 2 800 000 personnes sont déplacées.
En 1984, le Parti des travailleurs d'Éthiopie (PTE) est créé, et le 1er février 1987, une nouvelle Constitution suivant le style soviétique est soumise à un référendum. Celle-ci est officiellement approuvée par 81 % des votants, et en suivant la Constitution, le pays est renommé « République démocratique populaire d'Éthiopie » le 10 septembre 1987. Mengistu devient président.
an 1976 : Mali - Le 30 mars 1976, le parti unique Union démocratique du peuple malien (UDPM) est créé. Le régime autoritaire met en place également l'Union nationale des jeunes du Mali afin de contrôler la jeunesse et réduire l’influence du syndicat étudiant, l’Union nationale des élèves et étudiants du Mali (UNEEM), qui avait des liens avec des partis clandestins comme le PMT, le Parti malien pour la démocratie et la révolution (PMDR) et le Comité de défense des libertés démocratiques au Mali (CDLDM)
an 1976 : Ile Maurice - Les élections générales ont lieu le 20 décembre 1976. La coalition Labour-CAM ne remporte que 28 sièges sur 62. Le MMM obtient 34 sièges au Parlement, mais le Premier ministre sortant, Sir Seewoosagur Ramgoolam, réussit à rester en fonction, avec une majorité de deux sièges, après avoir conclu une alliance avec le PMSD de Gaetan Duval.
Le MMM remporte la majorité des suffrages en 1976, mais une coalition entre le Parti travailliste et le PMSD les empêche de prendre le pouvoir.
an 1976-1984 : Mauritanie - Le 8 août 1976, Moktar Ould Daddah est élu président de la République une fois de plus. Il est renversé en 1978, par une junte militaire que dirige le colonel Moustapha Ould Mohamed Saleck, lui-même renversé en 1980 par le colonel Mohamed Khouna Ould Haidalla et ce dernier, renversé par Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya en décembre 1984.
an 1976 : Mayotte - Émancipation des Comores et dissidence de Mayotte
La France organise un référendum spécial le 8 février 1976, les habitants de Mayotte confirment encore plus massivement leur premier vote avec plus de 90 %. Le gouvernement est à nouveau dans un réel embarras pour justifier sa politique internationale de non-intervention et les accords préexistants. Le parlement français entérine les votes mahorais le 24 décembre 1976. Mayotte devient une collectivité territoriale au statut provisoire initial prévu pour cinq années. L'assemblée générale des Nations unies et l'Union africaine condamnent et menacent, la France est isolée.
an 1976 : Réunion (Ile de la) - Monseigneur Gilbert Aubry devient le premier évêque réunionnais du diocèse de La Réunion.
La route du Littoral, qui relie Saint-Denis à La Possession en 11,7 km, est livrée le 5 mars après 29 mois de travaux. Elle a coûté 230 millions de francs.
an 1976 : Sénégal - 16 mars 1976 : L’Assemblée Nationale adopte une loi d’amnistie de tous les prisonniers politiques pour le 4 avril. Le même mois, une révision de la constitution autorise l’existence de trois partis politiques correspondant à trois tendances. A côté de l’UPS (parti gouvernemental) qui deviendra le PS (Parti Socialiste), se constituent le PDS d’Abdoulaye Wade, libéral-démocratique, et le PAI (Parti Africain de l’Indépendance) de Maihemout Diop, marxiste-léniniste.
an 1976 : Seychelles - Depuis le 29 juin 1976, les Seychelles forment un État indépendant, membre du Commonwealth et de la Francophonie.. L’archipel des Seychelles devient alors une république au parti unique.
Le président France-Albert René reste au pouvoir de 1976 à 2004. Son vice-président James-Alix Michel lui succède. Il est l’actuel président de la République des Seychelles.
an 1977 : Afrique du Sud - En mai 1977, la rencontre entre John Vorster et le nouveau vice-président américain, Walter Mondale, au palais Hofburg à Vienne en Autriche, aboutit à une impasse. La solution interne rhodésienne visée par les accords de Salisbury du 3 mars 1978, soutenue par les Sud-Africains, et basée sur un gouvernement multiracial, ne reçoit finalement pas l'aval de la nouvelle administration américaine dirigée par Jimmy Carter. La médiation sud-africaine est finalement un échec. Deux ans plus tard, à la suite des accords de Lancaster House, un nouveau processus sous patronage britannique aboutit à l'indépendance du Zimbabwe (ex-Rhodésie), appelé à être gouverné par Robert Mugabe, le chef marxiste de la ZANU.
À partir de 1977, l'organisation est de nouveau capable de commettre des attentats plus ou moins ciblés, parfois meurtriers, sur le sol sud-africain, visant en priorité les postes de police des townships et les Noirs accusés de collaborer avec le régime blanc. En 1977, un des chefs très populaire de la « Conscience noire », Steve Biko, est enlevé et assassiné par les forces de sécurité. Le journaliste et éditeur sud-africain Donald Woods alerte l'opinion publique mondiale sur les conditions de la disparition de Biko. Un embargo sur les ventes d'armes à l'Afrique du Sud est voté au conseil de sécurité des Nations unies alors que le pays est toujours engagé militairement en Angola contre le gouvernement marxiste, en soutenant directement ou indirectement le mouvement rebelle de l'UNITA. Cet échec diplomatique pour Vorster s'accompagne d'un scandale financier impliquant son ministre de l'Intérieur et de l'information Connie Mulder. Pourtant, lors des élections du 30 novembre 1977, le parti obtient le meilleur score de son histoire avec 64,8 % des suffrages, laissant l'opposition parlementaire désormais principalement représentée par le parti progressiste fédéral (16 %)183[source insuffisante]. Issu de la fusion du parti progressiste réformiste et de dissidents du parti uni, le parti progressiste fédéral a remporté son pari en devenant le principal parti de l'opposition parlementaire alors que le parti uni, désormais parti de la nouvelle république, s'effondre à une dizaine de sièges contre quarante-et-un élus en 1974.
John Vorster ne tarde pas cependant à être rattrapé par le scandale de l'information et, sous la pression, doit céder sous son fauteuil de Premier ministre. En compensation, il obtient d'être élu président de la république, fonction symbolique de laquelle il est contraint de démissionner, officiellement pour raisons de santé, un an plus tard.
an 1977-1979 : Congo-Brazzaville - Le régime est instable et doit faire face à de nombreux soubresauts. Au cours de cette période, le Congo reste dépendant de l'extérieur, en particulier en ce qui concerne les produits alimentaires et manufacturés. Son économie repose sur les exportations de matières premières brutes (bois, potasse, pétrole, fer, etc.), auxquelles s'ajoutent de modestes ressources pétrolières. Finalement, le 18 mars 1977, le président Marien Ngouabi est assassiné dans sa résidence. Dans les jours qui suivent, le cardinal Émile Biayenda, archevêque de Brazzaville (le 22 mars) et l'ancien président de la République Alphonse Massamba-Débat sont également assassinés. Le 5 avril 1977, le colonel Joachim Yhombi-Opango, devient président de la République, et ce jusqu'en février 1979. Puis le 5 février 1979, le colonel Denis Sassou-Nguesso prend le pouvoir par un coup d'État, qu'il qualifie de « riposte résolue de l'ensemble des forces de gauche de notre pays contre le courant droitier ». Il reste au pouvoir jusqu'en août 1992, avec un Parti unique et une centralisation du pouvoir. Denis Sassou-Nguesso se pose comme le seul héritier légitime de Marien Ngouabi.
1977-1990 : Bénin - Une nouvelle constitution est adoptée le 9 septembre 1977 et restera en vigueur jusqu’en 1990. L'État dirige tous les secteurs de l’économie, conduit la réforme agraire et développe l’industrialisation.
an 1977-1980 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Le 27 novembre 1977, une nouvelle Constitution est approuvée par référendum, donnant naissance à la Troisième République. Aux élections législatives de 1978, sept partis sont en présence, mais seuls les trois partis arrivés en tête sont autorisés à poursuivre leurs activités. Vainqueur de l'élection présidentielle en mai 1978, Lamizana est confronté à un mouvement de grève générale en 1980, organisé par la Confédération des syndicats voltaïques. Le 25 novembre 1980, il est renversé par le colonel Saye Zerbo, qui est à la tête du Comité militaire de redressement pour le progrès national (CMRPN).
1977-1980 : Cameroun - Le Cameroun devient un pays producteur de pétrole en 1977. Prétendant vouloir faire des réserves pour les temps difficiles, les autorités gèrent les recettes pétrolières « hors budget » dans la plus totale opacité (les fonds sont placés sur des comptes parisiens, suisses et new-yorkais). Plusieurs milliards de dollars sont ainsi détournés au bénéfice de compagnies pétrolières et de responsables du régime. L'influence de la France et de ses 9 000 ressortissants au Cameroun reste considérable. La revue African Affairs note au début des années 1980 qu'ils « continuent à dominer presque tous les secteurs clés de l'économie, à peu près comme ils le faisaient avant l'indépendance. Les ressortissants français contrôlent 55 % du secteur moderne de l'économie camerounaise et leur contrôle sur le système bancaire est total.
1977-1979 : Congo-Brazaville - Au cours de cette période, le Congo reste dépendant de l'extérieur, en particulier en ce qui concerne les produits alimentaires et manufacturés ; son économie repose sur les exportations de matières premières brutes (bois, potasse, pétrole, fer, etc.). Les ressources pétrolières restent modestes, et le pays est loin d'atteindre la prospérité relative du Gabon voisin.
Le 18 mars 1977, le président Marien Ngouabi est assassiné dans sa résidence. Dans les jours qui suivent, le cardinal Émile Biayenda, archevêque de Brazzaville (le 22 mars) et l'ancien président de la République Alphonse Massamba-Débat sont également assassinés. Le 5 avril 1977, le colonel Joachim Yhombi-Opango, devient président de la République, et ce jusqu'en février 1979.
1977 : Congo-Kingshassa - Zaïre - 1977 : des rebelles « katangais » venus d’Angola envahissent le Shaba, les troupes de Mobutu sont impuissantes, les rebelles sont repoussés par des troupes marocaines acheminées par l’aviation française.
1977-1980 : Djibouti - Après un référendum le 8 mai 1977 (98,8 % de « oui »), le territoire devient indépendant le 27 juin 1977 sous le nom de république de Djibouti alors que la flotte française, lors de l'opération Saphir a déployé jusqu’à 17 bâtiments sur zone dont ses porte-avions Clemenceau relevé par le Foch, soit la plus importante flotte déployée par la France, dans cette région, depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Une série d'attentats à la fin de 1977 est le prétexte à la mise en œuvre d'une politique autoritaire, caractérisée par un parti unique et un contrôle policier important de la population. C'est l'occasion de la rupture de l'alliance indépendantiste, avec le départ d'Ahmed Dini du gouvernement de Hassan Gouled Aptidon. Le barrage autour de la ville de Djibouti n'est supprimé qu'au début des années 1980.
1977 : Égypte - le pays accumule une dette monumentale durant les années de l'Infitah. Pour la restructurer, le FMI demande la suppression de toutes les subventions aux produits de base ce qui provoque des émeutes en janvier 1977. Le gouvernement fait intervenir l'armée, générant un nombre de victimes inconnu. Dans les campagnes, Sadate cherche à obtenir le soutien des élites rurales traditionnelles, dont l'influence avait décliné sous le nassérisme. Des paysans sont expulsés des terres contestées.
1977 : Érythrée - En 1977, une livraison massive d'armes soviétiques à l'Éthiopie permet à l'armée de cette dernière d'infliger des défaites au FPLE.
1977-1978 : Éthiopie - En juillet 1977, la Somalie de Mohamed Siad Barre attaque l'Éthiopie pour soutenir les indépendantistes de la province de l'Ogaden. Le conflit voit la défaite de la Somalie en mars 1978.
Les années sous Mengistu sont marquées par un gouvernement totalitaire et la militarisation du pays financée par l'URSS et Cuba. En 1977 et 1978, des milliers de personnes suspectées d'être des ennemis du Derg sont torturées ou tuées. Lorsque les corps ne sont pas abandonnés aux hyènes, les familles doivent payer la balle qui a servi à l'exécution. Cette période est nommée la « terreur rouge ». Les slogans annoncent : « Pour un révolutionnaire abattu, mille contre-révolutionnaires exécutés ». 30 000 étudiants sont mis en prison et 5 000 sont tués en une seule semaine.
1977-1980 : Guinée-Bissau - Luís Cabral, demi-frère d’Amílcar Cabral, devint président de la Guinée-Bissau. L'indépendance commence sous les meilleurs auspices. La diaspora bissau-guinéenne revient massivement dans le pays. Un système d'accès à l'école pour tous est créé. Les livres sont gratuits et les écoles semblent disposer d'un nombre suffisant d'enseignants. L'éducation des filles, jusqu'alors négligée, est encouragée et un nouveau calendrier scolaire, plus adapté au monde rural, est adopté. Une nouvelle monnaie voit le jour, le peso de Guinée-Bissau.
Sur le plan plan agricole, la poursuite de la "ferme modèle" continue de doter le pays d'une base de techniques de recherche. Des coopératives sont mises en place. la construction de silos à riz, destinés à assurer la continuité de la distribution de riz cultivés dans le pays est entreprise à la fin des années 70. Une filière coton est créé en 1977.
Sur le plan industriel, une petite industrie est créée : fabrique de chemises "Bambi"; chaudronnerie pour la fabrique de la carrosserie des voitures FAF montées localement, de marque Citroën) ; agroalimentaire fruitière à Bolama ; faïencerie dans la banlieue de Bissau ; poursuite des activités de la tuilerie de Bafatá. La construction d'un chemin de fer de fer destiné à favoriser le développement industriel, ainsi que plusieurs autres projets sont à l'étude.
La ville de Bissau est alors considérée comme l'une des plus propres d'Afrique, et des jeux gratuits pour les enfants des écoles (manèges, etc) fonctionnent.
Ce dynamisme est salué et certains auteurs considèrent que le pays est l'État le plus dynamique d'Afrique de l'Ouest.
Il sera renversé en 1980 par un coup d’État mené par le premier ministre et ancien commandant des forces armées, João Bernardo Vieira.
an 1977 - 1972 : Libye - En 1977, Kadhafi change le mode de gouvernement de la Libye, qui devient une Jamahiriya, c'est-à-dire un « État des masses » officiellement gouvernée par le peuple libyen selon un principe de démocratie directe. Kadhafi lui-même abandonne son poste de chef de l'État en 1979 : tout en n'ayant plus aucun poste officiel — son titre de « Guide de la révolution » n'apparaît dans aucun texte de loi — il continue cependant dans les faits d'exercer un pouvoir absolu en Libye. S'appuyant sur la prospérité née de la rente pétrolière et sur des politiques sociales généreuses, Kadhafi parvient dans les premières années à générer un consensus autour de son régime. Sa popularité s'effrite cependant avec les difficultés économiques causées par la chute des cours du pétrole.
1977-1980 : Mali - Le 16 mai 1977, Modibo Keïta meurt, officiellement d’un œdème pulmonaire. Cependant, aucune autopsie n’ayant été pratiqué, les raisons de sa mort sont incertaines : manques de soin, empoisonnement sont des raisons invoqués par les proches de l’ancien président.
Contestations du régime par les étudiants et élèves :
La jeunesse, et plus particulièrement les lycéens et les étudiants, sont les principaux contestataires du régime de Moussa Traoré.
Le 7 février 1977, une grève des étudiants est lancée par l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali (UNEEM) contre l'instauration d'un concours d'entrée pour les établissements de l'enseignement supérieur. Un accord conditionnel est signé par Samba Lamine Sow, secrétaire général de l'UNEEM, mais est contesté par la base. Le 10 février, une manifestation violente se déroule à Bamako, organisée par une fraction de l'UNEEM opposé à l'accord. Boniface Diarra, secrétaire général de l'UNEEM à l'École normale d'administration, est arrêté par la police.
Le 22 février le gouvernement exige des parents qu'ils fassent pression sur les lycéens pour reprendre les cours, les menaçants de leur faire rembourser les frais de scolarité. Les étudiants doivent s'engager à ne pas faire grève pendant une période de 10 ans. La majorité des élèves reprennent les cours.
Le 24 avril le ministre de l'éducation nationale annonce la dissolution du bureau de l'UNEEM et la fermeture des établissements scolaires de Bamako. Ceux-ci rouvrent le 6 mai. Le 9 mai, une manifestation est organisée pour demander la libération de B Diarra. La police interpelle de nombreuses personnes. Le 17 mai, Modibo Keïta est enterré à Hamdallaye à Bamako. Une manifestation spontanée rassemble plusieurs milliers de personnes. L'état d'urgence est décrété et une centaine de personnes sont arrêtées.
Parallèlement à la mise en place du parti unique, le régime créé l'Union nationale des jeunes du Mali (UNJM), une organisation étatique censée contrôler toutes les activités de la jeunesse. Les 20 et 21 janvier 1978 se tient au congrès constitutif de l'UNEEM en tant que section de l'UNJM, le mouvement étudiant affirme sa volonté d'autonomie et de noyautage de l'UNJM. Modibo Diallo est élu secrétaire général. Du 26 au 29 juin, lors du congrès constitutif (UNJM), S. Samacké, ancien membre de l'organisation des jeunes de l'US-RDA, proche d’Alpha Oumar Konaré, est élu secrétaire général.
En décembre 1978, le deuxième congrès de l'Uneem se tient. Le bureau est renouvelé et une ligne politique est affirmée : se démarquer du pouvoir et promouvoir le socialisme. Tiébilé Dramé, secrétaire général, fait adopté à l'unanimité le retrait de l'organisation étudiante de l'UNJM. Le 29 janvier 1979, l'UNEEM organise une marche de soutien aux élèves de la République centrafricaine contre la dictature de Jean-Bedel Bokassa. Le gouvernement malien accuse les 2000 élèves d'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État.
L'Uneem boycotte le congrès constitutif de l'Union démocratique du peuple malien (UDPM) qui se tient du 29 au 31 mars. Le 1er mai, l'UNEEM se retire effectivement de l'UNJM.
Le 7 août, l'UNEEM organise une campagne d'information et de sensibilisation pour populariser ses revendications : suppression des concours dans l'enseignement supérieur et la fonction publique, dotation en cantines et internats des lycées régionaux, suppression du tronc commun, augmentation des bourses et leur paiement à terme échu. Le 26 novembre, une grève a lieu dans tout le pays pour la satisfaction des revendications. Le 26 novembre, une marche sur le ministère de l'Éducation nationale à Bamako est organisée. Des milliers d'élèves envahissent la cour du ministère et prennent le ministre en otage pour l'obliger à lire les revendications. Le 4 et 5 décembre, la fermeture des établissements scolaires est décidée Moussa Traoré qui limoge le directeur de la sécurité. Le 17 décembre, le gouvernement décide d'enrôler les élèves et étudiants dans l'armée. Amnesty International dénonce l'envoi de 375 élèves au camp des parachutistes de Djikoroni où ils sont rasés et battus.
Le 18 décembre, les femmes de Bamako manifestent contre l'enrôlement de leurs enfants et sont rejointes par les élèves et étudiants. La police tire sur la foule. Amnesty International recense 15 morts sur l'ensemble du territoire. Le pouvoir est contraint de négocier avec l'UNNEM par la médiation de l'Union nationale des femmes du Mali et accepte les revendications des étudiants, sans fixer de délais pour leur réalisation. Les lycées rouvrent le 14 janvier 1980.
Le 15 janvier, au 2e congrès de l'UNJM, Sory Coulibaly, secrétaire du bureau exécutif de l'UDPM, annonce la dissolution de l'UNEEM. Le gouvernement décide qu’une seule organisation peut représenter la jeunesse ; l’Union nationale des jeunes du Mali. Le 13 février, une manifestation de lycéens arpente les rues de Ségou. La police intervient. Deux morts sont recensés et un élève et un enseignant sont arrêtés. Le 18 février, se tient un congrès extraordinaire de l'UNEEM. Abdoul Karim Camara, surnommé Cabral, est élu secrétaire général. Un mot d'ordre de grève pour réclamer la libération personnes arrêtées à Ségou, la restauration de l’UNEEM et le paiement des bourses.
Le 8 mars 1980, alors que le Mali accueille les chefs d'État des pays riverains du Sahara, l'UNEEM souhaite profiter de la présence de la presse internationale pour porter ses revendications. Des milliers de scolaires se regroupent dans le centre-ville de Bamako. Les manifestants s'en prennent aux vitrines des supermarchés, aux voitures de l'administration et aux bâtiments de l'État. La police réprime violemment les manifestants.
Les familles de Cabral et de Seudiou Mamadou Diarrah, secrétaire à l'information, sont arrêtées pour obliger les deux leaders étudiants à se rendre. Cabral est arrêté et torturé, obligé à prononcer à la radio un appel à la reprise des cours. Le 16 mars, il décède en prison en raison des tortures et de l'absence de soin. Le 19, un sit-in avenue de l'indépendance à Bamako rassemble plusieurs milliers d'élèves et étudiants qui réclament le corps de Cabral.
Des manifestations de soutien au régime sont organisées le 9 et le 22 mars mais rassemblent peu de monde. Le 29 mars, Moussa Traoré annonce la libération de tous les élèves, étudiants et professeurs et « pardonne les exactions des étudiants et élèves ». Le 31 mars, les cours reprennent. Du 8 au 12 avril se réunit le premier conseil national de l'UDPM. Constatant la faillite du parti et condamnant « l'attitude irresponsable des élèves et étudiants », il décide la tenue d'un congrès extraordinaire pour dynamiser le parti et la mise en place d'associations villageoises appelées ton ainsi qu'un service national de la jeunesse.
Le 14 avril, les forces de l'ordre interviennent violemment contre les élèves du lycée de Badalabougou à Bamako : dix élèves sont blessés. Le mouvement de grève reprend pour demander le paiement des bourses et l'autorisation de l'UNEEM.
En juin, les élèves et professeurs désertent les écoles et boycottent les examens pour protester contre le non-paiement des salaires et des bourses. Le 28 juin, les élèves et étudiants ayant obtenu le paiement des bourses reprennent les cours. Le 2 août, Alpha Oumar Konaré et Tierno Diarra sont remplacés respectivement au ministère de la jeunesse et de l'éducation par N'ji Mariko et le général Sékou Ly.
an 1977 - 1979 : Mayotte - Émancipation des Comores et dissidence de Mayotte
Entre 1977 et 1978, une intervention de couverture militaire est organisée, affirmant une présence maritime française dans le canal du Mozambique jusque-là délaissé. Une garnison, composée de troupes de la légion et d'infanterie de marine gravite autour la nouvelle base mahoraise gérée par la marine nationale.
Le parlement français perçoit aussi la gageure juridique pour intégrer la population mahoraise. Une administration préfectorale est installée par défaut pour gérer en fonction des principales normes administratives la collectivité mahoraise. Si le droit français s'applique, le droit traditionnel musulman peut également y être appliqué au gré des justiciables par les tribunaux locaux présidés par les cadis (de l'arabe : قاضي (qāḍī) signifiant juge).
Le parlement proroge par la loi du 22 décembre 1979 une nouvelle période quinquennale le statut de la collectivité de Mayotte.
Mayotte, collectivité française : Depuis 1975, l'île de Mayotte est toujours revendiquée par l'Union des Comores et l'Union africaine reconnaît ce territoire comme occupé par une puissance étrangère. En 1976, la RFI des Comores a saisi le Conseil de sécurité des Nations unies qui rejette la demande de reconnaissance de la souveraineté de la RFI des Comores sur Mayotte par 11 voix pour et une voix contre (« véto français »). Durant ce temps, les élus de Mayotte, fortement poussés par la population, tentent d'obtenir de la France le statut de département français afin d'assurer un ancrage définitif de l'île au sein de la République Française. Le 24 décembre 1976, la loi faisant de Mayotte une collectivité territoriale est votée.
Le 11 février 1977, décret no 77-129, fixe le chef de Mayotte à Mamoudzou, même si Dzaoudzi-Labattoir reste le chef-lieu transitoire, en attendant qu'un arrêté ministériel officialise définitivement ce transfert.
La situation économique dans l'État comorien est de plus en plus précaire, les libertés politiques sont remises en cause. En 1978, 8 000 réfugiés comoriens vivent à Mayotte qui ne compte encore que 47 000 habitants.
L'installation de la garnison et de la nouvelle administration préfectorale française, calquée sur celle de la métropole, provoque un afflux monétaire sans précédent. Les meilleurs agriculteurs délaissent leurs champs pour prendre un emploi de service à faible qualification. Le passage du SMIC à 800 Francs détermine le retrait des sociétés coloniales : elles vendent leurs terres à la France. Ainsi échoient à l'autorité politique et administrative coup sur coup deux adaptations à l'économie moderne : la production de cultures vivrières et la mise en valeur des ressources locales pour l'exportation.
an 1977-1992 : Mozambique - La guerre civile (1977-1992)
Le FRELIMO, s'appuyant sur sa légitimité au sein de la population mozambicaine, se proclame parti unique.
Samora Machel met alors en place un régime socialiste et dictatorial, nationalisant les industries et les fermes. Il tente de regrouper autoritairement les villageois dans des villages communautaires, inspirés des villages tanzaniens d'Ujamaa, dans le but de favoriser l'accès aux services et à l'éducation de la population mais aussi pour subroger les anciennes plantations coloniales par des fermes d'État.
Dans les mois qui précèdent son indépendance, le Mozambique est abandonné par la grande majorité des 4 500 propriétaires d'entreprises agricoles et le réseau de milliers de magasins faisant l’essentiel du commerce est presque totalement démantelé. L'économie, et en particulier l'agriculture, est alors complètement désorganisée. Le processus de reconstruction de la structure productive et du réseau de commercialisation, lent et conflictuel, est cependant progressif jusqu’en 1981. À partir de cette date, les actions de banditisme armé, soutenu par l'Afrique du Sud et les États-Unis, entraînent le Mozambique dans une nouvelle période de régression économique. Ces actions, localisées pour la plupart dans les zones rurales, sabotent la production des entreprises, causent la destruction des infrastructures commerciales et des voies de communication, et ciblent également les paysans. Des migrations forcées se produisent, créant ou aggravant les situations de famine.
Sur le plan international, le Mozambique se conforme aux sanctions économiques internationales contre la Rhodésie du Sud et l'Afrique du Sud, en dépit de ses propres intérêts économiques, ce qui accentue la désorganisation économique, politique et sociale du pays. Le pays accorde accueille également des mouvements nationalistes en lutte contre les systèmes ségrégationnistes de Rhodésie et d'Afrique du Sud. Mais, en moins de deux ans, à la suite du départ massif des cadres portugais, de l'échec rapide des fermes d'État et de l'effondrement du trafic portuaire et ferroviaire, conséquence logique de l'hostilité du gouvernement mozambicain à la Rhodésie et à l'Afrique du Sud, le pays est ruiné et au bord de la banqueroute. La campagne de sabotage systématique menée par la Résistance nationale du Mozambique (RENAMO), financée et soutenue d'abord par la Rhodésie puis par l'Afrique du Sud, finit par plonger le pays dans une guerre civile qui dura seize ans.
En 1979, André Matsangaíssa, le chef de la RENAMO, est abattu, mais la guérilla se maintient. Afonso Dhlakama lui succède.
Après l'indépendance du Zimbabwe en 1980, l'Afrique du Sud prend la relève de la Rhodésie dans le soutien financier et logistique à la RENAMO. Le pays est alors coupé en deux. La RENAMO oscille entre mouvement de rébellion et groupement mafieux adepte du banditisme et du sabotage. Toutes les voies de communication sont coupées, les lignes de transport d'énergies sabotées et les aménagements ruraux détruits. Le port de Maputo sombre dans le marasme alors qu'une sècheresse dévastatrice s'abat sur le pays, causant famine et déplacement de la population. Le Mozambique devient devenir pendant une quinzaine d'années l'un des trois pays les plus pauvres au monde et est tributaire de l´aide internationale, notamment celle en provenance des pays scandinaves.
Dès 1980, le FRELIMO prend acte de l'échec de sa politique économique et sociale. Samora Machel impute cet échec aux éléments ultra-gauchistes du FRELIMO. L'agriculture familiale est alors réhabilitée et les fermes d’État réformées. En 1983, le pays tourne le dos au socialisme et adhère au FMI et à la Banque mondiale. Les capitaux occidentaux, notamment portugais, commencent à revenir au Mozambique.
Des commandos sud-africains effectuent des raids fréquents, ciblant en particulier les bases de l'African National Congress (ANC). L'armée de l'air mène des frappes directement sur Maputo en 1983. Le gouvernement mozambicain accuse aussi d'anciens colons portugais vivant en Afrique du Sud et au Portugal, ainsi que des États conservateurs du Golfe (Arabie Saoudite et Oman) d'apporter une aide matérielle aux "bandits armés" de la RENAMO, via les Comores et le Malawi.
En 1984 a lieu, à Komatipoort, une rencontre au sommet entre Pieter Botha, président d'Afrique du Sud, et Samora Machel ; elle aboutit à l'accord de Nkomati, prévoyant l'arrêt de l’aide du Mozambique au Congrès national africain en échange de la fin du soutien sud-africain au RENAMO. Mais c'est un échec, aucun des signataires ne respectant sa signature. En même temps, le pays adhère au FMI et à la Banque mondiale ; il obtient ainsi une aide au développement des pays de la CEE et des États-Unis.
En 1986, l'avion présidentiel dans lequel se trouvait Samora Machel, de retour de Zambie, se déroute et s'écrase en Afrique du Sud, à 300 mètres de la frontière mozambicaine. Neuf passagers sont rescapés des restes du Tupolev piloté par un équipage soviétique, mais le président Samora Machel figure parmi les morts. L'enquête internationale, dirigée par le juge sud-africain Cecil Margo (en), à laquelle participèrent officieusement les Soviétiques et les Mozambicains, conclut à une série de négligences de l'équipage. Pour autant, les commentateurs et historiens n'écartent pas complètement l'hypothèse d'un sabotage par les services secrets sud-africains.
Après une courte période d'intérim, Joaquim Chissano succéde au père de l'indépendance mozambicaine. Il entreprend immédiatement un rééquilibrage diplomatique et pacifie ses relations avec le Malawi voisin, que Samora Machel avait accusé de donner refuge à la RENAMO. Il effectue un virage économique en procédant aux premières privatisations dans l'industrie alors que les Sud-Africains eux-mêmes étaient encouragés à réinvestir dans le pays.
En 1988, Chissano se détourne de l'URSS qui, par deux fois, avait refusé de lui accorder l'accession au COMECON. Si Chissano maintient néanmoins le traité d'amitié entre les deux pays, il se tourne uniquement vers les Européens et les États-Unis pour obtenir une aide financière.
Le 13 septembre 1988, à Songo, Joaquim Chissano et Pieter Botha renouvèlent la coopération entre leurs pays respectifs pour sauver le barrage de Cahora Bassa. Le rapprochement entre les deux gouvernements est facilité par l'entregent de Pik Botha, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, qui devient un habitué de Maputo.
En juillet 1989, le FRELIMO renonce au marxisme. Peu de temps après, Chissano accueille encore une fois Pieter Botha, sur le site du barrage de Cahora Bassa, au moment de l'achèvement des travaux de la commission tripartite (Portugal, Mozambique, Afrique du Sud) pour la réhabilitation de ce grand projet de développement électrique.
En 1990, alors que les régimes d'Europe de l'Est s'effondrent les uns après les autres (précédant la fin de l’Union soviétique en 1991) et que Frederik de Klerk légalise l'ANC en Afrique du Sud, les premiers pourparlers de paix ont lieu entre le FRELIMO et le RENAMO, débouchant en novembre sur une nouvelle constitution, reconnaissant le pluralisme politique.Le 4 octobre 1992, à Rome, un accord de paix est signé sous l’égide de la communauté de Sant'Egidio et avec l’appui de l'ONU, entre Joaquim Chissano pour le FRELIMO et Afonso Dhlakama pour le RENAMO. Il prend effet le 15 octobre.
Le RENAMO se transforme en un parti politique classique, Afonso Dhlakama restant à sa tête. Une force de maintien de la paix, l’ONUMOZ, est alors déployée au Mozambique. Ses derniers contingents quittent le pays en 1995.
La guerre civile a fait finalement un million de victimes, autant de réfugiés dans les pays voisins, et quatre millions de déplacés à l’intérieur du pays.
an 1977 : Sénégal - 20 avril 1977 : Ouverture à Dakar de la 4ème conférence franco-africaine, en présence du président de la république française, Valéry Giscard d’Estaing.
an 1977 : Seychelles - En 1977, un avocat, France-Albert René, alors Premier ministre, prend le pouvoir. Devenu président (de 1977 à 2004), il instaure un parti unique, socialiste à tendance marxiste. Depuis lors, les Seychelles se définissent comme révolutionnaires et tiers-mondistes. Toujours en place en 1991, le président René a, sous les pressions (discours de La Baule, 20 juin 1990), accepté d'engager son pays sur la voie du multipartisme et d'un certain libéralisme, autorisant notamment davantage de privatisations. Il quitte la présidence en 2004, à 69 ans, cédant sa place à James Michel, qui est réélu le 30 juillet 2006.
an 1978-1979 : Afrique du Sud - À la suite de la démission de John Vorster, des élections internes au sein du parti national ont lieu pour désigner son successeur au poste de président du parti et à celui de Premier ministre. Trois candidats sont en lice, Pik Botha, ministre des Affaires étrangères, représentant de l'aile libérale du parti et deux conservateurs, Pieter Botha, ministre de la défense, président du parti national dans la province du Cap, et Connie Mulder, président du parti national dans le Transvaal et Ministre des relations plurales et du développement. Au premier tour du scrutin, Pik Botha est éliminé. Au deuxième tour du scrutin c'est Pieter Botha, homme du sérail nationaliste mais réputé pragmatique et réformiste qui l'emporte, contre Connie Mulder, par 78 voix contre 72.
Le gouvernement de Pieter Botha est un subtil équilibre entre conservateurs (les « crispés » ou verkramptes en afrikaans) et libéraux (« éclairés » ou verligtes en afrikaans). Botha confie le ministère de la Défense à un proche, le général Magnus Malan, mais il maintient Pik Botha au ministère des affaires étrangères, et nomme au ministère de l'énergie, Frederik de Klerk, un conservateur du Transvaal, fils de l'ancien ministre Jan de Klerk. Si Botha fait figure, à l’origine, de partisan intransigeant de l'apartheid, ses fonctions à la tête de l'État l'amènent à trancher en faveur du camp des verligtes. Ses discours, tel que Adapt or die, annoncent des changements dans la politique raciale du gouvernement. En 1979, son ministre de l'emploi, Fanie Botha, procède à l'abandon de la loi d'apartheid réservant les emplois dans les mines aux blancs et autorise la formation de syndicats noirs dans le domaine minier.
Du côté de l'opposition parlementaire, le parti progressiste fédéral adopte un programme radical. En plus de proposer d'instituer un état fédéral permettant de partager le pouvoir entre Blancs et Noirs, le parti abandonne l'idée de proposer une franchise électorale basée sur les revenus et l'instruction pour promouvoir le suffrage universel sous forme d'un scrutin à la représentation proportionnelle et d'un régime constitutionnel accordant un droit de veto aux minorités. Pour s’attirer le soutien des dirigeants noirs les plus contestataires ou les plus sceptiques quant à l'utilité de cette opposition parlementaire, le parti abandonne toute référence à la civilisation occidentale, au statut de Westminster et à la notion de libre entreprise, et promeut le principe d'un état neutre, redistributeur de richesses.
1978 : Algérie - Le secteur de l'agriculture est modifié par plusieurs réformes dont la construction des villages socialistes et la réalisation du barrage vert, 1 500 km de long, 20 km de large et constitué de 3 millions d’hectares. Cependant Krim Belkacem s'oppose ouvertement à la politique de Boumédienne, le pouvoir l'accuse d'avoir organisé un coup d'État et le condamne à mort par contumace. Krim Belgacem sera assassiné à Francfort en 1970. Ferhat Abbas aussi dénoncera le système unique en 1976, il sera assigné à résidence surveillée jusqu'à 1978.
Sur le plan interne, le pouvoir continue la nationalisation et démarre les trois révolutions : industrielle, agraire et culturelle. Une charte et une constitution sont adoptées. L'arabisation des institutions est décrétée. En 1975, le président français Valéry Giscard d'Estaing est reçu à Alger. En 1978, la base secrète française B2-Namous sera fermée. Houari Boumedienne meurt en 1978 et Rabah Bitat est chargé de l'intérim de l'État. Chadli Bendjedid est désigné pour être élu par le peuple.
1978-1979 : Congo-Kingshassa - Zaïre - Le 25 janvier 1978, au moins 500 personnes au moins sont exécutées par le régime près de la ville d'Idiofa, à la suite de la rébellion d'un mouvement religieux. Les supposés chefs de ce mouvement sont pendus en public. En 1979, des centaines de chercheurs de diamants qui avaient organisé un trafic sont massacrés par les troupes d'élite à Mbujimayi.
Mai 1978 : à nouveau, 4 000 rebelles venus d’Angola, « les gendarmes katangais », attaquent la ville minière de Kolwezi, comme on les accuse d’avoir massacré des Européens, la Légion étrangère française et des soldats belges interviennent pour mater la rébellion
1978-1986 : Érythrée - De 1978 à 1986, le Derg (junte au pouvoir en Éthiopie) lance huit offensives d'importance contre le mouvement indépendantiste sans parvenir à le dominer. En 1988, le FPLE prend Afabet, où se trouvaient les quartiers généraux de l'armée éthiopienne au nord-est de l'Érythrée, forçant le retrait de l'Éthiopie vers les plaines de l'ouest. Le FPLE progresse ensuite vers Keren, deuxième ville d'Érythrée. À la fin des années 1980, l'URSS informa Mengistu qu'elle ne renouvelle pas son accord de défense et de coopération. L'armée éthiopienne s'en trouve affaiblie et le FPLE, soutenu par d'autres forces rebelles éthiopiennes, poursuit son avance vers les positions éthiopiennes.
1978-1979 : Ghana - Le lieutenant-colonel Ignatius Kutu Acheampong, temporairement commandant de la Première Brigade autour d'Accra, mène ce coup d'état, sans effusion de sang , mettant ainsi fin à la Seconde République, et s’installe au pouvoir. Il y reste jusqu’au 5 juillet 1978. Plusieurs changements sont mis en œuvre au Ghana durant cette période : l’adoption du système métrique, le changement de la conduite à gauche pour la conduite à droite, l'"Opération RSS Yourself "(un programme visant à développer l'autonomie dans l'agriculture), la « reconstruction nationale » (visant à promouvoir l'emploi et des compétences pour les travailleurs), les projets de rénovation dans les villes, et la reconstruction / mise à niveau des stades conformément aux normes internationales.
En juillet 1978, il est renversé par un coup d’État mené par un autre militaire. Il est remplacé par le chef d'état-major de la Défense, le lieutenant-général Fred Akuffo. Il reste en résidence surveillée. Puis il est arrêté avec deux autres anciens chefs d’État (le général Afrifa et le général Akuffo) et cinq autres officiers supérieurs (Amedume, Boakye, Felli, Kotei et Utuka), et exécutés par un peloton le 16 juin 1979, après un énième coup d’État le 4 juin 1979 qui amène au pouvoir le capitaine d'aviation Jerry Rawlings. Le Conseil révolutionnaire des forces armées réapparaît.
1978 : Kénya - Présidence de Daniel arap Moi - À la mort de Kenyatta le 22 août 1978, le vice-président Daniel arap Moi devient président par intérim, puis officiellement président le 14 octobre suivant. Le « style » du nouveau président, qui part à la rencontre des citoyens, tranche avec celui de son prédécesseur qui gouvernait « derrière des portes closes ». En signe d'apaisement, il libère Oginga Odinga et le nomme président de la Cotton Lint and Seed Marketing. Odinga ne reste pas longtemps à ce poste, vraisemblablement parce qu'il a toujours un trop franc-parler à propos de Kenyatta et, même, de Moi. Il accuse celui-ci de corruption et critique ouvertement les axes politiques suivis comme la trop grande présence militaire des États-Unis au Kenya.
1978-1980 : Mali - Moussa Traoré décide rapidement de se séparer de l’aile dure du Comité militaire de libération nationale qui lui reproche sa volonté d’ouverture. Il fait arrêter le 28 février 1978, Kissima Doukara, ministre de la Défense et de l'Intérieur Karim Dembélé et Tiécoro Bagayoko, directeur des services de sécurité, en leur reprochant une tentative de coup d'État. Le 30 avril, les directeurs de la Somiex et de la Comatex, des proches de Tiécoro Bagayogo, sont arrêtés pour corruption.
Le procès politique de « la bande des trois » a lieu du 18 au 21 octobre, Kissima Doukara et Tiécoro Bagayoko sont condamnés à mort, Karim Dembélé est condamné à 20 ans de travaux forcés. Deux ans plus tard, le 28 juin 1980, ils seront de nouveau jugés, cette fois pour détournement de fonds publics. Kissima Doukara, et Nouhoun Diawara, ancien intendant général de l'armée sont condamnés à mort pour détournement de fonds publics tandis que Tiécoro Bagayoko, ancien directeur des services de sécurité est condamné à 5 ans de travaux forcés et Karim Dembélé à 3 ans de prison.
Le 4 mai 1978, un remaniement ministériel permet l'entrée au gouvernement de jeunes intellectuels progressistes, séduit par une prétendue ouverture démocratique, comme Alpha Oumar Konaré qui devient ministre Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture.
1978 : Ouganda - En 1978, l'Ouganda frôle la faillite, et le gouvernement ougandais est aidé financièrement par les États arabes amis d'Amin Dada. Son régime prendra fin avec la guerre ougando-tanzanienne qui voit les rebelles ougandais prendre le contrôle du pays avec l'aide militaire de la Tanzanie.
an 1978 : Réunion (Ile de la) - premiers Jeux des Îles de l'océan Indien.
an 1978 : Sénégal - 26 février 1978 : Réélection à la présidence de la république de Léopold Sedar Senghor. Pour la première fois il a dû affronter un candidat de l’opposition, Abdoulaye Wade, chef du PDS (Parti Démocratique Sénégalais), qui a remporté 17 % des voix.
18 mars 1978 : Rétablissement des relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal au cours d’une réunion des chefs d’état à Monrovia.
an 1978 - 1979 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - En 1978, des accords internes ont lieu entre gouvernement rhodésien et mouvements nationalistes noirs modérés pour la mise en place d’une nouvelle assemblée et d’un gouvernement multiracial. En 1979, l’État éphémère de Zimbabwe-Rhodésie est créé, puis réintégré au Royaume-Uni, avant que les accords de Lancaster House préparent l’indépendance du Zimbabwe et une redistribution des terres après dix ans.
Craignant une fuite massive des capitaux, le nouveau régime accepte d'introduire dans la Constitution un article protégeant la propriété privée, notamment foncière, ainsi qu'une clause interdisant toute modification de la loi fondamentale pour une période d'au moins sept ans, ce qui a permis de rassurer les milieux économiques.
Il en est toutefois suspendu en 2002 pour violation du droit international par son gouvernement de l'époque, qui décide officiellement de s'en retirer en décembre 2003. Le pays est aujourd’hui candidat à sa réintégration, issue jugée improbable à court terme à la fin des années 2010.
1979 : Algérie - Après la mort de Boumédiène, Chadli Bendjedid prend la tête de l'État algérien, le 9 février 1979. Il fait sortir tous les prisonniers politiques. Le secteur économique devient libéral. La politique de l'arabisation continue malgré le Printemps berbère en 1980 et les revendications des élites francophones.
Il engage des réformes économiques fondées sur une libéralisation de l'economie, mais celle-ci est mal gérée et alimente la corruption. L'effondrement du prix des hydrocarbures en 1988, l'endettement de l'État et l'explosion démographique accélérent la crise du « modèle de développement algérien » et du système mis en place par le FLN.
an 1979-1985 : Angola - Alors que les forces du MPLA sont appuyées par des soldats cubains (commandées par le général Arnaldo Ochoa, exécuté à Cuba plus tard pour haute trahison et trafic de drogue en 1989) et l’aviation soviétique, celles de l’UNITA le sont par des soldats sud-africains.
Neto lance une opération militaire au Zaïre voisin dans la région du Shaba et fait noyer des mines afin de nuire à l’économie du puissant voisin. Les troupes zaïroises se retirent alors qu'une tension se développe entre Mobutu et les Belgo-Américains. Le FNLA perd alors toute importance et son chef Holden Roberto, père historique du mouvement indépendantiste, doit s'exiler au Zaïre.
À la mort de Neto en 1979, Dos Santos prend le pouvoir à Luanda. Politicien habile, il désamorce lentement la guerre en se tournant vers l’Occident, en écartant l’aile radicale de son parti. Les secteurs agricole et minier sont ravagés par la guerre qui fait venir de nombreux réfugiés à Luanda, le pétrole reste la seule source de richesse sur laquelle repose la fortune des hauts fonctionnaires du MPLA, tandis que l’UNITA se finance grâce au trafic de diamants. Même indépendant le pays est encore dépendant du Portugal notamment en matière d’éducation ; si l’alphabétisation progresse c’est grâce aux ONG portugaises et brésiliennes qui développent aussi pour la première fois l’enseignement secondaire et universitaire.
En janvier 1984, l’Afrique du Sud obtient de l’Angola la promesse du retrait de son soutien à la SWAPO (mouvement indépendantiste marxiste-léniniste namibien installé en Angola depuis 1975) en échange de l’évacuation des troupes sud-africaines d’Angola. Néanmoins, les troupes cubaines demeurent, tout comme les militaires sud-africains.
Malgré cet accord, l'Afrique du Sud, sous prétexte de poursuivre les guérilleros de la SWAPO mène des opérations de grande envergure sur le sol angolais, chaque fois que l'UNITA subissait des offensives des forces gouvernementales angolaises. En parallèle, l'Afrique du Sud organise des attentats en Angola. En mai 1985, une patrouille angolaise intercepte à Malongo un commando sud-africain qui s'apprêtait à saboter les installations pétrolières. Les États-Unis procurent aux rebelles des missiles sol-air Stinger, en passant par la base de Kamina, dans le sud du Zaïre, base que les États-Unis envisageraient de réactiver de façon permanente. L'aide américaine porterait également sur des armes antichars devant permettre à l'UNITA de mieux résister aux offensives de plus en plus menaçantes de l'armée de Luanda contre les zones encore sous son contrôle dans l'Est et le Sud-Est du pays.
an 1979 : République de Centrafrique - En septembre 1979, l'opération Caban, organisée par la France, renverse Bokassa et l'opération Barracuda remet au pouvoir David Dacko. En effet, depuis quelque temps Bokassa se rapprochait de plus en plus de Kadhafi dont la politique au Tchad est en contradiction complète avec les intérêts français.
David Dacko réinstaure la République et rétablit les libertés fondamentales.
1979 : Congo-Brazaville - Le 5 février 1979, le colonel Denis Sassou Nguesso, prend le pouvoir ; il qualifie par la suite son coup d'État de « riposte résolue de l'ensemble des forces de gauche de notre pays contre le courant droitier », visant à rompre avec « la politique d'irresponsabilité, de démission nationale, d'obscurantisme et d'aplatissement devant l'impérialisme des éléments de la bourgeoisie bureaucratique ». Il reste au pouvoir jusqu'en août 1992. D'une manière générale, les successeurs de Ngouabi ne modifient guère la gestion des affaires de l'État, qui reste fondée sur le monopartisme et la centralisation de l'activité politique et administrative (système dit « Obumitri » pour « oligarchie, bureaucratie, militarisme et tribalisme »). Denis Sassou-Nguesso se pose en seul héritier légitime de Marien Ngouabi, la presse gouvernementale (notamment le journal Etumba) le présentant comme le mokitani ya Marien Ngouabi (« digne successeur de Marien Ngouabi » en lingala).
an 1979 : Eswatini (Swaziland) - Le royaume du Swaziland et le changement de nom en Eswatini - En 1979, le prince Mabandla Dlamini, plutôt libéral, est nommé à la tête du gouvernement mais sans réel pouvoir, il ne peut s'opposer à la volonté des partisans de la Monarchie absolue d'engager des négociations avec l'Afrique du Sud pour obtenir un accès à la mer par incorporation au Swaziland du bantoustan frontalier du KaNgwane (le projet d'annexion n'aboutit finalement pas).
1979-1984 : Éthiopie - La guerre civile provoque l'abandon et la destruction des cultures et détourne une part importante des énergies et crédits vers les opérations militaires. En 1979, une famine importante touche le Nord du pays du Wollo à l'Érythrée. À cette occasion, le régime entame une politique de déplacements forcés, dite de « villagisation ». Cette politique obéit à plusieurs objectifs : les autorités poussent d'une part les paysans à abandonner les zones sinistrées -pour cause de famine ou de guérilla- pour les transférer dans les régions du Sud plus clémentes et plus sures, de l'autre ces déplacement diminuent les capacités de regroupements dans les régions du Nord hostiles au régime. Cette politique est conduite à une plus grande échelle, lors de la famine de 1984-1986 : d'octobre 1984 à mai 1986, 2 800 000 personnes sont déplacées.
1979 : Ghana - Le 24 septembre 1979, le pouvoir est transmis par Jerry Rawlings à un gouvernement civil mené par le Président Hilla Limann. C’est la troisième République du Ghana, qui dure peu de temps. Le 31 décembre 1981, en effet, un nouveau coup d'État renverse le régime de Limann. Jerry Rawlings revient au pouvoir.
1979 : Guinée-Équatoriale - La présidence de Teodoro Obiang - Le 3 août 1979, Macías est renversé par un coup d'État, à l'instigation de son neveu, le colonel Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ancien chef de la prison de Black Beach. L'ancien dictateur est jugé et exécuté, tandis que se constitue un Conseil suprême militaire présidé par Obiang. Les îles sont renommées Bioko et Annobón. Le nouveau régime se trouve dans des conditions difficiles : les caisses de l'État sont vides et la population est inférieure des deux-tiers à ce qu'elle était lors de l'indépendance.
1979-1980 : Mali - Lors de l’élection présidentielle du 19 juin 1979, Moussa Traoré, candidat unique, est élu, ainsi que 82 députés, tous membres de l’UDPM.
Combat pour le multipartisme : En 1979, le Parti malien pour la démocratie et la révolution (PMDR) appelle, lors de sa conférence de Tombouctou en 1979, « les patriotes et démocrates maliens » à s’unir pour combattre le régime de Moussa Traoré.
an 1979 : Namibie - L’abolition de l’apartheid namibien (1977-1979)
En octobre 1977, le nouvel administrateur sud-africain, Martinus Steyn, un juge à la réputation de libéral, abroge la loi prohibant les mariages mixtes et celle sur l'immoralité (interdisant les relations sexuelles entre personnes de groupes de couleurs différentes). Les contrôles intérieurs auxquels étaient assujetties les populations noires hors de leurs homelands sont supprimés sur tout le territoire, à l'exception de la zone diamantifère côtière (autour de Luderitz) et de la frontière septentrionale.
Le 6 novembre, Mudge conclut une alliance avec dix autres mouvements ethniques dont la NUDO (National Unity Democratic Organisation), le parti de Clemens Kapuuo, pour former l'Alliance démocratique de la Turnhalle (DTA) dont la présidence est confiée à Kapuuo.
De retour à Windhoek, Andreas Shipenga fonde de son côté la SWAPO-démocrate alors qu’A. H. Du Plessis créait l'ACTUR (Groupe d'action pour le retour aux principes de la Turnhalle) avec une partie des Basters de Rehoboth favorables à l'autodétermination.
Le 27 mars 1978, le président de la DTA, Clemens Kapuuo, est assassiné par des inconnus. La SWAPO, qu'il combattait très durement, est accusée. Cet assassinat provoque de violents affrontements à travers le pays entre Ovambo de la SWAPO et Héréros de la NUDO. Un climat d'insécurité inconnu jusque-là s'installe dans le pays et touche toutes les communautés. Le 4 mai 1978, peut-être en représailles, l'armée sud-africaine lance un raid meurtrier sur un camp d'entraînement de la SWAPO à Cassinga en Angola (867 morts et 464 blessés).
Le 29 septembre 1978, la médiation du groupe de contact aboutit au vote de la résolution no 435. L'objectif de l'indépendance de la Namibie y est réaffirmé. Un groupe d'assistance pour la période de transition (GANUPT) est créé afin d'assurer la régularité du processus électoral. Le Finlandais Martti Ahtisaari est nommé représentant spécial de l'ONU chargé de la Namibie.
En décembre 1978, pour la première fois de l'histoire du territoire, tous les habitants du sud-ouest africain « indépendamment de leur race et de leur langue sont appelés à voter selon le principe un homme une voix ». Ces élections, cependant boycottées par la SWAPO et la SWANU, sont organisées pour désigner une assemblée constituante. Avec un taux de participation de 80 %, la DTA recueille 82,2 % des voix (41 sièges) face à l'ACTUR (11,9 %, 6 sièges soit les deux tiers des voix blanches), au Parti chrétien démocrate (2,7 %, 1 siège), au Herstigte Nationale Party pro-apartheid de Sarel Becker (1,8 %, 1 siège) et Basters du Front de Libération (1,4 %, 1 siège). Ces élections sont cependant déclarées nulles et non avenues par l'ONU.
À partir de mars 1979, une série de négociations rapprochées se déroulent à New York entre l'Afrique du Sud, les pays du groupe de contact et ceux de la ligne de front (Angola, Botswana, Zambie, Mozambique et Tanzanie). La SWAPO, d'abord réticente, finit par accepter la résolution 435 et le fait que la question de Walvis Bay soit résolue indépendamment.
Le 21 mai 1979, l'assemblée nationale du Sud-Ouest africain/Namibie vote la loi sur l'abolition totale de la discrimination raciale.
En 1979, la SWAPO devient membre officiel du mouvement des non-alignés.
Le 21 mai 1979, jour du vote de l'abolition de la discrimination raciste par l'ancienne assemblée constituante désormais assemblée nationale investie de pouvoirs législatifs, Windhoek devient le siège de l'administration politique du pays — à l'exception encore de la police, de l'armée, de la justice et des affaires étrangères.
Le 11 juillet 1979, tous les lieux publics sont ouverts aux populations de couleur et une loi anti-discrimination est promulguée.
À la fin de l'année 1979, un accord général est adopté sur la création d'une zone démilitarisée de part et d'autre de la frontière du nord, mais sans succès.
1979-1980 : Ouganda - Entre le départ d'Idi Amin en avril 1979 et décembre 1980, les gouvernements se succèdent : le premier gouvernement de Yusuf Lule tombe après 2 mois, celui de Godfrey Binaisa ne durera que 8 mois, après mai 1980, le pays sera dirigé par un directoire militaire.
an 1979 - 1990 : Tchad - Régimes de Goukouni Oueddei et Hissène Habré (1979 - 1990)
En 1980, les factions rebelles dirigées par Hissène Habré prennent la capitale et l'État tchadien, ses services publics, l'armée, les administrations centrales, s'effondrent. Pourtant, la seconde bataille de N'Djaména permet à Goukouni Oueddei d'évincer son rival, Hissène Habré, avec l'aide décisive du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.
Dans le cadre de sa présidence, Habré crée une police politique, la Direction de la documentation et de la sécurité (DDS), responsable de milliers d'enlèvements et d'assassinats politiques. Les investigations internationales, qui permettront de poursuivre Hissène Habré pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture, permettront d'établir que son régime serait responsable de la mort de plus de 40 000 personnes. Entre 1982 et 1985, les mouvements d'auto-défense créés dans le sud sont ainsi brutalement réprimés. Lors du mois de « septembre noir » de 1984, des villages entiers sont pillés et incendiés.
an 1979 : Togo - Le 30 décembre 1979, à la suite d'un référendum, le pays adopte une nouvelle Constitution dont les fondements sont la présence d'un chef de l'État et des armées, un parti unique (le RPT) et une assemblée de 67 élus au suffrage universel et qui figurent sur une liste unique, non modifiable.
an 1980 : Afrique du Sud - Le 8 mai 1980, Botha mandate une commission parlementaire dirigée par son ministre de la justice, Alwyn Schlebusch, afin d'examiner les réformes constitutionnelles proposées par une commission de 1977, la commission Theron, qui constate que le système parlementaire de Westminster est obsolète, inadapté à une société multiculturelle et plurielle comme la société sud-africaine, qu'il renforce les conflits politiques et la domination culturelle d'un groupe sur les autres, formant ainsi un obstacle à la bonne gouvernance du pays, mais qui ne remet cependant pas en question le principe des lois d'apartheid. Soutenus par les éléments de l'aile libérale du Parti national, Botha et son ministre de la réforme constitutionnelle, Chris Heunis, entreprennent alors une vaste réforme visant à présidentialiser le régime et, surtout, octroyer un droit de vote et une représentation séparée pour les métis et les Indiens en instaurant un parlement tricaméral. Mais rien n’est prévu pour les Noirs, pourtant majoritaires. Bien que cette réforme soit limitée et qualifiée de bancale par les libéraux, et que le principe de la domination blanche ne soit pas remis en question, les conservateurs « se crispent »
an 1980 : Algérie - Le pouvoir doit aussi faire face aux premiers mouvements populaires depuis l'indépendance. Il réprime le Printemps berbère de 1980, puis les émeutes de Sétif en 1986.
an 1980-1998 : République de Botswana - Mort de Seretse Khama. La présidence est transmise au vice-président, Quett Masire, qui est élu en son nom propre en 1984 et réélu en 1989 et 1994.
Malgré son opposition à la politique d'apartheid menée par l'Afrique du Sud, le Botswana reste, pour des raisons de dépendance économique, assez proche de son voisin
Masire prend sa retraite de son poste en 1998.
an 1980 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Au début des années 1980, la Haute-Volta est l'un des pays les plus pauvres du monde : un taux de mortalité infantile estimé à 180 pour 1000, une espérance de vie se limitant à 40 ans, un taux d’analphabétisme allant jusqu’à 98 % et un produit intérieur brut par personne de 53 356 francs CFA (soit 72 euros)
À la suite du renversement du président Aboubacar Sangoulé Lamizana par un coup d'État militaire le 25 novembre 1980. Le gouvernement est remplacé par un Comité militaire de redressement pour le progrès national (C.M.R.P.N.). Le colonel Saye Zerbo est le président du C.M.R.P.N., chef de l'État, président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale et des anciens combattants et chef d'état-major général des forces armées. Le Lieutenant-Colonel Badembié Pierre Claver Nezien est ministre de l'intérieur et de la sécurité5. Cependant, deux ans plus tard, le 7 novembre 1982, le C.M.R.P.N est à son tour renversé et doit céder le pouvoir au Conseil provisoire de salut du peuple (C.P.S.P.) du commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Le 9 novembre 1982, le Lieutenant-Colonel Badembié Pierre Claver Nezien est abattu d'une balle dans le dos dans des circonstances troubles. Il est rayé immédiatement des cadres de l'armée le 10 novembre 1982. Le commandant Jean-Baptiste Ouedraogo choisit par la suite pour Premier ministre Thomas Sankara, le leader du Rassemblement des Officiers Communistes (R.O.C.). Thomas Sankara ne reste au pouvoir que jusqu'au 17 mai 1983, moment où il est arrêté et emprisonné.
Le 25 novembre 1980, un coup d'État militaire porte le colonel Saye Zerbo au pouvoir.
an 1980 : Burundi - Les conflits latents entre Tutsis et Hutus se poursuivent dans les années 1970 et 1980
an 1980 : Cap Vert - Le coup d'État en Guinée de novembre 1980 provoque un refroidissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le projet d'union est ainsi enterré, et le PAIGC modifie son nom en PAICV (Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert). Il instaure un régime à parti unique d'inspiration marxiste (bien que non-aligné) qui perdure jusqu'en 1990.
an 1980 : Afrique - les Comores - Depuis les années 1980, de nombreux ressortissants du pays formé par les îles indépendantes, cherchent à gagner Mayotte, notamment depuis Anjouan, pour chercher des conditions de vie meilleures. Ils le font sur une mer difficile, au péril de leur vie, sur des embarcations à moteur hors-bord appelées localement kwassa kwassa. Ces personnes sont considérées comme des immigrés clandestins par les autorités de Mayotte et sont renvoyées de la manière la plus systématique possible sur le territoire de la RFIC, renommée plus tard en Union. L'Union, considérant que Mayotte fait partie du territoire proteste contre cette politique qui, selon elle, brime ses citoyens qui ne font que gagner une partie du territoire de l'Union.
an 1980 : Afrique République de Djibouti - plus de 150 000 habitants
an 1980-1991 : Éthiopie - Alors que l'URSS, en pleines perestroïka et glasnost, n'est plus en mesure de soutenir le régime, la fin du Derg semble se rapprocher lorsque les deux principaux mouvements de guérilla, le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) et le Front populaire de libération de l'Érythrée (FPLE) coordonnent leurs opérations à partir du milieu des années 1980. Une série de victoires conduit le premier mouvement à élargir ses objectifs au sein de la coalition du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE), censé libérer tout le pays. Le 21 mai 1991, Mengistu Haile Mariam décide de fuir le pays et une semaine plus tard, les forces du FDRPE pénètrent dans la capitale. Le 28 mai 1991, le régime du Derg est tombé et la date est devenue un jour de fête nationale.
an 1980 : Gabon - À la fin des années 1980, la chute du cours du pétrole plonge le Gabon dans une grave crise économique, incitant la population à multiplier les revendications sociales et politiques.
an 1980 : Libéria - Le 12 avril 1980, le gouvernement est renversé lors d'un coup d'État mené par Samuel Doe, un autochtone qui prend le pouvoir. Il instaure rapidement une dictature.
an 1980 : Guinée-Bissau - En 1980, les conditions économiques se sont détériorées de manière significative, ce qui entraîne un mécontentement général vis-à-vis du gouvernement en place. Le 14 novembre 1980, João Bernardo Vieira dit « Nino Vieira » renverse le président Luís Cabral, demi-frère du leader indépendantiste Amílcar Cabral et au pouvoir depuis l'indépendance, par un coup d'État militaire sans effusion de sang. La Constitution est suspendue et un conseil militaire de neuf membres de la révolution présidé par Vieira est mis en place.
Depuis lors, le pays a évolué vers une économie libérale. Des coupes budgétaires ont été effectuées au détriment du secteur social et de l'éducation.
an 1980-1990 : Maroc - 1980-90 : instabilité sociale
Depuis les dernières décennies post-coloniales, le Maroc penche pour une politique nationale agricole tandis que son voisin algérien se tourne vers l'industrialisation et la planification socialiste. Cette décision ne suffit pas à enrayer les inégalités sociales qui déclencheront la colère de la population à travers les émeutes de 1981 à Casablanca et de 1984 à Marrakech et dans le Nord (Tétouan, Al Hoceima, Nador). Les campagnes agricoles sont victimes d'une longue période de sécheresse, tandis que la chute des cours du phosphate et la politique de rigueur budgétaire imposée par le FMI assombrissent la conjoncture économique. Durant les années 1980, le roi Hassan II annonce la candidature marocaine à l'adhésion à la Communauté européenne, qui est déclinée par la Commission de Bruxelles. Le Maroc obtiendra cependant un statut de partenaire avancé auprès des institutions européennes et sera un acteur incontournable du dialogue euro-méditerranéen.
En revanche, l'année 1988 est celle de la réconciliation officielle entre le Maroc et l'Algérie, concrétisée par le rétablissement des relations diplomatiques et la réouverture des frontières, cette dernière mesure prenant fin en 1994. En 1989 à Marrakech une réunion des cinq chefs d'État maghrébins marque la naissance de l'Union du Maghreb arabe, regroupant le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, et prévoyant à terme l'émergence d'un marché unique et la libre circulation des biens et des personnes. La crise latente entre Rabat et Alger via le conflit au Sahara empêche cependant la réalisation de ces objectifs.
En 1984 avait déjà eu lieu une tentative de fusion maroco-libyenne par le traité d'Oujda pour compenser le retrait du Maroc des instances de l'OUA (à la suite de la reconnaissance officielle du mouvement sahraoui par l'organisation panafricaine). Mais cette union binationale échoue en 1986 en raison de la visite au Maroc du Premier ministre israélien Shimon Peres, accueilli à Ifrane par le roi, et du bombardement aérien de la Libye par les États-Unis alliés du Maroc. L'hostilité profonde de l'administration Reagan à l'encontre du régime de la Jamahiriya de Mouammar Kadhafi entérine donc la fin de l'union maroco-libyenne.
an 1980-1897 : Namibie - En avril 1980, le nouvel administrateur sud-africain, Gerrit Viljoen, promulgue la nouvelle constitution. La police et l'armée locale sont désormais placées sous le contrôle de l'assemblée et le 1er juillet le premier gouvernement du Sud-Ouest africain/Namibie est mis en place avec un conseil des ministres de onze membres présidé par Dirk Mudge.
En juillet 1980, de nouvelles défections minent la SWAPO avec le départ de la plus importante des ethnies de la bande de Caprivi.
En août 1980, les homelands sont dissous. L'unité territoriale de la Namibie est consacrée. Des élections locales sont organisées en novembre pour élire les dix gouvernements locaux. Si la DTA l'emporte dans la plupart des ethnies (Héréros, Kavangos, Namas, métis…), elle obtient 41,5 % des voix blanches (48,2 % au Parti national pro-apartheid et 10 % à l'extrême-droite) alors que l'Ovamboland est privé d'élections en raison de la guerre à ses frontières et de l'insécurité dans la région. À la fin de l'année, le service militaire devient obligatoire quand sont créées les forces territoriales du Sud-Ouest Africain (SWATF) lesquelles constituent 40 % des effectifs engagés dans la guerre de frontière. Elles participent en août 1981 au raid sur la province angolaise de Kunene.
L'arrivée de Ronald Reagan et des républicains au pouvoir aux États-Unis va singulièrement modifier le rapport de force diplomatique, très défavorable à l'Afrique du Sud jusqu’ici. Après avoir accusé l'ONU de partialité dans cette affaire, l'Afrique du Sud va se trouver un allié en Chester Crocker, le sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique. Il reprend en effet une idée sud-africaine, qui avait conditionné son départ de Namibie et l'application de la résolution 435 au retrait des forces soviéto-cubaines d'Angola. En faisant leur cette proposition, les États-Unis, rapidement soutenus par la majorité du groupe de contact, vont renforcer l'Afrique du Sud avec qui des contacts bilatéraux étroits s'établissent, limitant le champ de manœuvre de l'ONU.
En août 1982, la condition du retrait cubain devient une condition sine qua non pour les deux gouvernements. Peu de temps après, la SWAPO récuse le groupe de contact, suivie par la France qui, par la voix de son ministre Claude Cheysson, refuse d'avaliser la condition exigée par l'axe Pretoria-Londres-Washington.
Ces négociations directes ainsi que des dissensions internes finissent par miner la DTA de l'intérieur. Le retrait de l'alliance d'une partie importante des Ovambos du Parti national-démocrate conduit l'assemblée de l'Ovamboland à changer de majorité. La DTA ne détient plus la majorité que dans six des onze régions. Par ailleurs, le refus de l'administrateur de promulguer une loi relative aux fêtes légales namibiennes provoque la démission collective du conseil des ministres le 18 janvier 1983. L’assemblée nationale est dissoute et les pouvoirs exécutifs conférés à l'administrateur sud-africain.
En janvier 1984, l'Afrique du Sud obtient de l'Angola le retrait de son soutien à la SWAPO contre l'évacuation des troupes sud-africaines… d'Angola.
En mai 1984, en Zambie, des négociations sont pour la première fois organisées sous l'égide de Kenneth Kaunda et de l'administrateur du Sud-Ouest africain Willie van Niekerk entre la SWAPO, la SWANU, l'Afrique du Sud et dix-neuf partis namibiens. La conférence ne débouche que sur la scission de la SWANU dont l'aile radicale accuse l'aile modérée (dont le président Moses Katjiongua) d'être des « marionnettes de l'Afrique du Sud ». En rejoignant la SWAPO, ces militants de la SWANU lui apportent une hétérogénéité ethnique jusque là relativement absente.
En novembre 1984, les négociations entre la SWAPO et l'Afrique du Sud se poursuivent au Cap-Vert alors que le président angolais José Eduardo dos Santos se rallie à la proposition américano-sud-africaine de retrait multilatéral
En juin 1985, après deux ans et demi d'administration directe, l'Afrique du Sud remet en place un gouvernement intérimaire sur proposition de la conférence multipartite (réunissant dix-neuf partis internes) . À cette époque, les townships sud-africains sont en ébullition et la position de l'Afrique du Sud est sérieusement affaiblie dans les organisations internationales. Le rand est en chute libre et l'isolement politique et diplomatique du pays rejaillit sur la Namibie.
En 1987, la conférence de /Ai-//Gams est organisée par le Conseil des Églises de Namibie. Pour la première fois, la SWAPO accepte de participer à une conférence interne et se rallie aux conclusions réclamant la concentration de toutes les forces d'opposition contre l'administration sud-africaine.
an 1980-1987 : Ouganda - En décembre 1980, Obote reprend le pouvoir à la faveur d'élections contestées, déclenchant une guerre civile. Après plusieurs années de combat, Obote est renversé en 1985 par un coup d'état de ses propres généraux mais le régime ne parvient pas à contenir la rébellion de l'Armée Nationale de Résistance (National Resistance Army - NRA), et début 1986, avec la prise de Kampala, Yoweri Museveni s'empare du pouvoir.
Depuis la prise du pouvoir et la nomination de Museveni, le gouvernement, dominé par Museveni et son parti le Mouvement National de Résistance (National Resistance Movement - NRM), a globalement mis fin aux violations des droits de l'homme perpétrées par les gouvernements antérieurs, a progressivement libéralisé la vie politique, accordé une certaine liberté de presse et mis en œuvre d'importantes réformes économiques (permettant par exemple la réduction de l'inflation de 240 % en 1987 à 5 % en 1994) avec le soutien du FMI, de la Banque mondiale et de bailleurs de fonds.
Le succès économique du pays est particulièrement flagrant : le pays sinistré à l'économie moribonde à la fin de la guerre civile a réussi à afficher un taux de croissance moyen du revenu par habitant de 2,5 % pendant les 23 années suivantes, une diversification économique a été entreprise (la part de la culture du café dans les revenus d'exportation est passée dans la même période de 90 % à 10 %).
an 1980-1990 : Rwanda - Malgré sa dictature, Juvénal Habyarimana séduit les démocraties occidentales et fait passer son pays pour la « Suisse de l'Afrique ». L'aide internationale au développement arrive. Même les journalistes qui l'avaient critiqué le plus violemment, lui deviennent plutôt favorables dans les années 1980.
Les travaux collectifs « umuganda », service civique imposé le samedi, sont utilisés pour stimuler des actions de développement. De nombreux projets de développement, facilités par des jumelages avec des collectivités locales européennes (Belgique, France, Allemagne, Suisse, etc.) soulignent ces bonnes relations entre l'Europe et le Rwanda.
Les Églises sont très actives aussi dans ces projets. Le pape se rend au Rwanda très catholique en septembre 1990.
Cependant la question des réfugiés Tutsi à l'étranger persiste. Environ 600 000 Rwandais (Tutsis ou opposants Hutus) vivent en exil à la fin des années 1980. Des milliers de réfugiés avaient été refoulés d'Ouganda au Rwanda en 1982, puis à nouveau expulsés du Rwanda peu après. En 1986, le gouvernement rwandais annonce que le pays est trop peuplé pour pouvoir accueillir les réfugiés. Ceux-ci revendiquent leur retour, au besoin par la force, et fondent en 1987 le Front patriotique rwandais.
Subissant une pression aussi bien intérieure de la part d'hommes politiques, d'intellectuels ou de journalistes, qu'extérieure de la part de pays bailleurs de fond exigeant des réformes, Juvénal Habyarimana abandonne le 5 juillet 1990 la présidence de son parti unique et annonce un prochain changement de la Constitution pour donner naissance à une démocratie en autorisant la création de partis politiques. En septembre 1990, quatre journalistes sont jugés pour avoir publié des articles sur la corruption du gouvernement, mais sont acquittés. Une semaine plus tard, Habyarimana nomme les membres de la commission chargée d'étudier la réforme politique. C'est à ce moment que le Front patriotique rwandais décide de lancer une attaque contre le Rwanda depuis l'Ouganda.
an 1980 : Sénégal - 31 décembre 1980 : Léopold Sedar Senghor quitte le pouvoir et laisse sa place à son Premier Ministre, Abdou Diouf.
an 1980 : Zambie - Dans les années 1980, l'économie du pays vacill
an 1980 : Zimbabwe, ou Zimbabwé - Ère Mugabe (1980-2017)
En 1980, quinze ans après la déclaration unilatérale d’indépendance de Ian Smith, les Britanniques reconnaissent l’indépendance de la Rhodésie du Sud qui prend le nom de Zimbabwe, membre du Commonwealth. L’ancien chef de guérilla Robert Mugabe est le nouveau Premier ministre. Au niveau africain, l'indépendance du Zimbabwe (ex-Rhodésie du Sud) est tardive, pour un pays pourtant vaste, doté d'une population assez importante.
L'Union nationale africaine du Zimbabwe (ZANU) remporte haut la main le scrutin de 1980. Le soir de sa victoire, Robert Mugabe rassure la population blanche lors d'un discours axé sur l'apaisement et la réconciliation. Il va même au-delà des accords de Lancaster : il reconduit les chefs des services de renseignements de l'ancien régime, et nomme deux ministres blancs.
L'accent est mis sur l'éducation et la santé, secteurs dont les Noirs avaient été presque entièrement privés sous le régime de Ian Smith. En 1992, une étude de la Banque mondiale indique que plus de 500 centres de santé ont été construits depuis 1980. Le pourcentage d'enfants vaccinés est passé de 25 % en 1980 à 67 % en 1988 et l'espérance de vie est passée de 55 à 59 ans. Le taux de scolarisation a augmenté de 232 % une année après que l'enseignement primaire ait été rendu gratuit et les effectifs de l'enseignement secondaire ont augmenté de 33 % en deux ans. Ces politiques sociales entraînent une augmentation du taux d'endettement.
Entre 1980 et 1983, une « guerre civile » a lieu entre les deux mouvements nationalistes noirs ZANU (Shonas) et ZAPU (Matabélés et Ndébélés). Entre 1983 et 1987, le Gukurahundi a eu lieu où des milliers de civils Ndébélés ont été tués par l'armée zimbabwéenne.
Plusieurs lois sont adoptées dans les années 1980 pour tenter de diminuer les écarts salariaux. Les écarts sont toutefois restés considérables. En 1988, la loi donne aux femmes, au moins en théorie, des droits identiques à ceux des hommes. Elles ne pouvaient auparavant prendre que peu d'initiatives personnelles sans le consentement de leur père ou de leur mari.
En 1987, après une modification de la constitution, Robert Mugabe devient le président du Zimbabwe au 31 décembre. Dans les années 1990, plusieurs événements accentuent l’autoritarisme du régime et la situation économique se détériore significativement sous le poids des sanctions internationales, conduisant le régime à accepter une politique de « réajustement structurel » préconisée par les institutions financières internationales. Cette politique prend la forme d'une sévère cure d'austérité : sous la contrainte, le gouvernement réduit drastiquement la dépense publique et des dizaines de milliers de fonctionnaires perdent leur emploi. Ces réformes impopulaires génèrent un vent de colère dans les villes du pays gagnées par le chômage.
an 1981-1983 : Afrique du Sud - Aux élections de juin 1981, le Herstigte Nasionale Party, (HNP), obtient 13 % des voix révélant la méfiance des ruraux afrikaners vis-à-vis du gouvernement PW Botha alors que le Parti national, avec 53 % des voix, perd corrélativement onze points par rapport aux élections de 1977.
À l'annonce des propositions sur les nouvelles institutions, les conservateurs du Parti National, menés par Andries Treurnicht, tentent de censurer le gouvernement. Botha impose cependant sa réforme provoquant une cassure idéologique entre Afrikaners du Transvaal et de l'Orange avec ceux du Cap et du Natal. Au Transvaal, Frédérik de Klerk et Pik Botha évincent Treurnicht, le président du Parti National transvaalien, en ralliant la majorité des élus. Treurnicht et un autre ministre du gouvernement, Ferdinand Hartzenberg, ne tardent pas à tirer les conséquences de leur échec et à quitter le Parti National avec une dizaine de parlementaires pour fonder, le 20 mars 1982, le Parti conservateur (Conservative Party, CP). À l'occasion de son congrès fondateur, il est rejoint par la vieille garde du parti national en rupture de ban, tels les anciens ministres Jimmy Kruger, Connie Mulder, chef du groupusculaire Parti national-conservateur, de l'ancien président John Vorster193, ou de Betsie Verwoerd, la veuve d'Hendrik Verwoerd. Le CP échoue cependant à rallier le HNP, resté fidèle à son héritage verwoerdien, hostile à l'intégration des anglophones et partisans d'un démembrement de l'Afrique du Sud pour y créer un réduit blanc, le Volkstaat.
Botha poursuit néanmoins ses réformes. En 1983, du fait que les quatre universités publiques réservées aux Noirs, Métis et Indiens (Fort Hare, Turfloop, Durban Westville et Western Cape) ne peuvent plus absorber la demande croissante, les universités blanches obtiennent la latitude d'inscrire des étudiants noirs à leurs cours. En cinq ans, l'université du Witwatersrand affiche ainsi un tiers d'étudiants noirs tandis que celle de Stellenbosch, la plus élitiste des universités sud-africaines, en compte un plus de 2 %.
Depuis 1980, le congrès national africain connait une nouvelle popularité dans la jeunesse des townships. Si l'ANC n'a pas organisé la révolte de Soweto et a vécu péniblement son impuissance dans les années 1970, la nouvelle décennie s'ouvre sous des augures bien meilleures, à la suite du démarrage d'une campagne de presse non concertée du Post de Soweto et du Sunday Express de Johannesbourg, l'un en faveur de la libération de Nelson Mandela et l'autre pour connaitre sa notoriété parmi les sud-africains. Des comités (Free Mandela Comittee) demandant sa libération sont créés dans tout le pays mais l'initiative du Post passe relativement inaperçue parmi les Blancs. C'est autour de cet homme, érigé en symbole dans les ghettos noirs, que s'organise la résurrection politique de l'ANC face, notamment, à la conscience noire. Grâce à la mobilisation autour de Mandela et à la faible capacité d’organisation de ses rivaux, l'ANC se réimpose en quelques années comme la première force anti-apartheid de libération et la seule à disposer d'une capacité militaire, hormis le congrès panafricain d'Azanie195. Ce dernier est d'ailleurs en pleine déconfiture interne depuis la mort de son fondateur Robert Sobukwe en 1978.
an 1981 : République de Centrafrique - Le 1er septembre 1981, le général André Kolingba, profitant d'une période d'agitation sociale, contraint David Dacko par un coup d'État à lui remettre le pouvoir et instaure un régime militaire fortement influencé par le colonel Mantion, l'officier de renseignement français qui dirige aussi la garde présidentielle.
an 1981-2011 : Égypte - Après l'assassinat de Sadate (1981), Hosni Moubarak est Président de la République jusqu'en février 2011, date de sa démission contrainte à la suite de la Révolution égyptienne de 2011. Hosni Moubarak poursuit la politique de libéralisation de l’économie, notamment par la réduction des subventions à l'agriculture et à la consommation, et par la libéralisation des prix. En 1992, il fait annuler les dispositions régissant la location des terres. Généralement appelée « loi pour chasser les paysans de leurs terres », cette loi, combinée aux autres mesures de désengagement de l’État dans l’économie, accroît le mécontentement des populations rurales pauvres en particulier en Haute-Égypte. Hosni Moubarak devient un pilier de la stratégie régionale des États-Unis et la Constitution qu'il met en place reconnait les
« principes de la charia » comme source principale de la législation.
an 1981 : Gambie - La Gambie fut dirigée par le président Dawda Jawara qui a été réélu cinq fois de suite. Il y a une tentative de coup d'État le 29 juillet 1981. La Gambie connaît un affaiblissement de son économie et également des allégations de corruption contre des responsables politiques. La tentative de coup d'État a lieu pendant que le président Jawara était en visite à Londres. Ce coup d'État est perpétré par le Conseil de gauche révolutionnaire nationale, composé de socialistes et de révolutionnaires du Parti travailliste de Samba Sanyang Kukoi (PDS) et des éléments de la « Force de Campagne » (une force paramilitaire qui a constitué l'essentiel des forces armées du pays). Le président Jawara demanda immédiatement l'aide militaire du Sénégal qui déploie 400 hommes de troupe en Gambie le 31 juillet. Le 6 août, quelque 2 700 soldats sénégalais sont déployés et vainquent les forces rebelles. Entre 500 et 800 personnes sont tuées lors de ce coup d'État.
an 1981-1990 : Ghana - Le nouveau gouvernement qui prend le pouvoir le 31 décembre 1981 est le huitième dans les quinze années depuis la chute de Nkrumah. S'appelant lui-même Conseil «provisoire» de Défense Nationale (PNDC), ses membres comprennent Rawlings en tant que président, le Brigadier Joseph Nunoo-Mensah (qui Limann avait rejeté en tant que commandant de l'armée), deux autres policiers et trois civils. En dépit de ses origines militaires, l’exécutif s’efforce de laisser la place à la société civile, progressivement. Cette volonté se concrétise par la nomination de quinze civils aux postes de ministre.
Dans une émission de radio, le 5 janvier 1982, Rawlings expose les facteurs qui motive selon lui la chute de la Troisième République. Il veut «une chance pour le peuple, les paysans, les ouvriers, les soldats, les riches et les pauvres, de faire partie du processus de prise de décision.» Il décrit les deux ans depuis l'AFRC a remis le pouvoir à un gouvernement civil comme une période de régression au cours de laquelle les partis politiques ont tenté de diviser le peuple pour mieux régner. Le but ultime du retour de Rawlings est donc de «rétablir la dignité de l'homme pour les Ghanéens», en impliquant la population dans la transformation de la structure de la société. Bien que les nouveaux dirigeants conviennent de la nécessité d'un changement radical, ils divergent sur les moyens de l'atteindre. Par exemple, John Ndebugre, secrétaire à l'agriculture dans ce gouvernement, appartient à une organisation de gauche radicale, qui plaide pour une approche marxisme-léninisme. Il est bien éloigné des orientations économiques envisagées par les proches de Rawlings.
En accord avec l’engagement de Rawlings en janvier 1982, des comités et institutions se mettent en place pour intégrer la population en général dans les mécanismes du gouvernement national. Des comités de travailleurs, des comités de Défense (WDCs) des comités Citoyens, etc. Ces comités sont impliquées dans des projets communautaires et des décisions de la communauté. Les tribunaux publics, établis en dehors du système juridique, sont aussi créés pour juger les personnes accusées d’actes antigouvernementaux . Et des séminaires de une à quatre semaines visant à rendre ces cadres moralement et intellectuellement prêts pour leur rôle dans la révolution sont organisés à l'Université du Ghana, Legon, en juillet et en août 1983.
La première phase d'action commence en 1983. Son objectif est de retrouver une stabilité économique, en acceptant une étape d’austérité. Le gouvernement veut réduire l'inflation et de recréer la confiance dans la capacité du pays à récupérer. En 1987, le progrès est évident. Le taux d'inflation a chuté à 20 %, et entre 1983 et 1987, la croissance de l'économie du Ghana reprend. Des prêts arriérés datant d'avant 1966 sont payés. En reconnaissance de ces réalisations, les agences internationales promettent plus de 575 millions de dollars pour l'avenir du pays. Une phase Deux du redressement peut commencer qui prévoit la privatisation d'actifs de l'État, la dévaluation de la monnaie, et l'augmentation de l'épargne et de l'investissement, et qui se poursuit jusqu'en 1990. Par contre, un des problèmes de cette politique de redressement est l’accroissement du chômage.
an 1981 : Sénégal - 1er janvier 1981 : Abdou Diouf succède à Léopold Sedar Senghor à la présidence de la république.
14 novembre 1981 : Création de la confédération de Sénégambie.
an 1981 - 1987 : Tchad - Régimes de Goukouni Oueddei et Hissène Habré (1979 - 1990)
En janvier 1981, le Tchad et la Libye proclament leur fusion. Celle-ci ne sera jamais effective, Goukouni Oueddei choisissant d'y renoncer sous la pression de la France et de États-Unis. Les troupes libyennes se retirent dans le cadre d'un accord conclu avec le gouvernement français. En juin 1982, Goukouni Oueddei est renversé à son tour par Hissène Habré, soutenu par les services de renseignement français et les mercenaires de Bob Denard.
Le nouveau président doit faire appel l'année suivante, en 1983, au soutien des forces françaises (opération Manta) pour l'aider à contenir une nouvelle invasion libyenne et la percée des rebelles de Goukouni Oueddei. En 1987, une contre-offensive des forces tchadiennes et françaises contraint finalement les troupes libyennes à évacuer le pays, à l'exception de la bande d'Aozou qui est restituée au Tchad seulement en 1994
an 1982 : Haute-Volta future Burkina Faso -Le pouvoir est renversé en 1982 par un autre coup d'État militaire qui place le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo à la tête de l'État et le capitaine Thomas Sankara à la tête du gouvernement. Ce premier entre en conflit avec Sankara et le limoge de son poste de Premier ministre en mai 1983. Trois mois plus tard, le 4 août 1983, Thomas Sankara effectue un nouveau putsch et instaure le Conseil national de la révolution (CNR) d'orientation marxiste.
an 1982 : Cameroun - Le Premier ministre Paul Biya devient président de la République le 6 novembre 1982, après la démission du président Ahidjo "pour raison de santé".
an 1982 : Canaries (Îles des) - Le statut d'autonomie
Dans ce contexte, des partis régionalistes se forment, revendiquant l'indépendance ou l'autonomie, voire un virage politique vers les États d'Afrique du Nord.
Le 16 août 1982, les îles Canaries deviennent une des dix-sept communautés autonomes d'Espagne (comunidades autónomas), avec Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas de Gran Canaria comme capitales communes. Le siège du Premier ministre (Presidente del Gobierno) change à chaque législature.
Le Parlement des Canaries a pour siège permanent à Santa Cruz de Tenerife.
Pour la première fois dans l'histoire des îles, le 30 mai 1983, désormais jour férié aux Canaries, les Canariens sont libres de choisir leurs propres institutions politiques.
an 1982 : Congo Kimshasa (Zaïre) - création d'un parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), par 13 parlementaires qui seront condamnés à 15 ans de prison. Un expert du FMI, Erwin Blumenthal, rend un rapport sévère sur la corruption du régime.
an 1982 : Eswatini (Swaziland) - Le royaume du Swaziland et le changement de nom en Eswatini - En février 1982, un accord secret de non agression entre Mbabane et Pretoria est signé, réduisant les activités des membres des mouvements anti-apartheid exilés au Swaziland. Mbabane s'aligne sur la politique régionale de Pretoria.
En août 1982, le roi Sobhuza II meurt des suites d'une pneumonie, allumant une guerre de succession familiale. Le jeune prince Makhosetiwe est désigné pour lui succéder mais l'interrègne de cinq ans est l'objet d'une importante lutte de faction parmi les 3 500 membres de la famille royale. La régence est d'abord confiée à la reine Dzeliwe (« la grande éléphante ») immédiatement soumise à la pression de la faction Tibiyo de la famille royale, hostile au Premier ministre. Après le limogeage de ce dernier, accusé par ses détracteurs de fomenter un coup d'État, le nouveau Premier ministre traditionaliste, Bekhimpi Dlamini, entreprend de rogner les pouvoirs de la régente au profit du conseil traditionnel des monarques swazis (le Liqoqo) qui n'apprécie guère la régente et sa volonté de maintenir des élections à brève échéance. Le 9 septembre 1983, le conseil traditionnel nomme alors une nouvelle régente, la reine Ntombi, en dehors de tout cadre légal et institutionnel.
an 1982-1989 : Gambie - La Gambie est unie au Sénégal de 1982 à 1989 dans une éphémère confédération de Sénégambie.
an 1982-1992 : Kenya - En juin 1982 l'Assemblée nationale inscrit dans la Constitution le parti unique, mais cette clause est rejetée par le Parlement en décembre 1991. En décembre 1992 des élections multipartites donnent au KANU et son chef la majorité des sièges, et Moi est réélu pour un mandat de cinq ans, tandis que les partis d'opposition s'emparent de 45 % environ des sièges parlementaires.
1982 est marqué par une série de faits qui vont marquer le pays pour la prochaine décennie :
- en juin, Oginga Odinga tente d'enregistrer une nouvelle formation politique mais, entretemps, le Procureur général (Attorney General) Charles Njonjo (en) signe un amendement à la Constitution introduisant l'article 2A qui fait du KANU l'unique parti politique autorisé. Le Kenya est, maintenant devenu un État de monopartisme constitutionnel. Après l'avortement de ce plan contre le gouvernement de Moi, Odinga est de nouveau consigné à résidence à Kisumu. Tout au long des années 1980, la critique internationale à propos de la situation des droits de l'homme appliquée par le KANU va aller en s'amplifiant ;
- le 1er août, une tentative de coup d'État perpétré par la force aérienne kényane contre le président Moi échoue. Le fils d'Oginga Odinga, Raila, est accusé d'être l'un des instigateurs. Il est détenu préventivement pendant 7 mois avant d'être incarcéré jusqu'au 6 février 1988, sans avoir jamais été jugé, à la prison de haute sécurité de Kamiti à Nairobi.
an 1982-1983 : Ile Maurice - En 1982, un gouvernement MMM-PSM (dirigé par le premier ministre Anerood Jugnauth, le vice-premier ministre Harish Boodhoo et le ministre des finances Paul Bérenger) est élu. Cependant, des différences idéologiques et de personnalité apparaissent au sein de la direction du MMM et du PSM. La lutte pour le pouvoir entre Paul Bérenger et Anerood Jugnauth atteint son apogée en mars 1983. Anerood Jugnauth se rend à New Delhi pour assister à un sommet du Mouvement des non-alignés ; à son retour, Paul Bérenger propose des changements constitutionnels qui retireraient le pouvoir au Premier ministre. À la demande de Anerood Jugnauth, le Premier ministre indien Indira Gandhi planifie une intervention armée impliquant la marine et l'armée indiennes pour empêcher un coup d'État, sous le nom de code Opération Lal Dora.
Le gouvernement MMM-PSM se sépare neuf mois après les élections de juin 1982. Selon un fonctionnaire du ministère de l'Information, ces neuf mois sont une "expérience socialiste". Harish Boodhood dissout son parti, le PSM, pour permettre à tous les parlementaires du PSM de rejoindre le nouveau parti de Anerood Jugnauth, le MSM, restant ainsi au pouvoir tout en prenant ses distances avec le MMM. La coalition MSM-Travail-PMSD est victorieuse aux élections d'août 1983, avec pour résultat la nomination d'Anerood Jugnauth comme Premier ministre et de Gaëtan Duval comme Vice-Premier ministre.
an 1982 : Sénégal - 1er février 1982 : Naissance officielle de la confédération de Sénégambie.
an 1983 : Afrique du Sud - Après le succès d'opérations symboliques comme l'attentat contre la centrale nucléaire de Koeberg, Umkhonto we Sizwe commet, le 20 mai 1983, l'attentat à la bombe le plus meurtrier de son histoire à Pretoria (19 personnes tués, 217 blessés). Le gouvernement dénonce le terrorisme ou l'assaut communiste, mais ce type d'action a un impact important sur la population noire, qui lui apporte de plus en plus son soutien. En accentuant la pression, l'ANC veut également réduire le sentiment de sécurité de la population blanche.
En août 1983, les divers mouvements opposés à l'apartheid s'allient au sein du front démocratique uni (United Democratic Front - UDF) pour coordonner la résistance au régime. La création de cette UDF confirme l’influence grandissante du courant non racial face au panafricanisme. Son programme politique est celui de la charte de la liberté de 1955, ce qui lui donne rapidement l'allure de branche interne de l'ANC en Afrique du Sud. La première réunion de l'UDF rassemble près de 12 000 personnes à Mitchell's Plain ce qui constitue le plus grand rassemblement contre l'apartheid depuis les années 1950. Le rassemblement est multiracial avec la présence de Archie Gumede, d'Helen Joseph et de Allan Boesak, un pasteur métis de l'église réformée hollandaise, par ailleurs président de l'alliance mondiale des églises réformées et ancien adepte de la théologie noire de la libération, rallié au courant non racial. La croissance de l'UDF est très rapide et touche toutes les communautés sud-africaines, y compris les Blancs, une première depuis l'échec du parti libéral.
En novembre 1983, Pieter Botha fait adopter sa réforme constitutionnelle par référendum. Avec 76 % de participation, les Blancs approuvent à 65 % la nouvelle constitution qui institue un système présidentiel et parlementaire tricaméral. Le poste de Premier ministre est supprimé et Botha prend la fonction de président de la république (State President). Il s'agit moins pour les Blancs d'accorder le droit de vote aux minorités de couleur que de maintenir l’exclusion des Noirs de toute représentation parlementaire202. La première cible de l'UDF vise alors à organiser avec succès le boycott des élections aux chambres indiennes et métis du nouveau parlement à trois chambres201. De leur côté, les héritiers de Steve Biko et de la conscience noire tentent de revenir sur le devant de la scène via l'organisation du peuple d'Azanie (AZAPO) et le comité du forum national, un mouvement créé pour concurrencer l'UDF et porter un message radical, anti-capitaliste et socialiste, inspiré de l'Ujamaa du tanzanien Julius Nyerere, formalisé dans le « manifeste du peuple azanien », un projet politique qui se veut alternatif à la charte de la liberté. Concrètement, la rivalité entre l'UDF et les partisans de la conscience noire s'exprime violemment sur le terrain sans que les tentatives de médiation de l'archevêque du Cap, Desmond Tutu, parviennent à y mettre un terme. Enfin, une troisième organisation politique émerge, dirigée par Mangosuthu Buthelezi, un ancien membre de la ligue de jeunesse de l'ANC, favorable à un partage régional du pouvoir avec les Blancs à l'échelle de la province du Natal qu'il voudrait voir associée avec le KwaZulu, qu'il dirige, dans un Kwa-Natal comprenant une assemblée élue au suffrage universel avec des garanties accordées aux minorités. Son projet est soutenu par les milieux d'affaires et politiques du Natal, qui sont majoritairement anglophones, par les intellectuels libéraux et par certains secteurs du pouvoir. Buthelezi et son organisation, l'Inkatha Freedom Party, à dominante essentiellement zoulou, rêvent d'être une alternative à l'ANC qui, pour sa part, rejette ces propositions et s'oppose à toute formule fédérale ou confédérale pour l'Afrique du Sud.
an 1983 : Eswatini (Swaziland) - Le royaume du Swaziland et le changement de nom en Eswatini - En octobre 1983, les élections confirment la prééminence de la faction Tibiyo et des traditionalistes au sein de la chefferie.
an 1983-1999 : Nigéria - Le retour de la dictature (1983-1999)
Un nouveau coup d'État en 1983 replonge le pays sous la dictature du conseil militaire suprême.
Wole Soyinka devient en 1986 le premier Prix Nobel de littérature africain noir. Cette consécration va encourager l'émergence d'un gisement d'écrivains nigérians, dont de nombreuses femmes comme Chimamanda Ngozi Adichie, Helen Oyeyemi, etc.
Au début des années 1990, le delta du Niger, riche en pétrole, devient le théâtre de violents affrontements entre les minorités ethniques locales, qui accusaient l’entreprise pétrolière Shell de porter atteinte à leur culture et leur environnement, et les forces de sécurité nigérianes chargées de protéger les installations pétrolières. En 1993, le Mouvement pour la survie du peuple Ogoni, dirigé par l'écrivain Ken Saro-Wiwa, réussi à mobiliser des dizaines de milliers de personnes contre Shell. La situation devient une cause de mobilisation internationale, obligeant le numéro un mondial du pétrole à cesser sa production. Afin de la relancer, le gouvernement du général Sani Abacha déclenche une répression meurtrière. Des centaines d'Ogonis sont emprisonnés et, dans certains cas, exécutés sommairement. Deux ans plus tard, Ken Saro-Wiwa et huit militants ogoni sont exécutés. Depuis lors, Shell a admis avoir été "forcée" de payer directement les forces de sécurité nigérianes pour reprendre le contrôle de la région.
Le 12 décembre 1991, Abuja devient la capitale du pays, se substituant dans ce rôle à Lagos. C'est l'aboutissement d'un projet lancé en 1975. Lagos est le principal port du pays, un centre économique et industriel, le premier marché de l'emploi. C'est une ville excentrée dans le sud du pays, insalubre, surpeuplée, et en plus, identifiée à un groupe ethnique qui y est prédominant, les Yorubas. Le site choisi pour servir de capitale fédérale est au centre du Nigeria, à la limite de quatre États. Il est dans une zone située entre les régions chaudes et humides du Sud, et les régions plus arides du Nord. Quatre grandes rivières assez proches garantissent un approvisionnement correct en eau. Comme se plait à le répéter le ministre chargé de ce projet de nouvelle capitale fédérale, c'est « la première capitale d'Afrique construite sur un terrain vierge ».
En 1993, après des élections annulées par le gouvernement militaire, le général Sani Abacha arrive à la tête de l'État. À sa mort soudaine en 1998, Abdulsalami Abubakar prend le pouvoir et rétablit la constitution de 1979.
an 1983 : Réunion (Ile de la) - le 2 mars, le premier conseil régional français est élu. Il siège sur la Région Réunion.
an 1983 : Sénégal - 27 février 1983 : Abdou Diouf est confirmé dans ses fonctions par un scrutin au suffrage universel. Il obtient plus de 80 % des voix face à quatre autres candidats.
3 avril 1983 : Abdou Diouf prête serment. Un nouveau gouvernement est constitué.
29 avril 1983 : L’Assemblée Nationale adopte une réforme constitutionnelle supprimant la fonction de Premier Ministre.
Mai 1983 : Léopold Sedar Senghor est élu à l’Académie Française.
Décembre 1983 : En Casamance, des affrontements avec les forces de l’ordre provoquent la mort de 24 personnes. La persistance des troubles nécessite l’intervention de l’armée.
an 1983 : Soudan - En 1983, il y a extension du droit musulman au droit pénal alors qu'il était cantonné depuis la colonisation au droit personnel20. La guerre dans le Sud reprend, sous la direction de John Garang, chef de l'Armée populaire pour la libération du Soudan (APLS ou SPLA) : c'est le début de la Seconde Guerre civile soudanaise.
La proximité avec les États-Unis s’accentue sous l'administration de Ronald Reagan. L’aide américaine passe de cinq millions de dollars en 1979 à 200 millions en 1983, puis à 254 en 1985, essentiellement pour les programmes militaires. Le Soudan devient ainsi le deuxième bénéficiaire de l’aide américaine en Afrique (après l’Égypte). La construction de quatre bases aériennes destinées à accueillir des unités de la Force de déploiement rapide et d’une puissante station d’écoute, près de Port-Soudan, est mise en chantier.
an 1984 : Cameroun - Ahidjo démissionne, officiellement pour « raisons de santé », il regrette son choix ultérieurement, mais, à la suite d'un coup d'État manqué de la part de ses partisans, il est contraint à l'exil en 1984. La répression vise particulièrement les régions du Nord, où des centaines de personnes sont tuées. Cette révolution de palais met ainsi fin à un régime auquel un haut magistrat reprocha par la suite l'« hypertrophie du pouvoir exécutif, renforcé par le monopartisme envahissant, et [l']atrophie de tous les contrepoids, pour ne pas dire tout court [l']absence de contrepoids ». Le président Biya tente alors d'affermir son pouvoir en renouvelant totalement les cadres et les structures du parti unique, rebaptisé en 1985 Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il réussit même à y rallier quelques opposants « de l'intérieur ». L'ouverture est marqué, également, lors des élections municipales d'octobre 1987 : des élections pluralistes dans le cadre du parti unique. Quelques mois plus tard, Biya est réélu président, tandis que la quasi-totalité des députés sont battus par des nouveaux venus lors des législatives.
Seul candidat, Paul Biya est élu président en 1984 et 1988. Il adopte un plan d’ajustement structurel qui lui est présenté par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale : privatisation, ouverture à la concurrence, réduction des dépenses sociales, etc. Les salaires des fonctionnaires sont réduits de 60 %, le secteur informel augmente très significativement, mais les classes dirigeantes ne sont pas affectées par ce programme.
an 1984 : Haute-Volta future Burkina Faso - Le 2 août 1984, le président Sankara rebaptise son pays Burkina Faso. Le décret présidentiel est confirmé le 4 août par l'Assemblée nationale. Son gouvernement défend la transformation de l’administration, la redistribution des richesses, la libération de la femme, la mobilisation de la jeunesse et des paysans dans les luttes politiques, la lutte contre la corruption, etc.
Thomas Sankara retire aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu'ils continuaient d'exercer. Il crée les CDR (Comités de défense de la révolution), qui sont chargés localement d'exercer le pouvoir, gérant la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la production et la consommation de produits locaux ou encore le contrôle budgétaire des ministères. Cette politique visait à réduire la malnutrition, la soif (avec la construction massive par les CDR de puits et retenues d'eau), la diffusion des maladies (grâce aux politiques de « vaccinations commandos », notamment des enfants, burkinabés ou non) et l'analphabétisme (grâce aux « opérations alpha », l'analphabétisme est passé pour les hommes de 95 % à 80 %, mais seulement de 99 % à 98 % pour les femmes). Des projets de développement sont également portés par les CDR, comme l'aménagement de la « Vallée de la Sourou » destiné à irriguer 41 000 hectares.
Les dépenses de fonctionnement diminuent pour renforcer l'investissement. Les salaires sont ponctionnés de 5 à 12 % mais les loyers sont déclarés gratuits pendant un an. En 1986, le Burkina Faso atteint son objectif de deux repas et de dix litres d'eau par jour et par personne. Soucieux d'environnement, Sankara dénonce des responsabilités humaines dans l'avancée du désert. En avril 1985, le CNR lance ainsi les « trois luttes » : fin des coupes de bois abusives et campagne de sensibilisation concernant l'utilisation du gaz, fin des feux de brousse et fin de la divagation des animaux. Le gouvernement mène des projets de barrages alors que des paysans construisent parfois eux-mêmes des retenues d'eau. Thomas Sankara critique également le manque d'aide de la France, dont les entreprises bénéficient pourtant en majorité des marchés liés aux grands travaux. Symboliquement, une journée du marché au masculin est instaurée pour sensibiliser au partage des taches ménagères. Sankara avance aussi l'idée d'un « salaire vital », prélevé à la source d'une partie du salaire de l'époux pour le reverser à l’épouse.
an 1984 : Afrique du Sud - À partir du mois de septembre 1984, une vague de violence éclate dans les townships, que l'ANC appelle à rendre ingouvernables pour les autorités et à transformer en zones libérées. Les premières cibles de ces violences sont d'ailleurs tous ceux considérés comme collaborateurs, les maires et conseillers municipaux des townships, les policiers noirs ou ceux connus comme étant des informateurs de la police, qui sont souvent victimes du supplice du pneu. L'armée sud-africaine est envoyée dans les townships alors que s'organise une campagne de boycott du paiement des loyers. La répression alimente alors la révolte au lieu de la freiner et soude les communautés, les jeunes des townships étant, pour leur part, convaincus d'être dans la phase finale de leur lutte. Face à cette répression, les alliés naturels de l'Afrique du Sud, comme les États-Unis, s'en désolidarisent sous la pression de l'opinion publique et des mouvements noirs américains.
En 1984, pour sortir du blocage politique, le régime politique est présidentialisé et un parlement tricaméral, ouvert aux Indiens et aux Coloureds, est inauguré. Néanmoins, l'état d'urgence est de nouveau proclamé en 1986 alors que des sanctions économiques et politiques internationales isolent le pays en dépit de l'abrogation de lois symboliques de l'apartheid comme le passeport intérieur. Seul l'État d'Israël continue d'avoir des relations discrètes et collabore avec le pouvoir au point de vue militaire et sécuritaire : échanges de technologies, contrats de licences de fabrication d'armement, échanges techniques en matière de sécurité intérieure et savoir-faire d'espionnage.
an 1984 : Burkina Faso (anc. Haute-Volta) - Le 4 août 1984, sous l'impulsion de Thomas Sankara, la Haute-Volta change de nom pour Burkina Faso
an 1984 : Cameroun - Le Premier ministre Paul Biya, le 6 avril 1984, échappe à une tentative de coup d’État perpétrée par des membres de la Garde présidentielle. Plusieurs des putschistes sont arrêtés et quelques-uns exécutés. De nombreuses autres personnalités sont également interpellées et emprisonnées à cet effet. Associé au coup d’État manqué, l’ancien président Ahidjo sera condamné à mort par contumace puis gracié plus tard par le président Biya. La répression vise particulièrement les régions du Nord, où des centaines de personnes sont tuées. Paul Biya reprend dès lors en main le parti unique, qu'il rebaptise Rassemblement démocratique du peuple camerounais.
Seul candidat, il est élu président en 1984 et 1988. Il adopte un plan d’ajustement structurel qui lui est présenté par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale : privatisation, ouverture à la concurrence, réduction des dépenses sociales, etc. Les salaires des fonctionnaires sont réduits de 60 %, le secteur informel augmente très significativement, mais les classes dirigeantes ne sont pas affectées par ce programme.
an 1984-1998 : Guinée - Après la mort de Touré en 1984, le gouvernement intérimaire est rapidement renversé par Lansana Conté. Sous la pression des bailleurs de fond, il introduit le multipartisme en 1993 et organise des élections, qui l'ont confirmé par deux fois à la présidence, en 1993 et en 1998. Bien que globalement épargnée par les conflits des pays voisins, la Guinée est confrontée à l'afflux de plusieurs centaines de milliers de réfugiés venus du Libéria et de Sierra Leone.
an 1984-1994 : Guinée-Bissau - En 1984, une nouvelle constitution est approuvée et ramène le pays à la règle civile. La Guinée-Bissau, comme une grande partie de l'Afrique sub-saharienne, se tourne vers la démocratie multipartite au début des années 1990 avec la fin de la Guerre froide. L'interdiction des partis politiques est levée en 1991 et des élections ont lieu en 1994.
an 1984 : Mali - En 1984 est créé le Front démocratique des patriotes maliens, en 1986 le Front national démocratique populaire (FNDP) qui comprend le Parti malien du travail (PMT), le PMDR, le PDPM, rejoint en 1989 par l'US-RDA.
an 1984-1985 : Mauritanie - Le 12 décembre 1984, le Colonel Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya qui est le Chef d'état major des armées, Premier ministre (1981-1984) et Ministre de la Défense, accède au pouvoir par un coup d'État sans effusion de sang avec l'aide du Comité Militaire de Salut National dont il est président.
Ould Taya déclare vouloir moraliser la vie politique et redonner de la crédibilité à l'État.
Les relations entre le Maroc et la Mauritanie ont continué de s'améliorer depuis l'arrivee de Ould Taya au pouvoir, ce qui refléte la vision pragmatique du Président Ould Taya selon laquelle seule une victoire marocaine sur le Polisario mettrait fin à la guérilla au Sahara occidental. Ould Taya a effectué sa première visite au Maroc en octobre 1985 (avant les visites en Algérie et en Tunisie).
an 1984 : Réunion (Ile de la) - Création de l'Académie de La Réunion.
an 1984 : Sénégal - 11 janvier 1984 : Renforcement de la coopération et de l’aide économique française.
an 1984-1985 : Soudan - En 1984 et 1985, après une période de sécheresse, plusieurs millions de personnes sont menacées par la famine, en particulier dans l’ouest du Soudan. Le régime fait en sorte de cacher la situation à l'international.
an 1985-1986 : Afrique du Sud - En 1985, la police tue ving-et-une personnes lors d'une manifestation commémorative du massacre de Sharpeville. Durant l'année, 35 000 soldats sont déployés pour rétablir l'ordre dans les townships. Près de 25 000 personnes sont arrêtées, dont
2 000 de moins de 16 ans, et 879 personnes sont tuées dont les deux tiers par la police. De leur côté, les principaux syndicats noirs s'unissent dans la COSATU, tandis qu'Umkhoto we sizwe lance une campagne de terreur dans les zones rurales du Transvaal contre les fermiers blancs. En décembre 1985, une mine anti-personnelle déposée par l'aile militaire de l'ANC tue la famille d'un touriste afrikaner dans le nord du pays, puis, le 23 décembre, un jeune activiste fait exploser une bombe dans un centre commercial d'Amanzimtoti (5 morts, 40 blessés).
Contre toute attente P.W. Botha s'est révélé être un leader plus habile et rationnel qu'attendu lors de ses premières années de pouvoir. Il obtient les bonnes grâces de Javier Pérez de Cuéllar, secrétaire général de l'ONU, qui n'hésite pas à le mettre sur le même plan que le dirigeant chinois Deng Xiaoping. Mais sa réforme constitutionnelle inaboutie handicape sa capacité à se faire entendre et comprendre de ses opposants et de la communauté internationale. Ses performances sont nettement plus erratiques dans la seconde moitié de son mandat, notamment après son accident vasculaire cérébral en 1985. Son désastreux discours sur le franchissement du Rubicon, donné en aout 1985 à Durban, est symbolique de ces errances. P.W. Botha, au lieu d'initier de nouvelles ouvertures, se considère comme le leader absolu d'une minorité blanche déterminé à se battre jusqu'au bout pour sa survie. Le discours déclenche un exode massif de capitaux et l'intensification des sanctions contre l'Afrique du Sud.
Les années 1985-1986 marquent un tournant du point de vue des sanctions économiques internationales, pas réellement suivies d'effets jusque-là, avec la mise en place d'un embargo économique et financier de plus en plus contraignant. Les premières sanctions avaient été posées en 1962 par les Nations unies, sans être contraignantes. Avant 1984, seul un embargo sur les ventes de pétrole par les membres de l'OPEP et un embargo sur les ventes d'armes, proclamé par les Nations-Unies, avaient eu un minimum d'effets. À partir de 1984, alors que la situation intérieure se dégrade, quelques pays proclament et appliquent un embargo total sur le commerce avec l'Afrique du Sud (Suède, Danemark et Norvège) mais ils ne sont pas suivis par ses principaux partenaires commerciaux.
En 1985, le pays est connu pour être extrêmement riche en ressources, avec des minerais abondants et variés, et des exploitations agricoles modernes. Les activités du secteur industriel représentent 22 % du PNB et dépassent les valeurs minières (15 %). L'extraction des minerais est le monopole de puissants conglomérats internationaux ou sud-africains tels la De Beers pour le diamant. La présence de minerais rares, 65 % des réserves mondiales de chrome, 25 % du marché mondial de manganèse, recherchés pour les industries de défense, scientifiques et pour la production énergétique, font alors de l'Afrique du Sud un pays indispensable à maintenir dans la zone d'influence des pays occidentaux. Le pays est également le premier pays extracteur d'or, de platine et l'un des premiers pour l'argent.
Il possède de larges gisements de vanadium, de fluorine, de fer, d'uranium, de zinc, d'antimoine, de cuivre, de charbon, et de tungstène. Le secteur des industries de transformations est, de loin le plus solide et le mieux organisé du continent africain, atteignant sur de nombreux aspects le niveau des pays européens. Dépourvue d'hydrocarbures, l'Afrique du Sud a d'ailleurs perfectionné le procédé de liquéfaction de la houille (procédé Sasol) et a opté pour l'électricité nucléaire (centrale de Koeberg). Enfin, avec 11,2 % de surface cultivables, l'Afrique du Sud présente un visage contrasté où coexistent des exploitations modernes appartenant à des blancs et établies sur les meilleures terres du pays et des exploitations sous-développées, appartenant à des agriculteurs noirs, situées dans des bantoustans surpeuplés.
Cependant, la caractéristique de l'expansion économique de l'Afrique du Sud est qu'elle repose sur l'exploitation des ressources naturelles et sur une main-d'œuvre disponible à très bas coûts. La politique d'apartheid en matière économique entretient de fortes tensions sociales et maintient un développement réduit du marché intérieur, inhabituel pour un pays industriel moderne. La moitié de la population noire, majoritaire dans le pays, subvient ainsi à ses besoins via l'économie parallèle. L'économie sud-africaine est par ailleurs aussi très dépendante de la technologie et des capitaux étrangers. Si, durant les années 1960, l'économie sud-africaine est parmi les plus performantes au monde, du point de vue des taux de profit, elle subit de graves crises périodiques, notamment après les émeutes de Soweto de 1976. Cette dégradation économique ne manque pas d'avoir un impact sur les pays d'Afrique australe, très dépendants de l'Afrique du Sud, et qui absorbent 10 % de ses exportations. À partir de 1975, le pays enregistre ainsi une croissance économique relativement faible (2 % en moyenne), alors que la croissance démographique globale dépasse 2,5 % par an (dont 3 % pour les Noirs contre 0,8 % pour les Blancs). En termes de revenu par habitant, l'Afrique du Sud se place au troisième rang en Afrique avec près de 2 500 dollars, mais le revenu d'un Noir représente le quart de celui d'un Blanc et le tiers de celui d'un asiatique. Si le gouvernement réussit pendant longtemps à maintenir des échanges internationaux très intenses avec ses partenaires commerciaux, l'application de sanctions économiques internationales, surtout à partir de 1986, entrainent une diminution des investissements étrangers, un exode des capitaux, une baisse de la croissance économique (0,7 %) et une augmentation du chômage.
En 1985, le rand perd la moitié de sa valeur et l'exode des capitaux s'accélère, non seulement à cause des campagnes anti-apartheid, mais aussi en raison de la baisse de rentabilité des firmes étrangères implantées dans le pays. Ainsi le secteur minier, qui représente 70 % des exportations, stagne et le secteur industriel, le plus vaste du continent, décline, faisant perdre à l'Afrique du Sud son statut de pays nouvellement industrialisé212. L'année 1986 est marquée par la poursuite de la répression, des milliers d'arrestations et des centaines de morts avec son cortège de bavures policières et de meurtres menés par de mystérieux « escadrons de la mort à la sud-américaine », touchant à la fois des universitaires blancs de gauche ou des personnalités noires impliquées dans des organisations civiles anti-apartheid. Au début de l'année, plus de 54 townships du pays sont ainsi en guerre ouverte contre le gouvernement et sa politique d'apartheid, deux millions d'étudiants sont en grève et plus de deux millions de salariés font grève au début du mois de mai. Une médiation est tentée par les pays du Commonwealth pour amorcer des pourparlers entre l'État et l'ANC ; ils proposent qu'en échange de la libération de Nelson Mandela et de ses compagnons, l'ANC renonce à la lutte armée et accepte de négocier une nouvelle constitution sur le modèle des accords de Lancaster House pour la Rhodésie du Sud. Parallèlement, des représentants des plus grandes entreprises sud-africaines rencontrent des membres de l'ANC à Lusaka en Zambie. Le 12 juin 1986, après avoir imposé graduellement des mesures d'urgence dans plusieurs districts administratifs, Botha proclame l'état d'urgence dans les townships. Après avoir appelé à rendre les townships ingouvernables, l'objectif des militants anti-apartheid des townships est dorénavant de créer des contre-pouvoirs à travers la mise en place de comités de rues et de quartiers. La police sud-africaine (SAP) et les forces armées sud-africaines (SADF) disposent d'un arsenal assez important pour contourner les tribunaux, détenir des gens sans procès, interdire des organisations ou suspendre des publications, et l'état d'urgence place les forces de sécurité à l'abri de toute poursuite juridique, alors que le nombre de tués dans les townships augmente.
Devant cette accélération de la répression policière des mouvements anti-apartheid, seuls les États-Unis, premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud en 1985, adoptent une position dure en promulguant le comprehensive anti-apartheid act de 1986 (arrêt de nouveaux investissements, embargo sur plusieurs produits comme le charbon et l'acier, arrêt des liaisons aériennes) et ce, malgré le veto du président Ronald Reagan. En 1987, seules 8 % des exportations sud-africaines sont cependant affectées, alors que l'or et les métaux dits stratégiques ne sont frappés d'aucun embargo. Les exportations sud-africaines vers les États-Unis chutent de 44,4 %, mais cela résulte surtout de l'embargo sur le charbon et sur l'uranium. Le Japon remplace alors les États-Unis comme premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud en devenant le principal importateur de produits sud-africains, suivi par l'Allemagne et l'Angleterre. Entre 1981 et 1988, 40 % des multinationales opérant en Afrique du Sud quittent le pays (soit 445 firmes), néanmoins nombreuses sont celles qui maintiennent des liens financiers et technologiques avec leurs ex-filiales sud-africaines. Ainsi, 53 % des groupes américains ayant désinvesti d'Afrique du Sud ont néanmoins assuré la persistance d'un certain nombre d'accords de licence, de fabrication, d'accords de franchise ou d'échanges technologiques (IBM ou Ford par exemple).
P.W. Botha entreprend encore de nouvelles réformes à la portée plus ou moins limitée. Après avoir levé l'interdiction des mariages mixtes et des rapports sexuels entre personnes de couleurs différentes, il abolit certaines lois emblématiques de l'apartheid comme la loi sur le « passeport intérieur », et reconnait l'obsolescence du système ainsi que la pérennité de la présence des Noirs dans les villes de la République Sud-Africaine blanche. L'abolition des mesures vexatoires du petty apartheid (la suppression des bancs ou des bus réservés aux Blancs) provoque de vives réactions dans les milieux conservateurs.
an 1985 : Burkina Faso - En décembre 1985, une courte guerre frontalière, la guerre de la Bande d'Agacher, oppose le Burkina Faso au Mali. Elle s'achève grâce à la médiation du Nigeria et de la Libye : la bande de territoire contestée est partagée entre les deux États, en décembre 1986, par un jugement de la Cour internationale de justice.
an 1985-1990 : Congo Brazzaville - Les tensions s'accentuent à la fin de la première présidence de Sassou-Nguesso, en particulier après l'adoption d'un plan d'ajustement structurel en juin 1985, la dette extérieure du Congo étant devenu impossible à maîtriser. Des émeutes lycéennes se produisent les 9 et 11 novembre 1985. Mais le régime ne commence réellement à perdre le contrôle de la situation qu'au milieu de l'année 1990. La Confédération syndicale congolaise (CSC) présidée par Jean-Michel Bokamba-Yangouma, s'oppose à un projet d'abaissement de l'âge de la retraite des fonctionnaires de 60 à 55 ans, et se détache peu à peu du parti unique. Elle prend son indépendance le 16 septembre 1990. La fin de l'année est marquée par de nombreuses grèves.
an 1985-1986 : Leshoto - Le 19 décembre 1985, un commando sud-africain abattait neuf activistes de l'ANC à Maseru. Jonathan en appela alors à l'aide des pays non alignés. Le 23 décembre, un attentat commis par des membres de l'ANC tua en représailles cinq personnes à Amanzimtoti dans le Natal. L'Afrique du Sud organisa alors un blocus commercial et financier du Lesotho dans le but d'obtenir la fermeture du bureau de l'ANC à Maseru et l'expulsion de ses représentants.
Jonathan obtempéra finalement mais trop tard. Le 19 janvier 1986, le dictateur était balayé par un coup d'État militaire soutenu par Pretoria14 et dirigé par le général Justin Lekhanya (Jonathan se réfugia néanmoins en Afrique du Sud). Son premier geste fut d'édicter un décret redonnant ses pouvoirs exécutif et législatif au roi Moshoeshoe II, tout en précisant cependant que le monarque n'agirait qu'en accord et après avis du conseil militaire dirigé par le général Justin Lekhanya.
Le nouvel homme fort du Lesotho était un conservateur proche de Pretoria. Sans perdre de temps, il fit expulser une centaine de militants de l'ANC sud-africain vers la Zambie et renvoya les conseillers techniques nord-coréens. Il recentra sa politique vers le pôle pro-occidental afin de financer un grand projet de barrage hydro-électrique au cœur du pays. Son zèle pro-sud-africain fut néanmoins tempéré par le roi qui l'empêcha finalement de mener une politique trop explicitement favorable au gouvernement de Pretoria.
an 1985 : Ile Maurice - Période est marquée par la croissance du secteur des zones franches industrielles (ZFI). L'industrialisation commence à s'étendre aux villages et attire de jeunes travailleurs de toutes les communautés ethniques. En conséquence, l'industrie sucrière commence à perdre son emprise sur l'économie. Les grandes chaînes de magasins commencent à ouvrir des magasins en 1985 et offrent des facilités de crédit aux personnes à faible revenu, leur permettant ainsi de s'offrir des appareils ménagers de base. L'industrie du tourisme connait également un boom, et de nouveaux hôtels voient le jour dans toute l'île.
an 1985-1987 : Sierra Leone - Siaka Stevens laisse sa place au commandant en chef des armées, Joseph Saidu Momoh, en novembre 1985. Ce dernier est officiellement élu président en janvier 1986. En novembre 1987, Momoh décrète « l'état d'urgence économique » et prend des mesures d'austérité draconiennes. Mais l'exploitation des mines de diamants continue toujours de rapporter beaucoup d'argent aux principaux chefs du régime.
an 1985 : Soudan - En mars 1985, l’annonce de l’augmentation des prix des produits de première nécessité, sur l’injonction du FMI avec lequel le régime était en négociation, provoque de premières manifestations. Le 2 avril, huit syndicats appellent à la mobilisation et à une « grève politique générale jusqu’à la suppression du régime actuel ». Le 3, des manifestations massives secouent Khartoum, mais aussi les principales villes du pays ; la grève paralyse les institutions et l’économie. Nimeiry est renversé le 6 avril 1985 par un coup d'État opéré par une junte militaire dirigée par le général Abdel Rahman Swar al-Dahab.
Les jours suivants, cette junte se transforme en Conseil militaire transitoire (CMT). L’Alliance nationale, composée des syndicats et des partis politiques — dont les deux grandes formations historiques, l’Oumma et le Parti unioniste démocratique (PUD), à laquelle se joint le parti communiste —, conclut un accord avec les militaires. Une transition est mise en place pour rétablir un pouvoir civil. Durant cette année, le CMT et un conseil des ministres partagent le pouvoir législatif alors que le CMT conserve le pouvoir constitutionnel.
an 1985 - 1992 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - En 1985, Nyerere, le « mwalimu » (l’instituteur), choisit, contrairement à l’habitude prise par la plupart des autres chefs d’État africains, de se retirer de la politique, après avoir tout de même conservé le pouvoir pendant 24 années. C’est Ali Hassan Mwinyi, alors président depuis 1980 de l’archipel de Zanzibar, qui prend sa succession. Malgré les résultats très largement négatifs de sa politique de développement économique, Nyerere conserva jusqu’à sa mort en 1999 l’estime de beaucoup de Tanzaniens et d’une partie de la communauté internationale. On lui reconnaît en effet le mérite d’avoir posé les bases d’un État démocratique pluriethnique.
an 1986 : Eswatini (Swaziland) - Le royaume du Swaziland et le changement de nom en Eswatini - À la suite de dissensions internes graves au sein du conseil traditionnel, la reine Ntombi fait accélérer les procédures successorales afin de faire monter sur le trône le jeune Makhosetiwe, intronisé le 25 avril 1986 sous le nom de Mswati III.
En possession de ses pouvoirs de monarque, le nouveau roi dissout le conseil traditionnel et limoge Bekhimpi Dlamini. Le 6 octobre 1986, il nomme Sotja Dlamini comme Premier ministre. Ce dernier était le premier à occuper ce poste sans être membre de la famille royale. Cette action marque le retour en grâce des partisans de l'ouverture politique et sociale.
an 1986 - 1992 : Libye - En gérant avec intelligence ses revenus pétroliers et en opérant sa transformation industrielle, la Libye devient autosuffisante et attractive pour les travailleurs migrants africains qui s'installent massivement dans le pays dans les années 1990
Sur le plan international, Kadhafi entretient des relations tendues, voire hostiles, avec une grande partie des gouvernements d'Afrique, du monde arabe, et du monde occidental, allant de l’extrémisme verbal au soutien à des rébellions armées. Tiers-mondiste et antisioniste, il parvient à acquérir une certaine popularité auprès de secteurs d'opinion, essentiellement dans les pays du sud, mais paie ses positions d'une série de crises diplomatiques, voire de guerres, qui débouchent sur son isolement politique. L'interventionnisme libyen en Afrique débouche sur des participations à des conflits armés au Tchad et en Ouganda. La Libye subit en 1986 un bombardement de la part des États-Unis36; le régime de Kadhafi est ensuite accusé de s'être livré à des actes de terrorisme d'État, notamment avec l'attentat de Lockerbie en 1988 et celui contre le DC10 d'UTA en 1989. En 1992, la Libye est soumise à un embargo par les Nations Unies.
an 1986 : Madère (Archipel) - (Madeira en portugais) est un archipel du Portugal composé de l'île du même nom, et de plusieurs autres petites îles. Il est situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc.
Madère entre dans l'Union européenne en 1986. Aujourd'hui, c'est une région ultrapériphérique de l'Union Européenne, et un territoire très touristique.
an 1986 : Togo - Après une période relativement calme, le climat politique et social du pays va commencer à se détériorer. Ainsi, en 1986, un commando infiltré depuis le Ghana organise un attentat manqué contre Eyadéma. Cette tentative de coup d'État déclenche de violentes manifestations à Lomé et entraîne une intervention de la France, craignant une déstabilisation du régime en place.
Les Togolais et en tout particulier les jeunes intellectuels tels que Tavio Amorin, Jean-Claude Edoh Ayanou, Me Wakilou Maurice Gligli, Francis Agbagli entre autres , supportent de moins en moins la loi du silence et la censure qui leur sont imposées. Nombreux sont ceux qui supportent encore moins de voir que ce sont les Togolais originaire du Nord du pays qui sont aux commandes de l'État, alors même qu'ils ne représentent approximativement que 20 % de la population, contre environ 45 % pour les Ewé du Sud.
an 1987 : Afrique du Sud - Aux élections du 6 mai 1987, avec 26 % des suffrages, le parti conservateur gagne le statut d'opposition officielle, au détriment des progressistes en fort recul. Aux municipales de 1988, le CP s'empare de 60 des 110 municipalités du Transvaal et d'une municipalité sur quatre dans l'État Libre d'Orange. Le NP conserve de justesse Pretoria. Botha se retrouve alors gêné sur sa droite et doit ralentir ses réformes. Il veut éviter une fracture irrémédiable entre Afrikaners
an 1987 : Burkina Faso - Le capitaine Blaise Compaoré prend le pouvoir lors d'un putsch le 15 octobre 1987. Au cours de ces évènements, il aurait fait assassiner son prédécesseur Thomas Sankara. La mort de ce dernier est sujette à controverses. La période suivant le coup d'État est baptisée « Rectification » par Blaise Compaoré.
an 1987-2014 : Burkina Faso (Anc. Haute-Volta) - Le régime de Blaise Compaoré (1987-2014) - Au bout de 4 ans de régime révolutionnaire, le président Sankara est renversé à son tour par Blaise Compaoré, le 15 octobre 1987. Thomas Sankara est assassiné lors de ce coup d'État, au cours d'une réunion du Conseil de l'Entente. Une des premières mesures que prend Blaise Compaoré est la dissolution du Conseil national de la révolution qu'avait créé Sankara ; il crée un nouveau parti, le Front populaire (FP).
Blaise Compaoré a été au pouvoir de 1987 à 2014. Compaoré est élu pour la première fois en 1991, et réélu en 1998, 2005 et 2010. Il démissionne le 31 octobre 2014.
Le multipartisme est instauré en 1991. En 1992, une grande partie des entreprises d'État sont privatisées.
En 2011, on assiste un mouvement de forte contestation de la violence policière et de l’injustice sociale. Le facteur déclencheur de cette crise a été la mort suspecte d'un élève du nom de Justin Zongo après son interpellation par la police à Koudougou.
Le 30 octobre 2014, Blaise Compaoré fait face à un soulèvement populaire contre son projet de modification de l'article 37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels, afin de se représenter en 2015. À la suite des émeutes, Blaise Compaoré convoque l'article 43 et décrète la vacance du pouvoir le 31 octobre 2014. Une période d'incertitude de plusieurs mois s'ensuit. Le chef d’état-major des armées, Honoré Traoré, annonce alors la création d’un «organe de transition», chargé des pouvoirs exécutif et législatif, dont l’objectif est un retour à l’ordre constitutionnel «dans un délai de douze mois». Le 1er novembre 2014, l'armée publie un communiqué qui affirme son soutien à Isaac Zida comme président de transition. Honoré Traoré en est un des signataires, ce qui implique son renoncement au pouvoir. Le 17 novembre, le diplomate Michel Kafando est nommé président de transition. Il nomme Isaac Zida, premier ministre.
an 1987 : Burundi - « La tribu des Tutsis, qui compte pour 10 à 15 % de la population, y domine et y dépouille de ses droits celle des Hutus, lesquels sont cinq à six fois plus nombreux. Le pouvoir politique central reste un monopole tutsi. En 1987, 13 des 15 gouverneurs de provinces sont tutsis et la totalité de l'armée aussi. » Des heurts ont lieu entre Tutsis et Hutus dans les années 1960. En 1972, l'insurrection des Hutus contre le régime dictatorial du président Michel Micombero (d’origine tutsi) est durement réprimée, les massacres atteignent plusieurs dizaines de milliers de victimes chez les Hutus (estimation : 100 000).
an 1987-1989 : Cameroun - Des affrontements violents à Yaoundé mettent aux prises étudiants et policiers dès décembre 1987 et, la situation économique empirant, de nouveaux troubles sociaux éclatent à partir de 1989.
an 1987 - 1990 : Tchad - Régimes de Goukouni Oueddei et Hissène Habré (1979 - 1990)
En 1987, une rébellion Hadjaraï est écrasée dans le sang. Hissène Habré n'en conserve pas moins le soutien de Paris jusqu'en 1990 jusqu'à ce qu'il soit renversé par Idriss Déby, l'un de ses généraux, le 1er décembre 1990, avec le soutien de la France. Hissène Habré se réfugie au Sénégal où il sera condamné à l'emprisonnement à perpétuité en 2016.
an 1988 : Afrique du Sud - En 1988, la COSATU est interdite ainsi que dix-huit autres organisations politiques.
Alors qu'elle est engagée dans la lutte contre les forces cubaines depuis l'indépendance de l'Angola en 1975, un retrait réciproque est négocié sous l'égide des Nations-Unis au cours de l'année 1988. Les forces cubaines acceptent de se retirer d'Angola. En contrepartie, le gouvernement Sud-Africain accepte de retirer son soutien militaire et financier au mouvement rebelle UNITA ainsi que d'engager le processus politique devant aboutir rapidement à l'indépendance de la Namibie, qui arrivera 21 mars 1990, qu'elle considérait jusque là comme sa cinquième province.
an 1988 : Algérie - En octobre 1988 éclate une crise sociale sur fond de luttes pour le pouvoir entre Chadli Bendjedid et l'oligarchie du FLN. L'armée tire sur les émeutiers le 10 octobre. La crise fait plus de 500 morts. Elle fait surgir ou réveille des mouvements et des collectifs contestant le pouvoir du FLN : des changements politiques s'imposent.
Les émeutes d'octobre 1988, violemment réprimées, entrainent l'année suivante la promulgation d'une nouvelle constitution reconnaissant la démocratie et le multipartisme. Le processus est toutefois brutalement interrompu en 1991 après la victoire électorale du Front islamique du salut, parti visant la création d'un État islamique et remettant en cause l'option démocratique. L'Algérie plonge alors dans un conflit militaire entre le pouvoir et les groupes armés issus du FIS. La guerre civile dure plus d'une décennie et fait près de 50 000 morts en cinq ans. Les groupes armés développent un terrorisme visant en premier lieu les civils notamment les femmes, les intellectuels, les étrangers ainsi que les villages isolés et détruisant des infrastructures publiques et économiques.
an 1988-1992 : Angola - En 1988, si la bataille de Cuito Cuanavale entre soldats angolais et cubains contre les forces de l’UNITA, appuyées par l’armée sud-africaine, aboutit à un échec relatif des forces en présence, elle constitue néanmoins un élément déclencheur pour la reprise des négociations sur l’avenir de la Namibie.
Le 20 juillet 1988, un accord en 14 points est trouvé entre l’Afrique du Sud, l’Angola et Cuba. Parmi ceux-ci, la mise en œuvre de la résolution 435 prévoyant des élections en Namibie sous le contrôle des Nations unies en contrepartie du repli du contingent cubain (manifestant le succès du « linkage » formulée depuis 1979 par l’Afrique du Sud avec le soutien des États-Unis depuis 1981).
Le protocole de Genève est signé le 5 août. Les 8 et 12 août, l’Afrique du Sud et la SWAPO acceptent la cessation des hostilités l’une envers l’autre et le 22 août, l’accord de paix est signé entre l’Angola et l’Afrique du Sud à Ruacana.
Le secrétaire général de l’ONU, Javier Pérez de Cuéllar se rend alors aux Union Buildings de Pretoria pour préparer l’accord de Brazzaville qui aboutit à la signature du 22 décembre préparant le calendrier de la mise en œuvre de la résolution 435 et celui du retrait cubain d’Angola.
En dépit d’une tentative désastreuse d’infiltration de la Namibie par 1 200 guérilléros de la SWAPO à partir de ses bases d’Angola le 1er avril 1989, le processus ira à son terme sous l’administration conjointe de l’Afrique du Sud et des Nations-Unies.
Cependant, en Angola, la guerre civile continue avec un peu moins de vigueur. Les accords de Bicesse en 1991 aboutissent à un cessez-le-feu et à l’organisation d’élections générales supervisées par les Nations-Unies. Le 26 août 1992, une révision de la constitution fait disparaître les dernières traces d'idéologie marxiste-léniniste et le nom officiel du pays devient république d'Angola.
an 1988 : Burundi - Après les massacres de 1988 (20 000 morts), pour éviter d'autres bains de sang, le président Pierre Buyoya, décide de lancer le pays dans une transition politique. Une constitution est rédigée par une commission chargée d'instaurer une démocratie multipartite au Burundi.
an 1988 : Érythrée - En 1988, le FPLE prend Afabet, où se trouvaient les quartiers généraux de l'armée éthiopienne au nord-est de l'Érythrée, forçant le retrait de l'Éthiopie vers les plaines de l'ouest. Le FPLE progresse ensuite vers Keren, deuxième ville d'Érythrée. À la fin des années 1980, l'URSS informa Mengistu qu'elle ne renouvelle pas son accord de défense et de coopération. L'armée éthiopienne s'en trouve affaiblie et le FPLE, soutenu par d'autres forces rebelles éthiopiennes, poursuit son avance vers les positions éthiopiennes.
an 1988-1991 : Éthiopie - La chute du régime (1988-1991)
La fin des années 1970 et surtout les années 1980 voient la montée en puissance des mouvements nationalistes régionaux. Le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) et le Front populaire de libération de l'Érythrée (FPLE) coordonnent leurs opérations à partir du milieu des années 1980 tandis que le Front de libération oromo progresse. En plus des rébellions, le pays est touché par une crise économique, causée par le manque d'investissements privés dans l'économie aux mains de l'État. La famine de 1984-1985 porte un coup en plus au régime du Derg qui dans un premier temps ne réagit pas, pour ensuite autoriser l'aide internationale. Mengistou veut répondre à cette crise en relocalisant les paysans vers des terres plus fertiles mais les manières brutales employées, les collectivisations rendent la mesure impopulaire. Une nouvelle réforme visant à déplacer les habitants des villages convainc définitivement les paysans qui soutiennent les mouvements de guérillas à la fin des années 1988. Enfin, « pilule amère » pour la classe dirigeante éthiopienne qui « commence à peine à savourer l'institutionnalisation de l'ordre socialiste », le nouveau pouvoir à Moscou annonce la Perestroïka et la Glasnost. Le régime du Derg perd donc un important soutien au niveau international. En 1988-1990, les quelques annonces d'ouverture de l'économie arrivent trop tard, dans le nord, les guérilléros prennent l'avantage.
En mars 1988, le FLPE remporte la bataille d'Afabet, un succès décisif dans un bastion du gouvernement central. Les séparatistes érythréens amassent une importante quantité de matériel militaire, déterminant dans la poursuite de la guerre et ouvrent la route vers Mitsiwa et Asmara. En février 1989, le FLPT, soutenu par la population locale et un contingent du FLPE remporte la bataille d'Endeselassié, une défaite lourde pour Mengisou puisque qu'environ 23 000 soldats gouvernementaux sont faits prisonniers. L'importance de ces succès est rappelée par Bahru : « Afabet et Endeselassie marquent le début de la fin du régime de Mengistou ».
Désormais, le FLPT se fixe un nouvel objectif : après la libération régionale, le mouvement doit libérer tout le pays. Telles sont les conditions dans lesquelles le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE) a été créé. Cette coalition comprend alors divers partis dont le Mouvement démocratique du peuple éthiopien, devenu le Mouvement national démocratique Amhara et l'Organisation démocratique des peuples Oromo. Néanmoins, la prédominance du FLPT dans la coalition ne fait aucun doute. À la fin de l'année 1989, le FDRPE remporte une bataille décisive au mont Gouna et en février 1990, Mitsiwa tombe aux mains du FLPE. La victoire de Gouna est suivie de celle de Maragngna dans le Wello ; le FDRPE organise alors quatre opérations : l'opération Téwodros, Wallelegn et Bilisumaf walqituma qui permettent respectivement la conquête du Godjam, du Wello et du Wellega. L'encerclement de la capitale étant assuré, le FDRPE se trouve en position de force face à gouvernement qui souhaite négocier. Voyant la défaite arriver, Mengistou quitte le pays le 21 mai 1991, passe par le Kenya pour ensuite se réfugier au Zimbabwe. L'armée gouvernementale en Érythrée s'effondre et la capitale est laissée aux forces du FDRPE qui pénètrent à Addis-Abeba le 28 mai 1991. La date est depuis devenue jour de fête nationale.
an 1988 : Kenya - Les élections générales du 21 mars 1988 ne comportent pas d'élection présidentielle car Moi est le seul candidat du seul parti autorisé. L'élection législative voit la disparition du vote à bulletin secret lors de l'élection primaire. Celui-ci est remplacé par un système appelé mlolongo (« file d'attente » en swahili) où les seuls électeurs autorisés doivent être membre du KANU et faire la file devant une photo du candidat qui a sa préférence. Au deuxième tour, cette élection législative est ouverte à tous les électeurs et se tient à bulletin secret.
an 1988 : Leshoto - Le 14 septembre 1988, la visite du pape Jean-Paul II manquait de dégénérer en fiasco politique à la suite de la prise en otage par des rebelles d'un car de pèlerins qui se termina par un bain de sang sous l'effet de l'assaut des forces armées.
an 1988 : Mali - Djenné : La Grande Mosquée est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco
an 1988 : Namibie - En janvier 1988, la bataille de Cuito Cuanavale en Angola va constituer l'élément déclencheur du règlement de la situation politique de la Namibie. Cette bataille, qui met aux prises 7 000 soldats sud-africains et 10 000 combattants de l'UNITA contre 20 000 soldats angolais et 5 000 soldats cubains, est la plus importante bataille engagée sur le continent africain depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle se solde par un échec relatif de toutes les forces engagées et marque les limites de la solution militaire.
Le gouvernement sud-africain de Pieter Botha est mis sur la sellette dans les médias sud-africains et par l'opinion publique sud-africaine. Le général Magnus Malan doit se justifier auprès des familles pour la mort (officielle) de trente et un soldats dans la guerre civile d'un pays étranger ne mettant pas en péril la sécurité nationale. Pour leur part, le président et l'état-major doivent en plus justifier le coût financier astronomique des opérations militaires et l'absence de solutions proposées à court terme. Quant au gouvernement cubain, il établit un constat financier et politique similaire. Ses forces armées n'ont jamais réussi à emporter la victoire malgré un engagement massif et ont subi de très lourdes pertes dans les combats pour des résultats peu convaincants. Il s'efforce donc de son côté, nonobstant la propagande, de se retirer d'un conflit impopulaire sans trop perdre la face.
L'accélération des négociations diplomatiques a lieu durant l'année 1988. Prise de court, la SWAPO entreprend une série de consultations avec des experts étrangers avec pour objectif la mise en œuvre de la résolution 435. Dans cette optique, elle refonde totalement son programme électoral et abandonne toute référence au marxisme-léninisme. Le 20 juillet 1988, un accord en quatorze points est trouvé entre l'Afrique du Sud, l'Angola et Cuba. Parmi ces points, la mise en œuvre de la résolution 435 en contrepartie du repli du contingent cubain. Le protocole de Genève est signé le 5 août. Les 8 et 12 août, l'Afrique du Sud et la SWAPO acceptent la cessation des hostilités bilatérales et le 22 août, l'accord de paix est signé entre l'Angola et l'Afrique du Sud à Ruacana.
Le secrétaire général des Nations unies Javier Pérez de Cuéllar se rend alors aux Union Buildings pour préparer l'accord de Brazzaville qui aboutit à la signature du 22 décembre préparant le calendrier de la mise en œuvre de la résolution 435 et celui du retrait cubain d'Angola.
an 1988 : Sainte-Hélène (Île) - Sainte-Hélène est régie par une constitution datant de 1988. À Sainte-Hélène, le pouvoir législatif est exercé par un conseil législatif de quinze membres, dont douze sont élus par la population du territoire pour un mandat de quatre ans selon un mode de scrutin plurinominal majoritaire dans une unique circonscription. Lors des élections, les habitants ont autant de votes qu'il y a de sièges, à raison d'un vote par candidats. Les 12 candidats ayant reçu le plus de votes sont déclarés élus. Les trois autres membres sont le gouverneur et deux officiers désignés par la Couronne britannique.
an 1988 : Sénégal - Février 1988 : Contexte économique et social de crise. Le président Abdou Diouf est reconduit dans ses fonctions avec plus de 73 % des suffrages, succès renforcé par la majorité absolue du PS aux élections législatives. L’opposition conteste les résultats et des émeutes et affrontements avec les forces de l’ordre conduisent à la proclamation de l’état d’urgence.
17 mai 1988 : Après la libération d’Abdoulaye Wade, accusé d’avoir attisé les mécontentements à la suite des élections de février, l’état d’urgence est levé.
an 1989-1990 : Afrique du Sud - En janvier 1989, victime d'une congestion cérébrale, le président Pieter Botha se retire pendant un mois. À son retour, il renonce à la présidence du Parti National (NP) mais déclare vouloir se maintenir jusqu'aux élections générales de 1990.
À la tête du NP lui succède le président du parti dans le Transvaal, Frederik de Klerk, soutenu par l'aile droite du parti.
Durant l'été 1989, les membres de son cabinet contraignent Botha à démissionner. Ils veulent, le plus rapidement possible, placer de Klerk à la présidence pour sortir d'une situation bloquée et impulser un nouveau souffle au pays.
Dès sa nomination à la présidence de la république, de Klerk s'entoure d'une équipe favorable à des réformes fondamentales. S'il maintient quelques piliers de l'apartheid, comme Magnus Malan à la défense et Adriaan Vlok à la sécurité intérieure, c'est pour donner des gages à l'électorat conservateur. Il maintient l'inamovible Pik Botha aux affaires étrangères, pour rassurer les libéraux, ainsi que le pragmatique Kobie Coetsee à la justice et Barend du Plessis aux finances. La nouveauté consiste surtout en la montée en puissance, au sein du gouvernement et du parti, de nationalistes réformistes comme Leon Wessels, Dawie de Villiers ou Roelf Meyer. Bien que catalogué comme conservateur, de Klerk veut changer l'image du parti national et du pays. Proche des milieux économiques, il sait que les sanctions internationales sont de moins en moins supportables pour le pays. Il avait pris conscience que le poids démographique des Noirs était trop important et que les Blancs étaient trop minoritaires (18 %) pour pouvoir diriger efficacement le pays. Il avait compris enfin que l'apartheid avait atteint ses limites et avait échoué à empêcher les Noirs de devenir partout majoritaires en Afrique du Sud blanche, à l'exception du Cap-Occidental où les métis demeuraient les plus nombreux et dans quelques zones urbaines comme Pretoria où les Afrikaners dominaient encore significativement. Dans le programme électoral qu'il propose, il envisage d'instaurer dans les cinq ans une nouvelle constitution fondée sur la participation pleine et entière de tous les Sud-Africains et dans le respect des aspirations des groupes, notion remplaçant dorénavant celle de race et définie comme un ensemble libre d'individus partageant les mêmes valeurs.
Les élections générales anticipées de septembre 1989 sont mauvaises pour le NP qui perd une trentaine de sièges au profit du Parti conservateur (CP) avec 39 sièges pour 33 % des voix, et du nouveau Parti démocratique (Democratic Party - DP), issu d'une fusion entre les petits partis progressistes et libéraux (avec 33 sièges et 21 % des voix). Le NP garde néanmoins une petite majorité à la chambre de l'assemblée et, s'il reste le premier parti des électeurs afrikaners (46 %), de justesse devant le CP (45 %), il est devenu le premier parti des électeurs blancs anglophones (50 %).
Le nouveau président reste prudent, annonçant comme priorité, durant son discours d'investiture, la rédaction d'une nouvelle constitution permettant la cohabitation pacifique de toutes les populations d'Afrique du Sud. Il prend néanmoins des mesures concrètes dès l'automne 1989 en autorisant les manifestations multiraciales, dont celles de l'ANC, à Johannesbourg, Soweto et au Cap, en prononçant l'élargissement de quelques figures de l'opposition anti-apartheid comme Walter Sisulu et en autorisant la création de quatre zones résidentielles multiraciales dans les provinces du Cap, du Natal et du Transvaal.
an 1989-1993 : Eswatini (Swaziland) - Le royaume du Swaziland et le changement de nom en Eswatini - En 1989, Sotja Dlamini est limogé à son tour pour désobéissance puis remplacé par Obert Dlamini, lequel reste en fonction jusqu'en 1993.
an 1989-1990 : Leshoto - En juillet 1989, le régime marqua une certaine libéralisation avec la fin de l'exil de Ntsu Mokhehle, autorisé à rentrer au pays. Le roi fut lui-même envoyé aux États-Unis afin de plaider la cause du Lesotho auprès des grandes institutions financières internationales alors que le pays manquait de crédits.
Cependant, les relations entre le général Lekhanya et le roi se dégradèrent subitement et le 19 février 1990, les royalistes tentèrent de renverser le dictateur militaire. Ce fut un échec qui aboutit à la déposition du roi en mars 1990. Désormais, roi en titre mais sans aucun pouvoir, Moshoeshoe II fut exilé.
En novembre 1990, son fils aîné lui succéda sous le nom de Letsie III.
an 1989-1990 : Libéria - La guerre civile au Liberia a coûté la vie à près de 150 000 personnes, des civils pour la plupart, et a provoqué un effondrement total de l'État. Des milliers de personnes ayant été déplacées à l'intérieur du Liberia et hors de ses frontières, quelque 850 000 personnes se sont réfugiées dans les pays voisins. Les combats ont commencé à la fin de l'année 1989 et au début de l'année 1990, causant plusieurs centaines de morts lors des affrontements entre les forces gouvernementales et les combattants se réclamant d'un groupe d'opposition, le National Patriotic Front of Liberia (NPFL), dirigé par un ancien membre du Gouvernement, Charles Taylor. Charles Taylor est de père américano-libérien et de mère native. Après des études aux États-Unis, il est revenu en Afrique, s'est plongé dans les intrigues politiques et militaires ouest-africaines, et est devenu un chef de guerre, avide de profits financier.
En 1989, le National Patriotic Front of Liberia (NPFL), le groupe d'opposition placé sous son autorité, s'organise. Ce mouvement prend les armes et s'empare rapidement d'une grande partie du pays sans rencontrer de résistance sérieuse de la part des forces gouvernementales. Les forces rivales ont des pratiques meurtrières très similaires. Néanmoins, l'avancée est stoppée aux portes de Monrovia. Dans le même temps, les membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) décident l'envoi d'une force d'interposition, l'Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group (ECOMOG), composée de 4 000 hommes. Ce contingent militaire, majoritairement nigérian, bloque la progression des troupes de Charles Taylor.
En 1990, un désaccord au sein du NPLF conduit Prince Johnson à faire sécession, et à créer l'Independent National Patriotic Front of Liberia (INPFL) avec un millier de dissidents. Le 9 septembre 1990, le président Doe est assassiné par Prince Johnson lors d'une visite aux troupes de l'ECOMOG.
an 1989 : Ile Maurice - En 1989, la bourse ouvre ses portes et en 1992, le port franc a commencé à fonctionner
an 1989-1990 : Namibie - Avec la mise en œuvre de la résolution 435 et le maintien de l'administration sud-africaine, le gouvernement de Pretoria réussit le tour de force de faire avaliser par l'ONU sa tutelle sur la Namibie depuis la fin théorique du mandat sud-africain en 1968. Au contraire de la Rhodésie du Sud, où les autorités gouvernementales avaient dû transmettre leur autorité au représentant du Royaume-Uni, l'ancienne puissance coloniale, en Namibie c'est l'administrateur sud-africain qui reprend au gouvernement et à l'assemblée législative du Sud-Ouest africain ses pouvoirs exécutifs, législatifs et administratifs. La conférence de la Turnhalle devient un non-événement.
En février 1989, le premier contingent de la GANUPT arrive en Namibie. Le 1er mars, le gouvernement du Sud-Ouest Africain/Namibie est dissous et ses pouvoirs transférés à Louis Pienaar, l'administrateur sud-africain. La mise en œuvre du plan des Nations unies est prévue pour le 1er avril.
Or le 1er avril plus de 1 600 combattants en arme de la SWAPO investissent le nord de la Namibie au mépris des accords passés dans le cadre des Nations unies. Cette invasion fut considérée comme la plus grave erreur de l'histoire de la SWAPO. Le représentant de l'ONU Martti Ahtisaari n'a plus d'autres choix que de demander l'aide de l'armée sud-africaine pour repousser les intrus vers l'Angola. Les plus violents combats qu'ait jamais connus la Namibie depuis le début du mandat sud-africain sont alors engagés. La SWAPO compte plus de 300 tués (contre 27 soldats sud-africains) et est désavouée par l'OUA, ses alliés — à l'exception de Robert Mugabe du Zimbabwe — et les Nations unies. Le 9 avril, un accord est signé fixant un processus de retrait sous la supervision du Groupe d'assistance des Nations unies pour la période de transition en Namibie. Si elle est un temps tentée de remettre en cause la mise en œuvre de la résolution 435, l'Afrique du Sud consent à reprendre le retrait progressif de ses troupes qui passe de 12 000 hommes en mai 1989 à 1 500 en juillet 1989. Le sort des supplétifs (les harkis namibiens) est également réglé par le transfert de 4 000 bushmen en Afrique du Sud. Les SWATF sont à leur tour démobilisés et les restes de l'armée sud-africaine cantonnés dans ses bases.
Le 2 juillet 1989, la SWAPO (qui, il faut le remarquer, n'a jamais été un parti interdit au contraire de l'ANC en Afrique du Sud) organise son premier meeting de campagne à Katutura avec les dirigeants de la SWAPO dite « de l'extérieur ». Hage Geingob présente un programme socialiste, assure que la SWAPO accepte désormais le multipartisme (la question était posée) mais n'envisage pas la moindre nationalisation.
Au bout de plusieurs semaines de campagne, la SWAPO reconnaît que son erreur du 1er avril lui a coûté de nombreuses voix dont peut bénéficier la DTA mais elle envisage encore de gagner avec plus de 66 % des voix ce qui lui permettrait alors de rédiger la future constitution. En septembre, pour couper court aux critiques, la SWAPO exprime par la voix de Theo-Ben Gurirab ses regrets aux victimes des exactions commises dans ses geôles d'Angola et de Tanzanie.
En septembre, un des premiers blancs à avoir rejoint la SWAPO (en 1984), Anton Lubowski, directeur adjoint de la campagne, est assassiné29. Le meurtre n'est pas élucidé à ce jour.
Le 14 septembre, Sam Nujoma revient au pays sous les ovations de 10 000 sympathisants
Les élections de novembre 1989
Sous la protection des 8 000 soldats de la GANUPT, le scrutin a lieu du 7 au 11 novembre 1989. Seulement dix partis sur quarante parviennent à obtenir le visa de la commission électorale pour participer aux élections, les autres n'ayant pu recueillir les 2 000 signatures requises ou déposer la caution exigée de 10 000 rands pour participer au scrutin. La SWAPO présente une liste comprenant l'essentiel du bureau politique mais aussi quelques nouveaux venus notamment deux blancs, Fanie Botha, fils de l'ancien ministre sud-africain du travail, et un fermier germanophone, Anton von Wiertersheim. L'Action chrétienne nationale représente les conservateurs blancs alors que la DTA représente les libéraux. Le centre-gauche est représenté par le Front démocratique unifié de Justus Garoëb (roi des Damaras) alors que la SWANU se présente divisée entre la SWANU-NNF (Front national de Namibie) et celle du Front patriotique national (centre-droit) de Moses Katjiongua. Les fédéralistes se sont regroupés derrière les Basters de Rehoboth dans la Convention fédérale de Namibie alors que les Ovambos hostiles à la SWAPO se divisent en trois formations, l'Action chrétienne-démocrate (CDA), la SWAPO-démocrate (d'Andreas Shipanga) et le Parti national-démocrate de Namibie (NNDP).
En dépit de la déclaration maladroite de Toivo ya Toivo (« ce n'est qu'au résultat de la SWAPO que l'on pourra juger si les élections ont été justes et équitables »), la validité du scrutin n'est remise en cause par personne.
Le taux de participation est 95 % (le corps électoral comprend 701 483 inscrits).
Le 13 novembre, les résultats sont proclamés :
* La SWAPO est largement en tête avec 57,33 % des voix (41 députés) mais loin des deux tiers des suffrages attendus. Elle réalise ses meilleurs scores dans l'Ovamboland (92,2 %), dans les districts miniers (53,5 % à Tsumeb, 64 % à Lüderitz), à Swakopmund (58,5 %) et dans le Kavangoland (51,7 %). L'analyse de ces résultats confirme la fracture ethnique car seule la présence de fortes communautés ovambos permettent à la SWAPO de gagner la majorité absolue dans 5 des 23 districts du pays dont les plus peuplés, ceux de l'Ovamboland et du Kavangoland et d'arriver en tête dans 3 autres.
* La DTA arrive en deuxième position avec près de 28 % des suffrages (et 21 députés dont Dirck Mudge) avec la majorité absolue dans huit districts et relative dans six autres. Elle bénéficie de l'appui massif des Héréros (66,4 % dans le Hereroland et 65,7 % dans le Kaokaland) et recueille la majorité des voix chez les Namas (57,9 % à Bethanie), chez les Mafwe (53 % dans la bande de Caprivi) et même chez les basters (45,2 % à Rehoboth). Elle arrive seconde dans l'électorat blanc (28,55 %).
* Le Front démocratique unifié obtient 5,65 % et 4 députés.
* L'Action chrétienne nationale réunit 3,54 % des voix et 3 députés. Avec plus de la moitié des voix de l'électorat blanc, elle obtient ses meilleurs scores dans les 6 districts où la population européenne représentait plus du double de la moyenne nationale (25 % des voix à Karasburg).
* La SWANU-NPF surpasse sa rivale avec 1,59 % (1 député).
* La Convention fédérale suit avec 1,56 % des voix (1 député).
* La SWANU-NNF est la dernière de ses formations à obtenir un élu avec 0,80 % des voix.
La mise en place de la nouvelle constitution
Le 21 novembre 1989, l'assemblée constituante se réunit pour la première fois. La SWAPO qui souhaite la mise en place d'une assemblée monocamérale et un pouvoir exécutif fort fait des concessions. Selon les mots du secrétaire général du parti, Moses Garoëb, elle consent à constitutionnaliser le multipartisme « pour le meilleur et pour le pire ».
Dès janvier 1990, la rédaction de la constitution est près d'être terminée. Sam Nujoma constitue alors un cabinet fantôme pendant qu'est examiné le projet constitutionnel par trois juristes sud-africains. Nujoma nomme comme Premier ministre un membre de l'ethnie damara, Hage Geingob et seize ministres dont Hifikepunye Pohamba à l'intérieur, Theo-Ben Gurirab aux Affaires étrangères et l'économiste germanophone Otto Herrigel aux finances.
À la fin du mois, la constitution est rendue publique. Précédée d'une longue charte des libertés fondamentales, elle institue un régime de type semi-présidentiel, un subtil compromis entre les tendances autoritaires de la SWAPO et celles plus libérales de la DTA. Discutée et amendée pendant quatre jours, l'assemblée constituante vote le 9 février à l'unanimité de ses membres la nouvelle constitution namibienne.
Le 16 février, l'assemblée constituante devient assemblée nationale et élit Sam Nujoma à la présidence de la République.
La transition entre l'administration sud-africaine et la nouvelle administration namibienne peut commencer. Elle se termine le 20 mars 1990, date de l'entrée solennelle de la république de Namibie dans la communauté internationale.
an 1989 : Sénégal - 25 avril 1989 : A la suite du pillage des boutiques tenues par des mauritaniens au Sénégal, environ 200 sénégalais sont massacrés à Nouakchott et à Nouadhibou en Mauritanie. Le couvre-feu est instauré.
an 1989 : Soudan - En 1989, le général Omar el-Béchir renverse le gouvernement civil de Sadeq al-Mahdi par un coup d’État encouragé par le Front national islamique (FNI), dirigé par Hassan el-Tourabi. Il aboutit à la prise de pouvoir par un Commandement révolutionnaire pour le salut national (Al-Inqaz).
an 1990 : Burkina Faso - Les violences policières et les meurtres d'opposants au président Blaise Compaoré scandent les décennies 1990 et 2000 : Dabo Boukary en 1990 ; deux étudiants en 1995 ; Flavien Nébié (12 ans) en 2000. Tous étaient militants ou manifestants
an 1990 : Afrique du Sud - En 1990, le nouveau président sud-africain, Frederik de Klerk, légalise l'ANC, le parti communiste sud-africain et tous les mouvements noirs. Nelson Mandela est libéré.
Dans un discours, le 2 février 1990 au parlement sud-africain, F.W. de Klerk provoque la fureur des ultras et la stupeur du monde entier en annonçant que des organisations politiques auparavant illégales n'allaient plus être interdites. Justifiant sa décision par les événements politiques récents survenus en Europe de l'Est, en Union soviétique et en Chine, et par les graves problèmes économiques de l'Afrique, il prononce la levée de l'interdiction de l'ANC, du congrès panafricain d'Azanie (PAC) et du parti communiste (SACP), la levée de la censure, la suspension de la peine capitale et la libération prochaine des derniers prisonniers politiques dont Nelson Mandela, figure emblématique de la lutte anti-apartheid. Pour le président sud-africain, ces mesures doivent permettre de « s'engager dans une nouvelle phase » et de passer de la violence à un processus de négociation. Ce processus repose aussi sur Nelson Mandela dont la contribution au règlement politique est décisive. Dès 1985, il avait commencé des pourparlers avec le gouvernement et avait rencontré à quarante-sept reprises de hauts fonctionnaires du gouvernement, amenant les dirigeants du Parti national à croire en un règlement acceptable négocié avec l'ANC. Nelson Mandela impose même au gouvernement qu'il ne fixe pas de pré-conditions et que les négociations portent sur la constitution d'une Afrique du Sud unifiée, répondant aux aspirations de la majorité noire. Le rôle de Mandela dans les négociations est d'autant plus important qu'il n'y a pas à l'ANC de personnalités qui aient la popularité et le charisme suffisant pour s'opposer à son autorité morale, Oliver Tambo, le président de l'ANC, étant diminué à la suite d'un accident vasculaire cérébral.
La riposte de l'ultra-droite au discours du président sud-africain ne se fait pas attendre ; des défilés de milices et autres organisations paramilitaires ont lieu dans la plupart des villes afrikaners. Eugène Terre'Blanche, le chef du groupement paramilitaire « Mouvement de résistance afrikaner » (AWB), organisation reconnaissable à son sigle formant une svastika à trois branches, devient aux yeux de l'opinion mondiale le symbole de l'oppression raciste sud-africaine et de la résistance au changement. Cette image très négative sert cependant les partisans des réformes.
La libération de Nelson Mandela, en février 1990, et les pourparlers entre le gouvernement et les ex-partis interdits déchaînent les passions au sein de la communauté blanche. Contre ceux qui crient à la trahison et au suicide politique d’un peuple, les partisans des réformes affirment leur croyance en une transition pacifique des pouvoirs à la majorité noire, transfert jugé inéluctable et seul moyen pour permettre l’obtention de garanties pour les minorités.
Le 21 mars 1990, après des négociations sous l’égide des Nations Unis et une période de transition de près d'un an, l'Afrique du Sud abandonne sa tutelle sur la Namibie qui accède alors à l'indépendance.
En Afrique du Sud, les négociations officielles débutent avec la signature des Accords de Groote Schuur le 4 mai 1990. Une délégation de l'ANC est constituée pour ces négociations avec Nelson Mandela, Alfred Nzo, Joe Slovo, Joe Modise, Thabo Mbeki, Ruth Mompati, Walter Sisulu, Ahmed Kathrada, Cheryl Carolus, Archie Gumede (en), et Beyers Naudé, une équipe multi-raciale, constituée essentiellement de militants très expérimentés, dont certains étaient depuis plus d'un quart de siècle en exil, ou d'autres emprisonnés sur la même période. Le gouvernement et cette délégation de l'ANC, menée par Nelson Mandela, manifestent ainsi l'engagement à négocier l'élaboration d'une nouvelle constitution transitoire. Une série d'accords est signée, formalisant la décision conjointe d'arriver à un règlement politique négocié. Si l'ANC décide de suspendre la lutte armée (août 1990), elle ne dissout pas pour autant sa branche armée.
En septembre, le Parti national ouvre ses rangs aux non-blancs, obtenant un certain succès auprès des métis du Cap alors que toutes les lois raciales relatives à la vie quotidienne des individus dans le cadre du Separate Amenities Act sont abrogées au mois d'octobre 1990.
an 1990 : Bénin (anc. Dahomey) - En février 1990, une Conférence nationale abroge la Constitution et met en place de nouvelles institutions pour une période transitoire : création d'un poste de Premier ministre, abandon de la référence « populaire » dans la dénomination du pays qui devient la République du Bénin, limitation de l'âge des candidats-présidents à 70 ans afin d'empêcher la candidature des anciens présidents Zinsou, Maga et Ahomadegbé.
an 1990 : Cameroun - Au début des années 1990, à la suite d'opérations de désobéissance civile, baptisées « Villes mortes », et d'émeutes, Paul Biya accélère la mise en œuvre du multipartisme. Il supprime la législation « contre-subversive » instaurée par son prédécesseur, restaurant ainsi la liberté d’association, et permet à une presse indépendante de commencer à paraître. Cette démocratisation a ses limites : le gouvernement continue d'avoir recours aux fraudes électorales et instrumentalise les appareils judiciaire et policier contre l'opposition.
À la fin des années 1990, les « compagnies juniors » canadiennes, investies dans plus de 8 000 propriétés minières, dans plus de 100 pays, pour la plupart encore à l'état de projet, multiplient les contrats avec des pays africains parmi lesquels le Cameroun, où Mega Uranium a des concessions sur 4 654 km2. L'ambassadeur américain au Cameroun, Niels Marquardt organise le voyage du premier ministre Ephraïm Inoni à l’été 2007 aux États-Unis, au cours duquel la délégation camerounaise est orientée vers des sociétés minières canadiennes, américaines, anglaises et australiennes.
Le 3 décembre 1990, l'Assemblée nationale adopte une série de lois destinées à contrôler la création de nouveaux partis, alors que la Constitution prévoyait explicitement le multipartisme intégral. Plusieurs partis « proches du pouvoir » se font ainsi reconnaître sans problèmes, mais la plupart des partis d'opposition, dans le pays ou en exil, refusent de cautionner ce « multipartisme sous contrôle ».
Le régime de Paul Biya est proche du gouvernement français, qui lui livre des armes et forme ses forces de répression. La France est le premier investisseur étranger, devant les États-Unis. Cent cinq filiales françaises sont implantées dans tous les secteurs-clés (pétrole, bois, bâtiment, téléphonie mobile, transport, banque, assurance, etc.).
an 1990-1991 : Cap Vert - En 1990, année où le Cap-Vert s'ouvre au multipartisme. Contraint par la pression populaire, qui réclame davantage de démocratie, le PAICV réunit un congrès extraordinaire en février 1990 pour effectuer des modifications de la Constitution. Plusieurs partis d'opposition s'unissent pour former le Mouvement pour la Démocratie (MPD) en avril 1990 à Praia, et contestent la légitimité de l'élection présidentielle prévue en décembre 1990.
Le monopartisme est aboli le 28 septembre 1990 et les premières élections multipartites organisées en janvier 1991.
Le MPD remporte les présidentielles avec 73,5 % des suffrages, ainsi que la majorité des sièges de l’Assemblée nationale. Cette alternance politique se réalise sans crise. António Mascarenhas Monteiro succéde à Aristides Pereira à la présidence.
an 1990 : République de Centrafrique - Au début des années 1990, Kolingba est peu à peu lâché par la France qui lui reproche un régime trop dictatorial et incompatible avec les objectifs du discours de La Baule du président François Mitterrand en 1990.
À la fin des années 1990, les « compagnies juniors » canadiennes, investies dans plus de 8 000 propriétés minières, dans plus de 100 pays, pour la plupart encore à l'état de projet, multiplient les contrats avec des pays africains parmi lesquels la République centrafricaine, où elles ont cependant du mal à se faire une place, la Colombe Mines, possédant les principaux sites diamantifères
an 1990 : Afrique - les Comores - La RFIC a traversé une crise politique qui a débuté dans les années 1990 avec des demandes émanant de la population mohélienne pour le rattachement de l'île à la France. Cette crise ne peut être interprétée correctement qu'au vu de la situation de Mayotte. Mayotte est revendiquée depuis la création du pays qui la considère comme faisant partie de son territoire, comme en témoigne l'article 1er de sa Constitution.
an 1990 : Mayotte - À partir des années 1990, on note un fort investissement économique français et un profond changement de la société mahoraise.
an 1990 : Zaïre Congo Kimshasa - Mobutu Sese Seko annonce la fin du parti unique (24 avril). Le multipartisme ne sera autorisé que le 18 décembre. Un massacre d'étudiants à l'Université de Lubumbashi par des membres de la garde présidentielle fait un nombre indéterminé des victimes. La coopération belge est suspendue. Création du front de l'opposition, qui réclame une conférence nationale (août).
an 1990-1993 : Afrique Côte d'Ivoire - Félix Houphouët-Boigny avait su avec prudence éviter tout conflit ethnique dans un cadre de parti unique et avait même permis l’accès aux postes de l’Administration publique à certains immigrants venus de pays voisins, réussissant à réaliser un melting-pot original et économiquement efficace. Cet équilibre reposait aussi sur une division écologique et sociale du travail : dans le nord, les Dioula dominent le transport et le commerce, les Burkinabè travaillent dans les plantations comme manœuvres, les propriétaires fonciers coutumiers sont les propriétaires rentiers des plantations. Grosso modo, les nordistes vivent ainsi de l’économie informelle tandis que les sudistes se retrouvent dans l’administration et la gestion du pouvoir. Les nordistes qui avaient acquis une qualification professionnelle suffisante sont envoyés dans les ambassades ou dans les institutions internationales pour représenter le pays ; certains accèdent à des ministères, mais politiquement marginaux.
Toutefois, le passage au multipartisme en 1990 à la suite du sommet France-Afrique de la Baule permet aussi l’affirmation identitaire des communautés ethniques dans l’espace politique et l'ouverture de débats sur la construction nationale. Les tensions entre les gens du nord et du sud, jusque-là cantonnées au champ économique, se transfèrent dans le champ politique.
L’arrivée inopinée d’Alassane Ouattara aux portes du pouvoir ne fait qu'aggraver la situation. Alors que ce nordiste avait été nommé Premier ministre pour résoudre la crise économique, celui-ci entend bien se positionner pour accéder au pouvoir, bouleversant les plans d'Henri Konan Bédié, le successeur désigné du président Houphouët-Boigny, ainsi que de Laurent Gbagbo, l'opposant historique, qui tous deux pensent leur tour venu. Le péril politique constitué par des gens du Nord suscite un sentiment d’autodéfense violent chez les gens du Sud et radicalise leur position contre les communautés du Nord.
En 1993, le président Houphouët-Boigny décède.
an 1990 - 2006 : Bénin (anc. Dahomey) - Premières années du renouveau démocratique (1990-2006)
Nicéphore Soglo, le premier président élu de l'ère du renouveau démocratique, devrait remettre le pays sur les pistes de l'économie de marché en créant les conditions favorables à la croissance économique. À la faveur du renouveau du système de gouvernement, le président Soglo redorera le blason des religions endogènes en se conciliant les pouvoirs traditionnels et fait du 10 janvier de chaque année la Journée nationale du vaudou.
Cependant, le poids des contraintes sociales à la croissance économique ainsi que les ajustements structurels qui visaient, entre autres, la compression des dépenses publiques recommandées par le FMI viennent raviver le mécontentement général de la population. De plus, les trafics traditionnels s'épanouissent au grand jour (whisky, essence, ciment, voitures, etc.).
Après avoir perdu sa majorité au sein de l'Assemblée législative, le président Nicéphore Soglo, accusé de népotisme par ses adversaires, est battu par Mathieu Kérékou à la présidentielle du 17 mars 1996. C'est un choc pour Nicéphore Soglo qui, après avoir crié au complot, envoie ses félicitations à Mathieu Kérékou et s'en va méditer plus de quatre mois, hors d'Afrique, les raisons de ses erreurs fatales.
Démocratiquement, Mathieu Kérékou est de retour sur la scène politique béninoise, après avoir dirigé le pays pendant dix-sept années (de 1972 à 1990) dans le fiasco politique et économique de la désormais ancienne république populaire du Bénin.
Les élections législatives de mars 1999 donnent de justesse la victoire à la Renaissance du Bénin (RB), le mouvement de l'opposition dirigé par Rosine Soglo, épouse de l'ancien président Nicéphore Soglo. Ces élections marquent l'échec du Mouvement africain pour la démocratie et le progrès (MADEP), le parti d'un des proches du président Kérékou, l'homme d'affaires Séfou Fagbohoun.
Cependant, en mars 2001, Mathieu Kérékou est réélu président de la République avec 84.06 % des voix. Arrivé en tête au premier tour, face à son prédécesseur Nicéphore Soglo, il sera confronté au désistement de ce dernier ainsi qu'à celui d'Adrien Houngbédji arrivé en troisième position. Ces deux candidats démissionnaires ont qualifié le scrutin de « mascarade ».
Terni par des soupçons de fraudes électorales et âgé de soixante-sept ans, Mathieu Kérékou entame donc un second mandat consécutif dans des conditions économiques fragiles.
an 1990-1993 : Gabon - Les années de braise (1990-1993)
Du 23 mars au 19 avril 1990, la Conférence nationale, dont l'organisation a été décidée à la suite du sommet de la Baule, rassemble les responsables politiques du gouvernement et de l'opposition pour trouver les voies vers une démocratisation du régime. Cette conférence nationale aboutit au rétablissement du multipartisme et ouvre une période, surnommée les « années de braise », qui se clôt avec la première élection présidentielle multipartite remportée par Omar Bongo en décembre 1993 avec 51 % des suffrages exprimés.
La mort suspecte, le 23 mai 1990, de l'opposant politique Joseph Redjembe déclenche des émeutes à Libreville mais surtout à Port-Gentil (incendies, pillages). La France intervient militairement pour « protéger ses ressortissants ».
En septembre-octobre 1990, les premières élections multipartites au Gabon aboutissent à la victoire du PDG, qui obtient la majorité absolue au Parlement.
Le 5 décembre 1993, la première présidentielle pluraliste est organisée. Omar Bongo est réélu face au père Paul Mba Abessole du Rassemblement national des bûcherons (RNB) avec 51,07 % des voix. Malgré les contestations (Paul Mba Abessole se proclame vainqueur des élections et nomme un Premier ministre tandis que des violences éclatent), la Cour constitutionnelle valide le résultat de l'élection le 13 décembre. Les émeutes qui suivent la proclamation de ces résultats sont durement réprimées. La contestation de ce dernier ne sera soldé qu'avec les « accords de Paris » entre majorité et opposition le 7 octobre 1994.
Le changement le plus notable depuis cette démocratisation est la multiplication des partis, dont l'opposition est toutefois neutralisée en leur offrant des postes ministériels (avec le PDG qui organise systématiquement la fraude sur fond de manque de transparence électorale) et la floraison de journaux d'opposition difficilement viables. Depuis lors, toutes les élections sont gagnées par le PDG et contestées par l'opposition.
Le quotidien des Gabonais n'évolue pas beaucoup, la situation économique se dégradant même vu que le secteur public se réduit sous la pression des bailleurs de fond (FMI, Banque mondiale) alors que le secteur privé peine à se développer. Une conférence nationale se tient en mars-avril 1990. À l'issue de celle-ci, et de manifestations, d'importantes réformes politiques sont adoptées, dont la création d'un sénat national, la décentralisation des finances, la liberté de rassemblement et de la presse, l'abolition du visa de sortie obligatoire et le multipartisme. Les premières élections législatives multipartites en presque trente ans ont lieu en septembre-octobre 1990.
an 1990 : Guinée-équatoriale - Le pays, jusqu'alors sans grandes ressources, a bénéficié de la découverte de pétrole dans les eaux territoriales.
an 1990 - 1996 : Madagascar - La résistance au régime ne devient véritablement efficace qu’au début des années 1990, sous l’impulsion du mouvement Hery Velona (Forces Vives) qui réussit en février 1993 à faire tomber Ratsiraka. Le nouveau président, Albert Zafy, procède aussitôt à une libéralisation forcenée de toutes les institutions dans le cadre d’une Troisième République. Mais la situation, au lieu de s’améliorer se dégrade davantage encore. Les investisseurs boudent Madagascar, d'autant que le pouvoir même est paralysé par les intrigues entre les clans rivaux dominant le Parlement, sur fond de corruption généralisée. Tout ceci aboutit à la destitution de Zafy par la Haute Cour constitutionnelle (HCC) le 5 septembre 1996, la gestion du pouvoir étant confiée en interim au Premier ministre Norbert Ratsirahonana.
an 1990 : Mali - L'Union nationale des travailleurs du Mali tient son conseil central extraordinaire les 28 et 29 mai 1990 et déclare : « Considérant que le parti unique constitutionnel et institutionnel ne répond plus aux aspirations démocratiques du peuple malien ; […] le conseil central extraordinaire rejette en bloc le dirigisme politique qui entrave le développement de la démocratie au Mali […] opte pour l'instauration du multipartisme et du pluralisme démocratique.
Le 15 octobre 1990 est créée l'Association des jeunes pour la démocratie et le progrès (AJDP).
Le 18 octobre 1990, le Comité nationale d'initiative démocratique (Cnid) est créée à Bamako par Mountaga Tall et Demba Diallo47, afin d’agir à visage découvert pour le multipartisme.
Une semaine plus tard, le 25 octobre 1990, l’Alliance pour la démocratie au Mali est créé par des militants du PMT, du PMDR, du FDPM et de l’US-RDA créent l’Alliance pour la démocratie au Mali (Adéma), présidée par Abdrahamane Baba Touré.
Ces associations vont mobiliser la population, en organisant des marches à Bamako et dans d’autres villes du pays. Le 10 décembre 1990, le Cnid organise une manifestation pacifique qui réunit 10 000 personnes à Bamako. Le 30 décembre 1990 une marche unitaire est organisée par le Cnid et l’Adéma à Bamako. Entre 30 000 à 50 000 personnes y participent.
Le 27 juin 1990, un poste de gendarmerie est attaqué à Ménaka. C'est le point de départ de l'insurrection armée menée par le Mouvement populaire de l'Azawad de Iyad Ag Ghali.
an 1990 : Ile Maurice - Le Premier ministre perd le vote sur la modification de la Constitution pour faire du pays une république avec Paul Bérenger comme président.
an 1990-1993 : Namibie - L’histoire de la Namibie se divise en plusieurs époques très distinctes. La Namibie est le troisième pays le plus jeune d'Afrique après l'indépendance de l'Érythrée en 1993 et du Soudan du Sud en 2011, la Namibie est indépendante depuis 1990.
Autrefois « terre sans nom », baptisée Deutsch-Südwestafrika à partir de la colonisation allemande en 1884, ce territoire a été administré par le dominion de l'Union d'Afrique du Sud de 1915 à 1961, puis fut placé sous la tutelle de la république d'Afrique du Sud jusqu'en 1990.
La Namibie indépendante
La cérémonie solennelle a lieu en présence de 25 000 personnes dans le grand stade de Windhoek. Sont présents le président sud-africain Frederik de Klerk, Nelson Mandela libéré depuis février 1990, le chef de l'OLP Yasser Arafat, le président égyptien Hosni Moubarak. Les États-Unis et l'Union soviétique sont représentés par leur ministre des affaires étrangères, James Baker et Edouard Chevardnadze. Le drapeau sud-africain est amené, marquant la fin de l'administration du gouvernement de Pretoria, avant que Sam Nujoma prête serment devant le secrétaire général de l'ONU. Pendant deux jours, de multiples défilés ont lieu dans les rues des villes mais les plus importants sont concentrés sur la Kaiser Strasse de Windhoek, bientôt rebaptisée avenue de l'indépendance.
Le nouvel État namibien, le 160e membre des Nations unies, hérite de nombreux atouts dont celui de figurer immédiatement dans le peloton des cinq pays les plus riches d'Afrique (en termes de PIB) avec l'Afrique du Sud, la Libye, le Gabon et le Botswana. Disposant d'un réseau routier moderne (au sud du parc d'Etosha), elle est totalement dépendante de la République sud-africaine (son principal fournisseur et son principal client à plus de 90 %) laquelle a néanmoins gardé le contrôle du port de Walvis Bay (elle ne le rendra qu'en 1994 après de longues négociations) et avec qui elle partage une union monétaire et douanière.
Par ailleurs, 4 664 propriétaires blancs exploitent 36 millions d'hectares alors que près d'un million de personnes (noires) survivent sur
34 millions d'hectares de terres communales. Les doutes sur la loyauté des milliers de fonctionnaires blancs restés en place vis-à-vis du nouvel État augmentent les tensions. Le retour en Namibie de plusieurs milliers d'exilés d'Allemagne de l'Est, dont certains n'avaient jamais vécu dans leur pays d'« origine », est vécu difficilement par ces derniers qui sont affublés du surnom d'« Allemands de l'Est de Namibie ».
L'aide étrangère attendue n'est pas non plus toujours au rendez-vous et le pays est placé sous surveillance économique. En fait, bien que les vertus de l'économie mixte soient le discours officiel, c'est bien l'économie de marché capitaliste qui est finalement appliquée.
Si, par nécessité, les relations sont bonnes avec l'Afrique du Sud, elles se détériorent avec l'Angola et la Zambie alors que la SWAPO tourne le dos au système collectiviste. Le pragmatisme prévaut et l'apprentissage réussi de la démocratie marque les premières années du gouvernement de la SWAPO. Le mérite en revient d'abord au premier ministre modéré Hage Geingob, mais aussi à Sam Nujoma qui en dépit de discours plus radicaux tranche toujours les débats en faveur de son premier ministre. Ainsi quand, soutenu par Hifikepunye Pohamba, Moses Garoëb estime dès avril 1990 que « la réconciliation nationale est allée trop loin » et dénonce le statu quo, Nujoma n'hésite pas à renouveler publiquement sa confiance en Geingob et en Theo-Ben Gurirab.
En 1992, les 31 anciens districts conçus par le rapport Odendaal sont redécoupés et laissent la place à 13 régions divisées en 95 circonscriptions et 53 localités. L'Ovamboland est ainsi divisé en quatre régions (Omusati, Ohangwena, Oshana, Oshikoto). En 2013, le pays est divisé en 14 régions. Les premières élections régionales et municipales post-indépendance ont lieu du 20 novembre au
3 décembre 1992 et indiquent un renforcement massif de la SWAPO (68,9 %), au détriment des petites formations, sur l'ensemble du pays, contre 28,6 % à la DTA. La SWAPO prend le contrôle de 9 régions, de 70 circonscriptions et de 31 villes dont Swakopmund, Grootfontein, Tsumeb, Lüderitz, Okahandja et Otjiwarongo. À Windhoek, le maire sortant Abraham Bernard May laisse la place à Matheus Shikongo (SWAPO).
En 1993, les premiers dollars namibiens sont mis en circulation mais l'unité monétaire reste le rand sud-africain dont les billets continuent à avoir cours légal dans le pays.
an 1990 - 1994 : Tunisie - Le président Bourguiba, modernise la pays. Il instaure la gratuité de l'enseignement, il instaure le Code du Statut personnel, qui est très favorable aux femmes et il reconnait les libertés fondamentales. En économie il nationalise les terres des colons et commence une réforme agraire. Le développement est planifié. Mais les remous créés par les nationalisations de terres obligent à arrêter la réforme en 1971 et à privatiser les entreprises d'état. Depuis le début des années 1990, la famille du président Ben Ali puis celle de sa seconde épouse contrôlent étroitement les activités modernes et en tirent des revenus considérables.
Depuis 1994, l'opposition a droit à 20 % des députés, mais le président recueille de 95 à 99 % des voix aux élections présidentielles. La vie démocratique est sous surveillance policière étroite et les graves atteintes aux droits de l'homme sont régulièrement dénoncées par les organisations internationales de défense des droits de l'homme. L'apparition de l'islamisme intégriste est combattue vigoureusement par le président Ben Ali.
an 1990-1993 : Togo - De violentes émeutes éclatent à Lomé, en octobre 1990, gagnant peu à peu les régions, surprenant le pouvoir. Les manifestations, au départ pacifiques, deviennent rapidement de violentes et sanglantes insurrections. Le président cède et accorde le multipartisme. Cette concession est malgré tout jugée insuffisante. Les chefs de l'opposition demandent la tenue d'une conférence internationale qui leur est d'abord refusée, puis accordée sous la pression de la grève générale de juin 1991. La conférence nationale souveraine (800 délégués) siège du 8 juillet au 28 août, dans un climat ambiant très tendu.
Il en résulte l'élection de Joseph Koffigoh, un nouveau premier ministre appelé chef du gouvernement de transition, assisté par le Haut Conseil de la République (HCR) qui tâche d'élaborer une nouvelle Constitution, ainsi que de veiller à la tenue des états généraux de la Santé, des Affaires sociales, de l'Éducation, etc. Et de préparer pour 1992, de nouvelles élections.
L'armée se retrouve divisée, les tentatives de rendre le pouvoir au général Eyadéma, toujours Président en titre, mais sans aucune autorité, n'aboutissent pas et déclenchent de graves épisodes sanglants dans l'ensemble du pays. Les maisons brûlent, les anciennes rancunes entre ethnies refont surface, les victimes sont nombreuses de chaque côté.
Les 27 et 28 novembre 1991, l'armée, principalement composée de Kabyê s'empare de la radio et de la télévision, et se rend devant la primature (la résidence du premier ministre). Elle exige la dissolution du HCR et la participation du RPT au gouvernement.
Après quelques jours, l'armée attaque la primature. Le premier ministre Josseph Koffigoh, alors présent, est emmené de force au palais présidentiel où il conclut avec le président Eyadéma, un accord où il est sommé de former un gouvernement d'union nationale avec des ministres du parti du président, le RPT. Au même moment, les responsables du HCR s'enfuient à l'étranger ou restent chez eux, sans bouger. Le RPT retrouve sa place et le général Eyadéma ses pouvoirs.
Puis le 27 septembre 1992, le pays adopte une nouvelle Constitution, qui conforte les pouvoirs retrouvés du Président. L'opposition organise des grèves ainsi que de nombreuses manifestations qui sont réprimées dans le sang en janvier 1993. On dénombre au moins 16 morts, l'opposition parle de 50 morts. La Communauté européenne suspend immédiatement sa coopération avec le Togo.
Ces violences entraînèrent un exode massif vers le Ghana (où auraient trouvé refuge 100 000 personnes) et le Bénin (130 000 personnes). Le 25 mars 1993, le général Eyadéma échappe à une attaque lancée contre sa résidence officielle. En août 1993, Eyadéma est réélu avec 94,6 % des voix en raison du boycottage du scrutin par l'opposition. Cependant, celle-ci remporte les élections législatives de février 1994 et obtient la majorité à l'Assemblée nationale. Les deux partis d'opposition (le CAR et l'UTD) nomment un Premier ministre, mais Eyadéma refuse et confie le poste à Edem Kodjo, chef de l'UTD.
an 1990-1991 : Rwanda - Subissant une pression aussi bien intérieure de la part d'hommes politiques, d'intellectuels ou de journalistes, qu'extérieure de la part de pays bailleurs de fond exigeant des réformes, Juvénal Habyarimana abandonne le 5 juillet 1990 la présidence de son parti unique et annonce un prochain changement de la Constitution pour donner naissance à une démocratie en autorisant la création de partis politiques. En septembre 1990, quatre journalistes sont jugés pour avoir publié des articles sur la corruption du gouvernement, mais sont acquittés. Une semaine plus tard, Habyarimana nomme les membres de la commission chargée d'étudier la réforme politique. C'est à ce moment que le Front patriotique rwandais décide de lancer une attaque contre le Rwanda depuis l'Ouganda.
1er octobre 1990 : début de la guerre civile rwandaise - L'Armée patriotique rwandaise, branche armée du FPR, lance une attaque depuis l'Ouganda sur le nord du Rwanda le 1er octobre 1990, bénéficiant d'un large appui de l'armée ougandaise – le chef de l'APR, Fred Rwigema est alors le numéro deux de l'armée ougandaise. Cette attaque marque ainsi le début de la guerre civile rwandaise. Le président Habyarimana appelle ses alliés à le soutenir. La France envoie des troupes le 4 octobre 1990 dans le cadre de l'opération Noroît. 500 paras belges opération "Green Beam" arrivent le lendemain ainsi que des troupes zaïroises. Ces dernières ainsi qu'une partie des troupes francaises sont les seules à être engagées au combat tandis que troupes belges et le restant des troupes françaises sécurisent la capitale où se trouvent la grande majorité des expatriés. Le Président Habyarimana demande lui-même le retrait des militaires d'élites de la Division Spéciale Présidentielles zaïroises, une semaine après leur engagement, car à défaut de s'impliquer dans les combats contre le FPR ils se comportent plutôt en pillards. Les Belges quittent le Rwanda le 2 novembre 1990 après le rapatriement de leurs ressortissants. Par la suite, l’intervention des troupes françaises dans le cadre de l’opération Noroît a été jugée « à la limite de l’engagement direct » par la Mission parlementaire d’information sur le Rwanda
La tentative d'invasion du FPR échoue, les Forces armées rwandaises réussissant à contenir l'offensive avec l'appui des forces françaises et zaïroises, et une répression massive fait suite à son attaque. Environ 10 000 personnes sont arrêtées, Tutsis ou opposants au régime, voire commerçants ougandais ou zaïrois. Des massacres de Tutsis sont organisés par les autorités locales dans le nord-ouest du Rwanda selon les règles de la corvée collective, et apparaissent comme un système d’intimidation et de vengeance en réponse à l'attaque du FPR. Mais loin d'unifier la population Hutu autour du régime, la répression conduit l'opposition à se renforcer, des organismes de défense des droits de l'homme se créent. Le 1er novembre 1990, les troupes belges se retirent. Le 9 novembre, est créé à Bruxelles un parti politique en exil, l'Union du peuple rwandais, qui dénonce les assassinats au Rwanda et la corruption du gouvernement. Le 11 novembre 1990, le Président Habyarimana annonce dans un discours à la radio l’instauration du pluripartisme et la tenue d’un référendum constitutionnel pour juin 1991, et annonce la suppression des mentions ethniques sur les cartes d’identité et les documents officiels.
En janvier 1991, le FPR effectue un raid sur Ruhengeri, s'empare de matériel militaire et libère de nombreux prisonniers politiques. En représailles, des massacres organisés par les bourgmestres eurent lieu jusqu'en juin, occasionnant entre 300 et 1 000 morts.
En février 1991, à l'instigation du HCR et de l'OUA, une conférence à Dar es Salam entre le Rwanda et l'Ouganda débouche sur une déclaration commune au terme de laquelle le Gouvernement rwandais s’engage à offrir à chaque réfugié le choix entre une des trois solutions suivantes : le retour au Rwanda, l’intégration par naturalisation dans le pays d’accueil, l’établissement dans le pays d’accueil avec maintien de la nationalité rwandaise. Cependant, pour le gouvernement rwandais, le retour des réfugiés est conditionnée à une aide financière extérieure, or la communauté internationale, davantage préoccupée par les événements de Yougoslavie et la chute de l'Union Soviétique, se désintéresse du Rwanda.
La France conditionne la poursuite de son appui militaire à la démocratisation du pays. Conjugué à l'affaiblissement du parti présidentiel et à l'opposition croissante, cela accélère le processus de réforme entamé en juillet 1990. Le 10 juin 1991, un amendement constitutionnel légalisant le multipartisme entre en vigueur. Le Mouvement démocratique républicain, principal parti d'opposition, est légitimé et une quinzaine d'autres partis sont fondés dans les mois qui suivent, les plus importants étant le Parti Social-démocrate, le Parti libéral et le Parti démocrate chrétien. Les principaux partis rejettent toute idéologie prêchant l’ethnisme, ou favorisant une région au détriment d'une autre. Ils souhaitent une négociation avec le FPR.
an 1990 : Sao Tomé et Principe - En août 1990, sous la pression de l'opposition, réunie dans la Coalition démocratique, une nouvelle Constitution instaura le multipartisme.
an 1990 - 1921 : Tchad - Présidence d'Idriss Déby (1990 - 2021)
Dès sa prise de pouvoir, Idriss Déby cherche à réconcilier les différents groupes rebelles et réintroduit le multipartisme au Tchad. Il fait adopter une nouvelle constitution par référendum et remporte en 1996 l'élection présidentielle.
En 2003, les recherches de gisements pétroliers permettent au Tchad de lancer les premières phases d'exploitation de son sous-sol, entraînant avec elles l'espoir que le Tchad puisse enfin connaître une phase d'essor économique et de développement humain.
Toutefois, alors que le président Déby fait modifier la constitution pour supprimer la limite de deux mandats présidentiels, une guerre civile éclate, contestant cette mainmise sur le pouvoir. Le président réussit à se maintenir au pouvoir et à être réélu, lors d'élections contestées boycottées par l'opposition. Entre 2006 et 2008, les forces d'opposition rebelles tentent plusieurs fois de prendre la capitale par la force, mais échouent systématiquement.
Le 13 avril 2006, des combats éclatent entre les troupes du président de la République et une faction de la rébellion, le Front uni pour le Changement (FUC), dans la périphérie de N'Djaména. Idriss Déby Itno accuse le Soudan, en pleine guerre du Darfour, de soutenir ses adversaires, à l’aube des élections présidentielles. Malgré l’opposition et les appels au boycott, le 3 mai 2006, Idriss Déby Itno est réélu au suffrage universel avec 64,67 % des votes exprimés. Le 2 février 2008, les rebelles, en provenance du Soudan frontalier, s’emparent de la capitale du Tchad, N'Djaména, à l'exception du palais présidentiel où le président Idriss Déby Itno semble s'être cloîtré. La France décide d’évacuer une partie de ses ressortissants. Le 4 février 2008, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques contre le gouvernement tchadien53, dont l’armée rencontre des difficultés à repousser les rebelles. La France, via l’opération Épervier, apporte alors une aide logistique qui permet d’assurer la stabilité régionale au Tchad .
Mais les rebelles mènent une guerre de mouvement dans l’Est du Tchad, afin de faire tomber le gouvernement au pouvoir. Les attaques répétées ont pour conséquence de provoquer en juin 2008 un combat opposant pour la première fois la mission militaire européenne EUFOR et les rebelles au sud d’Abéché, autour de la ville de Goz Beïda. En novembre 2008, dans l’Est du pays, deux véhicules militaires belges sont brûlés, à la suite de tirs provenant d’hélicoptères soudanais.
Contingent de la mission militaire EUFOR au Tchad en 2007-2009.
En mai 2009 a lieu une autre offensive de la rébellion partant du Soudan, toujours dans l'objectif de renverser Idriss Déby58. Le contingent militaire français de l'opération Épervier est suppléé, entre 2007 et 2009, par la force d'interposition EUFOR, forte de 3 000 soldats, mandatée par l'Union européenne à la demande de la France, en principe neutre mais qui assure un soutien de fait au régime du président Déby.
Finalement, en 2010, le président soudanais Omar el-Bechir se rend au Tchad pour normaliser les relations entre les deux pays. Le gouvernement du Tchad refuse d’arrêter ce dernier, pourtant visé par des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale émis à son encontre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour.
Article détaillé : Guerre civile tchadienne (2005-2010).
an 1990 : Zambie - les années 1990 sont marquées par la chute des prix du cuivre et par les sécheresses.
an 1991-1992 : Afrique du Sud - De mars à juin 1991, de Klerk fait abolir par le parlement les dernières lois d'apartheid encore en vigueur concernant l'habitat et la classification raciale. L'état d'urgence est levé à l'exception du Natal où des violences meurtrières entre ANC et partis noirs conservateurs ensanglantent la région.
En juin 1991, le gouvernement abolit les dernières lois de l'apartheid et entame un processus de transition constitutionnelle (Codesa).
Alors que les négociations continuent et que débutent les travaux de la CODESA le 20 décembre 1991, les élections partielles dans les régions afrikaners constituent de multiples revers pour le NP au profit du CP. De Klerk décide de faire de l'élection locale de Potchefstroom, fief NP du Transvaal, un enjeu national sur l'approbation des Blancs à ses réformes. Cette élection, qui a lieu au début de l'année 1992, est un cuisant revers électoral pour le NP avec la victoire du CP qui profite alors de l’aubaine pour réclamer des élections anticipées. De Klerk est affaibli par cette élection qui survient à la suite d'autres revers électoraux au profit des conservateurs. Les sondages sont mauvais pour le parti nationaliste. Tous indiquent, sinon une défaite face au CP, du moins la perte de la majorité absolue si des élections anticipées ont lieu. Une seule issue parait apporter des chances de succès, c'est l'organisation d'un référendum sur le bien-fondé des réformes, qui permettrait aux électorats du NP et du DP de s’additionner dans un même vote face au CP.
La campagne est très dure entre les partisans et les adversaires des réformes. Le but est la validation ou non par l'électorat blanc de l'abolition de l'apartheid, la continuation des négociations en vue du transfert de pouvoir à la majorité noire avec en contrepartie l’obtention de garanties quant aux libertés fondamentales.
Durant la campagne, de Klerk reçoit l'appui critique des libéraux lesquels dénoncent l’exclusivité des négociations NP-ANC et la mise à l’écart des autres formations politiques. De son côté, les adversaires des réformes réunissent dans un même camp l’extrême-droite, le CP et plusieurs conservateurs du NP en dissidence de leur parti, notamment Pieter Botha, l'ancien président. Utilisant adroitement la répulsion que provoque l’extrémisme de l’AWB d’Eugène Terreblanche dans l'électorat blanc modéré, assénant un message efficace par sa dichotomie (« Moi ou le chaos ») et bénéficiant d'un grand avantage financier et médiatique sur ses adversaires conservateurs, le NP a à cœur de mobiliser l'électorat sur le péril immense et irréversible causé par la généralisation de la violence et la faillite économique qu'entrainerait un vote négatif.
Le référendum eut lieu le 17 mars 1992. Avec un taux de participation supérieur à 80 %, les Blancs votent à 68,7 % pour le « oui » aux réformes. Le CP subit une défaite cruciale. Le référendum oblige les Blancs à décider concrètement de leur avenir et à faire un choix clair et définitif sur la politique de réformes constitutionnelles du gouvernement.
La défaite des partisans de l’apartheid est sans appel. La plupart des régions fiefs du CP votent oui aux réformes (51 % à Kroonstad et 58 % à Bloemfontein dans l'État Libre d'Orange ; 54 % à Kimberley dans le Cap-nord ; 52 % à Germiston et même 54 % à Pretoria dans le Transvaal). Seule la région de Pietersburg dans le Northern Transvaal manifeste à 57 % son hostilité aux réformes.
Dans les régions anglophones, c'est un raz-de-marée en faveur du oui (78 % à Johannesbourg, au Cap, à Port Elizabeth), les records ayant lieu au Natal (78 % à Pietermaritzburg ; 84 % à Durban). C'est la consécration pour de Klerk, qui déclare qu'en ce jour les Sud-Africains ont décidé par eux-mêmes de refermer définitivement le livre de l'apartheid. Sans condamner le régime passé, il rappelle que le système né de bonnes intentions avait dérapé sur la réalité des faits. Il s’avère que les Blancs ne renoncent pas au système parce qu'il est moralement condamnable, mais parce qu’avec pragmatisme, la communauté afrikaner prend acte du fait que l'apartheid est un échec, n'ayant pu lui assurer ni la sécurité économique ni la sécurité physique. Une issue négociée est alors d'autant plus vitale pour les Blancs.
an 1991 : Algérie - Début de la guerre civile en 1991. L'Algérie traverse alors une « décennie noire », marquée par l'affrontement entre les militaires, qui continuent à détenir les rênes du pouvoir, et les divers groupes islamistes (AIS, GIA, GSPC, etc.).
an 1991-2001 : Bénin (anc. Dahomey) - À la suite de l'élection présidentielle de mars 1991, Nicéphore Soglo remplace Mathieu Kérékou à la présidence de la République. Ce dernier est élu à son tour en mars 1996 puis réélu en mars 2001.
an 1991 : Burkina Faso - Une nouvelle constitution est adoptée par référendum et le 1er décembre 1991, Blaise Compaoré est élu président de la République (taux d'abstention : 74 %). Il est réélu en 1998, 2005 et en 2010.
an 1991 : Cap Vert - Le système à parti unique est officiellement aboli le 28 septembre 1990, et les premières élections libres ont lieu en janvier 1991. Elles voient la large victoire (73,5 %) du candidat du Mouvement pour la Démocratie, António Mascarenhas Monteiro, qui défait Aristides Pereira, président en fonction depuis 1975.
an 1991 : Congo Brazzaville - Confronté à une opposition de plus en plus forte, Denis Sassou-Nguesso organise une Conférence nationale, du 25 février au 10 juin 1991.
La Conférence nationale s'ouvre le 25 février 1991, et se proclame immédiatement souveraine. Elle est présidée par l'évêque d'Owando, Mgr Ernest Kombo. Y siègent des représentants de l'État, de partis politiques et d'associations de la société civile. Le président Sassou-Nguesso se voit retirer la plupart de ses prérogatives, mais n'est pas destitué. La restauration des symboles de la 1rel'hymne national et le drapeau tricolore proposé par Mbiki De Nanitélamio le président du RPR : est approuvée. Un Conseil supérieur de la République (CSR) remplace l'Assemblée nationale populaire.
an 1991 : Kenya - En août 1991, avec cinq autres opposants au régime, Oginga Odinga fonde le parti politique d'opposition Forum for the Restoration of Democracy (en) (FORD) et en devient président intérimaire. Les six fondateurs sont arrêtés et emprisonnés par le président Moi. Cette arrestation déclenche une série d'événements, dont l'interruption de l'aide internationale. Les pressions du Royaume-Uni, des États-Unis et des pays scandinaves aboutit à la libération des six hommes politiques puis, en décembre 1991, à l'abolition de l'article 2A de la Constitution. Le pays redevient, constitutionnellement, un État de multipartisme.
an 1991 : Congo Kimshasa (Zaïre) - début de la conférence nationale (août) sous la direction du premier ministre Mulunda Lukoji. Le 23 septembre les militaires impayés se livrent à de graves pillages à Kinshasa ainsi que dans plusieurs autres villes du pays. Mobutu affaibli acceptera de négocier avec l'opposition politique pour aboutir aux accords du Palais de Marbre qui conduiront à la nomination de l'opposant Étienne Tshisekedi de l'Udps comme Premier ministre. Il le reste du 1er au 21 octobre, date à laquelle il fut limogé par le président Mobutu Sese Seko pour être remplacé par Mungulu Diaka et ensuite Nguz Karl-i-Bond.
an 1991-2001 : Afrique République de Djibouti - À partir de 1991, une guerre oppose le gouvernement au Front pour la restauration de l'unité et la démocratie (FRUD), dirigé par Ahmed Dini, figure emblématique de l'opposition djiboutienne. Après un premier revers, l'armée reprend le contrôle du territoire en 1994. C'est alors qu'un traité est signé entre une partie du FRUD et le gouvernement djiboutien. Une partie plus radicale (le FRUD armé) n'intègre le processus de paix qu'en 2001.
En 1992, après le début de l'insurrection, une Constitution est adoptée par référendum. Elle prévoit un multipartisme partiel avec quatre partis.
En 1999, Ismaïl Omar Guelleh devient président de la République.
an 1991-1993 : Érythrée - En mai 1991, des militants du Front de libération du peuple du Tigray, proche du FPLE et soutenus par les États-Unis, renversent le Derg. Un gouvernement provisoire est mis en place. Les troupes du FPLE prennent le contrôle de l'Érythrée. La fin de la guerre est formalisée à Londres à la fin du mois de mai dans le cadre d'une conférence qui réunit les quatre principaux groupes combattants. Des pourparlers de paix se déroulent alors à Washington. Du 1er au 5 juillet 1991, la Conférence d'Addis Abeba établit un gouvernement de transition en Éthiopie. Le FPLE participe à la conférence en tant qu'observateur et négocie avec le nouveau gouvernement à propos des relations entre l'Érythrée et l'Éthiopie.
Cela aboutit sur un accord dans lequel l'Éthiopie reconnait à l'Érythrée le droit d'organiser un référendum sur la question de l'indépendance.
Le peuple érythréen se prononce pour l'indépendance au cours d'un référendum tenu du 23 au 25 avril sous la surveillance de l'ONU. Les autorités érythréennes déclarent l'indépendance le 27 avril. Le FPLE se réorganise en parti politique, prenant le nom de Front populaire pour la démocratie et la justice. L'Érythrée est déjà présidé, depuis cette accession à l'indépendance, par Isaias Afwerki. Ce mouvement FPLE affirme sa volonté de soutenir une économie de marché. Certains de ses cadres étaient initialement intéressés par l'idéologie marxiste ou maoïste, mais le soutien de l'Union soviétique à Mengistu a persuadé ce mouvement d'opter pour d'autres alliances et d'autres idéologies. Le FPLE institue un gouvernement provisoire avec à sa tête Isaias Afwerki, chef de file du mouvement. Le Comité central du FPLE tient cependant lieu de corps législatif.
an 1991-1995 : Éthiopie - Arrivé au pouvoir le 28 mai 1991, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien organise une conférence nationale du 1er au 5 juillet ; les 24 mouvements ayant participé à la guerre contre le Derg se réunissent. La nature de ces mouvements, nationalistes, autonomistes et régionalistes pour la grande majorité, oriente les débats vers des questions de revendications des différents peuples. La Charte nationale adoptée à l'issue de la conférence, prévoit la mise en place du Gouvernement de Transition d'Éthiopie (GTE) qui devra diriger le pays pendant deux ans. Il restera en place jusqu'en 1995. En novembre 1991, la population éthiopienne est « frappée » par la nouvelle division administrative. Le pays est partagé en douze kelels dont les frontières sont basées sur les différences de peuples et de culture en fonction du critère de la langue maternelle dominant.
Pour mettre fin au problème érythréen, le FDRPE et Front de libération du peuple érythréen (FLPE) s'accordent sur le droit de faire sécession, un droit théoriquement reconnu aux autres peuples d'Éthiopie. Un référendum est prévu bien que de facto, l'Érythrée soit déjà sous contrôle du FLPE. Le scrutin est organisé du 23 au 25 août 1993 et les séparatistes le remportent avec un score de 99,79 %. Le 24 mai 1993, l'Érythrée déclare son indépendance ; le gouvernement d'Addis Abeba est le premier à la reconnaître. Divers accords sont signés entre les deux États concernant la coopération et la défense.
Le 21 juin 1992, le FDRPE remporte les premières élections multipartites dans un climat national agité. Plusieurs partis politiques se sont retirés de la course, certains opposants affirment avoir subi des pressions et les candidats du FDRPE ont subi des attaques dans des zones contrôlées par le FLO. Le 5 juin 1994, les membres de l'assemblée constituante chargée d'adopter le texte élaboré par le GTE sont élus. 484 des 547 sièges sont remportés par le FDRPE. Une commission de rédaction de la constitution, créée le 18 août 1992 organise au début de l'année 1994 une série de réunions afin de percevoir l'opinion de la population. Le 8 avril 1994, un avant-projet de constitution est présenté, marqué par le fédéralisme à base linguistique. Le 28 octobre 1994, l'assemblée constituante débute le processus d'élaboration de la constitution en se basant sur l'avant-projet. Le 8 décembre 1994, elle vote une rectification et prévoit l'organisation d'élections pour le 7 mai 1995. Le 24 août 1995, le Conseil des Représentants des Peuples nouvellement élu adopte la Constitution, la République fédérale démocratique d'Éthiopie est proclamée. Negasso Gidada en devient le président, tandis que Meles Zenawi occupe le poste de Premier ministre.
La transition de quatre ans a été « tranquille » et « rapide ». La volonté d'introduire les droits de l'Homme et la légalité s'est d'abord heurtée à la réalité politique d'un État disposant de peu d'infrastructures dans lequel la force de la loi est peu effective. Le nouveau régime offre une liberté de mouvement et de circulation des gens et des capitaux ; en outre, les observateurs étrangers peuvent librement visiter le pays. Des médias libres apparaissent et les organisations de masse héritées du Derg disparaissent.
Le bilan des réformes économiques est mitigé. Si l'économie éthiopienne reste influencée par le rôle de l'État, jamais dans son histoire, une telle marge de liberté n'a été laissée aux investisseurs privés. Les terres restent une propriété du gouvernement, une mesure qu'il défend affirmant vouloir éviter un exode rural. Les finances publiques ont été contrôlées, la proportion des dépenses militaires a baissé et les ministères coordonnent leurs activités avec les régions. Le gouvernement a lutté avec succès contre l'inflation forte que tous les autres pays anciennement socialistes ont connu.
an 1991 : Mali - Le régime interdit d’activité l’Adéma et le Cnid le 18 janvier 1991.
Le 18 janvier 1991, une nouvelle manifestation est organisée à Bamako. Mountaga Tall, le leader du Cnid est blessé par un tir de grenade lacrymogène.Le lendemain, une manifestation a lieu à Ségou.
Le 3 mars 1991, une marche unitaire rassemble le Cnid, L’adéma, l’Association pour la justice, la démocratie et le progrès (AJDP) et la Jeunesse libre et démocratique (JLD). Le 17 mars 1991, l’Adema, le Cnid et l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) organisent une marche silencieuse en souvenir de Cabral, leader étudiant assassiné le 17 mars 1980.
Le Comité de coordination des associations et des organisations démocratiques, communément appelé Mouvement démocratique voit le jour le 22 mars 1991. Il est constitué par le Cnid, l’Adéma, l’AJDP, le JLD, l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), l’Association malienne des droits de l'homme (AMDH), l’AEEM et le barreau.
Le 26 mars 1991, Moussa Traoré est arrêté par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Un comité de réconciliation nationale est formé par les militaires.
Le Comité de réconciliation nationale rencontre les organisations démocratiques regroupées au sein du Comité de coordination des associations et des organisations démocratiques (CCAOD). Ils décident de constituer le Comité transitoire pour le salut du peuple (CTSP), qui comprend dix militaires et quinze représentants des organisations démocratiques dont 4 représentations des associations de jeunes et deux du mouvement de rébellion du nord. Le CTSP, présidé par Amadou Toumani Touré assume les fonctions de gouvernement provisoire.
Le CTSP organise une conférence nationale du 29 juillet 1991 au 12 août 1991 afin d’élaborer une nouvelle constitution et définir le processus électoral.
Le multipartisme est reconnu et une charte des partis politiques a été établi par une ordonnance CTSP le 10 octobre 1991.
an 1991-1999 : Maroc -
Le Maroc se distingue comme faisant partie des pays arabes ayant envoyé un contingent au Koweït aux côtés des Occidentaux pendant la guerre du Golfe, malgré les fortes manifestations populaires dans les rues marocaines en faveur de l'Irak de Saddam Hussein.
Sur le plan intérieur, les années 1990 voient s'amorcer une relative libéralisation du régime par le roi Hassan II, politique qui culmine avec la tenue des élections démocratiques de 1997 et la formation d'un gouvernement dit d'alternance, présidé par Abderrahman El Youssoufi de l'USFP (socialiste), et qui succède aux gouvernements technocratiques de Mohammed Karim Lamrani et d'Abdellatif Filali. Les prérogatives royales restent néanmoins confirmées par les référendums constitutionnels de 1992 et 1996.
En 1994 Marrakech abrite la réunion internationale qui aboutit à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
an 1991-1997 : Mauritanie - En 1991, les partis d'opposition furent légalisés et une nouvelle Constitution fut approuvée lors d'un réferendum en juillet 1991, ce qui instaure le multipartisme et Ould Taya crée le Parti républicain démocratique et social (PRDS) pour ce présenté à la prochaine élection. Depuis, de nombreuses élections ont eu lieu, en 1992, il est élu président de la République et est réélu en 1997.
À partir de 1995, Ould Taya instaure des relations diplomatiques avec Israël. La Mauritanie est en effet l'un des trois seuls pays de la Ligue arabe avec l'Égypte et la Jordanie à avoir des liens diplomatiques avec Israël.
an 1991 : Sao Tomé et Principe - En 1991, les élections législatives virent la victoire du parti d'opposition, le Parti de la convergence démocratique, et son dirigeant, Miguel Trovoada, fut élu président de la République. Le Parlement adopta un plan de redressement économique et de privatisations prôné par le FMI. La baisse brutale du niveau de vie imposée par ce plan fut à l'origine de graves désordres sociaux et politiques
an 1991-2002 : Sierra Leone - La guerre civile de Sierra Leone se déroula de mars 1991 au 18 janvier 2002. Cette guerre avait pour principal but le contrôle des zones diamantifères.
Elle causa la mort de 100 000 à 200 000 personnes et le déplacement de plus de 2 millions de personnes (ce qui représente le tiers de la population de l'époque). De nombreuses mutilations eurent également lieu, ainsi que l'emploi massif d'enfants soldats.
an 1991 : Seychelles - Le multipartisme est instauré en 1991.
an 1991 : Somalie - En mai 1991, le nord du pays, où les Issas sont majoritaires, déclare son indépendance sous le nom de Somaliland. Bien que de facto indépendant et relativement stable par rapport à l’agitation au sud, il n'est reconnu par aucun gouvernement étranger. Le successeur de Mohamed Siad Barre, Ali Mahdi Muhammad (janvier-novembre 1991) n'arrive pas à s'imposer sur l'ensemble du territoire, déchiré entre les seigneurs de guerre et les différents clans somalis. La sécheresse de 1991, dans un pays à l'équilibre alimentaire fragile, provoque une famine meurtrière car les affrontements empêchent l'arrivée des secours. Le bilan est estimé à environ 300 000 morts
an 1991 - 1996 : Zambie - En 1991 a lieu la première alternance politique : l'UNIP de Kenneth Kaunda est battu par le Movement for Multiparty Democracy (MMD) (en français : Mouvement pour la démocratie multipartite) de Frederick Chiluba.
En mars 1993, le gouvernement se déclare menacé par un « complot » et instaure l'état d'urgence. Plusieurs figures de l'opposition, incarnée par l'UNIP, sont arrêtées. Les relations diplomatiques sont rompues avec l'Iran et l'Irak, que le gouvernement zambien accuse de procurer une aide à l'UNIP. En janvier 1994, les affaires de corruption et de trafic de drogue impliquant le gouvernement conduisent le président Chiluba à limoger plusieurs de ses ministres. En 1996, le MMD au pouvoir remporte les élections boycottées par l'opposition dans un contexte de faible participation.
an 1992-1994 : Afrique du Sud - Si le référendum de mars 1992 donne un mandat sans ambigüité à Frederik de Klerk, la CODESA, qui rassemble dix-huit partis et le gouvernement pour des négociations constitutionnelles, se retrouve dans l'impasse à cause des exigences des dirigeants zoulous de l'Inkatha Freedom Party. Après le massacre de Boipatong, au cours duquel des militants zoulous abattent une soixantaine de résidents d'un township favorables à l'ANC, avec la complicité passive de la police, les travaux de la CODESA sont ajournés. En septembre 1992, Mandela menace et force de Klerk à libérer des prisonniers politiques en échange de la reprise des pourparlers avec l'ANC. Dans cette période critique, les deux négociateurs en chef ont des difficultés relationnelles. Mandela est convaincu que le président sud-africain n'est pas un partenaire loyal et le croit complice actif ou passif d'une troisième force, dirigée par les services de renseignements, qui attaque les partisans de l'ANC. Alors que le président de Klerk se considère comme un partenaire égal de l'ANC dans la création de la nouvelle Afrique du Sud, Nelson Mandela ne reconnait pas le président sud-africain, ni le gouvernement, comme un partenaire loyal, égal et moralement digne de lui. Mais, réaliste, il est conscient du pouvoir coercitif de l'État et de la nécessité de traiter avec ses représentants. Des scandales éclaboussent le gouvernement de Klerk, donnant raison à Mandela quant à l'existence d'une troisième force. Mis en cause dans la fourniture d'armes au parti zoulou Inkhata pour contrer les militants de l'ANC, Magnus Malan est contraint d'abandonner son poste de ministre de la défense pour celui des eaux et forêts. Le ministre de la loi et de l'ordre, Adriaan Vlok, est lui aussi impliqué dans ce scandale et cède également son poste pour un autre moins sensible. La mise à l'écart de ces deux piliers conservateurs du gouvernement, compromis dans les exactions des forces de sécurité, oblige de Klerk à accélérer les négociations en vue de l'élection d'une assemblée constituante en 1994.
Un forum multipartite, composé de vingt-six partis auquel se joint le Parti conservateur à titre d'observateur, succède à la CODESA. Les négociations, qui se tiennent à Kempton Park, près de Johannesbourg, doivent aboutir à la proposition d'une constitution provisoire. Ne voulant pas brader les intérêts de la minorité blanche, de Klerk recherche des garanties pour les droits des minorités notamment via le maintien et le respect de certains principes juridiques comme le respect du droit de propriété, afin de prévenir toute redistribution abusive de terres, la garantie des intérêts culturels, économiques et sociaux. Il s'agit pour les Blancs de transférer le pouvoir politique à la majorité noire, mais de conserver le pouvoir économique pour plusieurs années encore et éviter le sort des ex-colonies d'Afrique. Lors des négociations de Kempton Park, des garanties sont également confirmées concernant la rédaction de la future constitution par la future assemblée constituante. Toutes les négociations entreprises depuis 1990 se déroulent dans le cadre d'un « séminaire géant permanent », sans aucune aide ou interférence extérieure à l'inverse du cas de la Rhodésie du Sud (accords de Lancaster House) ou pour des pays plus éloignés comme la Bosnie-Herzégovine ou le conflit israélo-palestinien.
Parallèlement, les sanctions internationales, imposées bilatéralement ou par l'ONU, sont progressivement levées.
En août 1992, l'Afrique du Sud, exclue depuis 1964, est réintégrée aux Jeux olympiques de Barcelone sous les couleurs olympiques, l'ANC refusant que des sportifs noirs soient représentés sous celles de l'apartheid. Pour la première fois depuis dix ans, une équipe de rugby étrangère vient dans le pays durant l'été 1992 avec l'approbation de l'ANC, mais avec des conditions imposées aux officiels sud-africains. Cela n'empêche pas des débordements. Ainsi, lors du premier test-match contre la Nouvelle-Zélande à l'Ellis Park de Johannesbourg, en faisant jouer l'hymne national Die Stem au mépris des accords passés, devant des spectateurs arborant massivement les couleurs nationales bleues, blanches et orange, l'ANC menace d'en appeler à nouveau aux sanctions internationales.
En mars 1993, alors que les négociations continuent, un des dirigeants les plus populaires du parti communiste, Chris Hani, est assassiné. L'enquête trouve rapidement les instigateurs de l'attentat parmi les milieux d'extrême-droite. Le commanditaire de l'assassinat est Clive Derby-Lewis, un des chefs anglophones du CP. L'arrestation de ce dernier devient le symbole de la fin de l’impunité pour les tenants de la ségrégation. L'autorité morale de Mandela est particulièrement manifeste à cette occasion, après qu'il a réussi, par une allocution télévisée solennelle, à circonvenir les émeutes qui avaient suivi l'assassinat de Chris Hani et causé la mort de soixante-dix personnes.
En avril 1993, un nouveau coup dur frappe le CP : Andries Treurnicht meurt à la suite de problèmes cardio-vasculaire. Un nouveau chef, Ferdinand Hartzenberg, lui succède mais ne peut empêcher le déclin du parti.
Le 18 novembre 1993, l'ANC et le NP approuvent une nouvelle constitution intérimaire, multiraciale et démocratique, des élections pour tous les adultes en avril 1994 et le statut de langue officielle pour neuf langues locales soit un total de onze. Une grande partie de cette constitution intérimaire est d'ailleurs consacrée à rassurer la minorité blanche quant à une politique revancharde ; cela se traduit notamment par un compromis sur la formation d'un gouvernement ouvert aux partis minoritaires.
Du côté des radicaux de droite, un front du refus se constitue, regroupant le CP et divers mouvements afrikaners avec les partis et dirigeants conservateurs noirs. Ce regroupement au sein d'une « Alliance pour la liberté » marque l'arrivée sur la scène politique du général Constand Viljoen, un Afrikaner très respecté jusque dans les rangs de l'ANC. Il regroupe derrière lui la totalité des partis nationalistes, conservateurs ou d'extrême-droite.
Mais l'Alliance pour la liberté se brise rapidement, le seul point commun entre ses membres étant le refus des élections. Très vite, certains dirigeants noirs quittent l'alliance, contraints de rejoindre le processus électoral. C'est le cas des chefs du Ciskei ou du Bophuthatswana, après l’échec par ce dernier d’une tentative de sécession.
L'un des projets de Volkstaat proposé par le front de la liberté.
Quand Viljoen obtient la garantie de l'ANC que le prochain gouvernement nommerait une commission pour étudier la faisabilité du projet d'un Volkstaat (État Afrikaner) en Afrique du Sud, en contrepartie de la renonciation à la violence et de la participation des mouvements afrikaners aux élections, il est désavoué par ses partenaires du CP, du HNP et de l'AWB.
L’idée du Volkstaat était pourtant au cœur des revendications des Afrikaners conservateurs. Le CP avait été créé sur ce programme. Comme une sorte de bantoustan à l’envers, ce Volkstaat regrouperait sur un territoire assez vaste l'ensemble des Afrikaners, avec Pretoria pour capitale. Mais ils étaient divisés sur les limites géographiques de ce territoire indépendant ; les plus radicaux voulaient le constituer sur les frontières des anciennes républiques Boers alors que les plus modérés le voulaient dans le nord-ouest de la province du Cap, faiblement peuplée et dont la population avait l'afrikaans pour langue maternelle. Un embryon de Volkstaat s'était constitué à Orania, bourgade à la lisière entre l'État Libre d'Orange et la province du Cap, habitée uniquement par des Afrikaners.
À la suite du désaveu de Viljoen par le CP, le général afrikaner crée un nouveau parti, le Front de la liberté (Freedom Front, FF) pour représenter les Afrikaners aux élections de 1994.
Quant au CP, il livre ses dernières batailles parlementaires puis, symboliquement, en pleine session parlementaire, entonne pour oraison funèbre de la domination blanche, l'hymne national Die Stem van Suid-Afrika après que le gouvernement a fait adopter les dernières lois mettant sur pied un régime multiracial de transition, chargé d'élaborer dans les cinq ans une nouvelle constitution.
En avril 1994, après une campagne électorale sous tension, où les attentats de gauche et de droite se succèdent, le pays procède à ses premières élections multiraciales.
Deux jours avant le vote, un attentat attribué à l'extrême-droite a lieu à Johannesbourg, devant le quartier général de l'ANC. Des attentats meurtriers suivent à Germiston et à l'aéroport Jan-Smuts de Johannesbourg. Considérés comme un baroud d'honneur de l'extrême-droite, ils ne remettent pas en cause les élections.
an 1992-1995 : Angola - Les premières élections générales démocratiques et pluripartites ont eu lieu en Angola les 29 et 30 septembre 1992. Avec un taux de participation supérieur à 90%, le MPLA remporte 53 % des suffrages contre 34 % à l’UNITA. Aux élections présidentielles organisées en même temps, José Eduardo dos Santos reçoit 49,57% des voix contre 40,6% à Jonas Savimbi, le leader historique de l’UNITA16. Celui-ci dénonce des fraudes, refuse de participer au second tour et reprend les armes, cette fois sans plus aucun soutien international. Un second accord de paix est finalement signé à Lusaka le 20 novembre 1994 prévoyant l’intégration des forces de l’UNITA dans l’armée régulière. En 1995, l’accord est rompu.
an 1992 : Burundi - Après les massacres de 1988 (20 000 morts), pour éviter d'autres bains de sang, le président Pierre Buyoya, décide de lancer le pays dans une transition politique. Une constitution est rédigée par une commission chargée d'instaurer une démocratie multipartite au Burundi. Elle est validée par la population en 1992, malgré de nombreuses hésitations de Pierre Buyoya.
an 1992 : Canaries (Îles des) - Les Canaries et l'Union européenne
Lorsque l'Espagne rejoint l'Union européenne en 1986, les Canaries s'y refusent, par crainte de conséquences économiques négatives. Elles finissent par accepter de devenir membres à part entière en 1991, et rejoignent l'UE en 1992.
Depuis lors, le droit communautaire européen est en vigueur sur les îles, avec des réglementations spéciales dans certaines zones qui tiennent compte de la grande distance par rapport au reste du territoire de l'UE et visent à compenser les inconvénients de la situation insulaire.
L'archipel fait également partie de l'espace douanier européen, bénéficiant de conditions particulières dans certaines zones et bénéficiant de nombreux programmes d'aides et de subventions, en tant que région ultrapériphérique de l'UE. Le 1er janvier 2002, l'euro remplace la peseta comme monnaie.
an 1992-1997 : Congo Brazzaville - En mars 1992, la nouvelle Constitution est massivement adoptée par référendum. Elle entérine l'instauration d'une démocratie multipartite dans le pays et instaure un régime semi-parlementaire concentré autour de trois organes politiques : le président de la République, le Premier ministre et le Parlement bicaméral. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, rééligible une fois. À l'élection présidentielle d'août 1992, Sassou-Nguesso obtient 16,87 % des voix, en troisième position derrière Pascal Lissouba, ancien Premier ministre d'Alphonse Massamba-Débat et Bernard Kolélas. En position d'arbitre pour le second tour, Sassou-Nguesso s'accorde avec Lissouba pour le deuxième tour de la présidentielle et leurs partis respectifs signent un accord de gouvernement. Le 31 août 1992 Sassou-Nguesso effectue la passation de pouvoir avec Pascal Lissouba, et se retire. La situation politique reste toutefois tendue durant la présidence de Pascal Lissouba.
Une nouvelle constitution est approuvée par référendum le 15 mars 1992, avec 96,3 % de oui. La république populaire du Congo redevient « république du Congo », la question de distinction avec le Zaïre voisin n’étant plus pertinente non plus. La désignation informelle du pays « Congo-Brazzaville » est cependant réapparue en 1997 lorsque le Zaïre voisin a repris aussi officiellement son ancien nom de « république démocratique du Congo » à la fin du régime de Mobutu, causant des disputes diplomatiques entre les deux pays au sujet de l’appropriation du nom (pourtant légitime historiquement et géographiquement) repris par l’ex-Zaïre (qui a voulu même aussi reprendre le nom Congo sans qualificatif, une requête maintenant abandonnée).
Dans la foulée de l'adoption de la nouvelle constitution se tiennent les différentes scrutins : municipal et régional en mai 1992, législatif en juin-juillet. Lors des législatives, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) de Pascal Lissouba arrive en tête devant le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) de Bernard Kolélas et le PCT. Lors de l'élection présidentielle, en août, Pascal Lissouba et Bernard Kolélas passent le premier tour avec respectivement 35,9 et 20,3 % des voix. Denis Sassou-Nguesso arrive en troisième position avec 16,9 % des voix ; au deuxième tour, il apporte son soutien à Pascal Lissouba, qui est élu avec 61,3 % des suffrages contre 38,7 % à Bernard Kolélas.
Les années Lissouba :
Lors des pourparlers en vue de la constitution du gouvernement, Lissouba propose à son allié Sassou trois ministères contre sept qu'exigeait le PCT, dont l'Agriculture et les Sports. Contre l'avis de son parti, Sassou accepte et transmet à Lissouba la liste de ses trois poulains, Grégoire Lefouoba, Isidore Mvouba et François Ibovi.
Malgré cette interdiction, Grégoire Lefouoba fait défection et accepte le poste de ministre de l'agriculture. Maurice-Stéphane Bongho Nouarra (UPADS) est Premier ministre. Sassou change alors de camp et s'allie à Bernard Kolélas, l'infortuné du 2e tour de l'élection présidentielle. C'est le début d'un bras de fer entre d'un côté le président Lissouba et de l'autre la nouvelle alliance de l'opposition sous le label URD-PCT et apparentés. Cette nouvelle coalition majoritaire à l'Assemblée vote une motion de censure contre le gouvernement en place qui tombe. Lissouba doit dissoudre l'Assemblée. Des manifestations ont lieu : trois personnes succombent à des tirs de police (fusillade dite « du Centre culturel français »). Les 2 et 3 décembre, l'Armée sous la direction de son chef d'État major, le général Jean-Marie Michel Mokoko tente un coup de force avec la formule de gouvernement 60/40 basée sur la signature d'un protocole d'accord par tous les partis. Le 24 décembre, Claude-Antoine Da-Costa (UPADS) est nommé Premier ministre et forme un nouveau gouvernement majoritaire de l'opposition.
L'opposition URD-PCT conteste le résultat du premier tour des élections législatives de mai-juin 1993 et perturbe le deuxième tour, qui ne peut se tenir dans toutes les circonscriptions. C'est le début d'affrontements armés. Sassou fournit une aide logistique conséquente à Kolelas qui crée une milice de Ninjas (ces miliciens pour la plupart sont issus du Pool, un département du sud ; on parlera de « Ninjas de Kolélas »). Sassou de son côté continue à s'aider de la milice des Cobras du PCT. Lissouba, qui constate que l'armée refuse d'affronter les Ninjas, crée la milice des Cocoyes. Jacques Yhombi-Opango est nommé Premier ministre en juin.
En juillet 1993, les Cocoyes et les Ninjas s'affrontent dans les quartiers sud de Brazzaville (Bacongo, quartier d'origine de plusieurs habitants du Pool). C'est le premier affrontement civil. En 1994, dans un souci d'apaisement, Kolélas intègre le gouvernement, comme « opposition constructive ». En mai-juin 1994, une loi dite de décentralisation est votée, consacrant ainsi l'autonomie de gestion reconnue dans la constitution de mars 1992.
Sassou est hostile au compromis d'« opposition constructive » et met à profit cette période pour préparer un coup d'État : de 1995 à 1997, il voyage beaucoup entre sa région d'origine (Oyo, dans la région de la Cuvette), le Gabon et la France. Il rencontre dans le nord de nombreux réfugiés, civils et militaires, d'origine rwandaise (dont les miliciens« Hutu Power »). Ceux-ci, arrivés avec le HCR, ont même créé leurs propres villages dans divers endroits. Sassou en intègre certains au sein de sa milice Cobra, en tant qu'instructeurs. Des réfugiés civils rwandais sont formés aux combats. En parallèle, Sassou continue à recevoir des armes depuis plusieurs pays voisins (Gabon, Angola).
En 1997, Sassou veut entrer dans une ville du nord, Owando, sur une chaise à porteurs traditionnelle réservée aux dignitaires locaux. Les villageois s'y opposent. Les Cobras, présents, ouvrent le feu et font plusieurs morts.
Le 5 juin 1997, des militaires gouvernementaux entourent la résidence de Sassou à Brazzaville, sur mandat d'amener du procureur d'Owando contre deux officiers impliqués dans les violences des semaines précédentes. Sassou déploie alors un impressionnant armement (chars légers, canons) et ses troupes combattent l'armée congolaise.
Le 15 octobre 1997, la guerre civile du Congo voit la victoire de Denis Sassou-Nguesso, aidé par des troupes angolaises. Il abroge la constitution de 1992.
an 1992 : Congo Kimshasa (Zaïre) - Le premier ministre Nguz Karl-i-Bond suspend les travaux de la Conférence Nationale devenue trop insolente aux yeux de Mobutu (janvier). Le 16 février, une marche des chrétiens pour obtenir la réouverture de la Conférence Nationale ainsi que sa souveraineté est réprimée dans le sang par les militaires sous le gouvernement du premier ministre Nguz Karl-i-Bond et son ministre de la défense Honore Ngdanda (19 morts et plusieurs blessés). Cet incident grave conduit le 6 avril à la réouverture de la Conférence nationale, qui se déclare Souveraine (CNS) et installe à sa tête Monseigneur Laurent Monsengwo pour diriger les travaux. Le 15 août Étienne Tshisekedi est élu premier ministre par la CNS. Cette dernière clôturera ses travaux en décembre 1992 après avoir jeté les bases de la démocratisation. Mobutu travaille à saper ses résultats, notamment par l'introduction anarchique de nouvelles coupures de zaïre, monnaie aussitôt démonétisée par le Premier Ministre.
an 1992 : Ghana - Sous la pression internationale et interne pour un retour à la démocratie, le Conseil provisoire ou PNDC permet la mise en place d'une Assemblée Consultative composée de 258 membres représentant les districts géographiques, ainsi que des citoyens et des entreprises. L'assemblée est chargée d'élaborer un projet de constitution pour fonder une quatrième république. Le PNDC accepte le résultat des débats sans révision, et ce résultat est soumis à un référendum national le 28 avril 1992, dans laquelle il reçoit 92 % d'approbation. Le 18 Mai 1992, l'interdiction des partis politiques est levée dans le cadre de la préparation d'élections multipartites.
Le PNDC et ses partisans forment un nouveau parti, le Congrès National Démocratique (NDC). Les élections présidentielles ont lieu le 3 novembre 1992 et les élections législatives le 29 décembre de la même année. Les membres de l'opposition boycottent les élections législatives, cependant, ce qui a entraîné un Parlement de 200 sièges avec seulement 17 membres de partis d'opposition et deux indépendants.
an 1992 : Kenya - Le 29 décembre 1992 voit s'accomplir les premières vraies élections multipartites depuis l'indépendance. Sept partis sur les neuf présents sur les listes électorales proposent un candidat à l'élection présidentielle. Le président sortant, Moi, est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec 36,4 % des votes valables tandis que six des partis d'opposition obtiennent 46,8 % des sièges à l'Assemblée nationale ce qui oblige Moi à octroyer des postes ministériels à l'opposition. Des suspicions de bourrage d'urnes entrainent des violences dans la province de la vallée du Rift. Human Rights Watch accuse plusieurs politiciens, dont le président Moi, d'avoir incité et coordonné ces violences.
an 1992 : Libéria - Le NPLF tente un nouvel assaut sur Monrovia en 1992, qui se solde par un échec. La situation s'enlise. Des chefs de guerre créent de nouvelles factions dissidentes. Les tentatives de résolution du conflit par la CEDEAO restent vaines.
an 1992 : Mali - Les maliens approuvent par référendum le 12 janvier 1992 la nouvelle constitution. Le oui l’emporte avec 98,35 % des suffrages. Des élections municipales sont organisées la semaine suivante le 23 février et le 8 mars puis des élections législatives le 23 février et le 8 mars. Sur les 48 partis déjà créés, 22 participent aux élections et 10 obtiennent des élus. L’Adéma-Pasj, avec 76 députés sur 116, obtient une large majorité absolue. Le nouveau gouvernement signe un pacte national de réconciliation avec les Touaregs le 11 avril 1992 qui prévoit notamment : l’intégration des ex-rebelles dans les services publics (corps en uniforme et administration générale) et dans les activités socio économiques; l’allégement du dispositif militaire dans les régions du Nord; le retour de l’administration et des services techniques dans le Nord; la reprise des activités économiques et la mise en œuvre de programmes de développement socio-économique d’envergure pour le moyen et le long terme. L’élection présidentielle du 12 et 26 avril 1992 clôt le processus électoral de l’année 1992. Le candidat de l’Adéma-Pasj Alpha Oumar Konaré l’emporte au second tour face à Tiéoulé Mamadou Konaté, candidat de US-RDA et devient le premier président de la 3e république.
an 1992-1993 : Iles Maurice - En 1992, le parlement abolit la monarchie avec une grande majorité des voix. Maurice devient une république le 12 mars 1992 dotée d’un régime présidentiel, mais reste membre du Commonwealth. À partir de 1995, la nouvelle coalition au pouvoir (Parti travailliste et MMM) mène une politique de libéralisation de l’économie dont les mesures phares sont la libéralisation du transport aérien, le droit pour chacun de posséder un passeport et la fin du contrôle des devises.
le Premier ministre Anerood Jugnauth du Mouvement socialiste militant (MSM) reste premier ministre jusqu'en 1995. De 1982 à 1995, l'île Maurice vit une profonde évolution économique. Notamment de 1984 à 1988, le taux de croissance caracole autour de 7 %. Ce sont des années de boom économique avec la création d'une industrie locale.
Le pays doté d'un système parlementaire de type britannique. Depuis son indépendance, Maurice est un pays souverain qui fait partie du Commonwealth et, depuis le Ve Sommet d'octobre 1993, la république de Maurice fait également partie de la Francophonie. En plus du Parti travailliste sont fondés le comité d'action musulman, représentant la population musulmane, et le Parti mauricien social démocrate (PMSD), représentant essentiellement les franco-mauriciens et les « créoles », c'est-à-dire les descendants des esclaves africains.
an 1992-2006 : Ouganda - Bien que les bénéfices aient été inégalement répartis, le pourcentage de la population vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 56 % en 1992 à 31 % en 2006.
Dans le nord du pays, la venue au pouvoir de membres des ethnies du sud du pays encouragea le développement de rébellions dont la plus tenace est l'Armée de Résistance du Seigneur (Lord's Resistance Army - LRA), notoire pour ses actions contre les populations civiles et notamment pour ses enlèvements d'enfants utilisés comme soldats ou esclaves sexuels, et dont les agissements se sont poursuivis jusque dans le milieu des années 2000 (en Ouganda, toujours active aujourd'hui dans le nord du Congo).
Du fait de l'insécurité prévalant et de l'incapacité (ou du manque de volonté) de l'armée ougandaise à ramener la paix, le nord du pays reste en marge du développement économique observable dans le reste du pays.
an 1992 : Rwanda - Des manifestations publiques sont menées par les nouveaux partis de l'opposition. Cinquante mille personnes manifestent dans les rues de Kigali en janvier 1992 pour protester contre la formation du nouveau gouvernement, dont les membres sont quasiment tous issus du parti présidentiel. Des manifestations ont aussi lieu dans d'autres villes et dans le sud du pays. Elles demandent un gouvernement de transition pour redistribuer le pouvoir dans le pays. Les fonctions de chef de l'État et de chef de gouvernement sont séparées, un poste de Premier ministre est créé, attribué à un membre du MDR, des opposants sont libérés de prison, les fonctionnaires reçoivent le droit de grève, la séparation entre le MRND, parti présidentiel, et l'État s'étend petit à petit. Le gouvernement de transition sera mis en place le 16 avril 1992.
Les durs du régime créent en mars 1992 la Coalition pour la défense de la République (CDR), hostile aux Tutsis et à toute négociation avec le FPR et en même temps une milice nommée « Impuzamugambi » (ceux qui poursuivent le même but). Les milices Interahamwe27, sont aussi créées pendant cette période par le MRND, le parti du président, ainsi que les milices Inkuba pour le MDR, et Abakombozi pour le PSD. Ces milices sont initialement des mouvements de jeunesse animant les meetings politiques, mais elles sont utilisées également pour troubler les meetings des partis adversaires, et la violence prend de l'ampleur. Les attentats se multiplient, sans que leurs auteurs véritables soient vraiment poursuivis, le pouvoir se bornant d'accuser des infiltrés du FPR. En 1992 et 1993, environ 200 personnes trouvent la mort dans les attaques menées par les Interahamwe et d'autres groupements. Les armes se répandent dans la population.
En mars 1992, à la suite de fausses informations diffusées par la seule radio nationale, Radio Rwanda, des massacres de Tutsi sont commis dans le Bugesera au sud-est du Rwanda. Ceux-ci sont organisés par les bourgmestres dans le cadre de l'umuganda (travail traditionnel collectif), avec l'appui des Forces armées rwandaises et des milices Interahamwe, et occasionnent 300 morts. Une résidente italienne, Antonia Locatelli, qui dénonce l'organisation des massacres à Radio France International est également assassinée.
Le gouvernement de transition se met en place en avril 1992. Un changement d'orientation de Radio Rwanda est alors mis en œuvre. Le titre de Chef d’état-major de l’armée est rendu incompatible avec les fonctions présidentielles. La ministre de l'Éducation nationale, Agathe Uwilingiyimana, une enseignante du sud du Rwanda et membre du MDR, supprime les quotas qui réservait l'accès de l'enseignement secondaire aux Hutus, essentiellement ici de la région d'origine du Président, le remplace par un système au mérite et impose un contrôle policier de la bonne tenue des examens. Peu après, elle est agressée à son domicile par des hommes armés. Des milliers d'étudiants et de Rwandaises bravent les menaces armées des Interahamwe dans la rue, se regroupant dans une manifestation par solidarité avec Agathe Uwilingiyimana à la fin de l'été 1992.
Les partis d'opposition remportent les élections. Le président Habyarimana perd progressivement une grande partie de ses pouvoirs (dans une situation assez comparable avec celle de la cohabitation en France), en même temps qu'il doit faire face au durcissement de ses partisans les plus extrémistes.
En avril 1992, le MDR, le PL et le PSD contraignent le Président Habyarimana à négocier avec le FPR, mais Habyarimana lance une offensive pour être en position de force. Cette offensive est un échec et les Forces armées rwandaises doivent se replier, entraînant avec elles 350 000 civils. En juillet et août 1992, un accord de cessez-le-feu est signé à Arusha. C'est le premier pas vers les futurs Accords d'Arusha. Un premier protocole est signé le 18 août stipulant que les deux parties acceptent les principes fondamentaux de la démocratie, dont l’égalité devant la loi, le multipartisme, le Gouvernement électif, la garantie des droits fondamentaux de la personne, la fin de l’ethnisme. Le droit au retour des réfugiés est reconnu. En octobre 1992 est signé un deuxième accord prévoyant la constitution d'un gouvernement à base élargie, la répartition des portefeuilles ministériels étant définies par l'accord du 9 janvier 1993. Cependant une opposition à ces accords, de plus en plus violente et organisée se manifeste parmi les idéologues hutus, les fonctionnaires et les militaires au service du régime et les dignitaires de celui-ci.
an 1992-1998 : Somalie - En avril 1992, l'ONU envoie la première mission humanitaire afin d'endiguer la famine, ONUSOM. Celle-ci est un échec. Le 3 décembre 1992, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta à l’unanimité la résolution 794, qui approuvait la mise en place d’une force de maintien de paix sous l’égide de l’ONU, l’UNITAF. Organisée par Washington, l'opération prend le nom de « Restore Hope ». Les troupes atterrirent en 1993 et restèrent en poste durant deux ans.
De nombreux Somalis sont hostiles à une présence étrangère. En octobre 1993, après l'arrestation par les forces spéciales américaines de proches de Mohamed Farrah Aidid, le leader du Congrès de la Somalie unifiée, plusieurs échauffourées éclatent à Mogadiscio, ce qui cause la mort de 24 soldats pakistanais et de 19 soldats américains. L'Opération Restore Hope tourne au fiasco, et affecte durablement la politique étrangère des États-Unis. Le président Bill Clinton retire les troupes, l'ONU prenant le relais jusqu'au 3 mars 1995, perdant 151 Casques bleus et trois civils étrangers.
Au nord-est, le Puntland se déclare à son tour autonome en 1998, affirmant qu’il participerait à tout effort de réconciliation visant à reformer un pouvoir central. Le Jubaland fait à son tour sécession la même année. Il est actuellement englobé dans la Somalie du sud-ouest, sans statut clair.
Après le départ des troupes de l'ONU en 1995, la guerre civile en Somalie a progressivement décliné, avec l'arrêt de la plupart des conflits entre clans et l'apparition d'accords entre les divers groupes armés. Diverses milices se sont reconverties en agences de sécurité privées occupant des territoires délimités parfois à quelques quartiers de villes. La paix n’a pas été rétablie, mais la légère amélioration de la sécurité a permis à l’économie de redémarrer. Depuis la fin des années 1990, la Somalie constitue un assemblage de territoires sous domination clanique, où tous les services sont fournis par le secteur privé ou par les clans traditionnels. Les institutions gouvernementales sont ainsi remplacées par des institutions privées.
Le pays reste cependant divisé entre plusieurs factions. Le centre et le sud est contrôlé par Hussein Mohamed Aïdid; le nord-ouest par Mohamed Ibrahim Egal, élu de la République auto-proclamée du Somaliland en 1997 et mort en 2002. En janvier 1997, un accord de gouvernement, patronné par l'Éthiopie et le Kenya, échoue à régler le problème du désarmement et de la reconstruction de l'État . Le nord-est se déclare autonome en 1998 sous le nom de Puntland.
an 1992 - 1998 : Tanzanie (voir aussi Zanzibar) - Ali Hassan Mwinyi accélère l’ouverture et la libéralisation progressive du pays. En 1992, il autorise le multipartisme. En 1995, les premières élections multipartistes ont lieu, même si entachées de sérieux doutes sur leur régularité. Elles voient la victoire de Benjamin William Mkapa, un des disciples de Nyerere, qui est réélu en 2000. Mkapa doit faire face à de nombreuses difficultés qui grèvent le décollage tant espéré du pays : crise économique, épidémie de sida, afflux de réfugiés qui fuient les guerres du Burundi. À Zanzibar, des velléités indépendantistes émergent parfois, mais jusqu’à présent, l’Union tanzanienne est préservée. En 1998, des attentats visent les ambassades américaines de Dar es-Salaam et de Nairobi au Kenya : on compte plus de 250 victimes et 5 000 blessés.
an 1993 : Afrique du Sud - Ce processus de négociations débouche sur un projet intérimaire de constitution en 1993 qui réorganise l'État sud-africain autour des valeurs-clés de liberté, égalité, dignité et place en son sommet une Cour constitutionnelle et sur les premières élections au suffrage universel sans distinctions raciales ou censitaires de l'histoire du pays le 27 avril 1994. Ces élections sont remportées par le congrès national africain ce qui permet à Nelson Mandela d'être élu par la nouvelle assemblée constituante en tant que premier président noir du pays. Par la même occasion, le pays réintègre le Commonwealth.
an 1993 : Burundi - En 1992, l'UPRONA perd son statut de parti unique et des élections présidentielles et législatives sont organisées respectivement le 1er juin et le 30 juin 1993. Elles sont toutes les deux remportées par le Front pour la démocratie du Burundi (FRODEBU).
Le candidat du FRODEBU, le Hutu Melchior Ndadaye remporte la présidentielle. Le 26, les législatives confirment cette tendance : le FRODEBU devient majoritaire à l'assemblée. Le 10 juillet, Pierre Buyoya passe le témoin au nouveau président Melchior Ndadaye. La Tutsie Sylvie Kinigi est nommée première ministre, afin de bâtir une réconciliation entre les deux composantes hutue et tutsie.
Les Tutsis, qui avaient la mainmise sur l'appareil d'État depuis longtemps (au moins depuis l'indépendance) alors qu'ils ne représentent que 15 % de la population, prennent peur du pouvoir que gagnent, de manière légale, les Hutus, d'autant plus qu'après avoir été considérés comme des êtres inférieurs, certains Hutus veulent une revanche. De plus certains Tutsis considèrent le pouvoir comme un de leurs attributs et refusent que de simples Hutus puissent gouverner.
Le 21 octobre 1993, des militaires exécutent le président Melchior Ndadaye et six de ses ministres, dont le président de l'assemblée nationale, Pontien Karibwami, le vice-président de l'assemblée Gilles Bimazubute, le ministre de l'Intérieur Juvénal Ndayikeza et le directeur de la documentation nationale Richard Ndikumwami.
L'intérim à la tête du pays est assurée par Sylvie Kinigi, premier ministre du président assassiné Ndadaye, du 27 octobre 1993 au 5 février 1994.
Au début, des milliers de civils tutsis sont massacrés par leurs voisins hutus. Puis l'armée réagit très violemment, comme en 1972, et engage une répression très dure et massacre des Hutus. 50 000 à 100 000 personnes (à majorité Tutsies) sont tuées, certaines sources parlant de
200 000 à 300 000 victimes. Une Commission internationale d'enquête envoyée par l’ONU au Burundi conclut dans son Rapport S/1996/682 qu'il y a eu des actes de génocide contre les Tutsis. Plusieurs organisations et partis politiques souhaitent que ce génocide soit qualifié officiellement comme dans le rapport et qu'un tribunal pénal international soit mis sur pied pour juger les auteurs.
an 1993 : République de Centrafrique - En 1993, des mutins finissent par contraindre Kolingba à organiser des élections, organisées la même année.
1993, année où, suivant le courant de démocratisation lancé par le sommet de La Baule, les premières élections multipartites ont lieu et Ange-Félix Patassé est élu président de la République.
an 1993 : Zaïre Congo Kimshasa - le parlement mis en place par la CNS annonce une procédure de destitution du président Mobutu pour haute trahison (15 janvier). Pillages à Kinshasa, lancés par les militaires (24-29 janvier). Plus de 1 000 morts sont déplorés. Évacuation de 1 300 Occidentaux.
des heurts interethniques au nord Kivu entre rwandophones (Hutus et Tutsis) et non rwandophones (les autres ethnies locales de Nord-Kivu) font
4 000 morts. Création de la monnaie Nouveau zaïre, qui vaut 3 millions des zaïres anciens.
an 1993-2009 : Gabon - Après cette conférence nationale, dans le cadre d'élections où il n'est plus seul candidat, Omar Bongo est de nouveau élu en 1993, 1998 et 2005, quoique dans des conditions souvent contestées.
En février 1994, la dévaluation du franc CFA provoque des troubles sociaux à Libreville et Port Gentil, ainsi que le lancement d'une grève générale. Le président Jacques Chirac se rend à Libreville en 1996, en pleine affaire Elf. Au centre de l'affaire, la Fiba (French International Bank of Africa), qui appartenait à Elf, à la famille Bongo et à la République du Congo, et avait été créée en 1965 avec René Plas, gouverneur de la Banque européenne d'investissement et membre de la Grande Loge de France, avec deux autres banques (la Banque du Gabon et du Luxembourg (BGL) à Libreville et la Société internationale de banque. La Fiba est dirigée par Pierre Houdray et Jack Sigolet, qui travaillent tous deux chez Elf.
La Constitution est révisée le 18 avril 1997. Elle instaure un poste de vice-président et l'extension du mandat du président de 5 à 7 ans. Celle-ci sera suivie en 2003 d'une autre révision instaurant le scrutin à un seul tour et autorisant le chef de l'Etat à briguer plus de deux mandats.
En 2002, le pouvoir parvient à rallier une partie de l'opposition et entame avec cette dernière une forme de collaboration. Quatre opposants, dont Paul Mba Abessole, le principal adversaire d'Omar Bongo à l'élection présidentielle de 1993, entrent au gouvernement. Son parti, le Rassemblement pour le Gabon (RPG), rejoint le camp présidentiel en 2004. Parallèlement, en avril 2005, un ancien fidèle du président Bongo, Zacharie Myboto, crée un parti d'opposition, l'Union gabonaise pour la démocratie et le développement (UGDD).
Omar Bongo est réélu à l'élection présidentielle de 2005 à une majorité écrasante (79,18 %), même si ses deux principaux rivaux de l'opposition contestent la régularité du scrutin. Les élections législatives de 2006 sont également une écrasante victoire pour le camp présidentiel. En 2007 commencent les premières procédures sur les bien mal acquis. Omar Bongo décède le 7 juin 2009.
an 1993 : Ghana - La Constitution entre en vigueur le 7 janvier 1993. C'est le début de la Quatrième République. En 1996, l'opposition participe à la présidentielle et aux élections législatives, qui sont décrites comme pacifiques, libres et transparentes par les observateurs nationaux et internationaux. Rawlings est réélu avec 57 % des suffrages. En outre, son parti, le NDC, obtient 133 des 200 sièges du Parlement, soit seulement un siège de plus que la majorité des deux tiers nécessaire pour continuer à adapter la Constitution.
an 1993-1995 : Leshoto - En avril 1993, les premières élections pluralistes depuis l'indépendance furent organisées14 et se soldèrent par la victoire de Ntsu Mokhehle et de son parti, le parti du Congrès du Basutoland.
Cette parenthèse démocratique fut de courte durée. Letsie III suspendit la Constitution et le Parlement, puis limogea le gouvernement. Le pays allait s'enfoncer dans une crise de régime mais grâce à l'intervention du Botswana, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, Letsie III accepta finalement de rétablir le gouvernement, la Constitution et le Parlement, puis d'abdiquer en faveur de son père, Moshoeshoe II qui retrouva son trône le 25 janvier 1995.
an 1993-1997 : Libéria - Après la signature de l'accord de paix de Cotonou (Bénin) en 1993, négocié grâce à la CEDEAO, le Conseil de sécurité a créé la Mission d'observation des Nations unies au Liberia (MONUL), qui avait pour mandat notamment de contrôler le respect de l'accord de paix, et d'en vérifier l'application impartiale par toutes les parties. La MINUL a été la première mission de maintien de la paix que l'Organisation des Nations unies a entreprise en coopération avec une mission de maintien de la paix déjà mise sur pied par une autre organisation.
Toutefois, des retards dans l'application des accords et la reprise des combats entre factions libériennes ont fait qu'il n'y a pas eu d'élections en février-mars 1994, comme prévu. Au cours des mois suivants, plusieurs accords supplémentaires, amendant et précisant certaines dispositions de l'accord de Cotonou ont été négociés. Grâce au cessez-le-feu en vigueur, les Nations unies ont pu observer le déroulement des élections de juillet 1997, avec trois ans de retard sur le calendrier initial. Charles Taylor fait campagne avec un slogan resté célèbre : « Il a tué mon père, il a tué ma mère. Je vais voter pour lui », signifiant ainsi son intention en cas d'échec de remettre le pays à feu et à sang. Le 19 juillet 1997, il est élu président de la république du Liberia avec 75 % des voix.
an 1993-1999 : Malawi - À la suite de nombreuses pressions tant internes qu’internationales, un référendum a lieu le 14 juin 1993, au cours duquel les Malawites se prononcent massivement en faveur de l’introduction d’un régime démocratique multipartite. Des élections nationales, qualifiées de libres par les observateurs internationaux, ont lieu le 17 mai 1994 et voient l’accession à la présidence de Bakili Muluzi, chef du Front démocratique uni (FDU). Son parti remporte également 82 des 177 sièges de l’Assemblée nationale et forme une coalition avec l’Alliance pour la démocratie. La coalition est dissoute en juin 1996 mais certains de ses membres restent au gouvernement. La constitution de 1995 supprime les prérogatives de l’ancien parti unique et introduit le libéralisme économique ainsi des réformes structurelles. Les deuxièmes élections démocratiques ont lieu le 15 juin 1999. Muluzi est réélu pour un nouveau mandat de cinq ans, malgré une coalition entre le PCM et l’Alliance pour la démocratie. Il tente ensuite, sans succès, d'introduire un amendement constitutionnel qui lui permettrait de briguer un troisième mandat.
an 1993 : Mali - En février 1993, Moussa Traoré est condamné à mort (il sera gracié en 2002).
La décentralisation est l’une des œuvres la plus importante de la 3e république. Si elle faisait partie des discours des deux premières républiques, elle n’avait jamais été mise en acte. Le 11 février 1993, une loi définie les collectivités territoriales du Mali qui sont les régions, le district de Bamako, les cercles, les communes urbaines et les communes rurales, chacune étant dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et aucune ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité. Les collectivités s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus qui élisent en leur sein un organe exécutif.
an 1993 : Togo - Eyadema remporte de nouveau l’élection présidentielle boycottée par l’opposition.
an 1993 : Rwanda - Les accords d'Arusha et la nouvelle offensive du FPR - La signature en janvier 1993 d'un protocole dans le cadre des accords d'Arusha prévoit la formation d'un gouvernement à base élargie, mais la répartition des portefeuilles est définie a priori et non à partir d'élections. Le FPR se voit accorder cinq postes ministériels, tous pris sur le quota du MRND, le parti présidentiel. Cette disposition suscite la colère des partisans du MRND qui manifestent violemment pendant tout le mois de janvier 1993. Selon le premier ministre, Dismas Nsengiyaremye, « avec la caution des autorités locales, le MRND organisa des manifestations violentes à travers tout le pays du 20 au 22 janvier 1993 et proclama son intention de paralyser toutes les activités. Les partis d’opposition ne se laissèrent pas intimider et organisèrent des contre-manifestations qui neutralisèrent les activistes du MRND et de ses satellites, dans les préfectures de Byumba, Kibungo, Kigali-ville, Kigali rural, Gitarama, Butare, Gikongoro, Cyangugu et Kibuye (sauf commune Rutsiro). Dans les préfectures de Gisenyi, Ruhengeri, Kigali rural (zones de Bumbogo et de Buliza), Byumba (commune Tumba) et Kibuye (commune Rutsiro), ces manifestations se transformèrent rapidement en émeutes et les prétendants manifestants se mirent à tuer les Tutsis et des membres des partis d’opposition. Il y eut environ 400 morts et 20 000 personnes déplacées ».
À la suite de ces massacres, le FPR suspend les négociations. Il rompt le cesser-le-feu le 8 février 1993 et lance une offensive et provoque le déplacement de personnes, fuyant les tueries. La France annonce un renforcement de l'opération Noroît. Le 20 février 1993, le FPR proclame un cessez-le-feu unilatéral. À la suite de nouvelles négociations, le FPR accepte de reculer sur les positions qu'il occupait avant le 8 février, laissant une zone démilitarisée, à condition que la France se retire du Rwanda. Les partis gouvernementaux hors MRND acceptent mais cette concession est vue comme une trahison à la fois par le MRND mais aussi par certains représentants des autres partis. La sphère politique rwandaise se divise et ces clivages se retrouvent même au sein des partis. Ainsi, le MDR se divise profondément en plusieurs camps: un premier groupe reprenant les partisans d'une coalition avec le FPR contre le parti présidentiel (ligne défendue par Faustin Twagiramungu), un second groupe composé de ceux qui s'opposent à la fois au pouvoir en place et à l'arrivée du FPR par la force (voie proposée par Emmanuel Gapyisi) et un troisième groupe minoritaire de membres qui veulent en temps de guerre s'allier au MRND pour faire face aux attaques du FPR (ligne dite du Hutu Power). Le premier ministre Dismas Nsengiyaremye tombe le 16 juin. Sur proposition de Faustin Twagiramungu, il est remplacé le 17 juillet par Agathe Uwilingiyimana.
Les accords d'Arusha sont signés en août 1993, mais les deux forces principales sont le FPR et le front du refus conduit par le MRND. Les autres partis sont affaiblis par leur division.
L'armée française se retire fin 1993, conformément aux négociations d'Arusha, pour laisser l'ONU déployer au Rwanda une mission de paix, la MINUAR. Selon le lieutenant Ruzibiza, l'unité Charlie Mobile de la branche armée du FPR se livre à un massacre dans la nuit du 29 au 30 novembre 1993, dans la commune de Mutura. Pour faire croire à un massacre d'extrémistes hutus, une partie des victimes sont des tutsis.
Un détachement de six cents soldats du FPR est autorisé par les accords d'Arusha à s'installer au CND (parlement rwandais). À la stupeur de la MINUAR qui craignait le pire lors de ce transfert, ce détachement est applaudi par la foule à son arrivée à Kigali le 28 décembre 1993. Cet accueil chaleureux est sans doute un écho des manifestations de 1992 dans les rues de Kigali.
La mise en œuvre de ces accords est retardée par le président Habyarimana, dont les alliés extrémistes de la CDR n'acceptent pas les termes. La mise en place du gouvernement à base élargie, dont Faustin Twagiramungu est le premier ministre désigné, est repoussé de mois en mois.
an 1993 : Soudan - Le Front national islamique (FNI) est la seule formation politique autorisée. Les États-Unis accusent le Soudan, à partir de 1993, de soutenir des mouvements terroristes islamiques et inscrivent le pays dans la liste des États qui soutiennent le terrorisme, une liste dressée tous les ans par le département d’État.
an 1994-1998 : Afrique du Sud - Les premières élections générales non raciales au suffrage universel d'Afrique du Sud ont lieu du 26 au 28 avril 1994 et concernent 23 millions d'électeurs qui doivent désigner les membres du parlement et des neuf conseils provinciaux (les anciens bantoustans ont été réintégrés). Les principales opérations de vote ont lieu le 27 avril, la première journée ayant été réservée aux personnes malades ou âgées, aux handicapés et aux personnels de la police et de l'armée. Durant ces quelques jours, une série d'attentats fait 21 morts et plus de 150 blessés.
L'ANC remporte 62,5 % des voix contre 20,5 % au NP. Grâce aux populations coloured du Cap, ce dernier remporte la province du Cap occidental avec 59 % des voix.
L'Inkhata Freedom Party obtient 10 % des voix et une représentation provinciale presque uniquement au KwaZulu-Natal, alors que le Front de la liberté parvient à rassembler 2,8 % des électeurs. Le parti démocratique arrive en quatrième position avec 1,8 %..
Le 9 mai 1994, les quatre cents nouveaux députés élisent Nelson Mandela à la présidence de la République d'Afrique du Sud. Conformément aux accords négociés, il forme un gouvernement d'union nationale, réunissant des représentants des formations politiques ayant obtenu plus de 5 % des voix (ANC, NP et IFP). Thabo Mbeki et Frederik de Klerk sont respectivement nommés premier et second vice-présidents.
Le 10 mai 1994, Nelson Mandela prête serment à Pretoria devant le juge suprême, en présence de dignitaires de 160 pays. Dans le gouvernement d'union nationale qu'il constitue, FW de Klerk et Thabo Mbeki sont vice-présidents tandis que 18 ministres sont issus de l'ANC, 6 issus du Parti national et 3, dont Mangosuthu Buthelezi, issus de l'Inkatha Freedom Party.
La présidence de Nelson Mandela se met en place dans un esprit de réconciliation, dont le premier président noir du pays devient le symbole. Plus qu'un chef de gouvernement, il aspire à se conduire en chef d’État sage, sans amertume pour ses années de prison, artisan d'une paix digne et unificateur de la nation au-delà des clivages raciaux, au point de prendre le thé avec Betsie Verwoerd et autres veuves des anciens dirigeants des gouvernements d'apartheid. Nelson Mandela parvient à recevoir l'affection des Blancs, le point culminant étant son apparition lors de la finale de la Coupe du Monde de Rugby à Johannesbourg, en 1995. Ainsi, après avoir obtenu que l'équipe nationale de rugby conserve son maillot vert et or avec l'emblème de springbok, devenu au fil des années le symbole de l'apartheid dans le sport, Nelson Mandela se montre vêtu de ce célèbre maillot devant une foule de 70 000 spectateurs, essentiellement blancs, qui l'ovationnent.
Le gouvernement Mandela met en place une politique qui poursuit trois objectifs : parvenir à la réconciliation entre les victimes et les auteurs d'exactions politiques, en introduisant une Commission Vérité et Réconciliation, instituer les droits de l'Homme comme fondement de la politique étrangère, mettre en place une politique économique axée sur le marché pour favoriser la croissance et la redistribution.
La première audience de la Commission de la vérité et de la réconciliation, présidée par Mgr Desmond Tutu, archevêque du Cap et prix Nobel de la paix, a lieu le 15 avril 1996. Ses travaux dureront deux ans. La Commission est chargée de solder les années d'apartheid en recensant tous les crimes et délits politiques, commis non seulement pour le compte du gouvernement sud-africain mais aussi pour le compte des différents mouvements anti-apartheid, sur une période s'étalant du 1er mars 1960 (massacre de Sharpeville) au 10 mai 1994. En échange de l'amnistie, les auteurs d'exactions sont invités à confesser leurs méfaits. Des ministres, comme Adriaan Vlok ou Piet Koornhof, expriment des regrets pour certains de leurs actes commis au nom de la défense de l'apartheid tandis que l'ancien président de Klerk affirme, pour sa part, que, selon ses termes, jamais la torture n'a été encouragée ou couverte par les gouvernements successifs. Si le rapport final de la Commission épingle l'absence de remords ou d'explications de certains anciens hauts responsables gouvernementaux, il dénonce également le comportement de certains chefs de l'ANC, notamment dans les camps d’entraînement d'Angola et de Tanzanie.
La difficulté pour l'ANC de mettre en place la politique économique et sociale promise à ses électeurs provient du fait qu'elle n'a pas les moyens budgétaires pour le faire et que le « plan Marshall » qu'elle attendait des Occidentaux, avec des investissements massifs dans l'économie sud-africaine, ne se produit pas. En outre, les entreprises locales tardent aussi à faire les investissements nécessaires pour créer des emplois. Les actions symboliques de Nelson Mandela permettent néanmoins de rassurer les Blancs et d'apaiser les Noirs les plus impatients.
L'objectif du « programme de reconstruction et de développement » (RDP) mise en place par le nouveau gouvernement vise à pallier les conséquences socio-économiques de l'apartheid, comme la pauvreté et le grand manque de services sociaux dans les townhips. Entre 1994 et début 2001, plus d'un million de maisons à bas coût sont construites, permettant d'accueillir 5 millions de Sud-Africains sur les 12,5 millions mal logés. L'accès à l'eau potable dans les bantoustans est amélioré alors que plus de 1,75 million de foyers sont raccordés au réseau électrique. Le RDP est cependant critiqué pour la faible qualité des maisons construites, dont 30 % ne respectent pas les normes, un approvisionnement en eau dépendant beaucoup des rivières et des barrages et dont la gratuité pour les ruraux pauvres est coûteuse. À peine 1 % des terres envisagées par la réforme agraire ont été effectivement distribuées et le système de santé est impuissant à combattre l'épidémie de SIDA qui fait baisser l'espérance de vie moyenne des Africains du Sud de 64,1 à 53,2 ans de 1995 à 1998.
Une politique de discrimination positive (affirmative action) est également mise en place à partir de 1995. Elle vise à promouvoir une meilleure représentation de la majorité noire dans les différents secteurs du pays, administration, services publics et parapublics, sociétés nationalisées et privées… Initiateur de cette politique, Thabo Mbeki voit, dans la formation d'une classe capitaliste noire, la clé d'une société sud-africaine déradicalisée et la pérennité d'une démocratie durable. Le Black Economic Empowerment (BEE) est adopté par l'ANC en décembre 1997 puis en 1998, après avoir contribué à un rapide changement de la composition raciale des agents de l'administration, la pression est mise sur les employeurs du secteur privé pour mettre en œuvre la discrimination positive. Ces programmes contribuent au développement d'une nouvelle classe moyenne noire et urbaine (environ 10 % de la population noire). En contrecoup de cette politique, mais aussi pour des raisons liées à l'insécurité qui ravage le pays, plus de 800 000 blancs, souvent très qualifiés, dont l'écrivain J. M. Coetzee, quittent le pays entre 1995 et 2005 (soit 16,1 % des Sud-Africains blancs).
En 1996, la constitution transitoire est remplacée par une nouvelle constitution, adoptée au parlement par la quasi unanimité des députés de l'ANC et du parti national. En juin 1996, ce dernier quitte le gouvernement peu après son adoption. Accusé d'avoir trop cédé à l'ANC durant la période transitoire, le parti national se divise. L'ancien ministre nationaliste Roelf Meyer quitte le parti et fonde, avec Bantu Holomisa, le Mouvement démocratique uni, le premier nouveau parti multiracial de l'ère postapartheid. Une partie des membres les plus conservateurs du Parti national rejoignent le Parti démocratique dirigé par Tony Leon, nettement plus énergique à leurs yeux dans son opposition à l'ANC, ou bien le Front de la liberté. En 1998, sous la direction de Marthinus van Schalkwyk, le Parti national devient le Nouveau Parti national, qui se veut plus centriste que son prédécesseur.
Au terme de son unique mandat, Nelson Mandela a consolidé la démocratie en reconnaissant les limites constitutionnelles de son pouvoir exécutif et a ainsi amené l'ANC à renforcer son engagement et à se soumettre aux procédures constitutionnelles. Son style personnel, ses gestes de réconciliation et d'empathie envers les Sud-Africains blancs, son rôle dans la transformation des projets économiques et politiques de l'ANC vers le libéralisme économique et la renonciation aux nationalisations, sa volonté d'avaliser les conclusions de la commission vérité et réconciliation, malgré leur rejet par Thabo Mbeki et par l'ANC, sa volonté de mettre les droits de l'Homme au cœur des relations internationales, lui ont donné une aura et une stature nationale et internationale sans précédent, rassurant les investisseurs et mettant à l'écart ses partisans les plus extrêmes. Sa tentative de mobiliser les chefs d’États d'Afrique et du Commonwealth contre la dictature de Sani Abacha au Nigeria est symbolique de cette politique bien qu'il ait aussi défendu des gouvernements répressifs qui avaient aidé autrefois l'ANC dans sa lutte contre l'apartheid. Il n'a pourtant pas su éradiquer, au sein de l'ANC, les prédispositions autoritaires héritées des années en exil, notamment en limitant les procédures électorales internes au sein du mouvement et en faisant de Thabo Mbeki son héritier via des accords secrets entre dirigeants de l'ANC. La dimension la plus autoritaire de sa personnalité apparaît également parfois lors de diatribes contre les journalistes indépendants et les critiques, surtout quand elles proviennent de la communauté noire. Si son traitement de ses partenaires de la coalition révèle son aversion de l'opposition parlementaire libérale, la marginalisation de F.W. de Klerk, son second vice-président au sein du gouvernement d'unité nationale jusqu'en 1996, résulte de son hostilité personnelle envers l'ancien président.
an 1994 : Burundi - L'intérim à la tête du pays est assurée par Sylvie Kinigi, premier ministre du président assassiné Ndadaye, du 27 octobre 1993 au 5 février 1994.
Avec l'assassinat du Président Ndadaye, des milliers de citoyens burundais ont fui vers le Rwanda, l'ex-Zaïre et la Tanzanie. Le 14 janvier 1994, alors que Bujumbura vit au rythme des massacres, Cyprien Ntaryamira du FRODEBU est élu président pour calmer la situation. La première ministre Sylvie Kinigi reste en poste jusqu'à la nomination le 11 février d'un uproniste, Anatole Kanyenkiko, pour diriger un gouvernement d'Union nationale. Le pays est un champ de désolation : 800 000 exilés et 180 000 déplacés à l'intérieur du pays.
Le 6 avril 1994, l'avion qui ramène le président Ntaryamira et son homologue rwandais Juvénal Habyarimana est détruit par un missile à Kigali. L'attentat déclenche le génocide rwandais, qui contribue à déstabiliser encore le Burundi. Sylvestre Ntibantunganya est nommé président intermédiaire le 30 septembre 1994. Le major Buyoya reprend le pouvoir par un coup d'État le 25 juillet 1996.
an 1994 : Congo Kimshasa (Zaïre) - alors que le Front patriotique rwandais gagne la guerre contre l'armée génocidaire au Rwanda, Mobutu Sese Seko accorde à la France le droit d'utiliser le Kivu comme arrière de son opération « turquoise », qui permet la fuite au Zaïre du gouvernement, de l'armée et des milices génocidaires rwandais avec leurs armes, ainsi qu'un million de civils (juin-juillet 1994). Malgré la législation internationale, ceux-ci s'installeront dans des camps très proches de la frontière, d'où, les soldats et miliciens mèneront des attaques meurtrières contre le Rwanda en s'assurant des réfugiés civils comme otages et bouclier humain.
an 1994 : Gambie - En 1994, Yahya Jammeh effectue un coup d’État appuyé par des troupes gambiennes ayant participé à la Force Ouest au Libéria, mécontentes du retard de paiement de leur solde. Pendant deux ans, il est chef de l’AFPCR (Armed Forces Provisionnal Ruling Council) , un gouvernement transitoire de type dictatorial. Le gouvernement rétablit la peine de mort pour empêcher les contestations.
À la suite du coup d’État, la communauté internationale suspend les aides attribuées à la Gambie et la Grande-Bretagne déconseille la Gambie comme destination touristique. Jammeh prévoit alors des élections en 1996 (ce que le Commonwealth continue de condamner) où il est élu. C’est le début de la Seconde République, mais dans un climat de répression : les autres partis de Gambie sont interdits d’activité, les arrestations arbitraires se multiplient… Les nombreuses tentatives pour renverser Jammeh ne font qu’empirer sa politique à l’égard de ses opposants.
an 1994 : Guinée-Bissau - Au premier tour de l’élection présidentielle le 3 juillet 1994, Vieira reçoit 46,20 % des voix face à sept autres candidats. Il sort du deuxième tour le 7 août vainqueur avec 52,02 % des voix contre 47,98 % pour Kumba Ialá, un ancien conférencier de philosophie, dissident du PAIGC dont il a été exclu en 1989 et président du Parti social de renouvellement (PRS). Les observateurs internationaux des élections ont en général considéré le scrutin comme honnête. Vieira est proclamé premier président de la République démocratiquement élu le 29 septembre 1994.
an 1994 : Mozambique - En 1994, les élections donnent le FRELIMO de Joaquim Chissano vainqueur et, malgré des témoignages de fraude, le RENAMO respecte le résultat, se cantonnant à l’opposition politique. Le retour à la paix provoque le retour de 1,7 million d’expatriés, ainsi que le retour de quatre millions de déplacés à l’intérieur du pays. Économiquement, le pays doit alors procéder à de grandes réformes recommandées par les grandes institutions internationales. Certaines semblent contre-productives comme la dérégulation du secteur de la noix de cajou qui fait disparaître 90 % des emplois de cette industrie exportatrice.
an 1994 : Namibie - Le 6 septembre 1994, la première réforme agraire du pays entre en vigueur. Limitée aux terres commerciales, le texte prévoit l'emploi de moyens coercitifs par le biais de l'expropriation et le rachat forcé des terres — au prix du marché cependant. Dans les faits, les terres exploitées par les blancs étant sources de richesses et de devises importantes, la réforme n'est appliquée que timidement (en 2005 à peine 1 % de ces terres ont été reprises par des noirs) car le gouvernement refuse qu'elles soient livrées à une agriculture de subsistance peu productive de type communal. La question du partage de la terre (4 000 fermiers blancs possèdent 44 % des terres agricoles) suscite des tensions, moins graves toutefois qu'au Zimbabwe. La formule consistant pour le gouvernement à racheter les terres pour les redistribuer à la population noire s'avère longue et coûteuse.
an 1994 : Rwanda - Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Kigali. Les membres modérés du gouvernement, dont la première ministre Agathe Uwilingiyimana, ainsi que des opposants, sont assassinés par la garde présidentielle dès le lendemain et un contingent de 10 paras belges de la Minuar sont désarmés par les forces armées rwandaises (FAR) et massacrés dans l'heure qui suit; un gouvernement intérimaire (composé uniquement des ultras pro-génocide des Tutsis) est mis en place dans l'enceinte même de l'Ambassade de France à Kigali, avec Jean Kambanda pour premier ministre. Le génocide, dirigé par ce gouvernement, dure jusqu'au 4 juillet 1994. Il fait 800 000 morts selon l'ONU et plus d'un million selon les autorités rwandaises.
Le 4 juillet 1994, le FPR prend la capitale, Kigali, et constitue le 19 juillet un gouvernement sur la base des accords d'Arusha, première étape de la reconstruction de l'État rwandais. Une période de transition politique est décrétée.
Le président de la République est un Hutu ayant rejoint le FPR, Pasteur Bizimungu. Homme d'affaires, administrateur de banque, il a occupé le poste de président directeur général de l'entreprise publique « Électro-Gaz » jusqu'au moment de sa fuite du Rwanda en 1990. Le Premier ministre est également d'origine Hutu, ainsi que plusieurs autres ministres, dont celui de la justice. Mais « l'homme fort » du Rwanda est le général major Paul Kagame, vice-président et ministre de la défense, cofondateur du FPR, ancien exilé Tutsi en Ouganda.
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda est constitué par l'ONU fin 1994 par la résolution 955 du Conseil de sécurité.
an 1994 : Sao Tomé et Principe - En 1994, le MLSTP, rebaptisé Parti social-démocrate (PSD), remporta les élections législatives
an 1995 : Afrique du Sud - En 1995, une Commission vérité et réconciliation est mise en place, puis l'année suivante, le 10 décembre 1996 est adoptée la nouvelle constitution sud-africaine, principalement fondée sur la constitution provisoire de 1993.
an 1995 : Algérie - Le Groupe islamique armé (GIA) s'attaque à la France avec la vague d'attentats commis en 1995. Les non-musulmans sont désignés persona non grata en Algérie par les groupes islamiques armés, ce qui se traduit par l'assassinat des moines de Tibhirine (1996) et le départ des derniers Juifs d'Algérie.
Le pouvoir va alterner des phases de dialogue avec l'opposition et des périodes plus répressives. Il est frappé par les difficultés sociales à la suite de la crise économique et par l'assassinat de Mohamed Boudiaf en 1992. Le 16 novembre 1995, le général Liamine Zéroual devient le premier président issu d'une élection présidentielle pluraliste. En 1997, la première Assemblée nationale élue sur la base du multipartisme entre en fonction, suivie par un Conseil de la nation ou « chambre haute » la même année.
Dès le mandat du président Zéroual, les prémices d'un règlement politique de la crise se font jour, mais aucun accord n'est trouvé. L'AIS (branche armée du FIS) observe néanmoins une trêve durant sa présidence : le président Zéroual promulgue la loi Erahma (la Clémence) pour les terroristes repentis.
an 1995-1996 : Cap Vert - Les élections législatives de décembre 1995 augmentent la majorité du MPD à l’Assemblée, avec 50 sièges sur 72. Monteiro est reconduit président par les élections de février 1996. Les observateurs nationaux et internationaux ont qualifié les élections de 1995 et 1996 de libres et transparentes.
an 1995-2000 : Afrique Côte d'Ivoire - En octobre 1995, Henri Konan Bédié remporte à une écrasante majorité (96,16 % contre 3,84 % pour le candidat Francis Wodié) contre une opposition fragmentée et désorganisée qui avait appelé à boycotter cette première élection présidentielle organisée après le décès de Félix Houphouët-Boigny. Il resserre son emprise sur la vie politique, obtient assez rapidement une amélioration de la situations économique, avec une diminution de l’inflation et engage des mesures pour réduire la dette extérieure.
Trois mesures consacrent l'orientation tribaliste de la libéralisation politique entre 1993 et 2003 :
-
Le nouveau code foncier , qui oblige les exploitants étrangers (non Ivoiriens) de terres à les restituer à leur décès ou être louées par leurs descendants, et ce en dépit d’un titre foncier rural définitif (1998). Les propriétaires coutumiers du Sud étendent la qualification d'étranger à tous les allogènes (Baoulé, Dioula, Lobi).
-
La fin du droit de vote des étrangers et la mise en place d'une carte de séjour stigmatisante.
-
La Constitution de la Deuxième République, dont le point névralgique est la définition des critères d’éligibilité du président de la République (article 37) qui accentue davantage la rupture communautaire.
Finalement, malgré leurs profondes inimitiés ethniques, tous les groupes du Sud, les Krou et les Akan notamment, s’accordent pour refuser aux migrants ivoiriens d'accéder au pouvoir politique local sur leur territoire (sur lequel se situent Yamoussoukro, Abidjan, San Pedro) et a fortiori briguer la présidence de la République.
Des problèmes de gouvernance sont mis au jour lors de l’exécution de projets financés par l’Union européenne. En outre, différents faits, notamment l’exacerbation des tensions politiques et sociales par la presse, les actes de défiance à l’autorité de l’État posés par des opposants, l’incarcération de plusieurs leaders de l’opposition politique, instaurent un climat délétère qui conduit en décembre 1999 au renversement de Henri Konan Bédié par des soldats mécontents. Ceux-ci placent à la tête de leur groupe le général Robert Guéï qui devient, de ce fait, chef de l’État de Côte d’Ivoire. Henri Konan Bédié s’exile en France.
Soldats de l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) sécurisant un périmètre sensible à Bouaké.
Le régime issu du putsch est marqué durant son éphémère pouvoir par des troubles militaires et civils. Le pouvoir militaire réduit néanmoins la criminalité et la corruption en usant de méthodes parfois expéditives.
an 1995 : Érythrée - En 1995, des affrontements opposent l'Érythrée au Yémen à propos de la possession des îles Hanish, au sud de la mer Rouge. La Cour de justice internationale les attribue ensuite en grande partie au Yémen.
an 1995 : Eswatini (Swaziland) - Le royaume du Swaziland et le changement de nom en Eswatini - En 1995, le pays connaît une période pré-révolutionnaire quand l'Assemblée nationale et les maisons du ministre et du vice-président de l'université du Swaziland sont brûlées lors d'émeutes estudiantines.
an 1995-2000 : Iles Maurice - Navinchandra Ramgoolam (Hindi: नवीनचंद्र रामगुलाम ) dit Navin Ramgoolam (né le 14 juillet 1947 à Port-Louis) est un homme d'État mauricien, Premier ministre de la République de Maurice durant deux périodes (1995-2000 et 2005-2014).
Chef du Parti travailliste, il est le fils du « père de l'indépendance » mauricienne, Sir Seewoosagur Ramgoolam.
Premier ministre de 1995 à 2000.
an 1995 : Mayotte - En 1995, face à la croissance de l'immigration en provenance des autres îles comoriennes, le gouvernement Balladur abolit la libre circulation entre Mayotte et le reste des Comores. Les Comoriens sont dès lors soumis au régime des visas.
an 1995 : Mozambique - En 1995, le Mozambique adhère au Commonwealth, devenant le premier membre de celui-ci à n’avoir jamais fait partie de l’Empire britannique. Le pays parie sur les bienfaits d'une intégration économique plus poussée avec les six Etats anglophones qui l'entourent, les tensions liées à l'apartheid notamment, devenant de l'histoire ancienne. En décembre 1999 se tiennent de nouvelles élections qui donnent encore la victoire au FRELIMO. Des irrégularités poussent le RENAMO à menacer un retour à la guerre civile, mais à la suite de sa défaite devant la cour suprême, il finit par y renoncer. À la fin des années 1990, le Mozambique bénéficie du processus d’allégement de la dette des pays les plus pauvres.
À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le pays fait appel à des agriculteurs blancs d'Afrique du Sud et du Zimbabwe pour relancer des exploitations agricoles ou redévelopper les cultures de tabac, de maïs, de soja, de piment, de tournesol. Le gouvernement leur proposa concrètement des terres à la location pour des périodes de 50 à 100 ans, le but étant de favoriser l'emploi local. En 2000, un cyclone tropical suivi d'une inondation dévaste le pays, provoquant la mort de plusieurs centaines de personnes.
an 1995-1998 : Rwanda - En 1995, le Premier ministre Faustin Twagiramungu démissionne. En 1998 il accuse le FPR d'avoir massacré 250 000 personnes.
L'un des problèmes les plus aigus après le génocide est de rendre la justice. Très vite ce sont 130 000 présumés génocidaires qui sont emprisonnés. Selon des associations humanitaires comme Amnesty International, les charges qui pèsent sur la majorité de ces détenus n'ont pas pu être vérifiées, les tribunaux étant débordés, et les droits de la défense ne peuvent être respectés dans ce contexte. Dans certains cas des avocats eux-mêmes génocidaires ont été inculpés. À la fin du génocide il ne restait qu'une petite dizaine de juges et l'administration judiciaire était complètement détruite. Beaucoup de rescapés vivent dans le voisinage des tueurs de leur famille. La question de la réconciliation est souvent mise en avant comme solution politique, très mal acceptée par les rescapés.
Les forces génocidaires qui se sont repliées au Zaïre, anciennes FAR et milices interahamwe, se livrent à des infiltrations violentes dans le nord-ouest du Rwanda. En 1996, le Rwanda s'allie avec l'Ouganda et les rebelles de l'Est du Zaïre. Selon les opposants, le groupe d'expert de l'ONU chargé d'étudier cette question, des universitaires, l'ancien ministre congolais Honoré Ngbada Nzambo, Pierre Péan et Stephen Smith, l'argument sécuritaire n'est qu'un prétexte pour contrôler l'Est du Congo, où vivent les banyamulenge, congolais rwandophones, et dont une partie a été une province rwandaise avant la fixation des frontières, en 1896.
La coalition militaire conquiert le Zaïre, quatre-vingt-dix fois plus grand que le Rwanda, et renverse en 1997 son président, Mobutu Sese Seko (voir les articles Première guerre du Congo puis Deuxième guerre du Congo).
Après la prolongation de la période de transition, plusieurs changements de premiers ministres, la démission du président de l'assemblée nationale, Pasteur Bizimungu démissionne en 2000.
an 1995 : Sao Tomé et Principe - Le 25 avril 1995, l'île de Príncipe proclama son autonomie; le 15 août suivant, un coup d'État militaire déposa le président Trovoada, mais celui-ci fut rétabli dans ses fonctions quelques jours après l'échec du putsch.
an 1996 : République de Centrafrique - La Centrafrique connait depuis le milieu des années 1990 un cycle de soulèvements politico-militaires qui ont profondément déstabilisé l’environnement politique du pays.
En 1996, le président élu Ange-Félix Patassé est menacé par une série de trois mutineries au sein des Forces armées centrafricaines (FACA), qui l’amènent à demander l’intervention de l’armée française.
Cette crise ouvre une période dans laquelle l’instabilité devient progressivement chronique dans le pays.
an 1996-1997 : Congo Kimshasa (anc. Zaïre) - En 1996, les tensions provenant de la guerre civile et du génocide des Tutsi au Rwanda se propagent au Zaïre. La milice Hutu rwandaise Interahamwe, ayant fui le Rwanda à la suite de l'installation d'un gouvernement Tutsi, s'est mise à utiliser les camps de réfugiés Hutus dans l'Est du Zaïre comme bases pour des raids contre le Rwanda.
Une manifestation anti-Banyamulenge (Tutsis congolais du Sud-Kivu).marque le début de la rébellion contre Mobutu, avec l'appui des pays voisins.
Le Rwanda disperse par la force les camps des réfugiés Hutus à la frontière et appelle à rentrer au pays. La majorité s'exécute, mais une partie, surtout les hommes en armes prennent la direction de l'ouest et la plupart d'entre eux disparaîtront dans la forêt, et une partie, tuée par l'armée rwandaise qui la poursuivait. Mobutu Sese Seko se fait soigner en Suisse, pendant que l'armée zaïroise brille par son absence dans la guerre contre la coalition anti-Mobutu pour la conquête du Zaïre.
Ces milices Hutu se sont vite associées avec les forces armées du Zaïre (FAZ) pour lancer une campagne contre les Tutsis congolais vivant dans l'Est du Zaïre.
Par la suite, une coalition des armées rwandaise et ougandaise, sous le couvert d'une petite milice Tutsi, a envahi le Zaïre afin de combattre la milice Hutu, de renverser le gouvernement de Mobutu et finalement, de prendre le contrôle des ressources minières du Zaïre. Ils ont été très vite rejoints par différents hommes politiques du Zaïre, qui s'étaient opposés pendant nombre d'années sans succès à la dictature de Mobutu et qui voyaient une opportunité pour eux dans l'invasion de leur pays par deux des plus fortes armées de la région.
Cette coalition de quatre rébellions agrandie de deux armées étrangères et des figures d'opposition de longue date, menée par Laurent-Désiré Kabila, prend le 25 octobre le nom d'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL). Leur objectif, de manière plus large, était de chasser Mobutu et de prendre le contrôle des richesses du pays.
À la fin des années 1990, les « juniors » canadiennes, investies dans plus de 8 000 propriétés minières, dans plus de 100 pays, pour la plupart encore à l'État de projet multiplient les contrats signés dans les zones de conflit de la république démocratique du Congo, même s'il reste compliqué d'extraire les métaux, cuivre et cobalt en raison des conflits.
Le 2 janvier 1997, Kinshasa annonce une réplique « foudroyante » contre les rebelles. Chute de Kisangani, troisième ville du pays le 15 mars. Le lendemain, Bruxelles estime que « l'époque Mobutu est révolue. »
Le 4 avril 1997, chute de Mbujimayi, capitale du diamant, et dans les jours qui suivent, chutes de Kananga, Kolwezi, Kikwit, Lisala.
Le 4 mai 1997, se tient un face-à-face entre Mobutu Sese Seko et Laurent-Désiré Kabila sur un bateau sud-africain, l'Outeniqa, au large de Pointe-Noire en république du Congo.
Le 17 mai 1997, les troupes de Laurent-Désiré Kabila entrent dans Kinshasa sans rencontrer de résistance. Kabila, depuis Lubumbashi, se déclare président du pays, qu'il rebaptise république démocratique du Congo. Mobutu, malade, trouve refuge à Gbadolite pour s'exiler ensuite au Maroc, où il décède en septembre à Rabat.
Quelques mois plus tard, le président Laurent-Désiré Kabila remercie toutes les forces armées étrangères qui l'ont aidé à renverser Mobutu, et leur demande de retourner dans leurs pays. Il avait peur que les officiers militaires rwandais qui commandaient son armée ne complotent un coup d'État contre lui dans le but de placer au pouvoir un Tutsi qui répondrait directement au président du Rwanda, Paul Kagame. Cette annonce n'a pas été bien accueillie par les gouvernements rwandais et ougandais, qui comptaient prendre le contrôle de leur grand voisin.
an 1996 : Érythrée - La Constitution érythréenne est ratifiée en juillet 1996, mais n'est toujours pas matériellement appliquée.
an 1996 : Leshoto - En janvier 1996, Letsie III succéda légitimement à son père à la suite de la mort de ce dernier mais c'était cette fois pour être le souverain d'une monarchie parlementaire.
an 1996 : Mali - Les collectivités s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus qui élisent en leur sein un organe exécutif. Le 16 octobre 1996, 684 communes rurales sont créées et viennent s’ajouter aux 19 communes urbaines existantes.
an 1996-2003 : Ouganda - En 1996, l'Ouganda joua un rôle déterminant dans le soutien à la rébellion de Laurent-Désiré Kabila lors de la première guerre du Congo qui aboutit à la chute du régime du président du Zaïre Mobutu Sese Seko. Entre 1998 et 2003, l'implication de l'armée ougandaise s'accrut dans ce qui était devenu la République Démocratique du Congo, pour devenir un protagoniste de la deuxième guerre du Congo et même ensuite, l'Ouganda continua de soutenir des groupes rebelles congolais, tel le Mouvement de Libération du Congo. L'Ouganda fut alors fréquemment accusé de se livrer au pillage du pays et au trafic de ses matières premières.
Afin d'éviter le déchirement de la société par des partis politiques organisés selon des lignes ethniques, un système sans parti dans lequel seul le NRM était censé représenter la population et au sein duquel les différentes politiques devaient être débattues fut adopté. Le NRM permit le retour des rois traditionnels du Buganda, de Toro et d'autres royaumes du pays.
En mai 1996, les premières élections présidentielles furent organisées : Museveni remporta alors 75,5 % des suffrages, tandis que son principal opposant Paul Ssemogerere, ancien représentant du Parti Démocratique (Democratic Party - DP, parti d'opposition lors du second gouvernement d'Obote) en remporta 22,3 %.
an 1996 : Réunion (Ile de la) - Le 1er janvier, le président de la République Jacques Chirac instaure l'égalité sociale avec la métropole.
an 1996 : Sao Tomé et Principe - Trovoada réélu en 1996, il échouait cependant à obtenir un troisième mandat aux élections de 2001, et c'est Fradique de Menezes qui était élu dès le premier tour avec plus de 56 % des suffrages exprimés.
an 1996-1999 : Togo - En 1996, les présidents ghanéens et sud-africains se rendent à Lomé et font étape au village natal du président, Pya. Les relations avec le Ghana de Jerry Rawlings s'améliorent grandement et le Togo établit même des relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud, notamment lors de la visite de Nelson Mandela en mars 1996.
La privatisation des filières du coton et des phosphates se poursuit.
Lors des nouvelles élection présidentielle du 21 juin 1998, le général Eyadéma est réélu avec 52,13 % des suffrages exprimés, mais le résultat est contesté par l'opposition (qui est désormais représenté par Gilchrist Olympio, fils de l'ancien président assassiné) et mis en doute par les observateurs de l'Union européenne.
En mai 1999, Amnesty International affirme, dans un rapport intitulé Le Règne de la terreur, que des centaines de personnes ont été exécutées extrajudiciairement et que leurs corps ont été jetés à la mer et dans la lagune de Bè, après la proclamation des résultats de l'élection de 1998. Lomé rejette les accusations auxquelles il n'y a eu aucune réponse.
Les différents partis politiques soutenant Gnassingbé Eyadéma et ceux de l'opposition signent un accord le 29 juillet 1999, afin d'enrayer la crise politique qui perdure depuis les années 1990. En effet, les partis d'opposition ont boycotté les législatives de mars 1999 en raison de la réélection contestée du président en juin 1998.
an 1996 : Zambie - En 1996, le MMD au pouvoir remporte les élections boycottées par l'opposition dans un contexte de faible participation
an 1997 : Angola - En 1997, un gouvernement d’union nationale est finalement formé avec Jonas Savimbi mais en 1998 les combats reprennent après que Savimbi eut dénoncé, selon lui, le manquement du MPLA à ses obligations. Le 28 août 1997, le Conseil de Sécurité des Nations unies impose des sanctions contre l’UNITA.
an 1997 : Afrique - les Comores - La crise politique sur fond de crise économique, a connu son apogée avec la crise séparatiste anjouannaise de 1997. Les autorités politiques et la population de l'île s'étaient soulevées contre le gouvernement central en prônant initialement le rattachement à la France, puis par la suite, simplement une indépendance voire une large autonomie. La France, n'a manifesté dans cette crise aucune volonté d'abandonner son autorité sur Mayotte, et n'a pas souhaité engager des discussions avec les autorités des îles rebelles qui auraient pu être interprétées comme une volonté de sa part de « naturaliser » ou de recoloniser les îles. Or la population de Mayotte souhaitait depuis longtemps déjà que soit renforcé l'attachement de l'île à la France. Une fois la crise au sein de l'Union terminée, le conseil général de l'île a adopté à l'unanimité une résolution demandant au gouvernement français d'organiser le référendum local nécessaire pour la départementalisation.
an 1997 : Canaries (Îles des) - Catastrophes : tremblement de terre de Tenerife en 1989 ; collision au-dessus de Tenerife, le 27 mars 1997, de deux Boeing 747 (248 morts).
an 1997 : Congo Brazzaville - Nguesso, installé en France, revient au Congo, et y est accueilli avec ferveur par ses partisans. La situation dégénère en guerre civile de mai 1997 à octobre 1997.
Le 15 octobre 1997, l'armée angolaise s'engage dans le conflit aux côtés de Sassou-Nguesso et fait pencher la balance en sa faveur. Le 15 octobre, les forces de Lissouba sont défaites. Pascal Lissouba et ses proches quittent le pays. Les forces de Sassou-Nguesso, appuyées, outre l'armée angolaise, par des soldats tchadiens et des mercenaires rwandais, contrôlent les principales villes du pays. Le nombre de morts de la guerre civile est estimé à environ 400 000. Des massacres sont perpétrés, en particulier dans la région du Pool.
Le 25 octobre 1997, Sassou-Nguesso se proclame président de la République et promulgue un acte fondamental qui aménage une transition de durée flexible. Il établit trois organes dirigeants : la présidence de la République, le gouvernement et le Conseil national de transition.
an 1997 : Eswatini (Swaziland) - Le royaume du Swaziland et le changement de nom en Eswatini - En 1997, le Mozambique et l'Afrique du Sud tentent sans succès de convaincre le roi de démocratiser le Swaziland.
an 1997 : Kenya - En novembre 1997, intervient une libéralisation des contraintes à la formation d'un parti politique. Leur nombre passe de onze à vingt-six. Quinze d'entre eux propose un candidat président aux élections générales du 29 décembre. Moi est réélu avec 40,12 % des votes valables mais le KANU n'obtient que 50,95 % des suffrages lors de l'élection législative. Neuf partis d'opposition obtiennent, au moins, un siège à l'Assemblée nationale.
an 1997-1998 : Libéria - Grâce au cessez-le-feu en vigueur, les Nations unies ont pu observer le déroulement des élections de juillet 1997, avec trois ans de retard sur le calendrier initial. Charles Taylor fait campagne avec un slogan resté célèbre : « Il a tué mon père, il a tué ma mère. Je vais voter pour lui », signifiant ainsi son intention en cas d'échec de remettre le pays à feu et à sang. Le 19 juillet 1997, il est élu président de la république du Liberia avec 75 % des voix.
Après avoir été intronisé, le 2 août 1997, ce nouveau président, Charles Taylor, forme un gouvernement et annonce la mise en œuvre de mesures de réconciliation et d'unité nationale. L'objectif principal de la MONUL semble avoir été atteint. En novembre 1997, le mandat de la MONUL s'étant achevé le 30 septembre, l'ONU crée le Bureau d'appui des Nations unies pour la consolidation de la paix au Liberia (BANUL), dirigé par un représentant du Secrétaire général. Sa tâche principale est d'aider le gouvernement à consolider la paix. En 1998, l'ECOMOG quitte le Liberia.
Toutefois, le gouvernement au pouvoir et les dirigeants de l'opposition se révèlent incapables de surmonter leurs différends. Entretemps, la promotion de la réconciliation nationale est affaiblie par les violations systématiques des droits de l'homme, l'exclusion et le harcèlement des opposants politiques et l'absence de réforme dans le secteur de la sécurité. Rien ne change vraiment pour la population, par rapport à la première guerre civile. Ces éléments contribuent à la reprise de la guerre civile au Liberia et poussent la communauté internationale à demander aux parties belligérantes de parvenir à un règlement négocié du conflit.
an 1997 - 1998 : Madagascar - La nouvelle élection présidentielle qui se termine le 31 janvier 1997 consacre le retour de Didier Ratsiraka au pouvoir pour cinq ans. En 1998, celui-ci organise un référendum renforçant le pouvoir présidentiel tout en procédant à la mise en place des « provinces autonomes » qui demeurent en fait sous son contrôle direct.
an 1997 : Mali - Des élections législatives ont lieu au Mali en 1997. Inscrites dans un processus électoral incluant l’élection présidentielle et les élections communales, elles se déroulent dans un climat tendu entre l’opposition et le pouvoir. Une révision du code électoral est votée quelques semaines avant le scrutin. Un premier tour, organisé dans la confusion le 13 avril 1997, est invalidé par la Cour constitutionnelle. Le refus du gouvernement d’interrompre le processus électoral comme demandé par l’opposition regroupée au sein du Collectif de l’opposition (Coppo) aggrave les tensions. Les élections ont finalement lieu les 20 juillet 1997 et 3 août 1997. Alors qu’une grande partie de l’opposition a appelé au boycott, le parti du président Alpha Oumar Konaré, l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice remporte largement les élections. L’approche des élections de 1997 crée un climat tendu entre la majorité et l’opposition. Le gouvernement tente de réformer la loi électorale pour créer une Commission électorale nationale indépendante (Ceni) chargée d’organiser les élections et modifier le mode de scrutin. L’opposition, qui craint que cette réforme renforce le parti au pouvoir saisi la Cour constitutionnelle qui censure le 25 octobre 1996 le projet de loi adopté par l’assemblée nationale. Le gouvernement présente un nouveau texte qui est adopté par l’Assemblée nationale le 14 janvier 1997. Trois jours plus tard, la Ceni est mise en place et prépare dans la précipitation les élections législatives dont le premier tour a lieu le 13 février 1997. Le scrutin se déroule dans la confusion, en raison notamment de l’absence de listes électorales fiables. L’opposition réclame l’annulation du scrutin, la suspension du processus électoral, la démission du gouvernement et la dissolution de la Ceni. La Cour constitutionnelle annule le scrutin mais le processus électoral se poursuit. L’opposition, qui se réunit au sein du Collectif des partis de l’opposition (Coppo), décide de boycotter les élections à venir. À l’élection présidentielle, le président Alpha Oumar Konaré se retrouve face à un seul candidat, Mamadou Maribatrou Diaby, candidat du petit Parti pour l'unité, la démocratie et le progrès (PUDP) et est réélu avec plus de 95 % des suffrages. Le 8 juin 1997, le président est investi pour un second mandat de cinq ans dans un climat tendu. Les élections législatives qui se tiennent en juillet sont elles aussi boycotté par une grande partie de l’opposition. Le scrutin qui se déroule dans un climat de violence donne la victoire à l’Adéma-Pasj qui obtient 128 des 147 sièges. Les violences se poursuivent avec notamment le lynchage d’un policier lors d’un meeting de l’opposition le 10 août 1997, entraînant l’arrestation des principaux chefs de l’opposition, Me Mountaga Tall, président du CNID, Almamy Sylla, président du collectif de l'opposition, Youssouf Traoré de l'UFDP, Seydou Badian Kouyaté de l'US-RDA, Mohamed Lamine Traoré, ancien ministre de l'Intérieur, chef du MIRIA, Fanta Diarra, présidente des femmes du Congrès national d'initiative démocratique (CNID).
an 1998 : République de Botswana -La présidence est transmise au vice-président, Festus Mogae, qui remporte ensuite l'élection de 1999 et est réélu en 2004.
an 1998 : Burkina Faso - Blaise Compaoré est réélu en 1998. Le Burkina Faso connaît aussi des mouvements d'émeutes : en 1998 après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo,
an 1998-1999 : Congo Brazzaville - Le retour de Denis Sassou-Nguesso. Après une période de relatif apaisement, le président Sassou met en place des instances provisoires de gouvernement, notamment le Conseil national de transition (CNT). Le conflit reprend à la fin de l'été 1998. La population des quartiers sud de Brazzaville doit fuir en décembre 1998.
Le pouvoir ne reprend le contrôle de la quasi-totalité du territoire qu'à l'automne 1999 ; une partie du Pool reste aux mains de la rébellion. À la fin de l'année, Sassou-Nguesso tente de relancer une politique dite de réconciliation nationale. Il signe des accords avec la république démocratique du Congo et le HCR pour le retour des réfugiés qui avaient fui la guerre civile en se réfugiant à Kinshasa. Au cours de ces retours, plusieurs centaines de disparitions ont été constatées par les familles et les observateurs internationaux. De nombreux réfugiés ont été exécutés par les forces de sécurité congolaises : c'est « l'affaire des disparus du Beach ». Le chiffre de 353 disparus est évoqué.
an 1998 : Congo Kimshasa - En février 1998, Tshisekedi est relégué au Kassaï, il sera libéré en juillet. Kabila nomme un chef d'état-major katangais à la place du Rwandais qui occupait ce poste, avant de remercier les soldats étrangers (juillet). Kinshasa rompt avec ses alliés rwandais et ougandais, et commence une rébellion contre Kabila, soutenue par Kigali, Kampala et Bujumbura. Le Zimbabwe, l'Angola, le Tchad et la Namibie interviennent militairement aux côtés de Kinshasa.
Deux mouvements rebelles apparaissent :
-
les troupes rwandaises se sont alors retirées jusqu'à Goma, d'où elles ont lancé une nouvelle milice, ou mouvement rebelle, baptisé Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), mené par les Tutsis pour combattre leur ancien allié, le président Kabila ;
-
pour contrebalancer le pouvoir et l'influence du Rwanda en RDC, les troupes ougandaises créent un autre mouvement rebelle, appelé Mouvement pour la Libération du Congo (MLC), mené par le chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba, fils du milliardaire congolais Jeannot Bemba Saolona.
Ces deux mouvements, soutenus par les troupes rwandaises et ougandaises, déclenchent la deuxième guerre du Congo en attaquant, le 2 août 1998, l'armée encore fragile de la RDC. Le conflit durera jusqu'en 2002.
Le 10 août 1998, le président Laurent-Désiré Kabila et quasiment l'ensemble de son gouvernement se retirent à Lubumbashi, où s'organise la résistance militaire. Resté à Kinshasa en ministre de la guerre, Didier Mumengi, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, lance le mot d'ordre de résistance populaire. Il invente le slogan « la Paix se gagne » et organise des Forces d'auto-défense populaire (FAP). Les mouvements rebelles et leurs alliés rwandais et ougandais échouent à Kinshasa. L'Angola, le Zimbabwe et la Namibie s'impliquent militairement du côté du gouvernement de Laurent-Désiré Kabila, pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC, pays membre comme eux du SADC (Communauté de développement d’Afrique australe). La guerre s'enlise à l'Est du pays.
an 1998-1999 : République de Botswana - En 1998, Masire se retire de la vie politique. Et celui qui assure l'intérim, Festus Mogae, ministre des finances, est élu président en 1999.
Le Parti démocratique remporte les élections législatives du 16 octobre 1999, obtenant 33 sièges sur les 40 que compte le Parlement.
an 1998-2003 : Érythrée - En mai 1998, une nouvelle guerre éclate entre l'Éthiopie et l'Érythrée sur le tracé de la frontière. Elle fait environ 100 000 morts. Le conflit cesse en 2000 avec les accords d'Alger qui conduisent au déploiement des casques bleus sans mettre fin aux tensions, le tracé de la frontière entre les deux États restant contesté par l'Éthiopie. Une commission indépendante de l'ONU a émis un arbitrage sur la question de la frontière en 2003, mais cette solution a été rejetée par l'Éthiopie.
En 2001, le gouvernement a censuré toute la presse privée, arguant que cette dernière était inféodée aux intérêts étrangers et menaçait l'intégrité et l'indépendance du pays. En 2002, tous les groupes religieux hors les quatre principaux (églises orthodoxe d'Érythrée, église luthérienne d'Érythrée, église catholique, islam) ont été interdits, ceci notamment afin de lutter contre l'influence politique pro-américaine des courants pentecôtistes.
L'Érythrée et l'Éthiopie se livrent une guerre par procuration en Somalie, l'Érythrée comptant parmi les principaux soutiens aux insurgés islamistes qui combattent l'invasion de l'armée éthiopienne.
an 1998-2009 : Éthiopie - Le FDRPE va faire face à quelques difficultés. En 1998, l'Érythrée envahit l'Éthiopie et déclenche une guerre qui va durer deux ans. Le conflit fait plus de 80 000 morts et voit la victoire des troupes éthiopiennes. Depuis les rapports restent difficiles entre les deux États. Le gouvernement central est également confronté à deux rébellions armées, le Front de libération oromo (FLO) et le Front national de libération de l'Ogaden (FNLO). Ce dernier est d'ailleurs soutenu par l'Union des tribunaux islamiques, un mouvement actif en Somalie où l'Éthiopie est intervenue, en soutien au gouvernement officiel de Mogadiscio, de 2006 à 2009.
En 2005, les élections générales voient la montée des partis politiques de l'opposition qui ont remporté de nombreux sièges au parlement national et aux conseils régionaux. Ceux-ci contestent toutefois ces résultats qui permettent au FDRPE de se maintenir au pouvoir. Des manifestations violentes éclatent à Addis-Abeba et plusieurs opposants sont arrêtés. Si les élections générales de 2010 suscitent une même passion avec un taux de participation de 90 %, les résultats ne confirment pas la tendance de 2005. Au contraire, le FDRPE et ses alliés remportent la quasi-totalité des sièges de la chambre basse tandis que l'opposition ne s'impose que dans deux circonscriptions. Cette écrasante victoire à 99 %, contestée par les opposants, renforce la présence du parti de Meles Zenawi dans toute l'Éthiopie. Enfin, ces élections se distinguent des précédentes par le calme et le climat serein dans lequel le processus se déroule.
an 1998-1999 : Guinée-Bissau - Après une tentative échouée de coup d'État contre le gouvernement en juin 1998, le pays tombe dans une brève mais violente guerre civile entre les forces restées fidèles à Vieira et celles du chef d'état-major de l'armée Ansoumane Mané, ancien compagnon d'arme du chef de l’État pendant la guerre d'indépendance. Les rebelles renversent finalement le gouvernement de João Vieira le 7 mai 1999 qui trouve refuge à l'ambassade du Portugal avant de s'exiler au Portugal.
an 1998 : Leshoto - En 1998, le pays était néanmoins au bord de la guerre civile à la suite d'élections contestées. Une intervention militaire de l'Afrique du Sud a tourné au fiasco, faisant une cinquantaine de morts parmi les militaires sud-africains et lésothiens, un nombre indéterminé de victimes civiles, et laissant la capitale Maseru en ruines.
an 1998 : Togo - Lors des élections de 1998, Eyadema est proche de la défaite face à Gilchrist Olympio, fils de Sylvanus Olympio. Il remporte cependant l’élection dans des conditions très controversées.
an 1998 : Rwanda - En 1998, Faustin Twagiramungu, opposant au président Habyarimana, Premier ministre de 1994 à 1995.
an 1998 : Soudan - En 1998, le Soudan est frappé par l’aviation américaine qui bombarde l’usine pharmaceutique d’El Shifa, dans la banlieue de Khartoum, accusée d'être un lieu de fabrication d'armes chimiques.
an 1999-2008 : Afrique du Sud - Thabo Mbeki succède à Nelson Mandela à la suite des élections générales de juin 1999, qui consacrent une nouvelle victoire de l'ANC (66,4 %), et l'effondrement du Nouveau Parti national (6,9 %), supplanté par le Parti démocratique (9,6 %). Les deux formations d'opposition s'unissent pour gouverner la province du Cap-Occidental avant de fusionner dans l'Alliance démocratique (DA)
À certains égards, la présidence Mbeki peut être considérée avoir commencé en 1994 car il disposait alors, en tant que premier vice-président, de pouvoirs normalement dévolus à un Premier ministre.
La normalisation constitutionnelle du régime sud-africain, notamment marquée par la promotion des femmes, se poursuit autour des principales institutions chargées de promouvoir la démocratie et l'État de droit. Durant les deux mandats qu'effectue Mbeki, le pays connait une croissance économique annuelle de 5 à 6 %, stimulée par la hausse du cours des matières premières, et l'amélioration des conditions sanitaires et d'hébergement dans les townships. Ainsi, plus de 1,5 million de logements sont construits pour les plus pauvres et plus de 70 % des foyers sont raccordés à l'eau et à l’électricité. Dans le contexte d'un monde dominé par le consensus de Washington, Thabo Mbeki maintient un contrôle rigoureux des dépenses de l'État et mène une politique économique libérale. Il lance également deux initiatives, majeures en Afrique, que sont le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) et le remplacement de l'Organisation de l'unité africaine en Union africaine (UA).
Cependant, le maintien de 10 % de la population dans une misère extrême, le chômage en hausse, estimé à près de 40 %, la forte progression de la criminalité, l'expansion de la pandémie du VIH, dont Mbeki nie le lien avec la maladie, la dégradation de l'état des routes, des hôpitaux publics et des écoles publiques, l'inefficacité de l'administration et la dégradation de la qualité de l'enseignement public s'affirment comme les grands points noirs de sa politique. Il échoue également dans ses tentatives de médiation entre la communauté internationale et certains États africains à l'exemple du Zimbabwe, restant silencieux sur les atteintes aux droits de l'homme et le trucage des élections commis par le gouvernement de Robert Mugabe.
Vers la fin de son mandat, le président Mbeki est accusé d'avoir perdu le contact avec le peuple, pour privilégier une nouvelle bourgeoisie noire, tout aussi repliée sur elle-même que le fut la bourgeoisie blanche. Les critiques politiques dénoncent même l'autoritarisme d'un gouvernement tiraillé entre son aile gauche et son aile droite. Ses relations avec son vice-président, Jacob Zuma, se détériorent, d'autant plus qu'il doit congédier ce dernier à la suite d'un scandale politico-judiciaire.
En 2007, Thabo Mbeki décide de se présenter de nouveau à la présidence de l'ANC, notamment pour contrer Jacob Zuma en pleine ascension. Lors de la conférence élective du président de l'ANC, qui se tient du 15 au 20 décembre 2007 à Polokwane, Jacob Zuma reçoit néanmoins le soutien de près des trois quarts des 3 900 délégués face à Thabo Mbeki. Le 18 décembre, Zuma est élu président de l'ANC alors que les proches de Thabo Mbeki sont, tour à tour, éliminés du bureau national du parti.
an 1999 : Algérie - La démission de Zéroual, en 1999, débouche sur l'élection présidentielle d'avril 1999. L'ancien ministre des Affaires étrangères Abdelaziz Bouteflika se présente comme candidat « indépendant », mais il est soutenu par l'armée117 et tous ses adversaires se retirent la veille du premier tour;
En 1999, l'élection d'Abdelaziz Bouteflika contribue à ramener l'ordre. Abdelaziz Bouteflika décide de maintenir sa candidature en remportant l'élection présidentielle avec un score de 74 %. Il s'engage dès lors à appliquer son programme qui s'articule autour de trois axes principaux : le retour de la paix à travers l'application de la concorde nationale, la réactivation de l'économie et le retour de l'Algérie sur la scène internationale.
an 1999 : Angola - En 1999, le MPLA tente alors le coup de grâce et déclenche une offensive militaire massive contre le quartier général de L’UNITA et ses principaux bastions. Les opérations se soldent par un succès général malgré la fuite de Savimbi. Le 22 février 2002, Jonas Savimbi, est finalement abattu lors d’un assaut de l’armée gouvernementale. Le 4 avril 2002, un nouvel accord de cessez-le-feu est signé, mettant officiellement et définitivement fin à 27 ans d’une guerre civile (1975-2002) qui a fait près de cinq cent mille morts et entraîné le déplacement de quatre millions de personnes.
an 1999 : Burkina Faso - En 1999, à la suite de la loi ivoirienne de 1998 sur le domaine foncier rural, un conflit foncier a lieu à Tabou, en Côte d'Ivoire, entre Burkinabés et Ivoiriens. 17 000 d'entre eux fuient au Burkina Faso.
En septembre 2000, de nouveau, un conflit foncier, à San-Pédro cette fois, provoque l'évacuation d'un millier de Burkinabés. Enfin, en 2001, à la suite de l'élection de Laurent Gbagbo, des émeutes se multiplient. 80 000 Burkinabés rentrent au Burkina Faso.
an 1999 : Congo Kimshasa - Pour tenter de rétablir la paix et l'intégrité du pays, l'ONU décide en 1999 l'envoi d'une mission internationale intérimaire de surveillance et de maintien de la paix, la MONUC, en attendant la présence d'appuis militaires de différents pays.
En mai 1999 intervient la première scission de la rébellion, qui sera suivi de plusieurs autres. En juillet-août, un accord de paix est signé à Lusaka, qui prévoit un Dialogue intercongolais pour jeter les bases d'un nouveau départ. Un premier combat rwando-ougandais a lieu sur le territoire congolais, à Kisangani. Kabila crée en novembre des unités d'auto-défense.
an 1999 à nos jours (2022) : Maroc - Règne de Règne de Mohammed VI
En 1999, Mohammed VI succède à Hassan II. L'une des premières mesures du nouveau roi est de démettre Driss Basri de sa fonction de ministre de l'Intérieur (qu'il occupait depuis 1979) mais de maintenir El Youssoufi à son poste de Premier ministre jusqu'en 2002. Succèdent au vieux leader de gauche, comme chefs du gouvernement, Driss Jettou puis Abbas El Fassi à partir des élections législatives de 2007 qui voient la victoire de l'Istiqlal.
Au début du XXIe siècle, le Maroc se trouve confronté à un certain nombre de crises et de défis : conflit de l'îlot Persil avec l'Espagne en 2002, terrorisme avec les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca, et celui du 28 avril 2011 à Marrakech, puis émeutes à Sidi Ifni en 2008 et à Taza en 2012, qui mettent en relief toutes les problématiques auxquelles le pays doit faire face. Par ailleurs, depuis fin 2016, la région du Rif connaît un mouvement de protestation à dominante sociale et identitaire, nommé le Hirak, et auquel prend part activement la jeunesse locale. Le Hirak rifain, imité dans d'autres régions du pays comme à Jerada, est réprimé et ses leaders condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement. L'année 2019 connaît des atteintes contre certains droits humains, malgré une volonté de l'Etat de poursuivre le développement socio-économique notamment le long de l'axe Tanger-Agadir.
Le Maroc est touché en 2011 par les remous du printemps arabe et connaît une série de manifestations populaires axées autour du mouvement du 20-Février. Le roi fait alors approuver une nouvelle Constitution par référendum, qui redéfinit entre autres le rôle du gouvernement et officialise l'usage de la langue amazigh au côté de l'arabe. Les élections législatives qui s'ensuivent sont remportées par les islamistes modérés du PJD. Abdel-Ilah Benkiran issu du PJD est nommé à la suite de ce scrutin chef d'un gouvernement de coalition avec le RNI, le Mouvement populaire et le PPS. Le PJD confirme sa forte présence au niveau local et régional à la suite des élections communales de 2015.Saâdeddine El Othmani remplace Benkiran à la tête du gouvernement en 2017.
Sur le plan extérieur, toujours en 2015, le Maroc participe officiellement à l'Opération Tempête décisive déclenchée par l'Arabie saoudite contre l'insurrection houthiste au Yémen. Mais avec la crise du Golfe, les relations du Maroc avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se dégradent, Ryad et Abou Dabi reprochant à Rabat une neutralité bienveillante en faveur du Qatar. Les rapports maroco-saoudiens se détériorent gravement, ce qui amène le Maroc à se retirer de la guerre saoudienne au Yémen au début de 2019 et à rappeler son ambassadeur aux Émirats en 2020. En 2016, Rabat opère un virage stratégique en direction de la Russie et de la Chine, après des visites royales dans ces pays. Le Maroc réintègre l'Union africaine en 2017 afin de retrouver sa dimension géopolitique continentale, et entreprend d'adhérer à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'intervention de la Turquie dans la guerre en Libye qui se complexifie et dans laquelle s'affrontent plusieurs belligérants extérieurs plonge l'environnement maghrébin dans l'incertitude, ce qui pousse le Maroc à adopter une ligne prudente et à réitérer son attachement aux accords de Skhirat qu'il a abrité. Pour prévenir une aggravation du conflit, les autorités marocaines organisent à Bouznika des négociations entre les différentes parties libyennes en vue de privilégier une solution politique. L'ouverture d'un consulat des Émirats arabes unis à Laâyoune en novembre 2020 signe une réconciliation spectaculaire avec Abou Dabi après une longue période de brouille et conforte la souveraineté marocaine sur le Sahara à l'échelle internationale. Néanmoins le Maroc subit durement la pandémie de Covid-19 de 2020, et ses retombées sur le plan sanitaire, économique et social.
an 1999 : Iles Maurice - Après la mort du chanteur et icône des créoles (descendants d'Africains), Kaya, le 21 février 1999, dans un poste de police et dans des circonstances suspectes, de violentes émeutes éclatent dans l'île. Elles entraînent très vite des représailles contre les cités ouvrières créoles dans les régions rurales à forte majorité hindoue.
Malgré ces tensions, le développement économique amorcé dans les années 1980 se poursuit, et le pays continue à intéresser les investisseurs en Afrique, pour sa compétitivité.
an 1999 : Mauritanie - Depuis 1999, plusieurs coups d'État tentent de renverser le président Ould Taya dont celui des islamistes des Cavaliers du changement en juin 2003. Le verdict du procès de ces putschistes est clément et inattendu puisque les condamnés évitent tous la peine de mort.
an 1999 : Namibie - Les élections générales de 1999 sont remportées par la SWAPO, qui renforce son emprise à chaque échéance électorale.
an 1999-2003 : Nigéria - En 1999, les premières élections démocratiques depuis 16 ans sont gagnées par Olusegun Obasanjo, qui est réélu lors des turbulentes élections de 2003.
an 1999 : Réunion (Ile de la) - la Réunion compte 700 000 habitants.
Suite voir Histoire contemporaine (2 000 à nos jours)
an 1600 : X
an 1700 : R
an 1006-1007 : A
an 1201 : B
an 1400 : Afr
an 2019 : Afrique du Sud -
an 20-28 : République
an 317-319 : Algérie - Bou
an 419 : Afrique du Sud -
an 520 : UNION AFRICAINE - Le
an 522 : Burkina Faso
Histoire contemporenne
an 2014 : Afrique du Sud -
an 600 : Burundi -
an 600 : Eswatini (Swaziland)
an 704-708 : République
an 806-807 : Algérie -
an 1810 : Burkina
an 2014 : Afrique du Sud -
2000 avant notre ère : Burundi -
an 2014 : Afrique du Sud -
an 2015 : Burkina Faso
an 2017-2019 : Algérie -
an 2019 : Afrique du Sud -
an 2020 : UNION AFRICAINE -
an 2022 : Burkina
an 2023 : Libéria -
an 2023 :
an 1400 : Afrique
an 1900 : Afrique
an 1700 : Al
an 1010 : B
an 1007 : Algérie -